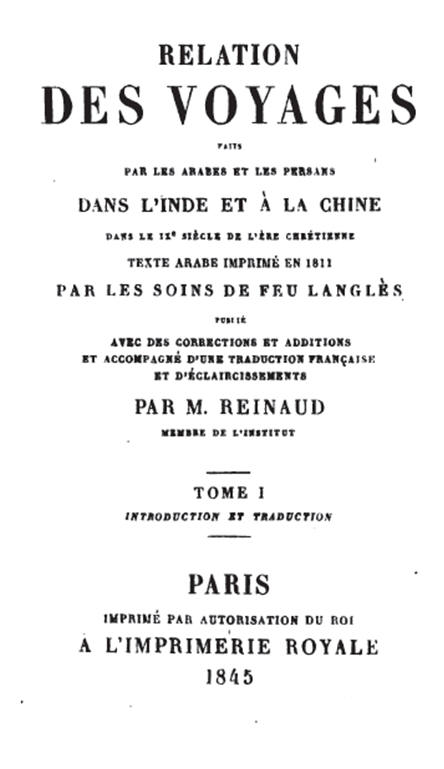
SOLEYMAN & ABOU ZEID HASSAN
ATTRIBUÉ A MASSOUDI
CHAINE DES CHRONIQUES.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
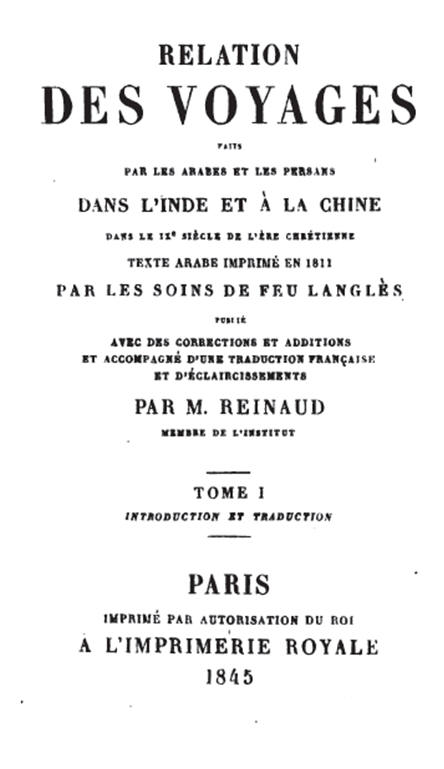
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Voici ce que dit Abou-Zeyd-Al-Hassan de Syraf:
J'ai lu avec attention ce livre, c'est-à-dire le premier livre, lequel j'avais été chargé d'examiner et d'accompagner des observations que j'avais recueillies dans mes lectures, au sujet des incidents de la navigation, des rois des contrées maritimes et de leurs particularités, en relevant tout ce que je savais à cet égard, dans les choses dont l'auteur de ce livre n'a point parlé. J'ai vu que ce livre avait été composé dans, l'année 237 (851 de J. C). Or, à cette époque, les choses qui tiennent à la mer étaient, parfaitement connues, à cause des nombreux voyages que les marchands de l'Irak faisaient dans les régions maritimes. J'ai donc trouvé tout ce qui est dit dans ce livre conforme à la vérité et à l'exactitude, excepté dans ce qui est rapporté (130) au sujet des aliments que les Chinois offrent à leurs parents morts, et dans ce qu'on ajoute, à savoir que, si on met pendant la nuit des aliments devant le mort, ils ont disparu le lendemain matin, ce qui autoriserait à croire que le mort les a mangés. On nous avait fait le même récit; mais il nous est venu de ces régions un homme sur les renseignements duquel on peut compter; et, comme nous l'interrogions à ce sujet, il a nié le fait et il a ajouté : « C'est une assertion sans fondement, c'est comme la prétention des idolâtres qui soutiennent que leurs idoles entrent en conversation avec eux. »
Mais, depuis la composition de ce livre, la situation des choses, particulièrement en Chine, a beaucoup changé. Des événements sont survenus qui ont fait cesser les expéditions dirigées (de chez nous) vert ces contrées, qui ont ruiné ce pays, qui en ont aboli les coutumes et qui ont dissous sa puissance. Je vais, s'il plaît à Dieu, exposer ce que j'ai lu relativement à ces événements.
Ce qui a fait sortir la Chine de la situation où elle se trouvait en fait de lois et de justice, et ce qui a interrompu les expéditions dirigées vers ces régions du port de Syraf, c'est l'entreprise d'un rebelle qui n'appartenait pas à la maison royale, et qu'on nommait Banschoua (131). Cet homme débuta par une conduite artificieuse et par l'indiscipline; puis il prit les armes et se mit à rançonner les particuliers; peu à peu les hommes mal intentionnés se rangèrent autour de lui; son nom devint redoutable, ses ressources s'accrurent, son ambition prit de l'essor, et, parmi les villes de la Chine qu'il attaqua, était Khanfou, port où les marchands arabes abordent Entre cette ville et la mer il y a une distance de quelques journées. Sa situation est sur une grande rivière, et elle est baignée par l'eau douce (132).
Les habitants de Khanfou ayant fermé leurs portes, le rebelle les assiégea pendant longtemps. Cela se passait dans le cours de l'année 264 (878 de J. C.). La ville fut enfin prise, et les habitants furent passés au fil de l'épée. Les personnes qui sont au courant des événements de la Chine rapportent qu'il périt en cette occasion cent vingt mille musulmans, juifs, chrétiens et mages, qui étaient établis dans la ville et qui y exerçaient le commerce, sans compter les personnes qui furent tuées d'entre les indigènes. On a indiqué le nombre précis des personnes de ces quatre religions qui perdirent la vie, parce que le gouvernement chinois prélevait sur elles un impôt d'après leur nombre. De plus, le rebelle fit couper les mûriers et les autres arbres qui se trouvaient sur le territoire de la ville. Nous nommons les mûriers en particulier, parce que la feuille de cet arbre sert à nourrir l'insecte qui fait la soie, jusqu'au moment où l'animal s'est construit sa dernière demeure. Cette circonstance fut cause que la soie cessa d'être envoyée dans les contrées arabes et dans d'autres régions.
Le rebelle, après la ruine de Khan-fou, attaqua les autres villes, l'une après l'autre, et les détruisit. Le souverain de la Chine n'était pas assez fort pour lui résister, et celui-ci finit par s'approcher de la capitale. Cette ville porte le nom de Khomdan (133). L'empereur s'enfuit vers la ville de Bamdou (134), située sur les frontières du Tibet et y établit son séjour.
La fortune du rebelle se maintint pendant quelque temps; sa puissance s'étendit. Son projet et son désir étaient de raser les villes et d'exterminer les habitants, vu qu'il n'appartenait pas à une famille de rois, et qu'il ne pouvait pas espérer de réunir toute l'autorité dans ses mains. Une partie de ses projets furent mis à exécution ; c'est ce qui fait que jusqu'à présent, nos communications avec la Chine sont restées interrompues.
Le rebelle conserva son ascendant jusqu'au moment où le souverain de la Chine se mit en rapport avec le roi des Tagazgaz, dans le pays des Turks. Les États de ce roi et ceux de la Chine étaient voisins, et il y avait alliance entre les deux familles (135). L'empereur envoya des députés à ce roi, pour le prier de le délivrer du rebelle. Le roi des Tagazgaz fit marcher son fils contre le rebelle, avec, une armée nombreuse et d'abondantes provisions (136). Une longue lutte commença; des combats terribles eurent lieu, et le rebelle fut enfin abattu. Quelques-uns ajoutent que le rebelle fut tué ; d'autres disent qu'il mourut de mort naturelle (137).
L'empereur de la Chine retourna alors vers sa capitale de Khomdan. La ville était en ruines; lui-même était réduit à une grande faiblesse; son trésor était épuisé, ses généraux avaient péri, les chefs de ses soldats et de ses braves étaient morts.
Outre cela, chaque province se trouvait au pouvoir de quelque aventurier, qui en percevait les revenus et qui ne voulait rien céder de ce qu'il avait dans les mains. L'empereur de la Chine se vit dans la nécessité de s'abaisser jusqu'à agréer les excuses de ces usurpateurs, moyennant quelques démonstrations d'obéissance que ceux-ci firent, et quelques vœux qu'ils prononcèrent pour le prince, bien que, d'ailleurs, ils ne tinssent aucun compte de ses droits en ce qui concerne les impôts, ni des autres prérogatives inhérentes à la souveraineté.
L'empire de la Chine se trouva dès lors dans l'état où fut jadis la Perse, quand Alexandre fit mourir Darius, et qu'il partagea les provinces de la Perse entre ses généraux (138). Les gouverneurs des provinces chinoises firent alliance les uns avec les autres, pour se rendre plus forts, et cela sans la permission ni l'ordre du souverain. A mesure qu'un d'entre eux en avait abattu un autre, il se saisissait de ses possessions ; il ne laissait rien debout dans le pays, et en mangeait tous les habitants. En effet, la loi chinoise permet de manger la chair humaine, et l'on vend publiquement cette chair dans les marchés (139). Les vainqueurs ne craignirent pas de maltraiter les marchands qui étaient venus commercer dans le pays. Bientôt l'on ne garda pas même de ménagements pour les patrons de navires (140) arabes, et les maîtres de bâtiments marchands furent en butte à des prétentions injustes; on s'empara de leurs richesses, et on se permit à leur égard des actes contraires à tout ce qui avait été pratiqué jusque-là. Dès ce moment le Dieu très haut retira ses bénédictions du pays tout entier; le commerce maritime ne fut plus praticable, et la désolation, par un effet de la volonté de Dieu, de qui le nom soit béni, se fit sentir jusque sur les patrons de navires et les agents d'affaires de Syraf et de l'Oman.
On a vu dans le premier livre un échantillon des mœurs de la Chine, et voilà tout. En Chine, un homme marié et une femme mariée qui commettent un adultère, sont mis à mort. Il en est de même des voleurs et des meurtriers. Voici de quelle manière on les fait mourir. On lie fortement les deux mains du condamné, et on les élève au-dessus de sa tête, de manière qu'elles s'attachent à son cou. Ensuite, on tire son pied droit et on l'introduit dans sa main droite; on introduit également son pied gauche dans sa main gauche; l'un et l'autre pied se trouvent ainsi derrière son dos, le corps entier se ramasse et prend la forme d'une boule. Dès ce moment, le condamné n'a plus de chance de s'échapper, et on est dispensé de commettre quelqu'un à sa garde. Bientôt, le cou se sépare des épaules; les sutures du dos se déchirent, les cuisses se disloquent, et les parties se mêlent ensemble; la respiration devient difficile, et le patient tombe dans un tel état, que, si on le laissait dans cette situation une portion d'heure, il expirerait. Quand on i'a mis dans l'état qu'on voulait, on le frappe, avec un bâton destiné à cet usage, sur les parties du corps dont la lésion est mortelle; le nombre des coups est déterminé, et il n'est pas permis de le dépasser. Il ne reste plus alors au condamné que le souffle, et on le remet à ceux qui doivent le manger.
Il y a, en Chine, des femmes qui ne veulent pas s'astreindre à une vie régulière, et qui désirent se livrer au libertinage. L'usage est que ces femmes se rendent à l'audience du chef de la police, et qu'elles lui fassent part de leur dégoût pour une vie retirée et de leur désir d'être admises au nombre des courtisanes, se soumettant d'avance aux devoirs imposés aux femmes de cette classe. En pareil cas, on écrit le nom de la femme et le nom de son père; on prend son signalement et on marque le lieu de sa demeure; elle est inscrite au bureau des prostituées. On lui attache au cou un fil auquel pend un cachet de cuivre qui porte l'empreinte du sceau royal; enfin, on lui remet un diplôme dans lequel il est dit que cette femme est admise au nombre des prostituées, qu'elle payera, tous les ans, au trésor public, une telle somme, en pièces de cuivre, et que tout somme qui l'épouserait sera mis à mort. Des ce moment cette femme paye, tous les ans, la somme qui a été fixée, et personne n'a plus la faculté de la molester.
Cette espèce de femmes sortent le soir, sans se couvrir d'un voile, et portent des étoffes de couleur; elles s'approchent des étrangers nouvellement arrivés dans le pays, notamment des gens corrompus et dépravés, et aussi des habitants du pays. Elles passent la nuit chez eux, et elles s'en retournent le lendemain matin. Louons Dieu de ce qu'il nous a préservés d'une pareille infamie.
La coutume des Chinois, de faire leurs achats et leurs ventes en pièces de cuivre, vient de l'inconvénient attaché à l'usage des pièces d'or et d'argent. Ils disent que, si un voleur parvient à s'introduire dans la maison d'un Arabe, qui est dans l'usage de faire ses transactions en pièces d'or et d'argent, il a la chance d'emporter sur son dos jusqu'à dix mille pièces d'or, ou le même nombre de pièces d'argent, ce qui suffit pour consommer la ruine de l'Arabe. Qu'un voleur, au contraire, s'introduise dans la maison d'un Chinois; il ne pourra pas emporter plus de dix mille pièces de cuivre; ce qui équivaut à dix mitscals d'or seulement (141).
Ces pièces de cuivre, que nous nommons folous (142), sont faites avec du cuivre et d'autres métaux (143) fondus ensemble. Elles sont de la grandeur de ce que nous appelons un dirhem bagly. Au milieu est un large trou par lequel on fait passer une ficelle. Mille de ces pièces équivalent à un mitscal d'or. Une seule ficelle enfile mille de ces pièces; mais à chaque cent l'on fait un nœud. Quand un homme achète une ferme, ou une marchandise, ou des légumes et des objets au-dessus, il donne un certain nombre de ces pièces, suivant la valeur de l'objet. On trouve de ces pièces à Syraf ; ces pièces portent des mots écrits en chinois (144).
A l'égard des incendies qui ont lieu en Chine, de la manière de bâtir les maisons et de ce qui a déjà été dit à ce sujet, les villes sont, dit-on, construites en bois et avec des roseaux disposés en treillage, à la manière des ouvrages qu'on fait chez nous avec des roseaux fendus. On enduit le tout d'argile et d'une pâte particulière à la Chine, qui est faite de graines de chanvre (145). Cette pâte est aussi blanche que le lait; on en enduit les murs, et ils jettent un éclat admirable.
Les maisons, en Chine, n'ont pas d'escalier, parce que les richesses des Chinois, leurs trésors et tout ce qu'ils possèdent, sont placés dans des caisses montées sur des roues et qu'on peut faire rouler. Lorsque le feu prend à une maison, on met en mouvement ces caisses avec ce qui y est renfermé, et il n'y a pas d'escalier qui empêche de s'éloigner avec rapidité (146).
Ce qui concerne les eunuques a été indiqué d'une manière bien brève (147). Les eunuques sont spécialement chargés de la perception de l'impôt et de tout ce qui tient aux revenus publics. Parmi eux, il y en a qui ont été amenés captifs des régions étrangères, et qui ont été faits, plus tard, eunuques; il en est d'autres qui sont nés en Chine, et que leurs parents eux-mêmes ont mutilés pour les offrir au souverain, afin de capter par là sa bienveillance. En effet, les affaires de l'empire et ses trésors sont entre les mains des gens de la cour (148). Les officiers qui sont envoyés par l'empereur vers la ville de Khanfou, port où affluent les marchands arabes, sont des eunuques. L'usage de ces eunuques, et des gouverneurs des villes en général, est, quand ils montent à cheval, de se faire précéder par des hommes qui tiennent à la main quelques pièces de bois semblables aux crécelles (des chrétiens), et qui les frappent l'une contre l'autre. Le bruit qui en résulte s'entend de fort loin. Aussitôt les habitants s'éloignent du chemin par où doit passer l'eunuque ou le gouverneur; celui qui est sur la porte d'une maison se hâte d'entrer et de fermer la porte sur lui. Cet état dure jusqu'après le passage de l'eunuque ou de l'homme préposé au gouvernement de la ville. Aucun homme du peuple n'oserait rester sur le chemin, et cela par un effet de la crainte et de la terreur qu'inspirent les hauts fonctionnaires; car ceux-ci tiennent à ce que le peuple ne prenne pas l'habitude de les voir, et à ce que personne ne pousse la hardiesse jusqu'à leur adresser la parole.
Le costume des eunuques et des principaux officiers de l'armée est en soie de la première qualité ; on n'apporte pas de soie aussi belle dans le pays des Arabes. Cette soie est très recherchée des Chinois, et ils la payent un prix très élevé. Un des marchands les plus considérables et dont le témoignage ne comporte pas de doute, raconte que, s'étant présenté devant l'eunuque envoyé par l'empereur dans la ville de Khanfou, pour choisir les marchandises venues du pays des Arabes et qui convenaient au prince, il vit sur sa poitrine un signe naturel, qui se distinguait à travers les robes de soie dont il était couvert. Son opinion était que l'eunuque avait mis deux robes l'une sur l'autre; mais, comme il tournait continuellement les yeux du même côté, l'eunuque lui dit: « Je vois que tu tiens tes yeux fixés sur ma poitrine ; pourquoi cela ? » Le marchand lui répondit : « J'admirais comment le signe qui est sur ta peau pouvait se distinguer à travers les deux robes qui couvrent ta poitrine. » Là-dessus, l'eunuque se mit à rire et jeta la manche de sa tunique du côté du marchand, disant : « Compte le nombre des robes que j'ai sur moi. » Le marchand le fit, et il compta jusqu'à cinq cabas (149) placés l'un sur l'autre, et à travers lesquels on distinguait le signe. La soie dont il s'agit ici est une soie écrue et qui n'a pas été foulée. La soie que portent les princes est encore plus fine et plus admirable (150).
Les Chinois sont au nombre des créatures de Dieu qui ont le plus d'adresse dans la main, en ce qui concerne le dessin, l'art de la fabrication, et pour toute espèce d'ouvrages ; ils ne sont, à cet égard, surpassés par aucune nation. En Chine, un homme fait avec sa main ce que vraisemblablement personne ne serait en état de faire. Quand son ouvrage est fini, il le porte au gouverneur, demandant une récompense pour le progrès qu'il a fait faire à l'art. Aussitôt le gouverneur fait placer l'objet à la porte de son palais, et on l'y tient exposé pendant un an. Si, dans l'intervalle, personne ne fait de remarque critique, le gouverneur récompense l'artiste et l'admet à son service; mais, si quelqu'un signale quelque défaut grave, le gouverneur renvoie l'artiste et ne lui accorde rien. Un jour, un homme représenta, sur une étoffe de soie, un épi sur lequel était posé un moineau ; personne, en voyant la figure, n'aurait douté que ce ne fût un véritable épi et qu'un moineau était réellement venu se percher dessus. L'étoffe resta quelque temps exposée. Enfin, un bossu étant venu à passer, il critiqua le travail. Aussitôt on l'admit auprès du gouverneur de la ville; en même temps on fit venir l'artiste; ensuite on demanda au bossu ce qu'il avait à dire; le bossu dit : « C'est un fait admis par tout le monde, sans exception, qu'un moineau ne pourrait pas se poser sur un épi sans le faire ployer; or l'artiste a représenté l'épi droit et sans courbure, et il a figuré un moineau perché dessus; c'est une faute. » L'observation fut trouvée juste, et l'artiste ne reçut aucune récompense.
Le but des Chinois, dans cela et dans les choses du même genre, est d'exercer le talent des artistes, et de les forcer à réfléchir mûrement sur ce qu'ils entreprennent et à mettre tous leurs soins aux ouvrages qui sortent de leurs mains.
Il y avait, à Bassora, un homme de la tribu des Coreyschytes, appelé Ibn-Vahab, et qui descendait de Habbar, fils de Al-asvad (151). La ville de Bassora ayant été ruinée (152), Ibn-Vahab quitta le pays et se rendit à Syraf. En ce moment un navire se disposait à partir pour la Chine. Dans de telles circonstances, il vint à Ibn-Vahab l'idée de s'embarquer sur ce navire. Quand il fut arrivé en Chine, il voulut aller voir le roi suprême. Il se mit donc en route pour Khomdan, et, du port de Khanfou à la capitale, le trajet fut de deux mois. Il lui fallut attendre longtemps à la porte impériale, bien qu'il présentât des requêtes et qu'il s'annonçât comme étant issu du même sang que le prophète des Arabes. Enfin l'empereur fit mettre à sa disposition une maison particulière, et ordonna de lui fournir tout ce qui lui serait nécessaire. En même temps il chargea l'officier qui le représentait à Khanfou de prendre des informations, et de consulter les marchands au sujet de cet homme, qui prétendait être parent du prophète des Arabes, à qui Dieu puisse être propice! Le gouverneur de Khanfou annonça, dans sa réponse, que la prétention de cet homme était fondée. Alors l'empereur l'admit auprès de lui, lui fit des présents considérables, et cet homme retourna dans l'Irak avec ce que l'empereur lui avait donné.
Cet homme était devenu vieux (153); mais il avait conservé l'usage de toutes ses facultés. Il nous raconta que, se trouvant auprès de l'empereur, le prince lui fit des questions au sujet des Arabes, et sur les moyens qu'ils avaient employés pour renverser l'empire des Perses. Cet homme répondit : « Les Arabes ont été vainqueurs par le secours de Dieu, de qui le nom soit célébré, et parce que les Perses, plongés dans le culte du feu, adoraient le soleil et la lune, de préférence au Créateur. » L'empereur reprit : « Les Arabes ont triomphé, en cette occasion, du plus noble des empires, du plus vaste en terres cultivées, du plus abondant en richesses, du plus fertile en hommes intelligents, de celui dont la renommée s'étendait le plus loin. » Puis il continua : « Quel est, dans votre opinion, le rang des principaux empires du monde? » L'homme répondit qu'il n'était pas au courant de matières semblables. Alors l'empereur ordonna à l'interprète de lui dire ces mots : « Pour nous, nous comptons cinq grands souverains (154). Le plus riche en provinces est celui qui règne sur l'Irak, parce que l'Irak est situé au milieu du monde, et que les autres rois sont placés autour de lui. Il porte, chez nous, le titre de roi des rois (155). Après cet empire vient le nôtre. Le souverain est surnommé le roi des hommes, parce qu'il n'y a pas de roi sur la terre qui maintienne mieux l'ordre dans ses Etats que nous, et qui exerce une surveillance plus exacte; il n'y a pas non plus de peuple qui soit plus soumis à son prince que le nôtre. Nous sommes donc réellement les rois des hommes. Après cela vient le roi des bêtes féroces, qui est le roi des Turks, et dont les États sont contigus à ceux de la Chine (156). Le quatrième roi en rang est le roi des éléphants, c'est-à-dire le roi de l'Inde. On le nomme chez nous le roi de la sagesse, parce que la sagesse tire son origine des Indiens. Enfin vient l'empereur des Romains, qu'on nomme chez nous le roi des beaux hommes (157), parce qu'il n'y a pas sur la terre de peuple mieux fait que les Romains, ni qui ait la figure plus belle. Voilà quels sont les principaux rois, les autres n'occupent qu'un rang secondaire. »
L'empereur ordonna ensuite à l'interprète de dire ces mots à l'Arabe : « Reconnaîtrais-tu ton maître, si tu le voyais?» L'empereur voulait parler de l'apôtre de Dieu, à qui Dieu veuille bien être propice. Je répondis : « Et comment pourrais-je le voir, maintenant qu'il se trouve auprès du Dieu très haut? » L'empereur reprit: « Ce n'est pas ce que j'entendais. Je voulais parler seulement de sa figure. » Alors l'Arabe répondit oui. Aussitôt l'empereur fit apporter une boîte, il plaça la boite devant lui; puis, tirant quelques feuilles, il dit à l'interprète : « Fais-lui voir son maître. » Je reconnais sur ces pages les portraits des prophètes ; en même temps, je fis des vœux pour eux, et il s'opéra un mouvement dans mes lèvres. L'empereur ne savait pas que je reconnaissais ces prophètes; il me fit demander par l'interprète pourquoi j'avais remué les lèvres. L'interprète le fit, et je répondis : « Je priais pour les prophètes. » L'empereur demanda comment je tes avais reconnus, et je répondis : « Au moyen des attributs qui les distinguent. Ainsi, voilà Noé, dans l'arche, qui se sauva avec sa famille, lorsque le Dieu très haut commanda aux eaux, et que toute la terre fut submergée avec ses habitants; Noé et les siens échappèrent seuls au déluge. » A ces mots, l'empereur se mit à rire et dit : « Tu as deviné juste lorsque tu as reconnu ici Noé; quant à la submersion de la terre entière, c'est un fait que nous n'admettons pas. Le déluge n'a pu embrasser qu'une portion de la terre ; il n'a atteint ni notre pays ni celui de l'Inde (158). » Ibn Vahab rapportait qu'il craignit de réfuter ce que venait de dire l'empereur et de faire valoir les arguments qui étaient à sa disposition, vu que le prince n'aurait pas voulu les admettre; mais il reprit: « Voilà Moïse et son bâton, avec les enfants d'Israël. » L'empereur dit : « C'est vrai; mais Moïse se fit voir sur un bien petit théâtre, et son peuple se montra mal disposé à son égard. » Je repris : « Voilà Jésus, sur un âne, entouré des apôtres. » L'empereur dit : « Il a eu peu de temps à paraître sur la scène. Sa mission n'a guère duré qu'un peu plus de trente mois. »
Ibn Vahab continua à passer en revue les différents prophètes; mais nous nous bornons à répéter une partie de ce qu'il nous dit. Ibn Vahab ajoutait qu'au-dessus de chaque figure de prophète on voyait une longue inscription, qu'il supposa renfermer le nom des prophètes, le nom de leur pays et les circonstances qui accompagnèrent leur mission. Ensuite il poursuivit ainsi : « Je vis la figure du prophète, sur qui soit la paix! Il était monté sur un chameau, et ses compagnons étaient également sur leur chameau, placés autour de lui. Tous portaient à leurs pieds des chaussures arabes ; tous avaient des cure-dents attachés à leur ceinture. M’étant mis à pleurer, l'empereur chargea l'interprète de me demander pourquoi je versais des larmes, je répondis : « Voilà notre prophète, notre seigneur et mon cousin, sur lui soit la paix ! » L'empereur répondit : « Tu as dis vrai ; lui et son peuple ont élevé le plus glorieux des empires. Seulement il n'a pu voir de ses yeux l'édifice qu'il avait fondé; l'édifice n'a été vu que de ceux qui sont venus après lui. » Je vis un grand nombre d'autres figures de prophètes dont quelques-unes faisaient signe de la main droite, réunissant le pouce et l'index, comme si, en faisant ce mouvement, elles voulaient attester quelque vérité (159). Certaines figures étaient représentées debout sur leurs pieds, faisant signe avec leurs doigts vers le ciel. Il y avait encore d'autres figures; l'interprète me dit que ces figures représentaient les prophètes de la Chine et de l'Inde (160). » « Ensuite l'empereur m'interrogea au sujet des califes et de leur costume, ainsi que sur un grand nombre de questions de religion, de mœurs et d'usages, suivant qu'elles se trouvaient à ma portée; puis il ajouta : « Quelle est, dans votre opinion, l'âge du monde? » Je répondis: « On ne s'accorde pas à cet égard. Les uns disent qu'il a six mille ans, d'autres moins, d'autres plus ; mais la différence n'est pas grande. » Là-dessus, l'empereur se mit à rire de toutes ses forces. Le vizir qui était debout auprès de lui témoigna aussi qu'il n'était pas de mon avis. L'empereur me dit : « Je ne présume pas que votre prophète ait dit cela. » Là-dessus la langue me tourna, et je répondis : « Si, il l'a dit. » Aussitôt je vis quelques signes d'improbation sur sa figure ; il chargea l'interprète de me transmettre ces mots: « Fais attention à ce que tu dis; on ne parie aux rois qu'après avoir bien pesé ce qu'on va dire. Tu as affirmé que vous ne vous accordez pas sur cette question ; vous êtes donc en dissidence au sujet d'une assertion de votre prophète, et vous n'acceptez pas tout ce que vos prophètes ont établi. Il ne convient pas d'être divisé dans des cas semblables ; au contraire, des affirmations pareilles devraient être admises sans contestation. Prends donc garde à cela et ne commets plus la même imprudence. »
L'empereur dit encore beaucoup de choses qui sont échappées de ma mémoire, à cause de la longueur du temps qui s'est écoulé dans l'intervalle; puis il ajouta : « Pourquoi ne t'es-tu pas rendu de préférence auprès de ton souverain, qui se trouvait bien mieux à ta portée que nous pour la résidence et pour la race ? » Je répondis: « Bassora, ma patrie, était dans la désolation ; je me trouvais à Syraf ; je vis un navire qui allait mettre à la voile pour la Chine; j'avais entendu parler de l'éclat que jette l'empire de la Chine, et de l'abondance des biens qu'on y trouve. Je préférai me rendre dans cette contrée et la voir de mes yeux. Maintenant je m'en retourne dans mon pays, auprès du monarque mon cousin (161); je raconterai au monarque l'éclat que jette cet empire, et dont j'ai été témoin. Je lui parlerai de la vaste étendue de cette contrée, de tous les avantages dont j'y ai joui, de toutes les bontés qu'on y a eues pour moi. » Ces paroles firent plaisir à l'empereur ; il me fit donner un riche présent; il voulut que je m'en retournasse à Khanfou sur les mulets de la poste (162). Il écrivit même au gouverneur de Khanfou, pour lui recommander d'avoir des égards pour moi, de me considérer plus que tous les fonctionnaires de son gouvernement, et de me fournir tout ce qui me serait nécessaire jusqu'au moment de mon départ. Je vécus dans l'abondance et la satisfaction, jusqu'à mon départ de la Chine. »
Nous questionnâmes Ibn Vahab au sujet de la ville de Khomdan, où résidait l'empereur, et sur la manière dont elle était disposée. Il nous parla de l'étendue de la ville et du grand nombre de ses habitants. La ville, nous dit-il, est divisée en deux parties qui sont séparées par une rue longue et large. L'empereur, le vizir, les troupes, le cadi des cadis, les eunuques de la cour et toutes les personnes qui tiennent au gouvernement occupent la partie droite et le côté de l'Orient. On n'y trouve aucune personne du peuple, ni rien qui ressemble à un marché. Les rues sont traversées par des ruisseaux et bordées d'arbres; elles offrent de vastes hôtels. La partie située à gauche, du côté du couchant, est destinée au peuple, aux marchands, aux magasins et aux marchés. Le matin, quand le jour commence, on voit les intendants du palais impérial, les domestiques de la cour, les domestiques des généraux et leurs agents entrer à pied ou à cheval dans la partie de la ville où sont les marchés et les boutiques; on les voit acheter des provisions et tout ce qui est nécessaire à leur maître; après cela, ils s'en retournent, et l'on ne voit plus aucun d'eux dans cette partie de la ville jusqu'au lendemain matin (163). La Chine possède tous les genres d'agrément; on y trouve des bosquets charmants, des rivières qui serpentent au travers ; mais on n'y trouve pas le palmier.
On raconte en ce moment un fait dont nos ancêtres n'avaient aucune idée. Personne, jusqu'ici, n'avait supposé que la mer qui baigne la Chine et l'Inde était en communication avec la mer de Syrie; une pareille chose eût paru incroyable jusqu'à ces derniers temps. Or nous avons entendu dire qu'on vient de trouver dans la mer Méditerranée (mer de Roum ou mer du pays des Romains) des pièces d'un navire arabe qui se composait de parties cousues ensemble. Ce navire s'était brisé avec son équipage ; les vagues l'avaient mis en pièces, et les vents, par l'entremise des vagues, avaient poussé ses débris dans la mer des Khazar (la mer Caspienne). De là les débris avaient été jetés dans le canal de Constantinople, d'où ils étaient arrivés dans la mer de Roum et la mer de Syrie. Ce fait montre que la mer tourne la Chine, les îles de Syla, le pays des Turks et des Khazar; ensuite elle se jette dans le canal de Constantinople, et communique avec la mer de Syrie. En effet, il n'y a que les navires de Syraf dont les pièces soient cousues ensemble ; les navires de Syrie et du pays de Roum sont fixés avec des clous, et non avec des fils (164).
On nous a raconté, de plus, qu'il a été trouvé de l'ambre dans la mer de Syrie. C'est une des choses qui paraissent incroyables, et dont on ne connaissait pas autrefois d'exemple. Pour que ce qu'on à raconté à cet égard fût vrai, il faudrait que l'ambre dont on parle fût arrivé dans la mer de Syrie par la mer d'Aden et de Colzom (la mer Rouge) ; en effet, la dernière de ces mers est en communication avec les mers dans lesquelles se forme l'ambre. Mais le Dieu très haut n'a-t-il pas dit qu'il avait élevé une barrière entre les deux mers (la mer Rouge et la mer Méditerranée (165)? Si donc le récit qu'on fait est vrai, il faut supposer que l'ambre trouvé dans la mer Méditerranée fait partie de l'ambre que la mer de l'Inde jette dans les autres mers, de manière que cet ambre, allant d'une mer à l'autre, sera arrivé jusque dans la mer de Syrie (166).
Nous commençons par la mention de la ville du Zabedj (Medinet-Al-zâbedj), vu que sa situation est en face de la Chine, et qu'entre cette ville et la Chine il y a la distance d'un mois de marche, par mer, et même moins que cela, lorsque le vent est favorable.
Le roi du Zabedj porte le titre de maharadja (le grand radja). On dit que sa capitale a neuf cents parasanges de superficie (168). Ce prince règne sur un grand nombre d'îles, qui s'étendent sur une distance de mille parasanges et même davantage. Au nombre de ses possessions sont l'île appelée Sarbaza (169), dont la superficie est, à ce qu'on dit, de quatre cents parasanges, et l'île nommée Alrâmy (170), qui a huit cents parasanges de superficie. On trouve dans cette dernière île le bois de Brésil (baccam), le camphre, etc. Le roi du Zabedj compte encore parmi ses possessions l'île de Kalah, qui est située à mi-chemin entre les terres de la Chine et le pays des Arabes (171). La superficie de nie de Kalah est, à ce qu'on dit, de quatre-vingts parasanges. Kalah est le centre du commerce de l'aloès, du camphre, du sandal, de l'ivoire, du plomb alcaly (172), de l'ébène, du bois de Brésil, des épiceries de tous les genres, et d'une foule d'objets qu'il serait trop long d'énumérer. C'est là que se rendent maintenant les expéditions qui se font de l'Oman ; c'est de là que partent les expéditions qui se font pour le pays des Arabes.
L'autorité du Maba-radja s'exerce sur ces diverses îles. L'île dans laquelle il réside est extrêmement fertile, et les habitations s'y succèdent sans interruption. Un homme, dont la parole mérite toute croyance, a affirmé que, lorsque les coqs, dans les États du Zabedj, comme dans nos contrées, chantent le matin pour annoncer l'approche du jour, ils se répondent les uns aux autres, sur une étendue de cent parasanges et au delà. Cela tient à la suite non interrompue des villages et à leur succession régulière (173). En effet, il n'y a pas de terres désertes dans cette île; il n'y a pas d'habitations en ruines. Celui qui va dans ce pays, lorsqu'il est en voyage et qu'il est sur une monture, marche tant qu'il lui fait plaisir; et, s'il est ennuyé, ou si la monture a de la peine a continuer la route, il est libre de s'arrêter où il veut.
Une des choses les plus singulières qu'on nous a racontées sur l'île du Zabedj, est celle qui concerne un de ses anciens rois. Ce roi était appelé le Maharadja. Son palais était tourné vers un tseladj qui prenait naissance i la mer, et l'on entend par tseladj un actuaire semblable à celui que forme le Tigre qui passe devant Bagdad et Bassora, actuaire qu'envahit l'eau salée de la mer, au moment du flux, et où l'eau est douce au moment du reflux. L'eau formait un petit étang attenant au palais du roi. Le matin de chaque jour, l'intendant se présentait devant le roi et lui offrait un lingot d'or en forme de brique; chaque brique pesait un certain nombre de mannas dont la somme ne m'est pas connue. Ensuite, l'intendant jetait cette brique, en présence du roi, dans l'étang. Au moment du flux, l'eau couvrait cette brique et les autres briques qui y étaient entassées, et on ne distinguait plus rien ; mais, quand l'eau s'était retirée, on apercevait les briques, et elles jetaient un grand éclat aux rayons du soleil. Le roi, lorsqu'il donnait audience, se plaçait dans une salle qui dominait l'étang, et il avait le visage tourné vers l'eau.
Cet usage ne souffrait pas d'interruption ; chaque jour on jetait une brique d'or dans l'étang, et, tant que le roi vivait, on ne touchait jamais à ces briques. Mais, à sa mort, son successeur faisait retirer toutes ces briques sans en laisser aucune. On les comptait, on les faisait fondre, puis on distribuait l'or aux princes de la famille royale, hommes et femmes, à leurs enfants, à leurs officiers, à leurs eunuques, à proportion de leur rang et des prérogatives attachées aux diverses fonctions. Ce qui restait était distribué aux pauvres et aux malheureux. On avait eu soin d'enregistrer les briques d'or et leur poids total. Une note portait que tel roi qui avait régné à telle époque et tel nombre d'années, avait fait jeter dans l'étang royal un tel nombre de briques d'or, pesant tant; qu'après sa mort, ces briques avaient été partagées entre les princes de la famille royale. Or l'honneur était réservé pour le roi dont le règne s'était prolongé le plus longtemps, et qui avait amassé un plus grand nombre de briques d'or.
Les récits qui ont cours dans le pays font mention, dans les temps anciens, d'un roi de Comar, pays qui produit l'aloès surnommé al-comâry (174). Ce pays n'est pas une île; sa situation est (sur le continent indien) du côté qui fait face au pays des Arabes. Aucun royaume ne renferme une population plus nombreuse que celui de Comar. Tout le monde y va à pied. Les habitants s'interdisent le libertinage et les différentes espèces de nabyd (175); rien d'indécent ne se voit dans leur pays et leur empire. Le Comar est dans la direction du royaume du Maharadja et de l'île du Zabedj. Entre les deux royaumes, il y a dix journées de navigation, en latitude (176), et un peu plus, en s'élevant jusqu'à vingt journées, quand le vent est faible (177).
On raconte que jadis le royaume de Comar tomba entre les mains d'un jeune prince d'un caractère naturellement prompt. Le prince était un jour assis dans son palais, et le palais dominait sur une rivière d'eau douce semblable au Tigre de l'Irak ; entre le palais et la mer il y avait la distance d'une journée. Le vizir se trouvait devant le roi, et déjà il avait été question de l'empire du Maba-radja, de l'éclat qu'il jetait, du nombre de ses sujets et des îles qui lui obéissaient. Tout à coup le roi dit au vizir : « Il m'est venu une envie que je voudrais bien pouvoir satisfaire. » Le vizir, qui était sincèrement attaché à son maître, et qui connaissait sa légèreté, lui dit : « Et quelle est cette envie, ô roi? » Le prince reprit : « Je voudrais voir devant moi la tête du roi du Zabedj exposée sur un plat. » Le vizir comprit que c'était la jalousie qui faisait ainsi parler le roi, et reprit : « Je ne verrais pas avec plaisir le roi nourrir de telles pensées. Aucun sentiment de haine ne s'est manifesté entre nous et entre ce peuple, ni en actions ni en paroles. Il ne nous a jamais fait de mal. D'ailleurs, il vit dans une île éloignée; il n'a que des rapports lointains avec nous; et il n'a jamais montré le désir de s'emparer de notre pays. Il ne faudrait pas que personne eût connaissance de ce que le roi a dit, ni que le roi en répétât un seul mot. »
Ce langage irrita le roi ; le prince ne voulut pas avoir égard à un avis si sage, et il répéta le propos qu'il avait tenu devant ses officiers et devant las principaux personnages de sa cour. Ce propos passa de bouche en bouche, et se répandit tellement, qu'il parvint jusqu'aux oreilles du Maharadja. Celui-ci était un homme d'un caractère ferme, d'un esprit vif et doué d'expérience; il était arrivé à un âge moyen. Il manda son vizir et lui fit part de la nouvelle qui lui était parvenue; puis il ajouta: «Il ne convient pas, après tout ce qui a été dit au sujet de cet étourdi, après les désirs insensés que font naître en lui sa jeunesse et sa présomption, et après le propos qui circule en ce moment, que nous le laissions tranquille; car c'est une des choses qui font tort à un roi, qui le rabaissent et qui le déconsidèrent. » Il lui recommanda de garder le silence sur ce qui venait de se passer entre eux ; mais, en même temps, il lui ordonna de faire préparer mille navires de moyenne grandeur, avec leurs machines de guerre, et de fournir chaque vaisseau d'armes et de guerriers, en aussi grande quantité que le comporterait le navire.
Le roi chercha à faire croire qu'il voulait se livrer à une promenade à travers les îles qui composaient son empire. Il écrivit aux gouverneurs de ces îles, pour leur annoncer son projet de les visiter et de se récréer dans leur île ; ce bruit se propagea partout, et chaque gouverneur se prépara à faire une réception convenable au Maharadja.
Mais, lorsque les préparatifs furent terminés et que toutes les dispositions eurent été prises, le roi monta sur sa flotte et se rendit avec ses troupes dans le royaume de Comar. Le roi et ses guerriers faisaient usage du cure-dent; chaque homme se nettoyait les dents plusieurs fois par jour; on portait le cure-dent sur soi, et l'on ne s'en séparait pas, ou bien on le confiait à son domestique.
Le roi de Comar n'eut connaissance du danger qui le menaçait que lorsque la flotte fut entrée dans le fleuve qui conduisait à sa capitale, et que les guerriers du Maharadja furent débarqués. Le Maharadja saisit donc le roi de Comar à l'improviste; il le prit et s'empara de son palais; les officiers du roi de Comar avaient pris la fuite. Le Maharadja fit proclamer sûreté pour tout le monde, et s'assit sur le trône du roi de Comar ; puis, faisant venir le roi de Comar, qui avait été fait prisonnier, ainsi que son vizir, il dit au roi : « Qu'est-ce qui t'a porté à former un désir qui était au-dessus de tes forces, qui, l'eusses-tu réalisé, ne t'aurait procuré aucun avantage, et que, d'ailleurs, n'aurait justifié aucune espèce de succès? » Le roi ne répondit rien. Le Maharadja reprit : « Si, outre le désir que tu as exprimé de voir ma tête exposée sur un plat devant toi, tu avais manifesté l'envie de ravager mes États, de t'en rendre maître, ou d'y faire des dégâts quelconques, je t'aurais traité de la même manière, mais, tu n'as désiré qu'une chose en particulier, je vais t'appliquer le même traitement, après quoi je m'en retournerai dans mes États, sans avoir touché à rien de ce qui t'appartient, en choses considérables ou de peu de valeur. Cela servira de leçon aux personnes qui viendront après toi; chacun saura qu'on ne doit pas entreprendre au delà de ses forces et des moyens qu'on a reçus en partage, et il s'estimera heureux d'avoir la santé, quand il se portera bien. » En même temps, il fit couper la tête au roi. Ensuite le Maharadja s'approcha du vizir et lui dit : « Tu t'es conduit en digne vizir ; sois récompensé de ta manière d'agir; je sais que tu avais donné de bons conseils à ton maître, s'il avait voulu les agréer. Cherche maintenant un homme qui soit capable d'occuper le trône après cet insensé, et mets-le à sa place. »
Le Maharadja partit à l'instant même pour retourner dans ses États, sans que lui ni aucun des siens eût touché à rien de ce qui appartenait au roi de Comar. A son retour dans ses Etats, il s'assit sur son trône, ayant la face tournée vers l'étang, et fit mettre devant lui le plat sur lequel se trouvait la tête du roi de Comar. En même temps, il convoqua les grands de l'État et leur raconta ce qui s'était passé, avec les motifs qui l'avaient forcé de faire cette expédition. Les peuples du Zabedj firent des vœux pour lui et lui souhaitèrent toute sorte de bonheur. Ensuite le Maharadja ordonna de laver la tête et de l'embaumer; puis, la mettant dans un vase, il l'envoya au prince qui occupait en ce moment le trône de Comar. La tête était accompagnée d'une lettre ainsi conçue : « L'unique motif qui me porta à traiter ton prédécesseur comme j'ai fait, ce fut sa mauvaise manière d'agir à notre égard et la nécessité de donner une leçon à ses pareils. Nous lui avons appliqué le traitement qu'il voulait nous infliger. Maintenant, nous croyons devoir te renvoyer sa tête, vu que nous n'avons aucun intérêt à la garder, et que nous n'attachons aucun honneur à la victoire que nous avons remportée sur lui. »
Quand la nouvelle de ces événements se fut répandue parmi les rois de l'Inde et de la Chine, le Maharadja grandit à leurs yeux. A partir de ce moment, les rois de Comar, chaque matin, à leur lever, tournaient la tête vers les pays du Zabedj et se prosternaient, adorant le Maharadja, en signe de respect.
Les rois de l'Inde et de la Chine croient a la métempsycose, et en font un principe de religion. Un homme dont le témoignage est digne de foi rapporte qu'un de ces rois eut la petite-vérole, et que, lorsqu'il fut sorti de maladie, s'étant regardé dans un miroir, il se trouva le visage laid. Il se tourna vers un fils de son frère, et lui dit : « Un homme comme moi ne peut pas rester dans ce corps, changé comme il est. Le corps est une simple enveloppe de l'âme, quand mon âme aura quitté ce corps, elle entrera dans un autre. Prends possession du trône ; je vais séparer mon âme de mon corps, en attendant que j'entre dans le corps d'un autre. » En même temps, il fit apporter son khandjar, qui était bien aiguisé et tranchant; il ordonna qu'on lui coupât la tête, après quoi il fut brûlé.
La Chine, par suite de l'extrême sollicitude du gouvernement, était autrefois, avant les troubles qui y sont survenus de nos jours, dans un ordre dont il n'y a pas d'exemple. Un homme, originaire du Khorassan, était venu dans l'Irak et y avait acheté une grande quantité de marchandises ; puis il s'embarqua pour la Chine. Cet homme était avare et très intéressé. Il s'éleva un débat entre lui et l'eunuque que l'empereur avait envoyé à Khanfou, rendez-vous des marchands arabes, pour choisir, parmi les marchandises nouvellement arrivées, celles qui convenaient au prince. Cet eunuque était un des hommes les plus puissants de l'empire ; c'est lui qui avait la garde des trésors et des richesses de l'empereur. Le débat eut lieu au sujet d'un assortiment d'ivoire et de quelques autres marchandises. Le marchand refusant de céder ses marchandises au prix qu'on lui proposait, la discussion s'échauffa; alors l'eunuque poussa l'audace jusqu'à mettre a part ce qu'il y avait de mieux parmi les marchandises, et à s'en saisir, sans s'inquiéter des réclamations du propriétaire.
Le marchand partit secrètement de Khanfou, et se rendit à Khomdan, capitale de l’empire, à deux mois de marche, et même davantage. Il se dirigea vers la chaîne dont il a été parlé dans le livre premier (178). L'usage est que celui qui agite la sonnette sur la tête du roi soit conduit immédiatement à dix journées de distance, dans une espèce de lieu d'exil. Là, il est tenu en prison pendant deux mois; ensuite le gouverneur du lieu le fait venir en sa présence et lui dit : « Tu as fait une démarche qui, si ta réclamation n'est pas fondée, entraînera ta perte et l'effusion de ton sang. En effet, l'empereur avait placé à la portée de toi et des personnes de ta profession des vizirs et des gouverneurs auxquels il ne tenait qu'à toi de demander justice. Sache que, si tu persistes à t'adresser directement à l'empereur, et que tes plaintes ne soient pas de nature à justifier une telle démarche, rien ne pourra te sauver de la mort. Il est bon que tout homme qui voudrait faire comme toi soit détourné de suivre ton exemple jusqu'au bout. Désiste-toi donc de ta réclamation, et retourne à tes affaires. » Or, quand un homme, en pareil cas, retire sa plainte, on lui applique cinquante coups de bâton et on le renvoie dans le pays d'où il est parti, mais, s'il persiste, on le conduit devant l'empereur.
Tout cela fut pratiqué à l'égard du Khorassanien ; mais il persista dans sa plainte, et demanda à parler a l'empereur. Il fut donc ramené dans la capitale, et conduit devant le prince. L'interprète l'interrogea sur le but de sa démarche ; le marchand raconta comment un débat s'était élevé entre lui et l'eunuque, et comment l'eunuque lui avait arraché sa marchandise des mains. Le bruit de cette affaire s'était répandu dans Khanfou, et y était devenu public.
L'empereur ordonna de remettre le Khorassanien en prison, et de lui fournir tout ce dont il aurait besoin pour le boire et le manger. En même temps il fit écrire par le vizir à ses agents de Khanfou, pour les inviter à prendre des informations sur le récit qu'avait fait le Khorassanien, et à tacher de découvrir la vérité. Les mêmes ordres furent donnés au maître de la droite, au maître de la gauche et au maître du centre; en effet, c'est sur ces trois personnages que roule, après le vizir, la direction des troupes; c'est à eux que l'empereur confie la garde de sa personne ; quand le prince marche avec eux à la guerre et dans les occasions analogues, chacun des trois prend autour de lui la place qu'indique son titre (179). Ces trois fonctionnaires écrivirent donc à leurs subordonnés.
Mais tous les renseignements qu'on recevait tendaient à justifier le récit qu'avait fait le Khorassanien. Des lettres conçues dans ce sens arrivèrent de tous les côtés à l'empereur. Alors le prince manda l'eunuque; dès que celui-ci fut arrivé, on confisqua ses biens, et le prince retira de ses mains la garde de son trésor; en même temps le prince lui dit : « Tu mériterais que je te fisse mettre à mort. Tu m'as exposé aux censures d'un homme qui est parti du Khorassan, sur les frontières de mon empire, qui est allé dans le pays des Arabes, de là dans les contrées de l'Inde, et enfin dans mes États, dans l'espoir d'y jouir de mes bienfaits; tu voulais donc que cet homme, en passant, à son retour, par les mêmes pays, et en visitant les mêmes peuples, dît: « J'ai été victime d'une injustice en Chine, et on m'y a volé mon bien. » Je veux bien m'abstenir de répandre ton sang, à cause de tes anciens services; mais je vais te préposer à la garde des morts, puisque tu n'a pas su respecter les intérêts des vivants! Par les ordres de l'empereur, cet eunuque fut chargé de veiller à la garde des tombes royales, et de les maintenir en bon état.
Une des preuves de l’ordre admirable qui régnait jadis dans l'empire, à la différence de l'état actuel, c'est la-manière dont se rendaient les décisions judiciaires, le respect que la loi trouvait dans les cœurs, et l'importance que le gouvernement, dans l'administration de la justice, mettait à faire choix de personnes qui eussent donné des garanties d'un savoir suffisant dans la législation, d'un zèle sincère, d'un amour de la vérité à toute épreuve, d'une volonté bien décidée de ne pas sacrifier le bon droit en faveur des personnes en crédit, d'un scrupule insurmontable à l'égard des biens des faibles et de ce qui se trouverait sous leurs mains.
Lorsqu'il s'agissait de nommer le cadi des cadis, le gouvernement, avant de l'investir de sa charge, l'envoyait dans toutes les cités qui, par leur importance, sont considérées comme les colonnes de l'empire. Cet homme restait dans chaque cité un ou deux mois, et prenait connaissance de l'état du pays, des dispositions des habitants et des usages de la contrée. Il s'informait des personnes sur le témoignage desquelles on pouvait compter, à tel point que, lorsque ces personnes auraient parlé, il fut inutile de recourir à de nouvelles informations. Quand cet homme avait visité les principales villes de l'empire, et qu'il ne restait pas de lieu considérable où il n'eût séjourné, il retournait dans la capitale et on le mettait en possession de sa charge.
C'est le cadi des cadis qui choisissait ses subalternes et qui les dirigeait. Sa connaissance des diverses provinces de l'empire, et des personnes qui, dans chaque pays, étaient dignes d'être chargées de fonctions judiciaires, qu'elles fussent nées dans le pays même ou ailleurs, était une connaissance raisonnée, laquelle dispensait de recourir aux lumières de gens qui peut-être auraient obéi à certaines sympathies, ou qui auraient répondu aux questions d'une manière contraire à la vérité. On n'avait pas à craindre qu'un cadi écrivit à son chef suprême une chose dont celui-ci aurait tout de suite reconnu la fausseté, et qu'il le fit changer de direction.
Chaque jour, un crieur proclamait ces mots à la porte du cadi des cadis : « Y a-t-il quelqu'un qui ait une réclamation à exercer soit contre l'empereur, dont la personne est dérobée à la vue de ses sujets, soit contre quelqu'un de ses agents, de ses officiers et de ses sujets en général ? Pour tout cela je remplace l'empereur, en vertu des pouvoirs qu'il m'a conférés et dont il m'a investi. » Le crieur répétait ces paroles trois fois. En effet, il est établi en principe que l'empereur ne se dérange pas de ses occupations, à moins que quelque gouverneur ne se soit rendu coupable d'une iniquité évidente, ou que le magistrat suprême n'ait négligé de rendre la justice et de surveiller les personnes chargées de l'administrer. Or, tant qu'on se préserva de ces deux choses, c'est-à-dire tant que les décisions rendues par les administrations furent conformes à l'équité, et que les fonctions de la magistrature ne furent confiées qu'à des personnes amies de la justice, l'empire se maintint dans l'état le plus satisfaisant.
On a vu que le Khorassan était, limitrophe des provinces de l'empire. Entre le Sogd (la Sogdiane) et la Chine proprement dite, il y a une distance de deux mois de marche, et cet espace consiste dans un désert impraticable et dans des sables qui se succèdent d'une manière non interrompue, n'offrant ni eau, ni rivières, ni habitations. Voilà pourquoi les guerriers du Khorassan ne songent pas à envahir l'es provinces de la Chine (180). La Chine, du côté du soleil couchant, a pour limite la ville appelée Madou, sur les frontières du Tibet. La Chine et le Tibet sont dans un état d'hostilités continuelles (181). Quelqu'un de ceux qui ont fait le voyage de Chine nous a dit y avoir vu un homme qui portait sur son dos du musc dans une outre; cet homme était parti de Samarkand, et avait franchi à pied la distance qui sépare son pays de la Chine. Il était venu de ville en ville jusqu'à Khanfou, place où se dirigent les marchands de Syraf. Le pays où vit la chèvre qui fournit le musc de Chine, et le Tibet, ne forment qu'une seule et même contrée. Les Chinois attirent à eux les chèvres qui vivent près de leur territoire; il en est de même des habitants du Tibet. La supériorité du musc du Tibet sur celui de la Chine tient à deux causes : la première est que la chèvre qui produit le musc trouve, sur les frontières du Tibet, des plantes odorantes (182), tandis que les provinces qui dépendent de la Chine n'offrent que les plantes vulgaires. La seconde cause consiste en ce que les habitants du Tibet laissent les vessies dans leur état naturel, au lieu que les Chinois m. altèrent les vessies qui se trouvent à leur portée. Ajoutez à cela que le musc chinois nous vient par la mer, et que, dans le trajet, il contracte une certaine humidité. Quand les Chinois laissent le musc dans sa vessie, et que la vessie est déposée dans un vase bien fermé (183), il arrive dans le pays des Arabes ayant les mêmes qualités que le musc du Tibet
Le premier de tous les genres de musc est celui que la chèvre dépose en se frottant contre les rochers des montagnes, au moment où la matière s'est amassée dans son nombril, et qu'elle s'y est réunie sous forme d'un sang frais, comme se rassemble le sang lorsqu'il survient un ulcère. Quand l'instant de la démangeaison est arrivé, et que l'animal en est incommodé, il se frotte contre les pierres, au point que sa peau se fend, et que ce qui est en dedans coule ; mais à peine la matière est sortie que la plaie se dessèche, et que la peau se ferme; dès lors la matière s'amasse de nouveau.
Il y a au Tibet des hommes qui font métier d'aller à la recherche du musc, et qui possèdent, à cet égard, des connaissances particulières. Quand ils.ont trouvé du musc, ils le ramassent, le réunissent ensemble et le déposent dans des vessies. Ce musc est réservé pour les princes. Le musc a acquis son plus haut mérite, quand il a eu le temps de mûrir, dans la vessie, Sur l'animal même, il l'emporte alors sur les autres muscs, de même que les fruits qui mûrissent sur l'arbre l'emportent sur les fruits qu'on cueille avant leur parfaite maturité.
Du reste, on va à la chasse des chèvres avec des filets dressés ou avec des flèches. Quelquefois on enlève la vessie de l'animal avant que le musc soit mûr. En ce cas, quand on retire le musc de dessus l'animal, il a une odeur désagréable qui dure un certain temps, jusqu'à ce qu'il ait séché ; mais, du moment que le musc est sec, ce qui n'a lieu qu'après beaucoup de temps, il change, et alors il devient véritablement du musc.
La chèvre qui produit le musc est comme nos chèvres, pour la taille, la couleur, la finesse des jambes, la division des ongles, les cornes d'abord droites, ensuite recourbées. Elle a deux dents minces et blanches aux deux mandibules; ces dents se dressent sur la face de la chèvre; la longueur de chacune n'est pas tout à fait la distance qui existe entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'index; ces dents ont la forme de la dent de l'éléphant. Voilà ce qui distingue cet animal des autres espèces de chèvre (184).
La correspondance qui a lieu entre l'empereur de la Chine et les gouverneurs des villes ainsi que les eunuques, se fait sur des mulets de la poste, qui ont la queue coupée, comme les mulets de la peste chez nous. Ces mulets suivent certaines routes déterminées d'avance (185).
Les Chinois, outre les diverses particularités que nous avons décrites, ont celle de pisser debout. Tel est l'usage du peuple parmi les indigènes. Quant aux gouverneurs, aux généraux et aux personnes notables, ils se servent de tubes de bois verni, de la longueur d'une coudée ; ces tubes sont percés des deux côtés, et le côté supérieur est assez large pour pouvoir y introduire le bout de la verge. On se met donc sur ses pieds quand on veut pisser ; on tourne le tube loin de soi, et on y décharge l'urine. Les Chinois prétendent que cette manière d'uriner est plus salutaire au corps, et que toutes les maladies auxquelles est sujette la vessie, notamment la pierre, viennent uniquement de ce qu'on s'accroupit pour pisser, ajoutant que la vessie ne se décharge complètement qu'autant qu'on fait l'opération debout (186).
Ce qui fait que les hommes, chez les Chinois, se laissent pousser les cheveux sur la tête, c'est que, lorsqu'un enfant vient au monde, on se dispense de lui arrondir la tête et de la redresser, comme cela se pratique chez les Arabes (187). Les Chinois disent que cela contribue à faire perdre au cerveau son état naturel et altère le sens commun. La tête d'un Chinois présente un aspect difforme ; les cheveux qui la couvrent cachent ce défaut (188).
Les Chinois se divisent en tribus et en famille», comme les tribus des enfants d'Israël et des Arabes. On a égard à cela dans les choses de la vie. En Chine, un homme n'épouse pas une personne qui lui est proche et qui est de la même famille; il est obligé de chercher ailleurs. En principe, un homme ne se marie pas dans sa tribu (189) ; c'est comme lorsque, chez les Arabes, un homme de la tribu de Temym ne se marie pas dans la tribu de Temym, ni un homme de la tribu de Rebyé dans la tribu de Rebyé, mais que les hommes de Rebyé se marient dans la tribu de Modhar, et les hommes de Modhar dans la tribu de Rebyé. Les Chinois disent que c'est un moyen d'avoir de plus beaux enfants (190).
On voit, dans le royaume du Balhara, et dans les autres provinces de l'Inde, des hommes se brûler sur un bâcher. Cet usage vient de la croyance des Indiens à la métempsycose, croyance qui a pris racine dans leur cœur, et qui ne leur laisse pas le moindre doute.
Parmi les rois de l'Inde, il y en a qui, lorsqu'ils montent sar le trône, se font cuire du riz, et à qui on sert ce riz sur des feuilles de bananier. Le roi a auprès de lui trois ou quatre cents de ses compagnons, qui se sont attachés à sa personne volontairement et sans y être forcés; après qu'il a mangé du riz, il en présente à ses compagnons, chacun d'eux s'approche a son tour et en prend une petite portion qu'il mange. Tous ceux qui ont mangé de ce riz sont obligés, quand le roi meurt, ou qu'il est tué, de se brûler jusqu'au dernier, le jour même où le roi est mort; c'est un devoir qui ne souffre pas de délai, et il ne doit rester de tous ces hommes ni la personne ni des vestiges (191).
Lorsqu'un homme a pris la résolution de se brûler, il se présente à la porte du gouverneur et lui demande la permission de se détruire; puis il parcourt les marchés. Pendant ce temps, on allume un bûcher d'un bois sec et pressé, et plusieurs hommes sont occupés à le faire brûler, jusqu'à ce qu'il soit devenu semblable à la cornaline pour l'incandescence et les flammes qui en sortent. Alors l'homme se met à courir dans les marchés s ayant devant lai des cymbales, et entouré de sa famille et de ses proches. Quelqu'un lui place sur la tête une couronne de basilic dans laquelle on a entrelacé des charbons ardents; en même temps, on lui verse sur la tête de la sandaraque, qui, mêlée au feu, produit l'effet du naphte. L'homme marche, la tête en feu; on sent sur son chemin l'odeur de la chair qui brûle, et pourtant il marche comme si de rien n'était, et on n'aperçoit sur lui aucun signe d'émotion enfin il arrive devant le bâcher et il s'y précipité; bientôt il n'est plus que cendres.
Un voyageur dit avoir vu un homme qui, au moment de se jeter dans le bûcher, prit son khandjar, le plaça au-dessus de son cœur, et se fendit de sa «tain jusqu'au-dessous du bas-ventre. Ensuite, il introduisit sa «tain gauche dans l'ouverture et, la dirigeant vers 4e foie, il tira tout ce qui se trouva à sa portée; pendant ce temps, il conversait comme à l'ordinaire; puis il coupa avec son khandjar un morceau de son foie, qu'il jeta à son frère ; il voulait montrer par là son mépris de la mort et son insensibilité à la douleur. Enfin il se précipita dans le bûcher, et se rendit dans le sein de la malédiction divine (192).
L'homme qui a fait ce récit ajoutait qu'il trouva dans les montagnes de cette partie du monde un peuple de race indienne qu'on peut comparer à nos kenyfyés et à nos djelydyés (193), pour le goût des choses frivoles et insensées; il existe une espèce de rivalité entre ces hommes et ceux de la côte. A tout instant quelqu'un de la côte se rend dans la montagne et adresse une espèce de défi aux habitants, pour voir qui supportera mieux les mutilations volontaires. Les hommes de la montagne vont aussi défier ceux de la cote.
Un jour, un homme de la montagne se rendit dans ce but sur la côte. Aussitôt les habitants s'assemblèrent autour de lui, les uns comme spectateurs, les autres pour prendre parti. L'homme proposa à ceux des habitants qui avaient la prétention de lutter avec les montagnards, d'imiter tout ce qu'il ferait, ou bien, s'ils ne pouvaient en venir à bout, de s'avouer vaincus. Ensuite il s'assit à l'extrémité d'un bois de cannes semblables à nos roseaux pour la souplesse. La racine de ces cannes est comme celle du aldan, mais plus épaisse. Quand on tire la tête de ces cannes, elles cèdent à l'effort et se ploient jusqu'à terre ; mais, dès qu'on les rend à elles-mêmes, elles reviennent à leur première direction. Cet homme ayant invité les assistants à tirer à eux une de ces cannes, quelqu'un prit la tête d'une canne épaisse, et la fit approcher de terre. Alors le montagnard attacha les mèches de ses cheveux à cette canne, en les serrant fortement; puis il prit son khandjar, qui flamboyait comme le feu, et dit aux assistants : « Je vais me couper la tête avec ce khandjar. Lorsque ma tête sera séparée du tronc, lâchez la canne à l'instant même. Au moment où la canne reprendra son ancienne place, entraînant ma tête avec elle, vous me verrez rire, et vous entendrez un petit bruit que je ferai en riant. » Aucun homme de la côte n'osa suivre cet exemple.
Ce récit nous a été fait par un homme dont le témoignage ne peut pas être révoqué en doute (194). La chose est d'ailleurs connue de tout le monde, d'autant plus que la partie de l'Inde où le fait s'est passé est assez rapprochée du pays des Arabes, et que nous avons continuellement des nouvelles de cette contrée.
Lorsqu'une personne avance en âge, soit homme, soit femme, et que ses sens s'appesantissent, elle prie quelqu'un de sa famille de la jeter dans le feu ou de la noyer dans l'eau ; tant les Indiens sont persuadés qu'ils reviendront sur la terre. Dans l'Inde, on brûle les morts.
L'île de Serendyb renferme la montagne des pierres précieuses, les pêcheries de perles, etc. Autrefois il n'était pas rare, dans cette île, de voir un homme du pays s'avancer dans le marché, tenant à la main un kri (195), c'est-à-dire un khandjar particulier au pays, d'une fabrication admirable et parfaitement aiguisé. Cet homme s'attaquait au marchand le plus considérable qui se trouvât sur son passage; il le prenait à la gorge, faisait briller le khandjar devant ses yeux, puis il le tirait hors de la ville. Tout cela se passait au milieu de la foule des assistants, et cependant il n'était au pouvoir de personne de réprimer cet excès ; car, si on essayait d'arracher le marchand à cet homme, il tuait le marchand, puis il se tuait lui-même. Quand le voleur avait tiré le marchand hors de la ville, il lui proposait de se racheter; quelqu'un venait avec une forte somme d'argent, et le marchand était mis en liberté. Cela dura pendant un certain temps. Mais, à la fin, le trône échut à un prince qui ordonna de saisir, n'importe par quel moyen, tout Indien qui aurait une telle audace. L'ordre fut exécuté. A la vérité, l'Indien tua le marchand et se tua lui-même; ce cas se reproduisit plusieurs fois, et un grand nombre d'indigènes et de marchands arabes trouvèrent ainsi la mort. Mais on finit par se lasser; ce genre d'attaque cessa, et les marchands n'eurent plus à craindre pour leur personne.
Les pierres précieuses rouges, vertes et jaunes sont tirées de la montagne qui domine l'île de Serendyb. La plus grande partie des pierres qu'on découvre sont apportées par l'eau, dans le moment du flux de la mer. L'eau fait rouler ces pierres de l'intérieur des cavernes, des grottes et des lieux où tombent les torrents. Des hommes sont chargés de veiller à la récolte des pierres, au nom du roi. D'autres fois, l'on extrait les pierres du fonds de la terre, comme on fait pour les mines; alors la pierre est attachée à des matières pierreuses et il faut l'en séparer.
Le royaume de Serendyb a une loi, et des docteurs qui s'assemblent de temps en temps, comme se réunissent, chez nous, les personnes qui recueillent les traditions du prophète (196). Les Indiens se rendent auprès des docteurs, et écrivent, sous leur dictée, la vie de leurs prophètes et les préceptes de leur loi.
On remarque, dans l'île de Serendyb, une grande idole d'or pur, à laquelle les navigateurs ont attribué des dimensions excessives ; il y existe aussi des temples qui ont dû coûter des sommes considérables.
On trouve, dans l'île de Serendyb, une communauté de juifs qui est nombreuse. Il y a également des personnes des autres religions, notamment des dualistes (les manichéens). Le roi de Serendyb laisse chaque communauté professer son culte (197).
En face de cette île, il y a de vastes gobb, mot par lequel on désigne une vallée, quand elle est à la fois longue et large, et qu'elle débouche dans la mer (198). Les navigateurs emploient, pour traverser le gobb appelé gobb de Serendyb, deux mois et même davantage, passant à travers des bois et des jardins, au milieu d'une température moyenne. C'est à l'embouchure de ce gobb que commence la mer de Herkend. Ce pays est d'un séjour fort agréable; on y a une brebis pour la moitié d'un dirhem ; on a pour le même prix, et en assez grande quantité pour contenter plusieurs personnes, une liqueur cuite, composée de miel d'abeille mêlé avec des grains de dâdy frais, etc. (199).
Les habitants passent la plus grande partie de leur temps à faire combattre des coqs et à jouer au nord (jeu de trictrac) (200). Les coqs, dans ce pays, sont grands et ont des ergots très forts. On attache aux ergots de petits khandjars bien aiguisés; ensuite on lâche les coqs l'un contre l'autre. Les joueurs parient de l'or, de l'argent, des champs, des plantes, etc. Aussi un coq qui a la supériorité sur les autres vaut une somme importante.
Il en est de même du jeu de trictrac. On y joue continuellement, et pour des sommes considérables. C'est au point que, parmi les hommes qui ont l'esprit léger ou fanfaron, ceux qui appartiennent à la classe inférieure et «eux qui n'ont pas d'argent jouent quelquefois leurs doigts de la main. Pendant qu'ils jouent, on tient i côté un vase contenant de l'huile de noix ou de l'huile de sésame ; car l'huile d'olive manque dans le pays; le feu brûle par dessous. Entre les deux joueurs est une petite hache bien aiguisée. Celui des deux qui est vainqueur prend la main de l'autre, la place sur une pierre et lui coupe le doigt avec la hache; le morceau tombe, et en même temps le vaincu trempe sa main dans l'huile, qui est alors extrêmement chaude et qui lui cautérise le membre. Cette opération n'empêche pas ce même homme de recommencer à jouer. Quand les deux joueurs se séparent, l'un et l'autre ont quelquefois perdu tous leurs doigts. Il y a des joueurs qui prennent une mèche et la trempent dans l'huile, puis la posent sur un de leurs membres et y mettent le feu. La mèche brûle, et eh sent {'odeur de la chair qui se consume, pendant ce temps l'homme joue au nard et ne laisse paraître aucune marque de douleur.
Une corruption effrénée règne dans ce pays parmi les femmes comme parmi les hommes. On voit quelquefois un marchand, nouvellement débarqué faire des avances à la fille du roi, et celle-ci, au su de son père, va trouver le marchand dans quelque endroit boisé. Les hommes graves, parmi les marchands de Syraf, évitent d'expédier ides navires dans cette contrée, particulièrement quand il s'y trouve des jeunet gens.
L'Inde est sujette au yessaré, mot qui signifie « pluie. » L'été, la pluie tombe dans le pays pendant trois mois de suite, sans discontinuer ni la nuit ni le jour; c'est comme un hiver qui ne souffre aucune interruption (201). Les Indiens ont soin, avant cette époque, de faire des approvisionnements. Lorsque le yessaré arrive, ils s'enferment dans leurs maisons qui sont faites en bois; le toit est couvert de chaume, et elles sont ombragées par des plantes. Personne ne sort plus, que dans un cas d'extrême nécessité. Seulement, c'est pendant cette saison que les artisans vaquent le mieux à leurs travaux. Quelquefois, l'humidité fait pourrir la plante des pieds. C'est le yessaré qui fait la richesse du pays; s'il vient à manquer, les habitants meurent de faim. En effet, ils sèment du riz; ils ne connaissent pas d'autres grains, et ils n'ont pas d'autre ressource pour manger. Le riz, pendant les pluies, se trouve dans les haramat, mot qui signifie « champs de riz; » il est couché par terre, et l'on n'a pas besoin de l'arroser ni de s'en occuper; lorsque le ciel commence à devenir serein, le riz parvient à sa plus grande croissance, et se multiplie à proportion (202). Dans l'hiver il n'y a pas de pluie.
Les Indiens ont des hommes voués à la religion et des hommes de science, qu'on nomme brahmes; ils ont des poètes qui vivent à la cour des rois, des astronomes, des philosophes, des devins, des hommes qui font lever les corbeaux (203), etc. On trouve parmi eux des devins et des faiseurs de tours qui viennent à bout de choses extraordinaires. Ces observations s'appliquent surtout à Canoge, vaste contrée formant l'empire du Djorz (204)
On remarque dans l'Inde une population connue sous le nom de baykardjy (205). Ces hommes vont nus, et leur chevelure leur couvre le corps et les parties naturelles ; ils se laissent pousser les ongles, de manière à former des espèces de pointes; ils n'en ôtent que les morceaux qui se brisent Ils vivent à la manière des moines errants; chacun d'eux a à son cou un fil auquel est attaché un crâne humain. Quand ils sont pressés par la faim, ils s'arrêtent devant la porte d'un indigène, et aussitôt les habitants leur apportent du riz cuit, charmés de cette visite. Ces hommes mangent le riz dans le crâne; quand ils sont rassasiés, ils s'en vont, ne demandant plus à manger que lorsqu'ils ne peuvent faire autrement.
Les Indiens ont divers usages, par lesquels ils prétendent se rendre agréables au Dieu très haut, et dont le Créateur est à une distance incommensurable (206). Par exemple, on bâtit, le long des chemins, des khans pour les voyageurs, et on y entretient des marchands de légumes à qui les passants achètent ce qui leur est nécessaire; de plus, on fonde une rente pour l'entretien d'une courtisane du pays qui est à la disposition des voyageurs. C'est là une des choses par lesquelles les Indiens croient se faire des mérites auprès de Dieu (207).
Il y a, dans l'Inde, des courtisanes qu'on nomme les courtisanes du Bodda, Quand une femme a fait un vœu et qu'il lui naît après cela une jolie fille, elle au conduit au Bodda, nom de l'idole qui est adorée dans le pays, et elle lui voue sa fille. Ensuite elle loue, pour sa fille, une maison dans le marché; elle suspend à la maison un voile, et elle fait asseoir sa fille sur un siège, de manière à ce qu'elle se trouve sur le passage, soit des indigènes, soit des étrangers, dont la religion ne condamne pas ces sortes d'actions. Tout homme, pour une somme déterminée, a pouvoir sur cette femme; mais, à mesure que celle-ci a amassé quelque argent, elle le remet aux ministres de l'idole pour être employé aux frais d'entretien du temple (208). Remercions Dieu, et louons-le de ce qu'il nous a élevés au-dessus des infidèles et nous a préservés de leurs vices.
Quant à l'idole appelée Moultan, aux environs de Mansoura, on y vient en pèlerinage à plusieurs mois de distance (209). On y apporte de l'aloès indien surnommé al-camrouny, de Camroun, nom du pays dont il est originaire; c'est un aloès de première qualité. On apporte donc cet aloès, et on le remet aux ministres de l'idole pour qu'il serve dans les fumigations. Quelquefois cet aloès vaut deux cents dinars le manna. On peut marquer cet aloès avec un cachet; le cachet s'empreint dans l'objet, tant il est tendre. Les marchands l'achètent de ces ministres (210).
On trouve dans l'Inde des personnes qui, par principe de religion, se rendent dans les îles qui se forment dans la mer (211) et y plantent des cocotiers ; elles se louent pour tirer de l'eau des puits, et, quand un navire passe dans le voisinage, cette eau sert à l'approvisionner. Il part de l'Oman des hommes pour les îles où croît le cocotier; ils apportent avec eux des outils de charpentier et les autres outils analogues; ils coupent le nombre de cocotiers qui leur est nécessaire, et, quand le bois est sec, ils le débitent en planches. En même temps, ils filent les fibres du cocotier, et en font des cordes qui servent à coudre ces planches ensemble. Avec les planches, on forme le corps du navire et tes mâtures (212); avec les feuilles, on tisse les voiles ; avec les fibres, on fait les câbles. Quand le navire est achevé, on le remplit de cocos, et on retourne dans l'Oman où se vend la cargaison. Ces expéditions procurent de grands bénéfices, vu que, pour tout ce qui entre dans le voyage, on n'a pas besoin de recourir à personne.
Le pays des Zendj est vaste. Les plantes qui y croissent, telles que le dorra, qui est la base de leur nourriture, la canne à sucre et les autres plantes, y sont d'une couleur noire. Les Zendj ont plusieurs rois en guerre les uns avec les autres; les rois ont à leur Service des hommes connus sous le titre de almokhazzamonn (ceux qui ont la narine percée), parce qu'on leur a percé le nez. Un anneau a été passé dans leur narine, et à l'anneau sont attachées des chaînes. En temps de guerre, ces hommes marchent à la tête des combattants; il y a pour chacun d'eux quelqu'un qui prend le bout de la chaîne et qui la tire, en empêchant l'homme d'aller en avant. Des négociateurs s'entremettent auprès des deux partis ; si l'on s'accorde pour un arrangement, on se retire; sinon, la chaîne est roulée autour du cou du guerrier ; le guerrier est laissé à lui-même ; personne ne quitte sa place (213), tous se font tuer à leur poste. Les Arabes exercent un grand ascendant sur ce peuple; quand un homme de cette nation aperçoit un Arabe, il se prosterne devant lui et dit : « Voilà un homme du pays qui produit la datte ; » tant cette nation aime la datte, et tant les cœurs sont frappés.
Des discours religieux (214) sont prononcés devant ce peuple; on ne trouverait chez aucune nation des prédicateurs aussi constants que le sont ceux de ce peuple dans sa langue. Dans ce pays, il y a des hommes, adonnés à la vie dévote, qui se couvrent de peaux de panthères ou de peaux de singes; ils ont un bâton à la main, et s'avancent vers les habitations; les habitants se réunissent aussitôt; le dévot reste quelquefois tout un jour jusqu'au soir, sur ses jambes, occupé à les prêcher et à les rappeler au souvenir de Dieu, qu'il soit exalté! Il leur expose le sort qui a été éprouvé par ceux de leur nation qui sont morts. On exporte de ce pays les panthères zendjyennes, dont la peau, mêlée de rouge et de blanc, est très grande et très large (215).
La même mer renferme l'île de Socothora, où pousse l'aloès socothorien. La situation de cette île est près du pays des Zendj et de celui des Arabes. La plupart de ses habitants sont chrétiens; cette circonstance vient de ce que, lorsque Alexandre fit la conquête de la Perse, il était en correspondance avec son maître, Aristote, et lui rendait compte des pays qu'il parcourait successivement. Aristote engagea Alexandre à soumettre une île nommée Socothora, qui produit le sabr, nom d'une drogue du premier ordre, sans laquelle un médicament ne pourrait pas être complet (216). Aristote conseilla de faire évacuer l'île par les indigènes, et d'y établir des Grecs, qui seraient chargés de la garder, et qui enverraient la drogue en Syrie, dans la Grèce et en Egypte. Alexandre fit évacuer l'île et y envoya une colonie de Grecs. En même temps, il ordonna aux gouverneurs de provinces, qui, depuis la mort de Darius, obéissaient à lui seul, de veiller à la garde de cette île. Les habitants se trouvèrent donc en sûreté, jusqu'à l'avènement du Messie. Les Grecs de l'île entendirent parler de Jésus, et, à l'exemple des Romains, ils embrassèrent la religion chrétienne. Les restes de ces Grecs se sont maintenus jusqu'aujourd'hui, bien que, dans l'île, il se soit conservé des hommes d'une autre race (217).
Il n'a pas été parlé, dans le livre premier, du côté de la mer qui est à droite du navire, lorsqu'on sort des côtes de l'Oman et du pays des Arabes pour entrer dans la grande mer. Le livre premier ne traite que du côté de la mer qui est à gauche, et qui renferme les mers de l'Inde et de la Chine; en effet, l'Inde et la Chine étaient l'objet spécial de la personne d'après laquelle ce livre a été rédigé.
La mer qui sort de l'Oman et qui est à la droite de l'Inde, baigne (sur la côte méridionale de l’Arabie), le pays du Schehr où croît l'encens, ainsi qu'une portion du territoire des peuples de Ad, de Himyar, de Djorhom et des Tobbas. Ces peuples parlent des dialectes arabes mêlés d'expressions adyennes et fort anciennes, dont la plus grande partie est ignorée des Arabes (218). Ils n'habitent pas de bourgs, et mènent une vie grossière et misérable. Leur pays s'étend jusqu'au territoire d'Aden, sur les côtes du Yémen. La mer s'avance ensuite vers Djidda, et de Djidda vers Aldjar, jusqu'aux côtes de Syrie. Elle se termine à Colzom, à l'endroit où il est dit dans l'Alcoran que Dieu a posé une barrière entre les deux mers (219). La mer, en cet endroit, change de direction, et baigne la terre des Berbères. Le coté vers lequel se porte la mer, et qui est situé i l'occident, fait face au Yémen t la mer va baigner le pays des Abyssins, d'où on exporte les peaux des panthères berbériennes ; ce sont les peaux les plus belles et les plus propres. La mer baigne aussi Zeyla, territoire où l'on recueille l'ambre ainsi que le dzabal, qui est le dos de la tortue.
Les navires de Syraf, lorsqu'ils se dirigent du côté qui est situé à droite de la mer de l'Inde, et qu'ils entrent dans la mer de Colzom, s'arrêtent à Djidda. Les marchandises qui sont destinées pour l'Egypte sont transportées de Djidda dans des navires particuliers à la mer de Colzom. Les navires de Syraf n'osent pas s'avancer sur cette mer, à cause des difficultés de la navigation et du grand nombre de rochers qui sortent de l'eau. Ajoutes à cela que, sur les côtes, il n'y a ni gouverneurs, ni lieux habités. Un navire qui vogue sur cette mer a besoin de chercher, pour chaque nuit, un lieu de refuge, de peur d'être brisé contre les rochers; il marche le jour, mais il s'arrête la nuit (220). Cette mer, en effet, est brumeuse et sujette à des exhalaisons désagréables. On ne trouve rien de bon au fond de l'eau ni à la surface. Cette mer est loin de ressembler aux mers de l'Inde et de la Chine. Les mers de ces pays recèlent dans leur sein la perle et l'ambre, et leurs montagnes fournissent des pierreries et des mines d'or; les animaux portent à leur bouche de l'ivoire ; la terre produit l'ébène, le bois de brésil (baccam), le bambou (khayzoran), l'aloès, le camphre, la muscade (djouzboua), le girofle, le sandal, et les autres substances parfumées, ou d'une odeur saisissante. Les oiseaux sont le perroquet et le paon ; les bêtes qu'on y châsse sont la civette et la chèvre produisant le musc. On ne finirait pas, si on voulait énumérer tous les avantages qui distinguent ces contrées.
L'ambre est une substance que la mer rejette sur ses rives. Elle commence à se montrer dans la mer de l'Inde, sans qu'on sache quel est son véritable point de départ. L'ambre de première qualité est celui qui est jeté sur les côtes de Barbera et du pays des Zendj, ainsi que sur les côtes du Schehr et de la portion de l'Arabie qui l'avoisine. C'est l'ambre en forme d'un œuf rond et bleuâtre.
Les habitants de ces contrées vont la nuit sur leurs côtes, lorsque la lune jette ses lueurs; ils ont des chameaux qui connaissent l'ambre, et qui sont dressés à la recherche de cette substance) Ils montent sur leurs chameaux, et, quand le chameau aperçoit un morceau d'ambre, il s'accroupit, aussitôt le cavalier descend et ramasse le morceau. On trouve aussi à la surface de la mer des morceaux d'ambre d'un poids considérable (221). Ces morceaux sont presque aussi gros qu'un taureau, etc. Quand le poisson appelé tâl (222) aperçoit cet ambre, il l'avale ; mais cet ambre, une fois arrivé dans son estomac, le tue, et l'animal flotte au-dessus de l'eau. Il y a des gens qui savent à quelle époque viennent les poissons qui avalent l'ambre ; ils se tiennent aux aguets dans leur barque; et, quand ils aperçoivent un poisson qui surnage, ils le tirent à terre avec des crochets de fer qu'on a enfoncés dans le dos de l'animal, et auxquels tiennent de fortes cordes; ils ouvrent le ventre de l'animal et en retirent l'ambre. La partie qui se trouve près du ventre de l'animal, et qui porte le nom de mand (223), répand une odeur infecte. Les vertèbres qui la surmontent se trouvent exposées chez les droguistes à Bagdad et à Bassora; mais la partie qui ne donne pas de mauvaise odeur est très propre.
Avec les vertèbres du dos du poisson nommé tâl, on fait quelquefois des sièges sur lesquels l'homme peut s'asseoir à son aise. On dit que, dans un bourg situé à dix parasanges de Syraf et appelé Altâyn, il y a des maisons d'une construction extrêmement ancienne; la toiture de ces maisons, qui sont légères, est faite avec les côtes de ce poisson. J'ai entendu dire à quelqu'un que jadis, tandis qu'il se trouvait auprès de Syraf, un de ces poissons vint échouer sur la côte. Il alla voir l'animal et trouva des personnes qui étaient montées sur son dos à l'aide d'une échelle légère. Les pêcheurs, quand ils prennent un de ces poissons, l'exposent au soleil, et le coupent par morceaux. A côté est une fosse où se ramasse la graisse; quand la chaleur du soleil a fait fondre la graisse, on puise dans la fosse; on met la graisse dans des vases et on la vend aux maîtres de navires. Cette graisse est mêlée avec d'autres matières, et on en frotte les vaisseaux qui vont sur la mer; elle sert à couvrir les traces des sutures et à boucher les trous (224). La graisse de ce poisson se vend fort cher.
La formation de la perle est un ouvrage de la sagesse de Dieu, dont le nom soit béni. Le Dieu très haut dit dans l'Alcoran : « Louanges à celui qui a créé tous les êtres par paires, tant ceux qui germent dans le sein de la terre, que ceux qui appartiennent à l'espèce humaine, sans compter ceux que l'homme ne connaît pas (225). »
La perle se présente d'abord sous la forme de la graine de l'aser; elle en a la couleur, la forme, la petitesse, la légèreté, la finesse et la faiblesse; elle voltige faiblement sur la surface de l'eau, et elle tombe sur les flancs des barques des plongeurs. Peu à peu elle se fortifie, elle grossit et prend la dureté de la pierre. Quand elle a acquis du poids, elle s'attache au fond de la mer, et elle se nourrit de ce que Dieu seul connaît. Dans le principe, on ne trouve dans la perle qu'un morceau de viande rouge, qui ressemble à la langue à sa racine, n'ayant pas d'os, ni de nerfs, ni de veines.
Du reste on ne s'accorde pas sur la formation de la perle. Quelques auteurs ont dit que le coquillage, lorsqu'il pleut, monte jusqu'à la surface de l'eau, et ouvre la bouche pour recueillir les gouttes de la pluie; ces gouttes se transforment en graines. D'autres auteurs soutiennent que la perle est engendrée par la coquille même ; c'est l'opinion la plus vraisemblable des deux; en effet on trouve quelquefois la perle dans la coquille, sous ferme d'un végétal qui tient à la coquille même; on peut l'en séparer, et c'est ce que les marchands qui voyagent sur mer nomment la perle cala (226). Dieu seul sait ce qui en est.
Une des manières les plus singulières d'acquérir de l'aisance, dont nous avions entendu parler, c'est ce qu'on dit d'un Arabe du désert, qui vint autrefois à Bassora, ayant avec lui une graine de perle qui valait une grande somme d'argent. Il se rendit chez un droguiste qu'il connaissait, et, lui montrant la perle dont il ignorait la valeur, il le pria d'en faire l'estimation. Le droguiste répondit que c'était une perle. L'Arabe demanda quelle était sa valeur; le droguiste l'estima cent dirhems. L'Arabe trouva cela une forte somme et dit : « Y a-t-il quelqu'un qui voulût m'en donner ce prix ? » A ces mots, le droguiste lui remit les cent dirhams, «t, avec cet argent, l'Arabe acheta des provisions pour sa famille. Pour le droguiste, il porta la perle à Bagdad, où il la vendit une grande somme d'argent, ce qui lui permit de donner une plus grande extension à son commerce.
Le droguiste racontait qu'il fit quelques questions a l'Arabe, au sujet de la découverte de cette perle. L'Arabe répondit : « Je passais à Al-samman, dans la province du Bahreïn, à une petite distance de la mer. J'aperçus, sur le sable, un renard mort, ayant à la bouche quelque chose qui semblait le pincer. Je descendis de ma monture, et je vis une espèce de couvercle, dont la face intérieure jetait un éclat blanchâtre. Dans les écailles était cet objet rond que je pris avec moi. Le droguiste comprit que, dans le principe, le coquillage était descendu sur la côte pour respirer l'air : tel est, en effet, l'usage des coquillages. Un renard, qui passait par là, vit un morceau de viande dans le fond du coquillage, lequel avait en ce moment la bouche ouverte ; il se jeta aussitôt sur l'animal, et introduisit sa tête dans la coquille pour saisir le morceau de viande; mais l'animal ferma ses deux écailles sur lui. Or, quand ce coquillage a fermé ses écailles sur un objet, on a beau le presser avec la main, il n'ouvre pas la bouche, quelque effort que l'on fasse. On est obligé de fendre les écailles avec un instrument de fer, dans toute leur longueur, tant l'animal est attaché à la perle, attachement qui ressemble à l'amour d'une mère pour son enfant. Quand le renard se sentit pincé, il se mit à courir, frappant la terre à droite et à gauche ; mais le coquillage ne le lâcha pas; le renard mourut et le coquillage aussi. Voilà comment l'Arabe découvrit le coquillage ; il prit ce qui se trouvait dans la coquille; Dieu lui inspira l'idée d'aller trouver le droguiste, et ce fut pour lui un moyen de se procurer des provisions.
Les rois de l'Inde sont dans l'usage de porter des pendants d'oreilles consistant en pierres précieuses montées en or; ils mettent à leur cou des colliers du plus grand prix, composés de pierres de la première qualité, rouges et vertes. Mais les perles sont ce qu'ils estiment davantage et ce qui est le plus recherché; c'est maintenant le trésor des souverains, leur principale richesse. Les colliers sont aussi portés par les officiers de l'armée et les grands personnages (227). Le principal d'entre eux sort soutenu sur le cou d'un homme du pays (228); il est vêtu d'un pagne et tient à la main un objet appelé djatra (229) ; cet objet est un parasol fait avec des plumes de paon, et avec lequel il se garantit des rayons du soleil. En même temps, ses serviteurs sont autour de sa personne.
Il y a, parmi les Indiens, une classe d'hommes qui ne mangent jamais deux dans un même plat ni à la même table. Cela leur paraît un péché et une chose déshonnête.
Quand il vient de ces hommes à Syraf, et qu'un des marchands notables de la ville les invite à un repas où l'on est quelquefois cent personnes, plus ou moins, le marchand est obligé de faire servir devant chacun d'eux un plat dans lequel il mange, sans que personne autre puisse y envoyer la main. Quant aux princes indiens et aux personnages considérables, il est d'usage, dans l'Inde, de mettre chaque jour devant eux des tables faites avec des feuilles de cocotier entrelacées ensemble; on fait, avec ces mêmes feuilles, des espèces d'assiettes et des plats. Au moment du repas, on sert les aliments sur ces feuilles entrelacées, et, quand le repas est fini, on jette à l'eau la table et les assiettes de feuilles avec ce qui reste d'aliments. On dédaigne de faire servir les mêmes objets le lendemain (230). Autrefois, l'on portait dans l'Inde les dinars du Sind, dont chacun équivalait à trois dinars ordinaires et davantage (231). On y portait l'émeraude, qui vient d'Egypte (232), montée en forme de cachets, et enfermée dans des boîtes. On y portait encore le bossad, qui est le corail, ainsi que la pierre nommée dahnadj (233). Ce commerce a maintenant cessé.
La plupart des princes indiens, les jours de réception publique, laissent voir leurs femmes aux hommes qui font partie de la réunion, qu'ils soient du pays, ou qu'ils viennent de pays étrangers ; aucun voile ne les dérobe aux regards des assistants (234).
Voilà ce que j'ai entendu raconter de plus intéressant, dans ce moment-ci, au milieu des nombreux récits auxquels donnent lieu les voyages maritimes; je me suis abstenu de rien reproduire des récits mensongers que font les marins, et auxquels les marins eux-mêmes n'ajoutent pas foi. Il vaut mieux se borner aux relations fidèles, bien que courtes. C'est Dieu qui dirige dans la droite voie.
Louanges à Dieu, le maître des mondes! Que ses bénédictions soient sur les meilleures de ses créatures, Mahomet et sa famille tout entière ! Dieu nous suffît. O le bon protecteur et la bonne aide !
Collationné avec le manuscrit sur lequel cette copie a été faite, au mois de safar de l'année 596 (novembre 1199 de J. C). Que Dieu nous conduise au bien !
FIN DU TOME PREMIER.
(130) Tom. Ier, p. 36.
(131) En Chinois, Hoang-chao.
(132) Massoudi, Moroudj, tom. Ier, fol. 59, place Khanfou à six ou sept journées de la mer. Evidemment il ne s'agit pas ici du port de Khanfou, qui était situé à l'embouchure du Tsien-Thang-Kiang, mais de Hang-tcheou-fou, capitale de la province, à quelques journées dans l'intérieur des terres. Aboulféda (Géographie, p. 363 et 361 du texte) ne (ait qu'une ville de Khanfou et de Hang-tcheou-fou, qu'il nomme Khinsâ. Il est probable que déjà, du temps d'Aboulféda, Khanfou avait perdu une partie de son importance.
(133) Cette ville était nommée par les Chinois Tchang-ngan ; les Arabes et les écrivains syriens de l'époque l'appellent Khomdan. Son nom actuel est Si-ngan-fou. Sa situation est sur un des affluents du fleuve Jaune, à plus de deux cents lieues de la mer, et elle est maintenant la capitale de la province Chen-si.
(134) La même ville est nommée ci-dessous, p. 114, Madou, et c'est probablement la véritable leçon. La dénomination de Madou ou Amdou est encore usitée au Tibet. (Voy. la relation du P. Orazio della Penna, Journal asiatique de septembre 1834, p. 193 et suiv.)
(135) Voy. le Discours préliminaire.
(136) Suivant Massoudi, l'armée des Turks se montait à quatre cent mille hommes, tant à pied qu'à cheval.
(137) Aboulféda a parlé de ces événements dans sa Chronique (tom. II, p. 25o) ; et Reiske, dans ses notes sur le passage d'Aboulféda, a rapporté un extrait du Moroudj de Massoudi.
(138) Au lieu de généraux, le texte porte molouk althaouayf ou chefs de bandes. Il s'agit ici des principautés qui, après la mort d'Alexandre et lorsque la puissance des princes Séleucides fut déchue, se formèrent en Mésopotamie, en Chaldée et dans la Perse. Ces principautés se maintinrent sous la domination des Parthes et ne furent tout à fait éteintes que sous les rois Sassanides. Les écrivains arabes supposent que ce fut Alexandre lui-même qui créa ces principautés. Hamza d'Ispahan (p. 41 et suiv.) porte le nombre de ces espèces de fiels a quatre-vingt-dix. Suivant Hamza, toutes ces principautés furent subjuguées par Ardeschir, fila de Babek, fondateur de la dynastie des Sassanides.
(139) Il s'agit probablement ici d'un fait exceptionnel et qui tenait à l'état d'anarchie où
Le texte comporte ici un « trou » de 3 pages
(151) Habbar, fils d'Al-asouad était un des idolâtres de la Mekke, qui montrèrent le plus d'opposition aux prédications de Mahomet. Une branche de la famille de Habbar s'établit à Bassora ; une autre branche fonda une principauté sur les bords de l'Indus.
(152) Le récit qui suit se retrouve dans le Moroudj de Massoudi, tom. Ier, fol. 61. Massoudi commence ainsi: « lorsque le prince des Zendj fit à Bassora ce qui est bien connu. » Il s'agit ici des dévastations commises par les Zendj, dans l'ancienne Chaldée. (Voy. la Chronique d'Aboulféda, tom. II, p. 238.) Cet événement eut lieu l'an 257 (870 ou 871 de J. C.), quelques années seulement avant les désordres qui bouleversèrent la Chine, et mirent en danger l'existence du khalifat.
(153) Massoudi nous apprend, fol. 62 v. que ceci se passait l'an 303 (915 de J. C).
(154) On n'en a compté que quatre.
(155) Les anciens rois de Perse s'étaient arrogé le titre de Schahinschah ou roi des rois ; ce titre était rendu, par les Grecs, basileus.
(156) Il s'agit ici du roi des Tagazgaz. (Voy. Massoudi, Moroudj, tom. Ier, fol. 56, 59 verso et 70.)
(157) Dans le titre donné à l'empereur de la Chine, le mot nomme désigne l'espèce et répond au homo des Latins ; ici il s'agit uniquement du sexe. C'est le vir des Latins.
(158) C'est ainsi que le déluge qui, suivant les écrivains chinois, eut lieu au temps de Yao, plus de deux mille ans avant notre ère, paraît avoir été particulier à la Chine.
(159) Tel est, en effet, le mouvement que font les musulmans, quand ils s'acquittent de leur profession de foi.
(160) Évidemment, la botte renfermait une collection de portraits des divinités et des principaux personnages du judaïsme, du christianisme, du mahométisme, du bouddhisme et des autres religions de l'Inde et de la Chine.
L'esprit général des princes de la dynastie Tang était la tolérance, et même peut-être l'indifférence. Tantôt le prince paraissait pencher pour le christianisme, tantôt pour le culte de Fo ou Bouddha, tantôt pour les doctrines des Tao-sse ou disciples de Lao-Tseu.
(161) Les khalifes de Bagdad appartenaient à la tribu des Corayschites.
(162) En Chine, les chevaux sont d'une petite espèce et fort rares. Les Chinois trouvent leur entretien trop cher. (Davis, Description de la Chine, tom. II, p. 237.)
(163) La ville de Pékin est aussi divisée en deux parties séparées par une rue. Mais à présent il est permis à certains marchands d'habiter dans le quartier de l'empereur. Il existe une description de Pékin, par le P. Gaubil. Cette description a été reproduite avec quelques modifications par M. Timkowski, Voyage à Péking (trad. franc., tom. II, p. 124 et suiv.).
(164) Massoudi, qui rapporte le même fait, dit qu'il eut lieu aux environs de l'île de Crète. Les débris du navire étaient en bois de sadj ou de teck, et les pièces en étaient cousues ensemble avec des fibres de cocotier. Massoudi prétend que, si dans les mers de l'Inde on emploie le fil à la place des dons, c'est parce que dans ces climats brûlants le fer est dissous par l'eau de la mer. Il est certain que dans les mers de l'Inde, le fer s'use beaucoup plus promptement que dans les mers du Nord. C'est ce qui fait que maintenant les Anglais, dans l'Inde, emploient le cuivre de préférence au fer. Ajoutez à cela que le fer a toujours été rare en Asie. D'un autre côté, Massoudi paraît croire que, dans cette occasion, les débris du navire firent le tour de l'Asie et de l'Europe, et qu'ils entrèrent dans la mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar. (Voy. le Moroudj-al-dzeheb, tom. Ier, fol. 71 verso.} J'ai exposé, dans ma préface de la géographie d'Aboulféda, les différentes opinions des écrivains arabes sur la prétendue communication de la mer Noire et de la mer Caspienne, soit entre elles, soit avec les mers du Nord.
(165) Voy. l’Alcoran, sourate xxvii, v. 62.
(166) Massoudi rapporte le même fait à la suite du premier, et il explique de même la manière dont cet ambre passa de la mer de l'Inde dans la mer Méditerranée.
(167) Dans l'île de Java.
(168) Ce qui fait vingt-neufs parasanges de long sur vingt-neuf parasanges de large. Il y a là une exagération évidente. Peut-être l'auteur veut parler de l'île proprement dite du Zabedj.
(169)
Ce nom est écrit ailleurs  saryra.
C'est probablement l'île de Sumatra.
saryra.
C'est probablement l'île de Sumatra.
(170) Voy. tom. Ier et le Discours préliminaire.
(171) L'île de Kalah me paraît répondre à la pointe de Galles, sur la côte méridionale de nie de Ceylan.
(172) Voy. ibidem.
(173) Un philosophe chinois, le célèbre Mong-Tseu, se sert de la même expression pour montrer la prospérité dont jouissait de son temps le royaume de Thsi, une des provinces de la Chine actuelle. « Le chant des coqs et les aboiements des chiens, dit-il, se répondent mutuellement et s'étendent jusqu'aux quatre extrémités des frontières. » (V. le liv. Ier, ch. m, Livres sacrés de l'Orient, par M. Pauthier, p. 233).
(174) La partie méridionale de la presqu'île.
(175) Vin fait avec les dattes ou les raisins secs.
(176) Le texte peut signifier largeur et latitude. Le mot arabe est employé deux fins, dans le dernier sens, par Hamza d'Ispahan. (Voy. l'édition de Saint-Pétersbourg, p. 190 et 327.) Le dernier sens supposerait que, dans l'opinion d'Abou-Zeyd, les îles de Java et de Sumatra étaient situées au midi de la pointe de la presqu'île, et non pas à l'orient.
(177)On trouve le même récit dans le Moroudj-al-dzeheb, de Massoudi, et le récit y est accompagné de quelques circonstances qui ne sont pas inutiles pour l'intelligence de l'en semble. Voici ce que dit Massoudi : « Le pays de Comar n'est pas une île ; c'est un pays de côtes et de montagnes. Il n'y a pas dans l'Inde beaucoup de royaumes plus peuplés que celui-ci. Aucun peuple dans l'Inde n'a la bouche plus propre que celui de Comar; en effet, ils font usage du cure-dent, à l'exemple des personnes qui professent la religion musulmane. Voilà pourquoi aussi, seuls entre les Indiens, ils s'interdisent le libertinage et se gardent de certaines impuretés. Ils s'interdisent aussi le nabid; mais pour ce cas en particulier ils ne font que ce que dit la masse des Indiens. La plupart d'entre eux marchent à pied, à cause du grand nombre de montagnes qui couvrent le pays; de rivières qui le traversent et du petit nombre de plaines et de tertres. » Ce passage fait partie du chapitre qui a été publié par M. Gildemeister; mais M. Gildemeister n'a pas bien compris le passage. (Voy. l'ouvrage intitulé : Scriptorum arabum de rebus indicis, p. 18 et 19 du texte, et p. 155 et suiv, de la version latine.
(178)Ibid.
(179) Il est parlé de ces officiers dans le Chi-king, part. III, ch. 1, ode 4e.
(180) Les anciens Persans avaient la prétention d'avoir poussé leurs conquêtes jusqu'aux rives de la mer orientale, et les récits qu'ils faisaient à cet égard se retrouvent dans le Schah-Namèh de Ferdoussi. Lisez, dans ce poème, certains épisodes du règne de Kai-Kaous, notamment ce qui est dit dans l’édition de M. Mohl, tom. II, p. 463. Massoudi, longtemps avant Ferdoussi, avait parlé de ces épisodes. Voy. le Moroudj, fol. 103, verso. Mais ces récits sont romanesques.
(181) Les peuples du Tibet, dont parle Abou-Zeyd, sont appelés par les écrivains chinois Thou-fan; à cette époque, ils exerçaient un grand ascendant sur la Chine et la Tartarie. (Voy. les Tableaux historiques de l'Asie, par Klaproth, p. 211 et suiv.)
(182) Le texte porte : « des épis à parfum. »
(183) Massoudi, qui rapporte les mêmes détails, parle d'un vase de verre. Voy. au fol. 69 du tom. Ier du Moroudj. Le récit de Massoudi a été suivi en partie par Cazouyny. (Voy. Chrest. arabe, de M. de Sacy, tom. III, p. 410.)
(184) Comparez la description de l'animal appelé musc par Buffon, et celle du moschus par Cuvier, Règne animal, édition de 1839, tom. Ier, p. 259. La description d'Abou-Zeyd n'est pas entièrement exacte, vu que sans doute il n'avait jamais vu l'animal.
(185) En Chine, la poste ne sert qu'aux gens du Gouvernement.
(186) Les musulmans s'accroupissent, à l'exemple de Mahomet. (Miskkat-almassabih, tom. Ier, p. 84, et Chardin, tom. IV, p. 2.) C'est de peur qu'en faisant autrement il ne tombe quelque goutte sur les vêtements, et qu'on ne soit souillé. L'usage des musulmans est suivi par les idolâtres de l'Inde. (Voyez l'ouvrage de M. l'abbé Dubois, tom. Ier, p. 330.)
(187) Hippocrate, dans son livre des airs, des eaux et des lieux, dit que les peuples voisins de la mer Noire avaient adopté l'usage de comprimer le crâne de leurs enfants, et que les habitants de ces contrées étaient macrocéphales, c'est-à-dire qu'ils avaient la tête allongée. Le passage d'Abou-Zeyd montre qu'il en était de même chez les Arabes de son temps. Cet usage existe encore parmi les tribus arabes de l'Afrique ; c'est la mère de l'enfant qui est ordinairement chargée de cette opération ; elle se (ait dans la première année de la vie, et, pour que l'enfant ne souffre pas, on la pratique graduellement, comme une espèce de massage, c'est-à-dire en frottant avec la paume de la main, et de bas en haut, les parties latérales de la tête. Les familles nobles attachent une grande importance à cette coutume ; d'abord par coquetterie, ensuite parce qu'on est jaloux de conserver sur la tête de l'enfant le type primitif, afin qu'il ne soit pas possible de le confondre avec la race berbère, généralement méprisée par les Arabes. (Voyage médical dans l'Afrique septentrionale, par M. le docteur Furnari, Paris, 1845, p. 23 et suiv.)
(188) Les Chinois, au viie siècle, lors de l'invasion des Mandchous, furent obligés de raser l'épaisse chevelure qui couvrait leur tête, pour se conformer à la coutume des Tartares, qui ne conservent qu'une longue tresse en forme de queue. Plusieurs Chinois aimèrent mieux s'expatrier que de renoncer à l'antique usage de la nation. (Davis, Description de la Chine, t. Ier, p. 52 et 185.) Les Coréens seuls ont conservé l'ancienne coutume.
(189) La population native de la Chine est désignée par les Chinois eux-mêmes sous le nom de Pe-sing ou « cent familles, » vraisemblablement d'après une tradition qui fixait le nombre de celles qui avaient formé le premier noyau de la nation. Il n'y a même encore à présent que quatre ou cinq cents noms de famille répandus dans tout l'empire ; et les personnes qui portent un même nom de famille sont si bien considérées comme issues d'une même souche, que la loi s'oppose à toute alliance entre elles. Mais la civilisation a effacé toutes les autres nuances qui pouvaient distinguer ces anciennes tribus, (Compares les Nouveaux mélanges asiatiques d'Abel-Rémusat, tom. Ier, p. 33, le Code pénal de la Chine, trad. franc, tom. Ier, p. 191 et suiv, sections cvii et suiv, et le Journal asiatique de décembre 1830, p. 613.)
(190) Massoudi a rapporté le même fait avec quelques autres circonstances (tom. Ier du Moroudj, fol. 58 v.) Le passage a été reproduit par Reiske, dans ses notes sur la Chronique d'Aboulféda (tom. II, p. 713) ; mais Reiske a fait dire à Massoudi le contraire de ce qu'il avait dit.
(191)
Il s'agit probablement ici des Naïres, sur lesquels on peut
voir les notes de Renaudot, p. 167. Massoudi (t. Ier du
Moroudj, f. 94 v.) nomme les compagnons du roi balandjar
 , mot qui, dit-il, signifie « ami
dévoué. »
, mot qui, dit-il, signifie « ami
dévoué. »
(192) Le voyageur dont il s'agit est Massoudi lui-même, qui dit avoir été témoin de ce trait barbare. Massoudi ajoute que le fait se passa sur le territoire de Seymour, aux environs de la ville actuelle de Bombay. (Voy. le Moroudj-al-dzeheb, tom. Ier, fol. 94.)
(193) Je n'ai rien trouvé sur les deux sectes dont parle l'auteur arabe.
(194) C'est probablement Massoudi lui-même. Il s'agit ici des environs de Bombay.
(195)
Massoudi écrit ce mot  , au pluriel
, au pluriel
 (tom. Ier. fol. 167
v.). Ce mot est écrit par les Malais
(tom. Ier. fol. 167
v.). Ce mot est écrit par les Malais
 ou
ou

(196) Le roi et la masse de la nation professaient le bouddhisme, comme ils le professent encore aujourd'hui, et les traditions bouddhiques de Ceylan forment une école à part, qui s'appuie sur les décisions des réunions religieuses tenues, sous forme de conciles, à diverses époques.
(197) Voy. le témoignage d'Edrisi, tom. Ier de la trad. franc, p. 72.
{198) Sur le mot gobb, voy. le témoignage d'Albyrouny, Journal asiatique de septembre 1844, p. 261 (p. 119 du tirage à part).
(199) Le dâdy, ou dzadzy, est, suivant Ibn Beythar, un grain semblable à l'orge, mais plus long, plus mince et amer au goût.
(200) Le code de Manou défend les maisons de jeu. (Voy. le livre IX, nos 220 et suiv.) Mais la défense n'a guère été observée. (Voy. la table alphabétique qui accompagne la traduct. franc, des Chefs-d'œuvre du théâtre indou, par M. Langlois, au mot sabhika.) Quant aux combats de coqs, tels qu'ils sont encore usités à Java, à Sumatra et dans les Moluques, il existe des lois particulières à leur sujet. (Grawford, History of the indian archipelago, tom. Ier, p. 112 ; Newbold, Statistical and political account, Londres, 1839, tom. II, p. 179.)
(201) Le mot yessaré me paraît être une altération du sanscrit varscha, signifiant « pluie. » Ces pluies commencent vers le solstice d'été, et durent tout l'été. Voy. à ce sujet un extrait curieux du traité d'Albyronny, Journal asiatique de septembre 1844, p. 267 (p. 125 du tirage à part). Massoudi, dans un passage de son Moroudj, dit que les pluies du yessaré, qui forment l'hiver des Indiens, tombent pendant les mois syriens haziran, tamouz et ab, lesquels répondent à notre été, et que l’été des Indiens tombe aux mois syriens de canoun et de sabat, qui forment notre hiver. Ce passage est altéré dans les manuscrits. Du reste, le temps des plaies n'est pas le même dans l'Inde méridionale, à l'est et a l'ouest de la chaîne des Gattes.
(202) On trouvera dans le poème sanscrit Harivansa, traduction de M. Langlois, tom. Ier, p. 307, une description poétique de l'état d'épuisement du sol à la fin du printemps, de l'abondance des plaies d'été, et de l'aspect verdoyant des champs pendant l'automne. Dans l'Inde méridionale, l'arrivée des pluies donne-lieu à des fêles particulières. (V. les Mœurs de l’Inde, par l'abbé Dubois, tom. II, p. 301.) L'espèce de riz nommée calama, laquelle est de couleur blanche, vient en pleine eau; on la sème en mai et juin, et elle est mure en décembre et en janvier.
(203) Dans le but de reconnaître à leur vol les choses futures. Ce préjugé existait chez les Arabes.
(204) Tom. Ier.
(205) Il faut peut-être lire Beiragi.
(206) littéralement : « Dieu est à une grande hauteur au-dessus de ce que disent les méchants. » (Alcoran, sourate xvii. v. 45.)
(207) Ces espèces d'hôtelleries portent dans le pays le nom de tchoultri, mot dont les Européens ont fait chaaderie.
(208) Comparez ce récit avec celui d'Edrisi, tom. Ier de la trad. franc., p. 80 et 81.
(209) Sur cette idole, voy. les extraits que j'ai publiés dans le Journal asiatique, septembre 1844, et février 1845.
(210) Sur le pays de Camroun, voy. le Discours préliminaire.
(211) Ces îles sont les Maldives et les Laque-clives. Sur ces îles, voy. le témoignage d'Albyrouny, Journal asiatique de septembre 1844, p. 265.
(212)
Le mot  , que nous traduisons par
mâtures, n'est pas expliqué d'une manière très nette dans le
dictionnaire intitulé Camous; mais, d'après on passage du
Kitab al-adjayb (man. ar. de la Bibl. roy. anc. fonds, n°
901, fol. 25), passage où le mot
, que nous traduisons par
mâtures, n'est pas expliqué d'une manière très nette dans le
dictionnaire intitulé Camous; mais, d'après on passage du
Kitab al-adjayb (man. ar. de la Bibl. roy. anc. fonds, n°
901, fol. 25), passage où le mot  se
rencontre deux fois, ce mot n'est pas susceptible d'une autre
signification.
se
rencontre deux fois, ce mot n'est pas susceptible d'une autre
signification.
(213) Litt. « aucun d'eux ne lève la jambe. »
(214) Littéralement: « des khothbas. »
(215)
Dans le Kitab al-adjayb, icA. 36 verso, le
récit qu'on vient de lire est placé dans l'île
 , qui répond probablement à l'île
Madagascar. Pour Edrisi, il le place mal à propos dans l'Inde, (t. Ier
de la trad. franc, p. 98.)
, qui répond probablement à l'île
Madagascar. Pour Edrisi, il le place mal à propos dans l'Inde, (t. Ier
de la trad. franc, p. 98.)
(216) L'aloès socotrin (aloe socotrina), dont on a fait le mot chicotin, se tire de l'aloès à feuilles d'ananas. C'est le meilleur de tous : il est d'une couleur noire, jaunâtre en dehors, rougeâtre en dedans, transparent, friable, résineux, amer au goût, d'une odeur forte et peu désagréable ; il devient jaunâtre quand on le pulvérise. Pour retirer ce suc, on arrache les feuilles de l'aloès au mois de juillet; on les presse, et on fait couler le sac dans un vaisseau où on le fait dessécher et épaissir au soleil ; ensuite, on l'expose à l'action du feu; puis, au mois d'août, on le dépose dans des outres de cuir ; c'est dans cet état qu'il arrive en Europe. Il est plus dur et plus friable en hiver qu'en été.
(217) Cosmas dit, dans la Topographie chrétienne, que, de son temps, l'Ile était occupée par des Grecs, des Arabes et des Indiens, c'est-à-dire des indigènes. Le même fait avait déjà été mentionné dans le Périple de la mer Erythrée, p. 17. Le récit de l'auteur arabe se retrouve, avec quelques circonstances de plus, dans le Traité d'Edrisi, t. Ier de la trad. franc., p. 47 et 48. Voy. aussi les notes de Renaudot.
(218) M. Fresnel a recueilli quelques détails sur ces dialectes. (Journal asiatique de juin 1838, p. 511 et suiv.)
(219) La mer Rouge et la mer Méditerranée.
(220) La navigation est restée la même, dans la partie septentrionale de la mer Rouge, jusqu'à ces derniers temps.
(221) Tom. Ier.
(222) Il a été parlé de cet animal à la page s, mais sans que son nom ait été rapporté; les aonreaux détails que l'on trouve ici permettent de mieux reconnaître à quelle espèce de cétacés appartient le tal.
(223) Les détails qu'on voit ici, sur l'ambre et les lieux ou on le recueille, se retrouvent en grande partie dans le Moroudj de Massoudi.
(224) Marco-Polo, en décrivant les navires faits avec du bois de cocotier, parle aussi de l'huile de poisson qui servait au calfatage. (V. l'édition de la Société de géographie, p. 35.) Une partie de ces faits se retrouve dans la Relation de Néarque, édition citée, p. 159.
(225) Alcoran, sourate xxxvi, vers. 36.
(226) C'est-à-dire, probablement, « la perle mobile. »
(227) Un passage de Quinte-Curce montre que ces usages existaient dans l'Inde dès le temps d'Alexandre, et renferme quelques traits qui se rapportent à ce qu'on a lu ci-dessus : « Corpora usque pedes carbaso velant; soleis pedes, capita linteis vinciunt. Lapilli ex auribus pendent; bracchia quoque et lacertos auro colunt, quibus inter populares aut nobilitas aut opes eminent. Capillum pectunt saepius, quam tondent. Mentum semper intonsum est : reliquam oris cutem ad speciem levitatis extequant. » (Lib. VIII, cap. ix.) Ce qui est dit des Indiens, qui se couvraient tout le corps, s'applique aux habitants de l'Hindoustan proprement dit, c'est-à-dire aux peuples qui, suivant l'auteur arabe, portaient deux pagnes.
(228) C'est-à-dire en palanquin.
(229) J'ai dit, ci-devant, que la forme sanscrite était tchatra.
(230) Les préjugés dont il est parlé ici, et qui tiennent à des scrupules religieux, existent encore parmi la masse des indigènes. (Voy. les Mœurs de l'Inde, par l'abbé Dubois, tom. Ier, p. 151.) Ils avaient frappé l'attention du voyageur chinois Hiouan-thsang, dans le viie siècle de notre ère. (Voy. les extraits que M. Pauthier a donnés de la relation chinoise. Journal asiatique de décembre 1839, p. 462.)
(231) Voy. tom. Ier.
(232 Il existait jadis en Egypte, sur les bords de la mer Rouge, une mine d'émeraudes qui a été retrouvée, dans ces derniers temps, par M. Cailliaud et par Belzoni. Cosmas (p. 339) a parlé du commerce des émeraudes d'Egypte dans l'Inde.
(233) Pierre verte qui se rapproche de l'émeraude.
(234) Voy. les Chefs-d'œuvre du théâtre indou, recueillis par M. Wilson, tom. Ier de la trad. franc., p. xlvi et lxxxii. Mais, depuis l'invasion musulmane, les femmes, dans l'Inde, ne pouvaient se laisser voir en public, et ce n'est qu'à présent qu'elles commencent à jouir de la même liberté que les femmes européennes. (Voyage de l’évêque anglican Hébert, traduction française, tom. Ier, p. 141.)
Pachyderme. — L'Eléphant. — « L'île de Ramny produit de nombreux éléphants. »
Ceylan, la seule île où l'on trouve des éléphants, n'a jamais produit de camphre et n'avait probablement point d'habitants anthropophages à réponse ou elle était visitée par les Arabes. L'ensemble de ces renseignements ne peut donc s'appliquer à aucun point du globe. Quelques-uns, à la vérité, conviendraient à l'île de Sumatra, dans laquelle Harsden croyait reconnaître notre Ramny, et à peu près aussi bien à Java ou à Bornéo. Remarquons, cependant, qu'à diverses époques les voyageurs ont bien pu voir des éléphants à Java et à Sumatra. Toutes les fois qu'il y a eu dans ces îles des princes assez puissants pour vouloir s'entourer d'un cortège semblable à celui des souverains indiens, et assez riches pour payer des éléphants, ils ont pu très facilement s'en procurer ; les Hollandais, dans leurs premiers voyages aux Indes orientales, en ont vu chez un rajah de Java, et cette circonstance a fait tomber Buffon dans la même erreur que nous signalons chez Abou-Zeïd (Histoire naturelle, tom. XI, p. 38, note B).
Il y aurait encore un autre moyen d'expliquer l'erreur de l'auteur arabe ; ce serait de supposer qu'il a mal entendu ce que lui auront dit les indigènes, d'un autre pachyderme, d'assez grande taille, qui se trouve à Sumatra et aussi probablement à Java. Le tapir indien, ou maïba, dont la taille égale celle d'un petit bœuf, dont les formes sont très lourdes, dont le pied est divisé en gros doigts courts, munis chacun d'un petit sabot, et dont la tête, enfin, se prolonge en une trompe rétractile, a bien pu faire croire a l'existence d'un éléphant sauvage, dans les deux îles que je viens de nommer. C'est très probablement d'après les renseignements qui se rapportaient au maïba, que Nieuhoff a décrit son sucotyro, auquel il a, d'ailleurs, ajouté quelques traits appartenant au bairiroussa.
« Les Chinois n'ont point d'éléphants et n'en laissent point entrer dans leur pays. »
Quand on voit les figures que les Chinois donnent de l'éléphant, on reconnaît aisément qu'elles n'ont pu être faites d'après nature. Cependant ils connaissent assez bien l'histoire de cet animal, qui habite des pays avec lesquels ils sont en relation habituelle. Les descriptions qu'ils en ont données dans leurs encyclopédies contiennent beaucoup de renseignements exacts et bien choisis sur les formes de l'animal, sur la manière de le prendre, de le dresser, etc. La seule erreur bien manifeste que j'aie rencontrée dans les passages nombreux dont je dois la connaissance à M. Stanislas Julien, est relative au mode d'accouplement de ces animaux. Suivant l'auteur chinois, les éléphants, pour se livrer à cet acte, entreraient dans l'eau et se présenteraient l'un à l'autre, face a face. La position singulière des organes sexuels chez le mâle et la femelle avait fait faire aux naturalistes d'Europe des conjectures différentes de celle-ci, mais qui ne s'écartaient pas moins de la vérité.
Le rhinocéros. — « Le même pays nourrit le boschan marque, autrement appelé kerkedden. Cet animal a une seule corne au milieu du front, et dans cette corne est une figure semblable à celle de l'homme ; la corne est noire d'un bout à l'autre, mais la figure placée au milieu est blanche... »
Il n'est pas douteux qu'il ne s'agisse dans tout ce passage du rhinocéros unicorne de l'Inde, que les Arabes avaient soin de distinguer du rhinocéros bicorne d'Afrique, qui leur était également connu. Quant aux noms que l'auteur donne ici à l'espèce du continent indien, boschan et kerkedden, je ferai remarquer que le dernier a été rapproché très justement par Bochart d'un nom employé pour cet animal, par Elien, qui dit que c'est le nom du pays. En général, on a lu ce mot kartazwnos; Bochart l'écrit karkazwnos;, et sous cette forme, certainement il ressemble beaucoup au mot kerkedden ou carcaddan. On peut aussi lui trouver quelque rapport, assez éloigné, il est vrai, avec le nom que porte en sanscrit le même animal, khadga ou khadgin, mots qui signifient de plus, le premier, poignard, le second, celui qui a un poignard. Ces deux noms, qui font évidemment allusion à la corne pointue dont l'animal est pourvu, nous reportent à l'époque où les métaux n'étaient point encore employés pour la fabrication des armes. Au reste, les progrès de l'industrie métallurgique n'empêchèrent pas que l'homme ne continuât longtemps encore à emprunter aux animaux les armes que la nature leur avait données pour leur défense. Cet usage même n'est pas encore complètement abandonné, et l'on peut voir dans Buffon, t. xii, pl. 36, la figure d'un double poignard indien fait avec les cornes de l'antilope cervicapra.
Un autre nom sanscrit du rhinocéros est gandaka, signifiant le pustuleux, le lépreux; ce mot conviendrait très bien au rhinocéros de Java, qui a la peau toute couverte de petits tubercules, et l'on pencherait à croire qu'il date de l'époque où Java était comme le centre d'un grand royaume indien, du royaume du Zabedj.
M. E. Burnouf m'a fait remarquer que les deux noms khadgin et gandaka, quoique reçus dans la langue sanscrite, portent les signes d'une origine étrangère. Il est bien certain que le rhinocéros était inconnu dans les lieux où s'est parlé d'abord le sanscrit, et ne devait pas originairement avoir de nom dans cette langue ; mais la mime remarque peut s'appliquer au second nom, dans sa double acception, puisque la lèpre et les affections semblables appartiennent presque exclusivement aux pays chauds.
Je ne sais pas à quelle langue appartient l'autre nom donné au rhinocéros, mais je crois qu'on peut découvrir à quelle idée se rattache l'épithète que notre auteur y accole. Le boschan est dit marqué, parce que ce sont les marques ou taches que présente sa corne coupée en tranches, qui en font le principal mérite. Dans l'espèce du Visapour, cette tache, au dire de notre auteur, offrirait en clair sur un fond obscur la figure d'un homme. Il faut, je crois, beaucoup de bonne volonté pour reconnaître dans ces taches irrégulières une silhouette humaine, et les Chinois eux-mêmes se contentent de les comparer à des fleurs et à des grains de millet. Leurs encyclopédies contiennent à ce sujet de nombreux détails. Je me contenterai de citer le passage suivant, dont je dois la traduction à la complaisance de M. Stanislas Julien.
« Lorsque les raies claires de la corne sont comme formées d'une série d'œufs de poissons, la corne est dite à yeux de millet, mi-yen. Lorsque, dans le noir, il y a des fleurs jaunes, cela s'appelle tching-sieou; lorsqu'au milieu du jaune il y a des fleurs noires, cela s'appelle tao sieou (tching veut dire direct, et tao veut dire renversé; cela paraît donc désigner le cas régulier et le cas anormal). Lorsqu'au milieu des fleurs il y a encore d'autres fleurs, cela s'appelle tchong-sieou, c'est-à-dire transparent double ; alors ce sont des cornes de première qualité. Lorsque les fleurs sont comme des graines de poivre ou de dolichos, la corne est de seconde qualité. La corne du rhinocéros-corbeau, qui est d'un noir pur et sans fleurs, est de troisième qualité. »
Il paraît, au reste, que, malgré tout le prix que mettent les Chinois à ces raretés, ils n'y découvrent pas la moitié des choses qu'y avaient vu les Arabes. Voici en effet comment s'exprime à ce sujet Demiri, dans un passage dont j'emprunte à Bochart la traduction : « Cum serra in longum dissecatur (cornu), varia; ex eo figurae emergunt albi coloris in nigro, puta pavonum, caprearum, avium et arborum certae speciei, hominum quoque et rerum aliarum picturae admirabilis. » Le même Demiri nous fournit des renseignements sur l'usage que l'on faisait de ces plaques : « Bracteas regum soliis et balteis exornandis, quae carissime emuntur. » Ce passage en explique un autre qui n'était pas suffisamment clair dans notre auteur, et montre que les ceintures n'étaient pas, comme on aurait pu le croire d'après la manière dont il s'exprime, faites entièrement de cornes de rhinocéros, mais seulement décorées de ces plaques mouchetées. Je suppose que ces ceintures militaires étaient devenues à la mode parmi les guerriers arabes, à l'époque des croisades. Nos chevaliers, à leur retour des expéditions à la Terre Sainte, les rapportèrent en Europe ou l'usage s'en conserva plus d'un siècle. Seulement, aux plaques de corne on fut obligé de substituer des plaques en ouvrage d'orfèvrerie. Il est inutile de faire remarquer que, quoi qu'en dise notre auteur, le rhinocéros n'est point dépourvu d'articulations aux jambes, pas plus que l'éléphant et l'élan, dont on a fait jadis le même conte. C'est aussi aujourd'hui un fait connu de tout le monde, que l'animal ne rumine point ; mais, parmi les voyageurs musulmans, quelques-uns sans doute n'étaient pas très empressés de se défaire d'une erreur qui leur permettait de manger au besoin, sans pécher, de la chair de rhinocéros. Il faut dire pourtant que les musulmans, en général, craignent d'enfreindre la loi relativement aux viandes prohibées ; et ces scrupules ont été un obstacle au succès de leurs missions dans quelques parties de l'archipel Indien. Ainsi, j'ai remarqué qu'aux Moluques ils n'ont pas fait de convertis dans les îles où l'on n'a d'autres animaux domestiques que les cochons, parce que les indigènes refusaient de s'abstenir du porc, ce qui eût été pour eux renoncer entièrement à l'usage de la viande; au contraire, dans les îles où l'on avait des buffles, on a pu consentir à se priver de laid et on a fini par embrasser la nouvelle religion.
Ruminants. — Le chevrotain porte-musc. — « La chèvre qui produit le musc est comme nos chèvres pour la taille.... pour les corna, qui sont d'abord droites et ensuite recourbées; elle a deux dents minces et blanches aux deux mandibules; ces dents se dressent sur la face de la chèvre. »
Dans ce passage, comme dans tous ceux que présentent, relativement à l'animal du musc, les ouvrages antérieurs au xviie siècle, on trouve, avec certains traits inexacts, qui prouvent que les descriptions n'ont pas été faites de visu, d'autres traits qui montrent qu'elles ne sont pas purement imaginaires. Quelques naturalistes se sont récriés sur l'inexactitude des voyageurs qui avaient pu, suivant eux, comparer le même animal, tantôt a une chèvre ou à une gazelle, tantôt à un chat ou à un renard) les voyageurs, si dédaigneusement traités par beaucoup de savants de cabinet, doivent être, dans ce cas au moins, absous de l'accusation. Le commerce, en effet, nous fournit deux parfums d'origine animale, le musc et la civette, et quoique ces deux produits viennent de pays fort différents, on les a quelquefois confondus ; mais les voyageurs, lorsqu'il leur est arrivé d'employer un nom pour l'autre, n'ont point mêlé à l'histoire du ruminant asiatique, celle du carnassier africain, et l'on peut, dans toutes leurs descriptions, quelque négligées et quelque inexactes qu'elles soient, reconnaître, à des signes certains, l'animal dont ils ont voulu parler.
Telle est, en particulier, l'indication d'un caractère qui ne s'observe que chez un très petit nombre de ruminants, chez les chevrotains et chez quelques cerfs asiatiques à bois pédoncule : je veux parler de la longueur des canines. Abou-Zeid, comme on l'a vu, dit que ces longues dents sont au nombre de quatre, et le dressent des deux cotés de la face ; Marco Polo en indiquait le même nombre, mais il faisait descendre celles de la mâchoire supérieure. Avicenne avait été plus exact en assignant à l'animal deux dents recourbées en arrière ; mais, comme il les comparait à des cornes, il paraît bien qu'il les supposait dirigées en haut. Cazwini, enfin, en les assimilant aux défenses de l'éléphant, semblait dire qu'elles avaient la pointe dirigée en avant et en bas. La vérité est que ces canines, au nombre de deux, naissent de la mâchoire supérieure, se portent en bas en se recourbant légèrement en arrière, et dépassent les lèvres de trois à quatre travers de doigt.
Le porte-musc est, comme tous les chevrotants, dépourvu de cornes. Marco Polo, sur ce point, a évité l'erreur dans laquelle est tombé Abou-Zeid.
Tout ce que dit notre auteur de la formation du musc est à peu près la reproduction de ce qu'on trouve à ce sujet dans les écrivains chinois, qui ont d'ailleurs été plus précis dans ce qu'ils disent du sac où s'amasse la matière odorante. « Le parfum du musc, disent-ils, est situé près de l'ouverture du prépuce ; mais il est contenu dans un sac particulier. »
Notre auteur accuse les Chinois de falsifier tout le musc qui se récolte dans leur pays ; suivant lui, ces fraudes sont une des causes de l'infériorité du musc de Chine comparé à celui du Tibet ; mais il assigne encore à cette différence dans la qualité des produits une autre cause, la différence dans la végétation des deux pays. « La chèvre qui produit le musc trouve sur les frontières du Tibet des plantes odorantes (littéralement des épis à parfum), tandis que les provinces qui dépendent de la Chine n'offrent que des plantes vulgaires. »
J'insiste sur cette expression, des épis à parfum, parce qu'il me semble qu'elle fait allusion à un aromate anciennement très fameux, le spica-nardi, le nard des anciens, qui est très différent du nard des botanistes modernes, et qui se trouve en effet dans le Bhoutan et sur les frontières du Tibet : c'est une espèce de valériane dont la tige est à sa base entourée de fibres qui offrent l'apparence d'un épi.
Cette idée, que le porte-musc trouve, tout formés dans les substances dont il se nourrit, les principes odorants qui le font rechercher, paraît s'être présentée aussi à l'esprit des Chinois. Suivant eux, « l'animal, dans les mois d'été, mange une grande quantité de serpents et d'insectes. » Quelle raison a-t-on eue pour supposer qu'il adoptait, pour un temps, un genre de nourriture si différent de celui des autres animaux dont il se rapproche par son organisation? c'est parce qu'on avait remarqué le parfum qu'exhalent certains coléoptères, comme le cerambyx moschatus, et l'odeur musquée beaucoup plus forte, mais moins agréable, qu'exhalent les serpents, odeur qui est encore plus marquée dans d'autres reptiles, tels que les crocodiles. Pourquoi suppose-t-on que c'est seulement en été que l'animal recourt à cet étrange régime? c'est que l'été est la saison pendant laquelle le musc se forme et s'accumule dans la poche abdominale qui se trouve pleine à l'entrée de l'hiver.
Cétacés. — « Ils y remarquèrent un poisson (sur le dos duquel s'élevait quelque chose de) semblable à une voile de navire. Quelquefois ce poisson levait la tête et offrait une masse énorme »
L'animal qui, « en soulevant sa tête, offre une masse énorme, » est un cachalot, grand cétacé commun dans les mers tropicales, où les baleines au contraire ne se montrent que très rarement. Comme le cachalot cependant n'offre dans sa conformation rien qui puisse rappeler l'idée d'une voile de navire, et qu'au contraire l'aileron triangulaire que portent sur le dos, soit les baleinoptères,[6] soit certains grands dauphins (l'épaulard des Saintongeois, par exemple), représente assez bien, aux dimensions près, la voile latine, si commune sur les bâtiments employés dans les navigations dont il s'agit ici,[7] j'avais pensé d'abord que l'auteur avait pu, dans ce passage, mêler des traits empruntés à l'histoire de deux animaux différents. Toutefois, en me rappelant que tous les cétacés velifères sont très peu connus des Arabes, j'ai du renoncer à cette conjecture ; celle qui me paraît la plus probable aujourd'hui, c'est que la comparaison avec une voile de navire est du tait de quelque copiste, et que l'écrivain original, impressionné de la même manière que l'ont été tous les anciens voyageurs, à la vue de ces monstres marins, a dû les comparer aune montagne, à un rocher au milieu de la mer, ou à quelque chose de semblable.[8]
« Les vaisseaux qui naviguent dans cette mer redoutent beaucoup ce poisson... »
Les précautions indiquées comme propres à écarter les cachalots, précautions auxquelles recouraient, dès l'époque d'Alexandre, les navigateurs qui fréquentaient ces mers, étaient le résultat d'une crainte fort exagérée sans doute, mais qu'on aurait tort de croire complètement chimérique. En effet, dans la saison des amours, les cachalots, dont les allures sont habituellement très calmes, se livrent à des mouvements désordonnés ; on les voit soulever tout à coup et sortir à moitié hors de l'eau leur tête volumineuse, agiter violemment leurs nageoires et plonger en donnant de grands coups de queue. Une petite embarcation qui se trouverait alors à leur portée chavirerait infailliblement. Mais ces dommages involontaires ne sont pas les seuls qu'on puisse leur reprocher, et il leur est arrivé quelquefois, toujours dans cette époque de surexcitation, de se livrer à de véritables actes agressifs, lorsqu'ils craignaient pour leurs femelles, qu'ils tiennent alors rassemblées en troupeau, et sur lesquelles ils veillent avec une évidente anxiété. Des faits semblables à celui que je vais rapporter ont dû être observés dam les temps anciens, et auront fait aviser aux moyens d'éloigner un danger bien réel, sans doute, mais infiniment plus rare qu'on ne le supposait.
Le 13 novembre 1820, un navire baleinier des Etats-Unis, l’Essex, se trouvant dans les mers du Sud par 47° de latitude, aperçut un groupe de baleines, vers lequel il se dirigea. Bientôt les canots furent mis à la mer et s'avancèrent vers la troupe de cétacés, le navire suivant la même direction, mais plus lentement. Tout à coup on vit la plus grosse baleine 6e détacher du troupeau, et, dédaignant les faibles embarcations, s'élancer droit vers le navire. Du premier choc elle fracassa une partie de la fausse quille, et elle s'efforça ensuite de saisir entre ses mâchoires quelques parties des œuvres vives; ne pouvant réussir, elle s'éloigna de quatre cents mètres environ, et revint frapper de toutes ses forces la proue du bâtiment. Le navire, qui filait alors cinq nœuds, recula à l'instant avec une vitesse de quatre nœuds : il en résulta une vague très haute ; la mer entra dans le bâtiment par les fenêtres de l'arrière, en remplit la coque et le fit coucher sur le côté. Vainement les canots arrivèrent, il n'était plus temps de sauver l’Essex. Tout ce qu'on put faire en enfonçant le pont, fut d'extraire une petite quantité de pain... »
Quoique l'auteur de ce récit emploie le mot de baleine, il est évident, par tout ce qu'il dit, par la supériorité de taille qu'il donne à un des individus, par la mention qu'il fait de mâchoires armées de dents, que c'est à un cachalot qu'il faut attribuer la perte de l’Essex, c'est-à-dire à un de ces cétacés communs dans les mers de l'Inde, et contre lesquels avaient été imaginés les expédients mentionnés successivement par Néarque, Strabon et Philostrate.
« La mer jette sur les côtes de ces îles de gros morceaux d'ambre ; quelques-uns de ces morceaux ont la forme d'une plante ou à peu près. L'ambre pousse au fond de la mer comme les plantes; » et plus loin: « Quand le poisson, appelé tâl, aperçoit cet ambre, il l'avale ; mais cet ambre, une fois arrivé dans son estomac, le toc, et l'animal flotte au-dessus de l'eau. Il y a des gens qui... »
Dans ces deux passages, les faits signalés sont en général vrais, et les conjectures seulement sont fausses, comme l'ont été d'ailleurs celles des savants européens, jusqu'à une époque très rapprochée de nous.
Il est vrai qu'on trouve dans les mers tropicales des masses d'ambre flottant à la surface de l'eau, et que ces masses sont quelquefois poussées par les flots sur le rivage. Il est encore vrai que l'on en trouve quelquefois dans les entrailles des cachalots, et que dans ce cas les individus sont malades ou morts ; mais ce qui n'est pas exact, c'est de dire qu'ils aient avalé cette substance et qu'elle soit la cause de leur maladie. Il est certain que l'ambre se forme dans leurs intestins, et il est probable qu'il s'y forme de la substance des calmars dont les cachalots se nourrissent, par suite de réactions analogues à celles qui transforment la chair des cadavres en terre et, sous l'influence de conditions encore mal déterminées, en adipocire. Il paraît que quelque affection du tube digestif, d'une part, empêche la digestion des aliments ingérés, et, de l'autre, s'oppose à leur sortie, de sorte que l'accumulation devient quelquefois énorme, et que notre auteur n'exagère peut-être pas en comparant au volume d'un taureau celui des masses d'ambre qu'on a trouvées quelque fois flottant à la surface de la mer ou encore contenues dans le cadavre des cachalots. Au reste, il paraît, d'après les témoignages récents de divers baleiniers, que, dans le cas où ces énormes masses se présentent, une partie seulement, la plus anciennement formée, a pris les caractères de l'ambre, et que le reste diffère peu des fèces à l'état normal ; c'est cette dernière partie, sans doute, que l'auteur désigne sous le nom de mand.
Swediaur est un des premiers écrivains qui ait parlé convenablement de l'origine de cette substance, et, si je ne me trompe, c'est lui qui a fait remarquer que les sèches dont on trouve dans l'ambre les becs cornés (pris longtemps pour des becs d'oiseaux), ont elles-mêmes une odeur ambrée. M. Lesson, à la vérité, veut faire honneur de cette découverte a Marco Polo ; mais il ne m'est pas bien prouvé que le vieux voyageur eût à cet égard une opinion différente de celle des écrivains arabes ; il ne m'est pas prouvé non plus qu'il n'attribuât la production de ce parfum à la baleine commune plutôt qu'au cachalot, désigné dans l'ancien texte français sous le nom de cap d'oille et cap dol, correspondant au nom de capidoglio encore usité aujourd'hui en Italie ; au reste, je citerai le passage entier ou l'auteur parle des habitants de la côte de Madagascar.
« Ils ont anbre asex, por ce qe en cel mer a balene en grant abondance ; et encore hi a cap d'oille, et por ce qe ils prennent de ceste balene et de cette cap dol asez, ont de l'anbre en grant quantité, et vos savès que la balene fait l'anbre. »
« Avec les vertèbres du dos du poisson nommé tâl, on fait quelquefois des sièges sur lesquels l'homme peut s'asseoir à son aise. On dit que, dans un bourg..., appelé Altayn, il y a des maisons d'une construction extrêmement anciennes ; la toiture de ces maisons, qui sont légères, est faite avec des côtes de ce poisson »
Toutes les personnes qui ont eu occasion de voir le squelette du cachalot exposé dans une des cours du Muséum d'histoire naturelle, concevront très bien qu'on ait pu employer, pour servir de tabourets, les vertèbres de ce grand cétacé. Quant à l'emploi des os longs dans la charpente, emploi déjà mentionné par des écrivains antérieurs, il y a lieu de supposer que les pièces que l'on désigne sous le nom de côtes, sont les mâchoires. Dans nos ports on fait encore aujourd'hui cette mauvaise application du nom ; cependant, tous les baleiniers savent bien de quelle partie de l'animal provient cet os qu'ils détachent quelquefois, pour recueillir l'huile qui en découle quand on l'a suspendu verticalement le long du mât.
« Les pécheurs, quand ils prennent un de ces poissons, l'exposent au soleil et le coupent par morceaux ; à coté est une fosse où se ramasse la graisse....»
Il est assez étrange qu'on ne trouve ici rien de relatif au blanc de baleine, qui est un des produits importants du cachalot. Cependant, comme on ne tirait parti que des cadavres rejetés à la côte, il est probable que la décomposition était d'ordinaire trop avancée pour qu'on pût recueillir isolément le sperma-ceti, qui se mêlait avec l'huile que la chaleur du soleil faisait couler.
Squales. « Cette mer renferme un autre poisson que nous péchâmes. Sa longueur était de vingt coudées. Nous lui ouvrîmes le ventre et nous en tirâmes un poisson de la mime espèce ; puis, ouvrant le ventre de celui-ci, nous y trouvâmes un troisième poisson du même genre. Tous ces poissons étaient en vie et se remuaient. »
Il s'agit évidemment ici d'un poisson du genre des squales, genre dans lequel se trouvent beaucoup d'espèce vivipares, et en particulier celle que l'on désigne sous le nom de requin ; c'est probablement à l'une de ces espèces si connues et si détestées des navigateurs, que se rapporte le récit du voyageur arabe, récit que nous ne pouvons mieux faire apprécier qu'en le rapprochant de celui d'un naturaliste moderne dont le témoignage n'est pas suspect.
« Pendant que nous étions dans le golfe du Mexique, dit M. Audubon (Ornithol. biograph., tom. III, p. 521), nous primes, une après-midi, deux requins. L'un de ces poissons était une femelle de sept pieds de longueur ; nous l'ouvrîmes et nous trouvâmes dans son ventre deux petits vivants et qui paraissaient très capables de nager. Nous en jetâmes un aussitôt à l'eau, et, il n'y fut pas plus tôt, qu'il profita de sa liberté pour s'éloigner de nous, comme s'il avait déjà été accoutumé à pourvoir à sa propre sûreté.
Si Soleyman s'était contenté de dire qu'on avait trouvé dans le corps du petit requin quel que chose qui ressemblait à un troisième requin, il n'y aurait aucun reproche à lui faire, car un voyageur n'est pas obligé d'être anatomiste. Son tort est de donner à entendre qu'il a vu remuer ce prétendu avorton, au lieu d'avouer qu'il répète, à cet égard, ce qu'il a entendu dire à d'autres on ce qu'il a lu dans quelque relation. Il aurait pu, en effet, pour des exemples analogues, s'appuyer d'autorités imposantes et citer par exemple, Aristote, qui dit qu'en Perse, en ouvrant des souris qui étaient pleines, on trouva que les fœtus femelles étaient aussi en état de prégnation.
Rémora. « Ce grand poisson (celui dont il vient d'être parlé dans la note précédente) se nomme al-oual. Malgré sa grandeur, il a pour ennemi un poisson qui n'a qu'une coudée de long et qui se nomme al-leschek. Lorsque ce gros poisson, se mettant en colère, attaque les autres poissons au sein de la mer et qu'il les maltraite, le petit poisson le met à la raison ; il s'attache à la racine de son oreille et ne le quitte pas qu'il ne soit mort. Le petit poisson s'attache aux navires, et alors le gros poisson n'ose pas en approcher. »
Tout le monde reconnaîtra, dans ce passage, l'histoire du rémora, poisson dont la tête est garnie supérieurement d'un disque au moyen duquel il s'attache a divers corps animés ou inanimés, immobiles ou en mouvement. On le trouve souvent fixé de cette manière au corps des squales, et surtout à la base des nageoires (ce sont probablement les nageoires pectorales que l'auteur désigne sous le nom d'oreilles). Il n'est pas rare, lorsqu'on prend des requins en mer, d'amener avec eux sur le pont un échéneïs qui y est fixé. Je n'ai jamais observé le fait moi-même, mais M. Bory de Saint-Vincent dit en avoir été plusieurs fois témoin. L'échéneïs s'attache assez souvent aux vaisseaux, et l'on sait que les ancien» croyaient qu'il pouvait arrêter, en s'y fixant, un navire en pleine course. C'était ce qui lui avait valu le nom de rémora, par lequel ils le désignaient. L'échéneïs ou sucet, comme l'appellent nos marins, a une telle tendance à s'attacher aux corps un peu volumineux qui se présentent à sa portée, et s'y fixe si solidement, que les indigènes de l'archipel Caraïbe avaient pu se servir de cet animal comme d'une sorte de harpon vivant qui allait lui-même chercher la proie. Les pécheurs avaient habituellement au fond de leur barque un de ces paissons attaché avec une cordelette à la naissance de la queue. Voyaient-ils une tortue flotter à la surface de la mer, ils mettaient à l'eau leur rémora, qui, se dirigeant aussitôt vers l'animal, se fixait à la carapace v et leur donnait ainsi le moyen, non pas d'attirer violemment l'animal, mais de le diriger vers un bas-fond, où il leur était facile ensuite de s'en rendre maître. On peut voir dans Oviedo, Coronica de las Induit, lib. xiii, cap. 10, la relation très intéressante de cette sorte de pèche (édit. de Séville, 1547, p. 106 verso).
Je crois inutile de faire remarquer que l'échéneïs est absolument incapable de causer la mort d'un requin. Que ce tyran des mers redoute un si petit poisson, cela est aussi très peu vraisemblable : cependant, comme des expériences plusieurs fois répétées ont prouvé que, du moins à l'état de captivité, un lion et un tigre s'effrayent à la vue d'une souris, je n'oserais déclarer entièrement dusse l'opinion émise par l'auteur arabe.
« La même mer nourrit un poisson appelé al-lokham; c'est une espèce de monstre qui dévore les hommes. »
Quoique l'on ait quelquefois, à ce qu'il paraît, appliqué à l'espadon le nom de al-lokham, il est probable que, dans le passage que nous venons de citer, ce nom désigne un sélacien, peut-être, le pantouflier, qui, par sa forme étrange, mérite bien la qualification de monstre, et qui, par sa férocité, n'est guère moins redoutable que le requin. L'espadon, à cause de sa grande taille qui dépasse quelquefois six mètres, a été souvent confondu avec des squales et avec des cétacés ; mais, quoique sa force puisse le rendre redoutable aux habitants de la mer, il ne paraît pas qu'il ait jamais attaqué des hommes, et surtout il n'en a jamais dévoré. Je ne crois pas que ce soit parmi les poissons osseux qu'il faille chercher le lohkam, quoique certaines espèces, telles que la grande sphyrène américaine, qu'on appelle communément barracuda, soit fort redoutée des nageurs.
Poissons volante. « On trouve dans la même mer, un poisson dont la face ressemble à la (ace humaine, et qui vole au-dessus de l'eau. Ce poisson se nomme al-meydj. »
On connaît plusieurs espèces de poissons volants qui appartiennent à deux genres différents, les exocets et les dactyloptères : notre auteur me paraît avoir parlé des uns et des autres. Dans le passage que nous venons de citer, il ne peut être question qui d'un dactyloptère, et probablement de l'espèce connue sous le nom de d. orientalis, qui est commune dans les mers de l'Inde, et dont on trouve déjà une figure dans Bontius (Hist. nat. et med. Ind. orient. Amsterdam, 1658, p. 78). L’al-meydj à face humaine rappelle le pithèque à tête de singe d’Elien (Hist. anim., l. XII, c. xxvii), et la tête arrondie des dactyloptères fait comprendre cette comparaison. Au reste, la description d’Elien ne peut s'appliquer à aucune espèce particulière, car elle réunit des traits appartenant à deux poissons différents, celui dont nous venons de parler et le pégase dragon. Ce qui montre bien que ce chapitre renferme des renseignements relatifs à deux êtres distincts, c'est que plusieurs des caractères qu'il indique sont inconciliables; par exemple, il est impossible d'avoir à la fois une tête de singe et la bouche sous la gorge.
« Il y a, dit-on, dans la mer, un petit poisson volant ; ce poisson, appelé sauterelle d'eau, vole sur la surface de l'eau. »
Je ne doute point que ce passage ne se rapporte à un exocet ; le nom, tout étrange qu'il puisse paraître, me semble d'autant mieux choisi que, lorsque j'ai eu l'occasion d'observer pour la première fois dans les mers des tropiques le vol onduleux des exocets, il m'a rappelé complètement le vol des sauterelles, particulièrement celui d'une belle espèce à ailes bleues, commune dans quelques parties de la France, une grande variété du grillus coerulescens.
« ....Ce poisson se nomme al-meydj. Un autre poisson qui se tient sous l'eau l'observe, et, si le premier tombe, l'autre l'avale. Celui-ci s'appelle al-anketous. »
Je ne saurais dire quel est l'animal que Soleyman a voulu désigner sous le nom d'al-anketous, et, quoiqu'il en parle comme d'un poisson, je ne m'étonnerais pas qu'il s'agît ici d'un mammifère, puisque les marsouins, auxquels il n'eut pas hésité sans doute à appliquer cette expression, sont au nombre des ennemis les plus redoutables des poissons volants. A la vérité, lorsqu'ils se livrent à cette chasse, les marsouins ne se tiennent pas sous l’eau, et, au contraire, ils restent autant que possible à la surface, afin de suivre des yeux la direction que prend le troupeau volant; mais ce renseignement ne conviendrait pas mieux aux vrais poissons engagés dans la même poursuite, aux dorades, par exemple. Le capitaine Basil Hall a décrit les allures de ces dernières, avec son talent accoutumé, dans un passage qu'on me pardonnera de citer ici.
« … Une bande de dix à douze poissons volants sortit de l'eau près du gaillard d'avant et fila contre le vent en rasant notre bord. Elle fut aperçue, au passage, par une grande dorade qui, depuis quelque temps, nous tenait compagnie, et, qui dans ce moment jouait autour du gouvernail en étalant ses chatoyantes couleurs. Voir cette proie et s'élancer dans l'air après elle, ce fut pour la dorade l'affaire d'un même instant. Elle partit de l'eau avec la rapidité du boulet, et son premier saut ne fut pas de moins de trente pieds. Quoique la vitesse dont elle était animée en partant dépassât de beaucoup celle des poissons qu'elle poursuivait » comme ils avaient sur elle une grande avance, elle retomba assez loin derrière eux. Nous la vîmes pendant quelques instants serpenter étincelante entre deux eaux, puis repartir par un nouveau saut plus vigoureux que le premier....
« Cependant, les poissons poursuivis par l'ennemi, qui s'avançait à pas de géant, continuaient de fuir d'un mouvement égal, et en se maintenant toujours à une même hauteur. Ils rentrèrent enfin dans l'eau, mais ce ne fut guère que pour y humecter leurs ailes, et nous les vîmes reprendre un second vol plus vigoureux et plus soutenu que le premier… Ce qu'il y eut de remarquable, c'est que, cette fois, ils prirent une direction toute différente de la précédente. Il était évident qu'ils sentaient l'approche de leur persécuteur, et que par ce détour ils cherchaient à le mettre bon de la voie ; mais mi ne prit pas un seul instant le change, et, dès le bond suivant, il se dirigea de manière à les couper. Ils eurent plusieurs fois recours à la même tactique, mais tout aussi inutilement. Bientôt il ne fut que trop aisé de reconnaître qu'ils perdaient à la fois leur force et leur courage. Leur vol devenait à chaque fois plus court et plus incertain, tandis que les énormes sauts de la dorade semblaient s'allonger à mesure qu'ils l'approchaient davantage de sa proie. Elle la rejoignit enfin, et dès lors, modérant tous ses mouvements, elle s'arrangea de manière à arriver à chaque bond précisément au point où la petite troupe retombait épuisée. Déjà la chasse était trop loin de nous pour que du pont nous pussions la suivre ; mais nous la retrouvâmes en montant sur les manœuvres. Ce fut de là que nous vîmes les poissons volants disparaître successivement, les uns saisis au moment où ils venaient de se replonger dans l'eau, les autres avant même qu'ils eussent touché sa surface. »
L’anabas. « On parle d'un autre poisson de mer qui, sortant de l'eau, monte sur le cocotier et boit le suc de la plante ; ensuite il retourne à la mer. »
Quelque étrange que puisse paraître cette assertion, elle se rapporte à un fait attesté par des témoins assez graves pour qu'on ne puisse guère le révoquer en doute. Le poisson dont il est ici question, le sennal du Malabar, est organisé de manière à retenir de l'eau sous ses branchies, et l'on conçoit fort bien qu'il puisse vivre très longtemps dans l'air; mais, comme ses formes générales sont lourdes, on ne s'attendrait pas à le voir grimper aux arbres. C'est cependant ce qu'a constaté un officier au service de la compagnie des Indes, le lieutenant Daldorf, qui, en 1791, a trouvé un sennal à deux mètres de hauteur, sur un palmier à éventail, et l'a vu s'efforcer de s'élever encore. Nous reproduirons ici une partie de la note insérée à ce sujet dans les Transactions de la Société linnéenne. M. Daldorf rattachait à tort l'anabas aux perches, et le désignait sous le nom de perca scandens.
Le cauri (cypraea moneta). Les cauris se rendent à la surface de la mer et renferment une chose douée de vie. On prend un rameau de cocotier et on le jette dans l'eau; les cauris s'attachent au rameau. On appelle le cauri al-kabtadj.
Ce passage est assez obscur et, en partie du moins, inexact : des animaux dont la coquille est aussi pesante que celle des cauris ne peuvent s'élever à la surface de l'eau qu'en rampant le long des rochers. Cependant, comme les rameaux de palmier sur lesquels notre auteur dit que l'al-kabtadj s'attache, doivent flotter à la surface, on pourrait supposer que l'auteur a voulu parler d'autres mollusques à test plus léger; mais, outre que des coquilles minces et par conséquent fragiles n'auraient pas été propres à servir de monnaie, ce qui prouve bien qu'il s'agit de l'espèce qui, aujourd'hui, de même qu'au temps de notre voyageur, est employée à cet usage dans une grande partie de l'Inde, c'est que c'est encore aux Maldives qu'on la va chercher.
M. Lesson, qui l'a vu recueillir dans ces lieux, a bien voulu me donner à ce sujet quelques détails. Ce n'est pas à la surface, mais au fond de l'eau (dans des lieux où d'ailleurs la mer a très peu de profondeur) qu'on présente à l'animal le corps sur lequel il se fixe. L'appât consiste en un petit morceau de poulpe onde calmar, auquel le cauri s'attache par son manteau. Quelques fragments de coquille placés en guise de lest à l'extrémité inférieure de la ficelle qui porte l'appât, servent à la faire descendre verticalement. Avec cet appareil, tout grossier qu'il puisse paraître, on prend en assez peu de temps un grand nombre de cauris. On en charge aux Maldives des quantités énormes pour Bombay, et il en va beaucoup aussi en Afrique.
Le dattier. « Ni la Chine ni l'Inde ne connaissent le palmier. »
Il est évident que, dans ce passage, l'auteur, sous le nom de palmier, désigne seulement l'espèce qui est pour les Arabes le palmier par excellence : le dattier. Cet arbre est pour les musulmans l'objet d'une prédilection particulière et d'une sorte de respect religieux. Voici, par exemple, en quels termes en parle Kazwini dans les Merveilles de la nature : « Cet arbre bénit ne se trouve que dans les pays où l'on professe l'islamisme. Le prophète a dit, en parlant du dattier: honorez le palmier qui est votre tante paternelle; » il lui a donné cette dénomination parce qu'il a été formé du limon dont Adam fut créé. » (De Sacy, Chrestomathie arabe, 2e édition, tom. III, p. 395.)
Malcolm raconte, dans ses Sketches of Persia, qu'une femme arabe, qui avait été emmenée en qualité de nourrice par une dame anglaise, racontait à son retour toutes les merveilles dont elle avait été témoin en Europe. La peinture qu'elle faisait de nos pays était si attrayante, que ses auditeurs étaient déjà tout disposés à murmurer contre la Providence qui avait fait d'un tel paradis la demeure des infidèles, lorsque la voyageuse ajouta : « Il faut avouer, cependant, qu'il y a une chose qui manque en Angleterre. — Et laquelle ? s'écrièrent aussitôt tous les Arabes, enchantés de trouver un début à ce qui faisait jusqu'à ce moment l'objet de leur envie. — On n'y trouve pas un seul dattier. — Pas de dattiers ! — Je n'en ai pas vu un seul, vous dis-je, et je n'ai pas cessé un moment d'en chercher. » Dès ce moment, tous les autres avantages disparurent aux yeux des Arabes, qui se retirèrent pleins de mépris pour un pays où le dattier n'était pas connu, et s'étonnant que des hommes consentissent à y vivre.
Il y a une remarque générale à faire sur les transcriptions de mots chinois en arabe. L'écriture arabe, d'une part, à cause de l'absence des voyelles, de l'autre, par la ressemblance de plusieurs consonnes, qu'on ne parvient à distinguer entre elles qu'à l'aide de certains points quelquefois omis par les copistes, est très sujette à dénaturer les mets empruntés aux langues étrangères. Mais il y a eu une chance de plus avec le chinois. C'est une erreur de croire qu'en Chine on parle une même langue, et que là ou le dialecte est le même on s'entende parfaitement. Autrefois, presque chaque province avait son langage particulier. Maintenant, il existe, outre la langue savante des lettrés, un langage vulgaire commun à tout l'empire, et dont les dialectes du nord et du midi ne différent que pour la prononciation et quelques idiotismes ; mais chaque province, et souvent chaque arrondissement a son patois. De plus, on parle dans les provinces de Canton et du Fo-kien, qui sont situées sur la côte, et où commerçaient les Arabes et les Persans, comme y commercent aujourd'hui les Européens, deux langages inconnus au reste de l'empire. On fera bien de lire à ce sujet un mémoire intéressant de M. Bazin, intitulé : Mémoire sur les principes généraux du chinois vulgaire. (Journal asiatique des mois d'avril, mai, juin et août 1845.)
[5] Ces notes sont de M. le docteur Roulin, sous-bibliothécaire de l'Institut, à qui j'avais en occasion de demander quelques éclaircissements sur divers passages de la relation arabe. (Note de M. Reinaud.)
[6] Les baleinoptères ont au moins trois fois la taille des épaulards, ce qui n'empêche pas qu'ils ne puissent également, les uns et les autres, être rapprochés, pour les dimensions, des cachalots, animaux qui présentent à cet égard une énorme différence, suivant les sexes ; en effet, tandis que les mâles atteignent une longueur de 18 à 20 mètres, les femelles ne dépassent pas en général 8 ou 9 mètres. Les épaulards sont à peu près aussi grands. Hunter a donné, dans les Transactions philosophiques (année 1787), la figure d'un individu de 8 mètres de longueur, qui avait été pris a l'embouchure de la Tamise. Six ans plus tard, on en prît un autre dans les mêmes parages, qui était long d'environ 10 mètres. L'épaulard est peut-être de tous les cétacés celui dont la nageoire dorsale figure le mieux une voile triangulaire; les Hollandais ont comparé cette partie à un sabre, et ont désigné par suite l'animal sous le nom de schwerd-fisch.
[7] Voyez, dans l'ouvrage de M. Paris (Constructions navales des peuples extra-européens), les planches 10, 14, etc. où sont représentés divers bâtiments employés par les Arabes, qui naviguent dans la mer Rouge, le golfe Persique et sur les côtes du Malabar.
[8] M. Reinaud, en lisant les épreuves de cette note, m'a fait les remarques suivantes qui semblent prouver que ma conjecture est fondée. Le passage dans lequel se trouve l'expression voile de navire n'est point de l'auteur du reste de la relation. Le copiste qui l'a ajouté pour suppléer à une lacune du manuscrit original avait emprunté, sans doute, ce qu'il dit de notre cétacé au Kitab al'adjayb ou au Moroudj-al-dzeheb de Massoudi (t. Ier, fol. 45 verso).
L'auteur
du Kitab al-adjayb et Massoudi se servent
aussi du mot arabe  signifiant
voile de navire. Massoudi, cependant, emploie d'abord le mot
signifiant
voile de navire. Massoudi, cependant, emploie d'abord le mot
 qui a bien la même
signification, mais qui peut se traduire aussi par
rochers, montagnes, châteaux. Il y a lieu
de croire que ce dernier mot est celui qu'avait employé
l'auteur inconnu de la relation originale à laquelle ont
puise Massoudi et l'auteur du Ketab-al-adjayb, et que
c'est dans le sens de rocher qu'il l'avait entendu
qui a bien la même
signification, mais qui peut se traduire aussi par
rochers, montagnes, châteaux. Il y a lieu
de croire que ce dernier mot est celui qu'avait employé
l'auteur inconnu de la relation originale à laquelle ont
puise Massoudi et l'auteur du Ketab-al-adjayb, et que
c'est dans le sens de rocher qu'il l'avait entendu