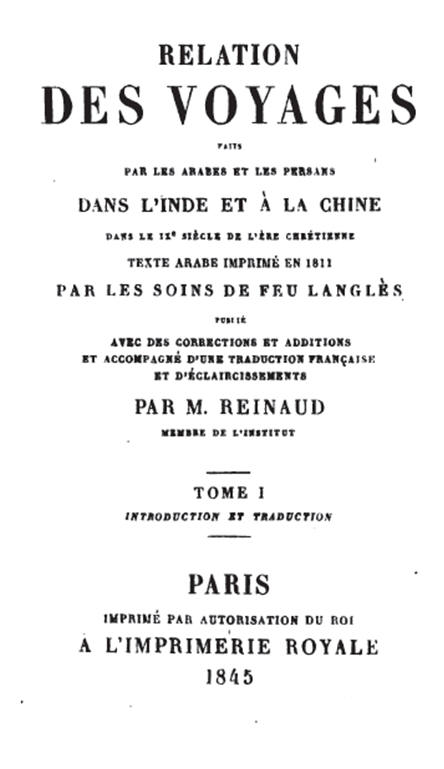
SOLEYMAN & ABOU ZEID HASSAN
ATTRIBUÉ A MASSOUDI
CHAINE DES CHRONIQUES.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
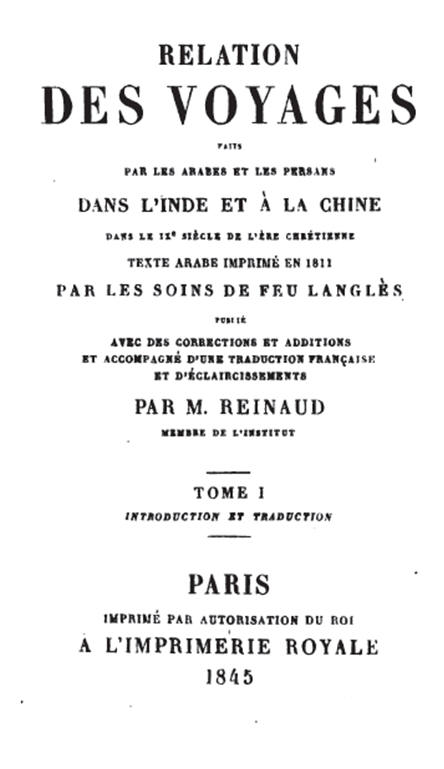
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
En 1718, un savant distingué par une instruction fort étendue, notamment dans les langues et les littératures de l'Orient, l'abbé Renaudot, publia un volume intitulé : Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux voyageurs mahométans qui y durent dans le ixe siècle de notre ère. Ces relations étaient traduites de la langue arabe, et Renaudot les avait accompagnées de remarques, dont plusieurs étaient fort intéressantes.
Le récit des voyageurs arabes jetait un jour tout nouveau sur les rapports commerciaux qui existèrent au ixe siècle entre les côtes de l'Egypte, de l'Arabie et des pays riverains du golfe Persique d'une part, et, de l'autre, les vastes provinces de l'Inde et de la Chine. Ce récit était d'autant plus curieux, qu'au moment même où l'on finissait de le mettre par écrit, les relations qui en forment l'objet s'étaient interrompues, et qu'elles ne reprirent que plusieurs siècles après, lorsque les Mongols, par la conquête successive de la Perse, de la Chine et de la Mésopotamie, eurent de nouveau mis en rapport immédiat les deux extrémités de l'Asie, et que l'Occident lui-même se trouva en communication avec l'Orient le plus reculé.
La partie du récit qui traite de la Chine n'était pas toujours d'accord avec ce que les savants missionnaires catholiques avaient écrit sur un pays si différent des autres. A la vérité, il y avait quelques erreurs provenant de Renaudot. Il n'eût pas été surprenant, d'ailleurs, que des marchands, qui ne parlaient pas la langue du pays et qui n'y étaient venus que pour des affaires commerciales, se fussent trompés sur quelques points. On accusa l'abbé Renaudot d'inexactitude et de légèreté; quelques-uns allèrent plus loin : comme Renaudot n'avait donné aucune indication précise du manuscrit d'où il avait tiré ce récit, se contentant de dire que le volume se trouvait dans la bibliothèque de M. le comte de Seignelay, on prétendit que l'abbé Renaudot avait lui-même forgé la relation, à l'aide de témoignages recueillis ça et là dans des ouvrages arabes.
La bibliothèque du comte de Seignelay, qui n'était autre que la bibliothèque fondée à grands frais par son aïeul, l'illustre Colbert, passa, il y a un peu plus d'un siècle, dans la grande Bibliothèque royale. En 1764, le célèbre Deguignes, que ses études sur la Chine et le reste de l'Asie avaient mis en état d'apprécier l'importance de la relation publiée par Renaudot, retrouva le manuscrit original dans l'ancien fonds arabe du département des manuscrits de la Bibliothèque royale, n°597. Ce manuscrit formait, dans l'origine, le n° 6004 de la bibliothèque Colbert, et il était entré dans cette riche collection l'an 1673, ainsi que le constate une note de la main du bibliothécaire, le célèbre Etienne Baluze. Conformément à ce que Renaudot avait indiqué dans sa préface, ou lit, à la suite de la relation, une série de remarques, écrites de la même main, sur l'étendue et les remparts de Damas, et de quelques autres villes de Syrie et de Mésopotamie , à l'époque où ces places étaient soumises à Nour-ed-Din, prince de Damas et d'Alep, vers l'an 1170 de notre ère, durant les guerres des croisades. Deguignes rendit compte de sa découverte dans le Journal des savants du mois de novembre 1764, et fit quelques remarques sur le travail de Renaudot. Plus tard, il revint sur le même sujet, dans le premier volume du recueil des Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi.
Les remarques de Deguignes renferment quelques observations importantes; mais il en est plusieurs qui manquent de fondement et qui montrent que Deguignes avait lu fort rapidement le manuscrit, ou qu'il ne l'avait que médiocrement compris. La traduction de Renaudot et plusieurs de ses notes annoncent également quelque précipitation. Il était donc devenu nécessaire, avec les progrès que la critique orientale a faits dans ces derniers temps, de soumettre la relation elle-même à un nouvel examen.
Le point par lequel il fallait commencer était la publication du texte arabe. Le manuscrit de la Bibliothèque royale est unique; il manque un certain nombre de feuillets à la relation ; la copie, quoique en général d'une écriture nette, offre de l'incertitude dans plusieurs endroits : on y trouve, d'ailleurs, des expressions qui peuvent fournir matière à difficultés. En 1811, feu M. Langlès fit imprimer l'édition qu'on voit ici, et inséra à la suite le morceau qui, dans le manuscrit, est placé immédiatement après, à savoir le tableau d'une partie des forteresses de la Syrie et de la Mésopotamie, au xiie siècle de notre ère. Mais, bien que M. Langlès ne soit mort qu'en 1824, il ne s'occupa pas de revoir l'édition, ni de l'accompagner d'une préface ou d'un avis quelconque, et l'édition est restée jusqu'à présent dans les magasins de l'Imprimerie royale.
Il est à croire que si M. Langlès laissa son travail inachevé, c'est qu'il n'en était pas entièrement satisfait. Cependant, l'on devait savoir gré à M. Langlès de la pensée qui l'avait dirigé, et il convenait de faire tourner son entreprise au profit du public savant. L'illustre Silvestre de Sacy, il y a une douzaine d'années, à une époque où il était inspecteur des types orientaux de l'Imprimerie royale, me proposa, au nom du Directeur, de revoir le texte imprimé sur le manuscrit, et de l'accompagner des remarques qui me paraîtraient nécessaires. La proposition de M. de Sacy me flatta; mais, après avoir lu le texte arabe, je n'osai pas me charger de la tâche qui m'était offerte. Je reconnus qu'il y avait une révision utile à faire ; en même temps je fus effrayé des difficultés qui se présentaient.
Depuis cette époque, je me suis beaucoup occupé de la géographie orientale. Une foule de questions, qui autrefois me paraissaient insolubles, se sont successivement éclaircies pour moi. Je me suis alors proposé moi-même à M. Lebrun, directeur de l'Imprimerie royale, pour la tâche à laquelle je m'étais jadis refusé; et M. Lebrun, dont tout le monde connaît le zèle éclairé, a bien voulu agréer ma proposition.
J'ai commencé par revoir avec soin le texte imprimé, et l'on trouvera, à la suite des notes de la traduction, les remarques auxquelles l'examen du manuscrit a donné lieu. Ensuite, je me suis occupé de contrôler et de compléter ce qui semblait inexact dans le manuscrit ou ce qui y manquait, à l'aide d'autres ouvrages où il est traité de matières analogues. Dès l'année 1764, Deguignes annonça que Massoudi, célèbre écrivain arabe de la première moitié du xe siècle de notre ère, avait, dans son ouvrage intitulé Moroudj-al-dzeheb, ou Prairies d'or, reproduit, quelquefois dans les mêmes termes, une partie de ce qui est dit dans cette relation. Je me suis empressé de lire ou plutôt de relire toute la première partie du traité de Massoudi, en relevant successivement les morceaux qui touchaient de près ou de loin au sujet en question. Ce travail de comparaison m'a mis en état d'éclaircir et de compléter plusieurs passages qui, sans cela, auraient été incompréhensibles. Il existe un autre ouvrage de Massoudi où j'avais remarqué plusieurs faits qui se trouvent aussi dans la présente relation. Cet ouvrage est intitulé, dans la plupart des manuscrits, Ketab-al-adjayb, ou Livre des merveilles.[1] On y remarque une suite de récits sur les différentes parties dont se compose l'univers et sur la manière dont, suivant les idées romanesques des musulmans, elles ont été successivement formées ; vient ensuite un tableau des mers orientales, ainsi que des côtes qu'elles baignent et des îles qui y sont contenues. Cette partie, comme le reste du volume, est surchargée de fables, et montre que l'auteur, conformément au titre dont il avait fait choix, avait pris à tâche de recueillir ce qui était le plus propre à frapper les imaginations. Si ce traité est réellement l'ouvrage de Massoudi, le manque de critique et le désordre qui se remarquent dans le cours de la narration me font croire qu'il a été rédigé dans la jeunesse de l'auteur. Quoi qu'il en soit, au milieu de récits absurdes, on rencontre des détails vrais et curieux. Pour donner au public une idée exacte des rapports qui existent entre la présente relation et les deux ouvrages de Massoudi, j'ai placé à la suite du texte de la relation deux morceaux extraits, le premier du Ketab-al-adjayb, le deuxième du Moroudj-al-dzeheb. L'un et l'autre ont été tirés des manuscrits de la Bibliothèque royale, et revus sur plusieurs exemplaires.
Je n'ai pas jugé utile d'accompagner ces deux morceaux d'une traduction; car on en trouvera l'équivalent dans la relation même, ainsi que dans les notes et le discours préliminaire. Mais ils auront l'avantage de remplir à peu prés les deux lacunes qui interrompent la présente relation. Les premiers feuillets du manuscrit sont perdus. Il est vrai que l'ancien propriétaire du volume, croyant lui rendre par là toute sa valeur, a mis en tête un nouveau commencement. … mais cette addition est tout à fait étrangère au récit original. Il en est de même du titre placé en tête. Ce titre, qui est Salfalal-altevarykh, ou Chaîne des chroniques, n'a aucun rapport avec le contenu de l'ouvrage, et on ne le trouve pas indiqué dans les traités de bibliographie arabe. Le véritable titre me paraît avoir été Akhbar-al-Syn oual-Hind, c'est-à-dire : Observations sur la Chine et l'Inde. Tel est du moins le titre que porte le commencement de la deuxième partie, commencement qui appartient sans aucun doute au corps de l'ouvrage. Malheureusement je n'ai pas non plus trouvé de mention de ce titre dans les livres arabes de bibliographie………………
Comme la traduction de l'abbé Renaudot ne me paraissait pas suffisamment exacte, j'en donne ici une nouvelle. Ma traduction est accompagnée de notes, pour lesquelles j'ai quelquefois mis à contribution les remarques de Renaudot et de Deguignes. J'ai eu soin d'indiquer ces emprunts ; quant aux points nombreux pour lesquels je me suis éloigné de la manière de voir de ces deux illustres savants, je n'ai pas à en parler; c'est au public à s'en rendre compte. Ici je me bornerai à quelques observations générales et à ce qui tient à l'ensemble même de la relation.
Le titre que Renaudot a placé en tête de sa traduction n'est point exact. Renaudot a parlé de deux voyageurs ; il n'y a eu qu'un voyageur, ou bien il faut compter comme voyageurs tous les marchands ou curieux d'entre les Arabes qui, au ixe siècle de notre ère, allaient commercer dans l'Inde et à la Chine, et dont les récits contribuèrent plus ou moins à la composition du présent traité.
Le récit qui sert de base à la relation, et qui porte dans le texte le titre de Livre premier, a pour garant un marchand nommé Soleyman, qui s'était embarqué sur les côtes du golfe Persique, et qui fit plusieurs voyages dans l'Inde et à la Chine. La rédaction du livre premier eut lieu l'an 237 de l'hégire (851 de J. C.) C'est l'époque où les rapports commerciaux de l'empire des Khalifes de Bagdad avec l'Inde et la Chine étaient dans leur plus grande activité. Soleyman s'exprime ainsi dans plusieurs endroits de sa narration : « Nous péchâmes, j'ai vu; » dans le chapitre de l'Inde, il parle d'un djogui qu'il avait vu s'exposant tout nu aux rayons d'un soleil ardent, et qu'il retrouva quatorze ans après dans la même situation; mais on aurait tort de conclure de là que Soleyman lui-même est l'auteur de la relation; on lit dans les remarques qui accompagnent la première partie, que la rédaction a été faite d'après ses récits. ….. Tout ce qui suit, jusqu'à la fin, appartient à un amateur de connaissances géographiques, lequel se nommait Abou-Zeyd-Hassan, et était originaire de la ville de Syraf, port de mer alors très fréquenté, dans le Farsistan, sur les bords du golfe Persique.
Abou-Zeyd n'était jamais allé dans l'Inde et à la Chine, comme l'ont cru Renaudot et Deguignes. Tout ce qu'il dit, il le tient de personnes qui le lui avaient rapporté. Il s'explique de la manière la plus nette à ce sujet, dès les premières lignes de son récit, et il déclare que son seul objet a été de modifier et de compléter le récit du marchand Soleyman, d'après ce qu'il avait recueilli dans ses lectures, et d'après ce qu'il tenait de la bouche des personnes qui avaient parcouru les mers orientales.
Abou-Zeyd, poursuivant le cours de ses observations, dit que, postérieurement à l'époque où le marchand Soleyman racontait ses aventures, l'état de tranquillité où se trouvait la Chine avait changé, ce qui avait ralenti les voyages de Chine, et les avait même interrompus. Là-dessus il raconte une révolte, qui était survenue en Chine l'an 264 de l'hégire (878 de J. C.), la fuite de l'empereur de sa capitale, etc.
L'ensemble du récit montre clairement qu'Abou-Zeyd vivait au moment où les événements de Chine avaient changé la face de l'Asie orientale. Mais voici un témoignage qui achève de nous fixer. Massoudi rapporte, dans le Moroudj-al-dzeheb, que, se trouvant à Bassora l'an 303 de l'hégire (916 de J. C.), il eut occasion de voir dans cette ville un homme appelé Abou-Zeyd-Mohammed, fils de Yézid et cousin du gouverneur de Syraf. Abou-Zeyd, que Massoudi représente comme une personne intelligente et instruite, avait quitté Syraf sa patrie, pour venir s'établir à Bassora, ville qui, bien qu'en ce moment déchue de son ancienne prospérité, était le rendez-vous des navigateurs. L'auteur de la deuxième partie de la relation se nomme Hassan, et Massoudi parle ici d'un homme appelé Mohammed; mais tout porte à croire qu'il ne s'agit que d'une seule et même personne. Massoudi raconte en cet endroit le voyage fait, quarante ans auparavant, dans l'Inde et à la Chine, par un Arabe établi à Bassora, lequel se nommait Ibn Vahab. Cet Arabe, non content d'aborder sur les côtes de Chine, comme le faisaient ses compatriotes, avait voulu visiter la capitale de l'empire, à deux mois de distance de la mer, et s'était fait présenter à l'empereur. Massoudi commence par dire qu'Ibn Vahab raconta ce qu'il avait vu à Abou-Zeyd de Syraf, lequel le lui communiqua à son tour. Or ce même récit se trouve dans la présente relation, et Abou-Zeyd dit, entre autres choses : « Nous questionnâmes Ibn Vahab, etc. »
Il résulte évidemment de là qu'Abou-Zeyd a fourni à Massoudi un certain nombre de faits qui se trouvent dans le Moroudj-al-dzeheb. Massoudi a également fait des emprunts au premier livre, rédigé d'après les récits du marchand Soleyman ; car on retrouve dans le Moroudj ce qui est dit ici d'un usage pratiqué dans l'île de Serendyb, lorsque le roi venait à mourir; seulement Massoudi parle en témoin oculaire. En effet, Massoudi, qui s'appliquait des vers arabes dont le sens est : « Je me suis tellement éloigné vers le Couchant, que j'ai perdu jusqu'au souvenir du Levant, et mes courses se sont portées si loin vers le Levant, que j'ai oublié jusqu'au nom du Couchant », avait parcouru dans tous les sens les mers de l'Arabie, de la Perse et de l'Inde. On comprend, en même temps, que Massoudi, bien qu'Abou-Zeyd n'ait jamais fait mention de son nom, a communiqué à son tour au second plus d'une observation importante. Abou-Zeyd parle d'un trait de courage féroce d'un Indien qui, avant de se jeter dans un feu ardent, se perça le cœur avec son khandjar. Il cite pour garant le témoignage d'un voyageur; et ce voyageur est Massoudi, qui parle de ce qu'il avait vu de ses propres yeux, et qui accompagne le récit de quelques nouvelles circonstances !
Après un examen attentif du Moroudj-al-dzeheb et de la présente relation, je me crois en droit de conclure qu'Abou-Zeyd et Massoudi étaient contemporains, qu'ils se sont vus et qu'ils se sont fait réciproquement des communications. Abou-Zeyd a pris copie des notes que lui fournissait Massoudi, et les a en général reproduites dans les mêmes termes, ayant soin seulement de parler à la troisième personne, là où Massoudi figurait comme témoin oculaire, A son tour, Massoudi a profité des observations qu'avait recueillies Abou-Zeyd. Cette explication rend compte, ce me semble, d'une part, de ce qu'il y a de commun dans les deux ouvrages, et, de l’autre, de quelques variantes dans le récit, variantes qui sont indépendantes de la différence du plan qui avait présidé à. la rédaction des deux traités. On trouve d'ailleurs dans le Moroudj, notamment dans la partie qui touche à l'histoire orientale, des faits qu'on chercherait vainement dans la présente relation : d'un autre côté, cette relation contient plusieurs remarques qui n'auraient pas été déplacées dans le Moroudj.
Une des considérations qui me font croire que la relation ne peut pas être de Massoudi lui-même, c'est la manière dont les faits y sont présentés. Massoudi, qui s'était donné beaucoup de peine pour recueillir des renseignements, et qui tenait à ce que le public lui en sût gré, ne s'est pas borné, en divers endroits de son Moroudj, à s'élever contre les écrivains peu délicats qui cherchent à s'approprier les matériaux rassemblés par autrui. Dans son Moroudj, comme dans ses autres écrits, à mesure qu'il a rapporté un passage emprunté à un auteur, chose qui lui arrive souvent, il ne manque jamais de reprendre en ces termes : « Massoudi rapporte, etc.[2] »
Le récit d'Abou-Zeyd et la relation entière se terminent par ces mots, qu'a omis Renaudot : «Voilà ce que j'ai entendu raconter de plus intéressant dans ce temps-ci, au milieu des nombreux récits auxquels donnent lieu les voyages maritimes. Je me suis abstenu de rien reproduire des narrations mensongères que font les marins, et auxquelles les narrateurs eux-mêmes n'ajoutent pas foi. Un récit fidèle, bien que court, est préférable à tout. C'est Dieu qui dirige dans la droite voie. »
La manière dont Abou-Zeyd s'est exprimé en commençant, et la manière dont il termine le livre, me paraissent donner une idée exacte de l'origine de cette relation et du plan qui a présidé à sa rédaction. Il n'y a véritablement qu'une relation, c'est celle qui a été écrite d'après les récits du marchand Soleyman, et qui était antérieure de plus de soixante ans à Massoudi et à Abou-Zeyd. La deuxième partie, qui est l'ouvrage de celui-ci, n'est qu'une suite de remarques tendant à modifier, à expliquer ou à confirmer le récif du marchand. Voilà d'où est venu le manque d'ordre et de proportion qui se fait sentir dans l'ensemble de la rédaction.[3]
On trouve à la fin du traité ces mots écrits de la main du copiste : « Collationné avec le manuscrit sur lequel cette copie a été faite, au mois de safar de l'année 596 (novembre 1199 de J. C.). » Ces mots prouvent que le manuscrit a été copié vers la fin du xiie siècle de notre ère. Renaudot attribuait au volume un peu plus d'ancienneté; il s'exprime ainsi dans sa préface : « Son antiquité se connaît assez par le caractère; mais il y a une marque certaine qu'il a été écrit avant l'an de l'hégire 569, qui répond à celui de J. C. 1173; car on trouve à la fin quelques observations de la même main, touchant l'étendue de Damas et d'autres villes de Syrie, dont Nour-ed-Din était le maître, et l'écrivain parle du prince comme étant encore vivant. Or ce prince mourut l'année qui vient d'être marquée. » Il est certain que dans le manuscrit on lit ces mots : « Mesure de quelques-unes des villes soumises au prince juste Nour-ed-Din Aboul-Kassem-Mahmoud, fils de Zengui, l'année 564 (1169 de J. C.). » Mais le nom de Nour-ed-Din est accompagné des mots: « De qui Dieu ait pitié, et dont il illumine la tombe ; » et ces mots prouvent qu'au moment où les observations furent mises par écrit, Nour-ed-Din était mort. Il est facile, du reste, de lever cette légère contradiction , en disant que l'état des forteresses, tel qu'il est présenté dans le manuscrit, fut dressé du vivant même de Nour-ed-Din et par ses ordres, mais que la présente copie ne fut faite qu'environ trente ans après sa mort.
Voilà ce que j'avais à dire sur la manière dont cette relation a pris naissance, et sur les circonstances qui ont accompagné sa publication en Europe. Mais cette préface serait incomplète, si on n'y indiquait les connaissances géographiques des Arabes à l'époque où la relation fut rédigée, du moins en ce qui concerne les mers orientales, et si on ne décrivait les itinéraires suivis par les navigateurs arabes, indiens et chinois. Ces deux importantes faces du sujet sont restées presque entièrement cachées à Renaudot et à Deguignes, et ce n'est que de nos jours qu'il est devenu possible de les éclaircir.
……………………………………………………………………………………………………….

« Les navires descendaient de la côte occidentale de l'Inde par la mousson du nord-est, vers décembre, et arrivaient en janvier près de Ceylan. La relation (de Soleyman et de son continuateur) nous dit, en effet, qu'entre Mascate, Koulam-Malay et la mer d'Herkend, il y a environ un mois de navigation. Ils doublaient la pointe de Galles, après avoir, probablement, préalablement reconnu le cap Comorin, en quittant les Maldives; ils arrivaient à Sumatra vers la fin de février ou les premiers jours de mars, époque à laquelle commence à souffler avec moins de violence la mousson du nord-ouest, que l'on rencontre en s'approchant de cette île. De la sorte les navires ne touchaient en aucune façon la côte de Coromandel. Cette route directe est encore celle qu'indique Mannevillette. Cet hydrographe prescrit, en effet, aux navires qui quittaient Ceylan d'aller reconnaître les îles situées au nord d'Achen, en conservant autant que possible la latitude de 5° 50', avant d'aller à la rade de Keydah. De la pointe d'Achen, les navires arabes se rendaient à Malacca par la mousson du sud-ouest, la plus favorable pour cette navigation, cette mousson se déclarant vers le mois d'avril. Ils passaient au sud des Nicobar ou dans les canaux qui sont entre ces îles et la petite Andaman, ou entre Poulo-Rondo et la grande Nicobar. S'il ventait grand frais du sud-ouest au nord-ouest, ils s'approchaient des îles Nias, qui sont en dehors de la pointe d'Achen, ce que font encore aujourd'hui les marins. De Malacca ils se rendaient, par le détroit de Malacca, à la côte de Cambodge, qu'ils longeaient, ainsi que celle de Cochinchine, jusqu'à la hauteur de Phu-yeu, d'où ils se dirigeaient directement vers la Chine, poussés par la mousson du sud-ouest, et arrivaient vers juin ou juillet. En naviguant à cette époque dans la mer de Chine, les navires évitaient ainsi les ty-fongs, qui ne se déclarent guère qu'au mois de mai, et les tempêtes, qui ne deviennent fortes et fréquentes qu'à partir de juillet. Tel est l'itinéraire qui nous paraît ressortir de la relation de Soleyman. » (Alfred Maury.)

Ce livre renferme une chaîne de chroniques (1), de pays, de mers, des diverses espèces de poissons. L'on y trouve aussi un tableau de la sphère et des choses merveilleuses de ce monde, ainsi que de.la situation approximative des villes et de la partie habitée de la terre, des animaux, de ce que la terre contient de singulier, et autres choses du même genre. C'est un livre précieux.
Voici la description de la mer qui est située entre l'Inde et le Sind, des pays de Gouz et de Mâgouz, de la montagne de Caf, du pays de Serendyb et de la victoire d'Abou-Hobaysch. Abou-Hobaysch est le s. nom d'un homme qui vécut deux cent cinquante-ans. Une année, il se rendit dans le Mâgouz et y vit le sage Al-saouah, avec lequel il se porta vers la mer (2). Ils y remarquèrent un poisson (sur le dos duquel il s'élevait quelque chose de) semblable à une voile de navire. Quelquefois ce poisson levait la tête (3) et offrait une masse énorme. Quand il rendait de l'eau par la bouche, on voyait, pour ainsi dire, s'élever un-haut minaret. Au moment ou la mer était tranquille, lorsque les poissons se ramassaient sur un même point, il les enlevait avec sa queue; ensuite il ouvrait la bouche, et on voyait le» poissons se précipiter dans son ventre et disparaître comme au fend d'un puits. Les vaisseaux qui naviguent dans cette mer redoutent beaucoup ce poisson. La nuit, les équipages font sonner des cloches semblables aux cloches des chrétiens (4) ; c'est afin d'empêcher «e poisson de s'appuyer sur le navire et de le submerger (5).
Cette mer renferme un autre poisson que nous péchâmes ; sa longueur était de vingt coudées. Nous lui ouvrîmes le ventre, et nous en tirâmes un poisson de la même espèce; puis, ouvrant le ventre à celui-ci, nous y trouvâmes un troisième poisson du même genre. Tous ces poissons étaient en vie et se remuaient; ils se ressemblaient pour la figure les uns aux autres.
Ce grand poisson se nomme al-ouâl. Malgré sa grandeur, il a pour ennemi un poisson qui n'a qu'une coudée de long et qui se nomme al-leschek. Lorsque le gros poisson, se mettant en colère, attaque les autres poissons au sein de la mer, et qu'il les maltraite, le petit poisson le met à la raison : il s'attache à la racine de son oreille et ne le quitte pas qu'il ne soit mort. Le petit poisson s'attache aux navires, et alors le gros poisson n'ose pas en approcher, à cause de la crainte que l'autre lui inspire.
On trouve dans la même mer un poisson dont la face ressemble à la face humaine, et qui voie au-dessus de l'eau. Ce poisson se nomme al-meydj. Un autre poisson, qui se tient sous l'eau, l'observe, et, si le premier tombe, l'antre l'avale. Celui-ci s'appelle al-anketous. En général, les poissons se mangent les uns les autres (6). La troisième mer porte le nom de mer de Herkend (7). Entre cette mer et la mer Al-larevy il y a un grand nombre d'îles; leur nombre s'élève, dit-on, à mille neuf cents (8). Ces îles forment la séparation des deux mers Al-larevy et Herkend; elles sont gouvernées par une femme. La mer jette sur les côtes de ces îles de gros morceaux d'ambre; quelques-uns de ces morceaux ont la forme d'une plante (9) ou à peu près. L'ambre pousse au fond de la mer, comme les plantes; quand la mer est très agitée, elle rejette l'ambre sous forme de citrouilles et de truffes (10). Ces îles, qui sont gouvernées par une femme, sont plantées de palmiers cocotiers. La distance qui sépare les lies l'une de l'autre est de deux, ou trois, ou quatre parasanges. Elles sont toutes habitées, et toutes portent des cocotiers. La monnaie y consiste en cauris; la reine amasse ces cauris dans ses magasins. On dit qu'il n'existe pas de peuple plus adroit que les habitants de ces îles. Ils fabriquent des toniques tissues d'une seule pièce, avec leurs manches, leurs parements et leur bordure. Ils construisent leurs navires et leurs maisons, et se chargent de tous les travaux du même genre. Les cauris se rendent à la surface de la mer, et renfermant une chose douée de vie. On prend un rameau de cocotier et oh le jette dans l'eau; les cauris s'attachent au rameau. On appelle le cauri al-kabtadj (11).
La dernière de ces îles est Serendyb, sur la mer de Herkend ; c'est la principale de toutes : on donne à ces îles, le nom de Dybadjat (12). Auprès de Serendyb est la pêcherie des perles. Serendyb est environnée tout entière par la mer (13). On remarque dans l'île une montagne, appelée Al-rohcun, sur laquelle fut jeté Adam, sur lui soit la paix (14) ! La trace de son pied est marquée sur le roc qui couronne la montagne, gravée dans la pierre, au sommet de la montagne. On n'y remarque qu'un seul pied; il est dit qu'Adam plaça son autre pied dans la mer. On ajoute que le pied dont la trace est empreinte au haut de la montagne est d'environ soixante et dix coudées de long. Autour de cette montagne est la mine de rubis rouges et jaunes et d'hyacinthes. L'île est soumise à deux rois. Elle est grande et large, et elle produit de l’aloès, de l'or et des pierres précieuses. On trouve dans ses parages la perle, et le schenek,[4] mot par lequel on désigne cette grande coquille qui sert de trompette, et qui est très recherchée.
La même mer renferme, dans la même direction que Serendyb, quelques îles qui ne sont pas nombreuses, mais qui sont très vastes, et dont on ne connaît pas l'étendue précise. Au nombre de ces îles est celle qu'on nomme Al-ramny (15) ; cette île est partagée entre plusieurs rois; son étendue est, dit-on, de huit ou neuf cents parasanges (16). Il s'y trouve des mines d'or; on y remarque aussi des plantations appelées amour et d'où l'on tire le camphre de première qualité (17).
Ces îles ont dans leur dépendance d'autres îles, parmi lesquelles est celle de Al-neyan (18). Ces îles abondent en or, et les habitants se nourrissent du fruit du cocotier. Ils s'en servent dans la préparation de leurs mets, et ils se frottent le corps avec son huile. Quand l'un d'eux veut se marier, il ne trouve de femme qu'autant qu'il a entre les mains le crâne de la tété d'un de leurs ennemis; s'il a tué deux d'entre les ennemis, il peut épouser deux femmes; s'il en a tué cinquante, il peut épouser cinquante femmes, suivant le g. nombre des crânes. L'origine de cet usage vient de ce que les habitants de cette île sont entourés d'ennemis; celui donc qui se montre le plus hardi dans les combats est le plus estimé de tous.
L'île de Ramny produit de nombreux éléphants, ainsi que le bois de Brésil (baccam) et le bambou (khayzoran). On y remarque une peuplade qui mange les hommes. Cette île est mouillée par deux mers, la mer de Herkend et celle de Schelaheth (19).
Après cela viennent les lies nommées Lendjebâlous (20). Ces îles nourrissent un peuple nombreux. Les hommes et les femmes vont nus; seulement, les femmes couvrent leurs parties naturelles avec des feuilles d'arbre. Quand un navire passe dans le voisinage, les hommes s'approchent dans des barques, petites ou grandes, et se font donner du fer en échange d'ambre et de cocos. Ils n'ont pas besoin d'étoffes, vu que, dans ce climat, on n'éprouve ni froid ni chaud.
Au delà sont deux îles, séparées par une mer nommée Andaman (21). Les habitants de ces îles mangent les hommes vivants ; leur teint est noir, leurs cheveux sont crépus, leur visage et leurs yeux ont quelque chose d'effrayant. Ils ont las pieds longs ; le pied de l'un d'entre eux est d'environ une coudée (22). Ils vont nus et n'ont pas de barques. S'ils avaient des barques, ils mangeraient tous les hommes qui passent dans le voisinage. Quelquefois, les navires sont retenus en mer, et ne peuvent continuer leur voyage À cause du vent. Quand leur provision d'eau est épuisée, l'équipage s'approche des habitants et demande de l'eau; quelquefois les hommes de l'équipage tombent au pouvoir des habitants, et la plupart d'entre eux sont mis à mort.
Au delà de cette lie se trouvent des montagnes qui ne sont pas sur la route, et qui renferment, dit-on, des mines d'argent. Ces montagnes ne sont pas habitées, et il n'est pas au pouvoir de tout navire n. qui veut y aborder, d'atteindre son but. Pour y arriver, l'on est guidé par un pic nommé Al-khoschnâmy. Un navire, passant dans le voisinage, l'équipage aperçut la montagne et se dirigea de son côté; le lendemain matin, il descendit dans une barque, et, coupant du bois, il alluma du feu; aussitôt l'argent entra en fusion : voilà comment on reconnut la mine. On emporta alitant d'argent qu'on voulut; mais, dis qu'on fut remonté dans le navire, la mer commença à s'agiter; on fut obligé de jeter tout l'argent qu'on avait pris. En vain on a voulu retourner vers la montagne; il a été impossible de la retrouver. Ces sortes de cas sont fréquents sur la mer; on lie saurait dénombrer les îles qui sont d'un accès difficile et que les marins ont de la peine à reconnaître; il y en a même où ils ne peuvent atteindre.
Quelquefois on aperçoit à la surface de cette mer un nuage blanc qui couvre les vaisseaux de son ombre ; il sort du nuage une langue longue et mince qui vient s'attacher à la surface de l'eau de la mer. Aussitôt l'eau entre en ébullition et présente l'image d'un tournant. Si le tournant atteint un navire, il l'absorbe. Ensuite, le nuage s'élève dans les airs, et il verse une pluie à laquelle se trouvent mêlées les impuretés de la mer. J'ignore si ce nuage s'alimente avec les eaux de la mer et comment cela s'opère (23).
Chacune de ces mers est exposée à un vent qui l'agite et la soulève au point de la faire bouillir comme Une marmite. Alors l'eau rejette les corps qu'elle contient dans son sein sur les cotes des îles qui y sont enfermées; les navires sont fracassés, et le rivage se couvre de poissons morts d'une grandeur énorme. L'eau jette même quelquefois des blocs de pierre et des montagnes, comme l'arc envoie la flèche. Pour la mer de Herkend, elle est exposée à un Vent particulier. Ge vent vient de l'ouest, en tirant vers les étoiles de l'Ourse (24) ; quand il souffle, l'eau de la mer entre en ébullition comme l'eau d'une marmite, et elle vomit une grande quantité d'ambre. Plus la mer est vaste et profonde, plus l'ambre est beau. Quand les vagues de la mer de Herkend se soulèvent, l'eau présente l'apparence d'un feu qui brûle. La même mer nourrit un poisson nommé al-lokham (25). C'est une espèce de monstre qui dévore les hommes (26).
Les marchandises (venant de la Chine) sont en petite quantité (et chères, à Bassora et à Bagdad). Une des causes de cette petite quantité, ce sont les incendies qui ont lieu fréquemment à Khanfou (27). Cette ville sert d'échelle aux navires; c'est l'entrepôt des marchandises des Arabes et des habitants de la Chine. Les incendies y dévorent les marchandises; ils viennent de ce que les maisons y sont bâties en bois et avec des roseaux fendus (28). Une autre cause de la rareté des marchandises, ce sont les naufrages des navires, soit en revenant, soit en allant; ajoutez à cela que les navires sont exposés à être pillés, ou bien sont forcés de faire un long séjour dans certains endroits, ce qui oblige les voyageurs à se défaire de leurs marchandises hors des provinces arabes. D'autres fois, le vent pousse les navires dans le Yémen ou dans d'autres contrées, et c'est là qu'on vend les marchandises. Enfin on est quelquefois obligé de s'arrêter pour faire radouber le navire, sans compter d'autres obstacles.
Le marchand Soleyman rapporte qu'à Khanfou, qui est le rendez-vous des marchands, un musulman est chargé par le souverain du pays de juger les différends qui s'élèvent entre les hommes de la même religion arrivés dans la contrée. Telle a été la volonté du roi de la Chine. Les jours de fête, cet homme célèbre la prière avec les musulmans; il prononce le khotba et adresse des vœux au ciel pour le sultan des musulmans (29). Les marchands de l'Irak ne s'élèvent jamais contre ses décisions, en effet, il agit d'après la vérité, et ses décisions sont conformes au livre de Dieu (l'Alcoran) et aux préceptes de l'islamisme.
A l'égard des lieux où les navires abordent, et qui servent d'échelle, on rapporte que la plupart des vaisseaux chinois partent de Syraf (sur les côtes du Farès). Les marchandises sont apportées de Bassora, de l'Oman et d'autres contrées à Syraf même; on les charge à Syraf sur les vaisseaux chinois. Cet usage vient de ce que les vagues sont très fortes dans cette mer (le golfe Persique) et que l'eau manque en plusieurs endroits. La distance, par eau, entre Bassora et Syraf, est de cent vingt parasanges. Quand les marchandises sont embarquées à Syraf, on s'approvisionne d'eau douce et on enlève; c'est le mot employé par les mariniers pour dire mettre à la voile. On se rend à Mascate, à l'extrémité de l'Oman. La distance de Syraf à Mascate est d'environ deux cents parasanges.
Dans la partie orientale de cette mer, entre Syraf et Mascate, se trouve, entre autres villes, Syf (le port), des Bènou-Al-safac, ainsi que l'île du fils de Kaouan. La même mer mouille les montagnes de l'Oman. De ce côté est le lieu nommé Al-dordour; c'est un lieu resserré entre deux montagnes, que traversent les petits navires, mais où ne peuvent s'engager les navires chinois. Là sont les deux rochers appelés Kossayr et Ouayr; une petite partie seulement des rochers se montre au-dessus de l'eau (30).
Quand nous eûmes dépassé ces montagnes, nous nous rendîmes au lieu nommé Sakar d'Oman; ensuite nous nous approvisionnâmes d'eau douce à Mascate, à un puits qui se trouve là (31). On peut se procurer eh cet endroit des moutons de l'Oman. De ce lieu, les navires mettent à la voile pour l'Inde, et se dirigent vers Koulam-Malay (32) ; la distance entre Mascate et Koulam-Malay est d'un mais de marche, avec un vent modéré. A Koulam-Malay il y a un péage (33), qui sert pour la contrée, et ou les navires chinois acquittent les droits; on y trouve de l'eau douce fournie par des puits. Chaque navire chinois paye mille dirhems; pour les autres navires (qui sont moins lourds), ils payent depuis un dinar jusqu'à dix (34).
Entre Maseate, Koulam-Malay et (la mer de) Herkend, il y a environ un mois de marche. On s'approvisionne d'eau douce à Koulam-Malay; puis on met à la voile pour la mer de Herkend. Quand on a dépassé cette mer, on arrive au lieu nommé Lendjebâlous (35). Les habitants de ce lieu ne comprennent pas la langue arabe, ni aucune des langues parlées par les marchands. Les hommes ne portent pas de vêtement; ils sont blancs et ont le poil rare. Les voyageurs disent n'avoir jamais vu leurs femmes. En effet, les hommes se rendent auprès des navires, dans des canots faits avec un seul tronc d'arbre, et ils apportent des cocos, des cannés à sucre, des bananes et du vin de cocotier (vin de palmier) ; cette liqueur est d'une couleur blanche. Si on la boit au moment ou elle vient d'être extraite du cocotier, elle est douce comme le miel ; mais, si on la conserve une heure, elle devient comme le vin; et, si elle reste dans cet état pendant quelques jours, elle se convertit en vinaigre. Les habitants échangent cela contre du fer. Quelquefois il leur vient un peu d'ambre, qu'ils cèdent aussi pour quelques objets en fer. Du reste, les échanges se font uniquement par signes, de la main à la main, vu qu'on ne s'entend pas. Ces hommes sont très habiles à la nage, quelquefois ils dérobent le fer des marchands sans leur rien donner en échange. De là, les navires mettent à la voile pour un lieu nommé Kalâh-Bâr. Le mot bâr (36) sert à désigner à la fois un royaume et une côte. Kalâh-Bâr est une, dépendance du Zabedj (Al-zâbedj) ; la situation du Zâbedj est à droite des provinces de l'Inde, et la région entière obéit à un seul roi (37). L'habillement des habitants consiste dans le pagne : grands et petits, tous portent un seul pagne (38). Les navires trouvent dans le Kalâh-Bâr de l'eau douce provenant, de puits. On préfère l'eau des puits à l'eau de source et a l'eau pluviale. La distance entre Kouiam, qui est situé dans le voisinage de la mer de Herkend et Kalâh-Bâr, est un mois de route (39).
Ensuite les navires se rendent dans un lieu nommé Betoumah (40), où il y a de l'eau douce pour les personnes qui en veulent. Le temps nécessaire pour y arriver est dix journées.
Apres cela, les navires se dirigent vers le lieu nommé Kedrendj, et y arrivent en dix journées. On y trouve aussi de l'eau douce. Il en est de même des îles de l'Inde; en y creusant des puits, on trouve l'eau douce. A Kedrendj est une montagne élevée où quelquefois s'enfuient les esclaves et les voleurs. Les navires se rendent ensuite au lieu nommé Senef, situé à une distance de dix journées; il s'y trouve aussi de l'eau douce ; on exporte de ce lieu l’aloès appelé al-senfy. Ce lieu forme un royaume. Les habitants sont bruns, et chacun d'eux se revêt de deux pagnes (41).
Quand les navires se sont pourvus d'eau douce, ils mettent à la voile pour un lieu nommé Sender-Foulat. Sender-Foulat est le nom d'une île; on met dix journées pour y arriver et il s'y trouve de l'eau douce.
De là, les navires entrent dans une mer appelée Sandjy, puis ils franchissent les portes de la Chine. Ces portes consistent dans des montagnes baignées par la mer; entre ces montagnes est une ouverture par laquelle passent les navires.
Quand, par un effet de la faveur divine, les navires sont sortis sains et saufs de Sender-Foulat, ils mettent à la voile pour la Chine et y arrivent au bout d'un mois. Sur ce mois, sept journées sont employées à traverser les détroits formés par les montagnes. Lorsqu'ils ont franchi ces portes, et qu'ils sont arrivés dans le golfe, ils entrent dans l'eau douce, et se rendent dans la ville de Chine où l'on a coutume d'aborder : cette ville se nomme Khanfou. Khanfou et les autres villes de Chine sont pourvues d'eau douce, provenant de rivières et de ruisseaux. Chaque contrée a aussi ses péages et ses marchés. Sur la côte, il y a le flux et reflux deux fois chaque jour et chaque nuit. (Dans le golfe Persique) depuis Bassora jusqu'à l'île des Bènou-Kaouan, le flux a lieu quand la lune se trouve au milieu du ciel, et le reflux au moment où la lune s'élève sur l'horizon et lorsqu'elle se couche. En Chine, et jusqu'auprès de l'île des Bènou-Kaouan, le flux a lieu au moment où la lune se lève. Quand-la lune occupe le milieu du ciel, la mer se retire, et elle revient quand la lune se couche. La mer se retire de nouveau lorsque la lune se trouve du côté opposé, au milieu du ciel. On raconte que, dans une île appelée Malhan, entre Serendyb et Kalah (42), dans la mer de l'Inde, du côté de l'orient, il y a une peuplade noire et qui est nue. Quand il lui tombe entre les mains un homme d'un autre pays, elle le suspend la tête en bas, le coupe en morceaux, et le mange presque cru. Le nombre de ces noirs est considérable ; ils habitent une, même île, et n'ont pas de roi. Leur nourriture est le poisson, la banane, le coco, la canne à sucre. Ils-demeurent dans des espèces de bois et au milieu des roseaux.
Il y a, dit-on, dans la mer, un petit poisson volant; ce poisson, appelé la sauterelle et eau, vole sur la surface de l'eau. On parle d'un autre poisson de mer qui, sortant de l'eau, monte sur le cocotier et boit le suc de la plante ; ensuite il retourne à la mer. On fait encore mention d'un animal de mer qui ressemble à l'écrevisse ; quand cet animal sort de la mer, il se convertit en pierre. On ajoute que cette pierre fournit un collyre pour un certain mal d'yeux (43).
Près du Zabedj, il y a, dit-on, une montagne, appelée la montagne du feu, dont il n'est pas possible d'approcher. Le jour, on en voit sortir de la fumée, et, la nuit, des flammes. Au pied est une source d'eau froide et douce; il y a une autre source d'eau chaude et douce (44).
Les Chinois, grands et petits, s'habillent en soie, hiver et été. Les princes se réservent la soie de première qualité; quant aux personnes d'un ordre inférieur, elles usent d'une soie en proportion avec leur condition. L'hiver, les hommes se couvrent de deux, trois, quatre, cinq caleçons, et même davantage, suivant leurs moyens. Leur but est uniquement de maintenir la chaleur dans les parties inférieures du corps, à cause de la grande humidité du climat et de la peur qu'ils en ont. Mais, l'été, ils revêtent une seule tunique de soie, ou quelque chose du même genre. Ils ne portent pas de turban.
La nourriture des Chinois est le rit. Quelquefois ils versent sur le riz du kouschan cuit (45), et le mangent ensuite. Quant aux princes, ils mangent du pain de froment et de la viande de toute espèce d'animaux, tels que cochons, etc.
Les fruits que possèdent les Chinois sont la pomme, la pêche, le citron, la grenade, le coing, la poire, la banane, la canne à sucre, le melon, la figue, le raisin, le concombre, le kheyar (46), le lotus, la noix, l'amande, l'aveline, la pistache, la prune, l'abricot, la sorbe et le coco. Le palmier n'est pas commun en Chine; on voit seulement des palmiers cher quelques particuliers. Le vin que boivent les Chinois est fait avec le riz (47) ; ils ne font pas de vin de raisin, et on ne leur en porte pas du dehors; ils ne le connaissent donc pas et n'en font pas usage. Avec le riz, ils se procurent le vinaigre, le nabyd (48), le nathif (espèce de confitures), et autres compositions du même genre.
Les Chinois ne se piquent pas de propreté. En cas d'impureté, ils ne se lavent pas avec de l'eau ; ils s'essuient, avec le papier propre à leur pays (49). Ils mangent les corps morts, et autres objets du même genre, comme font les mages (les idolâtres) (50) ; en effet, leur religion se rapproche de celle des mages. Les femmes sortent la tête découverte et portent des peignes dans leurs cheveux. On compte quelquefois, sur la tête d'une femme, vingt peignes d'ivoire et autres objets analogues. Pour les hommes, ils se couvrent la tête avec quelque chose qui ressemble à un bonnet. L'usage en Chine est de mettre à mort les voleurs, quand on les atteint (51).
Les habitants de l'Inde et de la Chine s'accordent à dire que les rois du monde qui sont hors de ligne sont au nombre de quatre. Celui qu'ils placent à la tête des quatre est le roi des Arabes (le khalife de Bagdad). C'est une chose admise parmi eux sans contradiction, que le roi des Arabes est le plus grand des rois, celui qui possède le plus de richesses et dont la cour a le plus d'éclat, et, de plus, qu'il est le chef de la religion sublime au-dessus de laquelle il n'existe rien. Le roi de la Chine se place lui-même après le roi des Arabes. Vient ensuite le roi des Romains. Le quatrième est le Balhara, prince des hommes qui ont l'oreille percée (52). Le Balhara est le plus noble des princes de l'Inde; les Indiens reconnaissent sa supériorité. Chaque prince, dans l'Inde, est maître dans ses États ; mais tous rendent hommage à la prééminence du Balhara. Quand le Balhara envoie des députés aux autres princes, ceux-ci, pour lui faire honneur, prodiguent les égards aux députés. Il paye une solde à ses troupes, comme cela se pratique chez les Arabes ; il a des chevaux et des éléphants en abondance, ainsi que beaucoup d'argent. La monnaie qui circule dans ses États consiste en pièces d'argent, qu'on nomme thatherya (53). Chacune de ces pièces équivaut à un dirhem et demi, monnaie du souverain. La date qu'elles portent part de l'année où la dynastie est montée sur le trône (54) ; ce n'est pas, comme chez les Arabes, l'année de l'hégire du Prophète, sur lui soit la paix! l'ère des Indiens a pour commencement le règne des rois, et leurs rois vivent longtemps ; souvent leurs rois règnent pendant cinquante ans. Les habitants des États du Balhara prétendent que, si leurs rois règnent et vivent longtemps, c'est uniquement à cause de l'attachement qu'ils portent aux Arabes, En effet, il n'existe pas, parmi les souverains, un prince qui aime plus les Arabes que le Balhara, et ses sujets suivent son exemple (55).
Balhara est le titre que, prennent tous les rois de cette dynastie. Il revient à celui de Chosroès (chez les Persans, de César chez les Romains), et ce n'est pas un nom propre. L'empire du Baihara commence à la côte de la mer, là où est le pays de Komkam (Concan), sur la langue de terre qui se prolonge jusqu'en Chine. Le Baihara a autour de lui plusieurs princes, avec lesquels il est en guerre, mai»qu'il surpasse de beaucoup. Parmi eux, est le prince nommé roi du Al-djorz (56). Ce prince entretient des troupes, nombreuses, et. aucun autre prince indien n'a une aussi belle cavalerie. Il a de l'aversion pour les Arabes; néanmoins, il reconnaît que le roi des Arabes est le plus grand des rois. Aucun prince indien ne hait plus que lui l'islamisme. Ses États forment une langue de terre. Il possède de grandes richesses; ses chameaux et ses chevaux sont en grand nombre. Les échanges se font, dans ses États, avec de l'argent (et de l'or) en poudre (57); le pays renferme, dit-on, des mines (de ces métaux). Il n'y a pas, dans toute l'Inde, de contrée mieux garantie contre les voleurs.
A côté de ce royaume est celui du Thafec; son territoire est peu considérable; les femmes y sont blanches et plus belles que dans le reste de l'Inde. Le roi vit en paix avec ses voisins, à cause du petit nombre de ses troupes. Il aime les Arabes au même degré que le Balhara (58).
A ces trois États, est contigu un royaume appelé Rohmy (59), et qui est en guerre avec celui de Al-djorz. Le roi ne jouit pas d'une grande considération. Il est aussi en guerre avec le Balhara, comme avec le roi de Al-djorz; ses troupes sont plus nombreuses que celles du Balhara, du roi de Al-djorz et du roi de Thafec. On dit que lorsqu'il marche au combat, il est accompagné d'environ cinquante mille éléphants (60). Il ne se met en campagne que l'hiver: en effet, les éléphants ne supportent pas la soif; ils ne peuvent donc sortir que l'hiver. On dit que, dans son armée, le nombre des hommes occupés à fouler le drap et à le laver s'élève de dix à quinze mille (61). On fabrique dans ses États des étoffes qui ne se retrouvent pas ailleurs; une robe faite avec cette étoffe peut passer, tant l'étoffe est légère et fine, à travers l'anneau d'un cachet. Cette étoffe est en coton ; nous en avons vu un échantillon (62). Les échanges se font, parmi les habitants, avec des cauris; c'est la monnaie du pays, c'est-à-dire sa richesse. On y trouve cependant de l'or, de l'argent, de l'aloès, ainsi que l'étoffe nommée samara avec laquelle on fait les medzabb (63). Le même pays nourrit le boschan marqué, autrement appelé kerkedenn (64). Cet animal a une seule corne au milieu du front, et dans cette corne est une figure dont la forme est semblable à celle de l'homme ; ta corne est noire d'un bout à l'autre; mais la figure placée au milieu est blanche. Le kerkedenn est inférieur pour la grosseur à l'éléphant, et sa couleur tire vers le noir; il ressemble au buffle, et est très fort; aucun animal ne l'égale pour la vigueur. Il n'a point d'articulation au genou ni à la main ; depuis le pied jusqu'à l'aisselle, ce n'est qu'un morceau de chair; l'éléphant le fuit; il rumine comme le bœuf et le chameau. Sa chair est permise ; nous en avons mangé. Il est nombreux dans cette contrée ; il vit dans les bois. On le trouve dans les autres provinces de l'Inde ; mais ici la corne en est plus belle; car elle offre souvent une figure humaine, une figure de paon, une figure de poisson, ou toute autre figure. Les habitants de la Chine font avec cette corne des ceintures, dont le prix s'élève, en Chine, jusqu'à deux et trois mille dinars, et même au delà, suivant la beauté de la figure dont on y trouve l'image.
Toutes ces cornes sont achetées dans les États du Rohmy, avec des cauris, qui sont la monnaie du pays (65). Apres cela vient un royaume placé dans l'intérieur des terres, et qui ne s'étend pas jusqu'à la mer; on le nomme royaume des Kaschibyn (66). C'est un peuple de couleur blanche, qui a les oreilles percées, et qui est remarquable pour sa beauté. Il habite les champs et les montagnes.
Vient ensuite une mer sur les bords de laquelle est un roi nommé Al-kyrendj (67). C'est un prince pauvre et orgueilleux, qui recueille beaucoup d'ambre; il possède également des dents d'éléphant. Dans ses États on mange le poivre encore vert, à. cause de sa petite quantité.
Après cela, on rencontre plusieurs royaumes; Dieu seul, qu'il soit béni et qu'il soit exalté! en connaît le nombre. Parmi ces royaumes est celui des Moudjah (68) ; c'est le nom d'un peuple d'un teint blanc, qui se rapproche des Chinois pour l'habillement. On trouve chez lui du musc en abondance (69). Le pays est couronné de montagnes blanches d'une longueur sans exemple. Les habitants ont à combattre plusieurs rois qui les entourent. Le musc qui se trouve dans le pays est bon et d'un effet énergique.
Au delà se trouvent les rois du Mabed, qui comptent un grand nombre de villes (70). Leurs États s'étendent jusqu'au pays des Moudjah ; mais ils sont plus considérables, et les habitants se rapprochent davantage des Chinois. A l'exemple de ce qui se passe en Chine, les dignités les plus considérables sont occupées par des eunuques, et le pays touche à la Chine. Les princes vivent en paix avec le roi des Chinois; mais ils ne lui prêtent pas obéissance. Tous les ans, les rois du Mabed envoient des députés au roi de la Chine avec des présents (71). Le roi de la Chine fait aussi des présents aux souverains du Mabed ; car cette contrée est fort vaste. Quand les députés du Mabed arrivent en Chine, ils sont surveillés, de peur qu'ils ne cherchent à se rendre maîtres du pays, vu le grand nombre de leurs compatriotes. On ne trouve entre les deux régions que montagnes et montées.
On dit que le roi de la Chine compte dans ses États plus de deux cents métropoles. Chacune de ces métropoles a à sa tête un prince (malek) et un eunuque; du reste, elle a d'autres villes sous sa dépendance. Au nombre de ces métropoles est Khanfou, rendez-vous des navires, et ayant vingt autres villes sous sa dépendance. Le nom de ville ne se donne qu'aux cités qui ont le djadem, et l'on entend par djadem une espèce de trompette. Le djadem est long et assez épais pour remplir les deux mains à la fois; on l'enduit de la même manière que les autres objets qui sous viennent de Chine. Il a trois ou quatre coudées de longueur; mais sa tête est mince, de manière à pouvoir être embouchée. On entend le son du djadem à près d'un mille de distance. Chaque ville a quatre portes, et à chaque porte il y a cinq de ces djadem, dont on sonne à certaines heures de la nuit et du jour. Chaque ville a également dix tambours, dont on frappe en même temps qu'on sonne du djadem. C'est une manière de rendre hommage au souverain. De plus, les habitants se rendent compte par là des heures de la nuit et du jour ; du reste, ceux-ci ont des signes et des poids pour connaître les heures (72).
Les échanges, en Chine, se font avec des pièces de cuivre (73). Les princes ont des trésors, comme les princes des autres pays; mais seuls, parmi les princes, ils ont des trésors de pièces de cuivre; car c'est la monnaie du pays. Ce n'est pas qu'ils ne possèdent de l'or, de l'argent, des perles, de la soie travaillée et non travaillée; bien au contraire, tout cela abonde chez eux: mais ces objets sont considérés comme marchandise; c'est le cuivre qui sert de monnaie.
On importe en Chine de l'ivoire, de l'encens, des lingots de cuivre, des carapaces de tortues de mer (74), enfin, le boschan ou kerkedenn, dont nous avons donné la description, et avec la corne duquel les Chinois font des ceintures.
Les bêtes de somme sont nombreuses chez les Chinois; ils ne connaissent pas le cheval arabe; mais ils ont des chevaux d'une autre espèce; ils ont aussi des ânes et des chameaux en grand nombre; leurs chameaux ont deux bosses.
Il y a en Chine une argile très fine avec laquelle on fait des vases qui ont la transparence des bouteilles; l'eau se voit à travers. Ces vases sont faits avec de l'argile (75).
Quand un navire arrive du dehors, les agents du gouvernement se font livrer les marchandises et les serrent dans certaines maisons. Les marchandises sont soumises au dork pendant six mois (76), jusqu'à ce que le dernier navire soit entré (77). Alors les Chinois prennent les trois dixièmes de chaque marchandise et livrent le reste au propriétaire. Ce que le sultan de la Chine désire se procurer, il le reçoit au taux le plus élevé et le paye comptant; il ne se permet, à cet égard aucune injustice. Au nombre des objets que le souverain prélève, est le camphre, qu'il paye au prix de cinquante fakkoudj le manna, et le fakkoudj équivaut à mille pièces de cuivre. Le camphre qui n'est pas mis à part pour le sultan, se vend la moitié de cette valeur, et on le met dans la Circulation générale.
Quand un Chinois meurt, il n'est enterré que le jour anniversaire de sa mort, dans une des années subséquentes. On place le corps dans une bière, et la bière est gardée datas la maison ; on met sur le corps de la chaux, qui a la propriété d'absorber les parties aqueuses; le reste du corps se conserve. Quand il s'agit des princes, on emploie l'aloès et le camphre. On pleure les morts pendant trais ans; celui qui ne pleure pas sur ses parents est battu de verges; hommes et femmes, tous sont soumis à ce châtiment; on leur dit: « Quoi ! la mort de ton parent ne t'afflige pas? » Ensuite, les corps sont enterrés dans une tombe, comme chez les Arabes. Jusque-là, on ne prive pas le mort de sa nourriture ordinaire; on prétend que le mort continue à manger et à boire. En effet, la nuit, on place de la nourriture à côté, et le lendemain on ne trouve plus rien. Il a mangé, se dit-on.
On continue à pleurer et à servir de la nourriture au mort, tant que le corps est dans la maison. Les Chinois se ruinent pour leurs parents morts ; tout ce qui leur reste de monnaie ou de terres, ils l'emploient à cet objet (78). Autrefois on enterrait avec le prince tout ce qu'il possédait, en fait de meubles, d'habillements et de ceintures; or les ceintures, en Chine, se payent à un prix très élevé. Mais cet usage a été abandonné parce qu'un cadavre fut déterré, et que des voleurs enlevèrent tout ce qui avait été enfoui avec lui (79).
En Chine, tout le monde, pauvre et riche, petit et grand, apprend à dessiner et à écrire.
Le titre que l'on donne aux fonctionnaires varie suivant la dignité dont ils sont revêtus, et l'importance des villes qui leur sont confiées. Le gouverneur d'une ville d'un ordre inférieur porte le titre de toussendj, mot qui signifie : il a maintenu la ville. On donne au gouverneur d'une ville de l'importance de Khanfou le titre de dyfou. Les eunuques sont-appelés du nom de thoucam; les eunuques sont nés en Chine même (80) ; le cadi des cadis (grand juge) est appelé lacchy-mâmakoun; et ainsi des autres titres, que nous ne reproduisons pas, de peur de les écrire incorrectement (81). Aucun de ces fonctionnaires n'est promu avant l'âge de quarante ans. C'est alors, disent les Chinois, que l'homme a acquis une expérience suffisante.
Les gouverneurs d'un ordre inférieur, quand ils siègent, s'asseyent sur un trône, dans une grande salle, un autre siège est placé devant eux. On leur présente les écrits où sont exposés les droits respectifs des parties; derrière le gouverneur est un homme debout, désigné par le titre de leykhou; si le gouverneur se trompe dans quelqu'une de ses décisions, et fait une méprise, cet homme le reprend. Il n'est tenu aucun compte de ce que disent les parties; ce qu'elles ont à dire dans leur intérêt doit être présenté par écrit (82). Lorsqu'une personne demande à poursuivre une affaire devant le gouverneur, un homme, qui se tient à la porte, lit d'abord l'écrit, et, s'il y remarque une irrégularité, il le rend à la personne. Les requêtes adressées au gouverneur doivent être rédigées par un écrivain qui connaisse les lois. L'écrivain ajoute au bas : « Rédigé par un tel, fils d'un tél. » Si quelque irrégularité se trouve dans l'écrit, la foute retombe sur le rédacteur, et on le bat des verges (83). Le gouverneur ne siège qu'après avoir mangé et bu; c'est afin qu'il apporte aux affaires plus d'attention. Chaque gouverneur est payé sur les revenus de la ville où il commande.
Le roi suprême ne se montre qu'une fois tous les dix mois. « Si, dit-il, le peuple me voyait fréquemment, il n'aurait plus de considération pour moi. Les formes du gouvernement doivent être despotiques; en effet, le peuple n'a aucune idée de la justice; la force seule peut lui apprendre à nous respecter. »
Les terres ne payent pas d'impôt; mais on exige une capitation de tous les mâles, chacun suivant ses moyens (84). Les Arabes et les autres étrangers payent un droit pour la conservation de leurs marchandises.
Quand les denrées sont chères, le sultan fait tirer des vivres des magasins publics, et on les vend à un prix inférieur à celui du marché; par conséquent, la cherté ne peut pas se prolonger (85).
L'argent qui entre dans le trésor public provient uniquement de l'impôt levé sur les têtes. Je suis porté à croire que l'argent qui entre chaque jour dans la caisse de Khanfou s'élève à cinquante mille dinars; et pourtant, ce n'est pas la ville la plus considérable de l'empire (86).
Le roi se réserve, entre les substances minérales, un droit sur le sel, ainsi que sur une plante (le thé) qui se boit infusée dans de l'eau chaude. On vend de cette plante dans toutes les villes, pour de fortes sommes; elle s'appelle le sâkh. Elle a plus de feuilles que le trèfle (87). Elle est un peu plus aromatique, mais elle a un goût amer. On fait bouillir de l'eau, et on la verse sur la plante. Cette boisson est utile dans toute espèce de circonstances (88).
Tout l'argent qui entre dans le trésor public provient de la capitation, de l'impôt sur le sel, et de l'impôt sur cette plante.
Dans chaque ville, il y a ce qu'on appelle le darâ; c'est une cloche, placée sur la tête du gouverneur, et qui est attachée à un fil, lequel s'étend jusque sur la voie publique, afin qu'elle soit à la portée de tout le monde indistinctement. Quelquefois ce fil a une parasange de long. Il suffit que quelqu'un remue tant soit peu le fil pour que la cloche se mette en mouvement. Celui donc à qui on a fait une injustice, remue le fil, et la cloche s'agite sur la tête du gouverneur. Le plaignant est admis auprès du gouverneur, afin qu'il expose lui-même ce qu'il désire, et qu'il fasse connaître le tort qu'on lui a lait. L'usage de la cloche existe dans toutes les provinces (89).
La personne qui veut voyager d'une province à l'autre se fait donner deux billets, l'un du gouverneur et l'autre de l'eunuque. Le billet du gouverneur sert pour la route, et contient les noms du voyageur et des personnes de sa suite, avec son âge, l'âge des personnes qui l'accompagnent, et la tribu à laquelle il appartient. Toute personne qui voyage, en Chine, que ce soit une personne du pays, un Arabe, ou tout autre, ne peut se dispenser d'avoir avec elle un écrit qui serve à la faire reconnaître. Quant au billet de l'eunuque, il y est fait mention de l'argent du voyageur et des objets qu'il emporte avec lui. Il y a sur toutes les routes des hommes chargés de se faire présenter les deux billets; des qu'un voyageur arrive, les préposés demandent à voir les billets; ensuite ils écrivent : « A passé ici, un tel, fils d'un tel, telle profession, tel jour, tel mois, telle année, ayant tels objets avec lui. » Le gouvernement a eu recours à ce moyen, afin que les voyageurs ne courussent pas de danger pour leur argent et leurs marchandises. Que si un voyageur essuie une perte ou meurt, on sait tout de suite comment cela s'est fait, et on rend ce qui a été perdu au voyageur, ou à ses héritiers, après sa mort (90).
Les Chinois respectent la justice dans leurs transactions et dans les actes judiciaires. Si un homme prête une somme d'argent à quelqu'un, il écrit un billet a ce sujet; l'emprunteur, à son tour, écrit un billet, qu'il marque avec deux de ses doigts réunis, le doigt du milieu et l'index. On met ensemble les deux billets. On les plie l'un avec l'autre, on écrit quelques caractères sur l'endroit qui les sépare; ensuite, on les déplie et on remet au prêteur le billet par lequel l'emprunteur reconnaissait sa dette. Si, plus tard, l'emprunteur nie sa dette, on lui dit : « Apporte le billet du prêteur. » Si l'emprunteur prétend n'avoir point de billet, qu'il nie avoir écrit un billet accompagné de sa signature et de sa marque, et que son billet ait péri, on dit à l'emprunteur qui nie la dette : « Déclare par écrit que cette dette ne te concerne pas ; mais, si, de son côté, le créancier vient à prouver ce que tu nies, tu recevras vingt coups de bâton sur le dos, et payeras une amende de vingt mille fakkoudj de pièces de cuivre (91). » Or, comme le fakkoudj équivaut à mille pièces de cuivre, cette amende fait à peu près deux mille dinars {92). D'un autre côté, vingt coups de bâton suffisent pour tuer un homme. Aussi personne, en Chine, n'ose faire une déclaration par écrit, de peur de perdre à la fois la vie et la fortune. Nous n'avons jamais vu qui que ce soit consentir à faire cette déclaration. Les Chinois se conforment, dans leurs rapports respectifs, à la justice, personne n'est privé de son droit ; ils n'ont pas même recours aux témoins ni aux serments.
Quand un homme fait faillite, et que les créanciers le font mettre, à leurs frais, dans la prison du sultan, on exige une déclaration de lui. Après qu'il est resté un mois en prison, le sultan le fait comparaître en public, et l'on proclame ces mots : « Un tel, fils d'un tel, a emporté l'argent d'un tel, fils d'un tel. » S'il reste au failli une somme placée chez quelqu'un, ou s'il possède quelque champ, ou des esclaves, en un mot, quelque chose qui puisse faire face à ce qu'il doit, on le fait sortir tous les mois, et on lui applique des coups de bâton sur l'anus, parce qu'il est resté en prison, mangeant et buvant, bien qu'il lui restât de l'argent. On lui applique les coups de bâton, que quelqu'un le dénonce ou ne le dénonce pas; il est battu dans tous les cas, et on lui dit : « Tu n'as cherché qu'à frustrer les autres de ce qui leur appartenait et à t'emparer de leur bien. » On lui dit encore : « Tâche de faire droit aux réclamations de ces personnes. » S'il n'en a pas les moyens, et s'il est bien constant pour le sultan qu'il ne reste au failli aucune ressource, on appelle les créanciers, et on les satisfait avec l'argent du trésor du Bagboun, titre que porte le roi suprême. Bagboun est le seul titre qu'on donne au souverain, et ce mot signifie fils du ciel ; c'est le mot dont nous avons fait magboun (93). Ensuite on proclame ces mots : « Quiconque entretiendra des rapports d'affaires avec cet homme sera mis à mort. » Ainsi personne n'est exposé à éprouver des pertes de ce genre. Si on apprend que le débiteur a de l'argent placé chez quelqu'un, et que le dépositaire n'ait pas fait de déclaration au sujet de cet argent, on tue celui-ci à coups de bâton. L'on ne dit rien pour cela au débiteur; on se contente de prendre l'argent, qu'où partage aux créanciers ; mais, à partir de ce moment, le débiteur ne peut plus entretenir de rapports d'affaires avec personne.
On dresse, en Chine, des pierres d'une longueur de dix coudées et gravées en creux. L'inscription présente un tableau des diverses maladies et de leurs remèdes. Pour telle maladie, y est-il dit, il y a tel remède. Celui qui n'a pas les moyens d'acheter le remède le reçoit aux frais du trésor public.
Les terres ne payent pas d'impôt; l'impôt se paye par tête, suivant la fortune de chacun et l'importance de ses propriétés (94).
Le nom de tout enfant mâle qui naît est écrit dans les registres du sultan (95). Dès que l'enfant est parvenu, à l'âge de dix-huit ans, on exige de lui la capitation ; mais, lorsqu'il a atteint sa quatre-vingtième année, il ne la paye plus; au contraire, on lui donne une pension aux frais du trésor public, et l'on dit à ce sujet : « Nous avons reçu de lui une pension quand il était jeune; il est juste que nous la lui rendions, maintenant qu'il est vieux (96).
Dans chaque ville, il y a des hommes de plume et des maîtres, qui instruisent les pauvres et leurs enfants aux frais du trésor public (97). Les femmes sortent les cheveux exposés à l'air ; pour les hommes, ils se couvrent la tête.
On trouve dans les montagnes un bourg, nommé Tâyou, dont les habitants sont courts de taille, tous les hommes qui, en Chine, sont courts de taille, sont censés venir de ce bourg. Les Chinois, en général, sont bien faits, grands, d'un blanc clair, mais coloré de ronge. Ce sont, de tous les hommes, ceux qui ont les cheveux du noir le plus foncé. Les femmes laissent pousser leurs cheveux (98).
Dans l'Inde, quand Un homme intente à Un autre une action qui doit entraîner la peine de mort, on dit au demandeur : Veux-tu soumettre le défendeur à l'épreuve du feu. » S'il répond oui, l'on fait chauffer jusqu'au rouge une barre de fer; ensuite on dit au défendeur : « Présente ta main. » En même temps, l'on étend sur sa main sept feuilles d'un certain arbre du pays, et on pose la barre dessus. L'homme se met à marcher en avant et en arrière; après cela, il jette la barre et on lui présente une bourse de cuir dans laquelle il introduit sa main ; la bourse est immédiatement scellée avec le sceau royal. Au bout de trois jours, on apporte du riz dont le grain est encore dans sa balle, et on dit à l'homme : « Frotte les grains, afin d'en détacher la pellicule. » Si sa main ne présente aucune trace de brûlure, le défendeur obtient, gain de cause et n'est pas mis à mort. Pour le demandeur, il est condamné à payer un manna d'or, que le souverain se réserve pour lui-même (99).
Quelquefois, on fait bouillir de l'eau dans une marmite de fer ou d'airain, de manière à ce que personne n'ose en approcher. On y jette un anneau de fer, puis on dit au défendeur : « Introduis ta main dans la marmite. Il faut alors que le défendeur retire l'anneau. J'ai vu un homme introduire sa main dans la marmite et la retirer saine et sauvé. En ce cas, comme pour l'autre, le demandeur est obligé de payer un manna d'or (100). Quand le roi de Serendyb meurt, on le traîne sur un char, très près du sol ; le corps est attaché au derrière du char de manière à ce que l'occiput de la tête traîne par terre et que les cheveux ramassent la poussière. En même temps, une femme, tenant un balai à la main, chasse la poussière sur la figure du mort et crie ces mots : « O hommes! cet homme était encore hier votre roi; il vous gouvernait; et ses ordres étaient exécutés par vous. Voilà où il en est réduit; il a dit adieu au monde, et l'ange de la mort s'est saisi de son âme. Ne vous laissez donc plus séduire par les plaisirs de cette vie; » et autres paroles analogues. Cette cérémonie dure trois jours; ensuite, on apporte du bois de sandal, du camphre et du safran, et on brûle le corps au milieu de ces aromates; après quoi on jette les cendres au vent. Tous les Indiens feraient leurs morts (101). Serendyb est la plus avancée des îles (102) qui dépendent de l'Inde. » Quelquefois, lorsqu'on brûle le corps du ni, ses femmes se précipitent sur le bûcher et se brûlent avec lui ; mais il dépend d'elles de ne pas le faire (103).
Dans l'Inde, il y a des personnes qui font profession d'errer dans les bois et les montagnes, et qui communiquent rarement avec le reste des hommes. Ces personnes n'ont quelquefois à manger que l'herbe des champs et les fruits des bois. Elles s'attachent un anneau de fer au bout de ta verge, afin de se mettre dans l'impossibilité d'avoir commerce avec les femmes. Parmi ces hommes il y en a qui vont nus. Quelques-uns se tiennent nus, la face tournée vers le soleil, et n'ayant pour toute couverture que quelque peau de panthère. Je vis, dans un de mes voyages, un de ces hommes, dans l'état que je viens de décrire; seize ans après, je retournai dans le même pays, et je retrouvai cet homme dans la même situation. Une chose qui m'étonna, ce fut que sa personne ne se fût pas fondue de chaleur.
La noblesse, dans chaque royaume, est censée ne faire qu'une seule et même famille; la puissance ne sort pas de son sein, et les princes nomment eux-mêmes leurs héritiers présomptifs; il en est de même des hommes de plume et des médecins; ils forment une caste particulière, et la profession ne sort pas de la caste (104).
Du reste, les princes de l'Inde ne reconnaissent pas l'autorité d'un même souverain (105). Chacun d'eux est maître chez lui. Néanmoins, le Balhara porte le titre de roi des rois. Quant aux Chinois, ils ne se nomment pas d'avance des héritiers.
Les Chinois sont des gens de plaisir ; mais les Indiens réprouvent le plaisir, et ils s'en abstiennent; ils ne boivent pas le vin (106), et se mangent pas le vinaigre qui est fait avec le vin. Ce n'est pas l'effet d'un scrupule religieux, c'est par dédain. «Tout prince, disent-ils, qui boit du vin, n'est pas un prince véritable. » Les Indiens sont entourés d'ennemis qui leur font la guerre et ils s'expriment ainsi : « Comment administrera-t.il bien les affaires de ses États, celui qui s'enivre (107) ? »
Quelquefois, les Indiens se font la guerre dans un esprit de conquêtes ; mais ces cas sont rares. Je n'ai pas vu de peuple se soumettre à l'autorité d'un autre, si ce n'est dans le pays qui fait suite au pays du poivre (108). Quand un roi fait la conquête d'un État voisin, il met à sa tête un homme de la famille du prince déchu, lequel exerce l'autorité au nom du vainqueur. Les habitants du pays conquis ne souffriraient pas qu'il en fût autrement (109). Quant à la Chine, il arrive quelquefois qu'un gouverneur de province s'écarte de l'obéissance due au roi suprême. Alors on l'égorge et on le mange. Les Chinois mangent la chair de tous les hommes qui sont tués par l'épée (110).
Dans l'Inde et dans la Chine, quand il est question de faire un mariage, les deux familles s'adressent des compliments et se font des présents; ensuite, elles célèbrent le mariage au bruit des cymbales et des tambours. Les présents qu'on se fait à cette occasion sont en argent, chacun suivant ses moyens. Si une femme mariée est convaincue d'adultère, la femme et l'homme sont mis à mort; voilà ce qui se pratique dans toutes les provinces de l'Inde; mais, si l'homme a fait violence à la femme, l'homme seul subit la peine. Toutes les fois qu'il y a eu concert entre l'homme et la femme, on les tue tous les deux.
Dans l'Inde comme dans la Chine, la filouterie, pour un objet léger ou considérable, est un cas de mort (111). En ce qui concerne l'Inde, quand un filou a volé une obole et une somme au-dessus, on prend un long bâton, dont on façonne l'extrémité en pointe; ensuite on fait asseoir le filou sur le bâton, de manière que la pointe lui entre par l'anus et lui sorte par le gosier.
Les Chinois commettent le péché du peuple de Loth avec des garçons qui font métier de cela, en place des courtisanes attachées aux temples d'idoles (112).
Les murs des maisons en Chine sont en bois; mais les Indiens bâtissent avec des pierres, du plâtre, des briques et de l'argile ; du reste, il en est quelquefois de même en Chine.
Dans l'Inde et dans la Chine, le firasch n'est pas admis (113) ; chacun est libre d'épouser la femme qu'il veut (même lorsqu'elle est grosse d'un autre homme),
La nourriture des Indiens est le riz ; dans la Chine, la nourriture est le blé et le riz ; les Indiens ne connaissent pas le blé. Ni les Indiens ni les Chinois n'usent de la circoncision.
Les Chinois sont idolâtres; ils adressent des vœux à leurs idoles et se prosternent devant elles; ils ont des livres de religion (114).
. Les Indiens laissent pousser leur barbe. J'ai vu des Indiens qui avaient une barbe de trois coudées. Ils ne se coupent pas non plus la moustache; mais la plupart des hommes en Chine n'ont pas de barbe; et chez eux c'est, en général, un effet naturel. Dans l'Inde, quand il meurt un homme, on lui rase la tête et la barbe (114 bis).
Dans l'Inde, quand un homme est mis en prison ou condamné aux arrêts, on lui retire le manger et le boire pendant sept jours. Les Indiens peuvent se faire mettre aux arrêts les uns les autres.
En Chine, il y a des cadis qui jugent les différents entre particuliers, de préférence aux gouverneurs; il en est de même dans l'Inde.
On trouve dans toute l'étendue de la Chine la panthère et le loup. Quant au lion, on ne le rencontre ni dans l'une, ni dans l'autre contrée.
On tue les voleurs de grand chemin.
Les Chinois et les Indiens s'imaginent que les boddes (115) leur parlent; ce sont plutôt les ministres des temples qui entrent en conversation avec le public.
Les Chinois et les Indiens tuent les animaux qu'ils veulent manger; ils n'égorgent pas l'animal, mais ils le frappent sur la tête jusqu'à ce qu'il meure (116.)
Ni les Indiens ni les Chinois ne pratiquent les ablutions pour se purifier de leurs souillures. Les Chinois s'essuient avec du papier; pour les Indiens, ils se lavent chaque jour avant le lever du soleil ; c'est après cela qu'ils mangent (117.)
Les Indiens n'approchent pas de leurs femmes au moment de leurs règles; ils les font même sortir de la maison, de peur de contracter quelque impureté. Pour les Chinois, ils ont commerce avec, leurs femmes dans cet état, et ils ne les envoient pas ailleurs.
Les Indiens se servent du cure-dents, et aucun d'eux ne saurait manger avant de s'être nettoyé les dents et de s'être lavé. Les Chinois ne suivent point cet usage (118).
L'Inde est plus étendue que la Chine: ses provinces feraient plusieurs fois les provinces de la Chine. On y compte également un plus grand nombre de principautés; mais les provinces de la Chine sont mieux peuplées.
Ni la Chine ni l'Inde ne connaissent le palmier; mais ces deux contrées possèdent d'autres espèces d'arbres et de fruits qui manquent à nos pays. L'Inde est privée du raisin ; mais il se trouve, à la vérité en petite quantité, dans la Chine. Tous les autres fruits abondent dans ces deux régions; la grenade surtout est abondante dans l'Inde.
Les Chinois n'ont pas de science proprement dite. Le principe de leur religion (119) est dérivé de l'Inde. Les Chinois disent que ce sont les Indiens qui ont importé en Chine les boddes, et qu'ils ont été les véritables maîtres en religion du pays. Dans l'une et l'autre contrée, on admet la métempsycose; mais on diffère dans las conséquences de certains principes (120).
La médecine et la philosophie fleurissent dans l'Inde. Les Chinois ont aussi une médecine ; le procédé qui domine dans cette médecine c'est la cautérisation.
Les Chinois ont des notions en astronomie ; mais cette science est plus avancée chez les Indiens (121).Du reste je ne connais personne, ni parmi les uns ni parmi les autres, qui professe l'islamisme, ni qui parle la langue arabe.
Les Indiens n'ont pas beaucoup de chevaux (122). Les chevaux sont plus nombreux en Chine.
Les Chinois n'ont pas d'éléphants, et ils n'en laissent pas entrer dans leur pays, regardant la présence de cet animal comme une chose fâcheuse (123).
Les troupes du roi des Indes sont nombreuses, mais elles ne reçoivent pas de solde. Le souverain ne les convoque que pour le cas de la guerre sacrée (124) ; les troupes se mettent alors en mouvement; mais elles s'entretiennent à leurs propres frais, sans que le roi ait rien à donner pour cela (125).Quant à la Chine, la solde des troupes est établie sur le même pied que chez les Arabes.
Les provinces de la Chine sont plus pittoresques et plus belles. Dans l'Inde, la plus grande partie du territoire est dépourvue de villes ; en Chine, au contraire, on rencontre, à chaque pas, des villes fortifiées et considérables. Le territoire chinois est plus sain, et les maladies y sont plus rares ; l’air y est si pur, qu'on n'y rencontre presque pas d'aveugles, ni de borgnes, ni de personnes frappées de quelque infirmité. Il en est de même dans une grande partie de l'Inde.
Les fleuves de l'une et de l'autre contrée sont considérables ; ils charrient beaucoup plus d'eau que nos fleuves. Les pluies dans l'une et l'autre région sont abondantes.
L'Inde renferme beaucoup de terres désertes. La Chine, au contraire, est partent cultivée. Les hommes de la Chine sont plus beaux que ceux de l'Inde, et se rapprochent davantage des Arabes pour les vêtements et les montures. Les Chinois, en costume et dan» une cérémonie publique, ressemblent aux Arabes; ils portent le caba (126) et la ceinture; pour les Indiens, ils portent deux pagnes, et se décorent de bracelets d'or et de pierres précieuses, les hommes comme les femmes (127).
En deçà de la Chine sont le pays des Tagazgaz, peuple de race tarie, et le khakan du Tibet. Voilà ce qui termine la Chine du côté du pays des Turks (128). Du côté de la mer, la Chine est bornée par les îles des Syla (Al-syla) ; ce sont des peuples blancs qui vivent en paix avec le souverain de la Chine, et qui prétendent que, s'ils ne lui envoyaient pas des présents, Le ciel ne verserait plus ses eaux sur leur territoire. Du reste, aucun de nos compatriotes n'est allé les visiter, de manière à pouvoir nous en donner des nouvelles. On trouve dans ce pays des faucons blancs (129).
FIN DU TOME PREMIER.
(1) C'est-à-dire une série de faits historiques.
(2) Il s'agit ici de la mer qui baigne les côtes occidentales de la presqu'île de l'Inde, depuis l'embouchure de l'Indus jusqu'aux environs de la ville de Goa. C'est la mer que les écrivains arabes appellent mer Larevy ou mer du pays de Lar. Comme les navires des Arabes partaient des bouches du Tigre et suivaient d'abord les côtes de Perse, la mer Larevy était précédée par la mer appelée mer de Perse. Il n'est point parlé ici de la mer de Perse, à cause de la lacune qui se trouve au commencement du volume.
(3) Ici commence la deuxième page du manuscrit arabe. et ce n'est qu'à partir de là que le récit devient authentique. La partie qui précède, partie qui occupe le côté verso du premier feuillet du manuscrit, me paraît apocryphe, et elle a été probablement imaginée pour dissimuler la lacune. Cette partie présente quelques expressions dont j'ai rendu le sens un peu au hasard.
(4) Le mot arabe
![]() au
pluriel
au
pluriel  , dérive du syriaque
, dérive du syriaque
 , terme qui s'applique à tout
objet avec lequel on fait du bruit, en le frappant. Il se dit des
cloches et des sonnettes, et c'est le sens qu'il a ici. On s'en est
ensuite servi pour désigner les crécelles avec lesquelles, dans les
églises, on annonce les différentes parties de l'office. En effet,
dans les Etats musulmans, l'usage des cloches est maintenant
interdit, excepté dans les montagnes du Liban, dans lesquelles la
population est uniquement composée de chrétiens.
, terme qui s'applique à tout
objet avec lequel on fait du bruit, en le frappant. Il se dit des
cloches et des sonnettes, et c'est le sens qu'il a ici. On s'en est
ensuite servi pour désigner les crécelles avec lesquelles, dans les
églises, on annonce les différentes parties de l'office. En effet,
dans les Etats musulmans, l'usage des cloches est maintenant
interdit, excepté dans les montagnes du Liban, dans lesquelles la
population est uniquement composée de chrétiens.
(5) On trouve un récit analogue dans la relation de Néarque, probablement à l'occasion de l'apparition de quelque baleine. Néarque rapporte que ses compagnons étant saisis de frayeur à l'aspect d'un poisson d'une grandeur monstrueuse, il les engagea à pousser tous à la fois un grand cri et à sonner des trompettes, ce qui mit le monstre en fuite. (Arrien, Historia indica, édition de Schmieder, Halle, 1798, p. 162 et suiv.) Au temps de Strabon, les navigateurs avaient adopté cet usage. (Strabon, liv. xv.) Mais Philostrate, qui écrivait à la fin du iie siècle de notre ère, fait mention, dans sa Vie d'Apollonius de Tyane, d'une coutume qui se rapproche davantage du récit de l'auteur arabe. Les navigateurs suspendaient à la proue et à la poupe du bâtiment des sonnettes qui étaient mises en mouvement par la marche du navire. (Philostrati opera, édition de Leipzig, 1709, p. 139.)
(6) Les détails qu'on lit ici se retrouvent en grande partie dans le Ketab-al-adjayb, accompagnés de nouvelles circonstances. En ce qui concerne le oual, que Massoudi nomme aoual, voyez le Moroudj-al-dzeheb, tom. Ier, fol. 45 verso. C'est un squale.
(7) La mer de Herkend est bornée à l'ouest par les Laquedives et les Maldives ; à l'est, par le continent de l'Inde ; au sud-est, par l'île de Ceylan et le golfe de Manar.
(8) Ptolémée (liv. VII, chap. 4) porte le nombre de ces îles à treize cent soixante et dix-huit. Comparez le passage arabe relatif aux Maldives et aux Laquedives avec le récit de Massoudi.
(9) Le Kitab-el-adjayb porte, au
lieu de plante, le mot
 , maison. Massoudi
parle de morceaux d'ambre gros comme des quartiers de rocher et
comme des montagnes. Ce sont des exagérations évidentes.
, maison. Massoudi
parle de morceaux d'ambre gros comme des quartiers de rocher et
comme des montagnes. Ce sont des exagérations évidentes.
(10) Il s'agit ici d'ambre gris. Suivant l'opinion de Swediaur, opinion qui est maintenant généralement suivie, l'ambre gris est formé des excréments durcis des cachalots. (Voyages de Chardin, édition de M. Langlès, tome III, pages 325 et suivantes. Voyez également ci-après, page 144.)
(11) La traduction française d'Edrisi, t. Ier, p. 69, porte al-kandj.
(12) Voy. à ce sujet le Discours préliminaire.
(13) Le mot arabe qui sert à désigner une île se dit aussi d'une presqu'île. Quand donc les Arabes veulent parler d'une véritable ile, ils disent que c'est une île entourée par la mer.
(14) Les musulmans croient qu'Adam, après son péché, fut jeté dans l'île de Ceylan, sur la montagne qui domine l'île; c'est de là que cette montagne a été appelée Pic d'Adam. Les musulmans y vont en pèlerinage ; suivant Ibn Batoutah, qui visita la montagne au xive siècle de notre ère, et qui a donné à ce sujet des détails curieux; ces pèlerinages commencèrent dans la première moitié du ive siècle de l'hégire, xe de notre ère. (Voy. la relation d'Ibn Batoutah). De leur côté, les bouddhistes de l'Inde, de la Chine et des contrées intermédiaires se rendent à cette montagne, parce que, dans leur opinion, le fondateur de leur religion y a laissé, comme marque de son séjour, la trace de son pied. (Voy. la relation d'un voyage fait par un Chinois, dans le ve siècle de notre ère, et intitulée Foe-koue-ki, p. 332 et suiv.) Le mot rohoun est une altération du sanscrit rohana.
(15)
Ce nom est écrit de diverses manières : Alrâmy
 , Alramny, Alrâmyn,
etc.
, Alramny, Alrâmyn,
etc.
(16) On voit ci-après, qu'il s'agit ici de parasanges carrées, ce qui fait environ vingt-neuf parasanges de long sur vingt-neuf parasanges de large.
(17)
Le camphre vient surtout dans l'ile de Sumatra ; le suc dont il se
forme est reçu dans un vase où il prend de la consistance ; c'est
alors qu'il reçoit le nom de camphre. Quand le suc est extrait de la
sorte, l'arbre se sèche et meurt. (Comparez le Kitab-al-adjayb,
fol. 22 ; Edrisi, tom. Ier de la trad. française, p. 80,
et Marsden, History of Sumatra, 3e
édition, p. 149 et suiv.) M. Walckenaer a fait observer que le
camphre est resté inconnu aux Grecs et aux Romains, et que c'est une
remarque faite par les Arabes. (Analyse des voyages de Sindbad, par
M. Walckenaer, Annales des voyages, de 1832, p.
16.) A l'égard de Fansour, nom du lieu d'où ou tirait le
camphre, ce nom varie dans les manuscrits. On trouve Fayssour
 , Cayssour
, Cayssour
 , etc.
, etc.
(18) Edrisi (tom. Ier de la trad. française, p. 76 et 77) a écrit Al-beynan.
(19) La mer de Schdaheth paraît répondre au golfe formé par l'île de Ceylan et le continent indien, au nord-est de l'île. Les deux mers dont il est parlé ici sont donc le golfe de Manar et le golfe de Pal*.
(20)
Ce nom est écrit ailleurs Lykh-yâlous
 , Lenkh-yâlous
, Lenkh-yâlous
 etc. Massoudi a écrit
alendjemâlous.
etc. Massoudi a écrit
alendjemâlous.
(21) Les îles nommées encore
aujourd'hui Andaman. Massoudi appelle ces îles Abrâmân

(22) Le texte porte de plus : « Il s'agit ici des parties naturelles. » Ces mots sont en partie raturés dans le manuscrit.
(23) Il s'agit ici d'une trombe, et dans ce qui suit de quelque volcan sous-marin. Camoëns a donné une description de la trombe dans le cinquième chant de son poème. Pline le naturaliste en avait parlé sous la dénomination de columna.
(24) Dans la direction du nord-ouest.
(25) Ce poisson, suivant quelques auteurs, répond à l'espadon. Mais ce n'est pas le cas ici.
(26) Ici, dans le manuscrit original, il y a une lacune d'un ou de plusieurs feuillets.
(27) Khanfou est, à proprement parler, le nom d'un port situé sur les côtes de Chine, à l'embouchure du fleuve Tsien-thang.
(28) Les incendies sont encore très fréquents à Canton, et pour les mêmes raisons. (Voy. la Description de la Chine, par Davis, tom. Ier, p. 111 et 376; tom. II, p. 87.)
(29) C'est-à-dire le khalife de Bagdad. La même expression se retrouve dans divers endroits de l'ouvrage de Hamza d'Ispahan, notamment aux p. 201 et suiv. Le mot sulthan signifie en arabe « puissance, » et il fut, dans l'origine, appliqué au khalife, comme équivalent de souverain. Mais, vers le milieu du ive siècle de l'hégire, xe siècle de notre ère, lorsque les khalifes de Bagdad eurent été dépouillés, par des soldats heureux, de la puissance temporelle, et qu'ils furent réduits à la puissance spirituelle, le mot sulthan devint le titre exclusif de l'émir qui dominait tous les autres. (Voyez à ce sujet mes Extraits des historiens arabes des croisades, Paris, 1839.) Le mot sulthan servit même à désigner d'une manière générale l'homme investi du pouvoir civil. (Voyez le traité d'Ibn Haukal, intitulé : Description de Palerme, traduit par M. Amari, dans le Journal asiatique, cahier de janvier 1845.)
(30) Voy. sur cet endroit, le Discours préliminaire.
(31) Mascate signifie, en arabe, « un lieu de descente. » Ce n'était d'abord qu'un mouillage ; mais, peu à peu le concours des navires lui donna de l'importance, et à la fin Sahar se trouva en partie abandonné.
(32)
Koulam est la ville nommée aussi Quillon; pour le mot
malay, il entre dans la dénomination vulgaire de Malabar
ou pays de Mala. Le manuscrit et le texte imprimé portent
Koukam-malay; mais Koukam est une faute de copie, et le
copiste lui-même a pris la peine d'écrire en marge qu'il fallait
lire Koulam. Il est surprenant que ni Renaudot, ni M. Langlès
n'aient fait attention à la note marginale qui est de la même main
que la relation entière. Du reste, la différence, en arabe, est
légère ; c'est  au lieu de
au lieu de  Edrisi a adopté la
bonne leçon. (Voyez le tom. Ier de la trad. française, p.
160 et 1J2:)
Edrisi a adopté la
bonne leçon. (Voyez le tom. Ier de la trad. française, p.
160 et 1J2:)
(33)
Le mot arabe
 , que je traduis par «
péage, » signifie proprement un lieu où l’on entretient des hommes
armés.
, que je traduis par «
péage, » signifie proprement un lieu où l’on entretient des hommes
armés.
(34) Mille dirhems faisaient à peu près mille francs de notre monnaie actuelle. Quant au dinar, il valait un peu plus de vingt francs.
(35) Voy. tom. Ier, p. 8, et le Discours préliminaire.
(36) Le mot bâr est écrit ailleurs mâr. On le retrouve dans Malabar, etc.
(37) L'empire du Zabebj avait pour centre les îles de Java et de Sumatra.
(38) Le pagne est une étoffe rayée avec laquelle on se couvre le milieu du corps. (Cf. la Chrest. arab. de M. de Sacy, t. Ier, p. 195, et l'abbé Dubois, Mœurs de l'Inde, tom. Ier, p. 455.)
(39) Kalah-bâr me semble répondre à la partie méridionale du Coromandel.
(40) Edrisi (tom. I, p. 82) a écrit Tenoumah.
(41) Sur ces différents lieux, voyez le Discours préliminaire.
(42) Probablement Kalah-bar.
(43) Cette pierre est encore employée dans la médecine chinoise. (Voy. l'Encyclopédie japonaise, liv. lxi, fol. 30.) Cette indication m'est fournie par M. Edouard Biot.
(44) On a signalé plusieurs volcans dans les îles de la Malaisie. (Voy. les relations modernes.)
(45) On lit, dans le dictionnaire heptaglotton de Castel, que le mot kouschan se dit d'un ragoût fait en Arabie, avec du riz et du poisson, ou bien avec du gras-double.
(46)Autre espèce de concombre.
(47) C'est la liqueur nommée oracle. Sur cette liqueur, qui a le goût de notre vin blanc, Voy. la Description de la Chine, par Davis, tom. I.
(48) Nabyd se dit, en arabe, des liqueurs fermentées, en général, principalement du jus de palmier. Sur oe jus, nommé, dans la presqu'île de l'Inde, toddy, et, dans les îles de la Malaisie, touah et nira, comparez l'abbé Dubois, Mœurs de l'Inde, tom. Ier, p. 7, et M. Dulaurier, Recueil de lois maritimes, par M. Pardessus, tom. VI, p. 462.
(49) Ce papier est fait avec des matières végétales. (Voy. la Description générale de la Chine, par Davis, trad. franc., tom. II, p. 158.)
(50) Voy. la description de la ville de Quinsaï, par Marco-Polo.
(51) Chez les musulmans, on coupe la main droite au filou. Pour le voleur proprement dit, il perd la main droite et le pied gauche.
(52) Dans l'Inde, tout le monde, même les statues des Dieux, portent des pendants d'oreille. (Dubois, Mœurs de l'Inde, t. Ier, p. 469). Quinte-Curce (liv. VIII, chap. ix) a parlé de cet usage, qui, chez les Grecs et les Romains, était réservé aux esclaves. Balhara est le titre que les écrivains arabes des premiers temps donnent au prince qui régnait dans la partie occidentale de l'Inde, aux environs du Guzarate et du golfe de Cambaye.
(53) Thatherya me paraît être une altération du mot grec statère, servant à désigner une monnaie d'argent. Les Indiens avaient des monnaies, frappées au coin du pays, comme le prouvent les médailles qu'on y découvre chaque jour. Ici il est parlé de monnaies thatheriennes, frappées aux environs du Guzarate; Ibn Haukal, témoin oculaire, dit que ces monnaies étaient aussi en usage dans la vallée de l’Indus. (Voy. le recueil de M. Gildemeister, intitulé De rebus indicis, p. 28 du texte. Voy. aussi Edrisi, tom. Ier de la trad. franc.) Le mot latin denarias, appliqué surtout à une monnaie d'or, s'était également introduit dans le sanscrit, sous la forme dinara; on le trouve avec cette acception dans Amara-cocha, vocabulaire qui paraît avoir été composé dans le ve siècle de notre ère. (Notes de M. Troyer, Histoire de Cachemire, tom. Ier, p. 435.) Les mots denier et statère se sont sans doute introduits dans l'Inde avec les monnaies grecques «t romaines, qu'on sait y avoir été un objet d'importation. (Voyez le Périple de la mer Erythrée, p. 18.)
(54) Sur les principales ères des Indiens, voy. l'extrait d'Albyrouny que j'ai publié dans le Journal asiatique de septembre 1844, p. 277 et suiv. (p. 135 et suiv, du tirage à part)
(55) Les Arabes, à l'époque dont il s'agit ici, étaient établis en grand nombre sur les côtes du golfe de Cambaye et y faisaient un riche commerce.
(56) On lit que la ville de Canoge était située dans le Djorz; or, Canoge se trouvait sur la rive occidentale du Gange, au sud-est de Dehli. Le Djorz me paraît répondre au Douab des Indiens, qui portait jadis le nom de Sorasena. (Comparez, Arrien, Historia indica, chap. viii, et les Chefs-d’œuvre du théâtre indou, trad. franc., t. Ier, p. lxxvii.)
(57)
Massoudi s'exprime ainsi (Moroudj al-dzeheb, tom. Ier,
fol. 75) : 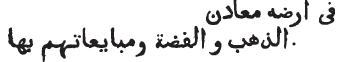
(58)
Les manuscrits de Massoudi portent Thâken
 et Thakân
et Thakân
 . Le même nom est écrit ailleurs
Thafen
. Le même nom est écrit ailleurs
Thafen  , Thaben
, Thaben
 , etc. Massoudi place ce
pays dans l'intérieur des terres.
, etc. Massoudi place ce
pays dans l'intérieur des terres.
(59)
Les manuscrits de Massoudi portent Ouahman
 . Suivant Massoudi, cette contrée
s'étendait sur la côte et dans l'intérieur des terres. Elle paraît
répondre à l'ancien royaume de Visapour.
. Suivant Massoudi, cette contrée
s'étendait sur la côte et dans l'intérieur des terres. Elle paraît
répondre à l'ancien royaume de Visapour.
(60) Il y a là une exagération évidente ; néanmoins, le même nombre se trouve dans le Moroudj de Massoudi (tom. Ier, fol. 75 verso).
(61)
On lit dans le Moroudj ces mots :
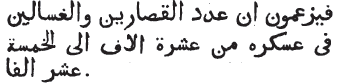 . Le fait rapporté ici ne
paraîtra pas invraisemblable, si l'on fait attention que de tout
temps, chez les Indiens, chaque caste et chaque profession a ses
attributions particulières, et qu'un homme d'une caste n'empiète
jamais sur les attributions d'un homme d'une autre caste; ajoutez à
cela qu'une armée indienne entraine avec elle des ouvriers de tous
les états et se suffit à elle-même. Voy. la description que Bernier
a faite de l'armée mogole, sous l'empereur Aurangzeb, époque,
cependant, où les mœurs nationales s'étaient modifiées. (Voyages
de Bernier, tom. II, p. 250.)
. Le fait rapporté ici ne
paraîtra pas invraisemblable, si l'on fait attention que de tout
temps, chez les Indiens, chaque caste et chaque profession a ses
attributions particulières, et qu'un homme d'une caste n'empiète
jamais sur les attributions d'un homme d'une autre caste; ajoutez à
cela qu'une armée indienne entraine avec elle des ouvriers de tous
les états et se suffit à elle-même. Voy. la description que Bernier
a faite de l'armée mogole, sous l'empereur Aurangzeb, époque,
cependant, où les mœurs nationales s'étaient modifiées. (Voyages
de Bernier, tom. II, p. 250.)
(62) Il est parlé de ces étoffes dans le Périple de la mer Erythrée.
(63)
On lit dans le Moroudj de Massoudi (tome Ier, fol.
75 verso) : « On exporte du pays, le poil appelé samara, dont
on fait les émouchoirs ou chasse-mouches ; ces émouchoirs reçoivent
des manches d'ivoire et d'argent, et les serviteurs les tiennent sur
la tête des princes, les jours de réception. » D'un autre côté, dans
le manuscrit, le mot  , que j'ai traduit par «
étoffes, » serait susceptible d'être lu
, que j'ai traduit par «
étoffes, » serait susceptible d'être lu
 ou
« plantes. » On sait que, dans l'Inde, la chaleur du climat a rendu
nécessaire l'usage du parasol et de l'émouchoir. Le parasol porte,
en sanscrit, le nom de tchatra. (V. le Harivansa,
traduction de M. Langlois, tom. Ier, p. 109, et
ci-devant, p. 151.) Le parasol, ayant passé de l'Inde en Perse, y a
reçu le nom de tchatra
ou
« plantes. » On sait que, dans l'Inde, la chaleur du climat a rendu
nécessaire l'usage du parasol et de l'émouchoir. Le parasol porte,
en sanscrit, le nom de tchatra. (V. le Harivansa,
traduction de M. Langlois, tom. Ier, p. 109, et
ci-devant, p. 151.) Le parasol, ayant passé de l'Inde en Perse, y a
reçu le nom de tchatra  ;
quant à l’émouchoir, il est nommé, en sanscrit, tchamara, mot
qui a été rendu, par Massoudi, par samara, Sur le tchamara,
voy. le Harivansa, tom. Ier, p. 307. L'émouchoir
est appelé, en hindoustani, tchaounri
;
quant à l’émouchoir, il est nommé, en sanscrit, tchamara, mot
qui a été rendu, par Massoudi, par samara, Sur le tchamara,
voy. le Harivansa, tom. Ier, p. 307. L'émouchoir
est appelé, en hindoustani, tchaounri
 et pankha
et pankha
 . Ordinairement, le tchamara est
fait avec le crin de la queue du bœuf du Tibet, appelé yak ou
bos
granniens.
Quelquefois, le nom s'applique à l'animal lui-même (Harivansa,
tom. Ier, p. 359). Les émouchoirs se font aussi avec de
la soie et des plumes de paon.
. Ordinairement, le tchamara est
fait avec le crin de la queue du bœuf du Tibet, appelé yak ou
bos
granniens.
Quelquefois, le nom s'applique à l'animal lui-même (Harivansa,
tom. Ier, p. 359). Les émouchoirs se font aussi avec de
la soie et des plumes de paon.
(64) Massoudi écrit notchan
 et nouschan
et nouschan
 (Moroudj, tom. Ier,
fol. 75 verso et 177 vers.) Cette dénomination est probablement un
mot indigène altéré. Albyrouny a parlé du même animal, sous la forme
sanscrite ganda (Journal asiatique de
septembre, 1844, p. 251 et suiv, et p. 109 du tirage à part), et il
le distingue du kerkedenn. Il en est de même de Kazouyny, dans le
Adjayb-al-makhloucat; Kazouyny appelle cet animal sinad
(Moroudj, tom. Ier,
fol. 75 verso et 177 vers.) Cette dénomination est probablement un
mot indigène altéré. Albyrouny a parlé du même animal, sous la forme
sanscrite ganda (Journal asiatique de
septembre, 1844, p. 251 et suiv, et p. 109 du tirage à part), et il
le distingue du kerkedenn. Il en est de même de Kazouyny, dans le
Adjayb-al-makhloucat; Kazouyny appelle cet animal sinad
 . La description qu'il en donne
est accompagnée d'une figure. Cette description a été reproduite par
Domayry, dans son Histoire des animaux.
. La description qu'il en donne
est accompagnée d'une figure. Cette description a été reproduite par
Domayry, dans son Histoire des animaux.
(65) La même description, accompagnée de quelques nouvelles circonstances, se retrouve dans le Moroudj, tom. Ier, fol. 76. (Voy. aussi l'extrait d'Albyrouny, Journal asiatique, à l'endroit cité, ainsi que le Ayyn-Akbery, version anglaise, Londres, 1800, in-4°, t. II, p. 96.) On peut rapprocher de ces divers témoignages celui de Cosmas, recueil de Montfaucon, t. II, p. 334 et suiv.
(66)
Massoudi, t. Ier, fol. 76, écrit Alkamen
 . Ce pays me paraît répondre au
Myssore.
. Ce pays me paraît répondre au
Myssore.
(67)
Massoudi a écrit Firendj  .
C'est, ce me semble, la côte de Coromandel.
.
C'est, ce me semble, la côte de Coromandel.
(68) Sur les côtes de l'empire birman. Edrisi fait de ce pays une île, parce qu'en arabe le même mot se dit d'une île et d'une presqu'île. (Voy. le tom. Ier de la trad. franc, p. 88.)
(69) Le musc du Tonquin est encore un des plus estimés.
(70)
Il s'agit probablement ici de la Cochinchine. Massoudi a écrit
Maber  , et Edrisi Mayed
, et Edrisi Mayed
 . Celui-ci fait aussi de
ce pays une île. (Tom. Ier de la trad. franc, p. 89.)
. Celui-ci fait aussi de
ce pays une île. (Tom. Ier de la trad. franc, p. 89.)
(71) Notice sur la Cochinchine, par le P. Gaubil ; Histoire générale de la Chine, par le P. Mailla, tom. XII, p. 10.
(72) La nuit est divisée par les Chinois en. cinq veilles, et chacune d'elles est annoncée au son du tambour ou d'une cloche. Le djadem servait également à annoncer les incendies, si fréquents dans la Chine. Voy. la description de la ville de Quinsaï, par Marco-Polo... L'auteur arabe dit que le son du djadem et du tambour était une manière de rendre hommage au souverain ; cet usage existait dans les pays musulmans, sous le nom de nouba. Du reste, l'abbé Renaudot fait remarquer, dans ses notes que les honneurs du djadem et du tambour ont été partagés par les gouverneurs de provinces et les magistrats. Quant aux mots arabes que j'ai traduits pu : « les Chinois ont des signes et des poids pour connaître les heures, » ils sont ainsi rendus par Renaudot, p. 25 : « ils ont aussi des cadrans et des horloges à poids. » L'interprétation donnée par Renaudot est peut-être la véritable. D'après ce que m'apprend M. Edouard Biot, le caractère chinois qui désigne le gnomon, piao, se dit proprement d'un signal. Les Chinois avaient, plusieurs siècles avant notre ère, des horloges d'eau ou clepsydres, ainsi que des gnomons ; le gnomon est indiqué avec son cadran dans le Tcheou-li, article Ta-sse-tou. Pour l'horloge d'eau, elle est indiquée dans le même recueil, article kié-hou-chi.
(73) Le texte porte avec des folous. Le mot folous est une altération du mot grec obole.
(74) Voy. Edrisi, tom. Ier de la trad. franc, p. 68, et ci-après, p. 142.
(75) Il s'agit ici de la porcelaine. Voy. aussi Edrisi, t. Ier de la trad. franc, p. 193 et 196. M. Alexandre Brongniart a consacré aux origines de la porcelaine une section du grand ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de Traité des arts céramiques, t. II, p. 473 et suiv. On trouve dans la relation du célèbre voyageur arabe, Ibn Batoutah, qui était né à Tanger, sur les bords de l'océan Atlantique, et qui pénétra en Chine vers l'année 1345 de notre ère, deux passages relatifs à la porcelaine ; dans ces passages, Ibn Batoutah paraît faire entrer, dans la cuisson de cette précieuse poterie, le charbon de terre, qui était des lors employé en Chine comme moyen de chauffage, et dont Marco-Polo a fait mention. Les expressions dont se sert Ibn Batoutah ne sont pas très précises ; peut-être même elles manquent d'exactitude. Voici les deux passages de la relation arabe : « La poterie chinoise ne se fabrique que dans la ville de Zeytoun et à Synkilan. On emploie pour cela une terre provenant de certaines montagnes du pays ; cette terre brûle comme le charbon, et on y ajoute des pierres particulières à la contrée ; on fait brûler les pierres pendant trois jours ; ensuite on y verse de l'eau, et le tout redevient terre. Après cela on couvre cette terre. L'a meilleure poterie est celle qui est restée couverte pendant un mois complet ; on ne dépasse pas ce terme. La moins bonne est celle qui n'est restée couverte que pendant dix jours ; celle-ci se vend, dans le pays, à un aussi bas prix que la poterie chez nous, et même à un prix plus bas. La poterie, chinoise est exportée dans l'Inde et dans tous les pays, jusque dans nos contrées du Maghreb ; c'est la plus belle espèce de poterie. » Voy. les manuscrits du supplément arabe de la Bibl. roy. n° 670, fol. 131 verso. Ibn Batoutah s'exprime ainsi au folio suivant : « Les habitants de la Chine et du Khatay n'ont pas d'autre charbon qu'une terre qui est particulière à leur pays. Cette terre est ferme, comme la terre glaise chez nous. On met le feu à cette terre, et die brûle comme du charbon ; elle donne même plus de chaleur que le charbon. Quand elle est convertie en cendres, on la délaye dans l'eau, puis on la fait sécher et on la fait servir une seconde fois. On continue la même opération jusqu'à ce qu'elle soit entière ment dissoute. C'est la terre qu'on emploie pour faire les vases de poterie chinoise ; seulement l'on y ajoute certaines pierres. » Il est parlé d'une poterie particulière qui se fabriquait à Koulam, dans le midi de l'Inde, dans la relation de Misar (édition de M. de Schlœzer, p. 24). A l'égard du témoignage de Marco-Polo, relativement au charbon de terre, voy. l'édition de la Société de géographie, p. 115 et 390. Marco-Polo a aussi parlé de Zeytoun, qui n'est pas mentionné dans la présente relation. Zeytoun est pour Tseu-thoung ; c'est le nom d'un port de mer de la province de Fou-kian, dont la dénomination actuelle est Thsiuan-tchou-fou. (Mémoires relatifs à l'Asie, par Klaproth, t. II, p. 208 et suiv, et Journal asiatique d'avril 1833.) Enfin la ville de Synkilan est probablement le port de Canton. (Journal asiatique du mois de mai 1833.)
(76) C'est-à-dire, garanties contre tout accident. Le dork, d'après le traité arabe intitulé Taryfat, indique une valeur que le vendeur dépose entre les mains de l'acheteur, comme garantie, de la part du vendeur, de la bonne qualité de l'objet vendu, l'acheteur prenant à sa charge certains accidents qui peuvent survenir. (Voyez le Taryfat, édit. de Constantinople, p. 61 et 82.)
(77) Jusqu'à la fin de la mousson.
(78) Confucius conseille de dépenser à l'enterrement de ses parents jusqu'à la moitié de ses biens. L'empereur actuel, plus sage que Confucius, a mis des bornes à ces sacrifices inutiles. Souvent un fils, pour honorer son père, avait ruiné sa famille. (Timkowski, Voyage à Pékin, trad. franc, tom. II.)
(79) Ce qui est dit des aliments laissés auprès des morts est modifié ci-devant. Il est probable que le marchand Soleyman a fait quelque confusion avec l'usage chinois d'après lequel, dans les cérémonies faites en l'honneur des morts, on présentait autrefois des aliments à un enfant, qui représentait le premier chef de la famille, et l'on augurait, d'après les paroles qui lui échappaient, si les offrandes étaient agréables aux ancêtres. Cette cérémonie est indiquée dans le Chi-king. (Voy. les Recherches de M. Edouard Biot sur les mœurs des anciens Chinois, Journal asiatique de novembre 1843, p. 351.)
(80) Voy. ci-devant.
(81) Toussendj paraît répondre à Cheou-tching, Thoucam à Tchou-kouan, titre général des chefs de l'administration supérieure, et Dy-fou à Tchi-fou, titre donné aux gouverneurs de villes du premier ordre. Klaproth a publié un tableau des titres accordés aux villes et aux fonctionnaires de la Chine. (Journal asiatique d'avril 1833.)
(82) Il n'y a pas, en Chine, d'avocat qui plaide; les déclarations des parties sont écrites, en forme de mémoire, par des écrivains autorisés, qui peuvent aussi les lire devant la cour. Ces écrivains achètent leur titre, et s'indemnisent par les prélèvements ou honoraires qu'ils reçoivent des parties. (V, le Chinese Repository, tom. IV, p. 335.)
(83) On se sert, en Chine, pour cet objet, de bambous dont la forme et la grandeur sont déterminées d'avance. (Code pénal de la Chine, traduit du chinois en anglais par M. Staunton, et de l'anglais en français par M. Renouard de Sainte-Croix, tom. Ier.)
(84) Cet usage a varié suivant les temps.
(85) Par vivres, il faut entendre le riz, le blé, le millet et les autres grains. Il existe un mémoire du P. Cibot sur les greniers publics en Chine. (Description de la Chine, par Grosier, tome dernier.)
(86) Voy., dans le Discours préliminaire, ce que Marco-Polo dit sur le montant des impôts prélevés sur la ville de Quinsaï, qui ici répond à la dénomination de Khanfou.
(87)
Sur le mot  , voy. le
Dictionnaire des matières médicales, par
Ibn-Beythar.
, voy. le
Dictionnaire des matières médicales, par
Ibn-Beythar.
(88) Les auteurs chinois font mention de l'impôt sur le sel et sur le thé, à l'époque dont il s'agit ici. (Voyez Klaproth, Notice sur l'encyclopédie de Ma-touan-lin, Zoom, asiatique de juillet 1832, p. 30.)
(89) Comparez ce passage avec ce que dit Edrisi, tom. Ier de la trad. franc. Autrefois, près du palais de l'empereur, à Pékin, il y avait un salon avec un tambour ; des mandarins et des soldats y montaient la garde jour et nuit. Quand quelqu'un ne pouvait obtenir justice, ou qu'il était vexé, il allait frapper le tambour; à ce bruit, les mandarins étaient obligés d'accourir, d'examiner les griefs du plaignant, et de lui procurer satisfaction. Aujourd'hui cet usage est aboli. (Timkoirski, Voyage à Peking, tom. II. Voy. aussi les notes de Renaudot.)
(90) Les passeports et les billets de passe sont mentionnés dans le Tcheou-li, par conséquent plusieurs siècles avant notre ère. On peut consulter sur ce qui se pratique maintenant le Code pénal de la Chine, trad. fr. t. Ier, p. 377 et suiv.
(91) Le texte arabe est obscur. Dans les anciens temps, suivant le Tcheou-li, les conventions privées des Chinois étaient faites en double. On séparait en deux la tablette ou, plus tard, le papier qui portait les deux doubles, et on devait les représenter soit à l'échéance du prêt, ou bien en cas de difficulté sur la convention. (Voy. le mémoire de M. Edouard Biot sur le système monétaire des Chinois, Journal asiatique de mai 1837. Voy. aussi le Livre de la voie et de la vertu, par Lao-Tseu, traduction de M. Stanislas Julien, p. 190.)
(92) Le fakkoudj correspond aux dénominations chinoises kouang et min, et équivaut à mille pièces de cuivre enfilées ensemble. L'enfilade est estimée ici le dixième de dinar ou pièce d'or arabe, et, comme le dinar valait, au xe siècle, vingt francs à peu près, il en résulte que l'enfilade valait deux francs, et que la pièce de cuivre n'était estimée que le cinquième d'un de nos centimes. Il fallait que l'or et l'argent fussent alors bien rares en Chine, pour que le cuivre conservât si peu de valeur dans le change.
(93)
C'est le même mot qui est écrit par quelques auteurs arabes
fagfour ; sa forme est altérée. On peut consulter sur ce mot le
supplément du P. Visdelou, à la Bibliothèque orientale de
d'Herbelot, au commencement. De son côté, Massoudi, Moroudj,
tom. Ier, fol. 59, verso, dit que bagbour est le
titre par lequel le peuple chinois désigne l'empereur ; mais que,
lorsqu'on s'adresse au prince même, on le nomme thamgama
 . Pour la
dénomination elle-même, elle existe en Chine depuis la plus haute
antiquité ; c'est le titre thian-Ueu ou fils du ciel, donné
aux empereurs. (Voy. le Journ. asiat. de juin 1830, Mémoire de M.
Kurz.)
. Pour la
dénomination elle-même, elle existe en Chine depuis la plus haute
antiquité ; c'est le titre thian-Ueu ou fils du ciel, donné
aux empereurs. (Voy. le Journ. asiat. de juin 1830, Mémoire de M.
Kurz.)
(94) Voy. ci-devant.
(95) Cet usage s'est maintenu jusqu'à nos jours, et tient lieu de ce que nous appelons l'état civil. (Code pénal de la Chine, trad. franc. t. Ier, p. 139 et suiv.) Marco Polo a parlé de cet usage, mais considéré sous un point de vue astrologique (édition de la Société de géographie, p. 171).
(96) L'âge où les hommes en Chine ont été soumis à la capitation a varié ; mais le Gouvernement s'est toujours montré plein d'égards pour les vieillards.
(97) La dynastie Tang, qui régna entre les années 620 et 904 de l'ère chrétienne, donna une grande impulsion à l'enseignement. Les maîtres des écoles reçurent à certaines époques une somme d'argent des étudiants ; à d'autres époques des allocations leur furent affectées.
(98) Les femmes, chez les Arabes, se coupent la chevelure. Sur cet usage, voy. mon ouvrage sur les monuments arabes, persans et turcs, du cabinet de M. le duc de Blacas, tom. II, p. 328.
(99) Le manna est un poids indien, qui varie suivant les provinces, depuis deux livres jusqu'au-dessus de quarante.
(100) Sur les épreuves judiciaires dans l'Inde, comparez le Code de Manou, livre VIII, n° 114, et les Mœurs des peuples de l'Inde, par M. l'abbé Dubois, tom. II, p. 465 et 546. Voy. aussi l'ouvrage d'Albyrouny, manuscrits arabes de la Bibl. roy. fonds Ducaurroy, n° 22, fol. 143 ; et les Recherches asiatiques, trad. franc, tom. Ier, p. 471 et suiv.
(101) Ce récit est reproduit par Massoudi, qui dit avoir été lui-même témoin du fait. (Voy. le Moroudj al-dzeheb, tom. Ier, fol. 32.) Edrisi a étendu cet usage à toute l'Inde. (Voy. le tom. Ier de la trad. franc., p. 178.)
(102) Voy. tom. Ier, p. 5.
(103) Traité d'Albyrouny déjà cité, fol. 142, verso.
(104) Il s'agit des castes des Brahmes, des Kschatrias, etc.
(105) A l'époque où écrivait l'auteur de la relation, tous les princes musulmans, à la différence de ce qui avait lieu dans l'Inde, reconnaissaient l’autorité spirituelle et la prééminence temporelle du khalife de Bagdad.
(106) Par vin, il faut entendre toute espèce de liqueur fermentée. Les Chinois boivent principalement de l'eau-de-vie faite avec du riz ; c'est ce qu'on appelle en Europe arak ; il y a d'ailleurs des vignes en Chine, comme l'auteur le dit ci-dessous. Sur l'usage du vin en Chine, voy. un mémoire de Klaproth (Journal asiatique de février 1828).
(107) Voy. ci-devant, ainsi que le Code de Manou, livre XI, nos 90 et suiv.
(108) Le pays du poivre est la côte du Malabar.
(109) Code de Manou, livre VII, nos 5, 201 et suiv.
(110) Marco Polo parle d'une tribu tartare chez laquelle le même usage existait de son temps. Voy. l'édition de la Société de géographie, p. 78.
(111) Chez les musulmans on coupe simplement la main aux filous ; encore se borne-t-on ordinairement à la bastonnade.
(112) En ce qui concerne les courtisanes des temples de l'Inde, voy. Edrisi, tom. Ier de la trad. franc., page 81, et ci-devant.
(113) Le mot firasch est arabe et est ainsi défini dans le Taryfat : état d'une femme qu'un homme s'est réservée pour lui seul, avec l’idée d'en avoir des enfants. Ainsi, une femme mariée est en état de firasch, aussi bien que l’esclave qui est grosse et dont l'enfant est reconnu d'avance par le maître. En pareil cas, chez les musulmans, une femme ne peut pas se marier à un autre homme, jusqu'à l'expiration de sa grossesse. On voit qu'en Chine et dans l'Inde il en était autrement. Chez les Romains, Auguste, comme on sait, épousa Livie, déjà grosse d'un premier mari.
(114) Il s'agit évidement ici des bouddhistes qui, depuis longtemps, étaient fort nombreux en Chine, et qu'on nomme les adorateurs de Fo. Les disciples de Confucius et les Tao-sse ne sont pas idolâtres.
(114 bis.) Le sens est peut-être : Dans l'Inde, quand quelqu'un perd une personne de sa famille, il se rase la tête et la barbe. Voy. le Lévitique, ch. x, vers. 6.
(115) Statues des divinités, en général. Sur ce mot, voy. ce que j'ai dit dans le Journal asiatique de février 1845.
(116) Chez les musulmans comme chez les juifs, on égorge l'animal et l'on commence par en tirer tout le sang.
(117) Dubois, Mœurs des peuples de l’Inde, tom. Ier, p. 153, 269, 330 et suiv.
(118)
L'usage du cure-dent est pour les musulmans on moyen de propreté ;
c'est même un devoir religieux. Quelques auteurs font remonter cet
usage chez les Arabes, jusqu'avant Mahomet. Voyez Pococke,
Specimen
historia Arabam,
p. 3o3, et le Tableau de l'empire ottoman,
de Mouradjea d'Ohsson, tom. II, p. 16. Le même usage existe chez les
Indiens. Voy. l'ouvrage de M. l'abbé Dubois déjà cité, tom. Ier,
p. 334. Il est fait mention de cette coutume, par rapport aux
Indiens, dans la relation de Hiouan-thsang, prêtre bouddhiste
chinois, qui visita l'Inde, entre les années 619 et 645 de J. C, et
qui publia sa relation, à son retour en Chine, par ordre de
l'empereur. M. Pauthier en a inséré de longs extraits dans le
Journal asiatique de l'année 1839. On peut voir, en ce
qui concerne le cure-dent, le cahier de décembre 1839, p. 462, avec
les observations de M. Stanislas Julien, cahier de mai 1841, p. 439.
L'usage du cure-dent, chez les Indiens, tient à la même cause que
chez les Arabes; c'est que les Indiens, ainsi que le mit remarquer
le voyageur chinois, apprêtaient leurs mets avec divers
assaisonnements, et tes prenaient avec les doigts, ne misant usage
ni de cuillères, ni de bâtonnets ; ce qni les obligeait de recourir
à des moyens de propreté particuliers. Les extraits chinois publiés
par M. Pauthier renferment plusieurs autres remarques qui se
rapportent à ce qui est dit dans la présente relation. Il est
singulier du reste que ni le marchand Soleyman, ni Abou-Zeyd, qui
reviennent plusieurs fois sur l'usage du cure-dent, n'aient dit un
mot d'une autre coutume qui existait depuis longtemps dans l'Inde ;
c'est l'usage du bétel mêlé à quelque substance échauffante, et
propre à contrebalancer l'action énervante du climat. Voici ce que
dit Massoudi (t. Ier du Moroudj, fol. 92) : « Les
Indiens ont coutume de mâcher la feuille du bétel, mêlée avec de la
chaux et humectée avec la noix d'arec ; cet usage s'est introduit à
la Mekke et dans d'autres villes du Hedjaz et du Yémen; on mâche
cette composition en guise d'argile ; elle se trouve chez les
droguistes, et elle sert pour les tumeurs, etc. Cette composition
resserre les gencives, raffermit les dents, purifie et embaume
l'haleine, corrige une excessive humidité, ramène l'appétit, excite
à l'amour, imprime aux dents la couleur de la grenade, inspire la
gaieté, communique un mouvement à l'âme et fortifie le corps. Les
Indiens, grands et petits, ont horreur des dents blanches, et la
personne qui ne fait pas usage du bétel est repoussée par tout le
monde. » Le bétel est appelé par les Arabes tanboul
 ; c'est le sanscrit tamboula.
; c'est le sanscrit tamboula.
(119) Le Bouddhisme.
(120) Il semblerait, d'après ce passage, qu'au temps où voyageait le marchand Soleyman, la religion bouddhique dominait en Chine et le brahmanisme dans l'Inde.
(121) M. Letronne a émis l'opinion que la division de l'écliptique en douze signes, admise dans l'Inde, a été empruntée par les Indiens aux Grecs, qui eux-mêmes la tenaient des Chaldéens. J'espère montrer, dans un mémoire spécial, qu'en général les connaissances astronomiques des Indiens dérivent de la Grèce. Quant à la division par mansions de l'espace que la lune parcourt en douze mois, division qui est admise par les Indiens, et qui ne se retrouve pas dans l’Almageste de Ptolémée, H. Biot place la source de ces notions dans la Chine (Journal des Savants, année 1839; année 1840, p. 27, 75, 142, 337 et 262; année 1845). Néanmoins, il paraît qu'au vie siècle de notre ère et dans les siècles qui suivirent immédiatement, les astronomes indiens avaient acquis la prééminence dans l'Asie orientale. Un bonze chinois, appelé Y-bang, ayant à exécuter, vers l'an 720 de J. C. de grands travaux de géographie mathématique, eut recours à des traités occidentaux qui ne peuvent être que des traités indiens, et ses compatriotes l'accusèrent de s'être borné en général à les copier. (Mémoires sar l'astronomie chinoise, du P. Gaubil, publiés par le P. Souciet, tom. II, p. 7 4 ; et Histoire des empereurs chinois de la dynastie Thang, par le P. Gaubil, Mémoires sur la Chine, tom. XXI, p. 16, et p. 148 du Traité de la Chronologie chinoise.)
(122) En général, les chevaux qui se trouvent dans l'Inde sont venus des pays situés au nord-ouest, ou bien de l'Arabie.
(123) Davis, Description de la Chine, t. II, p. 139.
(124) Il s'agit ici d'une guerre avec quelque peuple étranger à la presqu'île et professant une autre religion, ou bien de quelque guerre intestine entre les brahmanistes et les bouddhistes.
(125) On a vu ci-devant le contraire de cela, du moins en ce qui concerne le Balhara. Probablement le Balhara donnait une solde, tandis que, chez les autres princes, les troupes étaient entretenues au moyen de bénéfices militaires.
(126) Espèce de manteau usité surtout en Perse, et qui couvre presque tout le corps. (Voy. le Voyage de Chardin, édition de M. Langlès, tom. IV, p. 2.)
(127) Par pagnes, l'auteur désigne sans doute on vêtement qui couvre le milieu du corps, et un second vêtement qui se met sur les épaules. On a vu ci-devant, que les Indiens ne portent qu'un pagne. Le second passage s'applique probablement aux Indiens du Mord et le premier aux Indiens du Midi, où la température est plus chaude. (Voy. les Mœurs de l'Inde, par l'abbé Dubois, tom. Ier, p. 455, et 469.)
(128) Voy. sur ce passage le Discours préliminaire.
(129) Il s'agit probablement ici du Japon, alors en rapport de commerce avec la Chine. Dans le texte imprimé, on lit de plus que le premier livre a été lu par un musulman appelé Mohammed, l'an 1011 (de l'hégire, 1602 de J. C). Ces paroles se trouvent en effet dans le manuscrit, au bas de la page ; mais elles sont d'une autre main que le corps de la relation ; c'est mal à propos que M. Langlès les a reproduites, et même insérées au milieu du texte.
[1] On en trouve, à la Bibliothèque royale, plusieurs exemplaires, mais avec des titres différents. Le n° 90i, ancien fonds arabe, lequel nous offre une copie ancienne et belle, porte le titre de Ketab-mokhtasser-al-adjayb, ou Abrégé du livre des merveilles. Dans le n° 517 du supplément arabe, le même ouvrage, copie également belle et ancienne, est intitulé : Akhbar-al-zeman-oua-garayb-al-bahr-oual-omran, c'est-à-dire, Histoires du temps et singularités de la mer et du monde habité; ce titre distingue suffisamment le traité en question du grand ouvrage historique de Massoudi, intitulé Akhbar-al-zeman, ouvrage qui ne nous est point parvenu, mais sur lequel on peut consulter le Dictionnaire bibliographique de Hadji-Khalfa, édition de M. Flügel, tom. Ier, p. 186. Enfin, dans l'ancien fonds arabe, n° 955, le Kitab-al-adjayb est attribué à Cazouyny, si connu par son Traité d'histoire naturelle. Edrisi, dont l'autorité est grande en ces matières, cite dans sa préface, parmi les sources où il a puisé, le Ketab-al-adjayb de Massoudi, et j'ai retrouvé, dans les nos 901 de l'ancien fonds et 517 du supplément, un grand nombre de passages rapportés par Edrisi. Mais, d'un autre côté, Edrisi (tom. Ier de la traduction française de M. Amédée Jaubert, p. 38) cite un traité intitulé aussi Ketab-al-adjayb et qu'il attribue à un écrivain nommé Hassan, fils de Mondar. Cela prouve une chose, qu'on savait d'ailleurs (voyez le Dictionnaire bibliographique de Hadji-Khalfa, aux mots Ketab-al-adjayb, ainsi que la préface du manuscrit n° 903 de l'ancien fonds arabe) ; c'est que les récits qui forment la base de l'ouvrage étaient du goût de la masse des lecteurs, et que plusieurs écrivains avaient repris le même sujet, se bornant quelquefois à changer le titre du livre et le nom de l'auteur.
[2] Le savant M. Quatremère, qui, depuis longtemps, a eu occasion d'examiner la présente relation et le Moroudj-al-dzeheb), a émis, sur divers points, une opinion différente de celle que je viens d'exposer. M. Quatremère, sur quelques-uns de ces points, s'est peut-être laissé entraîner par Renaudot et Deguignes. Voici comment il s'exprime dans le Journal asiatique de janvier 1839, p. 22 : « La connaissance que j'avais acquise des qualités et des défauts qui distinguent Massoudi m'a fait reconnaître pour une production de cet écrivain un ouvrage estimable ; je veux parler du livre intitulé Anciennes relations des Indes et de la Chine, traduites par l'abbé Renaudot. En lisant cet ouvrage, on est vivement frappé du désordre qui règne dans la narration, de la manière peu naturelle avec laquelle sont rapprochés des faits curieux, mais qui appartiennent à des régions fort éloignées les unes des autres, en sorte qu'il est fort difficile de voir, dans cet amalgame un peu informe, le récit d'un on de plusieurs voyageurs. On observe que les deux marchands dont les noms se trouvent indiqués en plusieurs endroits, ne sont nullement désignés comme les auteurs de la narration, mais seulement comme des hommes véridiques qui, ayant parcouru une grande étendue de pays, et observé avec soin les particularités propres à chaque contrée, formaient des témoins respectables, sur l'autorité desquels l'écrivain anonyme avait cru devoir appuyer une partie des détails consignés dans son ouvrage. Or, ce désordre dans la narration des faits est un caractère distinctif des productions littéraires de Massoudi. D'un autre côté, cet écrivain, lorsqu'il parle des Indes et de la Chine, invoque souvent le témoignage de ces mêmes marchands, prétendus auteurs de l'ouvrage traduit par l'abbé Renaudot. On peut donc supposer que les deux narrations des voyageurs arabes ne sont autre chose qu'un fragment d'un des ouvrages de Massoudi. Il est naturel de croire que le récit des prétendus voyageurs arabes formait une partie ou de la seconde édition du Moroudj, ou de l'Akhbar-al-zemal, ou de quelque autre ouvrage de Massoudi. »
[3] Yakout, écrivain arabe de la première moitié du xiiie siècle de notre ère, fait mention, dans son grand Dictionnaire géographique, d'un personnage appelé Misar-Abou-Dolaf, fils de Mohalhel, lequel, l'année 331 de l'hégire (942 de J. C.), accompagna, à leur retour dans leur pays, des députés de l'empereur de la Chine, qui s'étaient rendus à Boukhara auprès de l’émir samanide. Misar visita successivement la Tartarie, la Chine et l'Inde, et il rédigea une relation de son voyage, que Yakout a reproduite en grande partie dans son dictionnaire. Cazouyny a inséré quelques fragments de la même relation dans son ouvrage intitulé Atsar-al-bilad; mais, autant que je puis en juger par les fragments que je connais, le témoignage de Misar ne mérite pas beaucoup de confiance. Les fragments de la relation de Misar qui nous ont été conservés par Yakout et Cazouyny, viennent d'être publiés par M. Kurd de Schloezer, en arabe et en latin, sous le titre de Abu-Dolef Misaris ben Mahulhal, de itinere asiatico commentarium; Berlin, 1845, in-4°.
[4] L'auteur parle d'une coquille qui sert de trompette. Au lieu de schenek, il faut écrire sankha; c'est un mot sanscrit qui se dit d'une conque marine, et qui désigne un des attributs de Vichnou.