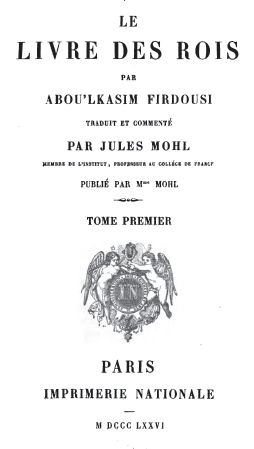
FERDOWSI/FIRDOUSI
LE LIVRE DES ROIS - Préface
TOME I (partie I)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
PAR
TRADUIT PAR JULES MOHL[1]
Un poème épique comme le Livre des rois, qui embrasse toute l’histoire d'un grand empire, depuis sa fondation jusqu'à sa destruction, a besoin d'être examiné sous beaucoup de rapports avant que sa véritable place, comme œuvre littéraire et comme source historique, puisse lui être assignée. Ne pouvant entreprendre de traiter dans une préface toutes les questions qui se rattachent à ce poème, je me contenterai de donner brièvement l'histoire des traditions épiques de la Perse, en me réservant d'examiner plus tard leur valeur historique ; mais, même en me restreignant à cette partie de mon sujet, je ne ferai que toucher à beaucoup de questions graves qui mériteraient une discussion plus étendue : car l'origine d'un poème épique est un des faits littéraires les plus curieux et en même temps les plus difficiles à étudier, par des raisons inhérentes à la nature même du sujet. Je parle ici de la véritable poésie épique, qui est toute historique et nationale, et représente l'histoire d'un peuple telle que ce peuple lui-même l'a faite dans la tradition orale. Toutes les nations ont eu de ces traditions, car aucune ne peut se former sans traverser des époques de dangers et d'actions héroïques, et sans produire des grands hommes qui frappent vivement son imagination. Le peuple en conserve le souvenir, les revêt instinctivement d'une forme poétique, et compose ainsi une histoire dans laquelle la vérité et la fable sont singulièrement entremêlées. Une ballade est pour lui, dans les temps de barbarie, ce qu’un document historique ou un bulletin est dans les temps civilisés. L'étude attentive que l’on a faite depuis quelque temps des poésies populaires a jeté une vive lumière sur la nature de ces traditions, sur les transformations qu'elles subissent dans leur transmission orale, et sur la véritable origine de la poésie épique. On les a trouvées dans les îles de la mer du Sud sous forme d'anecdotes, rimées, et servait à conserver le souvenir des événements et de leurs dates ; chez les Ecossais et les Grecs modernes, sous forme de balades historiques composées en commémoration d'actes de bravoure isolés ; chez les Circassiens, formant des biographies poétiques des hommes marquants, chantées à leurs funérailles, conservées dans leurs familles et dans leurs tribus, et composant dans leur ensemble toute l'histoire de la peuplade. Chez les Espagnols et chez les Serviens, ces chansons se rapprochent déjà tellement des poèmes épiques, qu'il ne leur fallait qu'un peu plus de liaison entre elles pour former des épopées. L'histoire de tous les peuples commence par là, car on conte et l’on chante avant d'écrire, et les premiers historiens n'ont pu fonder leurs récits que sur des matériaux pareils. On ne peut lire Hérodote sans être frappé du caractère épique de ceux de ses récits qui se rapportent aux premières époques de l’histoire ; mais l'historien ne se sert de ces traditions qu'à défaut de documents écrits, tandis que le poète épique trouve en elles les seules sources dont il puisse se servir. Il les réunit et en fait une œuvre d'art, tout en conservant le fond et, autant qu'il est possible, la forme de ses matériaux. S'il est animé d'un esprit vraiment national, son ouvrage devient bientôt populaire et se substitue, dans la bouche du peuple, aux chansons qui lui ont servi de base : les chanteurs publics adoptât la nouvelle rédaction, et les ballades originaires périssent. Cette destruction presque inévitable rend impossible, dans la plupart des cas, une comparaison directe des traditions et des poèmes épiques ; mais la facilité avec laquelle le nouveau poème détruit les anciens prouve elle-même qu'il les représente fidèlement.
Il est certainement arrivé bien souvent qu'un poète ait tenté de créer une épopée sans avoir une tradition nationale à lui donner pour base ; mais, dans ce cas, son poème a toujours été repoussé par le peuple. La beauté du langage et de la conception a pu donner à ces poèmes de la valeur aux yeux des lettrés et des écoles ; mais elle n'a pu suffire à les rendre populaires, et c'est la seule et véritable pierre de touche pour tout poème épique. S'il est adopté par le peuple et chanté sur la place publique, on peut être sûr qu'il repose sur des traditions réelles, et qu'il n'a fait que rendre, sous une forme plus parfaite, à la masse de la nation ce qu'il lui avait emprunté. Je ne puis donner un meilleur exemple de ce que j'entends par vraie et par fausse poésie épique, que les poèmes d'Homère et l'Enéide. Virgile a voulu suppléer, par son imagination, au défaut de traditions ; mais tout son art et toute la perfection de son style n'ont pu le rendre populaire ni faire de son livre une œuvre nationale.
On pourrait s’étonner que si peu de nations aient produit des poèmes épiques, puisque toutes en ont possédé les éléments ; mais, en y réfléchissant, on en voit facilement la raison. Pendant qu'une nation se trouve encore dans l'état de barbarie, les matériaux épiques abondent chez elle ; mais il est rare qu'il s'élève alors dans son sein un homme doué d'un sentiment de l'art assez profond pour pouvoir les réunir dans un ensemble poétique. Plus tard, quand il s'est déjà formé une littérature, mais avant qu'elle ait eu le temps de détruire la tradition orale, il peut se trouver un génie cultivé qui se prenne d'enthousiasme pour les chants populaires et en compose un poème national ; mais, à mesure que la littérature fait des progrès et qu'elle pénètre davantage dans le peuple, elle refoule et efface chez lui le sentiment épique ; le respect des écoles pour les formes savantes et artificielles fait tomber dans le mépris les formes rudes et naïves de la ballade historique ; les chanteurs sont remplacés par les livres : les chansons périssent, et la source de la poésie épique tarit. Si, plus tard encore, il arrive un temps comme le nôtre où les savants, fatigués des formes artificielles de la littérature, se retournent vers l'ancienne poésie populaire, celle-ci n'a plus assez de vie pour supporter une nouvelle rédaction ; et tout ce qui reste à faire, c'est de rassembler ce que le hasard a pu conserver.
Il n'y a pas lieu d'être surpris de trouver les Persans plus riches en traditions épiques que la plupart des peuples. La grandeur de leurs conquêtes, le sort varié de leur empire, la continuité de leurs guerres et la magnificence des monuments élevés par leurs anciens rois, devaient laisser des traces nombreuses dans le souvenir d'un peuple dont l’imagination a toujours été avide de merveilleux. Moïse de Khorène, auteur arménien du ve siècle, cite quelques-unes de ces traditions ; et, quoique le profond mépris avec lequel il traite ces fables de fables, comme il les appelle, l’empêche de s'en occuper avec détail, le peu qu'il dit sur Zohak et sur Rustem prouve néanmoins que ces traditions avaient déjà pris de son temps la forme qu'elles ont conservée depuis.
Le premier essai pour réunir ces traditions paraît avoir été fait dans le siècle suivant, par ordre de Nouschirvan, qui fit recueillir dans toutes les provinces de son empire les récits populaires concernant les anciens rois, et en fit déposer la collection dans sa bibliothèque. Ce travail fut repris sous le dernier roi de la dynastie des Sassanides, Iezdedjird, qui chargea le Dihkan Danischwer, un des hommes de la cour de Madaïn les plus distingués par la naissance et le savoir, de mettre en ordre les matériaux recueillis par Nouschirwan, et de remplir, avec l'assistance de plusieurs Mobeds, les lacunes qu'ils offraient. Voici comment Firdousi rend compte de ce travail :
C'est ainsi que les Dihkans devenaient les représentants de la tradition orale, et c’est dans ce sens, et uniquement dans ce sens, qu'on les trouve cites comme historiens. Nous verrons plus tard que Mahmoud le Ghaznévide fit venir à sa cour quelques descendants d'anciennes maisons persanes qui s'étaient occupés de rassembler tous les souvenirs de leurs familles : c'étaient de véritables Dihkans dans la seconde signification du mot.
Firdousi fait un usage fréquent du mot Dihkan dans ce sens, par exemple au commencement de l’épisode de Sohrab : Je conte une histoire tirée d'un ancien récit que je tiens de la bouche d'un Dihkan.
Il serait facile de citer un grand nombre de passages semblables ; mais je me contenterai d'un seul qui prouve que ce mot était déjà usité dans cette acception avant Firdousi. Tabari ayant énuméré les sources écrites de l'histoire de Kaïoumors, en vient à la tradition orale et dit : Nous ferons mention des récits des Dihkans, qui sont unanimes sur les traditions, que nous rapporterons ; et la solution (de la question chronologique sur Kaïoumors) que nous donnerons est tirée des paroles des Dihkans, etc.
Danischwer était probablement un Dihkan dans les deux sens du mot, un grand seigneur qui recueillait les souvenirs historiques de son pays. Son ouvrage, écrit en pehlewi contenait l'histoire de Perse depuis Kaïoumors jusqu'à Khorsou Parwiz, et portait le titre de Khodaï-nameh ou Livre des rois[2] ; et tous les ouvrages auxquels il a servi de base portent des titres dont la signification est la même, comme l’Histoire des rois, d'Ibn-al-Mokaffa, l’Ancien livre des rois d'Ali le poète, le Livre des rois d'Abou-Mansour, et le Livre des rois de Firdousi lui-même.
A prendre à la lettre l'expression de ce dernier, on devrait croire qu'il avait existé une grande collection de traditions autre que celle de Nouschirvan, et que le travail dont Danischwer était chargé ne consistait qu'à en recueillir les fragments dispersés. Cette supposition augmenterait certainement la valeur de la compilation du Dihkan, mais elle est peu probable ; car, si cette collection eût existé, Nouschirvan et Iezdedjird n'aurait pas eu besoin de faire venir des hommes de toutes les parties de l’empire pour réciter les traditions qu'ils connaissaient : il aurait suffi de se procurer ce livre, et le procédé employé sous les deux rois prouve bien évidemment qu'il s'agissait de réunir des traditions orales et vivantes. Il se pourrait bien qu'on eût déjà songé à conserver par écrit quelques-unes de ces traditions et que les livres qui les contenaient eussent été à cette occasion apportés à la cour, mais on ne saurait croire que ces livres formassent déjà un grand ensemble. On peut remarquer, au reste, que, dans presque tous les pays, ceux qui les premiers réunissent en un corps d'ouvrage les traditions orales, tâchent de donner à leurs récits un peu plus d'autorité en les faisant remonter à des œuvres imaginaires.
La conquête de la Perse par les Arabes survint presque immédiatement, et la collection de Danischwer fut trouvée par les vainqueurs parmi les trésors de Iezdedjird, et envoyée par Saad Wekas au khalife Omar. qui voulut en prendre connaissance, et se fît traduire quelques parties de l'histoire des Pischdadiens. Il en fut satisfait et ordonna que l'on en fît une traduction complète en arabe ; mais lorsqu'on en vint aux passages relatifs au culte du feu et à l'histoire de Zal et du Simurgh, le khalife déclara que c’était un mélange de bon et de mauvais qu'il ne pouvait approuver. Le livre fut, en conséquence, rejeté dans la masse du butin qui devait être distribué à l’armée arabe. On ajoute qu'il fut emporté en Abyssinie par un officier auquel il était échu en partage, traduit, dans ce pays, par ordre du roi, et, à la fin, transporté dans l’Inde, d'où Iacoub Leïs le tira dans le iiie siècle de l’hégire pour le faire traduire en persan ; mais cette anecdote n’est qu’une fable calquée maladroitement sur l'histoire du livre de Calila et Dimna que Nouschirvan s'était procuré dans l'Inde. Le fait est que l'ouvrage de Danischwer dut rester en Perse, car nous le retrouvons dans la première moitié du IIe siècle, entre les mains d'Abdallah Ibn-al-Mokaffa. Abdallah avait été Guèbre ; son véritable nom était Rouzbeh fils de Dadouïeh ; il avait abjuré sa religion entre les mains d'Isa, gouverneur de l’Irak, dont il était le secrétaire ; mais son orthodoxie musulmane resta toujours suspecte, ce qui ne peut étonner, car il paraît avoir passé sa vie à traduire en arabe un grand nombre d'ouvrages pehlewis, parmi lesquels se trouvait le Khodaï-nameh de Danischwer Dihkan. Cette traduction portait le titre d'Histoire des rois ; elle est malheureusement perdue. D'autres Guèbres composèrent des ouvrages sur les anciennes traditions de leur pays, comme Mohammed fils de Djehm le Barmékide, Bahram fils de Merdanschah, Mobed de la ville de Schapour, Bahram fils de Mihran d’Ispahan et autres ; et le poète Ali fils de Mohammed fils d'Ahmed de Balkh tira de ces matériaux son Ancien livre des Rois. Les chroniqueurs arabes se servirent de ces livres pour leurs études chronologiques et pour en faire des extraits assez maigres ; mais la population arabe et celle qui s'était assimilée aux Arabes ne pouvaient pas prendre beaucoup d'intérêt à ces traditions qui ne leur rappelaient rien, et qu'elles devaient regarder plutôt avec aversion comme des futilités frappées de la malédiction du prophète. Car c'est à l'occasion de Naser Ibn-al-Hareth, qui avait apporté de Perse l'histoire de Rustem et d'Isfendiar, et la faisait réciter par des chanteuses, dans les assemblées des Koreïschites, que Mohammed prononça le verset suivant :
Il y a des hommes qui achètent des contes frivoles, pour détourner par là les hommes de la voie de Dieu, d'une manière insensée, et pour la livrer à la risée ; mais leur punition les couvrira de honte.
Mais il en fût autrement dans les provinces orientales du khalifat, où des circonstances qui avaient agi depuis la conquête de la Perse, d’abord sourdement et ensuite avec une force irrésistible, produisirent, dès le IIIe siècle de l’hégire, un état des esprits qui devait rendre tout leur intérêt aux anciennes traditions persanes. Je suis obligé de remonter un peu plus haut pour expliquer la réaction dont je veux parler.
Le succès de la conquête arabe avait été très grand et très rapide. Peu d’années avaient suffi pour détruire l'empire persan, l’ancienne religion avait été abolie, la plus grande partie de la population s'était convertie à l’islamisme, la littérature persane avait disparu presque entièrement et avait fait place à la littérature arabe, et le khalifat paraissait assis d'une manière inébranlable sur son double trône, spirituel et temporel. Mais il s’en fallait bien que l'influence arabe, quelque grande qu'elle fut, reposât sur une base également solide dans toutes les provinces ci-devant persanes, ce qui tenait à l’état artificiel où les Arabes avaient trouvé la Perse au moment de la conquête. Le pehlewi était alors la langue officielle de tout l'empire persan : c'était un dialecte né, en Mésopotamie, du mélange des races et des langues sémitique et persane, une langue de frontières, comme son nom l'indique. Il était devenu langue officielle parce que les événements politiques avaient fixé, depuis des siècles, le siège de l'empire dans les provinces dont il était la langue usuelle. Dans les provinces orientales, au contraire, on parlait des dialectes purement persans, et le pehlewi n'y était que la langue officielle et savante, usitée dans les actes publics, sur les monnaies, dans les inscriptions, les livres et le culte, quoiqu'il paraisse que le clergé zoroastrien ait dû se servir en partie des dialectes provinciaux, car il nous reste des livres religieux écrits en persan oriental.
Après la conquête les Arabes s'établissent naturellement, en plus grand nombre que partout ailleurs, dans les provinces de la Perse les plus voisines de l’Arabie, précisément dans celles on l'on parlait pehlewi. Ils y placèrent le centre de leur empire, fondèrent Bagdad, Koufab, Mossoul et d'autres grandes villes toutes arabes, laissèrent périr les anciennes capitales des provinces, et agirent sur la population par tous les moyens que donnent le nombre, le pouvoir politique, le fanatisme religieux, l’influence d'une nouvelle littérature et le changement des lois et des institutions. Ils réussirent si complètement à s'assimiler cette population, qu'ils parvinrent à lui faire adopter peu à peu leur langue et à la substituer au pehlewi dans toute l'étendue des provinces occidentales, à l'exception de quelques districts montagneux. Dès ce moment la conquête arabe n'eut plus rien à craindre dans la Perse occidentale.
Les circonstances étaient bien différentes dans les provinces orientales. L'arabe, il est vrai, se substitua facilement au pehlewi et devint, à sa place, la langue de l'administration, de la littérature et de la religion ; et à la couche artificielle de pehlewi, si je puis parler ainsi, succéda une couche d'arabe aussi étendue, mais presque aussi superficielle. Les Arabes étaient en trop petit nombre dans la Perse proprement dite pour pouvoir apporter un changement radical dans la langue : on écrivait en arabe, mais le persan restait la langue parlée ; et dès lors la conquête n'était pas définitive. Car avec les langues se conservent les souvenirs qui donnent un esprit national aux peuples.
Aussitôt que le khalifat, qui s'était étendu avec une rapidité beaucoup trop grande relativement à sa base réelle, commença à montrer des signes de faiblesse, il se manifesta une réaction persane, d'abord sourde, et bientôt ouverte. La plus grande partie des anciennes familles persanes avaient conservé leurs propriétés foncières, et avec elles leur influence héréditaire, qui ne pouvait que gagner au relâchement de l'autorité centrale. Les gouverneurs des provinces orientales commencèrent à devenir plus indépendants de Bagdad ; on parlait persan à leurs cours, et ce que la domination du pehlewi n'avait pas fait, la domination d'une langue tout à fait étrangère comme l'arabe le fût : elle provoqua la création d'une littérature persane. Toutes les cours se remplirent de poètes persans, et les princes encouragèrent de tout leur pouvoir ce mouvement littéraire, soit qu'ils fussent eux-mêmes entraînés par un instinct aveugle vers cette manifestation de l'esprit national, soit que la protection qu'ils lui accordèrent fût le résultat d'un calcul politique. Ce qui pourrait faire admettre cette dernière supposition, c'est que ces princes étaient les premiers à rechercher les traditions nationales, dont la popularité devait leur être d'un si grand secours contre la suprématie politique des khalifes, et que cette politique fut suivie, avec une ténacité remarquable, par toutes les dynasties qui se succédèrent
Iacoub fils de Leïs, le fondateur de la famille des Soffarides, fut le premier prince de racé persane qui se détacha entièrement du khalifat. C'était un homme de basse extraction, fils d'un chaudronnier, d'abord chaudronnier lui-même, puis voleur, puis soldat au service du gouverneur du Séistan, puis enfin maître souverain de toute la Perse proprement dite, Iakoub fils de Leïs, quoique entièrement étranger aux lettres, paraît avoir senti l'avantage qu'il pouvait tirer des traditions nationales ; il se procura le recueil de Danischwer Dihkan, et ordonna à son vizir Abou-Mansour Abdourrezzak fils d'Abdoullah Farroukh, qui portait le titre de Moatemed-al-Moulk, de traduire en persan ce que Danischwer avait écrit en pehlewi, et d'y ajouter ce qui s'était conservé sur les temps écoules entre Khosrou Parwiz et Iezdedjird. Abou-Mansour chargea le wakil de son père, Saoud Ibn-Mansour-al-Moamri, de ce travail, en loi adjoignant quatre personnes : Tadj fils de Khorasani, de Herat ; Iezdandad fils de Schapour, du Séistan ; Mahoui fils de Khourschid, de Nischapour ; et Schadan fils de Berzin, de Thous. On ne sait rien sur aucun de ces personnages ; mais leurs noms ont de l'intérêt, parce qu’ils montrent que l'on choisit, pour remplir les vues de Iacoub, des hommes de pure race persane. Abdourrezzak et Saoud eux-mêmes étaient de la famille de Keschwad, une des plus considérables de l’ancien empire persan. L'ouvrage fut achevé l’an 260 de l’hégire, et se répandit dans le Khorasan et dans l’Irak. Les auteurs lui donnèrent le titre de Livre des rois, parce qu'il enseignait le gouvernement et le sort des empires, etc. ; il contenait aussi des histoires qui pouvaient paraître étranges au premier abord, mais qui plaisaient quand on en avait reconnu le sens, comme l'histoire de la pierre que Feridoun repoussa avec le pied, celle des serpents qui croissaient sur les épaules de Zohak, etc.
La famille de Iakoub fils de Leïs ne garda pas longtemps le pouvoir : vers la fin du IIIe siècle de l’hégire (an 297) ses possessions tombèrent entre les mains des Samanides princes descendant de la famille des Sasanides. Cette nouvelle dynastie s'occupa avec ardeur des traditions persanes. Belami, vizir d'Abou-Salih Mansour le Samanide (350-365 de l’hégire), chargea Dakiki de mettre en vers la traduction de l’ouvrage de Danischwer faite par ordre d'Abdourrezzak. Le choix du poète, dans un temps où les poètes abondaient, est assez significatif ; car Dakiki était Guèbre, comme on le voit par un de ses tétrastiques conserve par Djami : Dakiki a choisi quatre choses entre tout ce que le monde contient de bon et de mauvais : les lèvres couleur de rubis, le son de la harpe, le vin couleur de sang et la religion de Zerdouscht. Il prit pour début de son ouvrage le règne de Guschtasp et l'apparition de Zoroastre ; mais lorsqu'il eut composé de mille à deux mille vers, un esclave qu'il venait d'acheter lui en fonça, pendant une scène de débauche, un couteau dans le ventre, et le tua. Firdousi a conservé le fragment du poème de Dakiki, quoiqu'il en parle fort mal sous le rapport poétique ; mais il nous importe peu que les vers en soient plus ou moins doux et les images plus ou moins bien choisies, le grand point pour les lecteurs européens est de savoir si la tradition que Dakiki connaissait était identique avec celle que suivit Firdousi, et il ne peut guère y avoir de doute là-dessus, car Firdousi ne lui reproche rien à ce sujet, maigre l'amertume avec laquelle il critique en lui l’homme et le poète.
Les Samanides n'eurent pas le temps de faire recommencer l’entreprise car leur empire tomba quelques années plus tard, et passa aux mains des Ghaznévides. Le second roi de cette dynastie, Mahmoud fils de Sebekthin (387-421 de l'hégire, 997-1030 de J. C.), se sépara encore plus du khalifat que n’avaient fait ses prédécesseurs et, quoique musulman fanatique, il ne négligea rien de ce qui pouvait fortifier son indépendance politique. La langue persane fut cultivée à sa cour avec une ardeur jusque-là inouïe, et elle pénétra même dans l'administration où le vizir Aboul-Akbas Ben-Fadhl abolit l'usage de l'arabe. La cour du prince le plus puissant et le plus guerrier de son temps, était une véritable académie, et, tous les soirs, il se tenait ; au palais, une assemblée littéraire où les beaux esprits récitaient leurs vers et en discutaient le mérite en présence du roi, qui y prenait un vif plaisir. Mahmoud, comme les princes qui l'avaient précédé, s'intéressait avant tout aux poésies nationales et historiques, et ne se lassait pas de se faire raconter les traditions concernant les rois et les héros de la Perse ancienne. Son grand désir était d'en former une collection plus complète que celle des Sassanides et des Samanides, et de la faire mettre en vers. Il en recherchait partout les matériaux, également avide de livres et de traditions orales, de sorte que l’on ne pouvait mieux lui faire sa cour qu'en lui procurant les uns ou les autres.
C'est ainsi qu'il reçut du Séistan un volume contenant une partie du Seïr-al-Molouk (d'Ibn-al-Mokaffa), et qu'il s'empressa d'ouvrir une espèce de concours pour le faire mettre en vers. Khour-Firouz, un des descendants de Nouschirvan, qui se trouvait alors à Ghaznin et recherchait l'appui de Mahmoud, témoin de l'intérêt que ce sujet excitait, offrit au sultan l'ouvrage entier, ce qui fut pour lui le moyen d'obtenir tout ce qu'il était venu solliciter à la cour. Le prince de Kirman entendit parler d'un de ses sujets, nommé Ader Berzin, descendant du roi sassanide Schapour Dsoul-Aktaf, qui s'était occupé toute sa vie à recueillir les traditions des anciens rois. Il s'empressa de l'envoyer à la cour de Mahmoud, qui lui fit en retour des présents magnifiques. Il se trouva aussi à Merv un homme appelé Serv Azad, qui prétendait descendre de Neriman, et qui communiqua au roi les souvenirs conservés dans sa famille sur Sam, Zal et Rustem. C'est ainsi que Mahmoud réunit peu à peu ce qui existait de traditions relatives aux anciens rois de Perse. Mais ces traditions, il s'agissait de trouver un homme capable de les rédiger, assez lettré pour le goût raffiné d'un temps où la littérature était une mode et un art, et assez imbu de respect pour les traditions pour leur conserver leur caractère. Mahmoud chercha vainement cet homme pendant quelque temps. Il ouvrit des concours pour rédiger des épisodes qu'il désignait. Une fois il donna à chacun de ses poètes favoris : Ansari, Farroukhi, Zeïni, Asdjedi, Mandjeng Djeng-Zen, Kharremi et Termedi, une histoire à mettre en vers, en déclarant qu'il chargerait le vainqueur de la composition du grand poème qu'il avait en vue D'autres fois il pressait Ansari de l'entreprendre. Ce poète avait été d'abord attaché à l'émir Naser, frère favori du roi, ensuite au roi lui-même, qui avait pour lui la plus vive amitié, et aimait surtout à l'avoir auprès de son lit après qu'il s'était couché, pour l'entendre conter Ansari s'excusa sur le manque de temps, mais il proposa au roi un de ses amis qui avait toutes les qualités nécessaires, étant versé dans la tradition orale : cet homme était Abou'lkasim Firdousi, natif de Thous.
Je viens d'exposer le peu de données que nous avons sur l'histoire des traditions persanes depuis les Sassanides jusqu'au temps de Firdousi, pour montrer que la conquête ne les avait pas fait oublier et n'avait point diminué l'intérêt que la nation y attachait, et pour faire voir sous l'influence de quelles idées Firdousi conçut et exécuta le plan de réunir dans une épopée immense toutes les traditions épiques de la Perse, depuis la plus haute antiquité jusqu'au temps de la destruction de l'empire par les musulmans. Je passe maintenant à sa vie, sur laquelle on ne possède que peu de données authentiques. Les historiens de l’époque ne parlent presque pas du poète, et ce qui auprès de la postérité a fait la gloire du règne de Mahmoud a passé inaperçu devant des hommes accoutumés à ne remarquer que les faits matériels les plus apparents. On en est donc réduit sur ce point à ce que Firdousi dit de lui-même dans le cours de son ouvrage, aux deux préfaces dont j'ai parlé plus haut, et aux renseignements fort maigres que donnent Djami, Dauletschah et d'autres historiens de la poésie persane.[3]
Abou'lkasim Mansour, appelé Firdousi, naquit à Schadab, bourg des environs de Thous. Aucun auteur ne mentionne l’année de sa naissance ; mais les passages du Livre des rois où le poète parle de son âge donnent le moyen de la fixer avec une assez grande exactitude. Voici comment il s'exprime à la fin de son ouvrage : Lorsque j'eus atteint soixante et onze ans, le ciel s’humilia devant mon poème. J'avais donné à mon travail trente-cinq ans de ce séjour passager dans l'espoir d'acquérir un trésor ; mais puisqu'on a jeté au vent ma peine, mes trente cinq ans n'ont rien produit. Mon âge approche maintenant de quatre-vingts ans, et mon espoir a été tout à coup livré au vent. J'ai achevé l'histoire de Iezdejird le jour d'Ard du mois de Sefendarmedh ; lorsqu'il s'était écoulé cinq fois quatre-vingts ans depuis l'hégire, j'ai terminé ce livre digne des rois.
On ne peut pas douter, en lisant cette phrase, que l'âge réel du poète dans ce moment ne fût de soixante et onze ans, et que l'expression de près de quatre-vingts ans ne soit amenée seulement pour correspondre avec les cinq fois quatre-vingts ans de l'hégire.
Ce n'est pas la seule fois que Firdousi parle ainsi, dans un même passage, de son âge en nombre rond et en nombre exact. D'ailleurs le chiffre quatre-vingts est inadmissible, et voici pourquoi : si Firdousi avait eu quatre-vingts ans dans l'année 400 de l'hégire, il serait né en 390 ; mais il dit, dans l'introduction à l'histoire de Iezdejird Ier, qu'il a soixante-trois ans. Il aurait donc écrit ce passage l'an 383. Mais comme dans les vers suivants il parle du roi des rois, à qui il souhaite une domination sans fin, et que Mahmoud n'est monté sur le trône que l'an 387, on est oblige de placer l’année de la naissance du poète plus tard que 320. Tout porte donc à croire que le chiffre soixante et onze marque l'âge véritable du poète, qui en conséquence était né en 329. Cette date correspond d'ailleurs exactement avec d'autres indications qui se trouvent dans son poème. Il dit, par exemple, dans l'histoire des guerres de Keï-Khosrou contre Afrasiab : Lorsque j'avais cinquante-huit ans, j'étais encore jeune, mais ma jeunesse passait. J'entendis alors un bruit dans l'univers, qui me fit espérer que les soucis avaient vieilli, et que j'étais délivré de tout malheur ; voici ce bruit : hommes illustres et pleins de fierté ! il a paru une image de Feridoun le glorieux ; Feridoun au cœur vigilant est revenu à la vie, et le monde et l’époque se sont soumis à lui ; il a assujetti la terre par la justice et la générosité, et sa tête s'est élevée au-dessus de celle de tous les rois des rois, etc. Firdousi parle ici de l'avènement de Mahmoud, à qui toute cette tirade est adressée ; or cet avènement est de l'année 387, et Firdousi doit être né en 329, puisqu'il avait cinquante-huit ans à l'époque dont il est question.
Le père de Firdousi s'appelait Maulana Ahmed fils de Maulana Fakhr-eddin al-Firdousi ; il était d'une famille de Dihkans, et propriétaire d'une terre située sur le bord d'un canal dérivé de la rivière de Thous. Il donna à son fils une éducation savante ; car nous verrons plus tard que Firdousi était non seulement assez versé dans la langue arabe pour que ses poésies arabes excitassent l’admiration des beaux esprits de la cour de Bagdad, mais encore qu’il savait le pehlewi langue dont la connaissance, dans les provinces orientales de la Perse, était dès lors fort rare et probablement cultivée par les seuls Mobeds des Guèbres et par quelques Dihkans qui devaient en avoir besoin pour l’intelligence des traditions historiques dont ils s'occupaient. On sait peu de chose sur l’enfance du poète, si ce n'est qu'il avait des habitudes studieuses et retirées ; son plus grand plaisir était de s'asseoir sur le bord du canal d'irrigation qui passait devant la maison de son père. Or il arrivait souvent que la digue qui était établie dans la rivière de Thous pour faire affluer l'eau dans le canal, et qui n'était bâtie qu'en fascines et en terre, était emportée par les grandes eaux, de sorte que le canal demeurait à sec. L'enfant se désolait de ces accidents et ne cessait de souhaiter que la digue fut construite en pierre et en mortier : il se doutait peu alors que ce souhait influerait puissamment sur sa destinée, et serait accompli, mais seulement après sa mort.
A partir de là, on ne sait rien de la vie de Firdousi jusqu'à son âge mûr, si ce n'est qu'il doit s'être marié ayant l'âge de vingt-huit ans, car il perdit son fils unique âgé de trente-sept ans, lorsqu'il était lui-même dans sa soixante-cinquième année. Il s'était occupé de bonne heure à mettre en vers les traditions épiques. et lorsqu'il apprit la mort de Dakiki, qui dut avoir lieu à peu près l'an 360 de l'hégire, il fut saisi d'un vif désir d'entreprendre lui-même le grand ouvrage que Dakiki avait à peine emmenée. Je dirais, dit-il, d'obtenir ce livre pour le traduire dans ma langue ; je le demandais à un grand nombre d'hommes, craignant que si ma vie n'était pas longue, je ne fusse obligé de le laisser à un autre… Ainsi se passa quelque temps pendant lequel je ne fis part à personne de mon plan ; car je ne vis personne qui fut digne de me servir de confident dans cette entreprise. Mais, à la fin, il eut le bonheur d'obtenir le recueil pehlewi de Danischwer Dihkan, qu'il avait tant désiré posséder. Un de ses amis, Mohammed Leschkeri, lui rendit ce grand service et l'encouragea dans sa détermination. J'avais, continue-t-il, dans ma ville un ami qui m'était dévoué : tu aurais dit qu’il était dans la même peau que moi. Il me dit : C'est un beau plan, et ton pied te conduira au bonheur ; je t'apporterai ce livre pehlewi ; ne t'endors pas. Tu as de la jeunesse et le don de la parole, tu sais faire un récit héroïque : raconte donc de nouveau ce livre des rois, et cherche par lui de la gloire auprès des grands. Puis il apporta devant moi ce livre, et la tristesse de mon âme se convertit en joie. Après avoir consulté encore le scheik Mohammed Maschouk de Thous. il commença son grand travail à l'âge de trente six ans. Le premier épisode qu'il mit en vers fut l'histoire de Zohak et de Feridoun. Il travaillait, au commencement, en secret, parce qu'il cherchait un patron à qui il pût dédier son ouvrage et qui fût en état de le récompenser. Mais lorsqu'on sut, dans la ville de Thous, de quoi il s'occupait, tout le monde voulut entendre les parties du poème qui étaient déjà composées. Abou-Mansour, le gouverneur de la province, lui demanda de les réciter en sa présence, les admira, et pourvut dès ce moment à tous les besoins du poète ; ce qui paraît indiquer que son patrimoine était ou épuisé ou insuffisant. Firdousi se montra reconnaissant des bienfaits qu'il avait reçus d'Abou-Mansour ; il les a rappelés dans sa préface, écrite après la mort de son protecteur. On ne sait pas exactement quelles sont les parties du livre qu'il a mises en vers pendant cette époque de sa vie, car il ne paraît pas avoir suivi l’ordre chronologique dans son travail ; mais un des derniers épisodes qu'il doit avoir composés à Thons est sans doute l'histoire de Siawesch, qu'il termina dans la cinquante-huitième année de sa vie. C'est l'année même où Mahmoud succéda à son père (387 de l'hégire) ; mais le poète ne le connaissait pas encore, car il ne prononce pas le nom de Mahmoud à cette occasion.
On assigne au voyage de Firdousi à la cour de Ghaznin différentes raisons : selon les uns, le roi l'y invitait ; selon d'autres, Arslan Khan, successeur d'Abou-Mansour dans le gouvernement de Thous, l'y détermina avec beaucoup de peine et à l'aide du scheik Maschouk ; selon d'autres encore, les avanies que lui faisait subir le receveur des finances de Thous le forcèrent de porter en personne ses plaintes à Ghaznin. Cette dernière version est très peu probable, car Firdousi ne fait nulle part allusion à cette prétendue persécution, et il ne donne comme raison de son séjour à la cour que l'espoir d'être récompensé par le roi. Il était en effet bien naturel que Mahmoud, qui avait besoin de quelqu'un qui pût accomplir son dessein favori de procurer à la Perse un grand poème national, et le poète, depuis longues années occupé d'un travail si conforme à ce dessein, et qui pouvait espérer de trouver à la cour des matériaux plus amples et des récompenses plus dignes de son travail, se recherchassent mutuellement. On raconte que Firdousi, dès le début de son voyage, et à son arrivée à Herat, fut arrêté par des lettres de Ghaznin, qui étaient le résultat d'une combinaison de courtisans et de poètes également désireux d'éloigner le nouveau compétiteur à la faveur du roi. Il s’arrêta à Herat, chez Aboubekr Warrak, jusqu'à ce qu'il eût reçu de meilleures nouvelles. Cette anecdote renferme des détails douteux, mais les biographies de Firdousi en contiennent plusieurs du même genre ; et quand même elles ne seraient pas toutes véritables, on ne peut pas douter que le tableau de la cour de Mahmoud qu'elles nous présentent dans leur ensemble ne soit exact. Il était impossible que, dans une cour remplie de gens de lettres courtisans, avides et envieux, un nouveau venu, dont la réputation antérieure les effrayait et dont les talents leur faisaient ombrage, ne fût pas l'objet de haines et d'intrigues de toute espèce.
Firdousi eut beaucoup de peine à se faire remarquer du sultan, et les séances à la cour ou furent lues des parties du Seïr-al-Molouk, mises en vers par les principaux poètes, continuèrent sans que Firdousi pût se faire entendre. A la fin, un de ses amis, nommé Mahek, se chargea de remettre à Mahmoud l'épisode de Rustem et d'Isfendiar. Le sultan le reçut alors, et, apprenant qu'il était né à Thous, se fit expliquer par lui l'origine de sa ville natale. Il fut frappé des connaissances sur l'ancienne histoire de la Perse que déploya Firdousi, le présenta aux sept poètes qui s'étaient essayés sur le Livre des rois, et le renvoya avec des présents. Un autre jour il fit improviser par Firdousi un tétrastique en l'honneur d'un de ses favoris, Ayaz, et fut si enchanté de la manière dont le poète s'en acquitta, qu'il lui donna le nom de Firdousi (le Paradisiaque), en disant que le poêle avait converti l'assemblée en un paradis.
Ce fut probablement dans une des premières assemblées[4] auxquelles Firdousi assistait, qu'eut lieu le défi célèbre que lui portèrent trois des principaux poètes de la cour, Ansari, Farroukhi et Asdjedi. Ils commencèrent un tétrastique rimant sur la syllabe schen, et employèrent, dans les trois premières lignes, les seuls mots de la langue persane qui se terminent par cette syllabe. La grande connaissance des traditions que possédait Firdousi le tira d'embarras, et fournit pour la dernière rime le nom propre de Peschen. C'était l'époque brillante de la vie de Firdousi : il avait conquis la faveur du prince le plus magnifique de son temps, tous les matériaux que Mahmoud avait réunis étaient à sa disposition, et les moyens de réaliser le rêve de toute sa vie, l'achèvement de sa grande entreprise, se trouvaient entre ses mains. On peut voir un reflet de son ivresse de bonheur dans l'éloge de Mahmoud, placé dans la préface du Livre des rois, et écrit dans un temps ou rien ne lui faisait encore prévoir les malheurs que sa nouvelle position allait lui attirer. Mahmoud lui remit le Seïr-al-Molouk, et lui fit préparer un appartement attenant au palais et qui avait une porte de communication avec le jardin privé du roi. Les murs de son appartement furent couverts de peintures représentant des armes de toute espèce, des chevaux, des éléphants, des dromadaires et des tigres, des portraits de rois et de héros de l'Iran et du Touran. Mahmoud pourvut à ce que personne ne pût l'interrompre dans son travail, en défendant la porte à tout le monde, à l'exception de son ami Ayaz et d'un esclave chargé du service domestique. Le sultan professait pour lui une admiration passionnée et se complaisait à dire qu'il avait souvent entendu ces mêmes histoires, mais que la poésie de Firdousi les rendait comme neuves, et qu'elle inspirait aux auditeurs de l'éloquence, de la bravoure et de la pitié.
Il paraît que les épisodes du livre furent lus au roi à mesure que Firdousi les acheva, et que la récitation fut accompagnée de musique et de danse. On trouve dans un des plus anciens manuscrits du Livre des rois un dessin intéressant qui représente Firdousi récitant une partie de son poème devant le sultan. Le poète est assis sur un coussin, et devant lui est placé son livre sur une espèce de pupitre. En face de lui se tiennent des musiciens qui l'accompagnent, et des danseuses qui suivent les sons de la musique en s'inclinant à droite et à gauche. Cette représentation demi-théâtrale de la poésie épique n'était pas une innovation, car nous savons que Naser Ibn-al-Hareth amena de la cour de Nouschirvan des chanteuses qui récitaient les exploits de Rustem. Aujourd'hui encore le schaïr qui récite, au Caire et en Arabie, le poème épique d'Abou Saïd s'accompagne du monocorde appelé rebab.
Mahmoud ordonna à Khodjah Hasan Meïmendi de payer au poète mille pièces d'or pour chaque millier de distiques ; mais Firdousi demanda à ne recevoir qu'à la fin du poème la somme totale qui lui serait due, dans l'intention d'accumuler un capital suffisant pour pouvoir bâtir la digue dont il avait tant désiré la construction dans son enfance. Il était alors dans la première vogue de la faveur ; il ne pensait pas qu'elle pût changer et ne soupçonnait pas qu'il allait être l'objet de haines de toute espèce. Il avait été fort bien reçu par les personnes les plus considérables de la cour, et se répandait en éloges sur elles ; ce qui excita la jalousie de Hasan Meïmendi, qui bientôt commença à lui refuser tout ce qu’il demandait, de sorte que le poète était réduit à se plaindre que le pain lui manquait, tandis qu’il donnait son temps au travail ordonne par le sultan. Il paraît avoir eu à lutter presque continuellement avec le besoin, et ses plaintes sur la vie qu’il menait à la cour sont des plus amères. Arrive à la moitié de son travail, il dit : j’ai passé ainsi soixante-cinq ans dans la pauvreté, dans le besoin et la fatigue ; et, ayant terminé entièrement son poème, il se plaint, dans l'épilogue, que les grands et les nobles copiaient ses vers sans lui donner autre chose que leurs bénédictions, et qu'Ali le Dilémite, et Houseïn fils de Katib, étaient les seuls qui l'eussent soutenu, surtout le dernier. C'est lui qui m'a donné de la nourriture, des vêtements, de l'argent et de l'or ; c'est lui qui m'a donné les moyens de mouvoir pied et aile.
Cependant sa gloire s'étendait rapidement ; à peine un épisode de son poème était-il achevé que des copies s'en répandaient dans toute la Perse, et les plus généreux parmi les princes qui les recevaient, envoyaient, en retour, des présents à l'auteur. Mais ces ressources accidentelles ne l'enrichissaient pas, car il comptait sur la promesse de Mahmoud et n'amassait point de fortune. Quelques-unes de ces démonstrations de sympathie servirent même à fournir un nouvel aliment aux haines auxquelles il était exposé à la cour. C'est ainsi qu'une copie de l'épisode de Rustem et d'Isfendiar ayant été apportée à Rustem fils de Fakhr-al-daulet le Daïlémite, celui-ci donna au porteur cinq cents pièces d’or, envoya le double de cette somme au poète, et l’invita chez lui en lui promettant la réception la plus gracieuse. Hasan Meïmendi[5] ne manqua pas de faire à Firdousi un crime d'avoir accepté cette faveur d'un prince dont Mahmoud était l'ennemi politique et religieux ; car le Daïlémite et Firdousi étaient Chiites, pendant que Mahmoud et Meïmendi étaient Sunnites. Firdousi répond, dans l'Introduction au Livre des rois, à cette accusation d'hérésie avec autant de modération que de fermeté : Je suis, dit-il, l'esclave de la famille du prophète ; je révère la poussière des pieds d'Ali, je ne m'adresse pas à d'autres ; telle est ma manière de parler. — Si tu mets ton espérance dans un autre monde, prends ta place auprès du prophète et auprès d'Ali ; si mal t'en arrive, que ce soit ma faute, etc. Mais en même temps il est loin de se livrer aux récriminations si communes entre des sectes rivales ; il parle d'Aboubekr, d'Omar et d'Othman avec respect, et dit même : Le prophète est le soleil, ses compagnons sont la lune, et la véritable voie est celle qui les comprend tous. Cette tolérance ne désarma point les ennemis du poète, et sa préface même, qui est écrite dans un esprit de piété remarquable, devint le prétexte de nouvelles attaques ; on y trouva la preuve que l'auteur était non seulement Chiite, mais matérialiste et athée.
Ses ennemis littéraires lui faisaient d'autres reproches, dont le sujet est bien plus intéressant pour nous. Les gens de lettres, qui étaient jaloux de lui, discutaient, dans les assemblées du sultan, le mérite de son œuvre, et prétendaient qu'il était entièrement du à l'intérêt des sources, et nullement au talent poétique de l'auteur. Ses amis le défendaient, et, après une de ces discussions, le sultan et sa cour convinrent de donner à Firdousi un épisode qu'il mettrait en vers le jour même, de sorte qu'on pût voir, par la comparaison de sa composition avec l'original, ce qui appartenait au mérite de l'exécution. On choisit l'histoire du combat de Rustem avec Aschkebous Keschani. Firdousi rédigea, le jour même, sa version poétique telle qu'on la trouve dans le Livre des rois, la lut devant le sultan, et excita l'étonnement et l'admiration de toute la cour.
Ce serait une chose infiniment curieuse que l'original de cet épisode ; mais la rédaction que nous en a conservée une des préfaces persanes est évidemment postérieure à Firdousi, car elle contient un vers de Firdousi même. Je vais pourtant rapporter au bas de la page la traduction de cette anecdote, telle que nous la possédons, pour que le lecteur puisse la comparer avec le récit poétique qu’il trouvera dans le second volume.[6]
Entouré de toutes ces difficultés, Firdousi eut encore le malheur de perdre son fils, âgé de trente-sept ans. Il a consacré à cet événement quelques belles strophes, qu'on peut voir dans sa vie de Khosrou Parwitz : Tu m'as retendu dans le malheur une main secourable : pourquoi as-tu cherché une autre route que celle de ton vieux compagnon ? As-tu donc rencontré de jeunes amis pour me devancer si rapidement ? Ce jeune homme, lorsqu'il eut trente-sept ans, ne trouva pas le monde à son goût et partit ; il partit, et ne me laissa que peines et douleurs. Il a noyé dans le sang mon cœur et mes yeux ; il est allé dans le monde de la lumière et va y choisir une place pour son père. Des années nombreuses ont passé sur moi, de sorte qu'il ne me reste plus aucun de mes compagnons. Mon fils tient les yeux ouverts sur moi et s'impatiente de ce que je tarde à le rejoindre. J’ai soixante-cinq ans ; il en avait trente-sept, et il est parti sans demander congé au vieillard, etc.
Il paraît que ce malheur ne désarma pas les ennemis du poète, car nous le trouvons, l’année suivante, se plaignant de nouveau de leurs attaques. Mon livre, dit-il, aura soixante mille vers (et renfermera) des paroles dignes de louanges et propres à chasser les soucis, pendant que personne ne peut trouver un (autre) poème persan qui contienne trois mille vers. Quelque peine qu'ils se donnent pour y chercher de mauvais vers, ils en trouveront à peine cinq cents. Et pourtant un roi (comme Mahmoud) plein de générosité et brillant dans le monde entre tous les rois n'a pas jeté les yeux sur ces histoires, a cause des propos d'un calomniateur et de ma mauvaise fortune. Le calomniateur a été jaloux de mon œuvre et a déprécié ma marchandise aux yeux du roi. Mais quand le chef des armées du roi lira ces paroles pleines de douceur et qu'il y réfléchira dans la pureté de son âme, alors j'aurai à me réjouir des trésors que je recevrai de lui. Puissent ses ennemis ne jamais rapprocher ! Il parlera de moi au roi, et peut-être que mes peines, semblables à des semences, porteront leur fruit.
C’est au milieu de ces afflictions et de ces embarras de toute espèce que Firdousi passa à peu près douze ans à la cour[7] et qu’il acheva son ouvrage. Il le fit présenter à Mahmoud par Ayaz, et le roi ordonna à Hasan Meïmendi d'envoyer au poète autant d'or qu'un éléphant en pouvait porter ; mais Hasan persuada au roi que c'était trop de générosité, et qu'une charge d'argent suffisait. Il fit mettre 60.000 dirhems d'argent dans des sacs, et les fit porter à Firdouzi par Ayaz. Le poète était, dans ce moment, au bain ; et lorsqu'il en sortit, Ayaz le salua et lui fit apporter les sacs. Firdousi, ne doutant pas que ce ne fut de l'or reçut le présent avec grande joie ; mais lorsqu'il s'aperçut de son erreur, il entra en colère et dit à Ayaz que ce n'était pas là ce que le roi avait ordonné de faire ; Ayaz lui conta tout ce qui s'était passé entre Mahmoud et Hasan, et Firdousi lui donna alors vingt mille pièces, et autant au baigneur ; puis il prit chez un marchand de fouka, qui se tenait à la porte du bain, un verre de fouka, le but et le paya avec les vingt mille pièces qui lui restaient, en disant à Ayaz de retourner chez le sultan et de lui dire que ce n'était pas pour gagner de l'argent et de l'or qu'il s'était donné tant de peine. Ayaz rapporta les paroles du poète à Mahmoud, qui reprocha à Hasan de lui avoir fait commettre une injustice qui l’exposerait à être blâmé par tout le monde. Hasan répondit que tout présent du roi, que ce fût une pièce d’argent ou cent mille, devait être également bien reçu ; et que s'il donnait une poignée de poussière, on devrait la placer sur ses yeux comme du collyre. Il réussit à détourner sur Firdousi la colère du sultan et à faire revivre les anciens griefs de ce dernier contre le poète ; de sorte que Mahmoud déclara que le lendemain matin il ferait jeter ce Karmathe[8] sous les pieds des éléphants. Firdousi apprit ce qui s'était passé par un des grands de la cour qui avait été présent à cette scène, et il passa la nuit dans une grande anxiété. Le lendemain matin il se rendit, par la porte de communication entre son appartement et le palais du sultan , dans le jardin particulier que Mahmoud devait traverser pour aller à un pavillon où il avait l’habitude de faire ses ablutions ; là il se jeta aux pieds de Mahmoud, déclarant que ses ennemis l’avaient calomnié en disant qu'il était Karmathe et qu'il avait manqué de respect au sultan en refusant son présent ; que d'ailleurs les États du sultan contenaient des personnes de toutes les religions, des Ouvres, des juifs et des chrétiens, et qu'il n'avait qu'à regarder son esclave comme un de ceux-ci. Il parvint à apaiser Mahmoud ; mais il ne lui pardonna pas la manière dont il avait été traité, et se détermina sur-le-champ à quitter Ghaznin. Il rentra chez lui, prit les brouillons de quelques milliers de vers qu'il avait composés, mais qui n'étaient pas encore copiés, les déchira et les jeta au feu. Il se rendit ensuite à la grande mosquée de Ghaznin, et écrivit sur le mur, à l’endroit où le sultan avait l’habitude de se placer, les deux distiques suivants :
La cour fortunée de Mahmoud, roi du Zaboulistan, est comme une mer. Quelle mer ! on n'en voit pas le rivage. Quand j’y plongeais sans y trouver de perles, c'était la faute de mon étoile et non pas celle de la mer.
Ensuite il donna à Ayaz un papier scellé, le pria de le mettre au sultan après un délai de vingt jours et dans un moment de loisir, l’embrassa et partit un bâton à la main et couvert d'un manteau de derviche ; car il n’avait pas les moyens de faire de meilleurs préparatifs de voyage. Un grand nombre des gens de la cour auraient voulu l’accompagner, mais ils eurent peur du sultan et de Hasan, et il n'y eut qu’Ayaz qui ne démentit pas son amitié pour le poète, et qui envoya après lui une monture et des effets de voyage. Vingt jours après, Ayaz remit le papier de Firdousi au sultan, qui l'ouvrit pensant que c'était un placet, et y trouva la célèbre satire. Je la donne en entier, non seulement parce qu'elle contient beaucoup de traits qui se rapportent à la vie de Firdousi, mais parce qu'elle peint le caractère du poète mieux que ce que je pourrais dire.
« O roi Mahmoud, conquérant des zones de la terre, si tu ne me crains pas, crains Dieu. Comme la royauté est à toi dans ce monde, tu demanderas pourquoi ces clameurs. Ne connais-tu donc pas l’ardeur de mon âme ? N’as-tu donc pas pensé à mon épée qui verse le sang, toi qui m’appelles mécréant et impie ? Je suis un lion courageux, et tu m’appelles mouton ! On m'a calomnié en disant que l’amour de cet homme aux mauvaises paroles pour le Prophète et pour Ali est usé.[10] Je serai l’esclave de tous les deux jusqu'au jour de la résurrection, quand même le roi ferait déchirer mon corps. Je ne renoncerai pas à l’amour de ces deux maîtres, quand même l’épée du roi percerait ma tête. Je suis l’esclave de la famille du Prophète, je chante la louange de la poussière des pieds d'Ali ; et si quelqu'un a dans son cœur de la haine contre Ali, y a-t-il dans le mondé quelque chose de plus méprisable que lui ? Tu m'as menacé de me faire fouler aux pieds des éléphants jusqu'à ce que mon corps devint comme les flots bleus de la mer. Je ne crains rien, car, dans la sérénité de mon âme, j'ai le cœur rempli d'amour envers le Prophète et envers Ali. Que dit celui qui a proclamé la révélation, le maître des commandements et le maître des prohibitions ? je suis la ville de la connaissance de Dieu, et Ali est ma porte. C'est là la parole véritable du Prophète, et j’atteste qu’elle renferme le secret de sa pensée ; tu dirais que mon oreille entend sa voix. Si tu as du sens, de la prudence et de l’intelligence, prends ta place auprès du Prophète et d'Ali. S’il t'en arrive malheur, que la faute en retombe sur moi. Il en est ainsi, et c'est là la voie et la conviction dans lesquelles je suis né et dans lesquelles je mourrai. Sache que je suis la poussière des pieds d'Ali. Je ne m'adresse point à d'autres que lui et n'ai point d'autre manière de parler. Si le roi Mahmoud s'écarte de cette voie, son intelligence ne vaut pas un grain d'orge ; et puisque Dieu doit placer dans l'autre monde le Prophète et Ali sur le trône de la royauté, je pourrai y protéger cent hommes comme Mahmoud, si mes paroles, dans cette vie, prouvent l'amour que j'ai pour le Prophète et pour Ali. Il y aura des rois aussi longtemps que durera ce monde, et ceux qui porteront des couronnes entendront la déclaration que je fais, que Firdousi de Thous, qui a recherché la compagnie des hommes purs, n'a pas composé ce livre en l'honneur de Mahmoud. C'est au nom du Prophète et d'Ali que j'ai parlé, que j'ai enfilé les perles de l'intelligence. Lorsqu'il n'y avait pas de Firdousi dans le monde, c'était parce que la fortune du monde était impuissante à le produire. Tu n'as pas fait attention à mon livre, tu t'es laissé détourner par les paroles d'un calomniateur : mais quiconque a dit du mal de mon poème n'a pas de secours à attendre du ciel qui tourne sur nos têtes. J'ai composé en belles paroles ce chant des anciens rois ; et lorsque mon âge a approché de quatre-vingts ans, mon espérance a été anéantie tout à coup. J'ai, sur cette terre de passage, travaillé de longues années, dans l'espoir d'acquérir un trésor ; j'ai composé deux fois trente mille beaux vers[11] tous destinés à décrire les batailles, les épées, les flèches, les arcs et les lacets, les massues, les glaives puissants, les armures des chevaux, les cottes de mailles et les casques, les déserts, les mers, la terre et les flots, les loups et les lions, les éléphants et les tigres, les Afrilcs, les dragons et les crocodiles, les arts magiques des Ghouls, les enchantements des Divs, dont les cris s’élèvent jusqu'au ciel ; les guerriers renommés au jour de la bataille ; les hommes de guerre accoutumes aux combats et aux cris de la mêlée ; les rois illustres assis sur le trône el entourés de splendeur, comme Tour, Selm et Afrasiab ; comme le roi Feridoun et Keïkobad ; comme Zohak le mécréant, sans foi et sans justice ; comme Guerschasp et Sam fils de Neriman, qui étaient les Pehlewans du monde, accoutumés à vaincre ; les rois comme Houscheng et Thamouras le vainqueur des Divs ; comme Minoutchehr et Djemschid le puissant maitre ; comme Kaous et Keïkhosrou le couronné ; comme Rustem et le glorieux héros au corps d'airain.[12] Gouderz et ses quatre-vingts fils renommés, parfaits cavaliers dans le champ des tournois et lions dans le combat ; comme le glorieux roi Lohrasp, le Sipehdar Zerir et Guschtap ; comme Djamasp, qui brillait parmi les étoiles d'un éclat plus grand que le soleil ; comme Dara fils de Darab, Bahman et Iskender, qui fut le maitre des rois des rois ; comme le roi Ardeschir et son fils Schapour ; comme Bahram el le bon Nouschirvan. Tels sont les héros, portant haut la tête, que j'ai peints l’un après l’autre. Tous sont morts depuis longtemps ; mais ma parole a rendu la vie à leurs noms.
O Roi ! je t'ai adressé un hommage qui sera le souvenir que tu laisseras dans le monde. Les édifices que l’on bâtit tombent en ruine par l'effet de la pluie et de l’ardeur du soleil ; mais j'ai élevé dans mon poème un édifice immense auquel la pluie et le vent ne peuvent nuire. Des siècles passeront sur ce livre, et quiconque aura de l'intelligence le lira. J'ai vécu trente cinq années dans la pauvreté, dans la misère et les fatigues, et pourtant tu m'avais fait espérer une autre récompense, et je m'attendais à autre chose du maitre du monde. Mais un ennemi[13] (puisse le jour du bonheur ne jamais luire sur lui !) a dit du mal de mes bonnes paroles ; il m'a calomnié devant le roi ; il a fait un charbon noir d'un charbon ardent. Si tu avais été un juge équitable, tu aurais réfléchi, lorsqu'on te pariait ainsi, que j'ai payé, selon mon talent, par mes paroles, la dette que je devais au monde. J'ai rendu par mes vers le monde beau comme un paradis[14] et personne avant moi n'a su semer la semence de la parole. Il y a eu des hommes sans nombre qui ont répandu des paroles et composé des vers sans fin ; mais, si nombreux qu'ils aient été, personne n'en parle plus. Pendant trente ans je me suis donné une peine extrême ; j'ai fait revivre la Perse par cette œuvre persane ; et si le roi n'était un avare, j'aurais une place sur le trône. Mais comme il n’était pas né pour porter le diadème, [15] il ne pouvait pas se rappeler les manières de ceux qui sont faits pour le porter. S'il avait eu un roi pour père, il aurait mis sur ma tête une couronne d'or ; s'il avait eu une princesse pour mère, j'aurais eu de l'or et de l'argent jusqu'au genou. Mais comme il n'y a pas eu de grandeur dans sa famille, il ne peut entendre prononcer les noms des grands. La générosité du roi Mahmoud, de si illustre origine, n'est rien, et moins que rien.[16] Lorsque j'eus passé trente ans à travailler au Livre des rois pour que le roi me donnât en retour des richesses, pour qu'il me mit à l'abri du besoin dans ce monde, pour qu'il me fît porter haut la tête parmi les grands, il ouvrit son trésor pour me payer le mien, et me donna la valeur d'un verre de fouka. Pour un roi qui possède tant de trésors, je ne vaux donc qu'un verre de fouka ; je l'ai acheté chemin faisant ; et, de fait, ii vaut mieux qu'un pareil roi, qui n'a ni foi, ni loi, ni manières royales. Mais le fils d’un esclave ne peut valoir grand-chose, quand même son père serait devenu roi. Rehausser la tête de ceux qui ne le méritent pas et en espérer du bien, c’est perdre le bout de son fil, c’est nourrir dans son sein un serpent. Quand tu planterais dans le jardin du paradis un arbre dont l’espèce est amère, quand tu en arroserais les racines, au temps où elles ont besoin d’eau, avec du miel pur puisé dans le ruisseau du paradis, à la fin il montrera sa nature et portera un fruit amer. Si tu passes à côté d’un morceau d’ambre brillant, ton vêtement en sera tout parfumé ; mais si tu t’approches d'un charbonnier, il ne fera que te noircir. Il ne faut pas s'étonner du mal que fait ce qui est de race mauvaise ; il ne faut pas essayer de dépouiller la nuit de son obscurité. Ne mettez point votre espoir en des hommes de naissance impure ; car un noir, pour être lavé, ne devient pas blanc. Espérer du bien d'une source mauvaise, c'est placer sur son œil de la poussière au lieu de collyre.[17]
Si le roi avait été un homme digne de renom, il aurait honoré le savoir ; et, ayant entendu mes discours de toute espèce sur les manières des rois et sur les usages des anciens, il aurait accueilli autrement mes désirs, il n'aurait pas rendu vain le travail de toute ma vie. Voici pourquoi j'écris ces vers puissants : c'est pour que le roi y prenne un conseil, qu'il connaisse dorénavant la puissance de la parole, qu'il réfléchisse sur l'avis que lui donne un vieillard, qu'il n'afflige plus d'autres poètes, et qu'il ait soin de son honneur ; car un poète blessé compose une satire, et elle reste jusqu'au jour de la résurrection. Je me plaindrai devant le trône de Dieu le très pur, en répandant de la poussière sur ma tête et disant : O Seigneur ! brûle son âme dans le feu, et entoure de lumière l’âme de ton serviteur qui en est digne. »
Le sultan entra en fureur à cette lecture, et envoya sur-le-champ des hommes à pied et à cheval à la poursuite de Firdousi, en promettant 50.000 dinars à celui qui le ramènerait ; mais le fugitif avait une trop grande avance, et l’on ne réussit pas à l'atteindre. Au reste, la lutte entre le poète et le roi ne faisait que de commencer, car Mahmoud était le prince musulman le plus puissant de son temps, et Firdousi ne pouvait guère espérer de trouver un lien de repos dans toute l'étendue du khalifat ; néanmoins il n'avait pas trop présumé de la justice de sa cause et du pouvoir de son génie ; car s'il ne trouva pas partout de la protection, du moins ne rencontra-t-il personne qui eût voulu le livrer à son ennemi : la voix publique était pour lui, et il ne tarda pas à en éprouver les effets.
Les récits que nous possédons sur les aventures de Firdousi pendant sa fuite diffèrent considérablement entre eux, et il est très difficile de les concilier ou de décider, à chaque différence, quelle est la meilleure version. Le récit de la grande préface est entremêlé de vers qui, au premier abord, pourraient paraître l'œuvre de fauteur même de la préface, lequel les aurait ajoutés, selon le goût du temps, à la narration en prose ; mais, en y regardant de plus près, on reconnaît que ce sont des citations tirées d'une biographie en vers plus ancienne ; car non seulement ces fragments sont d'un style plus simple et meilleur que celui de la préface, écrite dans le goût qui régnait à la cour des Timourides, mais encore ils ne s'accordent pas toujours avec le récit en prose. Dans ce cas, je donne la préférence aux fragments en vers, car l'auteur de la préface paraît avoir changé quelquefois sans raison la suite des événements.
Firdousi se dirigea d'abord vers le Mazenderan[18] province qui était alors sous l’autorité de Kabous, prince du Djordjan, [19] et il s'y occupa à corriger le Livre des rois. Kabous, à qui Firdousi fit demander la permission de lui présenter son ouvrage, et qui était lui-même un homme de lettres distingué, promit de pourvoir à tous ses besoins, et Firdousi composa une pièce de vers en son honneur. Mais Kabous apprit bientôt les circonstances de la fuite de Ghaznin, et fut fort embarrassé de son nouvel hôte. Il avait à ménager Mahmoud, qui convoitait la possession du Mazenderan, et qui parvint, en effet, quelques années plus tard, à se faire reconnaître comme suzerain par Minoutchehr fils de Kabous. Les considérations politiques remportèrent dans son esprit ; il fit au poète un présent magnifique et le pria de choisir un autre séjour.
Firdousi reprit son bâton de voyage, et se rendit à Bagdad. Il n’y connaissait personne et resta quelques jours dans la solitude, jusqu'à ce qu'un marchand lui offrit sa maison. Le marchand ayant appris l’histoire du poète, tâcha de le consoler et de lui faire espérer du repos, puisqu'il était arrivé à l'ombre du maître des croyants. Il connaissait le vizir du khalife et espérait l'intéresser en faveur de son nouvel ami. Firdousi composa, en l'honneur du vizir, un poème en arabe, et le remit au marchand, qui se rendit à l'assemblée du vizir, où le poème fut lu en présence des beaux esprits de la cour, et reçu avec la plus grande approbation. Le vizir donna à Firdousi un appartement chez lui, et conta au khalife Kader-billah toute l’histoire du travail de Firdousi et la manière dont il avait été persécuté par Hasan et récompensé par Mahmoud. Kader-billah voulut le voir, et Firdousi lui remit, dans l'audience à laquelle il fut admis, un poème en mille distiques en son honneur. Le khalife le traita avec beaucoup de bonté, quoiqu'il trouvât mal, lui et sa cour, que Firdousi eût composé un ouvrage en l'honneur des anciens rois de Perse et des adorateurs du feu. Le poète, pour rentrer en grâce, fut obligé d'écrire un nouveau poème sur un thème emprunté au Coran. Il choisit Yousouf et Zouleïkha, et acheva ce nouvel ouvrage en neuf mille distiques, écrits en persan et dans le même mètre que le Livre des rois.[20]
Mais pendant ce temps Mahmoud avait reçu la nouvelle de l’accueil qui avait été fait au poète à la cour de Bagdad, et il adressa au khalife une lettre menaçante pour demander que le fugitif lui fût livré. Ce fut probablement alors que Firdousi partit pour Ahwaz, capitale de la province d'Irak-Adjemi, au gouverneur de laquelle il dédia son poème de Yousouf et Zouleïkha.[21] De là il se rendit dans le Kouhistan, dont le gouverneur, Nasir Lek, lui était très dévoué. Aussitôt qu'il eut touché la frontière de la province, Nasir Lek envoya au-devant de lui quelques-uns de ses familiers, qui l'amenèrent en cérémonie à la capitale. Nasir Lek lui-même alla solennellement à sa rencontre et le reçut très gracieusement. Firdousi lui confia qu'il allait écrire un livre pour éterniser le souvenir de son sort et de l'injustice du sultan ; mais Nasir, qui était ami de Mahmoud, lui représenta qu'il fallait s'abstenir de dire du mal d'autrui, surtout des rois ; et il lui donna cent mille pièces d'argent en le conjurant de ne plus écrire ni parler ou faire parler contre le sultan. Firdousi finit par lui livrer ee qu'il avait déjà rédigé, en lui permettant de le détruire, et composa une pièce de vers dans laquelle il déclara que son intention avait été de flétrir le nom de ses ennemis, mais qu'il y renonçait sur la demande de son protecteur, et qu'il remettait son sort entre les mains de Dieu. Nasir Lek adressa alors une lettre au sultan dans laquelle il lui reprocha ses torts envers Firdousi, et justifia la satire de ce dernier par les indignités qui ! avait souffertes. Le messager qui portait cette lettre à Ghaznin y arriva, à ce que l’on raconte, [22] le jour même où le sultan avait lu les deux distiques que Firdousi, avant son départ, avait écrits sur le mur de la mosquée ; et Mahmoud, déjà ébranlé par ces vers, le fut encore davantage par le message de Nasir Lek. Les amis de Firdousi saisirent cette occasion pour représenter au sultan tout le tort qu'il se faisait par cette persécution, dont ses ennemis se serviraient pour flétrir sa mémoire, et parvinrent à le mettre tellement en colère contre Hasan Meïmendi, qu'il le condamna à mort.[23]
Firdousi, sur ces entrefaites, soit qu'il eût appris le changement des sentiments du roi à son égard, soit qu'il eût voulu revoir, à tout risque, sa ville natale, s'en était retourné à Thous. et y avait repris ses anciennes habitudes. Mais un jour, en passant par le bazar, il rencontra un enfant qui chantait le vers suivant de la satire :
Si le père du roi avait été un roi, son fils aurait mis sur ma tête une couronne d’or.
Le vieillard en fut saisi, poussa un cri et s’évanouit ; on le rapporta dans sa maison, où il mourut l’an 411 de hégire, âgé de quatre-vingt-trois ans, et onze ans après l'achèvement de son ouvrage.
On l’enterra dans un jardin ; mais Abou’lkasim Gourgani, principal scheik de Thous, refusa de lire les prières sur sa tombe, en allant que Firdousi, quoique homme savant et pieux, avait abandonne la bonne voie et consacre son temps à parler des mécréants et des adorateurs du feu. Mais la nuit suivante il eut un rêve dans lequel il vit Firdousi au paradis, vêtu d'une robe verte et portant sur la tête une couronne d'émeraudes. Il en demanda la raison à l’ange Rithwan, et l’ange lui récita un tétrastique du Livre des rois qui avait fait admettre le poète. Après son réveil, le scheik se rendit à la tombe de Firdousi, y prononça les prières ordinaires et raconta son rêve aux assistants.
Pendant ce temps Mahmoud avait envoyé les cent mille pièces d'or qu'il devait au poète, avec une robe d'honneur et des excuses sur ce qui s'était passé ; mais au moment où les chameaux chargés d'or arrivaient à l'une des portes de Thous, le convoi funèbre de Firdousi sortait par une autre. On porta les présents du sultan chez la fille de Firdousi, qui les refusa, en disant : j'ai ce qui suffît à mes besoins et ne désire point ces richesses. Mais le poète avait une sœur qui se rappela le désir que celui-ci avait manifesté de bâtir en pierre la digue de la rivière de Thous pour laisser un souvenir de sa vie. La digue fut construite en conséquence, et quatre siècles après on en voyait encore les restes. Probablement cette construction n’épuisa pas tous les fonds de cet héritage, car Hakim Nasir fils de Khosrou raconte, dans son livre de Voyages, qu'il vit à Thous, en 438 de l'hégire, un grand caravansérail nouvellement bâti. Il demanda qui l'avait fait construire, et il lui fut répondu que Mahmoud avait envoyé un présent à Firdousi ; mais que le poète étant mort et son héritière ayant refusé de l'accepta, on avait fait un rapport au sultan, qui avait ordonné d'employer la somme à cette construction.
Nous avons vu plus haut quelles étaient les sources principales que Firdousi avait à sa disposition ; il nous reste maintenant à considérer quel usage il en a fait. S'en est-il tenu exactement aux traditions telles qu'elles avaient été recueillies sous les Sassanides, ou qu'elles existaient encore de son temps chez les Dihkans ? ou s'en est-il servi seulement comme d'un cadre vague qu'il a rempli de contes inventés à plaisir ? La solution de ce problème offre de grandes difficultés, parce que les matériaux mis en œuvre par le poète ont disparu presque entièrement, de sorte qu'il ne nous reste aucun moyen de comparaison directe. Mais ce qui fait la difficulté de la question en fait aussi l’importance ; car plus il est certain que nous avons perdu les traditions originales, plus il importerait de savoir si la rédaction que le Livre des rois nous en offre en est l'expression fidèle.
Firdousi lui-même déclare, à plusieurs reprises et de la manière la plus formelle, qu'il ne fait que suivre la tradition : des traditions ont été racontées ; rien de ce qui est digne d'être transmis n'a été oublié. Je te raconterai de nouveau une partie de ce qui a déjà été dit. Tout ce que je dirai, tous tout déjà conté, tous ont déjà enlevé les fruits du jardin de la connaissance. Il donne des détails sur ses prédécesseurs ; il indique les sources d'où il a tiré des épisodes particuliers ; enfin il fait tout ce qu'il peut pour convaincre son lecteur qu'il n'est pas l'inventeur de ce qu'il raconte. On pourrait mettre en doute la sincérité de ses paroles et croire qu'il n'a fait en cela que se conformer au goût de son époque ; mais nous avons de lui un témoignage écrit dans un temps où les circonstances avaient bien changé, où il était manifestement de son intérêt de présenter toutes ces traditions comme inventées par lui-même, et où il persiste néanmoins dans sa première assertion. Au commencement de son poème de Yousouf et Zouleïkha, il parle de son Livre des rois assez légèrement. Il se trouvait alors, comme nous l'avons vu, à la cour du khalife, où on lui reprochait d'avoir abusé de son talent pour faire revivre la gloire des anciens rois de Perse ; et son but, dans la composition de ce nouveau poème, était de se ménager les bonnes grâces de la cour orthodoxe…. Il déclare : J’ai composé un poème qui contient des récits de toute espèce, mais j’y ai conté ce que j’avais lu.
Tout ce que nous savons sur la manière dont il a composé son livre prouve que cette assertion du poète est vraie, et qu’il n’a ni voulu ni même pu s’éloigner beaucoup de ses sources. Nous avons vu qu’il n’osait commencer son ouvrage avant d’obtenir la collection de Danischwer Dihkan : qu’il misait les épisodes à mesure qu’il les achevait, devant Mahmoud, qui s’était occupé de ces mêmes traditions et les aimait passionnément ; qu’il était entouré d’ennemis qui l’observaient, le mettaient à l’épreuve et ne trouvaient qu’une chose à lui reprocher, précisément son exactitude à se conformer a la tradition ; enfin qu’il avait auprès de lui des Dihkans qui avaient recueilli, de leur côté, les souvenirs de leur famille et qui n’aurait as souffert qu’il les falsifiât. Voici comment il parle de l’aide qu’ils lui offraient : Maintenant je vais conter le meurtre de Rustem selon un livre écrit d’après les paroles des siens, il y avait un vieillard nommé Amd Serv, qui demeurait à Merv, chez Ahmed fils de Sahl ; il possédait le Livre des rois, et avait le corps et les traits d'un Pehlewan le cœur plein de sagesse, la tête pleine de souvenirs, et la bouche remplie de vieilles traditions. Il tirait son origine de Sam fils de Neriman, et parlait souvent des combats de Rustem. Je vais conter ce que j'ai appris de lui, etc. (Cet Azad Serv est le même que Serv Azad, que Mahmoud avait fait venir à la cour, comme nous avons vu plus haut. Firdousi n’a retourné ici son nom que parce que le vers, l’exigeait, comme il a fait pour beaucoup d'autres noms.) Au milieu de cet entourage, le poète n'avait donc guère autre chose à sa disposition que le choix des relations, le rejet des traditions qu'il ne voulait pas employer, et le coloris du récit.
Il y a une autre raison, négative il est vrai, mais néanmoins plus forte à uni sens, pour croire que Firdousi n'a pas altéré les traditions ; s'il l'avait fait, il se serait trahi sur-le-champ, car la critique historique était de son temps chose presque inconnue, et en s'écartant des traditions des Persans, il n'aurait pu que s'égarer dans celles des musulmans. On trouve, des exemples de cette confusion dans les historiens arabes antérieurs à Firdousi, tels que Tabari, qui traitent de l'histoire ancienne ; on en rencontre aussi dans quelques-unes des autres poésies épiques, et les romans persans des siècles suivants en sont remplis. Firdousi lui-même n'y a pas entièrement échappé ; il parle une fois de Bagdad à l'époque du règne de Feridoun ; il prend, dans un autre passage, Alexandre le Grand pour un chrétien, et confond, dans un troisième, Zoroastre avec Abraham. Ces fautes sont si énormes quelles prouvent jusqu'à l’évidence que l’auteur était incapable de sortir du cercle des traditions persanes sans se perdre, et elles sont en même temps si peu nombreuses, que l’on ne peut qu'être convaincu qu'il lui est rarement arrivé de s'écarter de son véritable terrain ; encore ces fautes ne portent-elles que sur des épithètes, et n'influent-elles en rien sur le cours des événements.[24]
Les autres défauts du récit, la manière inégale dont des événements d'une importance égale sont traités, les transitions trop brusques d'un épisode à l'autre, les répétitions des mêmes aventures avec des changements insignifiants, et la prédilection avec laquelle tous les hauts faits d'une époque sont accumulés sur un héros favori, sont autant de marques que l'auteur a suivi la tradition populaire, qui est, toujours et partout, inépuisable sur quelques sujets, et insouciante sur d'autres bien plus importants.
Les lacunes que l'on trouve dans le récit ne sont pas moins significatives. Firdousi paraît n'avoir pas trouvé de matériaux persans pour le règne d'Alexandre le Grand ; ce qui se comprend aisément, car les peuples ne chantent pas leurs propres défaites. Mais, au lieu de se livrer à son imagination dans un sujet qui y prêtait beaucoup, il aime mieux emprunter les contes dont les soldats grecs, à leur retour en Grèce, avaient rempli l'Occident. Ces contes avaient été recueillis en plusieurs collections, dont quelques-unes existent encore en grec et en latin, et dont une avait été traduite du grec en arabe.[25] C'est à l’aide de cette dernière que Firdousi a rempli la lacune qu'il avait trouvée dans les traditions de son pays, en y adaptant le conte persan qui fait d'Alexandre un chef de race persane, fils de Darab, roi de Perse, et d'une fille de Philippe de Macédoine, de même que les rédactions alexandrines des fables grecques relatives à Alexandre lui donnaient pour père l'Égyptien Nectanebo. Une autre lacune, encore plus considérable, que trouva Firdousi dans les traditions et qui s'étend sur toute l'histoire de la dynastie des Parthes, n'a pas été remplie par lui. Je ne m'explique pas l'absence de toute tradition sur cette époque ; mais le silence de Firdousi prouve au moins que son habitude n'était pas de donner carrière à son imagination, là où les matériaux lui manquaient.
Les témoignages extérieurs confirment de leur côté cette supposition. Les caractères des personnages principaux de l'ancienne histoire de Perse se retrouvent dans le Livre des rois tels que les indiquent les parties des livres de Zoroastre que nous possédons encore. Kaïoumors, Thahmouras, Djemschid, Feridoun, Minoutchehr, Guschtasp, Isfendiar, etc. jouent dans le poème épique le même que dans les livres sacrés, à cela près que, dans ces derniers, ils nous apparaissent à travers une atmosphère mythologique qui grandit tous leurs traits ; mais cette différence est précisément celle qu'on devait s'attendre à trouver entre la tradition religieuse et la tradition épique.
Il s'est conservé quelques traditions des Perses qui forment de véritables commentaires sur certaines parties du Livre des rois. Nous avons vu plus haut que Moïse de Khorène connaissait, un siècle avant Nouschirvan, des traditions populaires persanes identiques avec celles que rapporte Firdousi ; et les historiens arabes qui ont précédé notre auteur s'accordent avec lui sur l’ancienne histoire de Perse partout où l'envie de faire cadrer les traditions des Persans avec celles des Juifs ne leur fait pas faire des changements systématiques dans leurs récits. Mais il existe encore un meilleur témoignage de la conformité des récits de Firdousi avec la tradition reçue universellement de son temps : c'est celui de l'auteur du Modjmel-al-Tewarikh, qui vivait un siècle après Firdousi, et qui a écrit son ouvrage l'an 520 de l'hégire. C'était un homme d'un savoir et d'un esprit critique peu communs dans sa nation. Je me propose de le faire connaître ailleurs plus en détail ; il me suffira de remarquer ici qu'il avait étudié toutes les sources de l'histoire de Perse qui existaient de son temps, et dont la plus grande partie a péri depuis. Je vais citer un passage de sa préface qui montre l'étendue des ressources littéraires qu'il avait à sa disposition et l'importance qu'il attribuait au Livre des rois.
A chaque époque, les sages et les savants ont recueilli ce qui concerne les révolutions du ciel, les merveilles du monde, les histoires des prophètes et des rois, et tout ce qui s'est passe en différents lieux, et Mohammed fils de Djerir, surnommé Tabari, a composé un livre de tous ces renseignements ; mais il n’a traité qu'imparfaitement des vies et de l'histoire des rois de Perse (qui occupaient le quatrième climat et étaient les rois les plus puissants du monde) et sa chronique ne contient qu'un abrégé de leurs règnes par ordre de succession. Quoique les histoires des rois et des Chosroès, des princes et des grands qui nous ont précédés soient connues indépendamment de la chronique de Tabari, et que chacun d'eux en particulier ait obtenu en son lieu un récit détaillé de sa vie ; quoique ceux qui anciennement ont recueilli les traditions aient fait des versions des livres des Perses, qu'ils n'en aient rien omis dans leurs ouvrages en vers et en prose, et que chacun d'eux ait orné de belles peintures et de vignettes agréables[26] ces mêmes ouvrages célèbres et vantés, j'ai néanmoins voulu réunir dans ce livre la chronologie des trois de Perse, leurs généalogies, leurs expéditions et leurs biographies, l'une après l'autre, en abrégeant ce que j'ai lu dans le livre de Firdousi, qui est comme la racine, et dans d'autres livres qui en sont comme les branches, et qui ont été mis en vers par d'autres auteurs, comme le Guerechasp-nameh, le Faramourz-nameh, l'histoire de Bahman, celle de Kousch Pildendan, les ouvrages en prose d’Aboulmoayyid, c’est-à-dire les histoires de Neriman, de Sam, de Keïkobad, d'Afrasiab, les événements de la vie de Lohrasp, d'Aghousch-Wehadan et de Keï-Keschen. (J'y ai joint en outre) ce que j'ai trouvé dans la chronique de Djerir et dans le Siyar-al-Molouk, ou l'Histoire des rois, composée d'après la tradition orale et traduite par Ibn-al-Mokaffa, et dans le sommaire de Hamza fils de Hasan d'Ispahan, qui a suivi les ouvrages de Mohammed fils de Djehm le Barmécide, de Radouïeh fils de Schahouïeh d'Ispahan, de Mohammed fils de Bahram fils de Dathian, de Heschem fils d'Alkasem, de Mousa fils d'Isa al-K… ; ensuite j'ai suivi la chronique des rois de Perse que Bahram fils de Merdanschah, Mobed de Schapour, a apportée du Farsistan, et j'ai vérifié ces récits autant qu'il a été possible.
Telle était l'opinion qu'avait de Firdousi le plus savant des historiens persans, qui a ajouté plus qu'aucun autre aux données que l'on trouve dans le Livre des rois, et qui avait pour contrôler cet ouvrage des matériaux dont une grande partie n'existe plus. Son témoignage me dispense de citer celui des historiens postérieurs, qui tous ont pris le poème de Firdousi pour base de leurs récits, et qui l'ont même suivi si servilement, qu'ils ont fait tomber dans l'oubli toutes les autres sources de l'ancienne histoire de leur pays. Qu'il me soit seulement permis de citer un fait qui prouve que les Perses mêmes ont pour Firdousi une vénération qu'ils ne lui auraient pas vouée s'ils n'avaient reconnu son ouvrage comme conforme à leurs traditions. Je dois à l'amitié de Sir Gr. Haughton le manuscrit d'une légende guèbre qui porte ce titre : Histoire du sultan Mahmoud de Ghaznin.[27] On y raconte que Mahmoud rassembla un grand nombre de poètes à sa cour, et que Firdousi y composa son Livre des rois. Les portes en forent chagrins, et, dans leur haine et leur jalousie, ils firent un pacte entre eux, et se lièrent par un serment qui devait être inviolable. Cela fait, ils se présentèrent devant Mahmoud et lui conseillèrent de forcer les Perses, sous peine de mort, d'embrasser l’islamisme. La suite du livre contient la lutte qui s’éleva, à cette occasion, entre le sultan et les Perses, qui finissent par avoir le dessus. Les Perses avaient donc tellement adopte Firdousi, qu'il passait, dans leurs légendes, pour un coreligionnaire, et qu'ils ne savaient pas imaginer une cause plus vraisemblable de la persécution qu'ils auraient eu à supporter de la part de Mahmoud que la jalousie des rivaux de Firdousi envers ce poète. La popularité de ce dernier n'a pas diminué depuis huit siècles ; les savants imitent le Livre des rois, la cour et le peuple s'en font réciter les épisodes, et tout ce qui parle persan, musulmans ou Perses, le regarde comme l'ouvrage national par excellence.
Les faits que je viens de citer ne préjugent rien sur la vérité historique du récit de Firdousi : c'est là une question toute différente de celle qui nous occupe ici, et bien plus épineuse ; j'en réserve l'examen pour plus tard. Tout ce que j'ai voulu prouver ici, c'est que Firdousi a reproduit exactement, et telles qu'elles existaient sous les Sassanides, une partie des traditions nationales des Persans. Je dis une partie parce qu'il s'en faut bien que le Livre des rois ait épuisé toute la masse de souvenirs qui s'étaient conservés jusque-là. Le succès immense qu'il eut devait naturellement donner une importance littéraire inaccoutumée à toutes les traditions, soit écrites, soit orales, que les générations successives s'étaient transmises, et Firdousi eut bientôt une foule d'imitateurs, comme tous les hommes qui touchent vivement et directement un sentiment national. Presque tous les héros dont parle Firdousi, et quelques autres dont il ne parle pas, détinrent les sujets de biographies épiques ; et la longueur excessive de quelques-uns de ces ouvrages prouve non seulement l’abondance des matériaux qui existaient encore, mais aussi l’intérêt que le peuple y mettait : car ces interminables aventures, racontées sans art et sans grâce, n’auraient trouvé ni lecteurs ni auditeurs, si l’intérêt du fond n’est pas fait supporter la médiocrité de la forme. La vanité littéraire ne semble pas avoir été le motif de ces compositions : il n’y en a qu'un petit nombre où l'auteur parle de lui-même et de son œuvre et où il manifeste l'espoir d'en tirer de la gloire ; toutes les autres sont écrites on ne sait par qui et l’on ne saurait quand, si des circonstances accidentelles ne nous permettaient de leur assigner une date approximative. Les auteurs eux-mêmes ne paraissent écrire que pour conter ce qui les intéresse et devait intéresser les autres ; ils ont l'air de se regarder comme uniquement chargés de remplir les lacunes qu'ils ont trouvées dans le Livre des rois et ils rattachent ordinairement leur récit à quelques vers de Firdousi sans autre introduction.
Ces poètes s'attachèrent avec une préférence presque exclusive à l'histoire de la famille de Rustem, qui avait le gouvernement héréditaire du Séistan ou Nimrouz[28] et qui remontait à Djemschid. C'était la famille héroïque par excellence, et Firdousi avait déjà consacre à quelques-uns de ses, membres une grande partie de son ouvrage, mais sans épuiser la tradition, qui s'était plu à leur attribuer presque tous les prodiges de bravoure qui faisaient la gloire guerrière de la Perse. Ses imitateurs s'emparèrent de cette tradition ; et bien que plusieurs de leurs ouvrages soient perdus, il en reste assez pour que ces biographies des princes du Séistan forment un cycle épique presque complet : ce sont le Guerqchasp-nameh, le Sam-nameh, le Faramourz-nameh, le Djihanguir-nameh, le Banou-Gouschasp-nameh, le Barzou-nameh et le Bahman-nameh.
Le Guerschasp-nameh est le seul des poèmes de ce cycle qui ait acquis une certaine renommée. L'auteur du Modjmel-al-Tewarikh s'en est servi ; Mirkhond le mentionne comme une des sources où avait puisé l’historien Hafiz Abrou ; on le trouve même cité dans des ouvrages très récents, tels que l'autobiographie d'Ali-Hazin. Le Guerschasp-nameh a été commencé l'an 456 de l'hégire et achevé en 458. L'auteur, dont le nom m'est inconnu, fournit quelques détails sur les motifs qui lui ont fait entreprendre son poème, motifs assez curieux pour que j’en donne un extrait. Il raconte qu'étant un jour à table avec deux personnages puissants, Mohammed fils d'Ismaël Hosni et son frère Ibrahim, ils lui représentèrent combien son compatriote[29] Firdousi avait acquis de gloire par son Livre des rois, et ils l’exhortèrent à faire comme lui et à mettre en vers une histoire tirée de quelques livres anciens ; il se mit en conséquence à l'œuvre, et voici ce qu'il se proposa : Il y a dans le monde un livre sur les hauts refaits de Guerschasp, un livre qui rappelle le souvenir des grands, qui est plein de savoir et de sages avis, de secrets du ciel et de grands événements, de bons conseils et de récits d'enchantements, d'actions justes et injustes, bonnes fret cruelles, de joies et de douleurs ; il raconte les chasses les victoires et les combats des héros, les amours du cœur et ses haines, les jeux et les festins, les malheurs fret les réussites, les conquêtes des trônes et les invasions ; si tu en lis un peu dans chaque chapitre, tu augmenteras beaucoup tes connaissances. Tu voudrais ouïr quelque chose de Rustem, croyant qu'il n'y a pas eu d'homme comme lui ; mais quand tu auras entendu les combats de Guerschasp, ceux de Rustem te paraîtront tous comme du vent. Rustem était un homme qu'un méchant Div a pu porter sur un nuage et jeter dans la mer, que Houman a pu effrayer avec sa lourde massue, que le gardien d'une forêt a pu battre dans le Mazenderan, que Sohrab a pu vaincre et que le brave Isfendiar a pu jeter par terre.[30] Mais le Sipehdar Guerschasp n'a été, de sa vie, abattu ni jeté à terre par personne. Il a fait, dans le pays de Roum, à la Chine et dans l'Inde, ce que Rustem n'a pas pu faire ; ni loup, ni tigre, ni lion, ni Div, ni dragon courageux n'ont pu lui résister. Lors même qu'il combattait à pied, ayant perdu son cheval, il dépeuplait le monde de braves. Il donnait à chaque héros des trésors, il abattait les éléphants avec sa masse d'armes. Lorsque Firdousi à la parole douce, dans son Livre des rois a conté les traditions de manière à enlever la palme à tous les poètes, il a conservé le souvenir de beaucoup de combats de héros ; mais il n'a pas parlé de ceux de Guerschasp, qui étaient pourtant des branches sorties du même arbre, mais flétries, desséchées, et ne portant point fruit. Maintenant je ramènerai pour elles le printemps par mon talent, et leur ferai porter du fruit Le roi qui cherche la sagesse m'a dit : Chante de nouveau ce livre en mon nom ; et puisque Firdousi n'a pas conté ces histoires, compose avec elles le pendant de son livre.
La grande ambition de l'auteur du Guerschasp-nameh est donc d'égaler ou de surpasser Firdousi.[31] C'est le seul auteur épique persan qui ait montré de la jalousie littéraire à l'égard de son grand prédécesseur, et qui ne se soit pas subordonné à lui, soit expressément, soit tacitement, par la manière de traiter son sujet. Il élève autel contre autel ; sa préface est une imitation ambitieuse de celle de Firdousi ; il la commence, comme celui-ci, par un hymne en l’honneur de Dieu, de la création, du Prophète, du soleil et des astres, et la termine de même par les louanges du roi à qui il dédie son ouvrage, et des amis qui l'ont encouragé.
L'auteur prend l'histoire de la famille des princes du Séistan à son origine ; il raconte la fuite de Djemschid, et son mariage avec la fille du roi de Kaboul, puis il retrace brièvement la vie des descendants de Djemschid, jusqu'à Guerschasp ; là il entre dans son sujet et raconte en détail les aventures de son héros, ses guerres contre Zohak, ses expéditions dans le Touran, en Afrique et dans l'Inde, ses entretiens avec les Brahmins, les merveilles qu'il a vues dans les îles de l'Océan, etc. Le caractère de l'ouvrage est entièrement épique, et les sources d'où il est tiré sont évidemment analogues à celles dont s'est servi Firdousi. Il y a seulement un mélange plus grand de contes merveilleux, qui se rapportent à ce que Guerschasp voit dans les pays étrangers et surtout dans les îles de la mer indienne, et qui paraissent venir des marins des côtes du golfe persique ; on croirait quelquefois lire Sindbad le Marin.[32]
Le Guerschasp-nameh est écrit dans le mètre que Firdousi avait adopte, et qui est reste, presque sans exception, le mètre de la poésie épique persane. L’auteur dit à la fin de son ouvrage qu’il contient quatorze mille distiques ; mais le manuscrit qu'Anquetil a rapporte de l’Inde n'en contient que neuf à dix mille, quoiqu'il n'offre pas de lacunes évidentes. Le Guerschasp-nameh est de tous les poèmes persans celui qui a servi le plus à l'interpolation du texte de Firdousi. Je possède un manuscrit du Livre des rois où trois mille distiques du Guerschasp-nameh se trouvent intercales dans un seul endroit ; un autre en contient une suite de douze cents, et un troisième une quantité très grande, mais éparse dans toute la première partie de l'ouvrage par tirades de dix à vingt vers. Macan a imprimé, dans l'appendice de son édition de Firdousi, un fragment considérable du Guerschasp-nameh extrait d'un manuscrit du Livre des rois que j'ai maintenant entre les mains. A l'exception des huit premières pages, ce fragment correspond exactement avec le manuscrit du Guerschasp-nameh[33] de la Bibliothèque royale, et contient l’histoire de la fuite de Djemschid et la vie de ses descendants, jusqu'à la naissance de Guerschasp. Je ne puis deviner pourquoi Macan suppose que ce fragment a été tiré d'un livre auquel il donne le titre de Gustasp-nameh et qu'il attribue à Asadi : tout ce qu'il dit à ce sujet est entièrement dénué de fondement ; mais je n'entrerai dans aucun détail pour le réfuter, parce qu'il ne peut y avoir nul doute que le fragment en question ne soit pris du Guerschasp-nameh, à l'exception des huit premières pages, qui paraissent empruntées à un autre poème qui nous est inconnu ; car il n'est pas douteux qu'il n'y ait eu d'autres traditions épiques sur Djemschid, et j'en possède une sur sa mort mise en vers par un Perse nommé Nouschirvan ; elle est intitulée : Histoire du roi Djemschid et des Divs.[34]
Les biographies épiques de Neriman et de Sam, fils et petit-fils de Guerschasp, avaient été écrites en prose par Abou'lmoayyid ; mais il ne nous en reste rien, et nous sommes réduits, sur les traditions concernant Neriman, à ce que le Guerschasp-nameh en rapporte dans sa dernière partie. Sam a trouvé un second biographe dans l’auteur du Sam-nameh, ouvrage en vers, compose de onze mille distiques. Je n’en ai connu pendant longtemps que des fragments conserves dans la Bibliothèque royale de Paris et dans celle de la Compagnie des Indes à Londres, mais j’ai eu à la fin le bonheur d'en acquérir un manuscrit complet. L'auteur n’indique nulle part ni son nom, ni le temps où il a vécu, ni les circonstances sous l’influence desquelles il a composé son ouvrage : tout ce que l'on sait de lui, c’est qu'il était musulman, comme le prouve le Bismillah qui se trouve à la télé de son livre. Il commence par un passage de Firdousi tiré du commencement du règne de Minoutchehr et contenant la description de la première cour tenue par ce roi. Sam y promet à Minoutchehr de faire le tour du monde et de combattre ses ennemis. Firdousi passe de là directement à la naissance de Zal fils de Sam sans s'occuper de cette expédition ; et l'auteur du Sam-nameh remplit cette lacune laissée dans le Livre des rois, en donnant l'histoire des guerres de Sam dans l'Occident, dans le pays des Slaves et à la Chine, la découverte qu'il fait des trésors de Djemschid, et ses amours avec Peridokht, qui devint plus tard la mère de Zal. Arrivé à la naissance de ce dernier, l'auteur rattache fort simplement la fin de son ouvrage à la suite du récit de Firdousi, en disant : Maintenant que j'ai achevé ce conte, écoute l'histoire de Zal-Zer.
Le Sam-nameh est écrit dans le mètre du Livre des rois ; le style en est simple, les contes de fées y abondent ; mais le fond est évidemment tiré de la tradition telle qu'elle était sous les Sassanides ; car non seulement on n'y trouve aucune trace d'idées musulmanes, mais on y voit, au contraire, Gabriel jouer un grand rôle, travesti en Div à l’âme noire. Quand on pense avec quel respect les musulmans traitent toujours cet archange, [35] on ne peut guère s'expliquer son étrange transformation en Div que par la fidélité de l’auteur musulman à suivre une tradition qui doit avoir reçu sa dernière forme pendant la lutte qui exista sous les Sassanides entre les chrétiens et les sectateurs de Zoroastre.
Après Sam on rencontre une nouvelle lacune dans le cycle du Séistan, car Zal fils de Sam ne paraît pas avoir obtenu les honneurs d'un poème particulier : du moins le Modjmel-al-Tewarikh n'en mentionne aucun, et je n'en ai trouvé d'indice nulle autre part. Quant à Rustem fils de Sam, Firdousi avait si bien célébré sa vie, qu'aucun auteur persan après lui n'a dû être tenté d'écrire sur le même sujet[36] ; mais, parmi les quatre enfants de Rustem, il n'y en a qu'un dont Firdousi se soit occupé avec détail : c'est Sohrab, dont la mort forme le sujet d'un des plus beaux épisodes du Livre des rois. Les trois autres enfants ont été négligés par Firdousi, et les traditions qui les concernaient ont fourni la matière de trois poèmes épiques, le Djihanguir-nameh, le Faramourz-nameh et le Banou-Gouschasp nameh.
Le Djihanguir-nameh est une biographie complète. L’auteur commence par dire quelques mots sur la mort de Sohrab et sur la manière dont Firdousi l’avait chantée ; après quoi il entre en matière sans autre préambule, raconte le deuil de Rustem, son amour pour la fille de Mesiha, et arrive, après le récit de maintes aventures, à la naissance de Djihanguir (fol. 65 r°). La première partie de la vie de celui-ci est calquée sur l’épisode de Sohrab dans le Livre des rois, Djihanguir est élevé comme lui loin de son père, il est entraîné comme lui par Afrasiab è faire la guerre aux Iraniens, et comme lui il combat son père Rustem sans le connaître. Cette tradition d'un fils combattant son père, qu'il ne connaît pas, paraît avoir fait une impression très vive sur les Persans, car nous la trouvons répétée une troisième fois dans le Barzou-nameh, Au reste elle se rencontre chez presque tous les peuples ; J. Grimm a publié des fragments d'un poème allemand du viii siècle qui repose sur une base tout à fait semblable ; Miss Brook a découvert en Irlande deux très anciennes ballades dont le fond offre une ressemblance étonnante avec l’histoire de Sohrab ; et Dietrich a fait imprimer un conte russe qui retrace la même histoire.
Le combat de Djihanguir avec Rustem finit par leur reconnaissance mutuelle. Djihanguir passe du côté des Iraniens et prend une grande part aux guerres de Keïkaous contre les Touraniens, les Arabes, les Slaves et les Berbers. Il est, à la fin, tué à la chasse par un Div, et sa mère meurt de douleur en apprenant la perte qu’elle vient de faire. L'auteur termine son ouvrage en priant les hommes de sens de conserver cette vieille histoire jusqu'à la fin des jours.
Ce poème se compose de six mille trois cents distiques, et est écrit dans le mètre épique ordinaire. Le seul renseignement que l'auteur donne sur lui-même, c'est qu'il a écrit son ouvrage à Herat ; mais nous ne savons ni son nom ni l'époque où il vivait. Le Djihanguir-nameh n'est pas mentionné par l'auteur du Modjmel-al-Tewarikh ; mais je crois néanmoins qu'il date des premiers temps de la poésie épique persane, c'est-à-dire du v siècle de l'hère ; car les matériaux de ce poème et leur mise en œuvre sont encore tout à fait épiques, et n'ont rien de l'élégance ni du ton lyrique des poèmes postérieurs.
Les traditions rapportées dans le Djihanguir-nameh ne paraissent pas avoir été altérées par l'influence des musulmans, si ce n'est qu'il y est question de Bagdad, où l'auteur fait résider le roi des Arabes (fol. 90 r°). C'est une faute à laquelle presque aucun auteur épique persan n'a échappe.
Le Faramourz-nameh est un petit livre contenant à peu près quinze cents distiques, et qui ne roule que sur un seul épisode de la vie de Faramourz. L'auteur ne donne aucune espèce de préface et débute par ces vers : Un jour, les braves, tels que Feribourz, Thous, Rustem, Farairmourz, Gourdez, Babram, Guiv, Kustehem, Rebbam et Gourguin le vaillant, étaient assis devant le roi, entourés de musiciens et d'échansons ; ils étaient assis ensemble, berger et troupeaux, lorsqu'un messager illustre se présenta, demandant accès auprès du roi. Ce messager était envoyé par Nouschad, roi de l’Inde et vassal de la Perse. Il apporte une lettre dans laquelle Nouschad demande à Keïkaous de lui envoyer un membre de la famille de Sam pour le secourir contre ses ennemis, et déclare que sans cela il sera obligé de refuser le tribut qu'il paye à la Perse. Kaous fait un appel aux grands de sa cour, et Faramourz s'offre pour cette expédition ; il part, combat victorieusement les ennemis de Nouschad, les monstres qu'il rencontre, et, à la fin, Nouschad lui-même, discute avec les Brahmins, et finit par convertir le roi indien et son peuple à la religion persane.
Il existait, du temps de la composition de cet ouvrage, qui date du Ve siècle, beaucoup d'autres traditions sur Faramourz, dont on retrouve une partie dans le Barzou-nameh, le Djihanguir-nameh et le Bahman-nameh, On ne peut rien conjecturer sur l'auteur du Faramourz-nameh ; le seul manuscrit que j'en connaisse est écrit de la main d’un Perse, mais rien dans le livre même n’indique que l’auteur ne fût pas musulman. Je ne suis pas éloigne de croire que ce que nous possédons n'est qu'un fragment d'un ouvrage plus considérable.
Le Banou-Gouschasp-nameh est encore un ouvrage du Ve siècle de l’hégire. Il est composé de quatre ballades ou aventures, distinctes et sans liaison entre elles, et dont la dernière offre une singulière ressemblance avec une scène célèbre des Nibelungen.
Banou-Gouschasp est la fille de Rustem, et l’héroïne par excellence de l'épopée persane ; elle va à la chasse aux Kons et a la guerre, pourfend ses prétendants trop bardis, délivre des princes ensorcelés et changés en onagres ; et lorsque Rustem et Keïkaous, pour mettre fin aux combats des grands de la cour qui se la disputent, la marient à Guiv, un des plus braves parmi les Iraniens, elle lie son mari avec sa ceinture, et le jette sous son siège, jusqu'à ce que Rustem arrive pour lui faire des reproches et pour établir l'ordre dans la maison. Plus tard elle devint mère de Peschen, le même dont le nom tira Firdousi d'un si grand embarras.
Le Banou-Gouschasp-nameh est un petit ouvrage très informe, sans préface ni fin, et contenant à peu près neuf cents distiques ; son auteur était musulman, comme on le voit par une invocation au Prophète placée au commencement de la quatrième aventure, et par une autre qui se trouve à la fin du livre. Le Barzou-nameh et le Bahman-nameh contiennent une beaucoup plus grande quantité de traditions sur Banou-Gouschasp que le livre qui porte son nom, et qui probablement n’est qu'un fragment d'une collection plus considérable.
La tradition donne à Rustem plusieurs petits-fils : Sam fils de Faramourz, dont le Djihanguir-nameh parle souvent ; Peschen fils de Banou-Gouschasp, et Barzou fils de Sohrab ; mais ce dernier est le seul d'entre eux sur lequel il existe un poème particulier, le Barzou-nameh, qui, du reste, et plutôt une collection de toutes les traditions relatives à la famille de Rustem que Firdousi avait négligées, qu'une biographie de Barzou, quoique ce dernier y joie certainement le plus grand rôle. La forme de l'ouvrage peut faire supposer que l'intention du poète a été de l'incorporer au Livre des rois, quoique l'épisode surpasse en étendue l'ouvrage principal. Il commence, comme le Sam-nameh, par une citation de Firdousi, qu'il prend pour point de départ. Après avoir copié la dernière moitié de l'épisode de Sohrab, l'auteur dit : A présent que j'ai achevé l'histoire de Sohrab, je vais parler de son fils Barzou ; venez tous auprès de moi et écoutez ma chanson sur le noble fils de Sohrab, le héros illustre. Voici ce que j'ai lu dans un ancien livre où l'on a écrit ces histoires. Ensuite il entre en matière sans indiquer les sources où il puise ni les circonstances dans lesquelles le livre est composé ; de manière que tout ce que l'on peut affirmer de lui, c'est qu'il était musulman, comme le prouve une invocation à Mohammed. Le commencement de l'histoire de Barzou n'est qu'une variante de celle de Sohrab, ou plutôt de celle de Djihanguir. Sohrab, peu de temps avant d'aller combattre contre l’Iran, rencontre Schahroud, fille du châtelain de Segnan, l'épouse et lui laisse en partant une bague pour l’enfant qu'elle porte dans son sein. Gel enfant était Barzou, que sa mère éleva jusqu’à l’âge de vingt ans en lui cachant son origine, de crainte qu'il n'allât combattre Rustem pour venger la mort de son père. Mais un jour Afrasiab arrive à Segnan ; il est frappé de ta bonne mine de Barzou, l'emmène à sa cour et finit par l'envoyer à la guerre contre les Iraniens. Barzou est fait prisonnier par eux, découvre sa naissance et reste dans l'armée d'Iran. A partir de là, se déroule une suite interminable d'événements et d'aventures dans lesquelles paraissent tous les héros que nous voyons figurer à cette époque dans le Livre des rois, accompagnés d'une foule de personnages nouveaux dont Firdousi ne parle pas. Cette masse de traditions contient beaucoup d'histoires curieuses qui prêtent à des rapprochements intéressants, mais où s'entremêlent tant d'aventures que je ne puis pas même en retracer ici le cadre. Ce n'est pas ici le lieu de donner de tous ces poèmes une analyse suffisamment développée pour permettre de suivre l'histoire de chaque personnage marquant, et juger en connaissance de cause du caractère et des détails de ces traditions si compliquées. Celles du Barzou-nameh ne sont pas toujours entièrement conformes à celles que nous lisons dans le Livre des rois : ainsi Zadschem, roi du Touran, qui, chez Firdousi, est le grand père d'Afrasiab, est son fils dans le Barzou-nameh ; mais ce sont là des différences auxquelles il faut s'attendre quand il s'agit d'une tradition orale ancienne et répandue dans un pays aussi vaste que la Perse. Le Barzou-nameh me paraît avoir été composé d’après des sources encore plus populaires que celles de la plupart des autres poèmes épiques. La nuance, il est vrai, sur ce point-là, est difficile à préciser ; mais on trouve quelquefois les mêmes traditions racontées dans deux de ces poèmes, et l’on en voit alors la différence. Par exemple, le Barzou-nameh, qui traite longuement des guerres contre les Slaves, représente toujours ce peuple comme des Divs, et appelle leur roi le Div Seklab, pendant que le Sam-nameh parle des Slaves comme d'une nation d'hommes, et désigne leur roi sous le nom du roi Seklab
Il est difficile de déterminer la date de la composition du Barzou-nameh ; le Modjmel-al-Tewarikh ne le mentionne pas, et Anquetil du Perron l’attribue à un poète nommé Ataï, mais sans indiquer la source d'où il a tiré ce renseignement. Ce nom, fût-il le véritable nom de l’auteur, ne nous apprendrait rien sur son compte, car nous n'avons d'ailleurs, touchant ce poète, aucune information, A en juger par les caractères mêmes du livre, le Barzou-nameh doit appartenir au Ve ou au commencement du VIe siècle ; le style et l'esprit de la composition sont simples et tout à fait épiques, et les traditions rapportées dans l'ouvrage ne sont nullement corrompues par l'influence musulmane. Le manuscrit de la Bibliothèque royale est le seul que j'aie eu entre les mains ; il a été copié pour Anquetil d'après celui de Fareskhan, lieutenant du gouverneur de Surate, et il contient, sur treize cent cinquante neuf pages, environ soixante-cinq mille distiques ; mais malgré cette étendue démesurée, il est incomplet, et les trois mille derniers distiques y manquent. La longueur de ce poème a dû tenter les conteurs d'en extraire des épisodes, et Anquetil en a rapporté de l’Inde un qui, sous le titre de Sousen-nameh {le Livre de la chanteuse), semblerait faire un ouvrage à part, si on ne le retrouvait dans le Barzou-nameh; c'est l'histoire d'une chanteuse touranienne qui, par différentes ruses, s'empare des principaux héros iraniens et les envoie enchaînés au camp d'Afrasiab.
Le Barzou-nameh a quelquefois, mais plus rarement que le Guerschasp-nameh, fourni des interpolations pour le texte de Firdousi, et Macan en a publié une dans l'appendice de son édition. Elle est prise presqu'au commencement du Barzou-nameh, et renferme l'histoire des premiers combats de Barzou contre Rustem, son alliance avec les Iraniens et l'épisode de Sousen dont je viens de parler. Un autre épisode du Barzou-nameh tiré du manuscrit de la Bibliothèque royale, a été publié et traduit par Kosegarten, et roule sur une chasse à laquelle Keïkhosrou avait invité Barzou.
Le dernier poème de cette série est le Bahman-nameh. Je le compte parmi les épopées du cycle du Séistan, parce qu'il est presque entièrement consacré à l'histoire de la famille de Rustem, quoique le roi Bahman fils d'Isfendiar en soit le héros nominal. Ce poème est dédié au Seldjoukide Mahmoud fils de Malekschah. L'auteur, dont le nom m'est inconnu, paraît avoir été partisan de ce prince, pendant sa longue lutte avec son frère. Il annonce qu'il envoie son ouvrage à Mahmoud, aussitôt après son avènement au trône. L'époque à laquelle il fait allusion dans ce passage paraît être l'année 498 de l'hégire, dans laquelle Mahmoud réussit à se mettre en possession de l'héritage longtemps contesté de son père, et où il prit le titre de roi. Le Bahman-nameh fut donc composé vers la fin du Ve siècle de l'hégire. Il est divisé en quatre parties, dont la première décrit l'avènement au trône de Bahman fils d'Isfendiar, ainsi que ses aventures avec Kutaïou, fille du roi de Cachemire, et avec Homaï, fille du roi d'Egypte. Elle finit par le récit de la mort de Rustem, que Djamasp fait au roi, et par les plans de vengeance que Bahman forme contre la famille de Rustem. La seconde partie traite de la guerre contre le Séistan. Le vieux Zal, Faramourz, son fils Sam et les deux filles de Rustem, Banou-Gouschasp et Zerbanou, repoussent trois fois Bahman jusqu'à Bactres ; mais à la fin Zal est fait prisonnier, Faramourz tué, et le reste de la famille s'enfuit vers le Cachemire. Dans la troisième partie, Bahman poursuit les deux filles de Rustem jusqu'au Cachemire et dans l’Inde, et finit par les faire prisonnières ; il s'empare de même d'Aderberzin fils de Faramourz, et des deux fils de Zewareh frère de Rustem. Il se rend alors auprès des tombeaux de la famille du Séistan, les ouvre et les dépouille ; après quoi il renvoie tous ses prisonniers dans le Séistan, à l’exception d'Aderberzin. Dans la quatrième partie, Aderberzin est délivré par Rustem fils de Tour, il fait la guerre à Bahman et conclut, à la fin, un traité avec lui ; Bahman cède son trône à la reine Homaï et est tué à la chasse.
Le Bahman-nameh contient à peu près dix mille distiques ; il est écrit avec plus de prétentions littéraires que la plupart des autres poèmes épiques, et précédé d'une préface imitée de Firdousi. L'auteur indique partout la tradition orale comme la source où il a puisé, par exemple dans le passage suivant : Voici ce que dit un Dihkan, issu d'une famille de Mobeds, qui m'a ouvert la porte des histoires ; et autre part : Le poète demanda au conteur ce que Bahman, le maître du monde, avait fait après cela ; le conte leur ouvrit la bouche et lui dit : Je vais te raconter exactement cette tradition. On ne peut guère douter en effet qu'il n'ait eu à sa disposition des traditions anciennes, car il n'emprunte pas ses matériaux au Livre des rois ; et son récit, en général, se tient trop dans le cercle de l'ancienne poésie épique pour qu'on puisse le soupçonner d'avoir inventé le fond de son poème ; il était d'ailleurs d'une ignorance si complète qu'il n'aurait pas pu forger une fable sans se trahir sur-le-champ. Il donne dans la quatrième partie un singulier exemple de son inhabileté à exercer la moindre critique, et à déguiser même les plus grossiers défauts des contes populaires dont il se servait ; voici le passage : Le maitre du monde, traînant après lui son drapeau renversé, s'enfuit à Ctésiphon, ville qu'on appelle aujourd'hui Bagdad. Il y avait là un roi fortuné et célèbre par sa bravoure, dont le nom était Haroun Lafi. On voit que l'auteur confond Ctésiphon avec Bagdad, et ces deux villes avec Babylone ou avec quelque autre des anciennes grandes villes de la Mésopotamie ; et quoiqu'il ne fasse pas du roi de Baghdâd un khalife, on voit pourtant, par le nom qu'il lui donne, qu'il pense à Haroun-al Raschid.
L'impulsion donnée par Firdousi à la poésie épique persane avait ainsi duré pendant tout le Ve et probablement pendant une partie du VIe siècle de l'hégire. Les auteurs de tous les ouvrages dont je viens de parler appartiennent à son école ; ils ont tous imité sa manière de reproduire les anciennes traditions dont à son exemple ils ont fait la base de leurs poèmes, lesquels peuvent n'être considérés que comme des compléments du Livre des rois. Ils ont certainement échoué plus souvent que lui sur les écueils que présente ce genre de composition ; ils ont moins bien choisi leurs matériaux ; ils ont adopté plus de fables et des fables plus modernes ; enfin ils n'ont su l'égaler ni par l'importance du fond ni par la perfection de la forme ; mais il faut, malgré tous leurs défauts, les comprendre parmi les poêles épiques, car ils racontent l'histoire de leur pays selon la tradition orale et dans un esprit tout à fait national.
La décadence de la littérature épique commença au vie siècle de l’hégire, soit que les matériaux eussent été épuisés, soit que les progrès de la littérature polie eussent effacé les souvenirs populaires, soit que le sentiment national se fût affaibli, ou peut-être par toutes ces raisons ensemble. On ne cessa pas, il est vrai, de s'occuper de quelques-uns des rois et des héros que les épopées avaient célébrés, mais on s'en occupa dans un tout autre esprit. C'est le sort des traditions épiques de dégénérer en romans et en contes merveilleux. Ces deux espèces de fables s'introduisent de bonne heure dans la tradition, et grandissent aux dépens des souvenirs historiques, qui vont toujours s’effaçant. Les noms des héros restent, mais ils ne servent plus qu'à attirer l'attention sur des récits fantastiques. C'est ce qui arriva en Perse, où nous voyons naître sur les ruines de la poésie épique deux nouveaux genres de littérature, le roman historique et le conte épique, qui tous les deux se servent des circonstances les plus connues de la vie d'un homme célèbre pour en former un cadre, que l'un remplit du tableau et de l'analyse d'une passion, et l'autre de récits merveilleux destinés uniquement à étonner et à amuser le lecteur.
Le premier qui mit à la mode le roman historique fut Nizami (né l'an 513 et mort l'an 576 de l'hégire). C'était un grand poète lyrique et didactique, qui ne cherchait dans l'histoire que des sujets qui se prêtassent aux moralités et à la peinture des passions. Il a composé dans ce système quatre poèmes, dont trois traitent des sujets tirés de l'histoire épique persane ; ces derniers sont le Khosrou et Schirin, ou les Amours de Khosrou Parwiz ; le Heft Peiker, c’est-à-dire les Sept Images, ou les amours de Bahramgour avec sept princesses, et l’Iskender-nameh ou le Livre d'Alexandre le Grand. Les deux premiers sont plus lyriques ; le troisième est plus didactique, surtout dans sa seconde partie ; mais tous portent des traces de leur parenté avec la littérature épique. Nizami est encore trop voisin du siècle de cette littérature pour savoir se restreindre à son sujet et à son but principal ; de sorte qu'il s’est laissé aller à raconter beaucoup de circonstances tirées de la poésie épique qui ne sont point essentielles au développement de son roman. Mais quoiqu'il lui soit resté quelque chose des habitudes de ses prédécesseurs, on ne peut pourtant pas le classer parmi les poètes épiques : il n'a pas leur sentiment national, il ne puise pas comme eux dans la tradition, mais dans les livres et dans son imagination, et tire ses sujets indifféremment de l’histoire persane et de l'histoire arabe, pourvu qu'ils soient propres à faire briller son style et son esprit : c'est essentiellement un homme de lettres. Celui de ses poèmes qui se rapproche le plus, par sa forme, de la poésie épique est l’Iskender-nameh, où l'élément lyrique ne prédomine pas, mais auquel cependant manque le caractère essentiel de l'épopée, qui est d'être fondé sur une tradition nationale. Nous avons vu plus haut qu'il n'existait pas de tradition persane sur Alexandre : aussi Nizami ne fait-il que suivre la fable grecque, à laquelle il ajoute l’histoire de l’expédition des Russes contre Berda, expédition qui n'est certainement pas entrée dans la tradition persane, car elle a eu lieu l’an 945 de notre ère.
L'exemple donné par Nizami fut suivi par plusieurs poètes distingués des siècles suivants, qui l'imitèrent si servilement qu'ils se bornèrent presque exclusivement au petit nombre de sujets qu'il avait choisis.[37] Ils faisaient assaut de beau langage, de pensées raffinées, d'allusions délicates et difficiles à saisir ; mais ils n'avaient plus rien à ajouter aux traditions connues : ils prenaient leurs sujets tout arrangés dans les poésies épiques et dans Nizami, et tout ce qui leur importait, c'était de les traiter d'une manière encore plus élégante et plus artificielle que n'avait fait ce dernier. A cette classe appartiennent l’Iskender-nameh, le Khosrou et Schirin et le Hescht Behischt (les Sept Paradis, ou les Amours de Bahramgour) de Khosrou de Dehli (mort en 726 de l'hégire), l’Iskender-nameh de Djami (mort en 898 de l'hégire), le Khosrou et Schirin et le Heft Manzer (les Sept Stations, ou les Amours de Bahramgour) de Hatefi (du commencement du Xe siècle de l’hégire), et l’Iskender-nameh d'Abd-al-Salam fils d’Ibrahim, natif du Cachemire. Ce dernier ouvrage fait d’Alexandre le Grand un prophète ; et comme, dans les idées musulmanes, il faut être issu de race sémitique pour être prophète, l'auteur adopte la prétention des Arabes, qui, à l'exemple des Égyptiens et des Persans, revendiquent pour leur nation l’honneur d'avoir donné naissance à Alexandre le Grand. Nizami est, je crois, le premier parmi les Persans qui mentionne cette généalogie, mais sans l'approuver. Comme il était difficile de faire entrer Alexandre dans la lignée de Jacob ou d'Ismaël, on trouva l'ingénieux expédient de lui donner Esaü pour ancêtre La mère d'Alexandre est donc, selon Abd-al-Salam, issue de la race d'Esaü ; elle est vierge, devient enceinte miraculeusement, s'enfuit loin des hommes et meurt en mettant au monde un fils, que Philippe, roi des Grecs, des Russes et des Francs, trouve à côté de sa mère morte. Il l'adopte, le fait élever par Aristote, etc. Le récit retombe ensuite dans la fable grecque et ne se compose plus que de variations sur le thème de Nizami.
Tous ces romans, malgré leur forme, n'appartiennent plus à la véritable poésie épique, et je n'en ferai pas ici l’appréciation détaillée, parce que cette appréciation rentre dans le domaine de l'histoire de la poésie lyrique chez les Persans. Ils sont tous écrits en vers et dans un style tellement ambitieux, qu'il faut être lettré pour les comprendre ; tandis que les contes qui forment la seconde branche de la littérature épique dégénérée ont un caractère beaucoup plus simple, sont écrits par des littérateurs de bien plus bas étage et destinés à des lecteurs bien plus ignorants. Il est difficile de suivre l'histoire de leur composition et de leurs transformations, et cette tâche serait d'ailleurs tout à fait en dehors de mon sujet ; je vais seulement citer quelques traits qui pourront servir à caractériser ce genre d'ouvrages et à montrer pourquoi il faut les exclure de la littérature épique.
Un des compilateurs les plus infatigables de ces contes a été un Arabe. Abou-Thaher Ibn-Hasan Ibn-Ali Ibn Mousa de Tharsous, sur lequel je n'ai d'ailleurs aucun renseignement. Il paraît avoir fait une immense collection de contes sur l'histoire de Perse, collection que l'on divisa plus tard en divers ouvrages séparés, auxquels on donna les noms des rois ou des héros qui forment les sujets de chaque partie, comme le Darab-nameh, le Kaherman-nameh, le Kiran-Habeschy et autres. Le Darab-nameh est un volume in-folio de 800 pages, qui comprend les vies de Bahman, de Homaï, de Darab et d'Alexandre le Grand. Le cadre de cette composition est tiré de Firdousi ; mais il est rempli et enflé par une masse énorme de fables absurdes, dont je vais rapporter une des plus courtes pour donner une idée du livre. Alexandre s'étant, dans sa jeunesse, enfin de la cour de son grand père Philippe, arrive dans la capitale du pays des Berbers, dont le roi avait épousé la mère d'Alexandre, que Darius avait répudia. Il craint de se faire reconnaître, et n’ayant pas de moyens d'existence, il se présente dans le conseil des scribes du roi et demande un emploi. Un des scribes voyant sa beauté surhumaine, et pensant se faire honneur avec un serviteur d'aussi bonne mine, l'engage pour deux dirhems d'argent par jour. Son emploi consistait à pointer le matin le portefeuille du scribe au diwan, et à le reprendre le soir. Un jour le maître étant tombé malade, envoie le jeune Alexandre au conseil chercher son dossier ; mais les scribes invitent celui-ci à faire lui-même le travail de son maître. Le petit Alexandre répond qu'il n'ose pas le dire sans permission, retourne chez son maître, obtient son agrément et se met à la besogne. Les scribes voient avec jalousie les beaux caractères qui coulent de son roseau et les calculs merveilleux qu'il exécute ; ils en deviennent jaloux, le calomnient auprès du malade et le font chasser. Alexandre, se trouvant de nouveau sans ressources, achète un astrolabe, avec lequel il se place sur la grande route pour dire la bonne aventure aux passants ; car Aristote l'avait bien instruit dans les mystères de l'astrologie, etc. L'espace me manque pour continuer cet extrait, mais l'ouvrage entier consiste en contes pareils. [38]
Le Kaherman-nameh est un ouvrage immense qui remplit huit volumes ; la Bibliothèque royale en possède trois traduits en langue turque dans les environs du mont Kaf, où il s'amuse à atteler quatre cents hippopotames, et devient si féroce, que quand il ne trouve pas d'autres ennemis à combattre, il se bat contre lui-même, en prenant dans chaque main une massue de fer. Il finit par revenir dans les pays des hommes et s'établit dans les montagnes du Kouhistan, où il vit de lâchasse. Or Houscheng préparait alors une expédition contre les princes de l'Iran et du Touran, qui s'étaient réfugiés dans l'Inde, et Kaherman voit, un beau jour, pénétrer dans les défilés du Kouhistan une armée persane de dix-sept cent mille hommes, précédée d'une avant-garde de quatre-vingt mille hommes montés sur des rhinocéros, etc. Je ne suis pas sûr que le Kaherman-nameh soit un fragment de la collection d’Abou-Thaher de Tharsous ; mais je le suppose, parce qu'on y cite sans cesse un certain Tharsousi, absolument comme on cite Abou Thaher Tharsousi dans le Darab-nameh et dans le Kiran Habeschy, ouvrages que l'on sait être tirés de la collection d'Abou-Thaher.
Le Kiran-Habeschy est l'histoire d'un héros qui vécut sous Keïkobad et qui finit, après d'innombrables exploits, par devenir vice-roi de Bactres. Ce conte est certainement tiré de la compilation d'Abou-Thaher, €t il est tout à fait dans le goût des autres. Le Houscheng-nameh, le Faghfour-nameh, le Thahmouras-nameh et l’histoire de Djemschid sont de la même classe. C'est une véritable bibliothèque bleue, dans laquelle la tradition, si tant est qu'on y trouve encore une trace de tradition, est tombée au dernier degré d'abâtardissement. Ces contes sont au Livre des rois ce que Siegfried le Cornu des paysans allemands est à l'ancienne Edda. Leurs auteurs ne se contentent pas de mêler continuellement les traditions persanes et musulmanes, de donner, par exemple, à Kaïoumors Adam pour père et Seth pour fils ; de faire marcher l’année de Houscheng sous le drapeau de Salomon (comme dans le Kaherman-nameh) ; de faire raconter, par le Simurgh, à Alexandre le Grand, les conversations que l'archange Gabriel et Salomon tiennent dans le ciel (comme dans le Darab-nameh) ; mais ils bouleversent tout à un tel point qu'il est difficile de croire qu'ils aient seulement lu les poèmes épiques.
C'est ainsi que la tradition épique des Persans parcourut le cercle entier des transformations que peut subir une tradition. Formée librement par le peuple sous les anciennes dynasties, conservée par les Dihkans dans le temps de la décadence de l'empire, recueillie à plusieurs reprises par les derniers rois Sassanides, elle paraissait devoir succomber sous l'invasion arabe et sous le changement de maîtres, de religion, et de langue même que la domination musulmane fit subir à la Perse ; mais elle résista à toutes ces épreuves, fut reproduite dans la langue même des conquérants, et devint, entre les mains du peuple vaincu, un moyen de défense. Après mainte tentative infructueuse, parut enfin un homme qui sut la convertir en un véritable poème épique national ; et le Livre des rois pendant un siècle, fut suivi d'un grand nombre de poèmes composés dans le même esprit et qui le complétèrent dans toutes ses parties. Ces poèmes épuisèrent la tradition épique ; mais la nation ne se lassa pas d'entendre, sous de nouvelles formes, des récits relatif à ses héros favoris, et Nizami créa le roman historique, dans lequel il conserva le cadre fourni par les poètes épiques, mais en le remplissant, selon le goût de son temps, de sentiments raffinés. Son école domina dans la littérature persane pendant plusieurs siècles, et la tradition allait toujours s'affaiblissant sous le poids des ornements dont on la surchargeait. D'un autre côté, le peuple, à qui ces romans étaient inintelligibles, se créa le conte en prose, dans lequel il accumula, autour des noms célébrés par l'épopée, toutes les fables qu'il avait l'habitude de raconter, et qui étaient complètement étrangères à la tradition historique. C'est ainsi que périt la tradition vivante et orale ; mais la grande œuvre de Firdousi est restée, et n'a jamais cessé d'être l'objet de l'admiration des savants et de la prédilection du peuple.[39]
Les travaux dont le Livre des rois a été l’objet en Orient sont moins nombreux et moins importants que ne devrait le faire croire l'immense popularité dont cet ouvrage jouit depuis huit siècles dans le monde musulman. J'ai parlé plus haut de l’édition critique du texte que Baïsangher-Khan fit entreprendre l’an 829 de l’hégire ; c'est le seul essai d'épuration du texte que les musulmans aient tenté. On trouve parfois sur la marge des manuscrits, on certain nombre de notes ; mais on ne connaît aucun commentaire suivi sur l’ouvrage entier. Les préfaces se terminent quelquefois par un lexique très concis, qui a été reproduit par Macan. La première traduction du Livre des rois date de la fin du VIe siècle de l’hégire ; elle est en prose arabe ; l’auteur est Kawam-eddin Abou'lfatah Isa Ibn-Ali Ibn-Mohammed, natif d'Ispahan qui la dédia à l’Ayoubite Abou'lfatah Isa fils de Malek-el-Adel Aboubekr. Ce n'est qu'un extrait, qui ne peut guère servir à fixer le sens d'aucun passage difficile ; mais sa date le rend important pour la critique de l'ouvrage quand il s'agit d'interpolations considérables. Tatar-Aly-Effendi présenta, l'an 916 de l'hégire, à Kansou le Gauride, une traduction complète du Livre des rois en vers turcs. Une autre traduction turque fut exécutée en prose par Mehdy, officier du sérail, et dédiée à Othman II, l’an 1030 de l’hégire. Tawakkol-Beg fils de Tawakkol-Beg, employé au service de Dara-Schekoh fils de Houmayoun et vice-roi de Lahore, publia, l’an 1063 de l’hégire, sur la demande de Schemschir-Khan, sous le titre de Muntekhab-al-Tewarikh (Extrait des annales), un abrégé de Firdousi en persan. Cet ouvrage est écrit en prose mêlée de nombreux passages de vers ; il est plus court que l'extrait de Kawam-eddin, et s'arrête à la mort d'Alexandre, après laquelle on ne trouve plus qu'un sommaire en quelques pages, ne contenant guère que les noms des rois Sassanides. Tawakkol-Beg avait sous les yeux un manuscrit rempli d'interpolations, et son travail ne peut être d'aucun secours pour la critique du texte. Il termine son livre par un extrait de la préface n° 2. Enfin Hyde a possédé un autre extrait du Livre clés rois, entièrement en prose et intitulé Schah-nameh naser, le Livre des rois en prose. Ce livre est l'ouvrage d'un Perse, comme on peut s'en assurer en lisant la vie de Zoroastre que Hyde en a tirée, et qui est amplifiée à l'aide du Zerdouscht-nameh, légende perse dont un auteur musulman n'aurait pas fait usage. Sir W. Ouseley a publie quelques autres fragments de cet extraite.
Les Européens se sont occupés fort tard du Livre des rois. Le premier qui en ait publié des fragments est Sir W. Jones, dans ses Commentarii poeseos Asiaticae, Londres, 1772. Firdousi était alors encore si peu connu, que Sir W. Jones croyait que le Livre des rois était une collection de diverses poésies historiques que l’on avait l’habitude de réunir en un seul volume, rangées selon l’ordre chronologique des sujets, et dont une, en particulier, se distinguait par son caractère épique. Jones a donné quelques extraits du Livre des rois avec une partie de la satire, accompagnés d’une traduction latine.
Le premier qui ait essayé de traduire l’ouvrage entier est J. Champion, qui a publié le commencement de son travail sous ce titre : The Poems of Ferdosi, translated by Joseph Champion esq., t. I, Calcutta, 1786 (grand in-4°, 315 pages). Son introduction renferme un extrait de la grande préface persane ; sa traduction est en vers et finit au mariage de Zal et de Roudabeh. Cet ouvrage paraît avoir eu quelque succès, car il a été réimprimé à Londres en 1790, petit in-4°, ce qu'on ne peut attribuer qu'à la nouveauté du sujet ; car la traduction est conçue dans un faux système de paraphrase et ne donne aucune idée de l'auteur ni de son style.
Le comte Ludolf s'occupait presque en même temps d'une traduction littérale du Livre des rois, en prose allemande ; mais il n'en a para que quelques fragments contenant l’histoire de Djemschid et celle de Zohak. C'est un travail consciencieux, et il est à regretter qu'il n'ait pas paru en entier.
Le capitaine W. Kirkpatrick inséra, dans son Essai sur l’histoire de la poésie persane, malheureusement resté incomplet, les passages de Firdousi qui se rapportent à Dakiki.
Hagerman publia, en 1801, à Göttingen, une dissertation sous ce titre : Monumentae Persepolitani e Ferdusio poeta Persarum heroico illustratio, in-4°, dans laquelle il donne un fragment de l’histoire de Djemschid, mais d'une manière fort incorrecte. Il a publié plus tard, dans le journal de M. Schlegel intitulé Europa, la traduction d'une partie de la vie de Bahramgour.
Mouradgea d'Ohsson a pris Firdousi pour base de son Tableau historique de l'Orient, Paris, 1803, 3 volumes in-8°. C'est un extrait du Livre des rois, dans lequel l'auteur a voulu conserver ce qui est historique, en le complétant par des faits tirés d'autres sources.
E. Scott Waring dans son Tour to Sheeraz, Londres, 1807, a publié un assez grand nombre de passages de Firdousi ; mais il se contente le plus souvent de les accompagner de la traduction de Champion.
Dans la même année, Wilken fit imprimer, dans ses Institutiones linguae Persicae, p. 189-309, des fragments de l'histoire d'Alexandre, suivis d'une traduction latine.
Wallenbourg s'occupait pendant ce temps, à Vienne, d'une traduction de l'ouvrage entier en prose française ; mais elle n'a pas été achevée, et il n'en a rien paru que la traduction de la préface n° 2, sous le titre de : Notice sur le Schah-nameh ; Vienne, 1810, in-8°.
De son côte, la Compagnie des Indes avait, depuis quelques années, ordonné la publication du texte entier de Firdousi. Lumsden, alors professeur d'arabe et de persan au collège de Fort-William, fut chargé de ce travail et organisa un bureau de mounschis, qui collationnèrent vingt-sept manuscrits. Le premier volume seul parut sous ce titre : The Schah-namu, being a series of heroic poems on the ancient history of Persia, by the celebrated Abool-Kousim i' Firdousee of Toos, in eight volumes ; vol. I, Calcutta, 1811, in-folio. L'impression de cette édition est assez correcte, mais le texte ne répond pas, sous le rapport de la critique, à ce que l'on pouvait attendre d'un éditeur aussi savant et de préparatifs aussi considérables ; car on a suivi, malgré le grand nombre de manuscrits collationnés, le texte d'un manuscrit du xviie siècle prêté à Lumsden par feu Sir John Malcolm. J'ai eu longtemps entre les mains ce manuscrit, dans lequel le copiste a accumulé autant de vers qu'il a pu ; c'est ce que les Orientaux prennent pour un texte critique, et je ne doute pas que les mounschis n'y aient suivi plutôt leur goût que l'opinion de Lumsden, qui n'avait que peu de temps à donner à la révision de l'ouvrage. Cette édition ne fut pas continuée ; mais la copie qui avait été préparée pour le second volume servit à l'édition de Sohrab publiée par M. Atkinson sous le titre suivant : Soohrab a poem, freely translated from the original Persian of Firdosee by James Atkinson, Calcutta, 1814, in-8°.
L'année suivante parut à Londres un petit ouvrage intitulé : Episodes of the Schah-nameh of Ferdosee, translated into English verse by Stephen Weston ; 1815, in-8°. Ce livre ne contient qu’un petit nombre de passages suivis du texte en caractères latins.
Wahl, à Halle, avait l’intention de publier une traduction complète de Firdousi, et l’annonça, en 1816, dans le volume V des Mines de l’Orient ; il n'en a paru qu'un spécimen en vers blancs, accompagné du texte et de notes, (Mines de l’Orient, t. V, p. 109, 233, 351.)
Hammer publia, en 1818, son Histoire de la poésie persane, dans laquelle il inséra une traduction, en vers allemands des Sept Aventures d'Isfendiar et d'un fragment de Sohrab (Geschichte der schönen Redekünste Persiens, p. 56-76). Il avait déjà antérieurement publié deux autres fragments de Firdousi, dont l'un contient l'histoire de Khosrou et Schirin {Mines de l'Orient, t. II, p. 421-450), l'autre les aventures de Sam et de Zal (ibidem, t. III, p. 57-64).
S. de Sacy publia, dans la même année, le texte et la traduction du voyage de Barzouïeh dans l'Inde (Notices et Extraits, t. IX, p. 140-153).
En 1820 parut l'ouvrage de Goerres qui porte ce titre : das Heldenbuch von Iran ; Berlin, 2 vol. in-8. C'est un extrait très détaillé de Firdousi, et le seul travail qui encore aujourd'hui donne une idée juste de l'ouvrage. On peut sans doute refuser son assentiment aux idées que l'auteur émet dans sa préface, et faire des critiques de détail sur la traduction ; mais il faut reconnaître que les extraits sont faits avec un sentiment exquis de la poésie épique.
Ross plus connu sous le pseudonyme de Gulschin, avait conçu le plan d'une traduction complète de Firdousi accompagnée du texte ; mais il n'en a paru que quelques spécimens dans les Annals of oriental Literature, Londres, 1890, in-8°.
J'ai publié, en 1899, dans une petite brochure intitulée Fragments relatifs à la religion de Zoroastre, Paris, in-8°, quelques passages relatifs à la vie de Guschtasrp, qui ont été traduits plus tard, avec le reste de ce petit ouvrage, sous le titre de : Fragmente über die Religion des Zoroaster von Vullers ; 1831, in-8°.
Après toutes ces tentatives de publication et de traduction, parut enfin en 1839 une édition complète du Livre des rois : The Schah-nameh an heroic poem by Abool-Kasim Firdoosee published by Turner Macan ; Calcutta, 4 vol. in-8°. Elle contient une préface en anglais, dans laquelle l'éditeur rend compte de son travail et donne une vie de Firdousi ; une introduction persane où il reproduit, mêlée à ses propres réflexions, la plus grande partie de la préface persane n° 1 ; le texte complet du Livre des rois ; enfin un appendice qui se compose des épisodes rejetés du texte comme interpolés, et du lexique dont j'ai parlé plus haut. L'éditeur a reproduit, presque sans changement, tout ce qui a été imprimé du texte de Lumsden, en indiquant toutefois, par des étoiles, les passages suspects ; le reste de l'ouvrage forme la première rédaction critique du texte de Firdousi qui ait été entreprise par un Européen. Macan était plus propre que personne à remplir cette tâche, car il connaissait parfaitement la littérature persane el avait passe la plus grande partie de sa vie dans la meilleure société musulmane des provinces septentrionales de l’Inde. Il est à regretter que l’état de ses yeux ne lui ait pas permis de publier un choix de variantes, et une traduction anglaise de l’ouvrage qu'il m'a dit avoir voulu entreprendre.
Atkinson a imprimé, en 1832, un ouvrage sous ce titre : The Shah-nameh of the Persian poet Firdausi translated and abridged in prose and verse by James Atkinson ; Londres, in-8°. Ce livre n'est qu'une traduction de l'extrait persan fait par Tewakkol-Beg, et se termine, comme son original, à la mort d'Alexandre le Grand. La fin du volume contient une nouvelle rédaction de la traduction en vers de l'épisode de Sohrab.
Enfin Vullers a fait paraître, en 1833, une collection de passages de Firdousi sous le titre de : Chrestomatia Schahnamiana ; Bonn, in-8°. Elle renferme le texte des passages déjà publiés par Wilken, Wahl et Silvestre de Sacy, avec des variantes et un lexique.
Après avoir énuméré tous les travaux dont le Livre des rois a été l'objet, autant du moins qu'ils sont parvenus à ma connaissance, je dois dire quelques mots sur l'édition que je commence à publier. J'ai fait usage d'un grand nombre de manuscrits. La Bibliothèque royale de Paris en possède huit dont je me suis constamment servi. J'ai consulté à la bibliothèque de la Compagnie des Indes, à Londres, treize manuscrits, dont quelques-uns viennent de la bibliothèque de Tippou-Saïb : je les ai collationnés pour une grande partie du texte. Je n'ai qu'à me louer de toutes les facilités que j'ai trouvées dans ce dépôt magnifique et de la complaisance qu’a eue pour moi feu Sir Ch. Wilkins, alors conservateur de la bibliothèque. Feu Sir John Malcolm a eu la bonté de me prêter ses deux manuscrits, dont l’un a servi de base à l’édition de Calcutta, et l’autre avait fait partie de la bibliothèque de Nadir-Schah. Feu le colonel Baillie et Sir Graves Ch. Haughton ont bien voulu aussi me communiquer les leurs. Le plus beau de tous les manuscrits de Firdousi que je connaisse est celui qui a appartenu au colonel Doyle. Ce magnifique volume vient de la bibliothèque impériale de Dehli, et tous les empereurs, depuis Baber, le conquérant de l’Inde, jusqu'à Schah Alem, y ont apposé leur sceau. Le colonel, en partant pour là Jamaïque, le donna à la Société asiatique de Londres, qui m'a fait l'honneur de me l'envoyer à Paris, sur la proposition de Lord Munster et de Sir Graves Haughton, qui voudront bien me permettre de les en remercier ici publiquement. Feu le docteur Nicoll, à Oxford, m'a facilité, avec son amabilité habituelle, l'usage de la bibliothèque Bodléienne, qui contient un manuscrit de Firdousi copié par un Perse, et fort curieux sous ce rapport. Enfin je possède cinq manuscrits de l'ouvrage, dont un a servi à Macan pour son édition, et un autre, fort ancien, est remarquable en ce qu'il offre un excellent exemple de l'étal où était le texte avant la révision faite par ordre de Baïsangher-Khan. Il ne serait pas facile de donner aux personnes qui n'ont pas eu à comparer des manuscrits du Livre des rois une idée juste du nombre de variantes qu'ils fournissent et qu'on peut diviser en trois classes principales : 1° les grandes interpolations tirées d'autres poèmes épiques ; 2° les tirades de vers qui n'ajoutent rien au récit et sont l'ouvrage de quelque savant lecteur ou copiste qui s'est permis d'allonger le poème par ses amplifications ; 3° les variantes proprement dites, où le copiste n'a fait que changer quelques mots d'un vers ou un vers entier, soit par négligence, soit pour corriger le texte, soit pour substituer un terme nouveau à un vieux mot devenu difficile à entendre. La première classe est la plus facile à reconnaître ; les deux autres laissent de grands doutes quand le nombre et l'autorité des manuscrits qui contiennent l'une et l'autre version se balancent, et quand les expressions ne trahissent pas une origine moderne. J'ai quelquefois hésité dans ce cas. Au reste, cette immense variété de leçons ne doit pas faire douter de la possibilité de donner un texte suffisamment authentique ; car, à l'exception des grandes interpolations que l'on retrouve dans les poèmes dont elles sont empruntées, et qui en conséquence ne peuvent présenter aucune difficulté sérieuse, toutes ces variantes n'influent que peu sur la marche du récit, et ne sont pour la plupart que des répétitions, des transpositions de vers ou des substitutions de mots arabes à des mots persans maintenant hors d'usage ; et l'on trouvera ordinairement, dans la plupart des manuscrits anciens, une conformité suffisante pour une décision critique, j’avais essayé de classer les manuscrits par familles, comme on a fait avec un si grand succès pour le Nouveau Testament, pour les Pandectes, et comme M. de Schlegel l'a fait récemment pour le Ramayana ; mais je n'y ai pas réussi, de sorte que j'ai été réduit à me guider, dans chaque cas, selon les circonstances, le style, le sens, et selon le nombre et l'âge des manuscrits.
J'ai tâché de traduire d'une manière aussi littérale qu'il n’a été possible, sans blesser les règles de la langue française ; mais la limite est nécessairement un peu vague, et il y a un peu d'arbitraire dans les concessions que l’on est obligé de faire tantôt au désir de rendre rigoureusement les expressions de l'original, tantôt aux exigences de la langue de la traduction. Mon intention a toujours été de donner à l'expression exacte du sens la préférence sur l’élégance du style. Quand j'ai ajouté des mots pour compléter le sens d'une phrase, je les ai fait mettre en italique.
[1] Toutes les Notes du traducteur ne sont pas ici reproduites.
[2] Tous les écrivains qui ont traité de l'histoire de la poésie persane, tant orientaux qu'européens, donnent à l'ouvrage de Danischwer Dihkan le titre de Basitan-nameh (vieux livre), qui est emprunté au passage de Firdousi cité page vi, et à quelques passages semblables où le poète parle d'un ancien livre. Mais il est évident que Firdousi ne veut pas donner le titre d'un livre en disant un livre des temps anciens, et d'ailleurs cette phrase ne s'applique pas au livre de Danischwer Dihkan, mais à celui dont les fragments, selon le récit de Firdousi, avaient fourni la matière pour la composition de l'ouvrage de Danischwer. Il me semble qu'il ne peut y avoir aucun doute que le véritable titre de la collection de Danischwer nit été celui que j'ai indiqué. Aboulfaradj-al-Warrak, dans son Kitab al-Fihrist (voyez Notices et Extraits, t. X, p. 266), donne la liste des titres originaux des ouvrages qu'Ibn-al-Mokafifa avait traduits du pehlewi. Le premier de ces ouvrages est le Khodaï-nameh ; or khodaï signifie roi en pehlewi ; voyez le Boundehesch, manuscrit de la Bibliothèque royale, t. III, p. 38; t. VII, p. 38, ag; XVII, 1, 10, là, etc. Aboulfaradj ajoutée ce titre les mots traitant des vies (des rois). Firdousi traduit ce titre fort exactement par Livre des rois; mais il ne donne nulle part le titre original du Khodaï-nameh ; et il n'est pas difficile de deviner la raison de cette omission en apparence si singulière. Le mot khodaï, seigneur, qui sous les Sassanides avait été appliqué aux rois» ne servait, depuis l'introduction de l'islamisme, que pour désigner Dieu; de sorte que Firdousi pouvait craindre qu'on ne lui reprochât comme un blasphème le titre de la source principale de son ouvrage, et toute accusation d'impiété, si frivole qu'elle fut, était grave pour le poète au milieu de la cour jalouse et bigote de Mahmoud.
[3] Voyez sur la vie de Firdousi les deux préfaces persanes dont j'ai parlé plus haut; la notice donnée par Djami dans le Beharistan, et imprimée dans l’Anthologia Persica (Vienne, in-4) ; la biographie de Firdousi par Daulet schah traduite par S. de Sacy, dans les Notices et Extraits, t. IV, p. 230 et suiv. (Le texte de cette biographie a été publié par Vullers dans sa traduction allemande de mes Fragments relatifs à Zoroastre, Fragmente, etc. von Vullers, 1831.) Parmi les biographies écrites par des Européens, voyez surtout Atkinson, dans la préface de son Sohrab, Calcutta, 1813, in 8; de Hammer, dans son ouvrage intitulé : Geschichte der schönen Redekunste Persiens, 1816, et dans un article inséré dans le t. IX des Wiener Jahrbücher; la préface anglaise de Macan dans son édition du Shahnameh of Firdousee, Calcutta, 1839; un article biographique inséré dans le Rétrospective Review, que je ne connais que par une traduction publiée dans la Revue britannique de juillet 1887; et un article inséré dans Cochrane's foreign quarterly Review, n° 1, 1835.
[4] On place ordinairement cette scène dans un jardin où Firdousi se serait arrêté avant d'entrer dans la ville de Ghaznin, et où il aurait trouvé les trois poètes occupés à boire et à rimer. Je préfère la version de cette anecdote que donne la préface n 1, selon mon manuscrit n° 4, fol. 8 v°. Un pareil défi était tout à fait dans l'esprit de la cour lettrée de Ghaznin.
[5] Cette anecdote est confirmée par une autre qu'à son tour elle sert à éclaircir. Lorsque Mahmoud, l'an 420 de l'hégire, se fut rendu maître de la personne de Rustem fils de Fakhr-al-daulet, il lui demanda s'il avait lu le Livre des rois; le prisonnier répondit affirmativement. Alors le roi lui demanda s'il y avait trouvé un exemple de deux rois gouvernant le même pays ; Rustem répondit qu'il n'y avait rien trouvé de pareil. Quelle folie, dit Mahmoud, t'a donc poussé à venir dans mon camp? et il le fit jeter dans les fers, où il resta jusqu'à sa mort. (Voyez Price, Muhammedan History, t. II, p. 368.) Plusieurs savants ont douté que l'ouvrage de Firdousi put s'être répandu assez vite pour autoriser Mahmoud à faire une pareille question. Mais on comprend bien que Mahmoud, qui savait avec quelle faveur Rustem avait accueilli les épisodes du Livre des rois, et qui avait été si jaloux du patronage accordé à Firdousi par le prince deïlémite, ait trouvé irrésistible la tentation de se servir de ce livre même pour motiver la condamnation de son ennemi.
[6] Kamous le Keschanide envoya Aschkebous provoquer au combat les Iraniens. Rehham le combattit du côté des Iraniens, mais il finit par s'enfuir sur la montagne. Thous irrité voulut aller lui-même se mesurer avec Aschkebous; mais Rustem lui dit : Tu es le chef de l’armée, pourquoi combattrais-tu en personne? Maintiens l'armée dans sa position pendant que je me battrai avec Aschkebous : Garde, selon la coutume, le centre de l’armée, et moi je vais combattre à pied. Ensuite il s'avança à pied contre Aschkebous et lança une flèche contre son cheval. Le cheval tomba, et Aschkebous, qui se trouvait à pied, lança une flèche contre Rustem, qui, à son tour, le frappa d'une flèche dans la poitrine et le tua.
[7] Selon d'autres, il en repartit, après quatre ans de séjour, pour la ville de Thous, où il passa aussi quatre ans, au bout desquels il revint à Ghaznin (voyez Daulet schah) ; mais ce récit n'a rien de vraisemblable, car le poète aurait sans doute mentionné cette circonstance dans un des nombreux passages de son livre où il parle de lui-même.
[8] Les Karmathes étaient une secte qui exerça une grande influence dans le IIIe et le IVe siècle de l’hégire. Ils expliquaient le Coran allégoriquement et étaient à peine considérés comme musulmans. Firdousi ne faisait réellement pas partie de cette secte; mais cette accusation était une chose très grave pour lui qui était déjà suspect d'hérésie.
[9] Je donne ici la satire d'après mon manuscrit nº 5, qui se rapproche beaucoup du manuscrit de la Bibliothèque royale n° 229, et de celui que Macan a suivi dans sa préface persane, p. 63-66. D'autres manuscrits contiennent des rédactions de celle pièce, les unes beaucoup plus courtes, les autres beaucoup plus longues; j'en possède une qui n'a que trente distiques, et une autre qui en a cent soixante.
[10] Firdousi répète ici la déclaration de son attachement à Ali presque dans les mêmes termes qu'il avait employés dans la préface du Livre des rois, et qui avaient été le prétexte des accusations d'hérésie qu'il avait eu à subir.
[11] C'est un nombre rond, car les meilleurs manuscrits du Livre des rois ne contiennent que cinquante-trois à cinquante-quatre mille distiques. Il est vrai que dans quelques manuscrits on en compte soixante mille; mais ils sont enflés par des interpolations très considérables, tirées d'autres poèmes épiques, comme nous verrons plus tard.
[12] Bouin-tan, au corps d'airain, est un surnom d'Isfendiar fils de Guschtasp.
[13] Ceci est évidemment une allusion à Hasan Meïmendi.
[14] On a va plus haut le mot de Mahmoud auquel Firdousi fait allusion dans ce passage.
[15] Le père du sultan avait été, dans l'origine, esclave d'Alptequin, général au service de Nouh le Samanide.
[16] L'expression dont se sert Firdousi signifie littéralement, neuf dans neuf, et trois dans quatre ; je pense qu'elle est empruntée à un jeu. Je n'ai pas rencontré autre part cette singulière locution, de sorte que je ne puis en donner le sens que par conjecture.
[17] Ceci est une allusion à l’expression dont s'était servi Hasan Meïmendi à l’occasion du payement de Firdousi en argent au lieu d'or.
[18] Selon Daulet schah, il resta encore un mois caché à Ghazoin, ce qui est peu vraisemblable, se réfugia ensuite chez Abou’lmaani, marchand de livres à Herat, et ne partit pour le Mazenderan que lorsque la proclamation du sultan contre lui l’eut forcé de quitter le Khorasan. Selon l’auteur de la grande préface, il passa d’abord dans le Kouhistan; maison verra plus bas que son séjour dans cette province dut précéder immédiatement son retour à Thous ; et les fragments poétiques insérés dans cette préface même prouvent que c'est dans le Mazenderan que Firdousi se rendit d'abord : Firdousi ayant quitté Ghaznin, se rendit dans le Mazenderan.
[19] Dauletschah et les différents manuscrits de la préface n i écrivent avec une étrange confusion les noms de ce prince. Mais il n'y a guère de doute que ce ne fût Kabous, appelé Schems-almaali, fils de Weschmguir, qui fut déposé quelques années plus tard (en 403 de l'hégire).
[20] C'est le seul des outrages de Firdousi composés postérieurement au livre des rois qui se soit conservé ; mais il est fort rare, et je n’ai pu m’en procurer que le commencement, que je dois à l’amitié de M. Kasimirski. Macan le possédait; mais je ne sais pas ce que le manuscrit est devenu depuis la mort du propriétaire.
[21] Macan conclut de cette dédicace que le poème n'a pas pu être écrit à Bagdad. Mais il est très possible que Firdousi l’ait dédié successivement deux princes, ou qu’il l'ait achevé à Ahwaz. Il serait intéressant; tous beaucoup de rapports, de connaître ce poème, car il est probable que Firdousi, selon son habitude, y parlait de temps en temps des circonstances qui lui étaient personnelles, et y donnait le fil de» ses aventures postérieures à la satire.
[22] Il y avait évidemment une tradition généralement répandue, que quelques vers de Firdousi que Mahmoud aurait vus ou entendus inopinément avaient contribué à le taire ralentir de la persécution du poète; mais les détails que donnent les différentes biographies varient extrêmement. Selon Daulet schah (chez Vullers), ce serait Hasan Meïmendi qui aurait récité au sultan deux distiques de Firdousi au sujet d'une lettre que Mahmoud adressait au roi de Dehli; selon Djami (Beharistan, manuscrit de la Bibliothèque royale 308, fol. 80 v°), ce seraient d’autres vers que Hasan aurait récités pendant une chasse. Daulet schah présente, on général, Hasan Meïmendi comme le protecteur de Firdousi, ce qui est inconciliable avec le récit des deux préfaces et avec les vers cités dans la préface n° i.
[23] La préface n° 2 raconte autrement la disgrâce de Hasan : Elle dit que Mahmoud, aussitôt que les gens qu’il avait envoyés à la poursuite de Firdousi furent revenus sans l’avoir trouvé, rassembla ses ministres et leur déclara que cette affaire honteuse était leur œuvre, les condamna à payer les 100.000 dinars dus au poète, et les bannit de la ville. (Manuscrit de la Bibliothèque royale 278, fol. 4 v°.)
[24] Il ne manque certainement pas de fautes historiques, chronologiques et géographiques dans le Livre des rois; mais elles sont, pour la plus grande partie, de la classe de celles qui sont inhérentes à toute tradition orale qui a vécu longtemps dans la bouche d'un peuple. Elles ne peuvent pas être mises sur le compte du poète, et ne sont pas dues à l'influence des idées musulmanes.
[25] L'auteur du Modjmel-al-Tewarikh dit : Les philosophes grecs oui beaucoup de traditions sur la sagesse, les discours et le tombeau d'Alexandre; elles ont été traduites en arabe, et Firdousi en a mis une partie en vers, comme je dirai en son lieu. (Manuscrit persan 62, fol. 39 v°.)
[26] Le Modjmel-al-Tewarikh, p. 21 v° et suiv., contient un extrait d’un de ces anciens ouvrages persans, orné de vignettes ; c’est le Livre des portraits des rois Sassanides. C'est probablement le même ouvrage que Massoudi a trouvé à Istakher. Voyez Saint-Martin, article Masoudi, dans la Biographie universelle. Les Persans ont imité cet usage de leurs ancêtres dans les peintures dont ils ornent les manuscrits des poèmes épiques et des romans, ce qui doit être un grand scandale aux yeux des musulmans orthodoxes.
[27] Cette légende est en vers.
[28] C’est-à-dire le royaume du midi.
[29] Tu es de la même ville et du même métier que lui. (Guerschasp-nameh, p. 15.) Et un peu plus loin : C’est ainsi que Thous a produit deux poètes.
[30] On s'occupe beaucoup depuis quelque temps de l'histoire de l’origine de la chevalerie, et cette critique du caractère de Rustem peut servir à prouver que ce n'est pas chez les Persans qu'il faut là chercher; l'auteur du Guerschasp-nameh ne reproche à Rustem que des malheurs, pendant qu'il ne blâme point les trahisons suivies du succès que Firdousi raconte de lui, comme celles qui amenèrent la mort de Sohrab et d’Isfendiar. Les héros et leurs poètes manquaient également de sentiments chevaleresques.
[31] Je remarque, en passant, que tout en critiquant Firdousi, il ne lui reproche nulle part de s'être éloigné de la tradition, reproche qu'il ne lui aurait certainement pas épargné s'il avait eu un prétexte pour le lui adresser.
[32] On a cru que Sindbad était un conte arabe; mais il est d'origine persane, et a été écrit sous les Arsacides. Le Modjmel-al-Tewarikh le cite (fol. 61 r) parmi le petit nombre d’ouvrages composés sous cette dynastie. Les Persans ont été de tout temps un peuple peu maritime; mais nous savons pourtant par les auteurs romains qu'il y avait un commerce actif de l’embouchure du Tigre à la côte de l'Inde et à Ceylan ; ce qui explique l'existence de contes populaires sur les merveilles des iles.
[33] Ce ms. est copié par un Perse, comme indique la formule : au nom du Dieu clément et miséricordieux, qui remplace le Bismillah des musulmans. C'est une circonstance très remarquable, que la plupart des poèmes épiques persans, à l'exception du Livre des rois, ne se soient conservés que dans des copies de cette espèce. Il est probable que l'inélégance de leur style les aura fait abandonner de bonne heure par les musulmans, pendant que les Perses s’y attachaient comme à des souvenirs de la gloire de leurs ancêtres, dont ils se croyaient et se croient encore les seuls héritiers légitimes, et qu'ils ne désespèrent pas de faire revivre.
[34] Ce petit livre a le caractère légendaire commun à toutes les traditions conservées par les Perses. Il était tout naturel qu’une secte persécutée s'attachât à conserver plutôt la partie légendaire que la partie épique de ses souvenirs. C'est ainsi que la Vie de Zoroastre, écrite en vers persans, et dont Anquetil a donné des extraits, est toute mythologique, de même que les traditions relatives à Thahmouras, qui se trouvent dans l'appendice au Minokhired, et les récita de plusieurs aventures arrivées aux Perses après la chute de l'empire persan. Il n'y a que l’Histoire de la fuite des Perses dans laquelle prédomine le caractère historique. Je remarque ici, en passant, qu'outre la rédaction connue de ce dernier livre, il en existe une autre beaucoup plus étendue, et dont la première n'est que l'extrait. Je possède une partie de cette seconde rédaction, que je ferai connaître autre part.
[35] Les musulmans l'appellent l’Esprit fidèle, et se croient placés particulièrement sous sa protection. Voyez Coran, chapitre ii, verset 92 (édition de Flügel), et Sale, chapitre ii, verset 97.
[36] On trouve des manuscrits portant le titre de Rustem-nameh, mais ce ne sont que des copies de la partie du livre des rois qui contient l’histoire de Rustem.
[37] Il y a quelques autres poèmes qui portent pour titres des noms tirés de l’histoire de Perse; mais ils n’appartiennent pas même au roman historique : tel est le Djemschid-nameh (manuscrit de la Bibliothèque royale, fonds Ducaurroy), qui na rien de commun avec les traditions relatives à Djemschid, et dont le héros, fils d'un roi de la Chine, est entièrement de l’invention de l'auteur.
[38] Presque chaque paragraphe commence par ces mots, Abou Thaher raconte; » ce qui me paraît prouver que la rédaction persane que nous avons n'est que la traduction ou l'abrégé d'un original arabe.
[39] Il y a deux autres classes de poèmes persans qui ont pris la forme épique, mais que leur sujet et l'esprit dans lequel ils sont conçus ne permettent pas de comprendre parmi les véritables épopées : ce sont ceux qui traitent de l’histoire légendaire de la famille du Prophète, et ceux qui roulent sur la vie de quelques rois modernes de la Perse, contemporains ou à peu près contemporain de leurs auteurs. La première classe est assez nombreuse, et les ouvrages qui la corn posent ne manquent pas d'intérêt : tels sont le Saheb-Kiran-nameh, on la Vie de Hamcah Ben-Abdou’lmotleb, oncle de Mohammed, le Djami'l-Welayet, ou la Vie de Mohammed (par Naseby); le Misbah-al-Arwah, la Lampe des esprits, vie du Prophète; le Seïri-nouri-mouloud, la Marche de la lumière des créatures, autre vie du Prophète (par Abou'lhosëin ; le Hamleki-Heïder, le Combat du lion, vie d’Ali, gendre du Prophète (par Mirza-Refia Basil); le Khawer-nameh, le livre de l'occident, vie d'Ali (par Ibn-Hischam ), etc. Tous ces ouvrages sont étrangers à l’épopée persane par leur sujet même, qui n'a rien de national, et ils ne doivent pas nous occuper ici.
A la seconde classe appartient le Timour-nameh, de Halefi, c'es dire la vie de Timour. Le même auteur avait commencé une histoire en vers épiques de Schah Ismail, fondateur de la dynastie des Sofis ; mais il ne l’acheva pas. Cette tâche fut reprise par Mirza-Katim Gunabadi, qui composa, sous le titre ambitieux de Schah-nameh, une vie de Schah-Ismaïl, faible imitation du Livre des rois de Firdousi. Enfin le dernier roi de Perse, Feth-Ali-Schah, fit composer, sous le litre de Schehinschah-nameh, Livre du roi des rois, sa propre biographie. On voit, dans la bibliothèque de la Compagnie des Indes, un exemplaire de cet ouvrage orné de vignettes à l'instar des manuscrits de Firdousi. C'est une caricature grossière et presque burlesque du Livre des rois, dans laquelle le bulletin officiel remplace la tradition, et où la flatterie d’un poète de cour tient lieu de gloire nationale. (Hammer a donné des fragments du texte et une analyse du Schehinschah-nameh dans les Mines de l’Orient, t. VI, et dans les Wiener Jahrbücher, t. VI.) On peut classer dans la même catégorie le plus récent des poèmes persans sous forme d'épopée, le George-nameh, par le mollah Firouz-Ibn-Kaous, grand-prêtre des Perses de Bombay. C'est l'histoire de la conquête de l'Inde par les Anglais, dans le mètre de Firdousi ; elle peut passer, à en juger par les extraits et par la table des matières qui ont été imprimés, pour une gazette versifiée aussi exacte que prosaïque. (Voyez une brochure intitulée: Contents of the George-nameh, composed in verses in the Persian language by the late moollah Fyrooz bin Caoos, and to be printed by his nephew and successor Moollah Rustom bin Kaikobad; Bombay, 1836, in-4°, p. 80 et IX.) L'auteur du George-nameh ne manquait ni de savoir ni de talent, mais il n'a point fait preuve de bon sens dans cette œuvre étrange. Il est évident que tous ces ouvrages ne peuvent être que des chroniques ou des amplifications de rhétorique, et qu'il manquait à leurs auteurs la seule chose indispensable à tout poème épique, des traditions, ce qui me dispense d'en parler ici plus longuement.