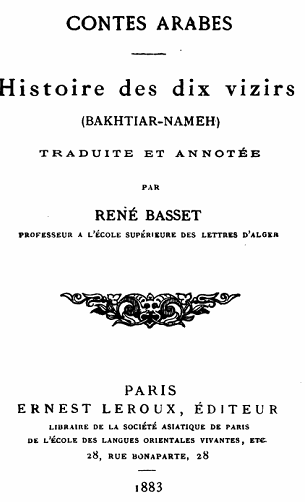
ANONYME
BAKHTIAR NAMEH -
HISTOIRE DES DIX VIZIRS (1ère partie) (2ème partie)Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
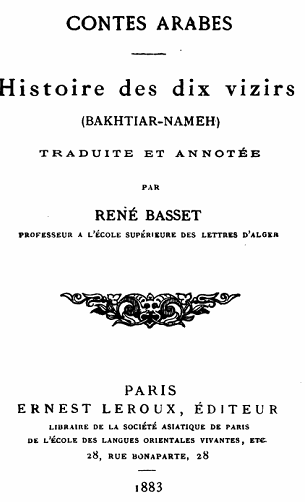
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
HISTOIRE DES DIX VIZIRS

 'étude
du
folklore, pour employer le terme
désormais consacré, est devenue de
nos jours une véritable science,
et, pour ne parler que des
contes, chaque année voit paraître
plusieurs recueils de récits,
occidentaux et orientaux, qui viennent
augmenter la collection, déjà si
considérable et pourtant si
incomplète encore, de ces documents
autrefois dédaignés. Tous n'ont pas
cependant la même importance, et
il est utile de distinguer
entre les contes recueillis aujourd'hui
pour la première fois et ceux
qu'une rédaction écrite a modifiés
en leur donnant une forme plus
ou moins littéraire.
'étude
du
folklore, pour employer le terme
désormais consacré, est devenue de
nos jours une véritable science,
et, pour ne parler que des
contes, chaque année voit paraître
plusieurs recueils de récits,
occidentaux et orientaux, qui viennent
augmenter la collection, déjà si
considérable et pourtant si
incomplète encore, de ces documents
autrefois dédaignés. Tous n'ont pas
cependant la même importance, et
il est utile de distinguer
entre les contes recueillis aujourd'hui
pour la première fois et ceux
qu'une rédaction écrite a modifiés
en leur donnant une forme plus
ou moins littéraire.
L'histoire de ces derniers a déjà été entreprise avec succès, et, bien que le sujet soit loin d'être épuisé, les travaux de De Sacy, de Loiseleur de Longchamps et enfin de Benfey sur le Pantchatantra, ceux de M. Comparetti sur le cycle de Sindibâd, de M. Kirpitchnikov sur le Barlaam et Josaphat, de M. Pertsch sur le Touti-Nameh, etc., ont montré quelle influence l'Orient a exercée, au moyen âge, sur les littératures de l'Occident. On a su retrouver le chemin suivi, depuis l'Inde jusqu'à la France, par « cette longue caravane de récits », déterminer les stations faites par elle dans les littératures pehlvie, syriaque, arabe, hébraïque, persane, turke, grecque, moghole, latine, espagnole, française, slavonne, etc.; et, si quelques-unes de ces étapes ne nous sont connues que de nom, la marche générale est aujourd'hui hors de doute.
On a été plus loin : après avoir établi d'une manière irréfutable que le bouddhisme est le point de départ de tous les cycles que nous connaissons, on s'est demandé si les missionnaires de Sakyâ-Mouni ont inventé les apologues dont ils appuyaient leurs prédications, ou s'ils n'ont fait qu'employer, en les modifiant, les récits populaires qui avaient cours-de leur temps. C'est ici que les deux branches du folklore se réunissent : la branche cultivée et la branche populaire. Les découvertes récentes faites dans les littératures égyptienne et assyrienne nous obligent à reporter plus haut que le ve siècle avant notre ère l'invention des romans : la publication des contes zoulous, berbères, celtiques, germaniques, slaves, a modifié la théorie exposée pour la première fois par Benfey. Retrouvera-t-on une source commune, placée bien près des temps préhistoriques, ou faudra-t il admettre que les contes ont pris naissance simultanément sur plusieurs points différents? C'est ce qu'il est impossible de préjuger aujourd'hui : les éléments nécessaires à la discussion de cette question sont loin d'être rassemblés. On a seulement établi qu'outre les ressemblances créées par la communauté d'origine ou les emprunts, il existe des formules ou traits communs à divers groupes, et cette découverte a fait faire un pzs de plus à la solution de ce problème.
Dans leur marche d'Orient en Occident, les familles de contes ont été souvent le point de départ de nouveaux cycles. C'est ce qui est arrivé pour le recueil que je traduis aujourd'hui. Le savant mémoire de M. Comparetti a exposé les modifications et les remaniements du livre de Syntipas ou Sindibâd-Nameh. De ce tronc partent deux rameaux qui ont eu leur fortune particulière : les Quarante vizirs et le Bakhtiâr-Nameh ou histoire des dix vizirs. Plus tard, ce dernier ouvrage a été compris avec le Sindibâd-Nameh dans une des rédactions des Mille et une Nuits, qui embrasse des cycles d'origine différente. C'est ainsi qu'au xiie siècle le brahmane Somadéva de Kachmir fit entrer dans le Kathasaritsagara ou Vri-hatkatha la plus grande partie des collections de récits qui existaient alors dans l'Inde.
On connaît le sujet du Syntipas : un prince est averti par son précepteur de garder, pendant sept jours, le silence le plus absolu. Il repousse les propositions de sa belle-mère; celle ci l'accuse près de son mari qui ferait mettre son fils à mort si chacun des sept vizirs (des sept sages dans les versions occidentales) ne racontait chaque jour, à tour de raie, une ou deux histoires, grâce auxquelles le supplice est différé. C'est en vain que chaque nuit la reine a recours au même moyen pour arracher une condamnation : celle-ci est révoquée le lendemain, et, le huitième jour, la vérité est découverte. Dans le Bakhtiâr-Nameh, un prince, après diverses vicissitudes, devient le favori de son père qui l'a abandonné aussitôt après sa naissance et ne le reconnaît pas. Les vizirs, au nombre de dix, jaloux du crédit du jeune homme, profitent d'une circonstance pour le perdre dans l'esprit de leur maître. Ce dernier condamne à mort son fils qui, pendant dix jours, échappe au supplice grâce à un récit toujours en rapport avec sa situation. Le onzième jour, il est retrouvé par celui qui l'a élevé et reconnu par le roi qui punit ses ministres.
On voit, en comparant ces deux analyses, que le Bakhtiâr-Nameh s'est arrêté dans son développement. Pour que la symétrie fût complète, comme dans le Syntipas, il faudrait que les vizirs ou la reine, devenue ici leur complice, racontassent au prince des histoires destinées à combattre l'influence produite par celles du jeune homme. Cette particularité tient sans doute à ce que cette branche du Syntipas, d'origine relativement récente, eut moins défaveur que les autres. Nous ne la retrouvons pas, comme le roman des Sept Sages, le Barlaam et Josaphat, le Kalilah et Dimnah, dans les littératures européennes du moyen âge. Bien plus, si quelques traits communs à d'autres groupes se rencontrent dans celui-ci, je n'aurai à signaler qu'un seul conte qui existe, avec ses données essentielles, quoique fort modifié, dans les Quarante vizirs. Je pourrai citer aussi quelques ressemblances de détail, mais bien plus rares que celles qu'on rencontre dans les contes venus par la tradition orale et ceux qui sont passés depuis longtemps dans le domaine de la littérature écrite.
La donnée qui sert de cadre aux onze histoires de ce recueil n'est pas particulière au Sindibâd-Nameh et aux deux cycles qui s'y rattachent : les Quarante vizirs et le Bakhtiâr-Nameh. Dans le Neh Manzer et les Mille et une Nuits, une condamnation à mort est remise de jour en jour grâce à des contes. Il faut toutefois remarquer que, dans les plus anciens récits de ce genre, le nombre des jours funestes est déterminé à l'avance et connu par l'astrologie : cette période dangereuse une fois passée, le danger n'existe plus. Dans les remaniements postérieurs, cette condition a disparu : la porte est restée ouverte aux additions et aux suppressions. Les Mille et une Nuits, par exemple, pourraient être doublées, sans rien changer à l'économie générale du recueil.
J'ai dit plus haut que le Bakhtiâr-Nameh était une branche du Sindibâd-Nameh ; c'est également l'opinion de M. Comparetti. J'ajouterai que cette rédaction a dû prendre naissance en Perse. Outre que, dans la version la plus ancienne, les villes et les pays cités, sauf une ou deux exceptions, appartiennent au plateau iranien; les noms propres : Azâd-bakht, Zâd-chah, Behrédjour, Behréwân, Pehléwân, etc., sont persans. De plus, dans aucune des littératures de l'Inde, il n'existe, au moins à ma connaissance, de recueil qui ait été l'original de ceux que nous possédons sur cette donnée. Dans son Essai sur les fables indiennes, Loiseleur de Longchamps a trouvé des rapports entre le Bakhtiâr-Nameh et l'’Alakeswarâ-Kathâ, contes tamouls cités par Wilson dans son Catalogue des manuscrits du colonel Mackenzie. « Les quatre ministres du roi d'Alakapour, étant accusés faussement d'avoir violé le privilège des appartements intérieurs, prouvent leur innocence et désarment la colère du roi en racontant un certain nombre d'histoires. » Il n'y a ici, comme on le voit, qu'une lointaine ressemblance avec un épisode du cadre du Bakhtiâr-Nameh. Quant au roman des Aventures des quatre derviches et du roi Azâd-bakht, plus connu sous le nom de Bâg o bahar (le Jardin et le Printemps), récemment traduit de l'hindoustani par M. Garcin de Tassy,[1] il n'a de commun que le nom du prince.
On remarquera la relation étroite qui existe entre le cadre du Bakhtiâr-Nameh et les récits qu'il renferme : ce qui est peut-être l'indice du peu d'ancienneté et de l'unité de composition, tandis que les autres cycles, le Pantchatantra, le Syntipas, etc., présentent, au moins dans leur forme actuelle, les apparences d'une œuvre collective, en dépit des noms de Vichnousarman ou du Persan Mousès.
Il n'est pas une situation de l'histoire d'Azâd-bakht et de son fils, qui ne se retrouve dans les récits que celui-ci fait à son père : le marchand infortuné est accusé à tort d'avoir violé les secrets du harem royal (conte I) ; le fils du joaillier, devenu le favori de son frère qui ne le connaît pas, est soupçonné d'avoir voulu l'assassiner et périrait sans la sage lenteur du roi (conte II); Dâdbin épouse Aroua, comme Azâd-bakht avait enlevé Behrédjour (conte V); Abou-Témâm est calomnié par les vizirs jaloux de son crédit (conte VIII); les aventures du fils d'Ibrahim, recueilli par des voleurs, sont aussi surprenantes que celles du fils d'Azâd-bakht (conte IX); enfin la femme du roi de Roum est l'objet des soupçons de Qaïsar, ignorant que Mélik chah est le fils que la reine a eu d'un premier mariage (conte X).
Il me reste à parler des différentes versions de cet ouvrage et en même temps à essayer de déterminer la date vers laquelle il a été composé. Comme je l'ai déjà fait observer, il n'existe point, dans les langues de l'Inde, de version qui serait aux textes postérieurs ce qu'est le Pantchatantra[2] au Kalilah et Dimnah et à ses nombreuses imitations ; le livre de Siddhapatha, aujourd'hui perdu, aux diverses branches du Syntipas; le Vétala-pantchavinsati aux contes moghols et kalmouks de Siddhi-Kur; le Sinhasa-nadvatrinsati à l'histoire d'Ardji-Bordji-Khân ou du Trône enchanté, le Souka-Saptati au Touti-Nameh, etc. On pourrait objecter l'existence d'une version malaie dont un fragment (l'histoire de Behzâd) a été publié par M. Niemann, ce qui semblerait indiquer une traduction dans une des langues de l'Inde. Mais cette histoire dérive du texte persan : si c'est directement ou indirectement, je l'ignore et laisse aux érudits qui s'occupent de malai, le soin de décider si celui-ci a fait des emprunts immédiats ou non à la littérature persane. Même en admettant cette seconde hypothèse, il ne s'agirait toujours que d'une version se rattachant aux recensions persanes, et par conséquent postérieure, comme je le montrerai tout à l'heure.
Le plus important des textes qui nous sont parvenus, mais aussi le moins connu, est celui en langue ouïgoure que renferme un manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne à Oxford. Jusqu'à présent, deux orientalistes seulement en ont publié un extrait et, par une fâcheuse rencontre, ils ont choisi la même histoire, celle du roi Dâdbin.[3] En 1827, A. Jaubert donna dans le Journal Asiatique une Notice et un Extrait de la version turque du Bakhtiar-Nameh, d'après le manuscrit en caractères ouïgours. Abel Rémusat, dans ses Recherches sur les langues tartares, avait reconnu l'écriture, la langue et le sujet de cet ouvrage déjà mentionné par Hyde et l'éditeur du dictionnaire de Meninski.[4] En 1832, Davids publia, à la suite de sa Grammaire turke, le facsimilé, la transcription et la traduction du conte déjà déchiffré, édité et traduit par Jaubert. Ce manuscrit, de 294 pages in-f°, est daté du mois de dqou'lh'iddjeh, l’an 838 de l'hégire (1434 de J.-C), l'année du Lièvre, suivant le calendrier ouïgour. Cette copie est donc antérieure à celle des autres textes que nous possédons dans cette langue : le Koudat Koubilik (la Science du gouvernement) composé en 462 de l'hégire (1069 de J.-C.) dont on a un manuscrit daté de 853 de l'hégire (1459 de J.-C), année du Mouton;[5] le Mirâdj-Nameh[6] (histoire de l'ascension de Mohammed) et le Tezkirat ul Evlia (Vies des saints musulmans) dont la copie porte la date du 10 de djoumada second, 840 de l'hégire (1436 de J.C.), l'année du Taureau.[7] Comme la plupart des ouvrages de cette littérature, la rédaction ouïgoure est une traduction d'une version persane, peut être la rédaction originale du Bakhtiâr-Nameh, aujourd'hui perdue et antérieure par conséquent à 1434. D'un autre côté, les textes persans du Sindibâd-Nameh qui servirent sans doute de modèle à notre recueil, datent (deux certainement sur trois) du xive siècle. C'est d'abord la 8e nuit du Touti-Nameh de Nekhchébi, mort en 1321, puis une rédaction en vers, faite en 1375 sur un texte en prose que nous ne possédons plus. On peut donc admettre, sans l'affirmer absolument, que la version originale du Bakhtiâr-Nameh dut être composée dans la dernière moitié du xive siècle. Le style simple et dégagé d'ornements de la rédaction ouïgoure, la première en date que nous ayons, permet de fixer vers cette époque la composition de l'original persan.
A quelle époque ce roman fut il traduit en arabe ? Nous l'ignorons et nous savons seulement qu'il l'était lors de la rédaction du texte des Mille et une Nuits, tel que l'a publié et traduit Habicht. Cette recension fut la première connue. Dans sa Bibliotheca Orientalis, M. Zenker cite les Onze journées, conte arabe, par Galland, Paris, in-16, s. d. C'est probablement le Bakhtiâr-Nameh, et la traduction fut faite sans doute sur le manuscrit 1790 du supplément arabe de la Bibliothèque Nationale. Cette version fut suivie d'une autre, considérablement modifiée et défigurée, publiée par Dom Chavis et Calotte, d'abord dans les Nouveaux contes arabes et ensuite dans le Cabinet des Fées, et traduite en allemand sous le titre de Die Eilf Tage[8] en 1789, Une autre version dans la même langue, due à L. A. W(ichmann), parut l'an suivant à Dresde et à Leipzig et fut rééditée par Bertuch dans la Blaue Bibliothek der allen Nationen[9] ». En 1792, une traduction anglaise de l'œuvre de D. Chavis et Calotte fut publiée à Edimbourg, et ensuite dans les Arabian Tales. Enfin Knös, après en avoir donné un fragment dans une thèse de doctorat,[10] fit paraître en 1807, à Göttingen, le texte arabe qu'il avait écrit à Paris, sous la dictée d'un Tunisien, nommé Mardoche (ou plus correctement Mourâd En Naddjâr), d'après un manuscrit du Caire, appartenant à Moustafa-Efendi.[11] C'est d'après cette édition que j'ai fait ma traduction. Outre les formes vulgaires qu'il renferme, cet ouvrage est rempli de fautes d'impression, comme, du reste, les autres publications de Knôs. Cette recension s'accorde absolument avec l'édition que donna Habicht dans les Mille et une Nuits,[12] ainsi qu'avec la version ouïgoure, mais il s'écarte sensiblement du groupe persan. Dans sa Continuation des Mille et une Nuits, Caussin de Perceval donna une nouvelle traduction du texte arabe que R. Ch. Rasch fit passer en danois en 1828. Les versions française et latine annoncées par Knös n'ont pas paru.
Une autre recension arabe existe en manuscrit au British Museum, et je dois à l'obligeance de M. Zotenberg de pouvoir donner ici le titre des contes dont quelques uns paraissent différents de ceux que nous connaissons :
1° Histoire du marchand de Perse et de ses aventures;
2° Histoire du marchand et de ses deux fils;
3° Le juste Abou Sâber le Dihqân et comment il sortit du caveau ;
40 Histoire de la reine Djihânah, fille du roi Safouân, maître de l'Oman ;
5° Histoire de la pieuse Aroua-Khatoun et de ses aventures avec le roi Dâdbin et ses vizirs;
6° Histoire du roi Behiâmdjour, fils de Djondi-Sabour, avec Qaïsar, le roi de Roum;
7° Histoire du roi Bakht-Azmâ le Persan ;
8° Histoire du roi Beïdâd et de son fils Behrâd ;
9° Histoire du roi Ilân-Châh et de ce qui lui arriva avec Abou-Temâm, à cause de ses vizirs envieux ;
10° Soleimân-Châh;
11° Berhin-Châh.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que les recensions persanes que nous possédons sont postérieures, au moins pour la rédaction, au texte arabe. Le vague des expressions, les ornements inutiles et les fautes de goût, défauts communs aux ouvrages de ce genre, ne manquent pas ici. Une seule version, publiée et traduite par Ouseley, est plus sobre de développements. Aussi a-t-elle été l'objet de la critique de Lescallier qui a remanié, comme il l'avoue, trois textes pour donner « une rédaction plus suivie, plus complète et plus ordonnée[13] ». Il s'est servi, outre l'édition de son prédécesseur, de deux manuscrits de la Bibliothèque nationale.[14] C'est d'après l'un d'eux que M. Kazimirski a donné en 1839 un texte lithographié.[15] La marche et le nombre des histoires sont les mêmes dans ces trois recensions. Une nouvelle traduction française fut publiée par Gauthier dans ses Mille et une Nuits.
Voici le tableau comparé des trois principales rédactions du Bakhtiâr-Nameh. Je n'ai pu y faire figurer le texte ouïgour dont je ne connais que le cinquième récit :
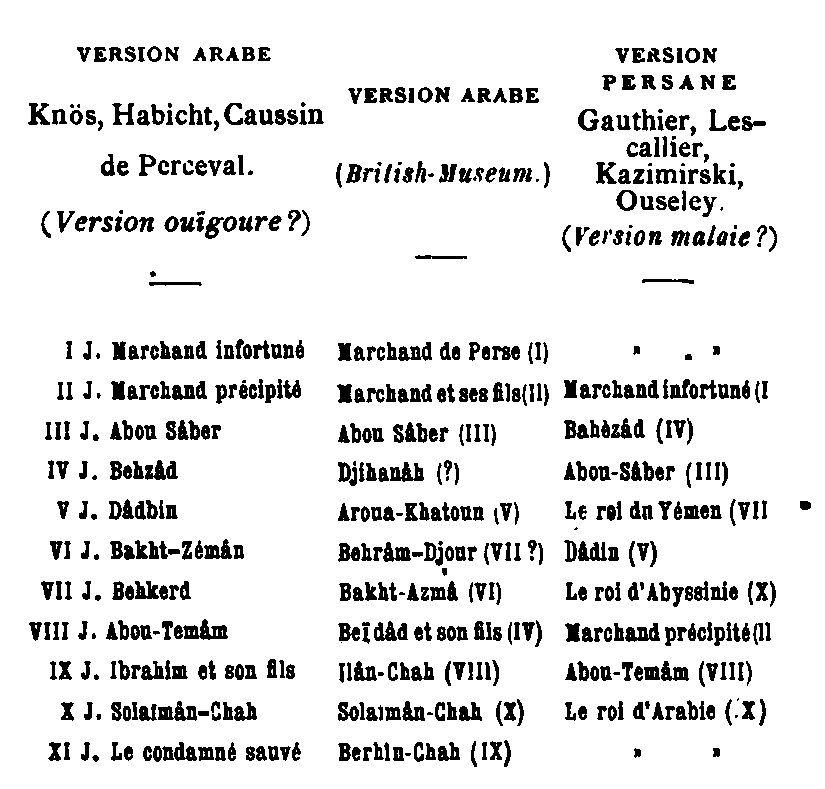
Les numéros entre parenthèses indiquent l'ordre du texte arabe d'après Knös, etc.
En résumé, le Bakhtiâr-Nameh paraît avoir été composé en persan (recension aujourd'hui perdue) dans la seconde moitié du xive siècle. Il passa de là en ouïgour (xve siècle) et probablement en arabe (recensions de Knös et du British Muséum). Dans la dernière moitié du xve siècle, il fut remanié en persan, soit d’après l’original, soit d’après un texte arabe, et sur cette version fut faite la traduction malaie.
Lunéville, 13 octobre 1882.
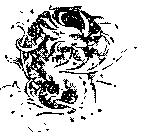
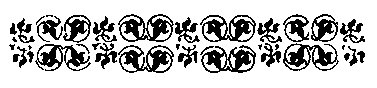
Arabian tales. London, 1794, 3 vol. in-4°.
Bag o bahar, Le Jardin et le Printemps, poème hindoustani, traduit en français par Garcin de Tassy. Paris, 1878, gr. in-8°; forme le tome VIII des Publications de l’Ecole des langues orientales.
The Bakhtyâr Nameh or story of the prince Bakhtyâr and the ten vizirs, a serie of persian tales from a mss. in the collection of sir W. Ouseley. London, 1801, 1 vol. gr. in-8° (texte persan et traduction anglaise).
Bakhtiar-Nameh, ou le favori de la fortune, conte traduit du persan par Lescallier. Paris, an XIII, 1 vol. in 8°.
Bakhtiar-Nameh, texte persan, autographié (par M. Kazimirski). Paris, gr. in-8°, 1839.
Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes, extrait du Mo'djem El Bouldan de Yaqout... par C. Barbier de Meynard. Paris, I. L, gr. in-8°, 1861.
Comparetti, Ricerche intorno al libro di Sindibâd. Milano, gr. in-4°, 1869. — Extrait des Memorie del R. Istituto Lombardo di Science e Lettere, vol. XI, « della seria ».
Corani textus arabicus, éd. Fluegel. Lipsiae, 1 vol. in-4°, 1834.
Mœurs et coutumes de l'Algérie, par le général E. Daumas. 3e édition. Paris, 1 vol. in-18 jés., 1858.
A. Lumley Davids, Grammaire turke, traduite de l'anglais par Mme Sarah Davids Londres, 1836, 1 vol. in-4°.
Die Eilf Tage, neue arabische Märchen, nebst andern Blumen der asiatischen Literatur. Iéna, 1789, 1 vol. in-12.
Dozy, Catalogus codicum orientalium bibliothecœ acad. Lugdun. Batav. Leyde, 1851-1877, 6 vol. in-8°.
L. Dubeux, La Perse, forme le t. II de l'Asie dans la collection de l'Univers pittoresque. Paris, 1 vol. in-8°, 1841.
Garcin de Tassy, Rhétorique et prosodie des langues de l'Orient musulman. 2e édition. Paris, 1 vol. in-8°, 1873.
D. Pascual de Gayangos, Escritores en prosa anteriores al siglo xv ; forme le t. LI de la Bibliothèque Rivadaneyra. 1 vol. gr. in-8°. Madrid, 1859.
Hérodote, Histoires (Bibliotheca Teubneriana scriptorum graecorum), éd. Dietsch. Lipsias, 1874, 2 vol. in-12.
Histoire Auguste, collection des auteurs latins publiée sous la direction de M. Nisard. Paris, 1855, 1 vol. in-4°.
Historia decem vizirorum et filii regis Azad-bakht, éd. G. Knös. 1 vol. in-12. Göttingae, 1807.
Cl. Huart, Anîs El 'Ockchâq, traité des termes figurés relatifs à la description de la beauté, par Cheref Eddîn Râmi; forme le 25e fascicule de la Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. 1 vol. gr. in-8°. Paris, 1875.
A. Jaubert, Notice et extrait de la version turque du Bakhtyâr-Nameh. Paris, 1827, in-8°.
Kalilah et Dimnah, texte arabe. Boulaq, 1 vol. in-4°.
Knös, Disquisitio de fide Herodoti.... Adnexum est specimen sermonis arabici vulga-ris seu initium historiœ jilii regis Açadbakht, e cod. inedito typis descriptum et in latinum conversum. GSttingae, 1805, in-4°.
La Fontaine, Fables.
Loiseleur de Longchamps, Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe. Paris, 1838, in-8°.
Maçoudi, Les Prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris, 9 vol. in-8°, 1861-1877.
Le comte de Marcellus, Chants populaires de la Grèce moderne. 1 vol. in-12. Paris, 1860.
G. Maspero, Les Contes populaires de l'Egypte ancienne; forme le IVe volume de la Collection des littératures populaires. 1 vol. in-16. Paris, 1882.
Les Mille et un Jours, contes persans, traduits en français par Pétis de Lacroix. Edition du Panthéon littéraire. Paris, 1 vol. gr. in-8°, 1843.
Les Mille et une Nuits, texte arabe. Boulaq, 2 vol. in-4°.
Tausend uni eine Nacht, arabisch, éd. Habicht. Breslau, 1825-1843, 12 vol. pet. in-8°.
E. Gauthier, Les Mille et une Nuits. Paris, 1823, in-8° (t. VI).
Nouveaux contes arabes ou supplément aux Mille et une Nuits, suivis de mélanges de littérature orientale, par M. l'abbé *** (D. Chavis et Cazotte). Paris, 1788, 3 vol. in-12.
Plutarque, Vie de Flaminius (Bibliotheca Teubneriana scriptorum Grœcorum), éd. Sintenis, t. II.
Plutarque, Vie de Pompée, id., t. III. Niemann, Maleische Lesebock. 2e édition. S'Gravenhage, 1876, in-8°.
A. de Puibusque, Le comte Lucanor, Apologues et Fabliaux de D. Juan Manuel. Paris, 1854, 1 vol. in-8°.
Le comte de Puymaigre, Les vieux auteurs castillans. Metz et Paris, 2 vol. in-8°, 1861.
Qërq vezir (les Quarante vizirs), ms. turk daté de l'an 975 de l'hégire.
Li Romans des Sept Sages nach der Pariser Handschrift hrsg. von Heinrich Adelbert Keller. Tübingen, 1836, in-8°.
Indian fairy tales collected and translated by Maive Stokes with notes by Mary Stokes
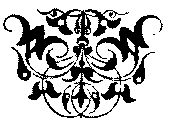
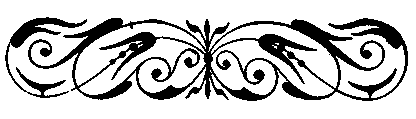
Au nom de Dieu clément et miséricordieux
 N
raconte qu’il existait autrefois un roi du nom d’Azâd-Bakht (Libre
fortune). Sa capitale était appelée Kanim-Modoud[16]
et son royaume s’étendait depuis les frontières du Sedjestan[17]
jusqu’à la mer. Il avait dix vizirs qui administraient ses Etats;
lui-même était un homme de grande science.
N
raconte qu’il existait autrefois un roi du nom d’Azâd-Bakht (Libre
fortune). Sa capitale était appelée Kanim-Modoud[16]
et son royaume s’étendait depuis les frontières du Sedjestan[17]
jusqu’à la mer. Il avait dix vizirs qui administraient ses Etats;
lui-même était un homme de grande science.
Un jour qu'il était parti pour la chasse avec quelques courtisans, il aperçut un eunuque à cheval, tenant dans sa main les rênes d'une mule qu'il conduisait, et sur laquelle était une litière de brocard d'or, surmontée d'une couronne incrustée de perles et de diamants. Une troupe de cavaliers l'escortait. A cette vue, le roi se sépara de ses compagnons, alla vers le cortège et demanda : « A qui est cette litière, et qui renferme-t-elle ? » L'eunuque qui ne le connaissait pas lui répondit : « Elle appartient à Isfehbed,[18] vizir du roi Azâd-Bakht, et renferme sa fille qu'il veut marier au roi Zâd-Chah.[19] » Tandis que l'eunuque faisait cette réponse, la jeune fille souleva un pan du rideau de la litière pour connaître qui parlait et aperçut le prince. Quand celui-ci la vit et quand il contempla sa figure et sa beauté, telles que le conteur n'en a jamais vu de semblables, son cœur fut agité; il s'éprit d'elle et se consuma d'amour.
« Tourne la tête de la mule, dit-il à l'eunuque, et reviens sur tes pas. Je suis le roi Azâd-bakht, et c'est moi qui l'épouserai, car son père Isfehbed est mon vizir et donnera sans peine son consentement. »
« Prince, répondit le serviteur, que Dieu éternise ta vie ! patiente jusqu'à ce que j'informe mon maître : alors tu la recevras de son plein gré : il n'est ni convenable, ni digne de toi de prendre ainsi cette jeune fille; ce serait une insulte pour son père si tu l'épousais à son insu. »
Le roi répliqua : « Je n'ai pas la patience d'attendre que tu sois allé trouver le vizir et que tu sois revenu : ce ne sera pas un affront pour lui si, moi, j'épouse sa fille. »
« Maître, reprit l'eunuque, toute chose précipitée n'est pas de longue durée et ne réjouit pas le cœur : il n'est pas séant que tu enlèves cette jeune fille d'une façon si outrageante ; ne te perds pas toi-même par ta précipitation, car je sais que son père en aura le cœur serré et que tu n'auras pas à te louer de ce qu'il fera. »
« Isfehbed, interrompit le roi, est un de mes serviteurs et de mes esclaves : je n'ai pas à m'inquiéter s'il est mécontent ou satisfait »
Puis il tira la bride de la mule, emmena la jeune fille dans son palais et l'épousa. Elle se nommait Behrédjour.[20]
L'eunuque, suivi des cavaliers, alla trouver le vizir et lui dit : « Maître, tu as passé de longues années au service du roi, sans lui être infidèle un seul jour, et cependant il vient d'enlever ta fille sans ton consentement. » Puis il lui raconta ce qui lui était arrivé avec elle et comment Azâd-bakht l'avait emmenée de force.
Lorsque le père entendit le récit de l'eunuque, il fut saisi d'une violente colère, rassembla un grand nombre de soldats et leur dit : « Tant que le roi ne s'est occupé que de ses femmes, nous n'avions pas à en prendre souci : mais à présent, il vient de porter la main sur notre harem : il faut que nous allions dans un pays où l'on ait pour nous plus de considération. » Puis il écrivit en ces termes à Azâd-bakht : « Je suis un de tes serviteurs et un de tes esclaves : ma fille est une servante à ta disposition. Que Dieu très haut prolonge tes jours et qu'il remplisse tes instants de plaisir et de joie : j'étais déjà tout prêt à te servir, à défendre ton autorité et à repousser tes ennemis; désormais je redoublerai de vigilance, puisque c'est pour moi que je veillerai, à présent que ma fille est devenue ta femme. » Ensuite il lui adressa un envoyé porteur de cadeaux.
Lorsque le messager arriva avec la lettre et qu'il offrit les présents au roi, celui-ci se réjouit fort et ne songea plus qu'à la nourriture et à la boisson. Le premier ministre qui était présent lui dit : « Prince, sache que le vizir Isfehbed est ton ennemi, car son esprit n'a pas été satisfait de ta conduite à son égard ; garde-toi de te contenter du message qu'il t'envoie, de ses paroles affectueuses et de son langage caressant.[21] »
Le roi écouta le discours du grand vizir sans en être préoccupé, et ne se soucia que de manger, de boire, de se divertir et de faire de la musique comme auparavant. Ensuite Isfehbed écrivit des lettres qu'il envoya à tous les émirs, les informa de son aventure avec Azâd-bakht et de l'enlèvement de sa fille et les avertit que le prince les traiterait comme il l'avait traité.
Le conteur continue : Lorsque ces messages arrivèrent dans les provinces, les émirs se rendirent auprès du vizir et lui dirent : « Que s'est-il passé? » Il leur raconta son histoire et celle de Behrédjour. Tous, d'un accord unanime, convinrent de travailler à la perte du roi. Ils marchèrent contre lui avec leurs troupes, sans qu'il en fût informé, sinon lorsque le bruit s'en répandit par tout le pays.
Alors Azâd-bakht dit à sa femme : « Qu'allons-nous faire ? » Elle lui répondit : « Tu es plus instruit que moi et je suis à tes ordres. » Le roi fit préparer deux chevaux rapides, monta sur l'un et la reine sur l'autre[22] : ils prirent autant d'or qu'ils purent, et partirent en fugitifs, pendant la nuit, pour le pays de Kerman.[23] Isfehbed entra dans la ville et se fit reconnaître pour roi,
La femme d'Azâd-bakht était enceinte : la délivrance la surprit auprès d'une montagne, au pied de laquelle les fugitifs s'arrêtèrent, à côté d'une fontaine. Elle mit au monde un garçon pareil à la lune et le revêtit d'un vêtement de brocard brodé d'or dans lequel elle l'enroula. Ils passèrent la nuit dans cet endroit et Behrédjour allaita son fils jusqu'au matin. Son mari lui dit :
« Nous sommes embarrassés par cet enfant, il n'est pas possible de rester ici ; d'un autre côté, nous ne pouvons l'emporter avec nous. Il vaut mieux le laisser ici et partir : Dieu peut lui envoyer quelqu'un qui le recueille et l'élève. »
Ils pleurèrent fort, l'abandonnèrent près de la source, enveloppé dans le manteau de brocard, placèrent près de sa tête mille dinars dans une bourse, remontèrent à cheval et s'enfuirent.[24]
Par l'ordre du Dieu très haut, il existait une troupe de brigands qui, dans le voisinage de cette montagne, avaient détroussé une caravane et pillé ses richesses. Ils vinrent à cet endroit pour partager leur butin et, regardant au pied de la montagne, ils aperçurent ce vêtement de brocard ; ils s'arrêtèrent pour examiner ce que c'était, trouvèrent l'enfant roulé dans cette étoffe, l'or auprès de sa tête, et se dirent, étonnés : « Louange à Dieu ! par quel crime cet enfant est-il ici ? » Puis le chef des brigands le recueillit, pendant qu'ils se partageaient les dinars, le traita comme son fils, le nourrit de lait et de dattes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à sa demeure et s'occupa de son éducation.[25]
Le prince Azâd-bakht et sa femme ne cessèrent de marcher tant qu'ils parvinrent chez le roi de Perse, dont le nom était Kathrou.[26] Celui-ci les reçut avec honneur, les établit dans son plus beau palais et, lorsqu'ils lui eurent raconté leur histoire d'un bout à l'autre, il leur donna une nombreuse armée et des richesses considérables. Azâd-bakht demeura quelques jours chez lui jusqu'à ce qu'il se fût reposé, puis il partit avec ses troupes pour son pays, livra une bataille sanglante à Isfehbed, surprit la ville, vainquit son ennemi et le tua; ensuite il revint dans sa capitale et s'assit sur le trône royal. Lorsqu'il se fut rétabli et que les provinces furent rentrées sous son autorité, il envoya des messagers à la montagne pour chercher l'enfant, mais ils ne le retrouvèrent pas et revinrent l'annoncer au roi.
Quelques années après, lorsque le fils du prince fut devenu grand, il s'associa aux voleurs pour couper les routes et, toutes les fois qu'ils hésitaient, ils prenaient le jeune homme avec eux. Un jour, ils sortirent pour attaquer une caravane dans le Sédjestân, mais elle était composée d'hommes braves, forts et bien approvisionnés. Comme ils avaient appris qu'il existait des brigands dans le pays, ils s'étaient mis sur leurs gardes et avaient augmenté leur nombre. Ils envoyèrent des espions qui leur donnèrent des renseignements sur les voleurs et se préparèrent au combat. A l'approche de la caravane, les brigands fondirent sur elle et il se livra une bataille acharnée. A la fin, les marchands eurent le dessus : ils tuèrent une partie de leurs ennemis; les autres prirent la fuite : parmi les prisonniers se trouva le fils du roi, pareil à une lune de beauté et de grâce. On l'interrogea : « Quel est ton père et comment se fait-il que tu sois avec ces scélérats? » Il répondit : « Je suis le fils de leur chef. » On l'enchaîna et on le conduisit à Azâd-bakht.
À leur arrivée à la ville, cette nouvelle parvint au roi qui ordonna de lui amener ce qui pouvait lui convenir. Lorsqu'ils furent en sa présence, le prince considéra le jeune homme et dit : « A qui est-il? » — « Sire, répondirent les marchands, nous étions sur telle route lorsqu'une bande de voleurs sortit contre nous : nous en sommes venus aux mains, nous les avons battus et pris ce jeune homme. » Lorsqu'on lui demanda : « Quel est ton père ? » il répliqua : « Je suis le fils du chef des brigands. » — « Je désire qu'il m'appartienne, » dit Azâd-bakht. — « Dieu te le donne, ô roi du siècle, répondit le chef de la caravane : nous sommes tous tes esclaves... » Or le prince ne savait pas que c'était son fils. Puis il dédommagea les marchands et fit entrer le jeune homme dans son palais où il resta en qualité de page.[27]
Au bout de quelque temps, le roi, reconnaissant en lui de l'instruction, de l'intelligence et beaucoup de savoir, s'en étonna, lui confia l'administration de son trésor et défendit qu'on n'en tirât rien sans la permission du trésorier. Les vizirs ne purent plus y puiser. Cela dura quelques années : Azâd-bakht ne voyait dans son favori que de la fidélité et du zèle ; tandis que le trésor était autrefois entre les mains des ministres qui en usaient à leur discrétion, ceux-ci en furent écartés dès qu'il passa sous l'autorité du favori, et le jeune homme devint plus cher qu'un fils au roi qui ne pouvait se passer de lui. A cette vue, les vizirs conçurent de la haine et songèrent à trouver un moyen qui pût écarter leur rival de l'œil du roi.
Lorsqu'arriva le moment fixé par le destin, il advint qu'un jour le trésorier but du vin et s'enivra. Ayant perdu sa route, il tourna dans le palais et le sort le conduisit dans le harem. Là était une chambre agréable où le roi dormait avec sa femme. Le jeune homme y entra et, trouvant un lit pour dormir, il s'y jeta, contempla avec admiration la richesse de l'ameublement à la lumière d'une bougie qui y brûlait et finit par s'endormir d'un profond sommeil. Le soir arrivé, une esclave apporta, comme à l'ordinaire, toute espèce de friandises en fait de mets et de boissons qu'elle préparait pour le roi et la reine. Le jeune homme dormait toujours, étendu sur le dos, sans se douter de rien, car, dans son ivresse, il ne savait pas où il était. La jeune fille, croyant que c'était le prince endormi sur son divan, plaça les cassolettes et les parfums près de son siège, puis elle ferma la porte et s'en alla.
Le roi sortit de la salle à manger, prit la reine par la main et la conduisit dans la chambre où dormait son favori. Il ouvrit la porte, entra et, trouvant son trésorier endormi, il se tourna vers la reine :
« Que fait là ce jeune homme? demanda-t-il ; assurément, il n'est venu ici qu'à cause de toi. »
« Je l'ignore, » répondit-elle. Là-dessus le dormeur s'éveilla et, voyant Azâd-bakht, il se leva et se prosterna devant lui. » Misérable, s'écria le roi, qui t'a conduit dans mon palais ? » Puis il ordonna de l'enfermer dans un endroit et la reine dans un autre.
Le lendemain matin, le prince, assis sur son trône, fit venir son premier ministre, le vizir des vizirs, et lui dit :
« Que penses-tu de l'action de ce scélérat qui est entré dans mon appartement et s'est couché sur mon divan? Je crains que ma femme n'ait de l'inclination pour lui. Quel est ton avis dans cette circonstance ? »
Le ministre répondit : « Que Dieu prolonge la vie du roi! Qu'as-tu observé chez ce page ? N'est ce pas un individu de basse extraction, un fils de voleur? un scélérat revient toujours à ses instincts pervers et celui qui élève le petit d'un serpent n'en peut attendre que des morsures. Quant à la reine, elle est innocente, car, depuis des années jusqu'à présent, on n'a vu en elle qu'honnêteté et pudeur. Maintenant, si le roi le permet, j'irai la trouver et je l'interrogerai pour pouvoir t'exposer clairement cette affaire. »
Le prince l'y autorisa et le vizir alla dire à Behrédjour : « Je suis venu vers toi à cause d'un grand scandale ; je désire que tu me dises la vérité et que tu me racontes comment ce jeune homme est entré dans la chambre. »
« Je l'ignore absolument, » répondit la reine, et elle proféra les serments les plus sacrés. Le ministre reconnut qu'elle était ignorante et innocente et il ajouta : « Je vais t'enseigner une ruse qui te sauvera et qui blanchira ton visage devant le roi. »
« Quelle est-elle? » demanda Behrédjour.
« Quand le prince te fera venir et quand il t'interrogera, tu lui répondras : Ce jeune homme m'a vue dans une loge grillée de la mosquée et m'a envoyé un message, me promettant cent perles d'un prix inestimable si je lui accordais mes faveurs. J'ai ri de sa demande et l'ai repoussée, mais il est revenu à la charge et m'a dit : Si tu m'accordes cela, c'est bien; sinon, une de ces nuits, j'irai, ivre, m'endormir dans ton appartement; le roi me verra et me tuera; toi, tu seras humiliée, noircie à ses yeux et déshonorée. Voilà, ajouta le ministre, ce que tu répéteras au prince ; moi je vais le retrouver et le lui rapporter. » Behrédjour y consentit.
Le grand vizir revint vers son maître et lui dit : « Ce jeune homme mérite un châtiment sévère après tant de bienfaits : une semence amère ne peut rien donner de doux. Je suis convaincu que la reine est innocente. » Puis il raconta à Azâd-bakht tout ce qu'il avait appris à la princesse. A cette nouvelle, le roi déchira ses vêtements et fit comparaître le trésorier. On l'amena en sa présence, puis le bourreau fut mandé et tous les assistants regardèrent le condamné pour savoir ce que le prince allait faire de lui, car il lui parlait avec colère, l'autre avec douceur. Azâd-bakht lui dit :
« Je t'ai comblé de richesses parce que j'avais vu en toi de la probité; je t'ai choisi entre tous mes grands, et je t'ai établi gardien de mon trésor. Pourquoi as-tu déshonoré mon harem ? pourquoi es-tu entré dans mon appartement et as-tu été infidèle ? Pourquoi n'as-tu pas considéré les bons traitements que tu as reçus de moi ? »
« O roi, répondit le jeune homme, je n'ai pas agi ainsi. de mon plein gré ni de ma pleine volonté ; je n'avais pas conscience d'être là où je me trouvais ; mais c'est pour mon malheur que j'y ai été conduit, car la fortune change et le bonheur s'anéantit. J'ai fait tous mes efforts pour qu'aucun vice n'apparût en moi et je me suis gardé de commettre aucune faute; mais personne ne peut résister au destin contraire et les efforts sont inutiles quand la bonne chance n'existe plus ; témoin le marchand qui s'affligeait de sa mauvaise fortune, dont les tentatives furent vaines et qui n'éprouva que des catastrophes. »
« Quelle est cette histoire et comment son bonheur se changea-t-il en adversité ? »
Le jeune homme commença:[28]
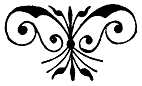

« Que Dieu prolonge la vie du roi! Il existait un marchand qui avait acquis de la fortune dans son commerce: son argent fructifiait. Mais un jour son bonheur changea sans qu'il le sût, et il se dit en lui-même : « J'ai de grandes richesses et je suis fatigué d'aller de pays en pays ; il vaut mieux me fixer dans une contrée et me reposer de mes fatigues et de mes peines en trafiquant chez moi. »
Puis il divisa son argent en deux parts : avec l'une, il acheta du blé pendant l'été, pensant : Quand viendra l'hiver, je le revendrai avec un gain considérable. L'hiver venu, le blé se vendait la moitié du prix que le marchand avait donné, ce qui l'inquiéta beaucoup. Il le garda jusqu'à l'autre année, mais la valeur baissa encore.
Un de ses amis lui dit : « Tu n'as pas de chance, avec ce blé, même si tu le vends à son prix. »
« Mon gain se fait attendre, répondit le marchand; il est possible que j'éprouve des pertes en cette affaire; Dieu le sait. Quand cela durerait dix ans, je ne le revendrai qu'à bénéfice. » Puis, tout en colère, il boucha la porte de son grenier avec de l'argile.
Mais, par la volonté de Dieu très haut, il survint une pluie abondante ; l'eau coula du toit de la maison où était déposé le blé : le marchand dut payer de sa bourse cent dirhems pour le transporter hors de la ville, car les grains pourris exhalaient une odeur infecte. — Son ami lui dit : « Que de fois je t'ai répété que tu n'aurais pas de chance avec ton blé et tu ne m'as pas écouté! A présent, il faut que tu consultes un astrologue et que tu l'interroges sur ton étoile. »
Le marchand suivit ce conseil et l'astrologue lui répondit : « Ton astre est défavorable, n'entreprends rien, car tu ne réussirais pas. » Il n'écouta pas ces paroles et pensa : « Si je travaille moi-même à mes affaires, je n'aurai rien à craindre. » Puis, au bout de trois ans, il alla prendre l'autre moitié de sa fortune, fréta un vaisseau, le chargea de marchandises de choix et de tout ce qu'il possédait, dans l'intention de s'embarquer pour voyager. Après quelques jours il se dit : « Je vais interroger les marchands pour savoir quelles marchandises rapportent des bénéfices; dans quel pays on peut les écouler et combien l'on en retire de gain. » On lui indiqua une contrée éloignée et on ajouta qu'un dirhem en rapportait cent. — Il partit sur son vaisseau et se dirigea vers ce pays. Mais, tandis qu'il était en route, il souffla un ouragan violent qui submergea le navire : le marchand se sauva sur une pièce de bois; le vent le jeta nu sur le rivage de la mer, près d'une ville des environs. Il remercia Dieu et rendit grâces pour son salut. Ensuite il aperçut dans la ville un vieillard très âgé à qui il raconta son histoire et ses aventures ; en entendant ce récit, cet homme s'affligea beaucoup; puis il fit apporter de la nourriture, fit manger le naufragé et lui dit .
« Demeure chez moi, je t'établirai le surveillant et l'intendant de mes biens et je te donnerai chaque jour cinq dirhems. » — « Que Dieu par sa grâce t'accorde une belle récompense, » répondit le marchand, et il resta dans cet endroit jusqu'à l'époque des semailles, de la moisson et de la récolte.
Le vieillard ne s'occupait plus de surveillance ni d'inspection, mais il s'en remettait à son hôte. Celui-ci, après avoir fait ses calculs, se dit : « Je ne pense pas que le maître de cette récolte me donne ce qui m'est dû : il est à propos que je mette à part la valeur de mon salaire : s'il m'accorde ce qui me revient, je lui rendrai ce que j'aurai détourné. »
Puis il enleva la quantité à laquelle il avait droit, la cacha dans un endroit secret et remit le reste au vieillard: Celui-ci lui dit : « Va, prends ce qui t'appartient, suivant nos conventions, vends-le et achète avec le prix des vêtements, des étoffes et d'autres choses; si tu restes chez moi dix ans, voilà le salaire que tu auras, et je te paierai de la sorte. »
Le marchand pensa en lui-même : « J'ai mal agi en détournant du blé à son insu, » puis il alla chercher ce qu'il avait caché ; mais, ne l'ayant pas trouvé, il s'en revint confus et chagrin. Le vieillard lui demanda : « Pourquoi es-tu triste ? » — « Je croyais que tu ne m'accorderais pas mon dû, répliqua l'intendant, et j'ai enlevé de ce blé la valeur de mon salaire : à présent, comme tu as été juste à mon égard, je suis allé chercher, pour te le rapporter, ce que j'avais caché; mais il a disparu. Quelqu'un l'aura trouvé et volé. » Lorsque le vieillard entendit ces paroles, il lui dit avec colère : « Il n'y a rien à faire contre une mauvaise destinée, » puis il ajouta : « Je t'avais donné cela, mais ton sort défavorable t'a poussé à agir comme tu l'as fait » et il le chassa de chez lui.
Le marchand s'en alla plein de tristesse, versant des larmes, et vint à passer près d'une troupe de plongeurs qui péchaient des perles. Ces gens, le voyant affligé, l'interrogèrent : « Que t'est-il arrivé et pourquoi pleures-tu? » Il leur raconta son histoire depuis le commencement jusqu'à la fin. Ils le reconnurent : « Tu es fils d'un tel? » lui demandèrent-ils. « Oui. » Alors ils partagèrent sa douleur et son chagrin, puis ils lui dirent : « Demeure ici jusqu'à ce que nous plongions : tout ce que nous rapporterons cette fois, nous t'en donnerons ta part. » Ils plongèrent et retirèrent dix coquillages renfermant chacun deux grosses perles. A cette vue, ils s'écrièrent pleins d'admiration : Tu as retrouvé ta chance : ton étoile est revenue! » Puis.ils lui remirent dix perles en ajoutant : « Vends en deux, cela te procurera un capital, et cache les autres pour un moment de détresse. »
Il les prit avec joie, en cousit huit dans ses vêtements et en garda deux qu'il mit dans sa bouche. Un voleur l'aperçut et alla avertir ses complices qui se réunirent contre le naufragé et lui enlevèrent ses habits. Quand ils se furent éloignés, il se dit : « Ces deux perles me suffisent, » puis il se dirigea vers la ville voisine et chercha à les vendre.
Mais le destin voulut qu'on eût volé auparavant à un joaillier de cet endroit dix perles pareilles à celles que possédait le marchand. Lorsqu'il aperçut ces dernières entre les mains du crieur public, il lui demanda : « A qui sont-elles? » — « A un tel, » lui fut-il répondu. Il aperçut un homme misérable, de médiocre apparence et lui dit : « Où sont les huit autres perles? » Le marchand, s'imaginant qu'il lui parlait de celles qui étaient dans son vêtement, répondit : « Des voleurs me les ont prises » Le joaillier crut lui avoir arraché "un aveu, et, en l'entendant parler ainsi, se confirma dans l'opinion que cet homme l'avait volé; il le saisit, le conduisit devant l'officier de police et dit : « Celui-ci m'a pris des perles; j'en ai retrouvé deux sur lui, et il a avoué pour les huit autres. » L'officier de police, qui avait été instruit du vol, fit jeter en prison, après une bastonnade, le marchand qui y demeura quelque temps. Le plongeur, l'y ayant aperçu, le reconnut, et, après l'avoir interrogé sur son aventure qu'il lui raconta, s'étonna de sa mauvaise fortune ; en sortant, il informa le sulthan de l'histoire, ajoutant que c'était lui-même qui avait donné les perles.[29] Le prince fit mettre le marchand en liberté, lui demanda le récit de ses infortunes et, après l'avoir entendu d'un bout à l'autre, il eut compassion de lui et lui donna une maison dans le voisinage de son palais, en qualité d'échanson.
La demeure du naufragé était près du palais; mais tandis qu'il se réjouissait en disant : « J'ai atteint le bonheur et je vivrai le reste de mes jours sous la protection royale, » il arriva qu'il trouva dans sa maison une fenêtre bouchée avec de l'argile et des pierres. Il la dégagea pour voir ce qu'il y avait derrière elle, c'était une lucarne donnant sur le harem royal. Aussitôt, saisi d'une grande crainte, il s'empressa d'apporter de l'argile pour boucher l'ouverture. Un des eunuques, l'ayant aperçu, alla en toute hâte prévenir le sulthan, qui, trouvant les pierres mal scellées, entra dans une violente colère et s'écria : « Est-ce ainsi que tu me récompenses de mes bienfaits en portant tes regards sur mon harem ? » Puis il ordonna de lui arracher les yeux, ce qui fut exécuté sur-le-champ. Le marchand prit ses yeux dans sa main et dit : « Quand donc ce destin fatal qui m'a persécuté dans ma fortune, sera-t-il en repos ? » Ensuite il se consola en ajoutant : « A quoi me servirait de lutter contre le mauvais destin : le Dieu clément ne me favorise pas; la lutte est un péché.[30] »
C'est ainsi, ô roi, termina le jeune homme, que mon sort a d'abord été prospère et que toutes mes entreprises réussissaient. Mais à présent, mon bonheur a disparu et tout se tourne contre moi.— Lorsqu'il eut terminé son histoire, la colère du prince se calma un peu et il dit : « Ramenez-le à sa prison ; la journée est finie ; nous verrons demain ce qu'il y a à faire et nous punirons son crime. »


Le second jour, le second vizir, dont le nom était Behréwân,[31] alla trouver son maître et lui dit : « Que Dieu glorifie le roi ! Voici que ce jeune homme a commis une action grave et honteuse contre la maison royale. »
Le prince ordonna d'amener le prisonnier, sur les représentations de son ministre, et, lorsqu'il fut présent, il lui dit : « Malheur à toi ! Il faut absolument que je te fasse périr de la pire mort pour la faute que tu as commise, et que je fasse de toi un exemple pour les hommes. »
« O roi, repartit son fils, ne te hâte pas, car le souverain qui examine les conséquences d'une affaire, affermit et assure la durée et la solidité de son pouvoir. Quant à celui qui ne réfléchit pas aux résultats, il lui arrive comme au marchand; le premier, au contraire, a le sort du fils du marchand. »
« Quelle est cette histoire? » demanda le prince.
Le jeune homme reprit :

« Il y avait un marchand qui, possesseur d'une grande fortune et d'une femme, partit pour un voyage de commerce, laissant son épouse enceinte. En la quittant, il lui dit : « Je me mets en route, mais je serai de retour avant ton accouchement, s'il plaît à Dieu très haut. » Elle lui fit ses adieux et il partit.
Il ne cessa de voyager de pays en pays jusqu'à ce qu'il arriva chez un roi avec lequel il se lia d'amitié. Ce prince avait besoin de quelqu'un pour administrer ses affaires et celles de ses états : voyant que le. marchand était instruit et intelligent, il l'obligea de rester près de lui et le combla de bienfaits. Bien des jours après, le vizir demanda à son maître la permission de retourner dans sa patrie en emportant les récompenses qui lui avaient été accordées : « Permets, dit-il, que j'aille voir mes enfants, et je reviendrai ici. » Le prince accorda l'autorisation, lui imposa l'obligation de revenir et lui fit présent d'une bourse contenant mille dinars d'or. Le marchand s'embarqua et fit route vers son pays. Voilà ce qui lui arriva..
Quant à sa femme, ayant appris que son mari était au service de tel roi, elle se mit en chemin avec ses deux enfants (car, pendant l'absence du marchand, elle était accouchée de deux jumeaux), et se dirigea vers ce royaume. Ils se rencontrèrent dans une île où le mari s'était lui-même arrêté cette nuit-là. La femme dit à ses enfants : « Voici un vaisseau qui vient du pays où est votre père, allez sur le bord de la mer vous enquérir de lui. » Ils obéirent et se mirent à jouer sur le bateau ; mais, tandis qu'ils étaient occupés à leurs jeux, le soir arriva : le marchand, qui dormait dans le navire, réveillé par leurs cris, se leva pour les chasser et sa bourse tomba parmi les bagages. Il la chercha sans la trouver, alors il se frappa la tête, saisit les enfants et leur dit : « Personne que vous n'a pris ma bourse, car vous étiez à jouer auprès des bagages pour voler quelque chose ; vous étiez seuls ici. » Puis il s'empara d'un bâton, attacha ses fils et se mit à les battre et à les fustiger, tandis qu'ils pleuraient. Les matelots, rassemblés autour d'eux, disaient : « Les enfants de cette île sont tous des voleurs et des larrons. » Dans l'excès de sa colère, le marchand jura que si sa bourse ne lui était pas rendue, il noierait les prisonniers. A ces mots, il les lia à une botte de roseaux et les jeta à la mer.
Cependant, leur mère, inquiète de leur absence, se mit à leur recherche et, arrivée au vaisseau, commença de demander : « Qui a vu deux enfants, de telle apparence, âgés de tant d'années? »
Les matelots qui l'écoutaient se dirent : « C'est le signalement de ceux qui viennent d'être noyés. »
La femme entendit ces paroles et se mit à gémir : « Hélas ! mes chéris ! mes fils ! Comment votre père pourra-t-il vous voir aujourd'hui ? »
Un des marins l'interrogea : « De qui es-tu la femme ? »
« De tel marchand, répondit-elle ; je voulais aller le rejoindre lorsque ce malheur est arrivé. »
En entendant ces paroles, le mari se leva, déchira ses vêtements et se frappa la tête en disant : « Par Dieu ! c'est moi qui ai fait périr mes fils! voilà le châtiment de celui qui n'envisage pas les conséquences de ses actes, qui ne s'informe pas et n'agit pas avec prudence! » Puis tous deux recommencèrent à se lamenter et à pleurer. A la fin, le marchand s'écria : « Par Dieu, je ne prendrai plaisir à rien tant que je n'aurai pas de leurs nouvelles. » Il se mit ensuite à parcourir les mers à leur recherche, mais inutilement.
Les enfants furent poussés par le vent vers le continent et jetés sur le rivage. L'un d'eux fut trouvé par les courtisans du roi de ce pays : ils l'amenèrent à leur maître à qui il plut extrêmement et qui l'adopta pour son fils. Il le présenta comme tel à ses sujets, prétendant l'avoir caché par affection. Le peuple se réjouit beaucoup à cause du roi et celui-ci fit de l'enfant son héritier présomptif et son futur successeur. Des années passèrent : le prince mourut et fut remplacé par le jeune homme qui s'assit sur le trône et vit prospérer ses affaires.
Pendant ce temps, ses parents parcouraient à sa recherche et à celle de son frère toutes les îles de la mer, dans l'espoir qu'ils auraient été jetés sur l'une d'elles, mais ils ne trouvaient pas de renseignements. Un jour que le père était dans un marché, il aperçut un crieur public, tenant un jeune homme qu'il voulait vendre. « Je l'achèterai, se dit-il, peut-être me consolera-t-il de la perte de mon fils. » — Il en fit l'acquisition et l'emmena dans sa maison. Quand sa femme l'aperçut, elle poussa un cri : « Par Dieu ! c'est mon fils. » Les parents se réjouirent fort et lui firent des questions sur son frère. « La mer nous a séparés, répondit-il, je ne sais ce qu'il est devenu. » Ils se consolèrent, et là-dessus bien des années se passèrent.
Ils habitaient dans le pays où régnait leur autre fils. Quand l'enfant retrouvé fut grand, son père lui donna des marchandises pour voyager. Il entra dans la ville où résidait son frère : celui-ci, informé qu'un trafiquant était arrivé avec des marchandises qui plaisaient aux femmes, le fit venir et asseoir devant lui. Aucun ne reconnaissait l'autre : toutefois leur sang était ému. Le prince dit au marchand : « Je désire que tu restes auprès de moi : tu occuperas un rang élevé et je te donnerai tout ce que tu demanderas. » L'autre accepta et demeura près de lui pendant quelques jours. Quand il vit que son frère ne le laisserait pas repartir, il envoya dire à son père et à sa mère de venir le retrouver. Ils s'occupèrent de se transporter près de lui, tandis que le crédit de leur fils s'accroissait sans qu'aucun d'eux ne connût le lien de parenté qui les unissait.
Une nuit, le roi sortit de sa capitale : il but, s'enivra et s'endormit. Le favori se dit : « Je vais le garder moi-même, afin de reconnaître les bontés qu'il a eues pour moi. » Il se leva aussitôt, tira son sabre et se tint à la porte de la tente royale. Un des serviteurs qui le jalousait à cause de la faveur dont il jouissait, l'aperçut, debout, le sabre à la main et lui dit :
« Que fais-tu à cette heure dans cet endroit ? »
« Je veille sur le roi, répondit-il, en reconnaissance de ses bienfaits ». Puis il se % tut.
Au matin, la troupe des courtisans fut informée de cette aventure et pensa : « Voilà l'occasion, mettons-nous d'accord et avertissons le prince pour qu'il surprenne lui-même son favori et nous délivre de lui. »
Ils allèrent ensemble trouver leur maître et lui dirent : « Nous avons un avis à te donner. » 4
« Quel est-il? »
« Ce marchand que tu as approché de ta personne, que tu as élevé au-dessus des grands de ton royaume, nous l'avons vu, la nuit dernière, le sabre nu et prêt à t'assaillir pour te tuer. »
En entendant ces paroles, le prince changea de couleur et leur demanda : « Avez-vous des preuves? »
« Quelle preuve exiges-tu? répliquèrent-ils. Si tu veux être convaincu, feins cette nuit d'être ivre et de t'endormir, puis observe-le, et tu verras de tes propres yeux tour ce que nous t'avons rapporté. »
Ils s'en allèrent ensuite trouver, le favori et lui dirent : « Sache que le roi t'est reconnaissant de ce que tu as fait pour lui la nuit dernière et qu'il augmentera ses bienfaits. » Par là, ils excitèrent son esprit.
La seconde nuit arrivée, le prince demeura éveillé et inquiet, à observer son serviteur.[33] Quant à celui-ci, il alla se placer à la porte de sa tente, tira son sabre et resta là. A cette vue, le trouble du prince augmenta : il fit arrêter son frère et lui demanda : « Est-ce ainsi que tu reconnais l'amitié que j'avais pour toi plus grande que pour qui que ce soit ? C'est ainsi que tu me récompenses ! »
Deux des courtisans se levèrent et dirent : « Seigneur, si tu l'ordonnes, nous allons lui trancher la tête. »
« La précipitation à faire périr un homme, répondit le prince, est chose coupable, même lorsqu'il n'est pas puissant. Nous pouvons bien le tuer quand il est vivant, mais non le faire revivre quand il est mort. Il faut examiner les suites de toute action : celui-ci, du reste, n'échappera pas à la mort. »
Il ordonna de le conduire en prison, puis il revint (dans la ville), s'acquitta de ses occupations et partit pour la chasse. A son retour, il avait oublié le condamné lorsqu'on entra chez pour lui dire . « Si tu négliges de t'occuper de cet homme qui a voulu t'assassiner, tous tes serviteurs ambitionneront le pouvoir : déjà il circule parmi le peuple des bruits à ce sujet. » Le roi, irrité de ces paroles, dit : « Amenez-le-moi ici », et il ordonna au bourreau de lui trancher la tête. On banda les yeux au prisonnier : l'exécuteur se tint debout près de lui et s'adressa au prince : « Avec ta permission, seigneur, je lui couperai le cou. » — « Arrête, interrompit son maître, je veux examiner son cas : s'il faut absolument le faire périr, il n'échappera pas à la mort. » Puis il le fit ramener en prison où le condamné demeura jusqu'à ce qu'il plût à son frère de le tuer.[34] ».
Sur ces entrefaites, ses parents ayant entendu parler de l'aventure, le père alla trouver le roi, écrivit une requête sur une feuille de papier et la lut au prince. Voici ce qu'elle contenait : « Sois miséricordieux envers moi, et Dieu le sera envers toi ; ne te presse pas d'ordonner une exécution, car moi-même, pour avoir agi avec précipitation, j'ai fait périr son frère dans la mer, ce qui m'a, jusqu'à aujourd'hui, causé de la douleur. Si tu veux sa mort, tue-moi à sa place. » Puis il se prosterna devant le roi et se mit à pleurer.
« Raconte-moi ton histoire, » lui demanda le prince.
« Seigneur, lui dit le vieillard, ce jeune homme avait un frère que je jetai avec lui dans la mer. » Puis il fit, d'un bout à l'autre, le récit de ses aventures. Alors le roi poussa un grand cri, s'élança de son trône et embrassa son père et son frère en disant : « Par Dieu, tu es mon père, voilà mon frère et ta femme est ma mère. » Ils demeurèrent tous à verser des larmes; ensuite le prince fit connaître l'événement à ses sujets et ajouta : « O peuple, comment jugez-vous mon habitude d'examiner les conséquences d'une action. » Les gens s'émerveillèrent de la sagesse et de la prudence de leur souverain. Celui-ci s'adressa à son père . « Si tu avais réfléchi aux résultats de ta conduite et si tu n'avais pas apporté de la précipitation dans ta manière d'agir, tu n'aurais pas été en butte au repentir et au chagrin pendant tout ce temps. » Puis il fit venir sa mère, ils se réjouirent tous ensemble et passèrent leur vie dans la satisfaction et le contentement.
« Quoi de plus nuisible, termina le prisonnier, que de ne pas considérer les suites d'une action ! Ne te hâte donc pas de me faire périr, de peur de ressentir ensuite de la peine et du souci. »
Après avoir entendu ce récit, le roi commanda de ramener le condamné dans sa prison jusqu'au lendemain, en disant qu'il réfléchirait à son affaire et qu'il ne pouvait se soustraire à la mort.


Le troisième jour, le troisième vizir vint trouver le roi et lui dit : « Sire, il ne faut pas négliger l'affaire de ce jeune homme, car sa conduite nous attire le mépris du peuple. Il faut donc le faire périr promptement pour couper court aux rumeurs qui circulent sur notre compte, et ne pas laisser dire que le roi a vu quelqu'un sur son lit avec la reine et qu'il lui a pardonné. » Ce langage affecta le prince et il fit amener le prisonnier qui comparut enchaîné. La colère royale avait été enflammée par les paroles du vizir ; Azâd-bakht s'élança de son trône et dit à son fils : « Homme de vile extraction, tu nous as couverts de honte et tu as nui à notre réputation : il faut absolument que ton âme quitte ce monde. »
« O roi, répondit le jeune homme, use de patience dans toutes tes actions : c'est le moyen d'arriver à ton but ; en effet, Dieu très haut récompense la patience par de grands biens : c'est elle qui tira d'un puits Abou-Sâber et le fit asseoir sur un trône. » « Qu'est-ce qu'Abou-Sâber et quelle est son histoire ? » demanda le prince.

Le prisonnier commença :
« Sire, il y avait un homme du nom d'Abou-Sâber, possesseur de nombreux bestiaux et marié à une belle femme qui lui avait donné deux enfants. Ils habitaient un bourg auprès duquel se tenait un lion qui dévorait une partie du bétail du Dihqân. La femme de celui-ci dit à son mari : « Ce lion a détruit la plus grande partie de nos troupeaux : monte à cheval, réunis les voisins et va le tuer, afin que nous soyons en repos. » « Femme, répondit son mari, la patience a toujours de bons résultats : ce lion est injuste envers nous, et Dieu ne peut faire autrement que d'exterminer tout être injuste : c'est notre patience qui causera sa perte : celui qui fait le mal est nécessairement abattu. »
Quelques jours après, le roi alla à la chasse : lui et sa suite rencontrèrent l'animal féroce et ne cessèrent de l'attaquer jusqu'à ce qu'ils l'eurent tué. Abou-Sâber, l'ayant appris, dit à son épouse : « Femme, ne t'ai-je pas dit que celui qui faisait le mal serait abattu : si j'étais parti pour tuer le lion, peut-être n'au-rais-je pas réussi ; voilà les fruits de la patience. »
Il arriva ensuite qu'un meurtre fut commis dans le bourg : le sulthan ordonna de le saccager. Les biens d'Abou-Sâber furent pillés comme les autres. Son épouse lui dit : « Toute la cour du roi te connaît : va l'informer de ce qui est arrivé pour qu'il te rende tes troupeaux. »
« Femme, lui répondit son mari, ne t'ai-je pas dit que celui qui fait le mal sera frappé, que tout roi injuste subira des représailles et que quiconque s'empare de la fortune des gens, ses propres richesses lui seront enlevées? »
Un de ses voisins l'entendit : c'était un des envieux du Dihqân ; il alla tout rapporter au sulthan qui envoya piller tous les biens d'Abou-Sâber et le chassa, lui et sa femme, de ce bourg
Ils s'en allèrent à travers le pays. « Tout ce qui est arrivé, lui dit son épouse, vient de ta lenteur à agir et de ta faiblesse d'esprit. »
« Patience, répondit-il ; la patience a d'excellents résultats. »
Ils marchaient depuis quelque temps lorsqu'ils furent rencontrés par des voleurs qui les dépouillèrent de leurs vêtements et enlevèrent leurs deux enfants. La femme se mit à pleurer en disant : « O mon mari, laisse ces sottises; lève-toi, suivons ces brigands; peut-être auront-ils pitié de nous et nous rendront-ils nos enfants. »
« Patience, répliqua Abou-Sâber, celui qui fait le mal recevra du mal par rémunération : son injustice retombera sur lui. Si je suis ces gens-là, peut-être l'un d'eux prendra son sabre et me tranchera la tête ; mais patience; la patience a d'excellents résultats. »
Ils marchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivèrent dans les environs d'un village du Kermân[37] auprès duquel coulait un fleuve. Le mari dit à sa femme : « Reste ici ; je vais entrer dans le village, et nous verrons s'il y a un endroit où nous puissions habiter. » Il la laissa auprès de l'eau et pénétra dans le bourg. Un cavalier arriva pour abreuver son cheval ; il aperçut la femme qui lui plut, et lui dit : « Lève-toi, monte près de moi, je t'épouserai et je te comblerai de biens. » — « Que Dieu prolonge ta vie, répondit-elle, j'ai un mari. » Mais il tira son sabre en criant : « Si tu ne m'obéis pas, je te tue. » Lorsqu'elle vit sa méchanceté, elle écrivit sur le sable avec son doigt : « O Abou-Sâber, tu as supporté avec constance qu'on t'enlevât ta fortune, tes enfants et ta femme qui t'était plus chère que tout le reste ; j'étais demeurée avec toi dans ton malheur pour voir à quoi te servirait ta patience. » Puis le cavalier l'enleva, la fit monter derrière lui et partit.
A son retour, le Dihqân ne vit plus son épouse; mais, ayant lu ce qu'elle avait écrit, il se mit à pleurer plein de tristesse. « Abou-Sâber, se dit-il, il faut prendre patience ; peut-être il aurait pu t'arriver quelque chose de plus fâcheux et de plus pénible. » Puis il erra devant lui comme un fou et rencontra une troupe d'ouvriers qui travaillaient par corvée à la construction du palais du roi. Lorsqu'on le vit, on se saisit de lui et on lui dit : « Travaille avec ces gens-là à bâtir la demeure royale, sinon nous t'enfermerons pour toujours en prison. »
Il se mit à l'œuvre, et chaque jour on lui donnait un pain. Un mois se passa ainsi. Un jour, en montant sur une échelle, un de ses compagnons tomba et se cassa la jambe ; il poussa des cris et versa des larmes.
« Prends patience, lui dit Abou-Sâber, et ne pleure pas ; car dans la patience tu trouveras du soulagement ; c'est elle qui tire un homme d'un puits et le fait asseoir sur un trône royal. »
Le roi qui était assis à sa fenêtre et qui entendait ces paroles, se mit en colère et ordonna qu'on lui amenât le Dihqân. Celui-ci fut conduit aussitôt en sa présence. Il y avait dans le palais une citerne renfermant un caveau vaste et profond ; le prince y fit descendre Abou-Sâber et lui dit : « Homme de peu d'intelligence, nous verrons comment tu sortiras de ce puits pour monter sur le trône. » Ensuite il venait chaque jour près de la citerne et lui criait : « Abou-Sâber, je ne vois pas que tu sortes du puits pour monter sur le trône. » Et il lui faisait donner deux pains. Le prisonnier demeurait silencieux et ne répondait pas ; mais il supportait avec constance ce qui lui arrivait.[38]
Le prince avait un frère que, longtemps auparavant, il avait fait enfermer dans ce caveau et qui y était mort ; mais les habitants du royaume le croyaient encore vivant. Trouvant sa captivité trop longue, les courtisans du roi murmurèrent à cause de la cruauté de leur maître : le bruit se répandit qu'il était un tyran. Un jour, le peuple se souleva contre lui, le tua, chercha le caveau et en tira Abou-Sâber qu'il prenait pour le frère du dernier souverain, car il lui ressemblait plus que personne, et il y avait longtemps qu'il y était enfermé. Dans cette pensée, on lui dit : « Te voilà à la place de ton frère; nous l'avons tué; c'est toi qui lui succède?. » Abou-Sâber se tut, reconnaissant dans cet événement la récompense de sa patience. Il s'assit sur le trône, revêtit des vêtements royaux et fit preuve de justice et d'équité, en sorte que ses affaires prospérèrent : le peuple lui obéissait, ses sujets l'aimaient et son armée était nombreuse.
Le roi qui l'avait dépouillé et chassé de son pays, avait un ennemi qui marcha contre lui, le vainquit, s'empara de sa capitale et le força à fuir. Le fugitif se rendit auprès d'Abou-Sâber pour lui demander des secours, sans savoir que c'était son ancien sujet. Il entra dans son palais avec des actions de grâces, mais le Dihqân se fit reconnaître de lui et lui dit : « Voilà comme la patience est récompensée : Dieu très haut m'a donné le pouvoir sur toi. » Puis il fit dépouiller, par ses soldats, le suppliant et sa suite, enlever leurs vêtements et les chassa du pays. Les courtisans d'Abou-Sâber et son armée s'étonnèrent de cette conduite envers un prince qui implorait du secours et en cherchèrent l'explication : « Ainsi n'agissent pas les rois, » disaient-ils, et ils ne pouvaient s'expliquer la chose.
Quelque temps après, on apprit qu'une bande de brigands était dans le pays. Abou-Sâber fit tous ses efforts pour s'en rendre maître : or c'étaient les voleurs qui l'avaient dépouillé et privé de ses enfants pendant son voyage. Il les fit amener en sa présence et leur demanda :
« Où sont les jeunes gens que vous avez pris tel jour? »
« Chez nous, répondirent-ils, et nous te les offrirons, seigneur, pour qu'ils te servent comme esclaves; nous te donnerons toutes les richesses que nous avons entassées ; nous abandonnerons tout ce que nous possédons; nous nous repentirons de nos fautes et nous combattrons devant toi. »
Mais il n'agréa pas leur discours ; il s'empara de tous leurs trésors, fit tuer tous les voleurs et reprit ses enfants avec lesquels il se réjouit beaucoup. Les soldats murmurèrent à cette vue en disant : « Il est plus injuste que son frère; une troupe de brigands vient à lui, veut se repentir et lui amène deux serviteurs; il les accepte, puis il prend les richesses de ces gens et les fait périr! C'est une grande injustice. »
Un peu plus tard, le cavalier qui avait enlevé sa femme se présenta devant lui pour se plaindre d'elle parce qu'elle le repoussait ; il prétendait qu'elle était son épouse. Abou-Sâber la fit venir en sa présence, pour rendre son arrêt et entendre ses raisons. Le cavalier l'accompagna. Lorsque le roi la vit, il la reconnut et la reprit à son ravisseur qu'il fît tuer. Là-dessus, il apprit que ses soldats criaient à la tyrannie. Il manda sa cour et ses vizirs et leur dit : « Par Dieu tout puissant, je ne suis pas le frère du prince défunt : celui-ci m'avait emprisonné pour une parole qu'il m'avait entendu prononcer. Tous les jours, il venait me la répéter : vous m'avez cru son frère, tandis que je suis Abou-Sâber; Dieu très haut m'a donné ce royaume en récompense de ma patience. Le roi qui est venu me demander du secours et que j'ai dépouillé, avait commencé autrefois par me piller et me chasser de mon pays; il m'avait banni injustement et s'était emparé tyranniquement de mes biens. J'ai usé de représailles envers lui. Quant aux voleurs qui voulaient changer de vie, je ne pouvais accepter leur repentir, car ils m'avaient maltraité contre toute justice ; ils m'avaient rencontré sur la route, m'avaient volé, dépouillé, s'étaient emparés de mon argent et de mes enfants : ce sont ces deux jeunes gens qu'ils voulaient me donner pour esclaves et que je leur ai repris; j'ai agi envers ces brigands comme ils avaient agi envers moi. Le cavalier que j'ai fait mourir avait ravi cette femme qui est la mienne et l'avait gardée captive ; Dieu très haut me l'a rendue. Voilà mon droit, et j'ai agi selon la justice, tandis que vous pensiez, d'après l'apparence des choses, que je me conduisais en tyran. »
Quand le peuple entendit ces paroles, il fut saisi d'étonnement et se prosterna jusqu'à terre. Son affection et son amour pour son prince augmentèrent ; il s'excusa près de lui et admira comment Dieu avait traité Abou-Sâber, le gratinant d'un royaume en récompense de sa patience et de sa constance, l'élevant du fond d'un caveau sur le trône royal, précipitant un prince de son trône dans un caveau, enfin réunissant la femme et le mari. Celui-ci ajouta : « Voilà l'agréable fruit de la patience et aussi le fruit amer de la précipitation. Tout ce que l'homme fait de bien ou de mal lui retourne. »
« Ainsi, ô prince, termina le prisonnier, tu dois user de patience le plus possible, car c'est ainsi qu'agissent les hommes généreux ; c'est le meilleur appui qu'ils puissent trouver; les rois ne se distinguent que par là. »
Quand Azâd-bakht entendit ces paroles, sa colère s'apaisa; il ordonna de ramener le jeune homme dans sa prison et les assistants se séparèrent.


Le quatrième jour, le quatrième vizir qui s'appelait Rouchâd[39] se présenta devant roi, se prosterna et dit : « Seigneur, ne te laisse pas tromper par les récits de ce jeune homme; car, tant qu'il restera vivant, le peuple ne cessera de parler de lui et ton cœur en sera préoccupé. »
« Par Dieu, répondit le prince, tu as raison; je vais le faire venir aujourd'hui et mettre à mort devant moi. » Puis il donna l'ordre d'amener le prisonnier qui comparut enchaîné. « Malheur à toi, s'écria Azâd-bakht; crois-tu donc pouvoir me séduire par tes récits et passer tes jours à parler. Je vais te faire exécuter aujourd'hui et je serai débarrassé de toi. »
« Sire, répliqua le jeune homme, tu peux me faire mourir quand tu voudras, mais la précipitation n'amène rien de bon, et la patience est le propre des hommes généreux. Si tu me tues, tu t'en repentiras et, quand tu voudras me faire revivre, tu ne le pourras pas; quiconque agit avec précipitation éprouve les mêmes infortunes que le prince Behzâd.[40] »
« Qu'est-ce que l'histoire du prince Behzâd et de sa précipitation ? » demanda le roi.

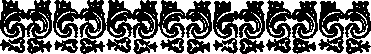
« Sire, reprit le jeune homme, il existait autrefois un roi dont le fils nommé Behzâd n'avait pas son pareil au monde pour la beauté. Il aimait la société et les réunions des marchands et se plaisait à manger avec eux. Un jour qu'il était dans une de leurs assemblées, il les entendit parler de sa beauté et de sa grâce. « De notre temps, il n'y a personne de plus beau que lui, » disait-on. Mais un des assistants répliqua : « La fille de tel roi est encore plus belle. » En entendant ces paroles, Behzâd perdit la tète et, le cœur palpitant, il interrogea cet homme. « Donne-moi des détails de ce que tu avances, prouve-moi qu'elle est plus belle que moi et fais moi savoir de qui elle est fille. »
« C'est la fille de tel roi. » répliqua le marchand.
Aussitôt le cœur du prince s'attacha à elle ; il changea de couleur et rapporta la chose à son père.
« Mon fils, lui dit celui-ci, cette jeune fille que tu aimes n'est pas hors de notre portée; nous pourrons l'obtenir; prends patience jusqu'à ce que je l'aie demandée à son père, » et il envoya des ambassadeurs vers ce roi qui exigea une somme de cent mille dinars.
« C'est possible, répondit le père de Behzâd, et il rassembla le contenu de ses trésors, mais il manquait encore quelque chose. « Prends patience, dit-il, mon fils, jusqu'à ce que nous ayons complété cette dot ; alors je ferai chercher la princesse. » Là-dessus, le jeune homme entra dans une violente colère, s'écria qu'il n'attendrait pas et s'en alla voler sur les grandes routes.
Un jour, il tomba au milieu d'une troupe de gens qui le vainquirent; il fut saisi, lié et conduit au chef du pays ou il exerçait le métier de brigand. En voyant son aspect et sa beauté, le roi conçut des doutes et lui dit : « Ce n'est pas la tournure d'un larron; parle franchement, jeune homme, qui es-tu ? » Behzâd eut honte de révéler sa condition, il préféra mourir et répondit : « Je ne suis qu'un voleur et un brigand. » — « Il ne convient pas, repartit le prince, d'agir à la légère avec ce jeune homme ; il faut examiner son affaire; la précipitation amène des regrets. » Il le fit ensuite conduire en prison et lui donna quelqu'un pour le servir.
Quelque temps après, le bruit se répandit que Behzâd avait disparu. Son père envoya des lettres pour le faire rechercher. L'une d'elles étant arrivée chez le roi qui avait emprisonné le prince, il rendit grâces à Dieu très haut pour n'avoir pas fait preuve de légèreté et fit venir son prisonnier devant lui. a Pourquoi veux-tu, lui dit-il, te faire périr toi-même? »
« Par crainte de la honte. »
« Si tu avais craint la honte, tu n'aurais pas agi avec précipitation. Ne sais-tu pas que les regrets sont les fruits de la légèreté?
Si nous aussi, nous nous étions hâtés comme toi, nous en aurions ressenti du repentir. »
Puis il le relâcha, lui fournit le reste de la somme et envoya informer le père de Beh-zâd et réjouir son cœur par la nouvelle du salut de son fils. Ensuite il dit à celui-ci : « Lève-toi, mon enfant, et va retrouver ton père. » Mais le prince répondit : « Seigneur, mets le comble à tes bontés en me permettant d'aller vers la princesse, car, si je retourne chez mon père, le temps me paraîtra trop long jusqu'au retour du messager qu'il aura envoyé. » Le roi sourit d'étonnement : « Je crains, dit-il, que ta précipitation ne te couvre de honte et que tu n'atteignes pas ton but. » Puis il lui donna des richesses considérables et il écrivit pour le recommander au père de la jeune fille. Lorsque Behzâd arriva, ce prince et les gens de son royaume allèrent à sa rencontre : on lui assigna un appartement somptueux et des ordres furent donnés pour hâter l'arriver de la princesse, conformément à ce qu'avait écrit l'autre souverain.
Le jour de la fête venu, le jeune homme, dans l'excès de son empressement et de son impatience, alla vers un mur qui le séparait de sa fiancée et se mit à regarder par un trou. Il fut aperçu par la mère de la jeune fille qui prit d'un de ses serviteurs deux broches de fer, les enfonça dans l'ouverture par où regardait le prince et lui creva les yeux. Behzâd poussa un cri, tomba évanoui et la joie disparut pour faire place à la tristesse et aux chagrins.
« Considère, ô roi, termina le prisonnier, le résultat de la précipitation et du manque de réflexion du jeune homme; cornaient sa légèreté lui causa de longs regrets et changea sa joie en douleur; vois aussi quelle fut la hâte de la femme qui lui creva les yeux sans réfléchir ; tels sont les fruits de la légèreté. Il convient donc que le roi ne s'empresse pas d'ordonner ma mort, car je suis entre tes mains et, le jour où tu voudras me tuer, tu le pourras. »
En entendant ces paroles, Azâd-bakht s'apaisa : « Ramenez-le à sa prison jusqu'à demain, dit-il; nous réfléchirons à son affaire. »


Le cinquième jour, le cinquième vizir, qui avait nom Djehrbour,[42] se présenta chez le roi et lui dit, après s'être prosterné : « Prince, lorsque tu viens à remarquer ou à apprendre que quelqu'un jette chez toi des regards indiscrets, tu dois lui arracher les yeux. A plus forte raison, celui que tu vois au milieu de ton palais, étendu sur ton lit royal et songeant à te déshonorer, celui-là doit périr nécessairement : nous ne te poussons à agir de la sorte que par affection pour ta dynastie et par zèle de te servir et de t'aimer. Comment est-il possible de laisser vivre un seul instant ce jeune homme? »
Ce discours remplit Azâd-bakht de colère et il ordonna d'amener sur-le-champ le prisonnier ; ce qui fut fait, et, en le voyant, il lui cria : « Malheur à toi ! tu as commis un grand crime; ta vie ne s'est que trop prolongée, il faut absolument que tu périsses : rien n'est pour nous préférable à ta mort. »
« O roi, répondit le prisonnier, sache que devant Dieu je suis innocent; c'est pourquoi j'espère vivre. Celui qui n'a rien à se reprocher n'est pas inquiet de l'avenir ; le chagrin et les soucis ne peuvent triompher de lui, tandis que le coupable sent toujours sa faute peser sur lui. Quand bien même sa vie se prolonge, il lui arrive comme au roi Dâdbin[43] et à son vizir. »
« Quelle est cette histoire? » demanda Azâd-bakht.
Le jeune homme commença :


« Prince, que Dieu éternise ta puissance. Il existait dans le Thabaristan[45] un roi appelé Dâdbin qui avait deux vizirs; l'un se nommait Zoukhân, l'autre Kerdân.[46] Le premier était père d'une fille qui n'avait pas sa pareille au monde pour la beauté, la chasteté et la piété; elle passait sa vie à jeûner, à prier et à adorer Dieu très haut. Son nom était Aroua. Le roi Dâdbin eut connaissance de ses qualités ; son cœur s'attacha à elle, il la demanda en mariage à son père :
« Je désire épouser ta fille, » lui dit-il.
« Prince, répondit le vizir, permets-moi de la consulter, et, si elle y consent, je te la donne. »
« Hâte-toi, » reprit le roi.
Zoukhân alla la trouver et lui fit connaître la demande de Dâdbin.
« Mon père, répliqua la jeune fille, je ne veux pas d'époux; mais, si tu me maries, que ce ne soit qu'à un homme qui soit mon inférieur et que je surpasse en noblesse; de la sorte, il ne me quittera pas pour une autre et ne s'enorgueillira pas devant moi. Autrement, je ne serais près de lui qu'une esclave. »
Son père alla rapporter au prince ce qu'il avait entendu ; toutefois l'amour et la passion du roi ne firent qu'augmenter, il dit à Zoukhân : « Si tu ne la maries pas de bon gré avec moi, je la prendrai de force. »
Le vizir retourna vers sa fille et lui fit connaître ces paroles, mais elle répliqua : « Je ne veux pas me marier. » Le père alla encore rapporter ce refus à Dâdbin qui s'irrita contre lui et lui adressa des menaces. Le vizir emmena sa fille et prit la fuite. A cette nouvelle, le prince fit partir des troupes pourles poursuivre et les ramener : lui-même sortit pour les rejoindre, s'empara d'eux, tua Zoukhân d'un coup de masse d'armes sur la tête, prit de force la jeune fille, la ramena dans son palais et l'épousa. Elle supporta ses malheurs avec patience, se confiant au Dieu très haut à qui elle rendait, nuit et jour, dans le palais de son mari, le tribut d'adoration qui lui est dû.
Un jour, le roi, partant pour une expédition, manda son autre ministre Kardân et lui dit : « J'ai confiance en toi; je veux te confier la garde de la fille de Zoukhân qui est devenue mon épouse; je veux que tu veilles sur elle en personne, car nul au monde ne m'est plus cher que toi. » Kardân se dit en lui-même : « Le roi me fait là un grand honneur, » puis il ajouta tout haut : « Avec amour et obéissance. » Lorsque Dâdbin fut parti, le vizir pensa : « Il faut absolument que je voie cette femme que le roi aime à ce point, » puis il se cacha dans un endroit d'où il pouvait l'apercevoir. Il la trouva au-dessus de toute description ; il en fut troublé et son esprit s'égara. La passion triompha de lui au point qu'il écrivit à la reine : « Aie pitié de moi, je meurs d'amour pour toi. » — « Vizir, lui répondit-elle, tu occupes près du roi un poste de confiance ; ne détruis pas la foi qu'il a en toi, mais que ton intérieur réponde à ton extérieur. Ne songe qu'à ta femme et à ce qui t'est permis; ce que tu ressens n'est qu'un désir charnel. » En entendant ces paroles, le ministre reconnut qu'elle était chaste de corps et d'âme ; il conçut un vif chagrin et craignit pour lui-même la colère du roi. « Je vais, pensa-t-il, inventer une ruse pour la faire périr ou bien pour la déshonorer aux yeux du prince. »
Lorsque celui-ci revint de son expédition, il interrogea son ministre sur les affaires de l'Etat. « Tout est en bonne situation, répondit Kardân, sauf une chose honteuse dont j'ai été informé et que je rougis d'apprendre au roi ; cependant, si je me tais, je crains qu'il n'en soit averti par un autre, et alors, j'aurai trahi la confiance et la foi qu'il a en moi. »
« Parle, lui dit Dâdbin, je te regarde uniquement comme un homme sincère, sûr, prudent en toutes tes paroles et à l'abri du soupçon. »
« Prince, reprit alors le vizir, il s'agit de cette femme à laquelle ton cœur s'est attaché et dont tu vantes la religion, les jeûnes et la prière ; je te découvrirai que tout cela n'est que mensonge et hypocrisie. »
« Que se passe-t-il donc ? » demanda le roi troublé.
« Sache, continua Kardân, que, quelques jours après ton départ, un individu vint me dire : « Vizir, monte et regarde. » J'allai à la porte de l'appartement et je trouvai la reine assise ayant auprès d'elle Abou'l-Kheïr, serviteur de son père, qu'elle a rapproché d'elle et avec qui elle te trompe. Voilà l'exposé de ce que j'ai vu et entendu. »
Dâdbin, transporté de fureur, commanda à un eunuque d'aller tuer Aroua dans son appartement. En entendant cet ordre, cet esclave lui dit : « Que Dieu éternise ton existence, ô roi! Il ne convient pas de la faire périr de cette façon : ordonne plutôt à un de tes eunuques de placer la reine et de la conduire dans un désert où il la laissera. Si elle est coupable, Dieu lui enverra la mort; si elle est innocente, il la sauvera; de cette façon, tu n'auras rien à te reprocher ; car cette femme t'est chère et tu as déjà tué son père dans ta passion pour elle. »
« Tu as raison, lui dit Dâdbin, » et il ordonna à un de ses serviteurs de la transporter sur un chameau dans le désert et de l'y abandonner pour prolonger son châtiment. L'eunuque accomplit ses ordres, la laissa sans provisions ni eau et s'en revint.
Aroua se dirigea vers une colline, joignit ses pieds et se leva pour prier. A ce moment, il arriva qu'un chamelier appartenant au roi Kesra,[47] ayant perdu des chameaux et menacé de mort par le roi s'il ne les retrouvait, s'enfonça dans le désert et arriva à l'endroit où était la jeune femme. Il l'aperçut debout, priant toute seule, et attendit qu'elle eût fini; puis il s'avança, la salua et lui demanda qui elle était'.
« Une servante de Dieu, » répondit-elle.
« Et que fais-tu dans cet endroit écarté ? »
« J'adore Dieu. »
En voyant sa grâce et sa beauté, le chamelier éprouva de l'amour pour elle et lui dit : « Si tu veux me prendre pour mari, je serai pour toi plein de prévenance et d'affection et je t'aiderai à obéir à Dieu très haut. »
« Je n'ai pas besoin d'époux, répondit-elle; je veux vivre ici à l'écart, occupée à servir mon maître. Si tu veux m'aider dans cette entreprise, conduis-moi à un endroit où il y a de l'eau; tu seras mon bienfaiteur. »
Il l'emmena dans une retraite où coulait un ruisseau, la fit descendre, la laissa et s'en retourna plein d'étonnement après avoir retrouvé ses chameaux grâce à la bénédiction de cette femme.
Kesra lui-demanda, à son retour, comment il avait rejoint ses animaux; le chamelier lui raconta l'histoire de la jeune femme et lui fit une telle description de sa beauté que le cœur du prince s'attacha à la solitaire. Sur-le-champ, il monta à cheval avec peu de personnes, alla à l'endroit indiqué et trouva Aroua. La voyant au-dessus de toute qualification, il fut saisi d'amour et lui dit :
« Je suis le roi Kesra, le grand roi ; ne veux-tu pas être mon épouse?
« Laisse-moi, ô prince, répondit-elle; je ne suis qu'une solitaire dans ce désert. »
« Il le faut absolument, reprit-il; si tu n'acceptes pas, je demeurerai ici, aux ordres de Dieu et aux tiens, et je l'adorerai avec toi. »
Puis il ordonna qu'on dressât une tente pour elle et en face, une autre pour lui afin qu'il pût servir le Seigneur avec elle, et fit préparer de la nourriture. Alors Aroua pensa : « Je ne puis pas tenir ce roi éloigné de ses sujets et de son royaume à cause de moi, » puis, s'adressant à la servante qui lui apportait à manger : « Dis au prince qu'il retourne vers ses femmes; il n'a que faire de moi ; je ne désire que ce lieu pour adorer Dieu. » L'esclave alla porter ces paroles à Kesra qui fit répondre : « Je ne me soucie pas de mes Etats; je veux rester ici près de toi et servir le Très-Haut dans ce désert. » La princesse prit alors le parti de céder et dit : « O roi, je ferai ce que tu voudras et je serai ta femme, à condition que tu m'amènes Dâdbin, son vizir Kardân et le chambellan qui lui appartient : ils viendront dans ta salle d'audience et je m'entretiendrai avec eux en ta présence : cela te donnera encore plus d'affection pour moi. » — « Que veux-tu faire? » demanda Kesra. Alors elle lui raconta son histoire d'un bout à l'autre, le langage que lui avait tenu le vizir, enfin elle l'informa qu'elle était l'épouse de Dâdbin.
En entendant ce récit, Kesra sentit redoubler son amour et sa passion. « Agis comme tu voudras, » lui dit-il. Puis il fit venir une litière, y plaça la princesse et la transporta dans sa résidence où il l'épousa. Il conduisit ensuite une armée nombreuse contre Dâdbin, qu'il amena ainsi que son vizir et son chambellan, en présence de la reine, tandis qu'ils ignoraient son dessein. On avait construit pour elle un pavillon; elle y entra, abaissa un rideau, et, lorsque les prisonniers furent introduits, elle leva le voile et dit : « Debout, Kardân, sur tes pieds, car il ne te convient pas d'être assis dans une pareille assistance, en présence du roi Kesra. » A ces mots, le ministre sentit son cœur se troubler ; ses articulations s'affaiblirent, il se leva plein de frayeur. La reine reprit : « Comment te trouves-tu dans cette situation? et toi qui passais pour dire la vérité, qui t'a poussé à me calomnier, à m'exiler de ma demeure, à m'éloigner de mon mari et à causer, par tes calomnies, la mort d'un homme fidèle ? Ce n'est pas là un cas où le mensonge soit permis et la ruse légitime. »
Le vizir, qui avait reconnu Aroua et écouté ces paroles, s'aperçut que la calomnie ne lui avait été d'aucun profit et que la sincérité seule était utile; il baissa les yeux, versa des larmes et dit : « Celui qui fait le mal y trouve infailliblement son châtiment, même si sa vie se prolonge; oui, j'ai commis des fautes et j'ai péché contre toi, poussé par la crainte et la violence d'une passion et d'un amour fatal. Cette femme est chaste, pure et innocente de toute faute. »
A ces mots, Dâdbin se frappa la tête en criant à Kardân : « Dieu t'anéantisse, toi qui m'as séparé de mon épouse et qui m'as fait commettre une injustice ! »
« Il faut absolument que Dieu te fasse périr, répliqua Kesra, toi qui as agi avec précipitation, sans examiner l'affaire, ni distinguer l'innocent du coupable. Si tu avais attendu, le crime aurait été évident à tes yeux ; tu aurais appris que ce mauvais vizir avait l'intention de te tuer : où étaient ta circonspection et ta réflexion ? »
Puis, s'adressant à Aroua : « Que veux-tu que je leur fasse? »
Elle répondit : « Je décide suivant la justice de Dieu très haut : Le meurtrier sera tué ; l'ennemi sera traité en ennemi, comme il a agi envers nous ; le bienfaiteur recevra sa récompense, selon ses mérites envers nous.[48] » Elle fit périr le roi Dâdbin d'un coup de masse d'armes sur la tête en disant : « C'est ainsi qu'il a assassiné mon père. » Quant au vizir, elle le fit placer sur une bête de somme et transporter dans le désert avec ces paroles : « Si tu es coupable, ta faute retombera sur toi et tu périras de faim et de soif dans la solitude ; si tu n'as rien à te reprocher, tu seras sauvé comme je l'ai été. » Pour l'eunuque qui avait conseillé à son maître de l'envoyer dans le désert, elle le revêtit d'un vêtement d'honneur d'un grand prix en disant : « Les princes doivent, dans leur intérêt, rapprocher de leurs personnes ceux qui te ressemblent : tu as parlé suivant la vérité et la bonté ; ainsi chacun sera rémunéré selon ses œuvres. » Ensuite Kesra lui donna le gouvernement d'une province de son royaume.
« Sache, ô prince, que celui qui fait le bien recevra du bien et que celui qui n'a ni faute ni péché à se reprocher ne redoute pas l'avenir. Je n'ai aucun reproche à me faire, et j'espère que Dieu découvrira la vérité au roi fortuné et qu'il me fera triompher de mes ennemis et de mes envieux. »
Lorsqu'Azâd-bakht entendit ces paroles, sa colère s'apaisa et il fit ramener le captif dans sa prison, pour réfléchir jusqu'au lendemain sur son affaire.

[1] Un volume gr. in-8°, Paris, 1878, forme le t. VIII de la collection des Publications de l'Ecole des langues orientales.
[2] Il ne s'agit pas de la version sanscrite du Pantchatantra telle que nous la possédons aujourd'hui, mais de celle d'après laquelle a été faite, au vie siècle, la version pehlvie de Barzouyeh.
[3] Voir la cinquième Journée
[4] Hyde, qui donna le facsimilé de la première page dans sa Religio veterum Persarum, le prenait pour le code des lois de Djenguiz-Khan écrit en khitaï, W. Jones (Asiatic Researches) en faisait du mauvais coufique, Langlès y voyait du moghol
[5] Cet ouvrage, après avoir été décrit par A. Jaubert (Notice d'un manuscrit turc en caractères ouigours. Paris, 1825) et Davids (Grammaire turque, pl. III, pp. 184. 186), a été publié par M. Vambéry : Uigurische Sprach-monumente und das Kudat Kubilik, Text, Transcription, Uebersetzung, Glossar, etc., in-4°. Innsbruck, 1870.
[6] Le Mirâdj-Nameh, publié pour la première fois d'après le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque nationale par M. Pavet de Courteille. Paris, 1882, gr. in-8°, forme le tome VI de la 2e série de la collection des Publications de l'Ecole des langues orientales.
[7] Jaubert, dans sa Notice, et Davids, qui parait l'avoir copié, disent que la copie du Koudat, Koubilik date de 853 de l'hégire et celle du Mirâdj-Nameh de 840, et ils assimilent 853 à 1459 et 840 à 1456, commettant ainsi une erreur de dix ans dans leur comparaison des deux calendriers. Que Jaubert ait mal lu le nombre ouïgour ou qu'il se soit trompé, faisant passer les dates musulmanes dans l'ère chrétienne, il n'en reste pas moins acquis que le manuscrit du Bakhtiâr est plus ancien que les deux autres. A ces ouvrages, il faut joindre l'Oghouz-Nameh, récemment découvert.
[8] Iéna, in-12, 1789. L'ordre des contes a été absolument modifié et quelques-uns ont disparu. En voici la liste :
1° Melekschah et Schahkadun (10e hist. de la version arabe);
2° L'heureuse condamnation à mort (11e) ;
3° Les caprices du destin ; histoire d'Abu-Bekr (1er) ;
4° Abu-Tamam
5° Le danger de vivre à la cour
6° Kaireddin ou les dangers de la précipitation (2e) ;
7° Il est si beau de pardonner (7e) ;
8° La prédiction (9e) ;
9° Mach-Allah et Beherdschur, ou l'amour maternel à l'épreuve (introduction) ;
10° Mach-Allah et Beherdschur, continuation et conclusion (introduction) ;
11° Abu-Saber ou la patience (3e).
[9] Citée par M. A. Keller, Li Romans des Sept Sages, Einleitung, p. xi.
[10] A la suite de sa Disquisitio de fide Herodoti.
[11] Knös, Historia decem vizirorum, préface.
[12] Tausend und eine Nacht, t. VI, pp. 191-343, comprenant les Nuits 435-486. Ce texte a sans doute passé dans la traduction allemande du même auteur que je n'ai pu consulter. Il existe aussi à la bibliothèque de Leyde Cf. Cat. Codic. Orient. bibl. acad. Lugd Batav., t. I, n° 463, fonds arabe. Voir l'appendice.
[13] Bakhtiar-Nameh, ou le favori de la fortune, Préface, p. vii.
[14] Supplément persan, n° 910 et 911. Le premier est daté de 944 de l'hégire (1537 de J-C); le second est de la même époque. La bibliothèque de Leyde (Catalogus codic. orient., t. I, n° 494) possède un manuscrit de la version persane, daté de 895 hég. (1489). Il en existe également deux exemplaires à la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford. C'est donc au moins à la fin du xve siècle qu'il faut faire remonter la rédaction des recensions persanes telles que nous les connaissons.
[15] Bakhtiâr-Nameh, texte persan, 1 vol. in-4°.
[16] J'ignore quel peut être le nom qui se cache sous Kanim-Madoud; la ville n'est pas nommée dans les versions persanes.
[17] Le Sedjestan ou Séistan est un pays partagé aujourd'hui entre la Perse et l'Afghanistan, et célèbre dans l'histoire fabuleuse de l'Iran on y montre les restes de l'écurie du héros Roustem, au temps du géographe Yaqout, cette province était peuplée de Kharedjites (dissidents) qui se faisaient remarquer par leur probité et leur charité C'est aux habitants de cette contrée que les Orientaux attribuent l'invention des moulins à vent (cf. Barbier de Meynard, Dictionnaire géographique de la Perse, p. 300) Dans les Mille et une Nuits (éd Habicht, t. VI, nuit 435), ce pays est nommé, par erreur, Sébestân au heu de Séistan, autre forme de Sedjestan. En outre, dans les versions persanes, le Seistân est donné comme le royaume même d'Azâd-bakht, qui s'étendait depuis l'Hindoustan jusqu'à la mer
[18] Au lieu d'Isfehend, qui porte le texte de Knoes, il faut lire Isfehbed, en persan Ispehbed. Le déplacement d'un point diacritique explique ce changement. Ispehbed signifie général en chef. Sous les Sassanides, ce titre était donné aux gouverneurs de provinces (cf. Maçoudi, Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, t II, p. 153) Dans les textes persans, le vizir est appelé Sipeh-salar, qui signifie également général, chef d'armée.
[19] Pour Azâd-Châh (noble roi), les rédactions persanes ne font mention ni de ce projet ni de ce roi : suivant elles, le vizir, ne pouvant se passer de sa fille, la faisait venir près de lui, lorsqu'elle fut rencontrée par Azâd-bakht.
[20] Ce nom, qui ne se rencontre pas dans les versions persanes, est formé des deux mots persans behreh, sort, lot, et gour (arabe, djour), fortune. Le texte persan du Bakhtiar-Nameh, lithographie à Paris, appelle cette princesse Khatoun-Chah.
[21] Les versions persanes ne mentionnent pas l'intervention du premier vizir.
[22] Dans le texte persan, c'est la reine qui conseille de fuir dans le Kermân.
[23] Le Kermân est une des provinces méridionales de la Perse, située entre le Baloutchistân, le Khorassan, le Fars et le golfe Persique. Les légendes persanes font dériver son nom soit de Kerman, arrière-petit-fils de Japhet, fils de Noé, soit d'un certain Bakhté-Guerm, qui lutta avec le roi sassanide Ardeschir (Artaxerxès) Babégân. D'autres traditions attribuent la culture et la civilisation de ce pays à une troupe de philosophes qui y auraient été déportés. Sous les Sassanides, l'impôt payé par cette province était de soixante millions de drachmes. Elle fut conquise par les musulmans sous les khalifes 'Omar I et 'Otsmân. Le Kermân n'eut pas de souverains indépendants, mais sa prospérité fut à son comble sous les Seldjouqides (cf. Barbier de Meynard, Dictionnaire géographique de la Perse, pp. 482-486).
[24] Dans les versions persanes, les mille dinars sont remplacés par dix perles formant un bracelet.
[25] Le chef des voleurs est nommé Ferroukh-Souvar (Cavalier fortuné) dans les recensions persanes (Lescallier, à tort : Fareksavar); et l'enfant, Khodadâd (Dieudonné).
[26] Le nom de Kathrou ne se trouve que dans le texte de Knoes, et n'a été porté par aucun roi de Perse; il n'est d'ailleurs pas plus persan qu'arabe.
[27] Les versions persane et ouïgoure donnent au fils d'Azâd-Bakht le nom de Bakhtiar (Fortuné), qui a fourni le titre du roman : Bakhtiar-Namèh ; en outre, elles pré sentent un récit plus détaillé des aventures du favori : le roi commence par l'attacher au service de ses écuries, une des charges les plus importantes de la cour de Perse (cf. Dubeux, La Perse, p. 461); de là, Bakhtiar arrive aux fonctions de trésorier.
[28] Comme on l'a vu dans l'introduction, d'après les versions persanes, le roi se contente, le premier jour, de faire enfermer Bakhtiar après son entrevue avec le vizir et l'interrogatoire de la reine C'est seulement le second jour et après les conseils de mort donnés par le second ministre, que le prisonnier raconte l'histoire du marchand persécuté par le sort. Celle-ci est la première dans toutes les recensions. Les Mille et une Nuits de l'édition de Habicht (t. VI, nuits 440-444, pp. 206-215), le ms. du British Museum et le texte de Knoes placent cette histoire le premier jour. Elle occupe les nuits 441-442 dans la traduction des Mille et une Nuits de Gauthier (tome IV).
[29] Cette partie de l'histoire se retrouve, avec quelques modifications, dans un conte des Mille et une Nuits (t. arabe, éd. de Boulaq, in-4°, t. I, 83-88) ; aventure du jeune homme qui cherche à vendre un collier de perles appartenant à sa maîtresse, jadis assassinée par une rivale et faussement accusé par un joaillier, qui prétend avoir été victime d'un vol. C'est peut-être à l'histoire du marchand infortuné que Pétis de La Croix a emprunté l'épisode d'Atalmulc précipité dans la mer par ses associés, puis dénoncé par eux comme coupable du vol devant le cadi d'Ormus, et sauvé par la déposition des paysans qui l'avaient recueilli (cf. Mille et un jours, lxxxive jour).
[30] Le texte des versions persanes de Lescallier, Gauthier, Ouseley et de l'édition de Paris, présente quelques variantes : il place la scène à Basrah, ne mentionne pas la consultation de l'astrologue ; avant même d'avoir constaté le vol, le marchand avoue les détournements au vieillard qui l'a recueilli. A la suite de son expulsion, il reçoit six perles des plongeurs; les voleurs lui enlèvent celles qu'il a cousues dans son vêtement et non celles qu'il a cachées dans sa bouche : le joaillier qui l'accuse de vol est de mauvaise foi, comme dans le conte des Mille et une Nuits cité plus haut ; le marchand est délivré par le chef des plongeurs quia voyagé avec le roi dans le Turkistân ; enfin, devenu trésorier, il est dénoncé par un vizir jaloux, mais son innocence est reconnue presque immédiatement âpre» qu'on lui a crevé les yeux. La version arabe, plus simple que les rédactions persanes, fait une plus grande part à la mauvaise fortune Le texte de Habicht s'accorde avec celui de Knoes Dans le manuscrit du British Museum, ce récit est intitulé Histoire du marchand de Perse.
[31] Le texte arabe porte Behroun, qu'il faut probablement corriger en Behrévan (Bon esprit). Le nom du vizir n'est pas donné dans les textes persans.
[32] Dans toutes les rédactions persanes, ce conte est placé dans la huitième journée, en réponse aux arguments du huitième vizir. Le texte de Habicht, où il occupe les nuits 444-448, et celui du British Museum s'accordent avec l'édition de Knoes. Les deux enfants n'y portent pas de noms, tandis que dans les autres versions, sauf peut-être celle en ouïgour, ils sont appelés Rouzbeh et Behrouz (Jour heureux et Heureux jour). On peut aussi relever quelques différences dans les détails : ainsi le joaillier n'obtient pas la permission de retourner dans sa patrie il fait venir sa femme et ses deux fils, et c'est en allant au-devant d'eux qu'il rencontre au matin ces derniers, non sur un bateau, mais au bord de la mer, près de l’endroit où, la veille, il a oublié une bourse d'or Behrouz est adopté par un roi, à qui il succède, Rouzbeh, devenu plus tard son favori, n'est pas victime de la perfidie des courtisans ; il est arrêté par les gardes qui le trouvent armé sur la terrasse du palais, près du roi endormi ; son supplice est différé à cause d'une guerre que Behrouz a à soutenir contre un prince voisin. On remarquera que, pour le fond, cette histoire ne diffère guère de celle qui sert de cadre à ces récits.
[33] Le rédacteur anonyme de ce conte a peut-être imité le passage de Kalilah et Dimnah (chap. v, éd. de Boulaq), où Dimnah, par ses calomnies, met en garde l'un contre l'autre le lion et le taureau et sème ainsi la division entre eux. Une aventure semblable arriva sous le règne du Khalife El Motaouakkel, lorsque ses courtisans cherchèrent à perdre dans son esprit Boghâ l'ainé, un des chefs de la milice turke (cf. Maçoudi, Prairies d'or, éd. Barbier de Meynard, t. VI, chap. cxvii. pp. 259-262). On sait qu'une perfidie de ce genre amena l'assassinat de l'empereur Aurélien (Flavius Vopiscus, Vie d'Aurélien, dans l’Histoire auguste, ch. xxxvi).
[34] La situation du fils du joaillier, devenu roi et sur le point de tuer son frère qu'il ne connaît pas, se retrouve dans un chant populaire grec : Les deux frères, dont l'un, devenu capitaine de voleurs, tue son frère qui s'est fait muletier (Marcellus, Chants populaires de la Grèce moderne, p. 146). Les reconnaissances de frère et de sœur, d'enfants et de parents, font le sujet de nombreux contes et chansons en russe, en espagnol, en français, en grec, en allemand, etc. Cf. de Puymaigre, Les vieux auteurs castillans, t. II, chap. xii. Dans un conte berbère que j'ai recueilli à Frendah, d'un individu de Bou-Semghoun, qsar du sud oranais, toute une famille, dispersée depuis des années, se retrouve et ne se reconnaît que par le récit fait par chacun de ses aventures.
[35] Les aventures d'Abou-Sâber forment dans toutes les rédactions le sujet de la troisième histoire, mais, comme partout, les textes persans diffèrent de l'arabe. Le meurtre du collecteur d'impôts et les ravages du lion y sont mêles Abou-Sâber, qui n'est plus qu'un homme pauvre, montre de l'égoïsme plutôt que de la résignation Lorsqu'il est employé à la construction du palais, c'est lui et non un de ses compagnons d'esclavage qui se casse la jambe, le tyran meurt d'une colique et non dans une insurrection il est remplacé par son prisonnier qui seul a pu deviner les trois énigmes dont la solution devait donner le trône. Cette épisode ne laisse pas subsister l’apparente contradiction qui existe entre la conduite d'Abou-Sâber et sa sagesse renommée lorsqu'il enlevé deux enfants à des voleurs repentants qu'il fait mettre à mort, et la femme d'un homme qui vient se plaindre à lui, enfin, lorsqu'il se montre sévère envers un roi détrôné. Les enfants sont ramenés par un marchand à qui le ravisseur les a vendus
La traduction de Gauthier (nuits 443 444) suit le texte arabe, comme celle des Mille et une Nuits de l'édition Habicht (nuits 448 (.53) Celles de Lescallier et la version du texte lithographie à Pans s'accordent avec la recension d'Ouseley.
L'histoire d'Abou Sâber se trouve dans les Onze jours (Die eilf Tage, récit xi)
L'intérêt dramatique est beaucoup moins vif dans ces dernières.
[36] Lors de la conquête arabe, les Dihqans (du persan Deh, village, et Khân, seigneur) formaient une sorte de noblesse territoriale bientôt abaissée par les vainqueurs au niveau du reste de la population. Ce nom prit alors la signification de propriétaire foncier et même de villageois. Cependant, aujourd'hui encore, on l'emploie quelquefois dans le sens de chef de village.
[37] Le texte arabe de Knœs porte Qaramân, par un qaf ; ce qui s'entendrait alors de la province d'Asie-Mineure, appelée par les Européens Caramanie. Le texte suivi par Gauthier prouve qu'il faut rétablir Kermân, le lieu de la scène étant en Perse comme dans les autres contes.
[38] Le 28e exemple conté par Patronio au comte Lucanor est peut-être emprunté à la même source que cet épisode : Rodrigo Melendez de Valdes, ou, suivant les éditions imprimées, Pedro de Melendez, avait coutume de remercier Dieu pour tout ce qui arrivait, estimant, comme Candide, que c'était pour le mieux. Un jour il se cassa la jambe et loua Dieu, bien qu'il ignorât que par là il échappait aux embûches que ses ennemis lui avaient tendues avec l'autorisation du roi (cf. les Œuvres de D. Juan Manuel dans les Prosateurs espagnols antérieurs au xve siècle, p. 385; de Puibusque, le Comte Lucanor, pp. 258-365).
[39] Au lieu de Zouchâd que porte le texte arabe et qui n'a aucun sens, j'ai rétabli Rouchâd qui signifie en persan visage joyeux.
[40] Lescallier nomme ce prince Bahèzâd et Gauthier Behézâd, formes incorrectes pour Behzâd, bien né.
[41] D'après les versions persane et malaie (Niemann, Blœmlezinguit maleische Geschriften, t. I, p. 54), Behzâd était fils d'un roi de Haleb (Alep). La princesse dont il tombe amoureux est Nikanne, fille du roi de Roum, dont il entend parler par un de ses amis qui a été à Constantinople Le roi de Haleb est obligé d'écraser son peuple d'impôts pour fournir les 100 lakhs de roupies, demandés pour prix de la main de la princesse L'impatience de Behzâd le pousse à attaquer une caravane dont le chef lui fournit, quand il l'a reconnu, les moyens de compléter la somme Le prince est aveugle par Nicarine, non par sa belle-mère, et après la mort de son père, les gens de Haleb se choisissent un autre roi.
Les versions de Gauthier (n. 442-443), de Lescallier, de l'édition de Pans et d'Ouseley et la version malaie sont les mêmes, avec plus de détails dans la première
Le texte de Habicht (nuits 453-455) est analogue a celui de Knœs.
[42] Le nom du cinquième vizir, Djehrbour pour Djehrpour, qui ne se trouve que dans les textes arabes, signifie en persan fils de la Renommée.
[43] Le sens de Dâdbin est « qui discerne le bon droit ». Par erreur, Gauthier le nomme Dâbdin; Ouseley, Dadéin, l'édition de Paris et le texte ouïgour, Dâdîn (Jaubert, Notice et extrait de la version turque du Bakhtiar Nameh, p. 15 ; Davids, Grammaire turke, p. 177).
[44] Les versions persanes : Gauthier (nuits 445-448), Ouseley, Lescallier et édition de Paris diffèrent des textes arabes et ouïgour. Dans les premières, c'est Kardar qui, désespérant d'obtenir la main de la fille de son collègue, pousse le roi à la demander pour lui-même, comptant la lui enlever par une calomnie. Après que Dâdbin a épousé Aroua et tué son ministre, il part pour une expédition, laissant le soin des affaires à Kerdân, mais sans lui con fier la garde de la reine. Celle-ci, calomniée près de son mari, n'échappe pas au supplice, grâce aux représentations d'un eunuque, mais par l'intervention du vizir qui espère la retrouver dans le désert. La princesse, recueillie par un chamelier, est reconnue innocente par son mari qui fait périr le ministre calomniateur, après qu'il l'a convaincu du mensonge.
La version ouïgoure donne les mêmes détails que les textes arabes de Knœs et de Habicht (nuits 455-461).
Il existe, en outre, quelques différences secondaires entre les deux recensions ; dans la persane, le royaume de Dâdbin n'est pas nommé, non plus que la fille du vizir, ni son serviteur Abou'lkhéir qui devient un bouffon. L'arabe seul donne le nom de ce dernier.
On remarquera que l'histoire du mariage de Dâdbin avec Aroua est, à peu de chose près, la reproduction de l'histoire du mariage d'Azâd-bakht avec Behrédjour. Le reste du récit, dans le texte persan, est une variante du conte de Geneviève de Brabant.
[45] Le Thabaristan est une province du nord de la Perse, située sur le bord de la mer Caspienne. Une tradition fait venir le nom de ce pays des mots persans Thabar (hache) et Zènân (femme), et raconte qu'un roi de Perse ayant déporté, dans cette province montagneuse, alors couverte de forêts, tous les criminels du royaume, ceux-ci demandèrent des haches pour se construire des maisons, et des femmes pour fonder des familles : d'où Thabar-Zènân, et par corruption Thabaristan. La même étymologie, tout à fait dans le goût oriental, s'explique d'une autre façon, par ce fait que chaque habitant, jeune ou vieux, porte continuellement une hache à sa ceinture (Thabaristan, pays des haches). Sous les Achéménides, le chef de cette province se nommait Espehboud (ou Ispehbed) et transmettait le gouvernement à son fils. L'historien national Zahir-eddîn rapporte qu'après le partage des états d'Alexandre, le Thabaristân échut à un descendant des anciens rois : ses descendants régnèrent jusqu'au temps du roi sassanide Qobad, fils de Firouz, qui y établit son fils Kelous. Celui-ci y fonda une nouvelle dynastie. La conquête du pays parut si difficile aux Arabes qu'ils se contentèrent longtemps d'une soumission nominale. Ce fut seulement sous le khalifat d'El Mamoun (ixe siècle de notre ère), que les montagnes les plus sauvages, dernier asile de l'indépendance du Thabaristan, furent conquises par Mousa ben Hafs. La ville principale de cette province est Amol, fondée suivant une légende par Djamschid, Faridoun ou Thahomourz (cf. Barbier de Meynard, Dictionnaire géographique de la Perse, pp. 38o-387). Dans le texte ouïgour, Didbin règne dans le Tataristân (pays des Tatars).
[46] Au lieu de Zouhhan et de Kardân (intelligent), les textes persans donnent Kamkar (puissant) et Kardâr (actif), et la version ouïgoure Kerdân et Kourdâr (pour Oourdâr, joyeux?).
[47] Le nom de Kesra (Chosroès, des Grec), est l'altération arabe du persan Khosrou. Les Orientaux le donnaient à tous les princes sassanides, comme Qaïsar (César) à ceux de Byzance; Faghfour, aux rois de la Chine; Tobba', à ceux du Yémen ; Nedjâchi, (Negouch), aux souverains d'Abyssinie ; Fera'oun (Pharaon), à ceux d'Egypte. Deux des derniers princes de la dynastie nationale des Ghaznévides portèrent aussi ce nom : Khosrou-Châh, fils de Behrâm-Chah, et Khosrou-Moulk, son fils.
[48] C'est la loi du talion, comme elle est indiquée dans le Coran, Sourate, II, verset 173 : « O vous qui croyez, le talion vous est prescrit pour le meurtre : un homme libre pour un homme libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme. » Cf. aussi les Sourates V, 49, XXII, 113. Il est vrai que Mohammed ajoute (Sour. II, v. 173) : « Celui à qui son frère remet une peine semblable, doit être traité avec humanité et il doit s'acquitter par des bienfaits.