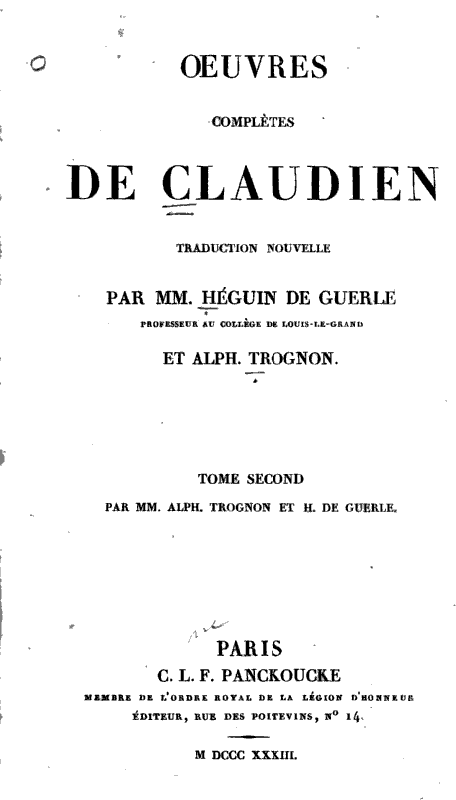
Claudien
LETTRES.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
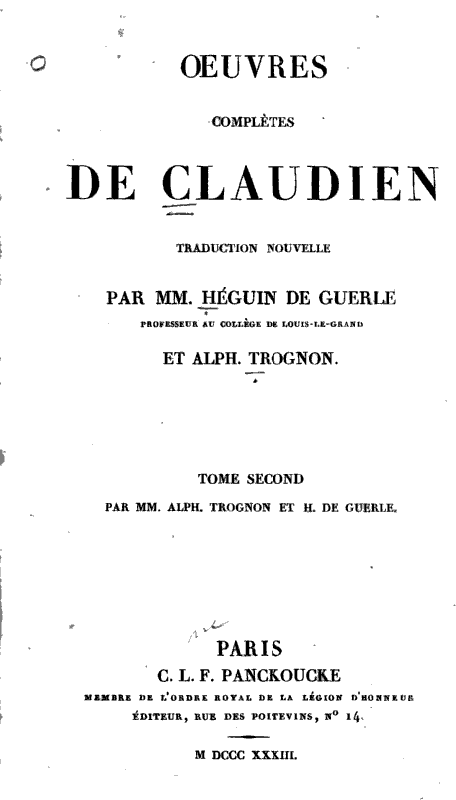
LETTRES.I.A Hadrien, préfet du prétoire.Eh quoi ! l’élan de votre colère doit-il se prolonger si longtemps? Mes yeux verseront-ils toujours des larmes? Changez-vous tout à coup votre faveur en haine? Et cette âme qui ne saurait faire le mal, et ces sentiments d’humanité, que sont-ils devenus? L’envie aura-t-elle donc tant de puissance? laisserez-vous tant d’empire à ses jalouses clameurs? Oui, j’en conviens, imprudent, la douleur et la jeunesse toujours inconsidérée m’ont égaré. L’orgueil m’a poussé, une ardeur insensée m’a trompé. Mais vous, deviez-vous lutter contre moi avec les mêmes armes? Les dieux ne sont-ils pas sourds aux reproches des mortels? leurs vains outrages ne troublent jamais la paix du ciel. Mes châtiments ont comblé la mesure. Pardonnez à un ennemi terrassé. Me voici, j’avoue mon crime, et j’implore mon pardon. Achille, malgré son courroux, épargna les restes d’Hector; Oreste apaisa les Furies qui vengeaient sa mère; Hercule rendit à Priam les citadelles qu’il lui avait prises; le héros de Pella s’attendrit à la vue d’un roi détrôné: il plaignit Darius d’avoir succombé sous les coups d’un esclave, et consola son ombre plaintive par un superbe mausolée; il rendit à Porus, captif, l’inde, agrandie de nouvelles provinces. C’est lui qui fonda notre commune patrie; c’est ainsi qu’il pardonnait à ses ennemis. Votre vertu vous appelle à marcher sur ses traces Si j’ai offensé quelqu’un des habitants de l’Olympe qu’il m’écrase dans sa vengeance, et repaisse sa fureur. J’ai perdu vos faveurs, et voici que déjà la pauvreté hideuse me poursuit. Ma maison est déserte : je suis privé de mes plus chers amis. L’un expire au milieu des supplices, l’autre traîne dans l’exil sa triste destinée. Quels malheurs encore puis-je éprouver? quels nouveaux dangers peuvent m’assaillir? Quand on peut déchirer son ennemi, quand on peut lui arracher la vie, le courroux se calme. Les bêtes sauvages s’éloignent de la proie qui est sous leurs pieds, et le lion farouche laisse, quand il l’a terrassée, la victime qu’il brûlait d’abattre sa faim n’aime à s’assouvir que sur le corps d’un taureau indomptable qui résiste à ses attaques. L’envie a rompu les premiers fils de mes naissantes destinées, et son deuil est venu empoisonner ma joie. Vaincu par le supplice, j’embrasse vos genoux ; jetez sur ma faiblesse un regard désarmé. Pourquoi honorer d’un si violent courroux un si chétif ennemi? Éole n’essaie point sa fureur sur des antres étroits; une humble colline n’est pas le théâtre des combats de Borée l’un ébranle les Alpes, et l’autre agite les sommets du Rhodope. La flamme céleste ne s’est jamais arrêtée sur la tête du saule; la modeste bruyère est indigne de la colère du maître du tonnerre: ce ne sont que des chênes immenses, et des frênes séculaires, qu’il faut aux coups de la foudre. Que ces vers soient pour vous le rameau du suppliant, l’olivier de Minerve, un pieux encens. Prenez pitié de vos clients ! Oui, rendez-moi à moi-même; versez un baume salutaire sur mes cruelles plaies; rendez-moi à l’honneur, à la vie. Que l’édifice de ma fortune, par vous renversé, se relève par vous. Télèphe revint guéri par la lance d’Achille, dont il avait senti le poids; la main qui l’avait frappé le rappela à la vie: ce fut son ennemi qui le guérit, et qui ferma lui-même les blessures qu’il avait ouvertes. Si mes prières, si mes larmes ne peuvent vous tour cher, foulez aux pieds les Muses, arrachez-moi de funestes honneurs, le prix de mes services militaires; chassez un ancien ami, un ancien compagnon farines. Qu’ils seront beaux les triomphes remportés sur un pauvre poète Qu’elles seront nobles les dépouilles qui enrichiront votre victoire ! Égyptien comme nous, que votre pouvoir écrase vos malheureux concitoyens ! Que notre commune patrie entende ces plaintes, que Pharos, si connue des vaisseaux, en soit émue, et que, levant au dessus de ses flots son visage baigné de larmes, le Nil pleure notre sort sur ses rives nombreuses. II.A SérèneQuand pour la première fois l’Hymen éclaira de son flambeau- l’union d’Orphée et que ses chants de fête retentirent dans les plaines de Thrace, les bêtes sauvages et les oiseaux, aux mille couleurs se disputèrent l’honneur d’offrir à leur poète les plus beaux présents. Tout plein du souvenir de la grotte dont les échos sonores avaient offert un noble théâtre aux accords harmonieux de sa lyre divine, le lynx apporte le cristal arraché aux entrailles du Caucase; le gryphon les lingots d’or que recèlent les régions hyperboréennes. Les colombes, dans leur vol rapide, dérobant aux bosquets de Vénus leurs trésors, tressent des couronnes de fleurs entremêlées de roses; et le cygne, dépouillant les sœurs de Phaéton de l’ambre que distillent leurs rameaux, vient des rivages de l’Eridan lui offrir ses parfums. Les grues, repassant le Nil après leur guerre contre les Pygmées, recueillent les perles précieuses de la mer Rouge. Le vieux phénix vient aussi des derniers confins de l’Orient, tenant dans sa serre recourbée un baume précieux. Pas un oiseau, pas un animal ne refuse de porter à cette lyre divine les présents de noces dont elle est si digne. Calliope alors parait sa bru de ces richesses et de tous les trésors de l’Hélicon. Mère pleine de tendresse, elle osa convier la maîtresse du radieux Olympe aux noces de son fils: la reine des dieux ne rejeta pas sa demande, peut-être pour honorer la mère, peut-être aussi par une juste faveur pour la piété du poète. Souvent, en effet, ses vers, comme une offrande, avaient paré ses autels, quand d’une voix pure il chantait la puissance de Junon, ou les coin- bats de son époux, armé de La foudre, dans les plaines de Phlégra; et les menaces des Titans et d’Encelade se tournant contre eux-mêmes. Aussi, voulant que sa présence consacrât la première nuit de cette union, elle orna de présents célestes la couche nuptiale. Jamais beauté mortelle ne fut parée de tels dons; les dieux seuls peuvent en jouir. Eh bien ! ce que Junon, dans sa bonté, fut pour Orphée, Sérène, vous pouvez l’être pour moi. Les astres, ses esclaves, attendent un signe de sa tête; et vous, la terre et la mer sont soumises à vos lois. Lorsque je demandais une épouse, à l’exemple de tous les amans, je ne promis pas des pâturages couverts de mes troupeaux, mille collines ombragées au loin de mes vignobles, mille oliviers balançant leur verte chevelure, de riches moissons tombant sous d’innombrables faucilles, ou de majestueux palais dont le faîte repose sur des poutres dorées. Une divinité prescrivait cette union, ce fut assez; oui, Sérène, votre lettre m’a tenu lieu de troupeaux, de moissons, de palais. Elle a fléchi les parents, l’ombre de votre nom a voilé de sa majesté la pauvreté du poète. Eh ! quand Sérène écrit ses ordres, que ne ferait pas le génie de l’état, ou l’empire qu’elle exerce sur les cœurs? Plût aux dieux que je plisse, éclairé par les rayons de votre tête divine, célébrer ce jour si désiré dans le camp de votre époux, aux pieds du trône où s’assied votre gendre ! La pourpre serait pour notre union un présage propice; la cour m’environnerait d’une auguste assemblée; et cette main, qui naguère dans ses lettres me promettait ma jeune épouse, la remettrait elle-même entre mes bras ! Mais puisque la mer qui nous sépare s’oppose à des vœux peut-être trop hardis, et s’étend entre vous et les rives de la Libye; ô reine ! malgré votre absence, soyez- nous favorable; qu’un signe de vos puissants sourcils me promette un heureux retour ! C’est vous qui pouvez m’ouvrir une route vers la terre que vous habitez; c’est vous encore qui ordonnerez au doux Eurus de calmer la mer, de la rendre plus favorable alors les Muses et la source inspiratrice d’Aganippe chanteront en chœur les vœux que formera pour sa protectrice le fidèle serviteur conservé par vous. III.A Olybrius.Que penser? quoi ! votre main ne trace point quelques lignes pour moi? elle ne me renvoie pas à son tour un salut? Est-il si pénible d’écrire? et pourtant, qui peut égaler votre facilité, soit que vous composiez des vers, soit que, nouveau Cicéron, vous tonniez à la tribune? En vous, la fortune le cède aux trésors de l’esprit, et votre éloquence surpasse encore vos immenses richesses. N’avez-vous personne pour porter vos écrits? Mais non, à toutes les heures du jour, vos courriers inondent de poussière la voie Flaminienne. Quand votre génie déborde, quand un messager est toujours prêt à porter vos écrits, le mépris seul est à mes yeux cause de ce silence. Ainsi, vous dédaignez, je dois le croire, un poète qui vous fut cher; et votre infidèle amitié s’éteint par l’absence. Votre cœur m’a-t-il donc oublié? Oh ! non; puisse plutôt le Soleil se plonger dans l’Hydaspe ! puisse l’Aurore sortir des mers de l’Ibérie; l’Égypte, par un changement subit, blanchir sous les frimas du Gète, et l’Ourse éteindre ses feux dans des flots qui lui sot interdits ! Oui, si Olybrius méprise déjà mon attachement, Oreste n’a jamais aimé Pylade. Allons, plus de retards, plus d’obstacles; que les richesses de votre génie instruisent votre ami loin de vous. Que souvent vos lettres éloquentes hâlent leur course vers moi; que je les presse sur mes lèvres et sur mon cœur ! César ne dédaignait pas d’écrire à l’humble Virgile; et vous, vous rougiriez de m’écrire? Oh ! alors, adieu la poésie ! IV.A Probinus, pour l’engager à écrire.Quand donc, je vous en supplie, cessera notre silence mutuel? Quand donc une lettre de vous m’apportera-t-elle une douce réponse? Suis-je trop timide, ou plutôt seriez-vous trop orgueilleux? Oui, tous deux nous sommes coupables. Les jours se sont écoulés; et, en rougissant d’écrire le premier, on se laisse entraîner dans d’éternels retards. Mais, que faire? Le respect que je vous dois m’empêche de commencer; l’amitié m’ordonne d’écrire : eh bien, que l’amitié l’emporte ! Le hasard favorise l’audace, le poète de Cée l’a dit. Sa pensée me guide, et je ne crains plus de parler, quand vous gardez le silence. Si j’ai commis une faute, on accusera ma hardiesse; jamais on ne m’accablera du reproche d’ingratitude. C’est sous votre consulat que, pour la première fois, j’ai puisé aux sources du Latium, et que ma Muse, oubliant la Grèce, a revêtu la toge romaine. A mon début, vos faisceaux que j’ai chantés m’ont été d’un heureux présage: c’est à vous que je devrai mon avenir. Cette lettre est un défi, ne la laissez pas, je vous prie, sans réponse, Probinus. Adieu; jouissez en paix du bonheur que vous a légué votre pare. Adieu ! V.A Gennadius, ex-proconsul.O toi, l’honneur de l’Italie, habitant des bords heureux du Rubicon; toi, après Cicéron, le plus bel ornement de la tribune romaine, connu des peuples de la Grèce et du Nil qui m’a vu naître les deux nations craignent et chérissent également tes faisceaux. Tu me demandes des vers qui puissent consoler ton esprit de ses longues privations? J’en atteste l’amitié, il n’en reste plus au logis : se fiant à leurs ailes, ils quittent bientôt leur nid, et, méprisant leurs pénates, ils s’envolent, pour ne plus revenir.
|