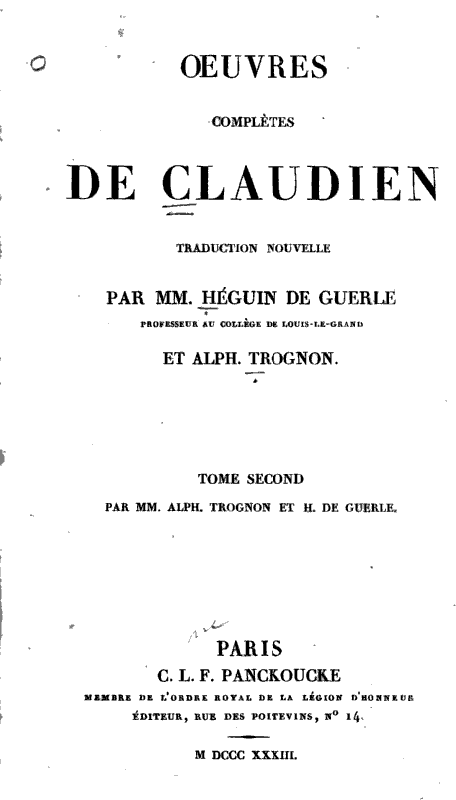
Claudien
IDYLLES.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
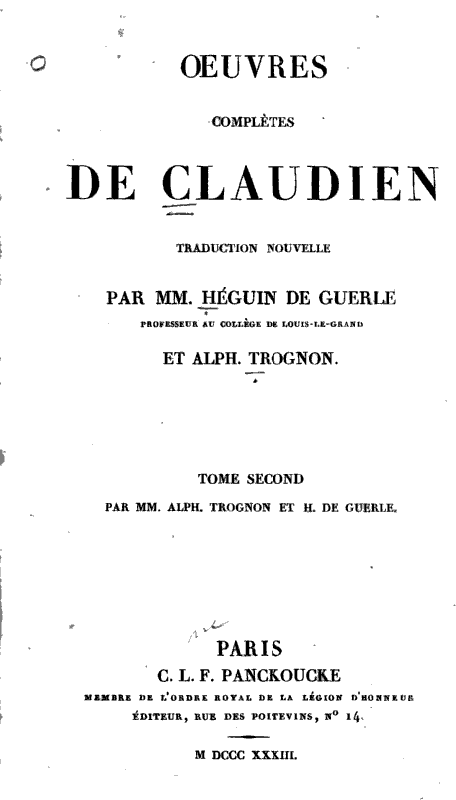
IDYLLES.ILe Phénix.Au delà des Indes et de l’Orient, s’élève un bois sacré, baigné par les flots de l’Océan le plus reculé; c’est lui que les coursiers écumants de l’Aurore foulent de leurs premiers pas, et qui retentit des coups frappés près de sa cime, lorsque le char vaporeux de la déesse s’élance avec bruit du seuil de son liquide palais. C’est là que le jour rougit de ses premiers feux, et que la nuit, à l’aspect des roues étincelantes, pâlit et replie son noir manteau. C’est là le séjour fortuné de l’oiseau du soleil seul et défendu par les dangers du rivage, il possède un royaume que n’ont point souillé des êtres malheureux, et qui n’est point flétri par la contagion mortelle du genre humain. Cet oiseau, pareil aux dieux, voit son éclat égaler en durée celui des étoiles, et ses membres renaissants fatiguer le cours des siècles. Jamais de grossiers aliments n’ont rassasié sa faim; ce n’est point à des sources vulgaires qu’il étanche sa soif. La chaleur du soleil le nourrit de ses purs rayons; il savoure les vapeurs nourrissantes de Téthys, et s’engraisse du suc de ses légers parfums. Ses yeux sont entourés d’un éclat mystérieux; une auréole de feu couronne sa tête; sa crête, en se dressant, brille d’une flamme empruntée au soleil, et sa lumière pure dissipe les ténèbres; ses jambes sont teintes de la pourpre de Tyr. Plus légère que le zéphyr, son aile s’embellit des couleurs de l’azur, que parsèment et rehaussent des taches d’or. Ce n’est point un germe, une semence développée dans le sein d’une mère qui lui donna naissance : il est à la fois et son père et son fils; sans que rien le crée, il régénère dans une mort féconde ses membres affaiblis par l’âge, et chaque nouveau trépas lui ouvre les portes d’une nouvelle vie. Quand l’été, quand l’hiver ont mille fois recommencé leur cours périodique, quand le printemps, fournissant sa carrière, a répandu mille fois sur les campagnes l’ombre que l’automne est venu moissonner: alors, fatigué sous le poids des années, il succombe; ainsi, battu par la tempête, le pin chancelle sur le sommet du Caucase, et tombe enfin entraîné par son poids: le vent le dépouille de ses brandes, une partie éclate, minée par la pluie, et la vieillesse qui le ronge détruit le reste. Ainsi pâlit et s’efface l’éclat du Phénix; sa brillante aigrette se voile sous les glaces de l’âge : telle Diane, captive au milieu des nuages, laisse évanouir sa lumière douteuse. Ses ailes, accoutumées à fendre la nue, se soulèvent à peine de terre. Alors, convaincu que sa carrière est achevée, et se préparant à une nouvelle existence, il recueille sur les collines des herbes desséchées par la chaleur, et, couvrant cet amas des feuilles parfumées de l’arbre de Saba, il élève un bûcher où il trouvera sa tombe et son berceau. C’est là qu’il se pose; et, dans sa faiblesse, saluant le soleil d’un chant plus doux, sa voix suppliante implore ces flammes qui vont lui donner de nouvelles forces. Phébus l’aperçoit; retenant ses coursiers, il s’arrête; et ces mots viennent consoler son pieux nourrisson : « O toi, qui vas laisser ta vieillesse sur ce bûcher, et qui vas trouver une nouvelle existence dans ce qui semble être un tombeau pour toi, être privilégié qui rajeunis par ta mort; toi, qui n’expires jamais que pour renaître, je te rends de nouveau à la vie : quitte cette enveloppe qu’ont maigrie les années; change de forme, et reparais plus éclatant. Il dit; et, secouant sa tête étincelante, il en détache un rayon, le lance, et frappe d’une flamme féconde l’oiseau qui attend ses bienfaits. Déjà le Phénix se consume pour renaître; impatient d’une nouvelle vie, il périt avec joie. Le bûcher odorant brûle, embrasé par les feux du ciel, il dévore les restes de ses membres vieillis. La Lune, dans sa surprise, retient ses taureaux éclatants, et le pôle ne tourne plus sur son axe immobile. A l’aspect de ce bûcher créateur, la Nature effrayée tremble que l’immortel oiseau ne périsse dans son berceau; elle avertit les flammes de lui rendre fidèlement son ornement éternel. Aussitôt la force se répand dans ses membres épuisés, un nouveau sang inonde ses veines. Ces cendres, qui vont être animées, s’agitent et se meuvent d’elles-mêmes, et la plume recouvre ces débris embrasés. Ainsi, se reproduisant par lui-même, il s’élance du bûcher, il s’enfante et se succède, et le feu seul met un léger intervalle entre les confins de ses cieux existences. Aussitôt il vole vers le Nil, pour consacrer les mânes de son père, il porte avec joie sur la terre de Pharos l’enveloppe qui renferme ses restes : d’une aile rapide il s’élance vers un autre univers, portant ses cendres cachées sous une enveloppe de gazon. Des milliers d’oiseaux l’accompagnent, et leur troupe étonnée lui forme un cortège dans les airs. Leurs bataillons serrés dérobent le jour à la terre : aucun n’ose précéder son roi; ils suivent, respectueux, les traces embaumées de leur guide. Ni le vautour farouche, ni l’oiseau du maître des dieux, ne s’apprêtent au combat: un commun respect maintient la paix entre eux. Ainsi, sur les bords du Tigre, le chef des Parthes guide ses troupes barbares; tout brillant de l’éclat de l’or et des pierreries, il orne son cimier de l’aigrette royale; un frein d’or retient son coursier, l’aiguille d’Assyrie embellit la pourpre qui le couvre; et, fier de son empire, il promène orgueilleusement sa puissance au milieu de ses escadrons soumis. Célèbre dans toute l’Égypte, et connue par ses pieux sacrifices, une ville adore le Soleil, et cent colonnes arrachées au mont de Thèbes portent dus les airs le sommet de son temple. C’est là que le Phénix dépose les restes de son père, et, adorant les traits brillants du dieu qui l’a créé, il confie son dépôt à la flamme; il dépose sur l’autel et les restes et les germes de son corps. Le temple brille de l’éclat de la myrrhe, un parfum divin s’exhale dans les airs; et, se répandant jusqu’aux marais de Péluse, le baume de l’Inde frappe au loin l’odorat, verse sur l’homme sa bienfaisante odeur, et une vapeur plus douce que le nectar parfume les sept bouches du Nil. Heureux oiseau, qui hérites de ta propre existence ! tu puises ta force ou nous trouvons le néant; tes cendres te donnent la vie; ta vieillesse disparaît, et tu restes. Tout ce qui a été, tu l’as vu: tous les siècles se déroulent sous tes yeux. Tu sais à quelle époque la mer a caché les rochers sous ses flots; quelle année fut embrasée des feux de Phaéton dans sa course incertaine. Aucun désastre ne t’atteint, et, survivant à tous les fléaux, tu triomphes de la terre, et demeures éternel : la Parque ne peut saisir le fil de tes jours, elle n’a pas le pouvoir de te nuire. II.Le Porc-épic.On m’avait dit, ô Stymphale, que tes oiseaux semaient des traits dans leur vol meurtrier. Longtemps la fable qui arme leurs ailes de pointes dangereuses révolta mon esprit. Je crois maintenant à ces récits; j’ai vu le Porc-épic: il m’a confirmé l’existence des oiseaux que frappa le bras d’Hercule. Son mufle allongé le rapproche du pourceau; ses soies se hérissent sur le haut de sa tête : on dirait des cornes. Son œil enflammé se colore d’une teinte de sang. Les pattes qui soutiennent son corps velu sont celles d’un jeune chien; et pourtant, la nature a daigné donner des armes merveilleuses à un si petit animal ! Sur tout son corps, se dresse une forêt menaçante; une moisson de dards, aux changeantes couleurs, s’élève toute prête pour le combat: fixée par des racines profondes, une partie se dérobe au regard; l’autre, toute parsemée de taches noires, s’élance comme un trait solide, dont l’extrémité se termine en une pointe effilée. Mais ces armes ne sont pas comme celles du hérisson, elles ne restent pas immobiles : il les lance à son gré, et, protégeant au loin son corps, il fait voler en s’agitant les dards qui l’armaient. Tantôt, comme le Parthe, il blesse dans sa fuite l’ennemi qui le poursuit. Tantôt, comme au sein d’un camp retranché, il inonde d’une grêle de traits l’épieu du chasseur, et hérisse ses flancs des javelots qu’il a produits. Tout son corps combat en même temps, et son dos, en s’agitant, retentit d’un son rauque. On dirait deux armées qu’anime la trompette, et qui se heurtent l’une contre l’autre tant un si petit corps fait entendre de bruit ! La ruse est encore pour lui une nouvelle arme; il sait ménager sa fureur, et sa colère ne s’épuise pas en traits inutiles : il se contente de menacer l’ennemi avec prudence, et ne dépense ses traits que pour sauver ses jours. Ses coups sont certains; son adresse lance un trait inévitable; l’espace ne trompe pas ses yeux; son corps ébranlé garde toute sa force, et dirige ses habiles efforts. L’industrie humaine a-t-elle jamais tant fait avec le secours de la raison? L’homme ravit leurs cornes aux chèvres farouches de la Crète: il les assouplit à l’aide du feu; les entrailles du taureau fournissent des cordes à son arc. Il donne au roseau des ailes et un fer aigu. Voilà qu’un petit animal est armé des traits qu’il a produits, il n’a pas besoin de secours étrangers il porte tout avec lui; il est à la fois son carquois, son arc et ses flèches. Un seul animal possède à lui seul toutes les ressources de la guerre. S’il est vrai que l’imitation ait été pour nous la source de tous les arts, c’est lui qui nous apprit à atteindre de loin l’ennemi; le Cydonien lui doit l’art de combattre; le Parthe, en frappant dans sa fuite, n’a fait que suivre l’exemple de cet animal armé de traits, III.La Torpille.Qui n’a pas entendu parler de l’indomptable adresse de la cruelle Torpille, et du poison subtil qui lui a si bien mérité son nom? Son corps n’est point couvert de dures écailles; sa marche lente semble la livrer à son ennemi; et, languissante, elle imprime à peine sa trace sur le sable où elle se traîne. Mais la nature a armé son flanc d’un venin glacial elle a fait circuler dans ses veines le froid qui engourdit tous les êtres, et a renfermé dans son sein des frimas qu’elle communique à son gré. La ruse en elle aide encore la nature : sûre de sa force, elle s’étend au milieu des algues; mais bientôt, joyeuse du succès, elle se relève, et dévore impunément ses victimes encore palpitantes. Si parfois, imprudente, elle a avalé l’appât qui cachait un fer trompeur, si elle se sent arrêtée par l’hameçon recourbé; elle ne fuit point, elle ne cherche pas à s’en délivrer par d’inutiles morsures : elle se rapproche au contraire, dans sa ruse, du fil trompeur; captive, elle n’oublie pas ses armes, et répand au loin, dans les eaux, le souffle empoisonné qui s’exhale de ses veines. Le venin glisse le long de la soie, s’élève au dessus des flots pour atteindre son ennemi; un froid terrible s’élève du sein des eaux, et, suspendu au fil de l’hameçon, il se glisse à travers les nœuds du roseau, et, glaçant le sang du pêcheur, il enchaîne sa main victorieuse. Celui-ci repousse un fardeau si dangereux, abandonne sa proie rebelle, et revient désarmé, car sa ligne est perdue. IV.Le Nil.Heureux celui dont le soc entrouvre les plaines de l’Égypte ! il n’appelle pas les nuages qui voilent le ciel d’épaisses ténèbres, il n’invoque point les autans dont l’haleine glaciale souffle la pluie, ni l’arc nuancé de changeantes couleurs. L’Égypte, fertile sans nuages, possède seule des rosées qui n’altèrent pas la sérénité de l’air; elle ne s’inquiète ni des cieux, ni des vents: c’est elle qui porte les eaux qui la fécondent; elle a pour elle le Nil qui, dans sa course rapide, jaillit de ses antres profonds, et qui, tout brûlant des feux de la zone et du tropique embrasé, se précipite dans notre univers. Ses flots inconnus sortent d’une source cachée, qui se dérobe à nos vaines recherches; car jamais homme n’a pu voir le lieu de sa naissance. On dit que, créé sans témoin, il roule des eaux qu’ont éclairées d’autres cieux. De là, se divisant dans sa course vagabonde par toute la Libye, il se précipite à travers les noirs royaumes des Éthiopiens, il arrose les contrées condamnées aux feux éternels du soleil, et va porter partout la vie à ces peuples altérés. Il traverse Méroé, les farouches Blemyes, et la noire Syène. Le Garamante avec son coursier sans frein, et le Girrhéen qui dompte les monstres, boivent ses eaux. Ce sont eux qui habitent de vastes grottes sous d’immenses rochers, qui arrachent à l’ébène ses rameaux, à l’éléphant ses défenses. Il baigne aussi ces contrées dont les habitants se ceignent la tête d’un diadème de flèches. Ses eaux ne se gonflent pas comme celles des autres fleuves, à la même époque, et pour de semblables causes. Ce n’est point la glace en se fondant, ni les torrents pluvieux, descendus des montagnes, qui grossissent son cours. Lorsqu’ailleurs le triste hiver fait déborder les eaux, le Nil reste enfermé dans ses rives; et quand les fleuves se traînent languissants, c’est alors que, changeant les lois du monde, le Nil gonfle ses flots. Car tout ce que chaque rivière a perdu pendant l’été, est un tribut que la nature paie au Nil, et cet impôt, levé sur tout l’univers, se concentre dans un seul fleuve. Quand la Canicule arme le soleil de feux plus ardents, et pompe la rosée de la terre, quand la chaleur dessèche ses entrailles, et que le monde semble embrasé par ses puissants rayons; les frimas, apportant au Nil une saison opposée, ramènent dans les campagnes épuisées ses inondations périodiques. Il se déborde, plus vaste que la mer Égée, plus impétueux que les flots ioniens; et se déploie au loin dans les vastes plaines. La terre semble nager au milieu des eaux, les sillons désormais sont battus par la rame, et le berger, surpris par la chaleur assoupissante de l’été, voit à son réveil ses troupeaux et sa demeure flotter sur les ondes. V.L’Aimant.O vous, dont l’esprit inquiet, interrogeant le monde sonde les secrets de la nature, qui cherchez quelle cause obscurcit la lune, et fait pâlir le soleil; d’où viennent les comètes à la sanglante chevelure, de quel antre s’échappent les vents, quelle puissance ébranle les fondements de la terre, et, déchirant la nue, en fait jaillir l’éclair, et fait gronder la foudre; quelle lumière colore l’arc d’Iris : moi aussi, je cherche à résoudre ces grands problèmes; et, si votre esprit peut entrevoir la vérité, éclairez mes doutes. Il est une pierre, sans couleur, pâle et dédaignée: l’Aimant est son nom. Elle ne pare point la chevelure des Césars, ni le cou éblouissant de la jeune vierge; elle ne rattache pas d’une agrafe brillante la ceinture du guerrier; mais, si vous considérez les prodiges inconnus de cette pierre grisâtre, elle aura plus de prix à vos yeux que ces belles parures, que les richesses recueillies par l’Indien sur les grèves rougeâtres de l’océan, oriental. C’est au fer qu’elle doit la vie; c’est de lui qu’elle se nourrit: c’est là son aliment, c’est là sa pâture. Elle répare ainsi ses forces épuisées; et, circulant dans tous ses membres, cet aliment ranime en elle, par sa présence, une vigueur secrète. Loin du fer, l’aimant périt, toutes ses parties affaiblies succombent sous la faim, la soif dessèche et entrouvre ses veines. Mars, dont la lance sanglante ébranle les villes, et Vénus, qui change en doux loisirs les soucis des humains, habitent en commun le sanctuaire d’un temple d’or. Chacune de ces divinités a son image particulière: Mars est représenté sous la forme d’un fer brillant; une pierre d’aimant offre les traits de Vénus. Le prêtre, selon l’usage, célèbre leur union. Les flambeaux guident les danses; le seuil est, pour cette fête, orné de guirlandes de myrte; un lit s’élève, jonché de feuilles de roses, et la pourpre nuptiale voile la couche des deux amants. Alors s’opère un prodige inouï. Vénus, d’elle-même, entraîne son amant sur son sein, et, rappelant la scène dont les cieux furent témoins, elle enchaîne, par sa voluptueuse attraction, les membres de Mars; elle le tient suspendu dans les airs; ses mains pressent le casque du dieu qu’elle enlace tout entier dans ses bras frémissants. Mais lui, provoqué par l’action de ce souffle puissant, s’attache par d’invisibles nœuds à cette pierre qui l’attire. La nature préside à leur hymen, une alliance indissoluble enchaîne le fer à l’aimant; et les deux divinités s’unissent encore par de nouveaux larcins. Quelle chaleur secrète anime ces deux métaux d’une même sympathie? Quel penchant entraîne ainsi ces corps insensibles? L’aimant brûle et semble respirer, l’amour lui révèle la présence d’un métal chéri, et le fer lui-même se plie à de douces étreintes. C’est ainsi que Vénus d’un regard arrête et calme le dieu des combats, lorsqu’il se précipite altéré de sang, et que son glaive qu’il brandit anime sa colère. Seule, elle se présente à ses farouches coursiers, elle apaise le courroux dont son cœur est gonflé, et calme son sang par une douce flamme. La paix est rendue à son esprit; il dit adieu aux combats meurtriers, et, pour presser dans ses bras la déesse, il incline son aigrette étincelante. Amour ! cruel enfant, quelle est donc ta puissance? Tu triomphes de la foudre, tu forces le maître des dieux à quitter l’Olympe pour aller mugir au milieu des flots; tu animes des roches glacées, des corps insensibles; et voilà que tes feux consument les rochers et les pierres que tu frappes de tes traits: le fer obéit à tes charmes, et la flamme amollit le sein glacé du marbre. VI.Apone.O toi qui donnes la vie à la ville d’Anténor, source bienfaisante, dont les eaux repoussent loin de tes bords de malignes influences; quand tes prodiges ont fait parler des bouches muettes, quand la Muse chante des vers à ta louange, quand il n’est pas une main qui n’ait tracé quelques lignes de reconnaissance pour des vœux que tu as comblés; ne serais-je pas coupable envers les Muses, envers les Nymphes, si, seul, je reste muet devant ton cours. Non, je ne puis taire et passer sous silence un lieu dont le renom vole de bouche en bouche. Moins élevé qu’une haute colline, moins aplani qu’une rase campagne, un tertre arrondit mollement ses gracieux contours; il vomit une onde bouillante, et, de quelque côté que l’eau cherche à se frayer un passage, elle rencontre le feu qui la repousse: le sol spongieux exhale des vapeurs humides, et l’onde, captive dans sa prison brûlante, se fraie d’étroits sentiers à travers la roche poreuse. Région liquide de la flamme, où, du sein de la terre, jaillissent les feux de Vulcain, rivages brûlants d’un sol sulfureux qui ne croirait cette contrée stérile? Eh bien, cette terre fumante est couverte de riantes prairies, et la pierre, calcinée par le feu, s’y cache sous le gazon. Tandis que des rochers se fondent à cette chaleur, l’herbe, malgré ces feux, s’élève verdoyante. A côté, de larges sillons, creusés dans le marbre, coupent en deux ces rochers à demi-brisés et séparés par un long intervalle. C’est, selon la fable, la trace de la charrue d’Hercule, ou plutôt l’œuvre du hasard. Au milieu, image vivante d’une mer embrasée, un lac d’azur déroule son immensité, et couvre de ses eaux un vaste espace. Mais il est encore plus grand, quand il pénètre dans la ‘roche et qu’il disparaît sous ses arcades voûtées. Des brouillards épais s’en exhalent: ses eaux sont désagréables au goût et au toucher; mais elles conservent jusqu’au fond leur transparence et leur limpidité. La nature a veillé sur elle-même : et, pour ne pas le dérober entièrement à nos yeux, elle a laissé le regard plonger dans des abîmes que la chaleur rendait inaccessibles. Quand les vapeurs qui le couvrent se dissipent, emportées par les vents, quand cette onde fumante a repris son azur; alors vous pouvez admirer la vaste plaine qui s’étend sous ses flots; on y voit briller de vieilles lances, présents des rois; au milieu, troublé par un sable épais qui altère sa couleur, le lac disparaît, entraîné dans un gouffre obscur. On voit s’ouvrir les cavernes que remplit son onde ténébreuse, dont les replis pénètrent au fond de ces rochers. Alors, vous voyez les entrailles de la montagne; dans sa courbe, elle décrit un arc, et enchaîne les flots sous une voûte suspendue. Un amphithéâtre de verdure concentre ces vapeurs qu’il couronne; la terre y surnage comme une légère écorce, et, ne cédant jamais sous le fardeau qui la presse, elle semble s’abîmer, et pourtant soutient toujours le pied du voyageur tremblant. On dirait que c’est un ouvrage de l’homme, tant ses contours sont légers, tant elle est mince et solide. Le lac remplit son lit jusqu’aux bords, et semble craindre de franchir ses limites. Une roche inclinée verse le surplus de ses eaux, et les pousse sur le dos incliné de la plaine. Elles s’égarent en nombreux méandres qu’a tracés la nature, et bientôt le plomb les reçoit dans ses larges canaux. Les conduits, tout empreints de ces brûlantes exhalaisons, distillent sans bruit un sel aussi blanc que la neige. Cette onde répand partout ses trésors, et, obéissant à la main industrieuse de l’art, poursuit sa route sinueuse; elle franchit, en bouillonnant, des voûtes continues, et promène dans les étuves une chaleur tempérée. Mais bientôt, une vapeur plus pénétrante s’en échappe, si l’eau, dans son cours, se heurte contre un rocher. Bientôt le malade, tout dégouttant de sueur, a regagné son humide cellule où les eaux, plus éloignées de leur source, lui procurent une agréable fraîcheur. Salut, source illustre, qui verses des flots salutaires; gloire du sol italien, salut ! Asyle public ouvert à toutes les maladies, tu viens au secours des enfants d’Esculape; et, divinité tutélaire, tu ne vends pas tes bienfaits. Soit que ton onde brûlante s’échappe des fleuves infernaux, et que le Phlégéthon, se détournant dans son cours, échauffe notre univers; soit que tes eaux tombent glacées dans une carrière de soufre, et, en sortent embrasées, comme le témoignent leurs vapeurs; soit que, par un partage égal entre le feu et l’onde, tu cherches, arbitre impartial, à combiner ces deux éléments, de sorte qu’ils ne cèdent point l’un à l’autre, mais que, sous des lois équitables, ils subissent l’un et l’autre leur mutuelle influence; quelle que soit la cause qui te produit, quelle que soit ton origine, je crois que ce n’est pas sans dessein que tu coules sur la terre. Et, qui oserait attribuer tant de merveilles au hasard? Qui oserait prétendre que les dieux n’en sont pas les auteurs? Le maître de l’univers, qui mesure les siècles au mouvement des astres, t’a donné une place brillante dans ses œuvres sacrées; prenant en pitié notre frêle existence, il a voulu que la terre nous versât la santé; et soudain, du haut de la montagne entr’ouverte, jaillit un fleuve qui devait arrêter les terribles fuseaux de la Parque. Heureux les habitants qui ont mérité de naître sur tes bords, qui peuvent revendiquer Apone comme leur propriété. Pour eux, la terre n’a point de peste, l’Auster de miasmes dangereux, et Sinus de brûlantes chaleurs. Si l’inflexible ciseau de Lachésis les condamne à la mort, ton onde adoucit au moins pour eux les infirmités de la vie. Si leurs membres se gonflent d’une maligne humeur; si leurs entrailles, affaiblies par une bile surabondante, se couvrent d’une couleur livide, ils n’ont pas besoin d’ouvrir leurs veines, et de guérir leurs maux par de nouvelles blessures; une herbe ne mêle pas son amertume à leur breuvage; ils retrouvent, sans souffrance, leur vigueur dans tes eaux, les douleurs s’apaisent, et le malade revient brillant de santé. VII.Sur les statues d’Amphinomus et d’Anapus.Voyez ces deux frères qui fléchissent sous un pieux fardeau, dignes tous deux de partager les honneurs célestes. Devant eux, la flamme respectueuse a suspendu ses ravages, et l’Etna, frappé d’admiration, retient ses flammes vagabondes. Pressant dans leurs bras leurs pères et mères suspendus à leur cou, ils regardent le ciel et hâtent leur marche. Ces deux fils, pour emporter leurs vieux parents, ont retardé leur propre fuite; mais ce retard leur coûtera cher. Voyez comme le vieillard montre l’incendie qui s’avance, comme la mère invoque, d’une lèvre tremblante, la faveur des dieux ! La frayeur a hérissé leurs cheveux, et l’airain lui-même semble pâlir et frissonner de crainte. Les membres des jeunes gens s’animent d’une généreuse horreur; sans inquiétude pour eux-mêmes, ils craignent pour leur précieux fardeau Le vent a relevé leurs manteaux; l’un lève le bras droit; son bras gauche lui suffit pour soutenir son vieux père. L’autre de ses mains enlacées entoure sa mère, dont le sexe, plus faible, lui commande plus d’attention. N’allez pas, en passant, oublier de payer le tribut d’éloges que l’on doit à la pensée de l’artiste. A leurs figures, on reconnaît deux frères: celui-ci ressemble plus à sa mère, celui-là à son père. L’art du burin fait entrevoir leurs différents caractères; et les parents revivent dans les traits de leurs fils. Donnant à chacun de ces deux frères une expression particulière, pour varier leur tendresse, il a varié leur physionomie. O cœurs fidèles aux lois de la nature ! leçons vivantes de la justice céleste, modèles des jeunes gens, espérance des vieillards ! méprisant d’autres richesses, vous vous êtes précipités à travers les flammes, pour sauver les cheveux blancs des auteurs de vos jours. Oui, je le crois, tant de vertu dut éteindre les feux que vomit Encelade. Vulcain lui-même arrêta les débordements de l’Etna: il craignait de blesser les modèles d’un si pieux dévouement. Les éléments furent sensibles à votre tendresse; l’air vous aida à soutenir votre père, et la terre allégea le poids de votre mère. Si une amitié à toute épreuve a placé au rang des dieux deux jeunes Spartiates; si Énée doit l’immortalité à son père, qu’il arracha aux flammes de Troie; si la renommée a transmis d’âge en âge le nom des deux frères d’Argos, qui s’attelèrent au char de leur mère: pourquoi, Amphinomus, et toi, courageux Anapius, la Sicile n’a-t-elle pas élevé un temple en votre honneur? Quoique cette île ait bien des titres à la célébrité, qu’elle sache cependant qu’elle n’a rien produit de plus glorieux que vous. Qu’elle ne pleure plus les pertes qu’a causées le feu dans sa course incertaine; qu’elle cesse de gémir sur ses maisons consumées par les flammes : si l’incendie eût cessé, ces deux frères n’eussent pas fait éclater leur piété : ce n’est pas trop d’un si grand malheur pour payer une gloire éternelle. |