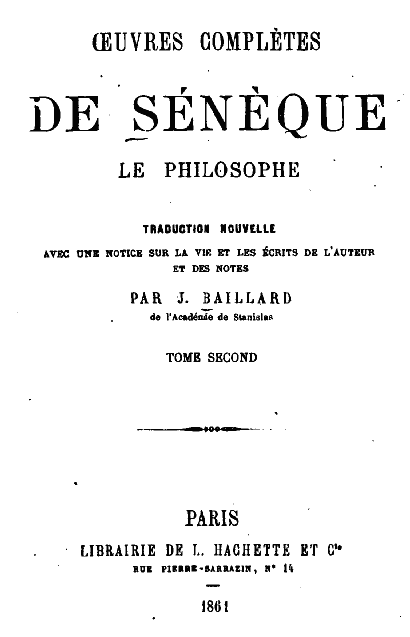|
SÉNÈQUE LETTRES A LUCILIUS.
XLI - LXXX
(I - XL) (LXXXI -CCXXIV)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
SÉNÈQUELETTRES A LUCILIUS
LETTRE XLI.Dieu réside dans l'homme de bien. — Vraie supériorité de l'homme.Tu fais une chose excellente et qui te sera salutaire si, comme tu l'écris, tu marches avec persévérance vers cette sagesse qu'il est absurde d'implorer par des vœux quand on peut l'obtenir de soi. Il n'est pas besoin d'élever les mains vers le ciel, ni de gagner le gardien d'un temple pour qu'il nous introduise jusqu'à l'oreille de la statue, comme si de la sorte elle pouvait mieux nous entendre ; il est près de toi le Dieu, il est avec toi, il est en toi. Oui, Lucilius, un esprit saint réside en nous, qui observe nos vices et veille sur nos vertus, qui agit envers nous comme nous envers lui. Point d'homme de bien qui ne l'ait avec soi. Qui donc, sans son appui, pourrait s'élever au-dessus de la Fortune? C'est lui qui inspire les grandes et généreuses résolutions. Dans chaque âme vertueuse il habite Quel dieu? Nul ne le sait, mais il habite un dieu.[1] S'il s'offre à tes regards un de ces bois sacrés peuplé d'arbres antiques qui dépassent les proportions ordinaires, où l'épaisseur des rameaux étages les uns sur les autres te dérobe la vue du ciel, l'extrême hauteur des arbres, la solitude du lieu, et ce qu'a d'imposant cette ombre en plein jour si épaisse et si loin prolongée te font croire qu'un Dieu est là.[2] Et cet antre qui, sur des rocs profondément minés, tient une montagne suspendue, cet antre qui n'est pas de main d'homme, mais que des causes naturelles ont creusé en voûte gigantesque! ton âme toute saisie n'y pressent-elle pas quelque haut mystère religieux? Nous vénérons la source des grands fleuves ; au point où tout à coup de dessous terre une rivière a fait éruption on dresse des autels; toute veine d'eau thermale a son culte, et la sombre teinte de certains lacs ou leurs abîmes sans fond les ont rendus sacrés. Et si tu vois un homme que n'épouvantent point les périls, pur de toute passion, heureux dans l'adversité, calme au son des tempêtes, qui voit de haut les hommes et à son niveau les dieux, tu ne seras point pénétré pour lui de vénération! Tu ne diras point : Voilà une trop grande, une trop auguste merveille pour la croire semblable à ce corps chétif qui l'enferme! Une force divine est descendue là. Cette âme supérieure, maîtresse d'elle-même, qui juge que toute chose est au-dessous d'elle et qui passe, se riant de ce que craignent ou souhaitent les autres, elle est mue par une puissance céleste. Un tel être ne peut se soutenir sans la main d'un Dieu : aussi tient-il par la meilleure partie de lui-même au lieu d'où il est émané. Comme les rayons du soleil, bien qu'ils touchent notre sol, n'ont point quitté le foyer qui les lance ; de même cette âme sublime et sainte, envoyée ici-bas pour nous montrer la divinité de plus près, se mêle aux choses de la terre sans se détacher du ciel sa patrie. Elle y est suspendue, elle y regarde, elle y aspire, elle vit parmi nous comme supérieure à nous. Quelle est donc cette âme? Celle qui ne s'appuie que sur les biens qui lui sont propres. Quoi de plus absurde en effet que de louer dans l'homme ce qui lui est étranger? Quelle plus grande folie que d'admirer en lui ce qui peut tout à l'heure passer à un autre? Un frein d'or n'ajoute pas à la bonté du coursier. Le lion dont on a doré la crinière, qui se laisse toucher et manier, qui subit patiemment la parure imposée à son courage dompté, n'entre pas dans l'arène du même air que cet autre qui, sans apprêt, garde tout son instinct farouche. Celui-ci, dans sa fougue sauvage, tel que l'a voulu la nature, majestueusement hérissé, beau de la peur qu'inspire son seul aspect, on le préfère à cet impuissant[3] quadrupède qui reluit de paillettes d'or. Nul ne doit tirer gloire que de ce qui lui est personnel. On fait cas d'une vigne dont les branches surchargées de fruits entraînent par leur poids ses soutiens mêmes jusqu'à terre : trouvera-t-on plus beaux des ceps d'or, où des raisins, des feuilles d'or serpentent? Le mérite essentiel d'une vigne est la fécondité. Dans l'homme aussi ce qu'il faut priser c'est ce qui est de l'homme même. Qu'il ait de superbes esclaves, un palais magnifique, beaucoup de terres ensemencées et de capitaux productifs ; tout cela n'est pas en lui, mais autour de lui. Loue en lui ce qu'on ne peut ni ravir ni donner,[4] ce qui est son bien propre. « Que sera-ce donc? » dis-tu. Son âme, et dans cette âme la raison perfectionnée. Car l'homme est un être doué de raison ; et le souverain bien pour lui est d'avoir atteint le but pour lequel il est né. Or, qu'exige de lui cette raison? Une chose bien facile : de vivre selon sa nature ; chose pourtant que rend difficile la folie générale. On se pousse l'un l'autre dans le vice; comment alors rappeler dans les voies de salut ceux que nul ne retient et que la multitude entraîne? LETTRE XLII.Rareté des gens de bien. — Vices cachés sous l'impuissance.Ce qui est gratuit coûte souvent bien cher.Cet homme t'a déjà persuadé qu'il est homme de bien. Mais ce titre-là ne s'acquiert et ne se constate pas si vite. Tu sais ce qu'ici j'entends sous ce mot? un homme de bien du second ordre. Pour l'autre, comme le phénix, il naît une fois dans cinq siècles ; et faut-il s'étonner que les prodiges s'enfantent à de grands intervalles? Le médiocre et le commun, le sort se plaît à les créer souvent ; mais il confère aux chefs-d'œuvre le mérite de la rareté. L'homme dont tu parles est loin jusqu'ici de ce qu'il fait profession d'être ; et s'il savait ce qu'est un homme de bien, il ne se jugerait pas encore tel, peut-être même désespérerait-il de le devenir. « Mais il pense si mal des méchants! » Et les méchants aussi pensent comme lui : le plus grand supplice d'un cœur mauvais, c'est de déplaire et à soi-même et à ses pareils. « Mais il hait tous ces grands improvisés qui usent en tyrans de leur pouvoir! » Il fera comme eux, quand il pourra les mêmes choses qu'eux. Sous l'impuissance de bien des hommes un génie pervers est caché : il osera, quand il aura foi en ses forces, tout ce qu'ont osé les mauvais instincts qu'un sort prospère a fait éclore. Les moyens seuls de développer toute leur noirceur manquent à ces âmes. On manie impunément le serpent le plus dangereux tant qu'il est roide de froid ; alors son venin, sans être mort, n'est qu'engourdi. Combien de cruautés et d'ambitions, et de débauches auxquelles il ne manque, pour égaler en audace les plus monstrueuses, que d'être aidées de la Fortune! Elles ont les mêmes vouloirs : veux-tu t'en convaincre? Donne-leur de pouvoir tout ce qu'elles veulent.[5] Tu te rappelles cet homme dont tu prétendais pouvoir disposer; je te disais qu'il était volage et léger, que tu ne le tenais point par le pied, mais par le bout de l'aile. Je me trompais : tu le tenais par une plume ; il te l'a laissée dans la main et s'est envolé. Tu sais comment ensuite il s'est joué de toi, et que de choses il a tentées qui devaient lui tourner à mal! Il ne se voyait pas courir au piège en voulant y pousser les autres ; il oubliait combien étaient onéreux les objets de sa convoitise, quand ils n'eussent pas été superflus. Sachons donc voir que ce qui provoque notre ambition et nos efforts si laborieux ou ne renferme nul avantage, ou offre encore plus d'inconvénients. Telle chose est superflue, telle autre ne vaut pas notre peine. Mais notre prévoyance ne va pas si loin, et nous appelons gratuit ce qui coûte le plus cher. Ο stupidité de l'homme! Il s'imagine ne payer que ce qui vide sa bourse, et obtenir pour rien ce pour quoi il se donne lui-même. Ce qu'il ne voudrait pas acheter, s'il fallait, en échange, livrer une maison, une propriété d'agrément ou de rapport, il est tout prêt à l'acquérir à prix d'inquiétudes, de dangers, de temps, de liberté, d'honneur.[6] Tant l'homme n'a rien qu'il prise moins que lui-même! Que ne fait-il donc en tout projet et pour toute chose ce que fait quiconque entre chez un marchand? L'objet qu'on désire, à quel prix serait-il livré? Souvent le plus dispendieux est celui qu'on reçoit pour rien. Que d'acquisitions, que de présents je puis te citer qui nous ont arraché notre indépendance[7]! Nous nous appartiendrions, s'ils ne nous appartenaient pas. Médite ces réflexions dès qu'il s'agira non seulement de gain à faire, mais de perte à subir. Dis-toi ; « Que vas-tu perdre? Ce qui t'est venu du dehors. Tu n'en auras pas plus de peine à vivre après qu'avant. L'avais-tu longtemps possédé? Tu t'en es rassasié avant de le perdre. Si tu ne l'as pas eu longtemps, tu n'en avais pas encore l'habitude. Ce sera de l'argent de moins? Partant, moins de tracas. Ton crédit en diminuera? Tes envieux aussi. Considère tous ces faux biens dont on s'éprend jusqu'à la folie, que l'on perd avec tant de larmes, et comprends que ce n'est point la perte qui fâche, mais l'idée qu'on se fait de cette perte. On la sent, non point par le fait, mais par la réflexion. Qui se possède n'a rien perdu : mais à combien d'hommes est-il donné de se posséder? » LETTRE XLIII.Vivre comme si l'on était sous les yeux de tous. — La conscience.Tu me demandes comment cela est venu jusqu'à moi ; qui m'a pu dire ta pensée que tu n'avais dite à personne? « Celle qui sait tant de choses : la renommée. » Quoi! diras-tu, suis-je assez important pour mettre la renommée en émoi? — Ne te mesure pas sur l'endroit où je suis, mais sur celui que tu habites. Qui domine ses voisins est grand où il domine. La grandeur n'est pas absolue : elle gagne ou perd par comparaison. Tel navire, grand sur un fleuve, est fort petit en mer; le même gouvernail, trop fort pour tel navire, est exigu pour tel autre. Toi aujourd'hui, tu as beau te rapetisser, tu es grand dans ta province : tes actions, tes repas, ton sommeil, on épie, on sait tout. Tu n'en dois que mieux t'observer dans ta conduite. Mais ne t'estime heureux que le jour où tu pourrais vivre sous les yeux du public, où tes murailles te défendraient sans te cacher, ces murailles que presque tous nous croyons faites moins pour abriter nos personnes que pour couvrir nos turpitudes. Je vais dire une chose qui peut te faire juger de nos mœurs : à peine trouverais-tu un homme qui voulût vivre portes ouvertes. C'est la conscience plutôt que l'orgueil qui se retranche derrière un portier. Nous vivons de telle sorte que c'est nous prendre en faute que de nous voir à l'improviste. Mais que sert de chercher les ténèbres, de fuir les yeux et les oreilles d'autrui? Une bonne conscience défierait un public; une mauvaise emporte jusque dans la solitude ses angoisses et ses alarmes. Si tes actions sont honnêtes, qu'elles soient sues de tous; déshonorantes, qu'importe que nul ne les connaisse? tu les connais, toi. Que je te plains, si tu ne tiens pas compte de ce témoin-là! LETTRE XLIV.[8]La vraie noblesse est dans la philosophie.Tu persistes à te faire petit, et à te dire trop chétivement doté par la nature d'abord, puis par la Fortune, quand il ne tient qu'à toi de te tirer des rangs du vulgaire et d'atteindre à la plus haute des félicités. Si la philosophie possède en soi quelque mérite, elle a surtout celui de ne point regarder aux généalogies. Tous les hommes, si on les rappelle à l'origine première, sont enfants des dieux. Te voilà chevalier romain, et c'est à force de talent que tu es entré dans cet ordre : mais, grands dieux! à combien de citoyens les quatorze bancs ne sont-ils pas fermés? Le sénat ne s'ouvre pas pour tous : la milice même, pour nous admettre à ses fatigues et à ses périls, est difficile dans ses choix. La sagesse est accessible à tous; devant elle nous sommes tous nobles. La philosophie ne refuse ni ne préfère personne:[9] elle luit pour tout le monde. Socrate n'était point patricien; Cléanthe louait ses bras pour tirer l'eau dont il arrosait un jardin; la philosophie, en adoptant Platon, ne lui demanda pas ses titres, elle les lui conféra. Pourquoi désespérerais-tu de ressembler à ces grands hommes? Ils sont tous tes ancêtres, si tu te rends digne d'eux, et pour l'être, il faut tout d'abord te persuader que nul n'est de meilleure maison que toi. Nous avons tous même nombre d'aïeux ; notre origine a tous remonte plus loin que la mémoire des hommes, « Point de roi, dit Platon, qui n'ait des esclaves pour ancêtres, point d'esclave qui ne sorte du sang des rois. » Une longue suite de révolutions a brouillé tout cela, et le sort a bouleversé les rangs. Quel est le vrai noble? Celui que la nature a bien préparé pour la vertu.[10] Voilà le seul titre à considérer. Autrement, si tu me renvoies aux vieux temps, chacun date d'un âge avant lequel il n'y a plus rien. Depuis le berceau du monde jusqu'à nos jours une série de vicissitudes nous a fait passer par de brillants comme par d'obscurs destins. Un vestibule rempli de portraits enfumés ne fait pas la noblesse. Nul n'a vécu pour notre gloire, et ce qui fut avant nous n'est pas à nous.[11] C'est l'âme qui anoblit; elle peut de toutes les conditions s'élever plus haut que la Fortune. Suppose-toi, non pas chevalier romain, mais affranchi, tu peux un jour être seul libre de fait parmi tant d'hommes libres de race. « Comment cela? » diras-tu. En n'adoptant pas la distinction populaire des biens et des maux. Informe-toi non d'où viennent les choses, mais où elles aboutissent. S'il en est une qui puisse donner le bonheur, elle est bonne par essence, car elle ne peut dégénérer en mal. Quelle est donc la cause de tant de méprises, quand la vie heureuse est le vœu de tous? C'est qu'on prend les moyens pour la fin, et qu'en voulant l'atteindre on s'en éloigne. Tandis qu'en effet la perfection du bonheur consiste dans une ferme sécurité et dans l'inébranlable foi qu'il nous restera, on se cherche au loin des causes de soucis, et sur cette route perfide de la vie, on porte ses embarras bien moins qu'on ne les traîne. Aussi s'écarte-t-on toujours davantage du but poursuivi; plus on s'épuise en efforts, plus on reste empêtré, ou rejeté en arrière. Ainsi l'homme qui dans un labyrinthe presse le pas se fourvoie en raison de sa vitesse même. LETTRE XLV.Sur les subtilités de l'école.Tu te plains de la disette des livres en Sicile. L'important n'est pas d'en avoir beaucoup, mais d'en avoir de bons. Une lecture sagement circonscrite profitera; variée, elle amuse. Qui veut arriver à un but précis doit aller par un seul chemin, et non vaguer de l'un à l'autre, ce qui n'est pas avancer, mais errer. « J'aimerais mieux, diras-tu, des livres que des conseils. » Oh! en vérité, tous ceux que je possède, je suis prêt à te les envoyer, à vider tout mon grenier, à me transporter moi-même, si je le pouvais, près de toi, et, n'était l'espoir que tu obtiendras de bonne heure de cesser tes fonctions, c'est une expédition que j'eusse imposée à ma vieillesse : ni Charybde, ni Scylla, ni ce détroit maudit par la Fable ne m'auraient fait reculer. Je l'aurais franchi, que dis-je? l'aurais passé à la nage pour pouvoir t'embrasser et juger par mes yeux des progrès de ton âme. Quant au désir que tu exprimes de recevoir mes ouvrages, je ne m'en crois pas plus habile que je ne me croirais beau si tu demandais mon portrait. Je sais que c'est plutôt indulgence d'ami qu'opinion réfléchie, ou si c'est opinion, ton indulgence te l'a suggérée. Au reste, quels qu'ils soient, lis-les comme venant d'un homme qui cherche le vrai sans l'avoir encore trouvé, mais qui le cherche avec indépendance. Car je ne me suis mis sous la loi de personne ; je ne porte le nom d'aucun maître; si j'ai souvent foi en l'autorité des grands hommes, sur quelques points c'est a moi que j'en appelle.[12] Tout grands qu'ils sont, ils nous ont légué moins de découvertes que de problèmes; et peut-être eussent-ils trouvé l'essentiel, s'ils n'eussent cherché aussi l'inutile. Que de temps leur ont pris des chicanes de mots, des argumentations captieuses qui n'exercent qu'une vaine subtilité! Ce sont des nœuds que nous tressons, des équivoques de sens que nous enlaçons dans des paroles et qu'ensuite nous débrouillons. Avons-nous donc tant de loisir? Savons-nous déjà vivre, savons-nous mourir? Toutes les forces, toute la prévoyance de notre esprit doivent tendre à n'être pas dupe des choses : qu'importent les mots? Que me font tes distinctions entre synonymes où jamais nul n'a pris le change, que pour disputer? Les choses nous abusent : éclaircis les choses. Nous embrassons le mal pour le bien; nous désirons les contraires, nos vœux se combattent, nos projets se neutralisent. Combien la flatterie ressemble à l'amitié! Et non seulement elle lui ressemble, mais encore l'emporte et enchérit sur elle, trouve pour se faire accueillir l'oreille facile et indulgente, s'insinue jusqu'au fond du cœur, nous charme en nous empoisonnant. C'est cette similitude-là qu'il faut m'apprendre à démêler. Un ennemi caressant vient à moi comme ami ; le vice usurpe le nom de vertu pour nous surprendre ; la témérité se cache sous les dehors du courage ; la lâcheté s'intitule modération, l'homme timide a les honneurs de la prudence.[13] Là est le grand péril de l'erreur, c'est là qu'il faut des marques distinctives. Au surplus, l'homme à qui l'on dit avez-vous des cornes? n'est pas si sot que de se tâter le front, ni assez inepte et obtus pour entrer en doute, quand par tes subtiles conclusions tu as cru le persuader. Ces finesses déroutent sans nuire, comme les tours d'un escamoteur avec ses gobelets et ses jetons, dont l'illusion fait tout le charme : le procédé une fois compris, adieu le plaisir. J'en dis autant de nos pièges de mots : car de quel autre nom appeler des sophismes sans danger pour qui les ignore, inutiles à qui les possède? Veux-tu à toute force des équivoques de langage à éclaircir, démontre-nous que l'homme heureux n'est pas celui que le monde nomme ainsi, et chez lequel l'or afflue en abondance, mais celui qui a tous ses trésors dans son âme, qui, fier et magnanime, foule aux pieds ce qu'admirent les autres qui ne voit personne contre qui il se veuille changer; qui ne prise dans l'homme que ce qui lui mérite le nom d'homme ; qui, prenant la nature pour guide et ses lois pour règles, vit comme elle l'ordonne ; qu'aucune force ne dépouille de ses biens; qui convertit en biens ses maux; ferme dans ses desseins, inébranlable, intrépide ; qui peut être ému par la violence, mais non jeté hors de son assiette ; enfin que la Fortune, en lui dardant de toute sa force ses traits les plus terribles, effleure à peine sans le blesser, et n'effleure que rarement. Car ses traits ordinaires, si foudroyants pour le reste des hommes, ne sont pour lui qu'une grêle sautillante, qui lancée sur les toits sans incommoder ceux qui sont dessous, fait entendre un vain cliquetis et se fond aussitôt. Pourquoi me tenir si longtemps sur cet argument que toi-même tu nommes le menteur,[14] et sur lequel on a composé tant de livres? Voici que la vie tout entière est pour moi un mensonge : démasque-la, subtil philosophe, ramène-la au vrai. Elle juge nécessaire ce qui en grande partie est superflu,[15] ou qui, sans être superflu, n'est d'aucune importance réelle pour assurer et compléter le bonheur. Car il ne s'ensuit pas qu'une chose soit un bien dès qu'elle est nécessaire ; et l'on prostitue ce nom si on le donne au pain, à la bouillie, à tout ce qui pour vivre est indispensable. Ce qui est bien est, par le fait, nécessaire ; ce qui est nécessaire n'est pas toujours un bien, attendu que certaines choses nécessaires sont en même temps très viles. Nul n'ignore à ce point la dignité de ce qui est bien, qu'il le ravale à tels objets d'une éphémère utilité. Eh! pourquoi ne pas consacrer plutôt tes soins à démontrer à tous quel temps précieux on perd à chercher le superflu, et que d'hommes traversent la vie en courant après les moyens de vivre? Passe en revue les individus, considère les masses : personne qui n'ait chaque jour l'œil fixé sur le lendemain. « Quel mal y a-t-il là? » diras-tu. Un mal immense : on ne vit pas, on attend la vie, on la recule en toute chose.[16] Avec toute la vigilance possible, le temps nous devancerait encore ; grâce à nos éternels délais, il passe comme chose qui nous serait étrangère, et le dernier jour a épuisé ce que chaque jour laissait perdre. Mais pour ne point excéder les bornes d'une lettre, qui ne doit pas occuper la main gauche du lecteur, remettons à un autre jour le procès des dialecticiens, trop subtiles gens qui font leur étude exclusive d'une chose accessoire. LETTRE XLVI.Éloge d'un ouvrage de Lucilius.J'ai reçu ton ouvrage, comme tu me l'avais promis; et, me réservant de le lire à mon aise, je l'ai ouvert sans vouloir en prendre plus qu'un avant-goût. Peu à peu l'attrait même de la lecture me fit aller plus loin. Il y règne un grand talent ; et la preuve, c'est qu'il m'a paru court, bien qu'il dépasse la taille des miens comme des tiens, et qu'au premier aspect on puisse le prendre pour un livre de Tite Live ou d'Epicure : enfin j'étais retenu par un charme si entraînant, que sans m'arrêter j'ai lu jusqu'au bout. Le soleil m'invitait à rentrer, la faim me pressait, les nuages étaient menaçants, et pourtant je l'ai dévoré tout entier. J'étais plus que satisfait, j'étais ravi. Quelle imagination! Quelle âme! je dirais : quels élans! si l'auteur faiblissait parfois, s'il ne s'élevait que par saillies. Or ce n'étaient pas des élans, mais une chaleur soutenue, une composition mâle, sévère et néanmoins par intervalles moelleuse et douce à propos. Tu as le style grand et fier : soutiens-le, garde cette allure. La matière y aidait sans doute; il faut donc la choisir fertile, propre à saisir, à échauffer l'imagination. Je te parlerai plus au long de ton livre après un nouvel examen : jusqu'ici mon jugement n'est pas plus arrêté que si j'avais entendu lire l'ouvrage, au lieu de l'avoir lu. Laisse-moi faire mon enquête. Sois sans appréhension : mon arrêt sera franc. Heureux mortel! tu n'as rien qui oblige personne à te mentir de si loin. Il est vrai qu'aujourd'hui, à défaut de motif, on ment par habitude. LETTRE XLVII.Qu'il faut traiter humainement ses esclaves.J'apprends avec plaisir de ceux qui viennent d'auprès de toi que tu vis en famille avec tes serviteurs : cela fait honneur à ta sagesse, à tes lumières. « Ils sont esclaves? » Non ils sont hommes. « Esclaves? » Non : mais compagnons de tente avec toi. « Esclaves? » Non : ce sont des amis d'humble condition, tes coesclaves, dois-tu dire, si tu songes que le sort peut autant sur toi que sur eux.[17] Aussi ne puis-je que rire de ceux qui tiennent à déshonneur de souper avec leur esclave, et cela parce que l'orgueilleuse étiquette veut qu'un maître à son repas soit entouré d'une foule de valets tous debout. Il mange plus qu'il ne peut contenir, son insatiable avidité surcharge un estomac déjà tout gonflé, qui, déshabitué de son office d'estomac, reçoit à grand’ peine ce qu'il va rejeter avec plus de peine encore ; et ces malheureux n'ont pas droit de remuer les lèvres, fût-ce même pour parler. Les verges châtient tout murmure; les bruits involontaires ne sont pas exceptés des coups, ni toux, ni éternuement, ni hoquet; malheur à qui interrompt le silence par le moindre mot! Ils passent les nuits entières debout, à jeun, lèvres closes. Qu'en arrive-t-il? Que leur langue ne s'épargne pas sur un maître en présence duquel elle est enchaînée. Jadis ils pouvaient converser et devant le maître et avec lui, et leur bouche n'était point scellée ; aussi étaient-ils hommes à s'offrir pour lui au bourreau, à détourner sur leurs têtes le péril qui eût menacé la sienne. Ils parlaient à table, ils se taisaient à la torture. Voici encore un adage inventé par ce même orgueil : Autant de valets, autant d'ennemis.[18] Nous ne les avons pas pour ennemis, nous les faisons tels. Et que d'autres traits cruels et inhumains sur lesquels je passe, et l'homme abusant de l'homme comme d'une bête de charge! Et nous, accoudés sur nos lits de festin, tandis que l'un essuie les crachats des convives, que L'autre éponge à deux genoux les dégoûtants résultats de l’ivresse, qu'un troisième découpe les oiseaux de prix, et promenant une main exercée le long du poitrail et des cuisses, détache le tout en aiguillettes! Plaignons l'homme dont la vie a pour tout emploi de disséquer avec grâce des volailles, mais plaignons plus peut-être l'homme qui donne ces leçons dans la seule vue de son plaisir, que celui qui s'y conforme par nécessité. Vient ensuite l'échanson, en parure de femme, qui s'évertue à démentir son âge : il ne peut échapper à l'enfance, l'art l'y repousse toujours, et déjà de taille militaire, il a le corps lisse, rasé ou complètement épilé : il consacre sa nuit entière à servir tour à tour l'ivrognerie et la lubricité du chef de la maison : il est son Jupiter au lit, et à table son Ganymède.[19] Cet autre, qui a sur les convives droit de censure, dans sa longue faction, ô misère! devra noter ceux que leurs flatteries, leurs excès de gourmandise ou de langue feront inviter pour demain. Ajoute ces Chefs d'office, subtils connaisseurs du palais du maître, qui savent de quels mets la saveur le rappelle ou l'aspect le délecte, quelle nouveauté réveillerait ses dégoûts; de quoi il est rassasié, blasé; de quoi il aura faim tel jour. Mais souper avec eux, il ne l'endurerait pas ; il croirait sa majesté amoindrie, s'il s'attablait avec son esclave. Justes dieux! et que d'esclaves devenus maîtres de telles gens! J'ai vu faire antichambre debout chez Callistus[20] son ancien maître, j'ai vu ce maître, qui l'avait fait vendre sous écriteau avec des esclaves de rebut, être exclu quand tout le monde entrait. Il était payé de retour : il l'avait rejeté dans cette classe par où commence le crieur pour essayer sa voix, et lui-même, répudié par lui, n'était pas jugé digne d'avoir ses entrées. Le maître avait vendu l'esclave, mais que de choses l'esclave faisait payer au maître. Songe donc que cet être que tu appelles ton esclave est né d'une même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt[21] comme toi. Tu peux le voir libre, il peut te voir esclave. Lors du désastre de Varus, que de personnages de la plus haute naissance, à qui leurs emplois militaires allaient ouvrir le sénat, furent dégradés par la Fortune jusqu'à devenir pâtres ou gardiens de cabanes! Après cela méprise des hommes au rang desquels avec tes mépris tu peux passer demain[22]! Je ne veux pas étendre à l'infini mon texte, ni faire une dissertation sur la conduite à tenir envers nos domestiques traités par nous avec tant de hauteurs, de cruautés, d'humiliations. Voici toutefois ma doctrine en deux mots : Sois avec ton inférieur comme tu voudrais que ton supérieur fat avec toi. Chaque fois que tu songeras à l'étendue de tes droits sur ton esclave, chaque fois tu dois songer que ton maître en a d'égaux sur toi. « Mon maître! vas-tu dire, mais je n'en ai point. » Tu es jeune encore : tu peux en avoir un jour. Ignores-tu à quel âge Hécube fît l'apprentissage de la servitude? Et Crésus! et la mère de Darius! Et Platon! Et Diogène! Montre à ton esclave de la bienveillance : admets-le dans ta compagnie, à ton entretien, à tes conseils, à ta table. Ici va se récrier contre moi toute la classe des gens de bon ton : « Mais c'est une honte, une inconvenance des plus grandes! » Et ces mêmes gens-là je les surprendrai baisant la main au valet d'autrui! Ne voyez-vous donc pas avec quel soin nos pères faisaient disparaître ce qu'a d'odieux le nom de maître et d'humiliant celui d'esclave? Ils appelaient l'un père famille et l'autre[23] familiaris, terme encore usité dans les mimes. Ils instituaient la fête des serviteurs, non comme le seul jour où ceux-ci mangeraient avec leurs maîtres, mais comme le jour spécial où ils avaient dans la maison les charges d'honneur et y rendaient la justice : chaque ménage était considéré comme un abrégé de la république. « Comment! Je recevrais tous mes esclaves à ma table! » Pas plus que tous les hommes libres. Tu te trompes, si tu crois que j'en repousserai quelques-uns comme chargés de trop sales fonctions, mon muletier par exemple, ou mon bouvier : je mesurerai l'homme non à son emploi, mais à sa moralité. Chacun se fait sa moralité; le sort assigne les emplois. Mange avec l'un, parce qu'il en est digne, avec l'autre pour qu'il le devienne. Ce que d'ignobles relations ont pu leur laisser de servile, une société plus honnête l'effacera. Pourquoi, ô Lucilius! ne chercher un ami qu'au forum et au sénat? Regarde bien, tu le trouveras dans ta propre maison. Souvent de bons matériaux se perdent faute d'ouvrier ; essaye, fais une épreuve. Comme il y aurait folie à marchander un cheval en examinant non la bête, mais la housse et le frein; bien plus fou est-on de priser l'homme sur son costume, ou sur sa condition qui n'est qu'une sorte de costume et d'enveloppe, « Mais un esclave! » Son âme peut-être est d'un homme libre. Un esclave! Ce titre lui fera-t-il tort? Montre-moi qui ne l'est pas. L'un est esclave de la débauche, l'autre de l'ambition, tous le sont de la peur.[24] Je te ferai voir des hommes consulaires valets d'une ridicule vieille, des riches, humbles servants d'une chambrière, des jeunes gens de la première noblesse courtisans d'un pantomime. Est-il plus indigne servitude qu'une servitude volontaire? En dépit donc de tous nos glorieux, montre à tes serviteurs un visage serein et point de hautaine supériorité. Qu'ils te respectent plutôt qu'ils ne te craignent. On me dira que j'appelle les esclaves à l'indépendance, que je dégrade les maîtres de leur prérogative, parce qu'à la crainte je préfère le respect, oui je le préfère, et j'entends par là un respect de clients, de protégés. Mes contradicteurs oublient donc que c'est bien assez pour des maîtres qu'un tribut dont Dieu se contente : le respect et l'amour. Or amour et crainte ne peuvent s'allier. Aussi fais-tu très bien, selon moi, de ne vouloir pas que tes gens tremblent devint toi et de n'employer que les corrections verbales. Les coups ne corrigent que la brute. Ce qui nous choque ne nous blesse pas toujours ; mais nos habitudes de mollesse nous disposent aux emportements, et tout ce qui ne répond pas à nos volontés éveille notre courroux. Nous avons pris le caractère des rois : les rois, sans tenir compte de leur force et de la faiblesse de leurs sujets, se livrent à de tels excès de fureur et de cruauté, qu'on les croirait vraiment outragés si la hauteur de leur fortune ne les mettait fort à l'abri de tels risques. Non pas qu'ils l'ignorent, mais de leur plainte même[25] ils tirent un prétexte pour nuire ; ils supposent l'injure, pour avoir droit de la faire.[26] Je ne t'arrêterai pas plus longtemps : tu n'as pas ici besoin d'exhortation. Les bonnes habitudes ont entre autres avantages celui de se plaire à elles-mêmes, de persévérer ; les mauvaises sont inconstantes; elles changent souvent, non pour valoir mieux, mais pour changer. LETTRE XLVIII.Que tout soit commun entre amis. Futilité de la dialectique.La lettre que tu m'as envoyée pendant ton voyage, aussi longue que le voyage même, aura plus tard sa réponse. J'ai besoin de me recueillir et d'aviser à ce que je dois te conseiller. Toi-même qui consultes, tu as longtemps délibéré si tu consulterais : je dois d'autant mieux t'imiter qu'il faut plus de loisir pour résoudre une question que pour la proposer, ici surtout où ton intérêt est autre que le mien. Mais parlé-je ici encore le langage[27] d’Epicure? Non : nos intérêts sont les mêmes ; ou je ne suis pas ton ami, si toute affaire qui te concerne n'est pas la mienne. L'amitié rend tout indivis entre nous : point de succès personnel non plus que de revers : nous vivons sur un fonds commun. Et le bonheur n'est point pour quiconque n'envisage que soi, rapportant tout à son utilité propre : il nous faut vivre pour autrui, si nous voulons vivre pour nous. L'exacte et religieuse observation de cette loi sociale qui fait que tous se confondent avec tous, qui proclame l'existence du droit commun de l'humanité, soutient puissamment aussi cette société plus intime dont je parle, qui est l'amitié. Tout sera commun entre amis, si presque tout l'est d'homme à homme. O Lucilius, le meilleur des hommes, je demanderais à nos subtils docteurs quels sont mes devoirs envers un ami et envers mon semblable, plutôt que tous les synonymes d'ami et combien le mot homme signifie de choses. Voici deux chemins opposés : la sagesse suit l'un, la sottise a pris l'autre : lequel adopter? De quel parti veut-on que je me range? Pour l'un tout homme est un ami, pour l'autre un ami n'est qu'un homme : celui-ci prend un ami pour soi, celui-là se donne à son ami. Et vous allez, vous, torturant des mots, agençant des syllabes! Qu'est-ce à dire? Si par un tissu d'artificieuses questions et à l'aide d'une conclusion fausse je n'arrive à coudre le mensonge à un principe vrai, je ne pourrai démêler ce qu'il faut fuir de ce qu'il faut rechercher! O honte! sur une chose si grave nous, vieillards, ne savons que jouer. Un rat est une syllabe; or un rat ronge du fromage, donc une syllabe ronge du fromage. Supposez que je ne puisse débrouiller ce sophisme, quel péril mon ignorance me suscitera-t-elle, quel inconvénient? En vérité devrai-je craindre de prendre un jour des syllabes dans une ratière, ou de voir, par ma négligence, un livre manger mon fromage? Ou peut-être y a-t-il plus de finesse à répondre : Un rat est une syllabe; une syllabe ne ronge pas de fromage : donc un rat ne ronge pas de fromage. Puériles inepties! Voilà sur quoi se froncent nos sourcils, sur quoi se penchent nos longues barbes! Voilà ce que nous enseignons avec nos visages soucieux et pâles! Veux-tu savoir ce que la philosophie promet aux hommes? le conseil. Tel est appelé à la mort ; tel est rongé par la misère ; tel autre trouve son supplice dans la richesse d'autrui ou dans la sienne; celui-ci a horreur de l'infortune; celui-là voudrait se soustraire à sa prospérité ; tel est en disgrâce auprès des hommes, et tel auprès des dieux. Qu'ai-je à faire de vos laborieux badinages? Il n'est pas temps de plaisanter : des malheureux vous invoquent. Vous avez promis secours aux naufragés, aux captifs, aux malades, aux indigents, aux condamnés dont la tête est sous la hache; où s'égare votre esprit? Que faites-vous? Vous jouez, quand je meurs d'effroi. Secourez-moi: à tous vos discours, c'est la réponse de tous.[28] De toutes parts les mains se tendent vers vous : ceux qui périssent, ceux qui vont périr implorent de vous quelque assistance; vous êtes leur espoir et leur force; ils vous crient : « Arrachez-nous à l'affreuse tourmente ; nous sommes dispersés, hors de nos voies : montrez-nous le clair fanal de la vérité. » Dites-leur ce que la nature a jugé nécessaire, ce qu'elle a jugé superflu ; combien ses lois sont faciles, de quelle douceur, de quelle aisance est la vie quand on les prend pour guides, de quelle amertume au contraire et de quel embarras quand on a foi dans l'opinion plus que dans la nature; mais d'abord enseignez ce qui peut alléger en partie leurs maux, ce qui doit guérir ou calmer leurs passions. Plût aux dieux que vos sophismes ne fussent qu'inutiles! Ils sont funestes. Je prouverai, quand on le voudra, jusqu'à l'évidence, que jetées dans ces arguties, les plus nobles âmes s'amoindrissent et s'énervent. Je rougis de dire quelles armes on offre à qui va marcher contre la Fortune, et comme on le prépare au combat. Fait-on ainsi la conquête du souverain bien? Grâce à vous, la philosophie n'est plus que chicanes ténébreuses, ignobles : elles avilissent ceux mêmes qui vivent de procès. Que faites-vous autre chose, en effet, quand vous poussez sciemment dans le piège ceux que vous interrogez? qu'y voit-on? qu'ils ont succombé par la forme. Mais, à l'exemple du préteur, la philosophie les rétablit dans leur droit. Pourquoi déserter vos sublimes engagements? Dans vos pompeux discours, vous m'avez garanti « que l'éclat de l'or pas plus que celui du glaive n'éblouirait mes yeux, qu'armé d'un courage héroïque je foulerais aux pieds ce que tous désirent et ce que tous craignent, » et vous descendez aux éléments de la grammaire? Quel est ce langage? S'élève-t-on par là jusqu'aux cieux? Car c'est ce que me promet la philosophie, de me faire l'égal de Dieu, c'est à quoi elle m'invite, c'est pourquoi je suis venu; tenez parole. Ainsi donc, cher Lucilius, débarrasse-toi autant que tu le pourras des exceptions et fins de non recevoir de nos philosophes. La clarté, la simplicité vont si bien à la droiture! Eussions-nous encore maintes années à vivre, qu'il les faudrait économiser pour suffire aux études essentielles : quelle folie donc d'en cultiver de superflues dans une si grande disette de temps? LETTRE XLIX.La vie est courte. Ne point la dépenser en futilités sophistiques.Il y a sans doute, cher Lucilius, de l'indifférence et de la tiédeur à ne se souvenir d'un ami que si les lieux nous le rappellent; toujours est-il que les endroits qu'il fréquentait réveillent parfois le regret assoupi dans notre âme ; c'est plus qu'un sentiment éteint qui ressuscite, c'est une plaie fermée qui se rouvre; ainsi notre deuil, bien qu'adouci par le temps, se renouvelle à l'aspect du serviteur aimé, du vêtement, de la demeure de ceux que nous pleurons. Voici la Campanie, voici surtout Naples en vue de tes chers. Pompéi : tu ne croirais pas comme tout cela ravive les regrets de ton absence. Tu es tout entier sous mes yeux ; je m'arrache une seconde fois de tes bras ; je te vois dévorant tes larmes et résistant mal à tes émotions qui se font jour malgré tes efforts pour les comprimer. Il me semble que c'est hier que je t'ai perdu. Eh! tout n'est-il pas d'hier, à juger par le souvenir? Hier, j'assistais enfant aux leçons du philosophe Sotion ; hier je débutais au barreau; hier j'étais las de plaider; hier déjà je ne le pouvais plus. Incalculable vitesse du temps, plus manifeste alors qu'on regarde en arrière! Ceux qu'absorbe l'heure présente ne le sentent point, tant il fuit précipitamment et passe sans appuyer! D'où vient, dis-tu, ce phénomène? C'est que tout le temps écoulé se resserre dans un même espace, est vu du même coup d'œil, en un seul amas qui tombe dans un gouffre sans fond. Et d'ailleurs, peut-il y avoir de longs intervalles dans une chose dont le tout est si court? Ce n'est qu'un point que notre vie, c'est moins encore, et cette chose si minime, la nature l'a divisée comme si c'était un espace. Elle en a fait la première, puis la seconde enfance, puis l'âge adulte, puis cette sorte de déclivité qui mène à la vieillesse, puis la vieillesse même. Quel petit cercle pour tant de degrés! Naguère je te reconduisais; et ce naguère pourtant est dans notre vie une bonne part, toute restreinte qu'elle doive nous paraître un jour, songeons-y. Jusqu'ici le temps ne me semblait pas si rapide; maintenant son incroyable vélocité me frappe, soit que je sente l'approche des lignes fatales,[29] soit que je commence à réfléchir sur mes pertes et à les compter. C'est là ce qui accroît surtout mon indignation, lorsque je vois des hommes à qui ce temps ne peut suffire, même pour l'essentiel, quand ils le ménageraient avec le plus grand soin, le dépenser presque tout en superflu. Cicéron dit que, sa vie fût-elle doublée, il n'aurait pas le temps de lire les lyriques. Je fais le même cas des dialecticiens, dont la sottise est moins divertissante. Les premiers font profession de dire des riens; les seconds croient dire quelque chose. Je ne nie pas qu'on ne doive leur donner un coup d'œil, mais rien qu'un coup d'œil, et les saluer en passant à cette seule fin de ne pas être dupe, de ne pas croire qu'il y ait chez eux quelque rare et précieux secret. Pourquoi te mettre à la torture et sécher sur un problème qu'il est plus piquant de dédaigner que de résoudre? C'est en pleine sécurité et quand on voyage bien à l'aise qu'on va ramassant de menus objets; mais quand on a l'ennemi à dos, quand vient l'ordre de lever le camp, la nécessité fait jeter tout ce que les loisirs de la trêve avaient permis de recueillir. Ai-je le temps d'épier des paroles à double entente, pour y exercer ma sagacité? Vois nos peuples ligués, nos portes, nos remparts, Tant de bras aiguisant des glaives et des dards.[30] Une âme forte, voilà ce qu'il me faut, et qu'un tel fracas de guerre m'assiège sans m'étourdir. Chacun devrait me juger hors de sens, si tandis que femmes et vieillards apporteraient tous des pierres pour fortifier les retranchements, quand la jeunesse en armes n'attendrait pour faire une sortie ou ne demanderait qu'un signal, quand les traits ennemis s'enfonceraient dans les portes, et que le sol même tremblerait par l'effet des mines et des percées souterraines, si alors, assis les bras croisés, je posais des questions comme celle-ci : Vous avez ce que vous n'avez pas perdu; or vous n'avez pas perdu de cornes, donc vous avez des cornes; et autres combinaisons de ce genre, raffinements d'hallucinés. Eh bien, maintenant même, à bon droit tu m'estimerais fou si je dépensais ma peine à de pareilles choses : j'ai aussi un siège à soutenir! A la guerre, le péril me viendrait du dehors: un mur me séparerait de l'ennemi; ici c'est en moi qu'est l'ennemi mortel. Le temps me manque pour ces fadaises, j'ai sur les bras une immense affaire. Comment m'y prendre? La mort est sur mes pas, la vie m'échappe : dans ce double embarras donnez-moi quelque expédient ; faites que je ne fuie point la mort et que je ne laisse point fuir la vie. Enhardissez-moi contre les obstacles, que je me résigne à l'inévitable : ce temps si étroit, venez me l'élargir, montrez que ce n'est pas la longueur mais l'emploi de la vie qui la fait heureuse; qu'il peut arriver, qu'il arrive bien souvent que tel qui a vécu longtemps a très peu vécu. Dites-moi, quand je vais dormir : « Tu peux ne plus te réveiller, » et quand je me réveille : « Tu peux ne plus dormir;[31] » quand je sors : « Tu peux ne plus rentrer; » et quand je rentre: « Tu peux ne plus sortir. » Non, ce n'est point le navigateur seulement que deux doigts séparent de la mort, c'est pour tous que l'intervalle est également mince. Sans se montrer partout d'aussi près, partout la mort est aussi proche. Dissipez ces ténèbres, et vous me transmettrez mieux des leçons auxquelles je serai préparé. La nature nous a créés capables d'apprendre : nous tenons d'elle une raison imparfaite, mais perfectible. Parlons ensemble de la justice, de la piété, de la frugalité, de la chasteté qui tout à la fois s'abstient d'attaquer et sait se défendre. Ne me menez point par des détours ; j'arriverai plus aisément où tendent mes efforts. La vérité, dit certain tragique, est simple en ses discours : aussi ne la faut-il point compliquer; rien ne sied moins que ces insidieuses finesses à une âme qui se porte au grand. LETTRE L.Que peu d'hommes connaissent leurs défauts.J'ai reçu ta lettre plusieurs mois après son envoi. J'ai donc cru superflu de demander au porteur ce que tu faisais. Il a certes bonne mémoire s'il s'en souvient ; toutefois j'espère que ta façon de vivre est telle que, n'importe où tu sois, je sais ce que tu fais. Car que ferais-tu, sinon te rendre meilleur chaque jour, te dépouiller de quelque erreur, reconnaître tes fautes à toi dans ce que tu crois celles des choses? Quelquefois on impute aux lieux ou aux temps tel inconvénient qui partout où nous irons doit nous suivre. Harpaste, la folle de ma femme, est restée chez moi, tu le sais, comme charge de succession ; car pour mon compte j'ai en grande aversion ces sortes de phénomènes : si parfois je veux m'amuser d'un fou, je n'ai pas loin à chercher, c'est de moi que je ris.[32] Cette folle a subitement perdu la vue, et, chose incroyable mais vraie, elle ne sait pas qu'elle est aveugle: à tout instant elle prie son guide de déménager, disant que la maison est sombre et qu'on n'y voit goutte. Ce qui en elle nous fait rire nous arrive à tous, n'est-il pas vrai? Personne ne se reconnaît pour avare, personne pour cupide. L'aveugle du moins cherche un conducteur; nous, nous errons sans en prendre et disons: « Je ne suis pas ambitieux; mais peut-on vivre autrement à Rome? Je n'ai point le goût des dépenses : mais la ville en exige de grandes ; ce n'est point ma faute si je m'emporte, si je n'ai pas encore arrêté un plan de vie fixe ; c'est l'effet de la jeunesse. » Pourquoi nous faire illusion? Notre mal ne vient pas du dehors ; il est en nous ; il a nos entrailles mêmes pour siège. Et si nous revenons difficilement à la santé, c'est que nous ne nous savons pas malades[33] ». Même à commencer d'aujourd'hui la cure, quand chasserons-nous tant de maladies toutes invétérées?[34] Mais nous ne cherchons même pas le médecin, qui aurait moins à faire si on l'appelait au début du mal : des âmes novices et tendres suivraient ses salutaires indications. Nul n'est ramené difficilement à la nature, s'il n'a divorcé avec elle. Nous rougissons d'apprendre la sagesse ; mais assurément s'il est honteux de chercher qui nous l'enseigne, on ne doit pas compter qu'un si grand bien nous tombe des mains du hasard. Il y faut du travail. Et à vrai dire, ce travail même n'est pas grand, si du moins, je le répète, nous nous sommes mis à pétrir notre âme et à la corriger avant qu'elle ne soit endurcie dans ses mauvais penchants. Fût-elle endurcie, je n'en désespérerais pas encore; il n'est rien dont ne vienne à bout une ardeur opiniâtre, un zèle actif et soutenu. Le bois le plus dur, même tortu, peut être rappelé à la ligne droite; les courbures d'une poutre se rectifient sous l'action du feu : née tout autre, notre besoin la façonne à ses exigences. Combien plus aisément l'âme reçoit-elle toutes les formes, cette âme flexible et qui cède mieux que tous les fluides! Qu'est-elle autre chose en effet qu'un air combiné de certaine façon? Or tu vois que l'air l'emporte en fluidité sur toute autre matière, parce qu'il l'emporte en ténuité? Crois-moi, Lucilius, ne renonce pas à bien espérer de nous par le motif que la contagion nous a déjà saisis et nous tient dès longtemps sous son empire. Chez personne la sagesse n'a précédé l'erreur : chez tous la place est occupée d'avance. Apprendre les vertus n'est que désapprendre les vices. Mais il faut aborder cette réforme avec d'autant plus de courage qu'un pareil bien une fois acquis se conserve toujours. On ne désapprend pas la vertu. Le vice rongeur est en nous une plante étrangère ; aussi peut-on l'extirper, le rejeter au loin : il n'est de fixe et d'inaltérable que ce qui vient sur un soi ami. La vertu est conforme à la nature ; les vices lui sont contraires et hostiles. Mais si les vertus une fois admises dans l'âme n'en sortent plus et sont aisées à entretenir, pour les aller quérir les abords sont rudes, le premier mouvement d'une âme débile et malade étant de redouter l'inconnu. Forçons donc la nôtre à se mettre en marche. D'ailleurs le remède n'est pas amer : l'effet en est aussi délicieux qu'il est prompt. La médecine du corps ne procure le plaisir qu'après la guérison : la philosophie est tout ensemble salutaire et agréable. LETTRE LI.Les bains de Baïes. Leurs dangers, même pour le sage.Chacun fait comme il peut, cher Lucilius. Toi, là-bas, tu as l'Etna, cette fameuse montagne de Sicile que Messala, ou que Valgius, je l'ai lu en effet dans tous les deux, a surnommée l'unique, je ne vois pas pourquoi ; car bien des endroits vomissent du feu ; et ce ne sont pas seulement des hauteurs, comme il arrive plus souvent, vu la tendance de la flamme à s'élever, ce sont aussi des plaines. Nous, faute de mieux, nous nous sommes contentés de Baïes, que j'ai quitté le lendemain de mon arrivée ; séjour à fuir, bien qu'il possède certains avantages naturels, parce qu'il est le rendez-vous que la volupté s'est choisi. « Quoi donc? Doit-on vouer de la haine à un lieu quelconque? » Non sans doute. Mais comme tel costume sied mieux que tel autre à l'honnête homme, au sage, et que sans être ennemi d'aucune couleur, il estime qu'il en est de peu convenables à qui professe la simplicité, de même il y a tel séjour que ce sage ou l'homme qui tend à l'être évitera comme incompatible avec les bonnes mœurs. Ainsi, songe-t-il à une retraite, jamais Canope[35] ne sera son choix : pourtant Canope n'interdit à personne d'être sobre. Baïes ne l'attirera pas davantage, Baïes devenu le lieu de plaisance de tous les vices. Là le plaisir se permet plus de choses qu'ailleurs; là, comme si c'était une convenance même du lieu, il se met plus à l'aise. Il faut choisir une région salubre non seulement au corps, mais à l'âme. Pas plus que parmi les bourreaux, je ne voudrais loger auprès des tavernes. Avoir le spectacle de l'ivresse errante sur ces rivages, de l'orgie qui passe en gondoles, des concerts de vois qui résonnent sur le lac, et de tous les excès d'une débauche comme affranchie de toute loi, qui fait le mal et le fait avec ostentation, est-ce là une nécessité? Non : mais un devoir pour nous, c'est de fuir au plus loin tout ce qui excite aux vices. Endurcissons notre âme, et tenons-la à longue distance des séductions de la volupté. Un seul quartier d'hiver amollit Annibal ; et l'homme que n'avaient dompté ni les neiges ni les Alpes se laissa énerver aux délices de la Campanie. Vainqueur par les armes, il fut vaincu par les vices. Nous aussi nous avons une guerre à soutenir, guerre où nulle relâche, nulle trêve n'est permise. Le premier ennemi à vaincre est la volupté qui, tu le vois, entraîna dans ses pièges les cœurs les plus farouches. Qui embrassera cette tâche en la mesurant tout entière saura qu'il ne doit accorder rien à la mollesse, rien à la sensualité. Qu'ai-je besoin de ces étangs d'eau chaude, de ces bains sudorifiques où s'engouffre un air sec et brûlant qui épuise le corps? Que le travail seul fasse couler nos sueurs. Si, comme Annibal, interrompant le cours de nos progrès et ne songeant plus aux batailles, le bien-être physique absorbait nos soins, qui ne blâmerait, et avec justice, une indolence hors de saison, dangereuse après la victoire, plus dangereuse quand la victoire est inachevée? Moins de choses nous sont permises à nous qu'à ceux qui suivaient les drapeaux de Carthage : il y a plus de péril à nous retirer, plus de besogne aussi à persévérer. La Fortune est en guerre avec moi: je ne suis pas homme à prendre ses ordres, je ne reçois pas son joug: qu'ai-je dit? j'aurai le courage plus grand de le secouer. Ne nous laissons pas amollir. Si je cède au plaisir, il me faudra céder à la douleur, céder à la fatigue, céder à la pauvreté ; l'ambition, la colère réclameront sur moi le même empire; je me verrai, entre toutes ces passions, tiraillé, déchiré. L'indépendance, voilà mon but; c'est le prix où tendent mes travaux. Qu'est-ce que l'indépendance? dis-tu. N'être l'esclave d'aucune chose, d'aucune nécessité, d'aucun incident, réduire la Fortune à lutter de plain-pied avec moi ; du jour où je sentirai que je puis plus qu'elle, elle ne pourra plus rien. Souffrirai-je tout d'elle, quand la mort est à ma disposition? Quiconque est tout à ces idées choisira une sérieuse, une sainte retraite. Une nature trop riante effémine les âmes, et nul doute que pour briser leur vigueur le pays n'ait quelque influence.[36] Tout chemin est supportable aux bêtes de somme dont le sabot s'est endurci sur d'âpres sentiers; celles qui furent engraissées dans de molles et humides prairies se déchaussent vite. Nos meilleurs soldats viennent de la montagne : point d'énergie chez ceux qui naquirent et vécurent à la ville. Nul labeur ne rebute des mains qui passent de la charrue aux armes : la poussière de la première marche abat nos parfumés et brillants citadins. La sévérité du site est un enseignement qui affermit le moral et le rend propre aux plus grands efforts. Liternum était pour Scipion un exil plus décent que Baïes;[37] un tel naufragé ne devait pas reposer si mollement. Ceux même que la fortune du peuple romain a investis les premiers de la souveraineté, C. Marius et Cn. Pompée et César, construisirent, il est vrai, des villas dans le pays de Baïes, mais ils les placèrent au sommet des montagnes. Il leur paraissait plus militaire de dominer au loin du regard les campagnes étendues à leurs pieds. Considère le choix de la position, l'assiette et la forme des édifices, tout cela ne sent point la villa, mais le château fort. Penses-tu que jamais Caton aurait habité, quelque joli belvédère[38] pour compter de là les couples adultères voguant sous ses yeux, et tant de barques de mille formes et de mille couleurs sur un lac tout jonché de roses, pour entendre des chanteurs nocturnes s'injurier à l'envi? N'eût-il pas préféré, loger dans l'un de ces retranchements qu'il traçait de sa main pour une nuit![39] Et quel homme, digne de ce nom, n'aimerait mieux être éveillé par la trompette que par une symphonie? C'est assez faire le procès à Baïes ; mais nous ne le ferons jamais assez aux vices; je t'en conjure, ô Lucilius! poursuis-les sans mesure et sans fin : car eux non plus n'ont ni fin ni mesure. Chasse de ton cœur tous les vautours qui le rongent ; et s'ils ne peuvent s'expulser autrement, arrache plutôt ton cœur avec eux. Surtout bannis les voluptés et voue-leur l'aversion la plus vive : comme ces brigands que les Egyptiens appellent Philètes, elles nous embrassent pour nous étouffer.[40] LETTRE LII.Sages et philosophes de divers ordres.Quelle est donc, Lucilius, cette force qui nous entraîne dans un sens quand nous tendons vers un autre, et qui nous pousse du côté que nous voulons fuir? Quelle est cette âme qui lutte contre la nôtre, qui ne nous permet pas de rien vouloir une bonne fois? Nous flottons entre mille projets contradictoires: nous ne voulons rien d'une volonté libre, absolue, constante.[41] « C'est, dis-tu, l'esprit de déraison qui n'a rien de fixe, rien qui lui plaise longtemps. » Mais quand et comment nous arracher à son influence? Personne n'est par soi-même assez fort pour s'en dégager : il faut quelqu'un qui lui tende la main, qui le tire delà bourbe. Certains hommes, dit Epicure, cheminent, sans que nul les aide, vers la vérité; et il se donne comme tel, comme s'étant tout seul frayé la route. Il les loue sans réserve d'avoir pris leur élan, de s'être produits par leur propre force. D'autres, ajoute-t-il, ont besoin d'assistance étrangère ; ils ne marcheront pas qu'on ne les précède, mais ils sauront très bien suivre; et il cite Métrodore[42] parmi ces derniers. Ce sont de beaux génies encore, mais du second ordre. La première classe n'est pas la nôtre ; heureux, si nous sommes admis dans la seconde ; car ne méprise pas l'homme qui peut se sauver avec l'intervention d'autrui : c'est déjà beaucoup de vouloir l'être. Après ces deux classes tu en trouveras une autre qui ne laisse pas d'être estimable, capable du bien si on l'y pousse avec une sorte de contrainte; il lui faut non seulement un guide, mais un auxiliaire et comme une force coactive. C'est la troisième nuance. Si tu veux un type de celle-là, Epicure te citera Hermarchus. Il félicite Métrodore, mais Hermarchus a son admiration. Bien qu'en effet tous deux eussent atteint le même but, la palme était due à qui avait tiré le même parti du fonds le plus ingrat. Figure-toi deux édifices pareils en tout, égaux en hauteur et en magnificence: l'un, établi sur un sol ferme, s'est rapidement élevé ; l'autre a de vastes fondations jetées sur un sol mou et sans consistance, et il en a coûté de longs efforts pour arriver à la terre solide. On voit dans le premier tout ce qui a été fait ; la plus grande et la plus difficile partie du second est cachée. Il est des esprits faciles et prompts; il en est qu'il faut remanier, comme on dit, et édifier à partir des fondements. Ainsi j'estimerai plus heureux celui qui n'a eu nulle peine à se former ; mais on a mieux mérité de soi quand on a triomphé des disgrâces de la nature, et que l'on s'est non pas dirigé, mais traîné jusqu'à la sagesse. Ces durs et laborieux éléments nous ont été départis à nous, sachons-le : nous marchons à travers les obstacles. Il faut donc combattre et invoquer quelques auxiliaires. « Mais qui invoquer? Celui-ci ou celui-là? » Recours même aux anciens, toujours disponibles : l'aide nous peut venir de ceux qui ne sont plus aussi bien que des vivants. Parmi ceux-ci faisons choix, non de ces gens à grands mots, à la parole rapide et précipitée, torrents de lieux communs et colportant à huis clos la sagesse, mais de ces hommes dont la vie est un enseignement;[43] qui disent ce qu'il faut faire et le prouvent en le faisant, et ne sont jamais pris à commettre ce qu'ils recommandent d'éviter : demande le secours de ces hommes que l'on admire plus à les voir qu'à les entendre. Non que je te défende d'écouter aussi ceux qui ont coutume d'admettre la foule à leurs dissertations, si du moins tout leur but, dès qu'ils se produisent en public, est de se rendre meilleurs en améliorant les autres, s'ils n'en font point une œuvre d'amour-propre. Car quoi de plus honteux que la philosophie courant après les acclamations? Le malade songe-t-il à louer l'opérateur qui tranche ses chairs? Aide-le par ton silence! et prête-toi à la cure ; et si des cris doivent t'échapper, je n'y veux reconnaître que les gémissements d'une âme dont on sonde les plaies. Tu veux témoigner que tu es attentif et que les grandes pensées t'émeuvent: à la bonne heure! Tu veux juger et donner ton avis sur qui vaut mieux que toi : pourquoi m'y opposerais-je? Pythagore imposait à ses disciples un silence de cinq ans: penses-tu toutefois qu'aussitôt après et la parole et le droit d'éloge leur étaient rendus? Mais quel aveuglement que celui d'un maître qui s'enivre au sortir de sa chaire des acclamations d'une foule ignorante! Peux-tu te complaire aux louanges de gens que toi-même tu ne peux louer? Fabianus dissertait en public, mais on l'écoutait avec recueillement; si l'on se récriait parfois d'admiration, ces transports étaient arrachés par la grandeur des idées et non par l'harmonie d'une molle et coulante diction que rien ne heurte dans son cours. Mettons quelque différence entre les acclamations du théâtre et celles de l'école : la louange aussi a son indiscrétion. Il n'est rien qui pour l'observateur n'ait ses indices, et les moindres traits peuvent donner la mesure de nos mœurs. L'impudique se reconnaît à la démarche, à un mouvement de main, souvent à une simple réponse, à un doigt qu'il porte-à sa chevelure,[44] à ses œillades détournées. Le méchant se trahit par son rire, le fou par sa physionomie et sa contenance.[45] Tout cela perce en symptômes extérieurs. Tu connaîtras ce qu'est un homme à la façon dont il se fait louer.[46] Nos philosophes en chaire sont flanqués d'auditeurs qui leur battent des mains : ils disparaissent sous le cercle admirateur qui se penche au-dessus d'eux. Ce n'est pas là, prends-y bien garde, louer un maître, c'est applaudir un histrion. Abandonnons ces clameurs aux professions qui ont pour but d'amuser le peuple : la philosophie veut un culte muet. Qu'on permette parfois aux jeunes gens de céder à l'enthousiasme quand l'enthousiasme agira tout seul, quand ils ne pourront plus se commander le silence. Ces suffrages-là sont un nouvel encouragement pour l'auditoire même, un aiguillon pour les jeunes âmes. Que la doctrine seule les émeuve, et non l'artifice des paroles : autrement, nuisible est l'éloquence qui se fait désirer pour elle, point pour le fond des choses.[47] Arrêtons-nous pour le présent ; car il est besoin de détails longs et spéciaux sur la manière de disserter devant le public, sur ce qu'on peut se permettre avec lui, et lui permettre avec nous. La philosophie a perdu, nul n'en doutera, depuis qu'on l'a livrée au peuple; mais elle peut se laisser voir dans son sanctuaire, quand toutefois elle trouve, au lieu d'ignobles fripiers, des ministres dignes d'elle. LETTRE LIII.Des maladies de l'âme. La philosophie veut l'homme tout entier.Que ne me persuaderait-on pas? On m'a persuade de m'embarquer : au départ la mer était des plus calmes, mais le ciel, à ne pas s'y méprendre, se chargeait de nuages grisâtres qui presque toujours donnent de la pluie ou du vent; je comptais, de ta chère Parthénope à Puteoli, gagner sur l'orage ce trajet de quelques milles, malgré les menaces du sinistre horizon Afin donc d'échapper plus vite, je cinglai au large droit vers Nesida, coupant court aux sinuosités du rivage. Déjà j'étais si avancé, qu'il me devenait égal d'aller ou de revenir, quand soudain le calme qui m'avait séduit disparaît. Ce n'était pas encore la tempête, mais la mer devenait houleuse et les lames toujours plus pressées. Je prie alors le pilote de me mettre à terre quelque part. Il me répond que toute la côte est escarpée, inabordable, et que par la tempête il ne craint rien tant que la terre. Mais, trop malade pour songer au péril, torturé de ces nausées lentes et sans résultat qui remuent la bile et ne l'épuisent point, je pressai de nouveau le pilote et le forçai bon gré mal gré de gagner la côte. Comme nous étions près d'y toucher, sans attendre que, suivant les prescriptions de Virgile, Vers la mer on tourne la proue ; ou que De la proue on ait jeté l'ancre.[48] me rappelant mon métier de nageur, mon ancienne passion pour l'eau froide, je m'élance, en amateur de bains glacés, avec mon manteau de laine. Que penses-tu que j'aie souffert à ramper sur des roches, à chercher une voie, à m'en faire une? J'ai senti que les marins n'ont pas tort de tant craindre la terre. On ne croirait pas quelles fatigues j'ai eu à soutenir, et je ne pouvais me soutenir moi-même! Non, Ulysse n'était pas né maudit de Neptune au point de faire naufrage à chaque pas : son vrai mal fut le mal de mer. Comme lui, vers quelque point que je navigue jamais, je mettrai vingt ans pour arriver. Dès que mon estomac se fut remis, et tu sais qu'en touchant la terre les nausées nous quittent, dès qu'une onction salutaire eut refait mes membres, je me mis à songer combien l'homme oublie jusqu'aux infirmités physiques qui à tout instant l'avertissent de leur présence, à plus forte raison ses infirmités morales, d'autant plus cachées qu'elles sont plus graves. Qu'un léger frisson nous survienne, nous prenons le change ; mais qu'il s'accroisse, et qu'une véritable fièvre s'allume, elle arrache l'aveu de son mal au mortel le plus ferme et le plus éprouvé. Sent-on quelque douleur aux pieds, des picotements aux articulations, on dissimule encore, on parle d'entorse au talon, d'un exercice où l'on se sera forcé. Le mal est indécis à son début, on lui cherche un nom ; mais que les chevilles viennent à se tuméfier et que du pied droit au pied gauche la différence soit nulle, il faut bien confesser que c'est la goutte.[49] Le contraire arrive dans les maladies qui affectent l'âme : l'état le plus grave sera le moins senti. Ne t'en étonne pas, cher Lucilius. Un homme légèrement assoupi, qui perçoit alors de vagues apparences, souvent reconnaît en dormant qu'il dort ; mais un sommeil profond éteint jusqu'aux songes et pèse tellement sur l'âme qu'il lui ôte tout usage de son intelligence. Pourquoi personne ne convient-il de ses propres vices? C'est qu'il est absorbé par eux. Raconter son rêve, c'est être éveillé; et confesser ses vices est signe de guérison. Éveillons-nous donc pour pouvoir démasquer nos erreurs : or la philosophie seule nous réveillera, seule elle rompra notre léthargie. Consacre-toi tout à elle; tu es digne d'elle, elle est digne de toi. Volez dans les bras l'un de l'autre ; et toi, renonce à toute autre affaire en homme de cœur, avec éclat. Point de demi-philosophie. Si tu étais malade, tu discontinuerais tout soin domestique, tu laisserais là tribunaux et procès, nul à tes yeux ne vaudrait la peine que même à tes heures de relâche tu assistasses à son procès, ta pensée et ton but unique seraient d'être au plus tôt quitte de ton mal. Eh bien! ne feras-tu pas de même pour ton âme? Congédie tous tes embarras, et sois enfin à la sagesse; on n'y arrive pas chargé des occupations du siècle. La philosophie exerce son droit souverain : elle donne l'heure, elle ne la prend pas. Loin d'être un pis aller, elle est notre affaire de tous les moments;[50] elle ne parait que pour commander. Les habitants d'une ville offraient à Alexandre une partie de leur territoire et la moitié de tous leurs biens. « Je ne suis pas venu en Asie, leur dit-il, pour recevoir ce que vous me donneriez, mais pour vous laisser ce dont je ne voudrais point. » La philosophie dit de même aux choses de la vie : « Je ne veux point du temps que vous auriez de reste ; c'est vous qui aurez celui dont je vous ferai l'octroi. » Voue donc à cette philosophie toutes tes pensées, tes assiduités, ton culte : qu'un immense intervalle te sépare du reste des hommes. Tu les dépasseras tous de beaucoup : les dieux te dépasseront de peu. — Quelle différence y aura-t-il entre eux et toi? — Tu veux le savoir? Ils dureront plus longtemps. Mais assurément le chef-d'œuvre de l'art est de réduire en petit tout un grand ouvrage. Le sage trouve autant d'espace dans sa vie que Dieu dans tous les siècles. Et même, en un point, le sage l'emporte : Dieu est redevable à sa nature de ne pas craindre, le sage l'est à lui-même. Chose sublime! joindre la fragilité d'un mortel à la sécurité d'un Dieu. On ne saurait croire quelle force a la philosophie pour amortir tous les coups du hasard. Pas un seul trait ne la pénètre : elle est remparée et inébranlable; elle lasse certaines attaques, d'autres sont comme des flèches légères perdues dans les plis de sa robe; ou bien elle les secoue et les renvoie à qui les a lancées. LETTRE LIV.Sénèque attaqué de l'asthme. Préparation à la mort.Mon mal m'avait laissé une longue trêve : tout à coup il m'a repris. « Quel genre de mal? » vas-tu dire. Tu as bien raison de le demander, car il n'en est point qui ne me soit connu. Il en est un pourtant auquel je suis pour ainsi dire voué, et que je ne sais pourquoi j'appellerais de son nom grec, car notre mot suspirium (suffocation) le désigne assez juste. Au reste il dure fort peu : c'est une tempête, un assaut brusque : en une heure presque il a cessé. Car peut-on être longtemps à expirer? Toutes les incommodités physiques, toutes les crises ont passé sur moi : aucune ne me paraît plus insupportable. Et en effet, dans toute autre, quelle qu'elle soit, on n'est que malade; dans celle-ci on rend comme le dernier souffle. Aussi les médecins l'ont nommée l'apprentissage de la mort, et l'asthme finit par faire ce qu'il a mainte fois essayé. Tu penses que je t'écris ceci bien gaiement, parce que je suis sauf. Si je m'applaudissais de ce résultat comme d'un retour à la santé, je serais aussi ridicule qu'un plaideur qui croirait sa cause gagnée, pour avoir obtenu délai. Toutefois, au fort même de la suffocation, je n'ai cessé d'avoir recours à des pensées consolantes et courageuses. Qu'est-ceci? me disais-je. La mort me tâtera-t-elle sans cesse? Eh bien soit! Moi aussi j'ai longtemps tâté d'elle. « Quand cela? » dis-tu. Avant de naître. La mort, c'est le non être:[51] ne l'ai-je pas déjà connu? il en sera après moi ce qu'il en était avant. Si la mort est un état de souffrance, on a dû souffrir avant de venir à la lumière ; et pourtant alors nous ne sentions nul déplaisir. Dis-moi, ne serait-il pas bien insensé celui qui croirait que la lampe éteinte est dans un état pire que celle qui n'est point encore allumée? Nous aussi on nous allume, et puis l'on nous éteint : dans l'intervalle nous souffrons bien quelque chose; mais après comme devant l'impassibilité est complète. Notre erreur, ce me semble, Lucilius, vient de croire que la mort n'est qu'après la vie, tandis qu'elle l'a précédée, de même qu'elle la suivra. Tout le temps qui fut avant nous fut une mort. Qu'importe de ne pas commencer ou de finir? Dans l'un comme dans l'autre cas c'est le néant. Voilà quel genre de remontrances je ne cessais de me faire, dans ma pensée s'entend, car parler, je ne l'aurais pu; puis insensiblement cet accès, qui déjà n'était plus qu'une courte haleine, me laissa de plus longs intervalles, se ralentit et enfin s'arrêta. Mais à présent même, bien que j'en sois quitte, ma respiration n'est pas naturelle, n'est pas libre : elle éprouve une sorte d'hésitation et de gêne. Comme elle voudrai pourvu que la gêne ne parte point de l'âme. A cet égard reçois ma parole : je ne tremblerai pas au dernier moment : je suis bien préparé; je ne compte même pas sur tout un jour. Il faut louer et imiter ceux qui n'ont pas regret de mourir tout en aimant à vivre. Quel mérite en effet de sortir quand on vous chasse? C'en est encore un pourtant : je suis chassé, mais je sors comme si je ne l'étais point. Aussi ne chasse-t-on point le sage; le mot suppose l'expulsion d'un lieu qu'on quitte malgré soi. Le sage ne fait rien malgré lui : il échappe à la nécessité ; car il veut d'avance les choses auxquelles elle le contraindrait. LETTRE LV.Description de la maison de Vatia. L'apathie ; le vrai repos.Je descends de litière à l'instant, aussi las que si j'avais fait à pied tout le chemin que j'ai fait assis. C'est un travail d'être porté longtemps, d'autant plus fatigant peut-être que la nature y répugne : car elle nous a donné des jambes pour marcher, comme des yeux pour voir par nous-mêmes. C'est la mollesse qui nous condamne à la débilité ; à force de ne vouloir pas, on finit par ne plus pouvoir. Au surplus j'avais besoin de me secouer un peu, soit pour dissiper les glaires fixées dans mon gosier, soit pour débarrasser ma respiration gênée par quelque autre cause, et j'ai senti que la litière me faisait du bien. J'ai donc voulu prolonger une promenade à laquelle m'invitait ce beau rivage qui, entre Cumes et la campagne de Servilius Vatia, forme un coude resserré comme une étroite chaussée, d'une part par la mer, de l'autre par le lac. Une récente tempête avait raffermi la grève. Là, comme tu sais, la lame fréquente et impétueuse aplanit le chemin, qui s'affaisse après un long calme, l'humidité qui lie les sables venant à disparaître. Cependant, selon mon usage, je regardais de toutes parts si je ne découvrirais rien dont je pusse faire profit, et mes yeux s'arrêtèrent sur cette campagne qui fut jadis celle de Vatia. Ce fut là que cet ex-préteur, ce richard, vieillit sans autre renommée que celle d'oisif, et à ce seul titre estimé heureux. Chaque fois que l'amitié d'Asinius Gallus[52] ou que la haine et plus tard l'affection de Séjan plongeait tel ou tel dans l'abîme, car il devint aussi dangereux d'avoir aimé Séjan que de l'avoir offensé, on s'écriait : « Ο Vatia! toi seul tu sais vivre! » Non; il ne sut que se cacher; il ne sut pas vivre.[53] Il y a loin du vrai repos à l'apathie. Pour moi, du vivant de Vatia, je ne passais jamais devant sa demeure sans me dire « Ci-gît Vatia.[54] » Mais tel est, ô Lucilius, le caractère vénérable et saint de la philosophie, qu'au moindre trait qui la rappelle le faux-semblant nous séduit. Car dans l'oisif le vulgaire voit un homme retiré de tout, libre de crainte, qui se suffit et vit pour lui-même, tous privilèges qui ne sont réservés qu'au sage. C'est le sage qui, sans ombre de sollicitude, sait vivre pour lui ; car il possède la première des sciences, la science de la vie. Mais fuir les affaires et les hommes, parce que nos prétentions échouées nous ont décidés à la retraite, ou que nous n'avons pu souffrir de voir le bonheur des autres ; mais, de même qu'un animal timide et sans énergie, se cacher par peur, c'est vivre, non pour soi, mais de la plus honteuse vie, pour son ventre, pour le sommeil, pour la luxure. Il ne s'ensuit pas qu'on vive pour soi de ce qu'on ne vit pour personne. Au reste c'est une si belle chose d'être constant et ferme dans ses résolutions, que même la persévérance dans le rien faire nous impose. Sur la maison en elle-même je ne te puis rien dire de positif : je n'en connais que la façade et les dehors, ce qu'en peuvent voir tous les passants. Il s'y trouve deux grottes d'un travail immense, aussi grandes que le plus large atrium et faites de main d'homme : l'une ne reçoit jamais le soleil, l'autre le garde jusqu'à son coucher. Un bois de platanes; au milieu un ruisseau qui va tomber d'un côté dans la mer, de l'autre dans le lac Acherusium, vous figure un Euripe[55] assez poissonneux, bien qu'on y pèche continuellement. Mais on le ménage quand la mer est ouverte aux pêcheurs ; le mauvais temps les fait-il chômer, on n'a qu'à étendre la main pour prendre. Du reste le grand mérite de cette villa, c'est qu'au delà de ses murs est Baïes, dont elle n'a pas les inconvénients, tout en jouissant de ses charmes. Voilà les qualités que je lui connais : c'est un séjour, je crois, de toute saison. Car elle reçoit la première le vent d'ouest, et si bien qu'elle en prive tout à fait Baïes. Vatia, ce me semble, n'avait pas trop mal choisi cet endroit pour y loger le désœuvrement de sa paresseuse vieillesse. Mais est-ce bien tel ou tel lieu qui contribue beaucoup à la tranquillité? L'âme seule donne à toutes choses le prix qu'elles ont pour elle. J'ai vu de délicieuses campagnes habitées par des cœurs chagrins : j'ai vu en pleine solitude le même trouble que chez les gens les plus affairés.[56] Garde-toi donc de penser que si ton âme n'est point entièrement calme, c'est que tu n'es pas en Campanie. Pourquoi d'ailleurs n'y es-tu pas? Envoies-y ta pensée : tu peux, malgré l'absence, vivre avec tes amis aussi souvent, aussi longtemps que tu le voudras. Et ce plaisir, le plus grand de tous, se goûte alors bien mieux. Car la présence rassasie et blase ; et pour s'être un certain temps entretenus et promenés et assis ensemble, une fois séparés on ne songe plus aux gens qu'on voyait tout à l'heure. Résignons-nous à l'absence pour cette autre raison qu'il n'est point d'ami qui, même près de nous, ne soit longtemps sans nous. Comptons d'abord les nuits qu'on passe séparément, les occupations qui pour chacun sont différentes, puis les goûts qui font qu'on s'isole, les courses à la campagne, tu verras que c'est peu de chose que le temps enlevé par les voyages. C'est dans le cœur qu'il faut posséder son ami : or le cœur n'est jamais absent; il voit qui il veut, et le voit tous les jours. Sois donc de moitié dans mes études, dans mes soupers, dans mes promenades. Nous vivrions trop à l'étroit, si en quoi que ce soit l'espace était fermé à la pensée. Moi je te vois, cher Lucilius, je t'entends même ; je suis tellement avec toi, que je doute à chaque lettre que je commence, si ce n'est pas un billet que je t'écris. LETTRE LVI.Bruits divers d'un bain public. Le sage peut étudier même au sein du tumulte.Je veux mourir, si le silence est aussi nécessaire qu'on le croit à qui s'isole pour étudier. Voici mille cris divers qui de toute part retentissent autour de moi : j'habite juste au-dessus d'un bain. Imagine tout ce que le gosier humain peut produire de sons antipathiques à l'oreille : quand des forts du gymnase s'escriment et battent l'air de leurs bras chargés de plomb, qu'ils soient ou qu'ils feignent d'être à bout de forces, je les entends geindre; et chaque fois que leur souffle longtemps retenu s'échappe, c'est une respiration sifflante et saccadée, du mode le plus aigu. Quand le hasard m'envoie un de ces garçons maladroits qui se bornent à frictionner, vaille que vaille, les petites gens, j'entends claquer une lourde main sur des épaules ; et selon que le creux ou le plat a porté, le son est différent. Mais qu'un joueur de paume survienne et se mette à compter les points, c'en est fait. Ajoutes-y un querelleur, un filou pris sur le fait, un chanteur qui trouve que dans le bain[57] sa voix a plus de charme, puis encore ceux qui font rejaillir avec fracas l'eau du bassin où ils s'élancent. Outre ces gens dont les éclats de voix, à défaut d'autre mérite, sont du moins naturels, figure-toi l'épileur qui, pour mieux provoquer l'attention, pousse par intervalles son glapissement grêle, sans jamais se taire que quand il épile des aisselles et fait crier un patient à sa place. Puis les intonations diverses du pâtissier, du charcutier, du confiseur, de tous les brocanteurs de tavernes, ayant chacun certaine modulation toute spéciale pour annoncer leur marchandise. « Tu es donc de fer, me diras-tu, ou tout à fait sourd pour avoir l'esprit libre au milieu de vociférations si variées et si discordantes ; tandis que les longues politesses de ses clients font presque mourir notre ami Crispus! » Eh bien oui : tout ce vacarme ne me trouble pas plus que le bruit des flots ou d'une chute d'eau, bien qu'on dise qu'une certaine peuplade transféra ailleurs ses pénates par cela seul qu'elle ne pouvait supporter le fracas de la chute du Nil. La voix humaine, je crois, cause plus de distraction que les autres bruits : elle détourne vers elle la pensée ; ceux-ci ne remplissent et ne frappent que l'oreille. Parmi les bruits qui retentissent autour de moi sans me distraire, je mets celui des chariots qui passent, du forgeron logé sous mon toit, du serrurier voisin, ou de cet autre qui, près de la Meta sudans,[58] essaye ses trompettes et ses flûtes, et beugle plutôt qu'une joue. Mais les sons intermittents m'importunent plus que les sons continus. Au reste je me suis si bien aguerri à tout cela, que je pourrais même entendre la voix écorchante d'un chef de rameurs marquant la mesure a ses hommes. Je force mon esprit a une constante attention sur lui même, et à ne se point détourner vers le dehors. Que tous les bruits du monde s'élèvent à l'extérieur, pourvu qu'en moi aucun tumulte ne se produise, que le désir et la crainte ne s'y combattent point, que l'avarice et le goût du faste n'y viennent point se quereller et se malmener l'un l'autre. Qu'importe en effet le silence de toute une contrée, si j'entends frémir mes passions? Il est nuit : tout s'endort dans un profond repos.[59] Erreur! Nul repos n'est profond, hors celui que la raison sait établir : la nuit nous ramène nos déplaisirs, elle ne les chasse point; elle nous fait passer d'un souci à un autre. Même quand nous dormons, nos songes sont aussi turbulents que nos veilles. La vraie tranquillité est celle où s'épanouit une bonne conscience. Vois cet homme qui appelle le sommeil par le vaste silence de ses appartements : pour qu'aucun bruit n'effarouche son oreille, toute sa légion d'esclaves est muette; ce n'est que sur la pointe du pied que l'on ose un peu l'approcher. Et néanmoins il se tourne en tous sens sur sa couche, cherchant à saisir à travers ses ennuis un demi-sommeil; il n'entend rien, et se plaint d'avoir entendu quelque chose. D'où penses-tu que cela provienne? De son âme, qui lui fait du bruit:[60] c'est elle qu'il faut calmer, dont il faut comprimer la révolte ; car ne crois pas que l'âme soit en paix parce que le corps demeure couché. Souvent le repos n'est rien moins que le repos. Aussi faut-il se porter à l'action et s'absorber dans quelque honnête exercice, chaque fois qu'on éprouve le malaise et l'impatience de l'oisiveté. Un habile chef d'armée voit-il le soldat mal obéir, il le dompte par quelque travail, par des expéditions qui le tiennent en haleine : une forte diversion ôte tout loisir aux folles fantaisies ; et s'il est une chose sûre, c'est que les vices nés de l'inaction se chassent par l'activité. Souvent on pourrait croire que l'ennui des affaires et le dégoût d'un poste pénible et ingrat nous ont fait chercher la retraite, mais au fond de cet asile où la crainte et la lassitude nous ont jetés, l'ambition par intervalles se ravive. Elle n'était point tranchée dans sa racine, mais fatiguée, courbée peut-être et écrasée[61] par les mauvais succès. J'en dis autant de la mollesse, qui parfois semble avoir pris congé de nous, puis revient tenter notre âme déjà fière de sa frugalité, et du sein même de nos abstinences redemande des plaisirs qu'on avait quittés, mais non proscrits pour jamais : retours d'autant plus vifs qu'ils sont plus cachés. Car le désordre qui s'avoue est toujours plus léger, comme la maladie tend à sa guérison quand elle fait éruption de l'intérieur et porte au dehors son venin. Et la cupidité aussi, et l'ambition et toutes les maladies de l'âme ne sont jamais plus dangereuses, sache-le bien, que lorsqu'elles s'assoupissent dans une hypocrite réforme. On semble rentré dans le calme, mais qu'on en est loin! Si au contraire nous sommes de bonne foi, si la retraite est bien sonnée, si nous dédaignons les vaines apparences dont je parlais tout à l'heure, rien ne pourra nous distraire; ni les voix d'une multitude d'hommes ni le gazouillis des oiseaux ne rompront la chaîne de nos bonnes pensées désormais fermes et arrêtées. Il a l'esprit léger et encore incapable de se recueillir, l'homme que le moindre cri, que tout imprévu effarouche. Il porte en lui un fonds d'inquiétude, un levain d'appréhension qui le rendent ombrageux; comme dit notre Virgile : Et moi, qui sous nos murs, calme au sein des alarmes, Affrontai mille fois toute la Grèce en armes, Un souffle me fait peur : je tremble au moindre bruit Et pour ce que je porte et pour ce qui me suit.[62] C'est d'abord un sage que ni le sifflement des dards, ni les phalanges serrées entrechoquant leurs armes, ni le fracas d'une ville que l'on sape n'épouvantent ; c'est ensuite un homme désorienté, qui craint pour son avoir, qui au moindre son prend l'alarme ; toute voix lui semble un bruit de voix hostiles et abat son courage ; les plus légers mouvements le glacent. Son bagage le rend timide. Prends qui tu voudras de ces prétendus heureux qui traînent et portent avec eux tant de choses, tu le verras Tremblant pour ce qu'il porte et pour ce qui le suit. Tu ne jouiras, sois-en sûr, d'un calme parfait que si nulle clameur ne te touche plus, si aucune voix ne t'arrache à toi-même, qu'elle flatte ou qu'elle menace, ou qu'elle assiège l'oreille de sons vains et discords. « Mais quoi? N'est-il pas un peu plus commode d'être à l'abri de tout vacarme? » J'en conviens; aussi vais-je déloger d'ici : c'est une épreuve, un exercice que j'ai voulu faire. Qu'est-il besoin de prolonger son malaise, quand le remède est si simple? Ulysse a bien su garantir ses compagnons des Sirènes elles-mêmes. LETTRE LVII.La grotte de Naples. Faiblesses naturelles que la raison ne saurait vaincre.Comme de Baïes je devais regagner Naples, je me laissai volontiers persuader que la mer était mauvaise, pour ne pas tenter derechef cette voie-là; mais j'eus tant de boue sur toute la route que cela peut passer aussi bien pour une traversée. J'ai dû subir complètement ce jour-là le sort des athlètes : la boue nous tint lieu de la cire à l'huile,[63] et nous prîmes notre couche de poussière sous la grotte de Naples.[64] Rien de plus long que ce cachot, ni de plus sombre que ces flambeaux qui, au lieu de faire voir dans les ténèbres, rendent seulement les ténèbres visibles. Au reste le jour y pénétrerait qu'il serait éclipsé par la poussière, déjà si pénible en plein air et si incommode ; qu'est-ce donc, quand c'est sur elle-même qu'elle tournoie, sans nul soupirail pour sortir, et qu'elle retombe sur le passant qui l'a soulevée? Les deux inconvénients opposés nous furent infligés à la fois : sur la même route, le même jour, boue et poussière nous mirent à mal. Toutefois cette obscurité profonde me donna sujet de rêver: je me sentis l'imagination comme frappée : c'était, non de la peur, mais un ébranlement causé par l'étrangeté d'une chose insolite et aussi des plus répugnantes. Mais ne te parlons plus de moi qui, loin d'être un sujet passable, suis plus loin encore de la perfection: parlons de l'homme sur qui la Fortune a perdu ses droits ; celui-là aussi peut avoir l'imagination frappée et changer de couleur. Il est des impressions, cher Lucilius, que n'éviterait point l'homme le plus ferme : la nature l'avertit par là qu'il est fait pour mourir. Ainsi le chagrin assombrit ses traits; il frissonne à un choc subit, et sa vue se trouble en sondant, du bord d'un précipice, son immense profondeur. Ce n'est point de la crainte; ce sont des mouvements naturels insurmontables à la raison. Ainsi encore certains braves, tout prêts à répandre leur sang, ne sauraient voir celui d'autrui ; d'autres ne peuvent toucher ni voir une blessure toute fraîche ou envieillie et purulente sans défaillir et perdre connaissance ; d'autres tendent la gorge au fer plus hardiment qu'ils ne l'envisagent. J'éprouvai donc, comme je le disais, une sorte non pas de bouleversement, mais d'ébranlement; en revanche, sitôt que je revis, que je retrouvai le grand jour, une joie involontaire et spontanée s'empara de moi. Pais je me mis à réfléchir combien il est absurde de craindre telle chose plutôt que telle autre, dès que toutes amènent une même fin. Où est la différence qu'on soit écrasé par une guérite ou par une montagne? Tu n'en trouveras aucune : bien des gens néanmoins craindront davantage ce second accident, bien que l'un soit mortel comme l'autre. Tant la peur considère moins l'effet que la cause! Penses-tu que je parle ici des stoïciens, selon lesquels l'âme de l'homme, écrasée par une grosse masse, ne peut plus sortir[65] et se disperse dans tout le corps, faute de trouver une issue libre? Nullement; ceux qui tiennent ce langage me semblent dans l'erreur. Comme on ne saurait comprimer la flamme, car elle s'échappe tout autour de ce qui pèse sur elle ; et comme l'air, qu'on le frappe de pointe ou de taille, n'est ni blessé ni divisé même, mais enveloppe l'objet auquel il a fait place ; ainsi l'âme, la substance la plus déliée de toutes, ne peut être retenue ni refoulée dans le corps ; sa subtilité se fait jour à travers les barrières mêmes qui la pressent. Tout comme la foudre, après qu'elle a rempli tout un édifice de ravages et de feux, se retire par la plus mince ouverture, l'âme, plus insaisissable encore que le feu, trouve à s'enfuir par le corps le plus dense. La question est donc de savoir si elle peut être immortelle. Or tiens pour certain que si elle survit au corps, elle ne saurait souffrir, aucune lésion,[66] par cela seul qu'elle est impérissable ; car il n'est point d'immortalité avec restriction, et rien ne porte atteinte à ce qui est éternel. LETTRE LVIII.De la division des êtres selon Platon. La tempérance, le suicide.Que notre langue est pauvre de mots, indigente même! Je ne l'ai jamais mieux senti qu'aujourd'hui. Mille choses se sont présentées, comme nous parlions par hasard de Platon, qui toutes demandaient des noms et n'en avaient point : quelques-unes en ont eu que, par dédain, on a laissé perdre. Or comment pardonner à l'indigence le dédain?[67] Cette mouche que les Grecs nomment œstron, qui chasse obstinément et disperse au loin les troupeaux dans les bois, nos pères l'appelaient asilum. On peut en croire Virgile : .... Cui nomen asilo Romanum est, œstrum Graii vertere vocantes.[68] On reconnaît, je pense, que ce mot a péri. Pour ne pas te tenir trop longtemps, certains mots étaient usités au simple ; ainsi on disait : cernere ferro inter se (vider sa querelle par le fer). Le même Virgile te le prouvera : Inter se coiisse viros, et cernere ferro.[69] Maintenant decernere est le mot ; le verbe simple n'est plus en usage. Les anciens disaient si jusso pour sijussero. Ne t'en rapporte pas à moi, mais au véridique Virgile : Cetera, qua jusso, mecum manus inferat arma.[70] Si je cite avec ce scrupule, ce n'est pas pour montrer quel temps j'ai perdu chez les grammairiens ; mais imagine combien de mots, depuis Ennius et Attius, la rouille a dû envahir, puisque, dans le poète même qu'on feuillette tous les jours, il en est que l'âge nous a dérobés. « Que signifie, dis-tu, ce préambule? Où tend-il? » Je ne te le cèlerai pas : je voudrais, si faire se pouvait sans choquer ton oreille, risquer le terme essentia; sinon je le ferai en la choquant. J'ai pour caution de ce terme-là Cicéron, assez riche, je pense, pour répondre, et si tu veux du plus moderne, Fabianus, orateur disert et élégant, brillant même pour notre goût raffiné. Car comment faire, Lucilius? De quelle manière rendre οὐσία, la chose qui existe nécessairement, qui embrasse toute la nature, qui est le fondement des choses? Grâce donc pour ce mot, passe-le-moi : je n'en serai pas moins attentif à user très sobrement du droit que tu m'auras donné ; peut-être me contenterai-je de l'avoir obtenu. Mais à quoi me sert ton indulgence? Voilà que je ne puis exprimer par aucun mot latin ce qui m'a fait chercher querelle à notre langue. Tu maudiras bien plus l'étroit vocabulaire romain, quand tu sauras que c'est une syllabe unique que je ne puis traduire. « Laquelle? » dis-tu. Τὸ ὄν.[71] Tu me trouves l'intelligence bien dure : il saute aux yeux que l'on peut traduire cela par quod est (ce qui est). Mais j'y vois grande différence : je suis contraint de mettre un verbe pour un nom: puisqu'il le faut, mettons quod est. Platon le divise en six classes, à ce que disait aujourd'hui notre ami, dont l'érudition est grande. Je te les énoncerai toutes, quand j'aurai établi qu'autre chose est le genre, autre chose l’espèce. Car ici nous cherchons ce genre primordial auquel toutes les espèces se rattachent, d'où naît toute division, où l'universalité des choses est comprise. Il sera trouvé si nous prenons chaque dérivé en remontant toujours ; ainsi arriverons-nous au tronc primitif. L'homme est espèce, comme dit Aristote; le cheval est espèce, le chien espèce : il faut donc à toutes ces espèces chercher un lien commun qui les embrasse et les domine. Quel est-il? le genre animal. Voilà donc pour tous ces êtres que je viens de citer, homme, cheval, chien, le genre animal. Mais il est des choses qui ont une âme et qui ne s'ont point animaux: on convient, par exemple, que les plantes et les arbustes en ont une ; aussi dit-on d'eux qu'ils vivent et qu'ils meurent. Les êtres animés occuperont donc une place supérieure, puisque dans cette classe sont compris et les animaux et les végétaux. D'autres êtres sont dépourvus d'âme, comme les pierres; ainsi il y aura un principe antérieur aux êtres animés, le corps. Je diviserai et je dirai : tous les corps sont ou animés ou inanimés. Il y a aussi quelque chose de supérieur au corps : car nous distinguons le corporel de l’incorporel. Mais d'où faudra-t-il qu'ils découlent? De ce à quoi nous venons d'appliquer un nom peu exact : de ce qui est. Nous le partagerons en deux espèces et nous dirons : ce qui est, est corporel ou incorporel. Voilà donc le genre primordial, antérieur et pour ainsi dire générique; tous les autres sont bien des genres, mais spéciaux. Ainsi l'homme est genre, car il comprend en soi les nations de toute espèce, Grecs, Romains, Parthes; de toute couleur, blancs, noirs, cuivrés ; il comprend les individus, Caton, Cicéron, Lucrèce. En tant qu'il contient des espèces, il est genre; comme contenu dans un autre, il est espèce. Le genre générique, ce qui est, n'a rien qui le domine : principe des choses, il les domine toutes. Les stoïciens veulent encore mettre au-dessus un autre genre supérieur dont je vais parler, quand j'aurai montré que· celui qui vient de m'occuper obtient à bon droit la première place comme embrassant toutes choses. Je divise ce qui est en deux espèces, le corporel et l'incorporel. Il n'en est point d'autre. Comment divisé-je le corps? En l'appelant animé ou inanimé. Ensuite comment divisé-je ce qui est animé? Je dis : les uns ont une âme, les autres n'ont qu'une animation ; ou bien : les uns ont un élan propre, ils marchent, ils se déplacent; les autres, fixés au sol, se nourrissent et croissent au moyen de leurs racines. Et les animaux, en quelles espèces les partageons-nous? Ils sont mortels ou immortels. Le premier genre est, dans l'idée de quelques stoïciens, le je ne sais quoi (quiddam). D'où leur vient cette idée, le voici. Dans la nature, disent-ils, il est des choses qui sont, il en est qui ne sont pas. Or la nature embrasse même ces dernières, qui apparaissent à l'imagination, comme les centaures, les géants, et toutes ces autres créations fantastiques de l'esprit auxquelles on est convenu de donner une forme, bien qu'elles n'aient point de substance. Je reviens à ce que je t'ai promis. Comment Platon divise-t-il tout ce qui est en six classes? D'abord l'être en lui-même n'est saisissable ni par la vue, ni par le tact, ni par aucun sens : il ne l'est que par la pensée. Ce qui est d'une manière générale, le genre homme par exemple, ne tombe pas sous la vue; on ne voit que des spécialités, comme Cicéron, comme Caton. Le genre animal ne se voit pas, il s'imagine ; mais on voit les espèces, le cheval, le chien. Au second rang des êtres, Platon met ce qui les domine et surpasse tous. C'est, dit-il, l'être par excellence, comme dit communément le poète : tous les faiseurs de vers sont ainsi nommés ; mais chez les Grecs ce titre n'appartient plus qu'à un seul homme. C'est d'Homère qu'on sait qu'il s'agit, quand on entend dire le poète. Mais quel est l'être par excellence? Dieu : car il est plus grand et plus puissant que tous les autres. Le troisième genre est celui des êtres qui proprement existent : ils sont sans nombre, mais placés hors de notre vue. « Mais quels sont-ils? » demandes-tu. Une création due à Platon : il appelle idées ce par quoi se fait tout ce que nous voyons et selon quoi tout se façonne. Elles sont immortelles, immutables, hors de toute atteinte. Ecoute ce que c'est que l'idée ou ce qu'il en semble à Platon. « L'idée est le type éternel des œuvres de la nature. » Joignons le commentaire à la définition, pour te rendre la chose plus claire. Je veux faire ton portrait : je t'ai pour modèle de ma peinture, et de ce modèle mon esprit recueille un ensemble de traits qu'il imprime à son ouvrage. Ainsi cette figure qui me guide et m'inspire et d'où j'emprunte mon imitation, est une idée. La nature possède donc à l'infini ces sortes de types, hommes, poissons, arbres, d'après lesquels se forme tout ce qui doit naître d'elle. En quatrième lieu vient l'eidos. Qu'est-ce que l'eidos? Il faut ici toute ton attention, il faut t'en prendre à Platon, non à moi de la difficulté de la chose; car point d'abstractions sans difficulté. Tout à l'heure je prenais le peintre pour comparaison ; s'il voulait avec ses couleurs représenter Virgile, il l'avait sous les yeux : l'idée était cette figure de Virgile modèle du futur tableau ; ce que l'artiste tire de cette figure, ce qu'il applique sur sa toile est l’eidos. « Où est la différence? » dis-tu. L'un est le modèle, l'autre, la forme prise du modèle et transportée sur la copie. L'artiste imite l'un, l'autre est son ouvrage. Une statue, c'est une certaine figure, c'est l'eidos. Le modèle aussi est une figure qu'avait en vue le statuaire en donnant une forme à son œuvre, savoir l'idée. Veux-tu encore une autre distinction? L'eidos est dans l'œuvre, l'idée en dehors de l'œuvre, et non seulement en dehors, mais préexistante. Le cinquième genre comprend les êtres qui existent communément, et ceci commence à nous concerner : là se trouve tout ce qui peuple le monde, hommes, animaux et choses. Le sixième genre désigne ce qui n'a qu'une quasi-existence, comme le vide, le temps. Tout ce qui se voit et se touche, Platon l'exclut du rang des êtres qu'il juge avoir une existence propre. Car tout cela passe et va sans cesse du plus au moins, du moins au plus. Nul de nous n'est sur ses vieux ans ce qu'il était dans sa jeunesse; nul n'est au matin ce qu'il fut la veille. Nous sommes emportés loin de nous, comme le fleuve loin de sa source ; tout ce que tu vois fuit du même pas que le temps; rien de ce qui frappe nos yeux n'est permanent. Et moi, à l'instant où je dis que tout change, je ne suis déjà plus le même. C'est là ce qu'exprime Héraclite : « On ne se baigne pas deux fois dans le même courant. » C'est le même fleuve pour le nom : mais les flots d'hier sont bien loin. Ce changement, pour être plus sensible dans un fleuve que chez l'homme, n'en est pas moins rapide pour ce dernier ni moins entraînant;[72] aussi admiré-je la folie de nos si vifs attachements à la chose la plus fugitive, notre corps, et de ces frayeurs de mourir un jour, quand chaque instant de vie est la mort de l'état qui précède! Ne crains donc plus, ô homme! de subir une dernière fois ce que tu subis chaque jour. J'ai parlé de l'homme, matière corruptible et caduque, en butte à toutes les causes de mort ; et l'univers lui-même, éternel, invincible qu'il est, se modifie et ne reste jamais le même. Car bien qu'il possède toujours ses éléments primitifs, il les possède autres que primitivement : il en bouleverse la distribution. « A quoi, diras-tu, ces subtilités me serviront-elles? » Puisque tu le demandes, à rien. Mais de même que le ciseleur donne à ses yeux fatigués par une trop longue tension quelque distraction et quelque relâche et, comme on dit, les restaure, ainsi parfois devons-nous détendre notre esprit et le refaire par certains délassements. Mais que ces délassements soient aussi des exercices : tu tireras même de là, si tu le veux bien, quelque chose de salutaire. Telle est mon habitude, Lucilius; il n'est point de récréation, si étrangère qu'elle soit à la philosophie, dont je ne tâche de tirer quelque chose et d'utiliser le résultat. Que recueillerai-je du sujet que nous venons de traiter, sujet étranger à la réforme des mœurs? Comment les idées platoniciennes me peuvent-elles rendre meilleur? Que retirerai-je de tout cela qui puisse réprimer mes passions? Tout au moins ceci, que tout objet qui flatte les sens, tout ce qui nous enflamme et nous irrite est, suivant Platon, en dehors des choses qui sont réellement. C'est donc là de l'imaginaire, qui revêt pour un temps telle ou telle forme, mais qui n'a rien de stable ni de substantiel. Et pourtant nous le convoitons comme s'il était fait pour durer sans cesse, ou nous-mêmes pour le posséder toujours. Êtres débiles et fluides, durant nos courts instants d'arrêt, élevons notre âme vers ce qui ne doit point périr. Voyons flotter dans les régions éthérées ces merveilleux types de toutes choses, et au centre de tous les êtres un Dieu modérateur, une Providence qui, n'ayant pu les faire immortels, la matière y mettait obstacle, les défend de la destruction, et de qui la raison triomphe de l'imperfection des corps. Car si l'univers subsiste, ce n'est point qu'il soit éternel, c'est qu'il est maintenu par les soins d'un régulateur. Les choses immortelles n'ont pas besoin qu'on les protège; le reste est conservé par son architecte dont la toute-puissance domine la fragilité de la matière. Méprisons toute cette matière, si peu précieuse qu'on peut contester qu'elle soit réellement. Songeons encore que si cet univers, non moins mortel que nous, est tenu par la Providence en dehors des périls, nous aussi pouvons, par une sorte de providence humaine, prolonger quelque peu la durée de notre frêle machine, si nous savons régir et maîtriser les voluptés par lesquelles meurt la grande partie des hommes. Platon lui-même dut au régime le plus exact d'atteindre à la vieillesse. Doué, il est vrai, d'une complexion ferme et vigoureuse, sa large poitrine lui a valu le nom qu'il a porté ; mais les voyages maritimes et les crises de sa vie avaient bien affaibli ses forces ; sa tempérance toutefois, sa modération dans tout ce qui aiguise nos appétits, son extrême surveillance de lui-même le conduisirent à ce grand âge dont mille causes l'éloignaient. Car tu sais, je pense, que Platon, grâce à son régime et par un singulier hasard, mourut le jour anniversaire de sa naissance, sa quatre-vingt-unième année pleinement révolue. En considération de quoi, des Mages, qui se trouvaient à Athènes, offrirent un sacrifice aux mânes de celui qu'ils croyaient favorisé d'une destinée plus qu'humaine pour avoir accompli le plus parfait des nombres, le nombre de neuf multiplié par lui-même. Je ne doute pas qu'il n'eût été prêt à faire sur ce total remise de quelques jours et des honneurs du sacrifice. La frugalité peut prolonger la vieillesse qui, si elle n'est pas fort désirable, n'est pas non plus à rejeter. Il est doux d'être avec soi-même le plus longtemps possible, quand on s'est rendu digne de jouir de soi. Enonçons ici notre sentiment sur le point de savoir si l'on doit faire fi des dernières années de la vieillesse et, sans attendre le terme, en finir volontairement. C'est presque craindre le jour fatal que de le laisser lâchement venir; comme c'est être plus que de raison adonné au vin que démettre l'amphore à sec et d'avaler jusqu'à la lie. Nous chercherons toutefois si cet âge qui couronne la vie en est pour nous la lie, ou bien la partie la plus limpide et la plus pure, quand du moins l'âme n'est pas flétrie, quand les sens, dans leur intégrité, prêtent force à l'intelligence, et que le corps n'est point ruiné et mort avant le temps. Grande est en effet la différence entre une longue vie et une mort prolongée. Mais si le corps est impropre au service de l'âme, pourquoi ne pas tirer celle-ci de la gêne? Et peut-être faut-il le faire un peu avant d'y être obligé, de peur que l'obligation venue on ne le puisse plus ; et comme l'inconvénient est plus grave de vivre mal que de mourir tôt, c'est folie de ne pas racheter au prix de quelques instants la chance d'un grand malheur. Peu d'hommes arrivent par une longue vieillesse à la mort sans que le temps leur ait fait outrage ; la vie de beaucoup s'est usée dans l'inaction sans profit pour elle-même. Est-il bien plus cruel, penses-tu, de perdre quelque peu d'une vie qui, en dépit de tout, doit finir? Ne m'écoute point avec répugnance, comme si l'arrêt te concernait; mais pèse bien mes paroles. Je ne fuirai point la vieillesse, si elle doit me laisser tout entier à moi, tout entier dans la meilleure partie de mon être ; mais si elle vient à saper mon esprit, à le démolir pièce à pièce, si elle me laisse non plus la vie mais le souffle, je m'élancerai hors d'un édifice vermoulu et croulant. Je ne me sauverai point de la maladie par la mort, si la maladie n'est pas incurable et ne préjudicie pas à mon âme ; je n'armerai pas mes mains contre moi pour échapper à la douleur : mourir ainsi c'est être vaincu. Mais si je sais que je dois souffrir perpétuellement, je m'en irai non à cause du mal, mais parce qu'il me serait un obstacle à tout ce qui fait le prix de la vie. Faible et pusillanime est l'homme qui meurt parce qu'il souffre ; insensé qui vit pour souffrir. Mais je deviens trop long; le sujet d'ailleurs épuiserait une journée. Et comment mettrait-il fin à son existence, celui qui ne peut finir une lettre? Donc porte-toi bien; ce mot-là, tu le liras plus volontiers que tous mes funèbres propos. LETTRE LIX.Leçons de style. La flatterie. Vraies et fausses joies.Ta lettre m'a fait grand plaisir : permets-moi l'expression reçue, et ne lui donne pas l'interprétation stoïcienne. Car le vice, croyons-nous, c'est le plaisir. A la bonne heure! d'ordinaire pourtant par ce dernier mot nous qualifions une affection gaie de l'âme. Je sais, encore une fois, que le plaisir (en formulant nos paroles sur nos maximes), est une chose honteuse, et que la joie n'appartient qu'au sage ; car c'est l'élan d'une âme sûre de sa force et de ses ressources. Toutefois, dans le langage habituel nous disons que le consulat d'un ami, ou son mariage ou l'accouchement de sa femme nous ont causé une grande joie, toutes choses qui loin d'être des joies, sont souvent le principe de futurs chagrins, tandis que la joie a pour caractère de ne point cesser, de ne point passer à l'état contraire. Aussi quand Virgile dit : les mauvaises joies de l'âme, il est élégant, mais peu exact ; car il n'y a jamais de mauvaise joie. C'est des plaisirs qu'il prétendait parler; et ce qu'il voulait dire, il l'a bien rendu : il désignait les hommes joyeux de leur malheur. Toujours est-il que je n'ai pas eu tort d'avancer que ta lettre m'a fait grand’ plaisir. La joie de l'ignorant eût-elle un honnête motif, n'en est pas moins une affection désordonnée· qui tournera vite au· repentir, un plaisir, dirai-je, qui, provoqué par l'idée d'un faux bien, n'a ni mesure ni discrétion. Mais, pour revenir à mon propos, voici ce qui dans ta lettre m'a charmé. Tu es maître de tes expressions ; et l'entraînement de la phrase ne te mène pas plus loin que tu n'as dessein d'aller. Bien des gens écrivent ce qui n'était point leur idée première, séduits qu'ils sont par l'attrait d'un mot éblouissant : cela ne t'arrive point : tout est précis et approprié au sujet. Tu ne dis qu'autant que tu veux et tu laisses entendre plus que tu ne dis. Ce mérite en annonce un autre plus grand : on voit que ton esprit aussi est exempt de redondance et d'enflure. Je trouve chez toi des métaphores qui, sans être aventureuses, ne sont pas non plus sans éclat : celles-là peuvent se risquer. J'y trouve des images ; et nous les interdire en décidant qu'aux poètes seuls elles sont permises, c'est n'avoir lu, ce me semble, aucun des anciens ; eux pourtant ne visaient point encore aux phrases à applaudissement. Ils s'énonçaient avec simplicité, uniquement pour se faire comprendre, et pourtant ils fourmillent de figures, chose que j'estime nécessaire aux philosophes, non pour la même raison qu'aux poètes, mais pour aider à nos faibles intelligences, et mettre l'auditeur ou le lecteur en présence des objets. Je lis en ce moment Sextius, esprit vigoureux, grec par son langage, romain par sa morale et sa philosophie. Une de ses comparaisons m'a frappé : « Une armée, dit-il, marche en bataillon carré, lorsque de tout côté les surprises de l'ennemi sont à craindre ; chacun se dispose à le recevoir. Ainsi doit faire le sage : déployer ses vertus en tous sens, n'importe par où vienne l'agression, y avoir la défense toute prête, et que tout obéisse sans confusion au moindre signe du chef. » Si dans les armées que disciplinent de grands tacticiens on voit les ordres du général parvenir simultanément à toutes les troupes, distribuées de telle sorte que le signal donné par un seul parcourt à la fois la ligne des fantassins et celle des cavaliers, la même méthode, selon Sextius, nous est à nous bien plus nécessaire. Car souvent une armée craint l'ennemi sans sujet, et la route la plus sûre est celle qu'elle suspectait le plus. Mais point de trêve pour l'imprévoyance : elle a à craindre au-dessus comme au-dessous d'elle ; l'alarme est à sa droite comme à sa gauche ; les périls surgissent derrière et devant elle ; tout lui fait peur ; jamais préparée, elle s'effraye même de ses auxiliaires. Le sage au contraire est sous les armes et en garde contre toute brusque attaque : la pauvreté, le deuil, l'ignominie, la douleur fondraient sur lui sans le faire reculer d'un pas. Il marchera intrépidement à la rencontre comme au travers de ces fléaux. Nous, mille liens nous enchaînent et usent notre force : nous avons trop croupi dans nos vices ; nous purifier est chose difficile. Car nous ne sommes pas souillés seulement, nous sommes infectés. Sans passer de cette image à une autre, je me demanderai, question que je creuse souvent, pourquoi l'erreur s'attache à nous avec tant de ténacité? C'est d'abord qu'on ne s'élance pas de toute sa force vers les voies de salut ; c'est aussi parce qu'on ne croit pas assez aux vérités trouvées par les sages, c'est que loin de leur ouvrir tout son cœur on ne donne à ces grands intérêts qu'une légère attention. Or comment apprendre à lutter efficacement contre le vice, quand on n'y songe qu'autant que le vice nous laisse de relâche? Nul de nous n'est allé au fond des choses : nous n'avons fait qu'effleurer la surface, et si peu de temps que nous ayons donné à la philosophie, semble assez, même trop, à nos gens affairés. Mais le plus grand obstacle est que rien ne nous plaît si vite que nous-mêmes. Trouvons-nous quelqu'un qui vante notre sagesse, notre sagacité, nos rares vertus, nous reconnaissons qu'il dit vrai. Et loin qu'un éloge mesuré nous suffise, tous ceux qu'accumule la flatterie la plus impudente, nous les prenons comme chose due;[73] qu'on nous proclame des modèles de bonté, de sagesse, nous en tombons d'accord, sachant pourtant que nous avons affaire à des menteurs de profession, et nous donnons si bien carrière à notre amour-propre, que nous voulons être loués précisément du contraire de ce que nous faisons. Entouré d'échafauds le tyran entend chanter sa clémence, l'homme de proie sa générosité, l'ivrogne et le débauché son extrême tempérance. Il suit de là qu'on renonce à se réformer, sûr que l'on est d'être le meilleur possible. Alexandre portait déjà dans l'Inde ses armes vagabondes et promenait la dévastation chez des peuples à peine connus même de leurs voisins, lorsqu'au siège de je ne sais quelle place dont il faisait le tour pour en découvrir les endroits faibles, il fut atteint d'une flèche. Il n'en resta pas moins à cheval et continua longtemps ses explorations. A la fin le sang ne coulant plus et s'étant figé dans la plaie, la douleur augmenta, la jambe peu à peu s'engourdit faute de support;[74] et contraint de s'arrêter il se mit à dire : « Tout le monde me jure que je suis fils de Jupiter ; mais cette blessure me crie : Tu n'es qu'un homme. » Disons comme lui, chacun dans notre sphère, quand l'adulation voudra nous infatuer de nos mérites : « Vous vantez ma prudence; mais je vois combien de choses inutiles je désire, ou que mes vœux seraient ma perte ; je ne distingue pas même, chose que la satiété enseigne aux animaux, quelle doit être la mesure du manger et du boire; je ne sais pas encore la capacité de mon estomac. » Je vais t'apprendre à reconnaître si tu es indigne du nom de sage. Dans le cœur du vrai sage il règne une joie, une sérénité, un calme inébranlables ; il vit de pair avec les dieux. Examine-toi maintenant. N'es-tu jamais chagrin, l'espérance n'agite-t-elle jamais ton âme impatiente de l'avenir, le jour comme la nuit cette âme se maintient-elle constamment égale, élevée et contente d'elle-même? Tu es arrivé au comble du bonheur humain. Mais si tu appelles le plaisir et de partout et sous toute forme, sache qu'il te manque en sagesse tout ce qui te manque en satisfactions. Tu aspires au bonheur, mais tu te trompes si tu comptes y arriver par les richesses, si c'est aux honneurs que tu demandes la joie ainsi qu'aux soucis des affaires. Ce que tu brigues là comme devant te donner plaisir et contentement, n'enfante que douleurs. Oui, tous ces hommes courent après la vraie joie, mais d'où l'obtient-on durable et parfaite, ils l'ignorent. L'un la cherche dans les festins et la mollesse ; l'autre dans l'ambition, dans un nombreux cortège de clients ; celui-ci dans l'amour, celui-là dans un vain étalage d'études libérales, et dans les lettres, qui ne guérissent de rien. Amusements trompeurs qui les séduisent tous un moment, comme l'ivresse qui compense un instant de joyeux délire par de longues heures d'abattement, comme les applaudissements et les acclamations de la faveur populaire qui s'achètent et s'expient par de si vives anxiétés. Persuade-toi bien que la sagesse a pour résultat une joie toujours égale. L'âme du sage est en même état que la partie de l'atmosphère supérieure à la lune : elle possède la sérénité sans fin.[75] Tu as donc pour vouloir être sage ce motif que le sage n'est jamais sans joie. Cette joie ne peut naître que de la conscience· de ses vertus. Elle n'est faite que pour l'homme de cœur, l'homme juste, l'homme tempérant. « Quoi? diras-tu, les sots et les méchants ne se réjouissent-ils pas? » Pas plus que le lion qui a trouvé sa proie. Quand ils se sont fatigués de vin et de débauches, que la nuit cesse avant leurs orgies, et que les mets les plus exquis entassés dans leur estomac trop étroit commencent à chercher une issue, alors les malheureux s'écrient comme le Déiphobe de Virgile : Tu te souviens, hélas! dans quelle fausse joie Se passa cette nuit, la dernière de Troie.[76] Toutes les nuits des débauchés se passent en plaisirs faux, et comme si chacune était pour eux la dernière. Cette autre joie, qui fait le partage des dieux et de leurs émules, ne s'interrompt ni ne cesse point : elle cesserait, s'ils l'empruntaient à l'extérieur. Comme c'est une grâce qu'ils ne tiennent de personne, elle n'est a la merci de qui que ce soit. Ce que la Fortune n'a point donné, elle ne l'enlève pas. LETTRE LX.Vœux imprévoyants. Avidité des hommes.Je me plains, j'ai des griefs, de la colère contre toi. En es-tu encore à former les vœux que formait pour toi ta nourrice, ou ton pédagogue ou ta mère? Ne comprends-tu pas encore que de maux ils te souhaitaient? Oh! combien nous sont contraires les vœux de ceux qui nous aiment, et d'autant plus contraires lorsqu'ils sont exaucés! Je ne m’étonne plus que dès le berceau tous les maux s'attachent à nos pas : nous avons grandi au milieu des malédictions de nos parents.[77] Que les dieux en revanche entendent de notre bouche une prière désintéressée. Les fatiguerons-nous toujours de nos demandes, en hommes qui n'auraient pas encore de quoi s'alimenter? Jusqu'à quand sèmerons-nous pour nous seuls des champs plus vastes que de grandes cités? Jusqu'à quand tout un peuple moissonnera-t-il pour nous? Jusqu'à quand l'approvisionnement d'une seule table arrivera-t-il sur tant de vaisseaux et par plus d'une mer? Peu d'arpents suffisent à nourrir un bœuf : c'est assez d'une forêt pour plusieurs éléphants : il faut, pour qu'un homme se repaisse, et la terre et la mer. Eh quoi! dans un corps si chétif, la nature nous a-t-elle donné un estomac si insatiable que nous surpassions en avidité les plus grands, les plus voraces des animaux?[78] Non certes. Car à quoi se réduit ce que l'on donne à la nature? Pour peu de chose elle nous tient quittes. Ce n'est point l'appétit qui coûte, c'est la vanité. Ces gens donc que Salluste appelle valets de leur ventre, mettons-les au rang des animaux, non des hommes, et quelquefois pas même au rang des animaux, mais des morts. Vivre, c'est être utile à plusieurs; vivre, c'est user de soi-même; maie croupir dans l'ombre et l'apathie, c'est de sa demeure se faire un tombeau. Au seuil même de tels hommes on peut graver sur le marbre, en épitaphe : morts par anticipation.[79] LETTRE LXI.Se corriger, se soumettre à la nécessité.Cessons de vouloir ce que nous voulûmes jadis. Pour moi, je tâche sur mes vieux ans qu'on ne m'accuse pas de vouloir les mêmes choses que dans mon jeune âge. Voilà où tendent uniquement et mes jours et mes nuits; voilà mon œuvre, ma préoccupation : mettre fin à mes vieilles erreurs. Je travaille à ce que chaque jour soit pour moi toute une vie. Et vraiment je le saisis au vol, non comme si c'était le dernier, mais dans la pensée qu'il peut l'être. L'esprit dans lequel je t'écris cette lettre est celui d'un homme que la mort peut appeler à l'instant même où il t'écrit. Prêt à partir, je jouis mieux de la vie, vu que son plus ou moins de durée ne m'est d'aucun prix. Avant d'être vieux j'ai songé à bien vivre, et dans ma vieillesse à bien mourir ; or bien mourir, c'est mourir sans regret. Prends garde de jamais rien faire malgré toi. Tout ce qui doit être, doit être une nécessité pour qui résiste : pour qui consent, la nécessité n'est pas. Oui assurément : se soumettre de bonne grâce au commandement, c'est échapper à ce que la servitude a de plus amer, qui est de faire ce qu'on ne voudrait point. Ce n'est pas d'exécuter un ordre qu'on est malheureux, c'est de l'exécuter à contrecœur. Disposons donc notre âme à vouloir tout ce que le sort exigera, et surtout envisageons sans chagrin la fin de notre être. Il faut faire ses préparatifs pour la mort avant de les faire pour la vie. La vie est assez riche de ressources; mais nous sommes trop avides de les multiplier ; quelque chose nous semble manquer, et nous le semblera toujours. Quant à vivre assez, les ans ni les jours n'y font rien; ce qui fait tout ici, c'est l'âme. J'ai vécu, cher Lucilius, autant qu'il me fallait : j'attends la mort rassasié de jours. LETTRE LXII.Même au sein des affaires on peut étudier.Ils ne disent pas vrai ceux qui veulent faire croire que le grand nombre de leurs affaires est pour eux un obstacle aux études libérales ; ils feignent des occupations ou les exagèrent, et c'est d'eux-mêmes que vient leur empêchement. Moi, cher Lucilius, moi, je suis libre, et n'importe où je me trouve, je suis à moi. Je me prête aux affaires, je ne m'y livre pas, et ne cours point après les occasions de gaspiller mon temps. Quelque part que je m'arrête, je reprends le fil de mes pensées, et j'occupe mon esprit de quelque salutaire réflexion. Quand je me donne à mes amis, je ne m'enlève pas pour cela à moi-même ; je ne suis point absorbé par ceux dont quelque circonstance me rapproche, ou bien un devoir social : non, je converse alors avec les plus vertueux des hommes. N'importe leur patrie, n'importe leur époque, c'est vers eux que vole ma pensée. Je porte partout avec moi Démétrius,[80] le meilleur des mortels, et laissant là nos grands et leur pourpre, je m'entretiens avec ce sage demi-vêtu, et je l'admire. Et comment ne pas l'admirer? Je vois que rien ne lui fait faute. On peut tout mépriser, on ne peut jamais tout avoir. Pour arriver aux richesses, le mépris des richesses est la voie la plus courte. Or comment vit notre Démétrius? Non en fier contempteur de tous les biens de la Fortune, mais en homme qui les abandonne aux autres. LETTRE LXIIINe point s'affliger sans mesure de la perte de ses amis.Tu es chagrin de la mort de Flaccus ton ami; mais je ne voudrais pas t'en voir affecté plus qu'il ne convient. Ne pas l'être du tout, j'aurais peine à te le demander, tout sûr que je suis que ce serait le mieux. Mais à qui cette fermeté d'âme serait elle donnée, sinon à l'homme qui s'est déjà mis fort au-dessus de la Fortune? Cet homme même éprouverait alors un commencement d'émotion, mais rien qu'un commencement. Pour nous, on peut nous excuser de nous laisser aller aux larmes, si elles ne coulent pas avec excès, et si nous-mêmes savons les arrêter. Nos yeux ne doivent ni demeurer secs à la perte d'un ami, ni s'épuiser de larmes ; il faut pleurer, mais non se fondre de douleur. Tu trouves dure la loi que je t'impose; et pourtant le prince des poètes grecs n'accorde le droit de pleurer que pour un seul jour ; et il a dit que Niobé même songea à prendre de la nourriture. Veux-tu savoir d'où viennent les lamentations, les pleurs immodérés? On veut afficher par là ses regrets : on ne cède pas à son affliction, on en fait parade. Ce n'est point pour ce qu'on souffre qu'on est triste. Déplorable folie! De la prétention jusque dans les larmes[81]! « Eh quoi! oublierai-je mon ami? » Il est bien court, le souvenir que tu lui promets, s'il ne dure pas plus que ta douleur. Ce front si rembruni va s'éclaircir au moindre sujet de rire qu'offrira le hasard : je ne te renvoie pas même à cette longueur de temps qui adoucit tous les regrets et calme les plus violents désespoirs. Dès que tu cesseras de t'observer, ce fantôme de tristesse s'évanouira. A présent tu choies ta douleur, tu la choies, et encore t'échappe-t-elle ; plus elle est vive, plus elle cesse vite. Appliquons-nous à trouver des charmes au souvenir de nos amis perdus ; car on n'aime pas à revenir sur une pensée constamment douloureuse. Toutefois si c'est pour l'homme une loi nécessaire qu'il ne puisse sans un serrement de cœur se rappeler ces noms chéris ; cette émotion non plus n'est pas sans jouissance. En effet, suivant le mot de notre Attalus, « le soutenir d'un ami qui n'est plus a pour nous cette douceur un peu âpre qui plaît dans certains fruits; comme en un vin trop vieux son amertume même nous flatte ; mais après quelque temps toute âpreté s'émousse, et le plaisir nous arrive sans mélange. » Si nous l'en croyons, « penser à nos amis vivants, c'est savourer le miel et les gâteaux les plus exquis ; se ressouvenir de ceux qui ont cessé d'être est une satisfaction quelque peu acerbe. Or on ne contestera pas que l'acidité aussi et toutes les saveurs d'un genre sévère stimulent l'estomac. Moi, je pense autrement : la mémoire de mes amis morts m'est douce et attrayante. Car je les ai possédés comme devant les perdre ; je les ai perdus comme les possédant encore. Prends donc, cher Lucilius, un parti qui convienne à tes sentiments d'équité : cesse de mésinterpréter le don que te fit la Fortune. Elle l'a repris, mais elle l'avait donné.[82] Jouissons pleinement de nos amis : qui sait pour combien de temps ils nous sont laissés? Songeons que de fois nous les quittâmes pour quelque lointain voyage ; combien, demeurant au même, lieu, nous fûmes souvent sans les voir ; nous reconnaîtrons que de leur vivant la privation a été plus longue. Mais comment souffrir ces hommes qui après avoir tant négligé leurs amis les pleurent si lamentablement, et ne vous aiment que s'ils vous ont perdu? Leur chagrin déborde avec d'autant plus d'effusion qu'ils ont peur qu'on ne mette en doute s'ils furent bons amis : c'est chercher tard à faire ses preuves. A-t-on d'autres amis? c'est mal mériter d'eux, c'est peu les estimer, comme incapables à eux tous de nous consoler d'une seule perte. N'en a-t-on point d'autres? on s'est fait soi-même plus de tort qu'on n'en a reçu de la Fortune. Elle ne nous a pris qu'un ami : nous n'avions pas su en faire un second. Et puis, dans son amitié unique, il n'a pas mis d'excès l'homme qui n'a pu en acquérir plus d'une. Celui qui, dépouillé par un vol de son seul vêtement, aimerait mieux déplorer son sort que d'aviser aux moyens de se parer du froid, de trouver à couvrir ses épaules, ne te semblerait-il pas un grand fou? L'être que tu aimais est dans la tombe : cherche un cœur à aimer. Mieux vaut réparer ta perte que de pleurer. Je vais ajouter une vérité bien rebattue, je le sais; néanmoins je ne veux pas l'omettre, quoique tout le monde l'ait dite. Le terme des douleurs que n'a point fait cesser la raison arrive avec le temps ; or pour l'homme sensé la plus honteuse manière de guérir c'est de guérir par lassitude. Mieux vaut renoncer à ton chagrin que d'attendre qu'il renonce à toi ; sèche donc au plus tôt des larmes qui, lors même que tu le voudrais, ne peuvent longtemps couler.[83] Nos pères ont limité à une année le deuil des femmes, non pour qu'elles pleurassent tout ce temps, mais pour qu'il ne fût point dépassé ; chez l'homme, aucun délai n'est légitime, parce qu'aucun ne lui fait honneur. Eh bien! de toutes ces inconsolables qu'on eut peine à retirer du bûcher, à séparer du cadavre de leurs époux, cite m'en une dont les larmes aient duré tout un mois. Rien ne rebute si vite que le spectacle de l'affliction : récente, elle trouve des consolateurs et s'attire quelques sympathies; invétérée, elle prête au ridicule et avec raison : c'est alors hypocrisie ou sottise. Voilà ce que j'ose t'écrire, moi qui ai pleuré si immodérément mon cher Annæus Sérénus qu'à mon grand déplaisir je suis un exemple de ceux que la douleur a vaincus. Mais je condamne aujourd'hui ce que j'ai fait alors, et je vois que la plus grande cause de ma vive affliction venait de n'avoir jamais pensé qu'il pouvait mourir avant moi. Je ne me représentais qu'une chose, que j'étais son aîné, et son aîné de beaucoup ; comme si le Destin suivait l'ordre des âges! Souvenons-nous donc à chaque instant que nous et tous ceux que nous aimons, sommes mortels. Je devais me dire : « Mon frère Sérénus est plus jeune que moi : mais que fait cela? Il devrait mourir après moi, comme il peut mourir avant, n Je n'y songeai point, je n'étais pas prêt ; et tout d'un coup la Fortune m'a frappé. Maintenant je me répète que tout est mortel, et que la mort n'a point de règle fixe. Dès aujourd'hui peut arriver ce qui peut arriver un jour quelconque. Pensons donc, cher Lucilius, que nous serons bientôt nous-mêmes où nous sommes si fâchés qu'il soit. Et peut-être, si, comme l'ont publié les sages, il est un lieu qui reçoive nos âmes, l'ami que nous croyons perdu n'a fait que nous devancer. LETTRE LXIV.Éloge du philosophe Q. Sextius. Respect dû aux anciens, instituteurs de l'humanité.Tu étais hier avec nous. Tu pourrais te plaindre si ce n'avait été qu'hier; aussi ajouté-je : avec nous; car avec moi, tu y es toujours. Il m'était survenu de ces amis pour lesquels on fait plus grande fumée, non pas celle que vomissent les cuisines de nos gourmands et qui donne l'alarme aux gardes de nuit; c'était cette fumée, modeste encore, qui révèle la venue de quelques hôtes. La conversation fut variée, comme est celle d'un repas, sans mener à fin aucun sujet, mais sautant d'une chose à une autre. On lut ensuite un ouvrage de Q. Sextius[84] le père, homme supérieur, si tu m'en crois, et, bien qu'il le nie, stoïcien. Bons Dieux! que de vigueur, que d'âme! On ne trouve pas cela chez tous les philosophes. Combien dont les écrits n'ont d'imposant que le titre et sont des corps vides de sang! Ils dogmatisent, ils disputent, ils chicanent : ils n'élèvent point l'âme, car ils n'en ont pas. Lis Sextius, et tu diras : « Voilà de la vie, du feu, de l'indépendance, voilà plus qu'un homme, il me laisse plein d'une foi sans bornes. » En quelque situation d'esprit que je sois, quand je le lis, je te l'avouerai, je défierais tous les hasards et je m'écrierais volontiers : « Que tardes-tu, ô Fortune? Viens sur l'arène! Tu me vois prêt. » Je sens en moi l'ardeur de cet Ascagne qui cherche où s'essayer, où faire preuve d'intrépidité, qui souhaiterait Qu'au lieu de faibles daims un sanglier sauvage, Un lion rugissant provoquât son courage.[85] Je voudrais avoir quelque chose à vaincre, de quoi m'exercer à la souffrance. Car Sextius a aussi ce mérite, qu'il vous montre la grandeur de la souveraine félicité, sans vous ôter l'espoir d'y atteindre. Il vous apprend qu'elle est placée haut, mais accessible à l'homme résolu. C'est le sentiment qu'inspire aussi la vertu : on l'admire, et pourtant on ne désespère point. Pour moi certes, je donne un temps considérable à la seule contemplation de la sagesse : je ne l'envisage pas avec moins d'étonnement que l'univers lui-même, qui me frappe souvent comme un spectacle nouveau pour mes yeux. Aussi je vénère les découvertes de la sagesse et leurs auteurs; je brille de les partager comme l'héritage d'une longue suite d'aïeux. C'est pour moi qu'ils l'amassèrent, pour moi qu'ils y mirent leurs sueurs. Mais agissons en bon père de famille : agrandissons l'héritage, et qu'il passe plus riche à nos neveux. Il reste encore, et il restera beaucoup à faire ; et pour qui naîtra mille siècles plus tard, la voie à de nouvelles conquêtes ne sera pas fermée. Mais lors même que nos devanciers auraient tout découvert, il y aura toujours, comme nouveauté, l'application, la science qui choisit et combine ce que les autres ont trouvé. Suppose qu'on nous ait laissé des recettes pour guérir les maux d'yeux; je n'ai plus à en chercher d'autres, mais à employer celles que je connais suivant le cas et la circonstance. Telle chose ramollit les tumeurs de l'œil ; telle autre diminue le gonflement des paupières ; ceci détourne le feu subit de la fluxion, cela rend la vue plus perçante. Il faut broyer ces drogues, choisir le moment, mesurer les doses pour chaque mal. Les remèdes de l'âme ont été trouvés par les anciens ; quand et comment les appliquer, c'est là notre tâche, notre étude à nous. Ils ont fait beaucoup, ceux qui nous ont précédés, mais ils n'ont pas tout fait : ils n'en méritent pas moins notre admiration et un culte analogue à celui des Dieux. Pourquoi n'aurais-je pas les portraits de ces grands hommes comme des encouragements à bien faire, et ne fêterais-je pas les jours où ils sont nés? Pourquoi ne prononcerais-je pas leurs noms avec un sentiment de vénération? Celle que je dois aux maîtres de mon enfance, je la porte à ces précepteurs du genre humain, par qui les sources du bien suprême ont découlé sur nous. Si je rencontre un consul ou un préteur, je leur rends tout l'honneur dû à d'honorables personnages, je descends de cheval, je me découvre la tête, je cède le passage ; et les deux Catons, et le sage Lelius et Socrate avec Platon, et Zénon et Cléanthe, je les recevrais dans mon âme sans offrir un digne hommage à tant de mérites! Non, je les salue de tous mes respects ; je me lève toujours devant ces grands noms. LETTRE LXV.Opinions de Platon, d'Aristote et des stoïciens sur la cause première.La maladie m'a pris une partie de la journée d'hier : toute la matinée a été pour elle, elle ne m'a laissé que l'après-midi. J'en profitai d'abord pour essayer de la lecture ; puis, mon esprit l'ayant pu soutenir, je me risquai à lui commander ou plutôt à lui permettre davantage. Je me mis à écrire, et même avec plus d'application qu'à l'ordinaire, en homme qui lutte avec un sujet difficile et qui ne veut pas être vaincu. Enfin il me vint des amis qui me firent violence et m'arrêtèrent tout court comme un malade intempérant. Je cessai d'écrire pour converser; et je vais t'exposer le sujet sur lequel nous sommes en litige. Nous t'avons constitué arbitre; tu as plus à faire que tu ne penses ; trois parties sont au procès. Nos stoïciens disent, comme tu sais, qu'il y a dans la nature deux choses, principes de tout ce qui se fait, la cause et la matière. La matière, gisante et inerte, se prête à tout, toujours au repos, si nul ne la met en mouvement. La cause, c'est-à-dire l'intelligence, façonne la matière et lui donne le tour qui lui plaît ; elle en tire des ouvrages de toute espèce. Il faut donc qu'il y ait et la substance dont se fait la chose et l'action qui la fait : celle-ci est la cause, l'autre est la matière. Tout art est une imitation de la nature ; et ce que je disais touchant l'œuvre de la nature doit s'appliquer aux œuvres de l'homme. Une statue a exigé une matière qui souffrît le travail de l'artiste, et un artiste qui donnât à cette matière une figure. Dans cette statue la matière était l'airain, la cause le statuaire. Toute autre chose est dans ces conditions : elle se compose de ce qui prend une forme et de ce qui la lui imprime. Les stoïciens veulent qu'il n'y ait qu'une cause, la cause efficiente. Suivant Aristote, la cause est de trois genres. La première, dit-il, est la matière même, sans laquelle rien ne peut se faire ; la seconde est l'ouvrier ; la troisième est la forme, qui s'impose à chaque ouvrage, comme à la statue, et qu'il appelle en effet eidos. Il en ajoute une quatrième : le but de l'œuvre entière. Eclaircissons ce dernier point. L'airain est la cause première d'une statue ; car jamais elle n'eût été faite, sans une matière » fusible ou ductile. La deuxième cause est l'artiste : cet airain ne pouvait devenir et figurer une statue, si des mains habiles ne s'y étaient employées. La troisième cause est la forme : cette statue ne s'appellerait pas le Doryphore ou la Diadumène,[86] si on ne lui en eût donné tous les traits. La quatrième cause est le but dans lequel on l'a faite, puisque sans ce but elle ne serait pas. Qu'est-ce que le but? Ce qui a invité l'artiste, ce qui lui a fait poursuivre son travail. Ce peut être l'argent, s'il l'a fabriquée pour la vendre ; la gloire, s'il a travaillé pour avoir un nom ; la piété, s'il voulait en faire don à un temple. C'est donc aussi une cause que la destination de l'œuvre. Et ne penses-tu pas qu'au nombre des causes d'exécution on doive mettre celle sans laquelle rien n'eût été fait? Platon en admet encore une cinquième : le modèle qu'il appelle Idée ; c'est ce qu'a devant les yeux l'artiste en faisant ce qu'il a l'intention de faire. Or il n'importe qu'il ait ce modèle hors de lui pour y reporter son regard, ou qu'il l'ait conçu et posé au dedans de lui-même. Ces exemplaires de toutes choses, Dieu les possède en soi ; les nombres et les modes de tous les objets à créer sont embrassés par la pensée divine : elle est pleine de ces figures que Platon nomme les idées immortelles, immutables, inépuisables. Ainsi par exemple, les hommes périssent:, mais l'humanité, par elle-même, d'après laquelle est formé l'homme, est permanente ; ceux-là ont beau souffrir et mourir, celle-ci n'en sent nul dommage. « Les causes sont donc au nombre de cinq, d'après Platon : la matière, l'ouvrier, la forme, le modèle, le but ; après quoi vient le produit de tout cela. Ainsi dans la statue, dont nous parlions en commençant, la matière, c'est l'airain ; l'ouvrier, c'est le statuaire ; la forme, ce sont les traits qu'on lui donne ; le modèle, c'est le type imité par l'art; le but est le motif de l'artiste; le résultat définitif, la statue. » « Le monde, ajoute Platon, est un effet des mêmes causes : il a Dieu pour créateur; pour matière, une masse inerte ; pour forme, cet ensemble et cet ordre que nous voyons; pour modèle, la pensée d'après laquelle Dieu a fait ce grand et magnifique ouvrage ; pour but, l'intention qui le lui a fait faire. » Et cette intention, quelle fut-elle? Toute de bonté. Ainsi du moins le dit Platon : « Pour quelle cause Dieu a-t-il créé le monde? Dieu est bon ; l'être bon n'est jamais avare du, bien qu'il peut faire ; il l'a conséquemment créé le meilleur possible. » Te voilà juge : porte ton arrêt et prononce lequel des deux systèmes te paraît le plus vraisemblable, je ne dis pas le plus vrai, car ces choses sont au-dessus de nous tout autant que la vérité elle-même? Ce grand nombre de causes, qu'Aristote et Platon établissent, comprend trop ou trop peu. Car si tout ce sans quoi rien ne peut se faire est à leurs y eux cause efficiente, ils ont dit trop peu. Qu'ils mettent au nombre des causes le temps : sans le temps rien ne peut se faire ; le lieu, on ne peut faire une chose sans qu'il y ait un lieu pour la faire ; le mouvement, sans lui rien ne se fait, rien n'est détruit ; sans mouvement, point d'art, point de transformation. Mais ici nous cherchons la cause première et générale : elle doit être simple, car la matière aussi est simple. Nous cherchons la vraie cause, c'est-à-dire la raison créatrice : car tout ce que vous avez énuméré ne constitue pas plusieurs causes distinctes, mais se rattache à une seule, à celle qui crée. La forme, dis-tu, est une cause! Non ; cette forme que l'ouvrier imprime à son ouvrage est une partie de cause, non une cause. Le modèle non plus n'en est pas une : c'est un moyen dont la cause a besoin. L'artiste a besoin de modèle comme de ciseau, de lime ; sans toutes ces choses l'art ne peut procéder, et pourtant ce ne s'ont ni parties de l'art, ni causes. Le but de l'artiste, dit-on, ce pour quoi il se met à l'œuvre, est une cause. Quand c'en serait une, elle ne serait pas efficiente, mais accessoire. Or celles-ci sont innombrables ; et nous cherchons la cause la plus générale. Mais la sagacité ordinaire de ces grands hommes leur a fait défaut lorsqu'ils ont dit que le monde entier, que toute œuvre achevée, est une cause : car il y a grande différence entre l'œuvre et la cause de l'œuvre. Porte donc ton arrêt, ou, ce qui est plus facile en de telles matières, dis que tu n'y vois pas assez clair, et ajourne-nous. « Tu vas demander quel plaisir je trouve à consumer le temps sur des abstractions qui ne guérissent aucune passion, qui ne chassent nul mauvais désir? » Mais je songe et travaille avant tout à ce qui fait la paix de l'âme ; je m'étudie d'abord, et ensuite l'univers. Et ce n'est pas là un temps perdu, comme tu l'imagines. Toutes ces questions, quand on ne les morcelé et ne les étire point en subtilités sans portée, élèvent en l'allégeant notre âme qui, sous le poids étouffant de la matière, aspire à déployer ses ailes et à revoir un ordre de choses dont elle a fait partie. Ce corps est en effet un fardeau pour l'âme et un supplice ; il la gêne, il l'opprime ; elle est dans les fers si la Philosophie ne lui vient en aide, et, lui ouvrant le spectacle de la nature, ne la pousse à quitter la terre pour respirer dans le ciel.[87] Ainsi elle est libre, ainsi elle voyage : elle se dérobe par intervalles; la prisonnière se refait là-haut de sa captivité. Comme après un travail délicat qui absorbait son attention et fatiguait sa vue, l'artiste, s'il habite une demeure sombre et mal éclairée, sort dans la rue et s'en va dans quelque lieu consacré au délassement public où ses yeux puissent jouir de la libre lumière; ainsi l'âme, enclose dans son obscur et triste logis, prend le large, toutes les fois qu'elle le peut, et se repose dans la contemplation des scènes de l'univers. Le sage et l'aspirant à la sagesse, quoique enchaînés à leurs corps, s'en détachent par la meilleure partie de leur être ; toutes leurs pensées tendent vers une sphère supérieure ; et pareils au mercenaire engagé par serment, la vie est pour eux une milice : ils ont habitué leur cœur à n'avoir pour elle ni affection ni haine, et se résignent à la condition mortelle, quoiqu'ils sachent que de plus amples destinées les attendent. M'interdiras-tu la contemplation de la nature? m'arracheras-tu à ce bel ensemble pour me réduire à un coin du tableau? Ne puis-je m'enquérir de quelle manière tout a pris commencement, qui a donné la forme aux choses, qui les a classées toutes en les dégageant de cette masse unique, de l'inerte matière qui les enveloppait? Quel fut l'architecte du monde où je suis? Quelle, intelligence a fixé des lois et un ordre à cette immensité, rassemblé ce qui était épars, séparé ce qui était confus, donné une face distincte à tout ce qui gisait dans l'informe chaos? D'où cet océan de clarté jaillit-il? Est-ce un feu ou quelque chose de plus lucide encore? Ne puis-je sonder ces merveilles? J'ignorerais d'où je suis descendu, si je ne verrai qu'une fois ce monde ou si je renaîtrai plusieurs fois ; où j'irai au sortir d'ici; quel séjour est réservé à l'âme affranchie des lois de l'humaine servitude! Me défendre tout commerce avec le ciel, c'est m'ordonner de vivre le front baissé. Je suis trop grand et destiné à de trop grandes choses pour me faire le valet de mon corps, qui n'est rien à mes yeux qu'un réseau jeté autour de mon indépendance. Je l'oppose aux coups de la Fortune pour qu'ils s'y arrêtent; je ne permets point qu'ils le traversent et qu'aucune blessure vienne jusqu'à moi. Tout ce qui en moi peut souffrir l'injure, c'est le corps : dans cette demeure assiégée habite une âme libre. Non, jamais cette chair ne saura me réduire à la peur, me réduire à la dissimulation,[88] indigne d'un cœur honnête : jamais je ne veux mentir en l'honneur d'un tel acolyte. Quand il me plaira, je romprai l'alliance qui nous associe, sans toutefois que, même à présent, les parts entre nous soient égales ; l'âme s'arrogera tous les droits. Le mépris du corps est le sûr gage de la liberté. Pour revenir à mon premier texte, l'étude dont nous parlions tout à l'heure contribue beaucoup à cette liberté. Tout en effet vient de la matière et de Dieu ; Dieu régit l'immensité qui l'environne et qui suit en lui son modérateur et son chef. Or l'être actif qui est Dieu est plus puissant et plus excellent que la matière passive sous sa main. La place que Dieu remplit en ce monde, l'esprit l'occupe dans l'homme : ce qu'est dans le monde la matière, le corps l'est en nous. Que la substance la moins noble obéisse donc à l'autre ; soyons fermes contre les accidents du sort; ne redoutons ni outrages, ni blessures, ni chaînes, ni indigence. La mort, qu'est-elle? une fin ou un passage. Je ne crains ni de finir : c'est la même chose que de n'avoir pas commencé ; ni de passer ailleurs : je· ne serai nulle part si à l'étroit qu'ici. LETTRE LXVI.Que tous les biens sont égaux et toutes les vertus égales.J'ai revu, après bien des années, Claranus mon condisciple, et tu n'attends pas, je pense, que j'ajoute qu'il a vieilli; mais, je t'assure, il est plein de verdeur au moral et vigoureux, et il lutte de son mieux contre l'affaissement du physique. Car la nature l'a iniquement traité; elle a mal logé une pareille âme, ou peut-être a-t-elle voulu nous montrer que le caractère le plus énergique et le plus heureux peut se cacher sous telle enveloppe que ce soit. Il a néanmoins vaincu tout obstacle, et du mépris de son corps il est venu à mépriser tout le reste. Le poète, selon moi, a eu tort de dire : Des grâces d'un beau corps la vertu s'embellit.[89] Elle n'a besoin d'aucun embellissement ; elle est à elle-même son plus grand relief, et consacre le corps qu'elle fait sien. Oui, j'ai bien considéré Claranus : il me semble beau et aussi droit de corps que d'esprit. Un homme de haute taille peut sortir de la plus petite cabane, comme une belle et grande âme d'un corps difforme et cassé. La nature produit de ces phénomènes, afin, je crois, de nous apprendre que la vertu peut naître partout. Si la nature pouvait d'elle-même enfanter des âmes nues, elle l'eût fait; mais elle a fait plus en en produisant quelques-unes qui, tout empêchées par le corps, se font jour néanmoins et rompent leurs entraves. Claranus me semble né comme exemple de cette vérité que la difformité physique n'enlaidit point l'âme, mais que la beauté de l'âme embellit le corps. Bien que nous ayons été fort peu de jours ensemble, nous avons eu de nombreux entretiens que je rédigerai successivement et que je te ferai parvenir. Le premier jour nous traitâmes cette question : « Comment les biens peuvent-ils être égaux, s'ils sont de trois classes? » Ceux qui, selon notre école, méritent le premier rang, sont, par exemple, la joie, la paix, le salut de la patrie. Comme biens de second ordre, fruits laborieux de tristes circonstances, il y a la patience dans les tourments, l'égalité d'âme dans la maladie. Nous souhaitons les premiers d'une manière immédiate ; les seconds, en cas de nécessité. Restent les biens de troisième ordre, comme une démarche modeste, un extérieur calme et honnête, la tenue d'un homme sage. Comment ces choses peuvent-elles être pareilles, quand il faut désirer les unes et craindre d'avoir besoin des autres? Pour expliquer ces distinctions, revenons au bien par excellence et considérons-le tel qu'il est. Une âme qui envisage le vrai, éclairée sur ce qu'elle doit fuir ou rechercher, assignant aux choses leur valeur non d'après, l'opinion, mais d'après leur nature, s'initiant dans tous les secrets et osant explorer toute la marche de la création, une âme qui veille sur ses pensées comme sur ses actes, dont la grandeur égale l'énergie, que ni menaces ni caresses ne sauraient vaincre, que l'une ou l'autre fortune ne maîtrise point, qui est supérieure aux heureuses et aux malheureuses chances, qui à la beauté unit la décence, à la vigueur la santé et la sobriété, imperturbable, intrépide, que nulle force ne brise, que les faits extérieurs n'enorgueillissent ni n'abattent point, une telle âme est proprement la vertu; telle en serait l'image, embrassée d'une seule vue, dévoilée une fois tout entière. Mais elle a mille faces qui se développent suivant les états et les fonctions diverses de la vie, sans qu'elle en devienne au fond ni moindre ni plus grande. Le souverain bien ne peut décroître ni la vertu rétrograder; mais elle se produit sous tel ou tel attribut, et prend la manière d'être qui convient à chacun de ses actes. Tout ce qu'elle a touché s'empreint de son image et de sa teinte ; les actions qu'elle inspire, les amitiés qu'elle noue, quelquefois des maisons entières, où l'harmonie rentre avec elle, s'embellissent de sa présence ; il n'est rien où elle s'emploie qu'elle ne rende digne d'amour, de respect, d'admiration. Sa force et sa grandeur ne sauraient donc monter plus haut, puisque l'extrême élévation ne comporte plus d'accroissement. Tu ne trouveras rien de plus droit que la rectitude, de plus vrai que la vérité, de plus tempérant que la tempérance. Toute vertu a la modération pour base ; la modération est la vraie mesure de tout. La constance n'a point à aller au delà d'elle-même, non plus que la confiance, la vérité, la loyauté. Que peut-on ajouter à la perfection? Rien; sinon il y avait imperfection là où l'on ajoutait. De même pour la vertu : si l'on pouvait y ajouter, elle serait incomplète. L'honnête non plus ne saurait croître en nulle façon : car c'est pour cela même dont je parle qu'il est l'honnête. Que dirons-nous de ce qui est beau, juste, légitime? Ne forme-t-il pas un même genre compris dans d'immuables limites? La faculté de croître est un signe d'imperfection ; et tout bien est soumis aux mêmes lois : l'intérêt privé se lie à l'intérêt public, tout de même certes qu'on ne peut séparer ce qui est louable de ce qui est à désirer. Ainsi les vertus sont égales, comme les œuvres qu'elles accomplissent, comme tous les hommes à qui elles se donnent. Quant aux plantes et aux animaux, leurs vertus, toutes mortelles, sont dès lors fragiles, caduques et incertaines; elles ont des saillies, puis s'affaissent ; aussi ne les estime-t-on pas le même prix. La règle qui s'applique aux vertus humaines est une ; car la droite raison est une et simple. Rien n'est plus divin que le divin, plus céleste gué le céleste. Les choses mortelles s'amoindrissent, tombent, se dégradent : on les voit grandir, s'épuiser, se remplir. La conséquence pour elles d'une condition si peu fixe est l'inégalité ; les choses divines ont une nature constante. Or la raison n'est autre chose qu'une parcelle du souffle divin immergée dans le corps de l'homme. Si la raison est divine, et qu'il n'y ait nul bien sans elle, tout bien est chose divine; or, entre choses divines point de différence, ni par conséquent entre les biens. Ce sont donc choses égales que le contentement, et que la ferme persévérance dans les tortures : car dans les deux cas la grandeur d'âme est la même ; dans l'un seulement elle se dilate et s'épanouit, dans l'autre elle lutte, elle tend tous ses ressorts. Eh quoi! N'y a-t-il pas un égal courage à forcer intrépidement les remparts ennemis et à soutenir un siège avec une constance à l'épreuve? Scipion est grand quand il bloque et réduit Numance aux abois, quand il contraint des bandes invincibles à s'égorger de, leurs propres mains ; mais grand aussi est le cœur de ces assiégés qui savent que rien n'est fermé pour l'homme à qui le trépas est ouvert et qui expire dans les bras de la liberté. Telle est la parité de tous les autres biens de l'âme, tranquillité, franchise, libéralité, constance, résignation, puissance de souffrir; car tous ont un même fondement, la vertu, qui maintient l'âme en équilibre et invariable. « Comment donc? Point de différence entre le contentement et cette constance que ne font point fléchir les douleurs? » Aucune, quant au fond même des vertus ; beaucoup, quant aux situations où chaque vertu se déploie : car ici l'âme est dans une aisance et un abandon naturels ; là, c'est une crise contre nature. J'appellerai donc indifférentes les situations qui peuvent recevoir beaucoup de plus et de moins; mais dans chacune les vertus sont égales. Elles ne changent pas avec la circonstance ; que celle-ci soit dure et difficile ou heureuse et riante, elles n'en deviennent ni pires ni meilleures ; nécessairement donc ce sont des biens égaux entre eux. De deux sages, l'un ne se comportera pas mieux dans sa joie que l'autre dans ses tortures : or deux choses qui n'admettent plus d'amélioration sont égales. Car s'il y a quelque chose au delà de la vertu ou qui puisse l'amoindrir ou l'accroître, l'honnête cesse d'être l'unique bien. La concession d'un tel fait est l'entière destruction de l'honnête. Pourquoi? C'est que rien n'est honnête de ce qui se fait à contrecœur et avec répugnance. Tout acte honnête est volontaire : apportez-y de la paresse, des murmures, de l'hésitation, de la crainte, il perd son grand mérite, le contentement de soi. L'honnête ne peut être où n'est pas la liberté ; et qui craint est esclave. L'honnête a toujours avec lui la sécurité, le calme ; si quelque chose le fait reculer, ou gémir, ou lui semble un mal, le voilà tout en proie au trouble, aux plus grands discorde, aux fluctuations. L'apparence du bien l'attirait, le soupçon du mal le repousse. Quand donc nous devrons bien faire, quels que soient les obstacles, voyons-y plutôt des désagréments que des maux, sachons vouloir et agir de grand cœur. Tout acte honnête s'opère sans injonction ni contrainte ; il est pur, et rien de mauvais ne s'y mêle. Je sais ce qu'on peut ici me répondre : vous voulez, dira-t-on, nous persuader qu'il n'y a nulle différence entre nager dans la joie et lasser le bourreau qui nous torture sur le chevalet. Je pourrais répliquer qu'au dire d'Epicure lui-même, le sage, dans le taureau brûlant de Phalaris, s'écrierait : « Je jouis encore, et la douleur ne m'atteint pas. » On s'étonne que je dise qu'il est égal d'être couché sur le lit de festin ou de garder dans les tortures une intrépide attitude, lorsque Epicure, chose plus incroyable, soutient qu'il est doux de rôtir dans les flammes[90]! Je réponds qu'il existe une grande différence entre la joie et la douleur. S'il s'agit d'opter, je prendrai l'une et j'éviterai l'autre : l'une étant conforme à la nature, et l'autre, contraire. A les considérer ainsi, un grand intervalle les sépare ; mais si l'on tient compte des vertus, toutes deux sont égales, et celle qui marche sur des fleurs et celle qui foule des épines. La souffrance, les traverses, les disgrâces quelconques sont de nulle importance; la vertu neutralise tout cela. De même que la clarté du soleil éclipse les astres de moindre grandeur; ainsi douleurs, contrariétés, injures, tout s'efface, tout est absorbé dans la grandeur de la vertu : n'importe où elle brille, tout ce qui ne tient pas d'elle son éclat reste dans l'ombre ; les désagréments de la vie ne lui font pas plus, quand ils pleuvent sur elle, qu'une faible ondée sur l'Océan. Pour reconnaître que je dis vrai, vois l'homme vertueux, à quelque épreuve que l'honneur l'appelle, y courir sans délai. Que devant lui soit le bourreau, le tortionnaire et le bûcher, il restera ferme ; ce n'est point le supplice, c'est le devoir qu'il envisage : il a foi dans sa noble mission comme il aurait foi dans un cœur honnête, il la juge utile, sûre, propice à ses intérêts. Un acte honorable est vu par lui du même œil que l'honnête homme pauvre, exilé, pâli par la souffrance. Oui, suppose deux sages dont l'un est comblé de richesses, dont l'autre, qui n'a rien, possède tout en lui-même, tous deux seront également sages, malgré la disparité de fortune. Il faut, ai-je dit, porter sur les choses le même jugement que sur les hommes ; la vertu est aussi louable dans un corps valide et libre d'entraves que dans un corps malade et garrotté. Donc tu ne t'applaudiras pas plus de la tienne, si le sort préserve ta personne des outrages, que s'il te mutile en quelque endroit : autrement ce serait juger le maître sur l'extérieur des esclaves. Car toutes ces choses sur lesquelles le sort exerce sa domination sont esclaves, l'argent, le corps, les honneurs, tous fragiles, caducs, périssables, et d'une possession incertaine. Il n'est en revanche de libre et d'indestructible que les œuvres de la vertu, qui ne sont pas plus désirables quand la Fortune les voit avec bienveillance que lorsqu'elle les frappe de son injustice. Le désir est à l'égard des choses ce qu'est l'affection envers les hommes. Tu n'affectionnerais pas plus, je pense, l'honnête homme riche que pauvre ; robuste et musculeux, que grêle et de constitution débile ; donc aussi tu ne souhaiteras pas plus une situation gaie et paisible qu'une soucieuse et difficile.[91] Sinon, de deux personnages également vertueux tu préféreras celui qui serait brillant et parfumé à celui qui serait poudreux et négligé ; puis tu en viendras à aimer mieux le sage s'il jouit de tous ses membres parfaitement sains que s'il est infirme et s'il louche. Peu à peu tes dédains croîtront, et de deux hommes également justes et éclairés tu choisiras l'un pour ses longs cheveux bien bouclés plutôt que l'autre dont le front serait un peu chauve. Quand des deux côtés la vertu est égale, les autres inégalités disparaissent ; car elles ne font point partie de l'homme, elles sont accessoires. Est-il un père assez injuste appréciateur de ses enfants pour aimer mieux le fils bien portant, de taille svelte et élevée, que son frère de courte ou de moyenne stature? Les animaux ne font point de distinction entre leurs petits : ils se prêtent à les allaiter tous indifféremment : les oiseaux partagent également la pâture à leur couvée. Ulysse est aussi pressé de revoir les rochers de sa pauvre Ithaque[92] qu'Agamemnon les nobles murs de Mycènes. Nul n'aime son pays parce qu'il est grand, mais parce qu'il est son pays. « Où tend ce discours? » diras-tu. A prouver que la vertu voit chacune de ses œuvres du même œil qu'un père ses enfants, qu'elle les aime également toutes et n'a de prédilection que pour celles qui souffrent : car l'amour des parents, quand il s'y joint de la pitié, est bien plus dévoué. De même la vertu, sans préférer celles de ses œuvres qui périclitent et sont en détresse, les entoure, à l'exemple des bons parents, de plus de soins et de complaisances. « Mais pourquoi telle vertu n'est-elle pas supérieure à telle autre? » Par la raison que rien n'est plus convenable que ce qui convient, que rien n'est plus uni que l'uni. Tu ne peux dire : telle vertu est plus que telle autre l'égale d'une troisième ; conséquemment aussi rien n'est plus honnête que l'honnête. Que si toutes les vertus ont la même nature, les trois genres de bien sont égaux. Oui, ce sont choses égales que se modérer dans la joie et se modérer dans la douleur ; la sérénité de l'une ne l'emporte pas sur cette fermeté de l'autre qui au sein des tortures dévore ses gémissements. L'une est désirable, il faut admirer l'autre, toutes deux n'en sont pas moins égales, parce que tous les désagréments possibles sont étouffés par une vertu plus grande qu'eux. Les juger inégaux c'est détourner ses yeux du fond des choses pour s'arrêter à la surface. Les vrais biens ont tous même poids, même volume ; les faux biens sont gonflés de vide. Que de choses ont de l'éclat et de la grandeur vues de face, qui mises dans la balance sont tout autres! Oui, cher Lucilius, tout ce qui tire son mérite de la saine raison est substantiel, impérissable; il raffermit l'âme, il la porte à une hauteur d'où elle ne descend plus. Mais ce qu'on vante sans réflexion, ce qui au jugement du vulgaire s'appelle biens enfle le cœur de vaines joies. D'autre part, ces maux prétendus que l'on appréhende jettent l'épouvante dans les esprits et y produisent la même agitation que chez les animaux l'apparence du danger. C'est donc sans motif que dans ces deux cas l'âme s'épanouit ou se froisse : il n'y a pas plus à se réjouir dans l'un qu'à s'effrayer dans l'autre. La raison seule ne change point, ne se départ point de son opinion ; car elle n'obéit point aux sens, elle leur commande. La raison est égale à la raison, comme la droiture à la droiture : donc la vertu n'est pas inférieure à la vertu : car elle n'est autre chose que la droite raison. Chaque vertu est une raison, et dès lors elle est droite; par conséquent l'une égale l'autre. Telle qu'est la raison, telles sont ses œuvres, toutes logiquement égales : semblables à leur mère, elles doivent se ressembler entre elles. Je dis qu'entre elles ces œuvres sont égales, parce qu'elles sont droites et honnêtes. Du reste elles différeront beaucoup, selon la diversité de la matière, qui tantôt est plus ample, tantôt plus restreinte ; tantôt illustre, tantôt sans éclat; qui concerne ici une foule d'hommes, là-bas un petit nombre; dans tous les cas néanmoins l'excellence de· l'acte est la même : c'est toujours l'honnête. Ainsi les hommes vertueux le sont tous au même point, en tant que vertueux ; mais il y a des différences d'âge : l'un est plus vieux, l'autre est plus jeune ; des différences physiques : l'un est beau, l'autre laid; des différences de fortune : l'un est riche, l'autre pauvre ; l'un a du crédit, du pouvoir, il est connu des villes et des peuples ; l'autre est obscur et le monde ne le connaît pas. Mais, par cela qu’ils sont vertueux, ils sont égaux. Les sens ne sont point juges des biens ni des maux : l'utile, le nuisible, ils l'ignorent. Ils ne peuvent prononcer qu'en face des objets, sans prévoyance de l'avenir, sans mémoire du passé, ils ne savent point les conséquences des choses. Or c'est de tout cela que se forme la trame et la série des événements et l'unité d'une vie régulière dans sa marche. C'est donc la raison qui est l'arbitre des biens et des maux, qui tient pour vil l'extérieur et tout ce qui n'est pas elle, et qui regarde les accidents qui ne sont ni biens ni maux comme de minimes et très légers accessoires : tout bien pour elle réside dans l'âme. Seulement il est des biens auxquels elle donne le premier rang et qu'elle aspire à obtenir, comme la victoire, de dignes enfants, le salut de la patrie ; puis des biens de second ordre qui ne se manifestent que dans les circonstances critiques, comme la résignation dans une maladie grave ou l'exil ; il y a des biens intermédiaires qui ne sont absolument ni conformes ni contraires à la nature, comme de marcher posément ou d'être décemment assis. Car il n'est pas moins selon la nature d'être assis que debout ou que de marcher. Les deux premières classes de biens sont de genre opposé ; vu qu'il est selon la nature de jouir de la tendresse de ses enfants, du bien-être de sa patrie, et qu'il est contre la nature de résister avec courage aux tourments et d'endurer la soif quand la fièvre brûle nos entrailles. « Eh quoi! y aurait-il des biens contre nature? » Non sans doute : mais il est des situations contre nature où ces biens-là se rencontrent; car être criblé de blessures, et fondre dans les flammes d'un bûcher et se voir terrassé par la maladie, tout cela est contre nature ; mais conserver en cet état une âme indomptable, voilà ce que la nature avoue. Et pour résumer brièvement ma pensée, l'élément du bien est quelquefois contre nature, le bien ne l'est jamais, parce qu'il n'est aucun bien sans la raison et que la raison suit la nature. Qu'est-ce en effet que la raison? L'imitation de la nature. Et le souverain bien? Une conduite conforme au vœu de la nature. « Il n'est pas douteux, dira-t-on, qu'on ne doive préférer une paix que nul ennemi ne trouble à une paix reconquise par des flots de sang, une santé jamais altérée à celle qui n'est revenue de graves maladies et des portes du trépas que de haute lutte, pour ainsi dire, et à grand renfort de patience. Sans doute aussi ce sera un plus grand bien de se réjouir que d'avoir à roidir son âme pour supporter les déchirements du fer ou de la flamme. » Point du tout. Car les choses fortuites seules comportent de grandes différences et s'apprécient par l’utilité qu'en tirent ceux qui les reçoivent. Le principe des vrais biens est de se conformer à la nature, condition que tous remplissent également. Quand le sénat suit l'opinion d'un de ses membres, on ne peut dire: « Celui-ci adhère plus pleinement que celui-là ; » tous se réunissent dans le même avis. Ainsi des vertus : toutes adhèrent aux vues de la nature ; ainsi des biens : tous sont conformes à cette même nature. Tel sera mort adolescent, tel autre, vieux; tel autre, encore en bas âge, aura pour toute grâce entrevu la vie ; tous ont été mortels au même degré, bien que le sort ait laissé le vieillard prolonger sa carrière, qu'il ait moissonné le jeune homme en pleine fleur, et arrêté l'enfant dès ses premiers pas. On voit des gens que la vie abandonne au milieu d'un repas, ou chez qui la mort est la continuation du sommeil, ou qui s'éteignent dans les embrassements d'une maîtresse. Mettez en regard ceux qui ont péri par le fer ou par la morsure d'un serpent, ou écrasés par une chute d'édifice, ou que de longues contractions de nerfs ont torturés en détail, on peut dire que les uns ont fini mieux, les autres plus mal ; mais c'a toujours été la mort. Elle vient par des chemins divers qui tous aboutissent au même terme. Jamais de plus ou de moins en elle; elle a pour tous sa commune règle : mettre fin à la vie. J'en dis autant des biens : l'un habite au milieu de plaisirs sans mélange, l'autre dans la détresse et l'amertume ; celui-ci modère la prospérité, celui-là dompte les rigueurs du sort ; tous deux sont biens au même titre, quoique le premier ait foulé une terre aplanie, et le second, d'âpres sentiers. Ils se réduisent à une même fin : ils sont bons, ils sont louables, ils ont la vertu et la raison pour compagnes ; la vertu égalise tout ce qu'elle avoue comme sien. Mais n'admire pas cette doctrine comme purement stoïcienne. Chez Epicure il y a deux sortes de biens, dont se compose la suprême béatitude : l'absence de douleur pour le corps et de trouble pour l'âme. Ces biens ne s'accroissent plus, dès qu'ils sont complets ; d'où viendrait l'accroissement où il y a plénitude? Que le corps soit exempt de douleur, qu'ajoutera-t-on à cet état négatif? De même qu'un ciel serein n'est pas susceptible d'une clarté plus vive, dès qu'il est pur de tout nuage et entièrement net, ainsi l'homme qui veille sur son corps et sur son âme, qui ourdit au moyen de l'un et de l'autre sa félicité, se trouve dans un état parfait et au comble de ses désirs, quand ni son âme n'est en proie aux orages ni son corps à la souffrance. Si quelques douceurs de plus lui viennent du dehors, elles n'ajoutent rien au souverain bien, mais, pour ainsi dire, elles l'assaisonnent, elles l'égayent ; car le bonheur absolu de la nature humaine se contente de la paix de l'âme et du corps. Je vais encore te montrer chez Epicure une autre division des biens, toute semblable à la nôtre. Ainsi il est des choses qu'il souhaiterait de préférence, comme le repos du corps libre de toute malaise, et la quiétude d'une âme heureuse par la conscience de ses vertus ; il en est d'autres dont il voudrait que l'occasion ne vint pas et que néanmoins il loue et approuve fort, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, une patience à l'épreuve de la mauvaise santé et des plus vives douleurs, patience qui fut la sienne dans le dernier et le plus heureux jour de sa vie. Il disait en effet : « Ma vessie et mon ventre ulcéré me torturent si fort qu'il n'y a point d'accroissement possible à ma souffrance ; et néanmoins c'est pour moi un heureux jour. » Or être heureux ainsi n'appartient qu'à l'homme en possession du souverain bien. Tu vois donc chez Epicure même ces biens dont tu aimerais mieux ne pas faire l'épreuve, et que pourtant, puisque ainsi le sort l'a voulu, il faut embrasser avec amour et louer à l'égal des plus grands biens. Il en est l'égal, peut-on le nier? ce bien qui couronne une heureuse carrière, et pour lequel les dernières paroles d'Epicure sont des actions de grâce. Permets-moi, vertueux Lucilius, une assertion plus hardie encore : si jamais biens pouvaient être plus granas que d'autres, selon moi ceux dont l'apparence rebute auraient ce privilège sur ceux qui ont pour éléments la mollesse et la sensualité. Il est plus grand de rompre les difficultés que de modérer ses joies. C'est par un même principe, je le sais, qu'on supporte la bonne fortune avec sagesse et la mauvaise avec fermeté. Celui-là peut être aussi brave qui veille en sécurité aux portes du camp dont nul ennemi ne menace les lignes, que celui qui, les jarrets coupés, combat sur ses genoux et ne rend point ses armes. Honneur au courage! est le mot qu'on adresse à ceux qui reviennent sanglants des batailles. Je louerais donc de préférence ces vertus d'épreuve et de dévouement qui ont su lutter contre la Fortune. Je n'hésite pas à le dire : la main mutilée de Mucius dont les chairs se tordent dans la flamme est plus glorieuse que celle du plus brave, demeurée sans blessure. Fier contempteur de cette flamme et de l'ennemi, Mucius regarda sa main se fondre lentement sur le brasier, tant qu'enfin Porsenna, heureux de son supplice, mais jaloux de sa gloire, le fit arracher de force du réchaud brûlant. Et cette vertu, je ne la placerais pas au premier rang? Je ne la préférerais pas à un bonheur tranquille et respecté de la Fortune, d'autant qu'il est plus rare de vaincre un ennemi par le sacrifice de sa main que par le fer dont elle est armée? Mais, vas-tu me dire, souhaiterais-tu ce bonheur pour toi? » Pourquoi non? qui n'ose le souhaiter, n'oserait s'en rendre digne.[93] Dois-je plutôt désirer que de jeunes esclaves viennent masser les parties les plus chatouilleuses de mon corps, qu'une courtisane, ou un adolescent transformé en courtisane, me déroidisse artistement les doigts? Heureux Mucius, qui livra sans peur sa main aux charbons, plus heureux que s'il l'eût offerte à un massage voluptueux! Il répara pleinement sa méprise : sans arme et sans main il mit fin à la guerre, et ce bras manchot fut vainqueur de deux rois. LETTRE LXVII.Que tout ce qui est bien est désirable. — Patience dans les tourments.Pour commencer par un propos banal, je te dirai que le printemps vient de s'ouvrir; mais en s'approchant de l'été, lorsqu'il nous défait de la chaleur, il s'est refroidi, et l'on ne s'y fie point encore ; car souvent il nous rejette dans l'hiver. Veux-tu savoir combien jusqu'ici il a été peu sûr? Je n'affronte pas encore l'eau toute froide : mais j'en tempère la crudité. « C'est, diras-tu, ne supporter ni chaud ni froid. » Cela est vrai, cher Lucilius : j'ai déjà bien assez des glaces de l'âge, moi qui au fort de l'été me sens à peine dégourdi, et qui en passe la plus grande partie sous mes couvertures. Je rends grâce à la vieillesse de m'avoir cloué dans mon lit. Et pourquoi ne la remercierais-je pas à ce titre? Tout ce que je ne devais pas vouloir, j'ai cessé de le pouvoir. C'est avec mes livres que j'aime le plus à m'entretenir. Si parfois il me survient de tes lettres, je m'imagine être avec toi ; et l'illusion est telle qu'il me semble non que je t'écris, mais que ma voix répond à la tienne. Cherchons donc aussi ensemble, comme dans un entretien réel, la réponse à la question que tu me fais. Toute espèce de bien est-elle désirable? « Si c'est un bien, dis-tu, de subir la torture avec courage, d'être héros sur le bûcher, et patient dans la maladie, il s'ensuit que toutes ces souffrances sont désirables ; or je ne vois rien là qui soit digne de souhait. Jusqu'ici assurément je ne sache pas qu'on se soit acquitté d'un vœu pour avoir été battu de verges, torturé par la goutte, ou allongé par le chevalet. » Fais ici une distinction, Lucilius, et tu verras dans tout cela quelque chose de désirable. Je serais bien aise d'échapper aux tourments; mais s'il faut les subir, mon vœu sera de m'y comporter intrépidement, en homme d'honneur et de courage. Je dois sans doute vouloir que la guerre n'arrive point; mais, si elle arrive, mon vœu sera de supporter noblement les blessures, la faim, toutes les nécessités qu'apporte la guerre. Je ne suis pas assez fou pour souhaiter d'être malade ; mais, si je dois l'être, mon vœu sera de ne faire acte ni d'impatience ni de faiblesse. Ainsi ce qui est désirable, ce n'est point le mal, mais bien la vertu qui l'endure. Quelques-uns de nos stoïciens estiment que la fermeté dans les tourments n'est pas à désirer ni à repousser non plus, parce que l'objet de nos vœux doit être un bonheur sans mélange et sans trouble et inaccessible aux contrariétés. Tel n'est point mon avis, et pourquoi? D'abord il ne peut se faire qu'une chose soit vraiment bonne et ne soit pas désirable ; ensuite, si la vertu est à désirer, et qu'il n'y ait nul bien sans elle, tout bien est, comme elle, désirable. Et puis, quand même la fermeté dans les tourments ne serait pas chose désirable, je demanderai encore si le courage ne l'est pas? Car enfin le courage méprise et défie les dangers ; son plus beau rôle, son œuvre la plus admirable est de ne pas fuir devant la flamme, d'aller au-devant des blessures et, au besoin, loin d'esquiver le coup mortel, de le recevoir à poitrine ouverte. Si le courage est désirable, la fermeté dans les tourments l'est aussi : c'est en effet une partie du courage. Distingue bien tout cela, je le répète, et rien ne fera plus équivoque pour toi. Ce qu'on doit désirer, ce n'est pas de souffrir, mais de souffrir courageusement. Voilà ce que je souhaite : le courage ; car voilà la vertu. « Mais qui formera jamais un pareil souhait? » Il y a des vœux clairs et déterminés, ceux qui se font pour une chose spéciale ; il y en a d'implicites, quand un seul en embrasse plusieurs. Par exemple, je souhaite une vie honorable : cette vie honorable se compose d'actes variés ; elle comprend le tonneau de Régulus, la blessure qu'élargit Caton de sa propre main, l'exil de Rutilius, la coupe empoisonnée qui fit monter Socrate du cachot dans les cieux. Ainsi, en souhaitant une vie honorable, j'ai du même coup souhaité les épreuves sans lesquelles parfois elle est impossible. ……………………..O trois et quatre fois heureux, Vous tous qui, pour sauver les hauts remparts de Troie, Sous les yeux paternels mourûtes avec joie[94]! Souhaiter à quelqu'un un pareil sort n'est-ce pas avouer qu'il fut désirable? Décius se dévoue pour la République; et poussant son cheval, il court chercher la mort au milieu des ennemis. Son fils, après lui, émule du courage paternel, répète les solennelles paroles qui sont déjà pour lui un souvenir de famille, et s'élance au plus épais de la mêlée sans nul souci que de sauver Rome par sa mort du courroux céleste, et convaincu qu'un si beau trépas est digne de son ambition. Doutes-tu donc que ce ne soit une grande félicité de faire une fin mémorable, marquée par quelque œuvre généreuse? Dès qu'un homme souffre les tourments avec courage, il fait usage de toutes les vertus. Une seule peut-être est en évidence et frappe le plus les yeux : la patience : mais là est aussi le courage, dont la patience, la puissance de souffrir et la résignation ne sont que des rameaux : là est la prudence, sans laquelle il n'est point de conseil et qui détermine à supporter l'inévitable avec le plus de fermeté possible : là est la constance, que rien ne peut chasser de son poste, qu'aucune violence n'écarte et ne fait départir de ses résolutions : là se trouve réuni l'indivisible cortège des vertus. Tout acte honorable est le fait d'une seule vertu, mais sous l'inspiration commune des autres; or ce qu'approuvent toutes les vertus, bien qu'une seule semble l'exécuter, est chose désirable. Eh quoi! ne verrais-tu de désirable que ce qui vient par les voies de la mollesse et de la volupté, que ce que l'homme salue par de joyeux festons à sa porte? Il est des voluptés amères, il est des vœux héroïques que fêtent non point une foule banale de complimenteurs, mais l'hommage d'une vénération religieuse. Ne penses-tu point, par exemple, que Régulus souhaita de retourner à Carthage? Entre par là pensée dans cette âme si haute ; sépare-toi un moment du vulgaire et de ses préjugés ; vois, aussi grande que tu dois la voir, l'image de cette vertu si belle et si magnifique qui veut, au lieu d'encens et de guirlandes, les sueurs, le sang de ses fidèles. Considère M. Caton portant ses mains si pures sur ses entrailles sacrées et déchirant, élargissant ses plaies, iras-tu donc lui dire : « Que n'es-tu plus heureux? Je le voudrais comme toi, je souffre de ton supplice ; » plutôt que : « Je te félicite de ce que tu fais. » Ceci me rappelle notre Démétrius qui compare une vie toute tranquille et sans nulle agression de la Fortune à une mer morte. Ne rien avoir qui te réveille, qui te mette au défi, dont l'annonce ou le choc subit te force d'éprouver la fermeté de ton âme, mais croupir dans un repos exempt de toute secousse, ce n'est point tranquillité, c'est bonace. Attalus le stoïcien disait souvent : « J'aime mieux que la Fortune me tienne dans ses camps qu'à sa cour.[95] Je subis la torture mais avec courage, tout va bien; je péris, mais avec courage, tout va bien. » Entends Epicure te dire : « Cela même est doux. » Pour moi, je n'appliquerai jamais l'épithète de molle à une doctrine si honnête et si austère. La flamme me dévore sans me vaincre. Et il ne serait pas désirable, je ne dis point qu'elle me dévore, mais qu'elle ne me vainque pas! Rien de plus noble, de plus beau que la vertu : tout est bon, tout est désirable dans ce qui s'opère par son commandement. LETTRE LXVIII.La retraite : n'en point faire vanité.J'approuve ta résolution : cache-toi au sein du repos, et cache même ton repos.[96] Si tu ne le fais d'après les maximes des stoïciens, tu suivras pourtant leurs exemples, sache-le bien ; mais tu le feras aussi d'après leurs maximes, et pour peu que tu le veuilles, tu les trouveras raisonnables. Nous ne poussons point le sage à prendre part à tout gouvernement, ni en toute occurrence, ni sans relâche ; d'ailleurs, en lui donnant une République digne de lui, c'est-à-dire le monde, nous ne le plaçons pas en dehors de l'autre, lors même qu'il s'en est retiré. Peut-être même il n'abandonne un coin de terre obscur que pour passer sur un plus vaste et plus noble théâtre ; peut-être, du ciel où il est assis, reconnaît-il qu'une chaise curule ou un tribunal ici-bas étaient pour lui de bien humbles sièges. Je te confie ici ma pensée : jamais le sage n'est moins inoccupé que quand les choses divines et humaines se dévoilent à ses yeux. Revenons au conseil que je te donnais : que ton repos soit ignoré. Garde-toi d'afficher la philosophie et la retraite ; couvre d'autres prétextes ta détermination ; dis que c'est faiblesse de santé, de tempérament, que c'est paresse. Mettre sa gloire à ne rien faire est une lâche ambition. Certains animaux, pour qu'on ne puisse les découvrir, brouillent leurs voies à l'entour de leur gîte ; il te faut faire de même, ou il ne manquera pas de gens pour te relancer. Habituellement on dédaigne les endroits découverts, on fouille ce qui est mystère et obscurité : les choses scellées tentent le voleur. Il ne fait point cas de ce qu'on n'enferme point; devant une maison ouverte il passe outre.[97] Telle est la pente du vulgaire, de l'ignorance, avide de pénétrer tous les secrets. Le mieux est donc de ne pas faire sonner trop haut sa retraite, or c'est le faire en quelque sorte que de se trop celer, de s'exiler trop loin de la vue des hommes. L'un s'est confiné à Tarente ; l'autre s'est enterré à Naples ; celui-ci depuis longues années n'a point passé le seuil de sa porte. C'est convoquer la foule autour de sa retraite que d'en faire le texte d'une histoire quelconque. Une fois dans la solitude, il ne faut point tâcher que[98] le monde s'entretienne de toi; il faut t'entretenir avec ta conscience. Et de quoi? De ce qu'on répète si volontiers sur le compte des autres, du mal que tu dois penser de toi-même ; tu en prendras l'habitude et de dire la vérité et de l'entendre. Mais soigne surtout la partie que tu sentiras en toi la plus faible. Chacun connaît ses infirmités corporelles; ainsi tel soulage son estomac par le vomissement, tel autre le soutient par une fréquente nourriture ; un troisième coupe son régime par la diète qui débarrasse et purge son corps. Ceux qui sont sujets à la goutte s'abstiennent soit de vin soit de bains : insouciants sur tout le reste, ils ne songent qu'au mal qui les attaque habituellement. Notre âme aussi a des parties malades auxquelles doivent s'appliquer nos soins. Que fais-je dans ma retraite? Je panse mon ulcère. Si je te montrais un pied gonflé, une main livide, ou une jambe raccourcie par le dessèchement des nerfs, tu me permettrais de rester en place et de tout mettre en œuvre pour me guérir : j'ai un mal plus grand que tout cela, mais je ne puis te le montrer. C'est dans mon âme qu'est le gonflement, la masse d'humeurs, l'abcès impur. Ne va pas me louer, ne va pas dire : « Ο le grand homme! Il a tout dédaigné, il a condamné les folies de la vie humaine, il a tout fui. » Je n'ai rien condamné que moi. Ce n'est pas à moi qu'il faut vouloir venir pour profiter à mon exemple. Tu te trompes, si tu comptes tirer d'ici quelque secours : ce n'est pas un médecin, c'est un malade qui y demeure. J'aime mieux qu'en me quittant tu dises : « Je croyais cet homme riche de bonheur et de science, j'avais soif de l'entendre ; je suis déchu de mon espoir, je n'ai rien vu, rien entendu qui piquât ma curiosité, qui m'invitât à revenir.» Si tel est ton sentiment, ton langage, tu auras gagné à me voir. J'aime mieux que ma retraite excite ta compassion que ton envie. « La retraite! diras-tu ; toi, Sénèque, tu me la conseilles! Tu te laisses aller aux phrases d'Épicure! » Oui, je te prêche le repos ; mais un repos où tu fasses de plus grandes et de plus belles choses que celles que tu quitteras. Frapper aux portes orgueilleuses des grands, tenir registre des vieillards sans héritiers, avoir grand crédit sur la place, sont des avantages en butte à l'envie, éphémères, et, à vrai dire, ignobles. Tel l'emporte beaucoup sur moi par son influence sur les juges, tel autre par son temps de service militaire et le haut rang qu'il lui a valu, un autre par la foule de ses clients. Cette foule, que je ne puis avoir, lui donne plus de crédit. Est-ce un grand mal que les hommes triomphent de moi, si à ce prix je triomphe de la Fortune? Plût aux dieux que cette détermination eût été de bonne heure embrassée par toi, et que ce ne fût pas en présence de la mort que nous songeassions à vivre heureusement! Aujourd'hui même tarderons-nous encore? Car que de choses sur la frivolité, sur le danger desquelles la raison devait nous convaincre et que l'expérience nous dévoile maintenant! Faisons comme ceux qui quittent les derniers la barrière et qui forcent de vitesse pour regagner le temps perdu : que l'éperon redouble ses coups. Nous sommes dans l'âge qui se prête le mieux aux études de la sagesse ; la vie a jeté son écume, les passions indomptées d'une ardente jeunesse sont bien amorties ; peu s'en faut qu'elles ne soient éteintes. « Mais ce que tu apprends au moment du départ, quand te servira-t-il et à quoi? » A partir meilleur! Au reste, n'en doute pas, aucun âge n'est plus propre à la sagesse que celui où des épreuves multipliées et de longues et fréquentes souffrances ont dompté la nature et qui arrive aux salutaires pratiques par l'épuisement des passions. Cette heureuse saison est la nôtre : quiconque dans la vieillesse est parvenu à être sage le doit à ses années. LETTRE LXIX.Que les fréquents voyages sont un obstacle à la sagesse.Je n'aime pas à te voir changer de lieux et voltiger de l'un à l'autre. D'abord de si fréquentes migrations sont la marque d'un esprit peu stable. La retraite ne lui donnera de consistance que s'il cesse d'égarer au loin ses vues et ses pensées. Pour contenir l'esprit, commence par fixer le corps, autre fugitif; et puis c'est la continuité des remèdes qui les rend surtout efficaces ; n'interromps point ce calme et cet oubli de ta vie antérieure. Laisse à tes yeux le temps de désapprendre, et à tes oreilles de se faire au langage de la raison. Dans chacune de tes excursions, ne fût-ce qu'en passant, quelque objet propre à réveiller tes passions viendra t'assaillir. L'homme qui s'efforcera d'arracher l'amour de son cœur évitera tout ce qui rappellerait la personne aimée ; car rien n'est plus sujet que l'amour aux recrudescences; de même pour bannir tout regret des choses qui enflammèrent nos désirs on détournera ses yeux et ses oreilles de ce qu'on aura quitté. La passion est prompte à la révolte ; n'importe où elle se tourne, quelque chose se présente qui intéresse ses préoccupations. Point de mauvais penchant qui n'ait à offrir son appât. L'avarice promet de l'argent; la mollesse, mille voluptés diverses ; l'ambition, la pourpre et les applaudissements et par suite la puissance et tout ce que peut la puissance. Chaque vice te sollicite par un salaire : la retraite veut des sacrifices gratuits. Un siècle entier suffirait à peine pour que des vices enhardis par une longue licence pussent se réduire et accepter le joug; que sera-ce si le court espace qui nous reste est morcelé par des lacunes? Pour amener une œuvre quelconque à la perfection il faut la vigilance et l'attention les plus soutenues. Si tu me veux croire, médite bien ces vérités : exerce-toi, soit à bien accueillir la mort, soit à la prévenir, si la raison t'y engage. Il n'importe qu'elle vienne à nous, ou que nous allions à elle. Persuade-toi de la fausseté du mot que répètent tous les ignorants : Heureux qui meurt de sa belle mort! Et puis tu peux te dire : nul ne meurt qu'à son jour. Tu ne perds rien de ta part de temps: qu'abandonnes-tu? Ce qui n'est pas à toi. LETTRE LXX.Du suicide. Quand peut-on y recourir? Exemples mémorables.Après un long intervalle, j'ai revu ton cher Pompéi; je me suis retrouvé en présence de ma jeunesse. Tout ce que j'y avais fait alors, il me semblait que je le pouvais recommencer, que je l'avais fait peu auparavant. Nous avons côtoyé la vie, Lucilius ; et de même que sur mer, comme dit notre Virgile, On voit la terre et les cités s'enfuir,[99] ainsi, dans cette course si rapide du temps, s'efface d'abord notre enfance, puis notre adolescence, puis, n'importe comme on l'appelle, la saison intermédiaire du jeune homme au vieillard, frontière des deux âges, puis les meilleures années de notre vieillesse même, et enfin commence à nous apparaître le terme commun du genre humain. Nous y voyons recueil, insensés que nous sommes, et c'est le port, souvent désirable, jamais à fuir. Celui qui dès ses premiers ans s'y voit déposé n'a pas plus à se plaindre qu'un passager dont la traversée a été prompte. Car tantôt, tu le sais, la paresse des vents se joue de lui et le retient dans un calme indolent qui ennuie et qui lasse ; tantôt un souffle opiniâtre le porte avec une extrême vitesse à. sa destination. Ainsi de nous, crois-moi : la vie a mené rapidement les uns au but où il faut bien qu'arrivent même les retardataires ; elle a miné et consumé lentement les autres ; et tu n'ignores pas qu'il ne faut point se cramponner à elle ; car ce n'est pas de vivre qui est désirable, c'est de vivre bien. Aussi le sage vit autant qu'il le doit, non autant qu'il le peut. Il décidera où il lui faut vivre, avec qui, comment, dans quel rôle : ce qui l'occupe, c'est quelle sera sa vie, jamais ce qu'elle durera. Est-il assailli de disgrâces qui bouleversent son repos, il quitte la place, et n'attend pas pour le faire que la nécessité soit extrême ; mais du jour où la Fortune lui devient suspecte, il examine, non sans scrupule, s'il ne doit pas dès lors cesser d'être. « Qu'importe, dit-il, que je me donne la mort ou que je la reçoive, que je finisse plus tôt ou plus tard? je n'ai pas là grand dommage à craindre. » On ne perd pas grand’ chose à voir fuir tout d'un coup ce qui échappait goutte à goutte. Mourir plus tôt ou plus tard est indifférent ; bien ou mal mourir ne l'est pas. Or, bien mourir, c'est nous soustraire au danger de mal vivre. Aussi regardé-je comme des plus pusillanimes le mot de ce Rhodien[100] qui, jeté par un tyran dans une fosse et nourri là comme une bête sauvage, dit à quelqu'un qui lui conseillait de se laisser mourir de faim : « Tant que la vie lui reste, l'homme peut tout espérer. » Cela fût-il vrai, la vie doit-elle s'acheter à tout prix? L'avantage le plus grand et le mieux assuré, je ne voudrais pas l'obtenir par un indigne aveu de lâcheté. Irai-je songer que la Fortune peut tout pour celui qui vit encore? Pensons plutôt qu'elle ne peut rien contre qui sait mourir. Il est des cas pourtant où, sa mort fût-elle sûre, imminente, et fût-il instruit que la peine capitale l'attend, la main du sage ne se prêtera point à exécuter l'arrêt. C'est folie de mourir par crainte de la mort. Voici venir celui qui tue : attends-le. Pourquoi le devancer? Pourquoi te faire l'agent de la cruauté d'autrui? Es-tu jaloux du bourreau, ou plains-tu sa peine? Socrate pouvait finir sa vie en s'interdisant toute nourriture et préférer la faim au poison ; cependant il passa trente jours en prison et dans l'attente du supplice, non avec l'idée que tout était possible, qu'un si long délai ouvrait le champ à beaucoup d'espérances, mais il voulait satisfaire aux lois et que ses amis pussent jouir de Socrate à ses derniers instants. Qu'y eût-il eu de plus absurde que l'homme qui méprisait la mort redoutât la ciguë? Scribonia, femme d'un haut mérite, était la tante de Drusus Libo, jeune homme aussi stupide que noble, et à prétentions plus élevées qu'on ne les eût permises à qui que ce fût en ce temps-là, ou à lui-même en aucun temps. Au sortir du sénat, rapporté malade dans sa litière qui certes n'était pas suivie d'un nombreux convoi, car tous ses proches avaient indignement abandonné celui qui pour eux n'était déjà plus un accusé, mais un cadavre, il délibéra s'il se donnerait la mort ou s'il l'attendrait. « Quel plaisir auras-tu, lui dit Scribonia, à faire la besogne d'autrui? » Elle ne le persuada pas, il se tua et fit bien ; car devant mourir trois ou quatre jours après, au gré de son ennemi, vivre c'était préparer à cet ennemi une jouissance. Tu ne saurais donc décider en thèse générale s'il faut prévenir ou attendre la mort quand une violence étrangère nous y condamne ; une foule de circonstances peuvent déterminer pour ou contre. Si je puis opter entre une mort compliquée de tortures et une mort simple et douce, pourquoi ne prendrais-je pas cette dernière? Tout comme je fais choix du navire, si je veux naviguer; de la maison, s'il me faut un logis, ainsi du genre de mort par où je voudrais sortir d'ici. Et de même que la vie n'en est pas meilleure pour être plus longue, la mort la plus longue est la pire de toutes. La mort est la chose où l'on doit le plus agir à sa fantaisie : l'âme n'a qu'à suivre son premier élan : préfère-t-elle le glaive, le lacet ou quelque breuvage propre à glacer les veines, qu'elle achève son œuvre et brise les derniers liens de sa servitude. On doit compte de sa vie aux autres, de sa mort à soi seul. La meilleure est celle qu'on choisit.[101] Il est absurde de se dire : « On prétendra que j'ai montré peu de courage, ou trop d'irréflexion, ou qu'il y avait des genres de mort plus dignes d'un grand cœur. » Dis-toi plutôt que tu as en main la décision d'une chose où l'opinion n'a rien à voir. N'envisage qu'un but : te tirer des mains de la Fortune au plus vite ; sinon υ ne manquera pas de gens qui interpréteront mal ta résolution. Tu trouveras même des hommes professant la sagesse qui nient qu'on doive attenter à ses jours, qui tiennent que le suicide est impie et qu'il faut attendre le terme que la nature nous a prescrit. Ceux qui parlent ainsi ne sentent pas qu'ils ferment les voies à la liberté. Un des plus grands bienfaits de l'éternelle loi, c'est que pour un seul moyen d'entrer dans la vie, il y en a mille d'en sortir. Attendrai-je les rigueurs de la maladie ou des hommes, quand je puis me faire jour à travers les tourments et balayer les obstacles? Le grand motif pour ne pas nous plaindre de la vie, c'est qu'elle ne retient personne. Tout est bien dans les choses humaines dès que nul ne reste malheureux que par sa faute. Vous plaît-il de vivre? vivez ; sinon, vous êtes libres : retournez au lieu d'où vous êtes venus. Pour calmer une douleur de tête vous vous êtes mainte fois fait tirer du sang; pour diminuer une pléthore, on vous perce la veine ; or il n'est pas besoin qu'une large blessure partage vos entrailles pour vous ouvrir les vastes champs de la liberté : une lancette suffit ; la sécurité est au prix d'une piqûre.[102] D'où nous vient donc tant d'apathie et d'hésitation? Nul de nous ne songe qu'il devra un jour quitter ce domicile. Comme d'anciens locataires, trop attachés aux lieux et à leurs habitudes, les incommodités qui nous pressent ne peuvent nous en chasser.[103] Veux-tu être indépendant de ton corps? Ne l'habite que comme un lieu de passage. Considère-le comme une tente dont tôt ou tard il faudra te passer : tu subiras avec plus de courage la nécessité d'en sortir. Mais comment la pensée de finir viendrait-elle à qui désire tout et sans fin? Rien au monde n'est plus nécessaire à méditer que cette question du départ ; car pour les autres épreuves, on s'y aguerrit peut-être en pure perte. Nous aurons préparé notre âme à la pauvreté ; et nos richesses nous seront restées. Nous l'aurons armée de mépris contre la douleur; et, grâce à une santé ferme et inaltérable, jamais l'essai de cette vertu ne nous sera demandé. Nous nous serons fait une loi de supporter avec constance la perte des êtres les plus regrettables ; et tous ceux que nous aimons auront survécu respectés par le sort. Savoir mourir est la seule chose qu'un jour on exigera forcément de nous. Ne va pas croire que les grands hommes seuls ont eu la force de rompre les barrières de l'humaine servitude. Ne prétends pas qu'il a fallu être Caton pour arracher de sa main cette âme que le glaive n'avait pu faire sortir. Des hommes de la condition la plus vile se sont, par un généreux effort, mis hors de tous périls : n'étant pas maîtres de mourir à leur guise, ni de choisir tel qu'ils l'eussent voulu l'instrument de leur trépas, ils se sont saisis du premier objet venu ; et ce qui de sa nature était inoffensif, leurs mains courageuses en ont fait une arme mortelle. Naguère, au cirque des animaux, un des Germains commandés pour le spectacle du matin se retira, sous prétexte d'un besoin naturel, dans le seul endroit où les gardiens le laissaient libre ; là il prit le morceau de bois où était fixée l'éponge nécessaire à la propreté du corps, se l'enfonça tout entier dans la gorge, et interceptant le passage de l'air parvint à s'étouffer. « C'était traiter la mort avec peu de respect! » Sans contredit. « Et d'une façon bien sale et bien peu noble! » Eh! quoi de plus sot, quand on veut mourir, que de faire le délicat sur les moyens? Voilà un homme de cœur! Qu'il méritait bien qu'on lui laissât le choix de sa mort! Quel noble usage il eût fait d'un glaive! Qu'il se serait intrépidement jeté dans les profondeurs de la mer ou sur les pointes aiguës d'un rocher! Privé de toute ressource, il sut ne devoir qu'à lui-même la mort et l'arme qui la lui donna : il nous apprit que pour mourir rien ne nous arrête que la volonté. Qu'on juge comme on voudra l'action de cet homme énergique ; mais qu'on reconnaisse que le trépas le plus immonde est préférable à la plus élégante servitude. J'ai commencé à citer des hommes de la classe la plus abjecte, je vais poursuivre, car on exigera davantage de soi en voyant ceux qu'on méprise le plus s'élever au mépris de la mort. Les Catons, les Scipions, et d'autres dont les noms sont pour nous l'objet d'une admiration traditionnelle, nous les croyons trop grands pour être imités ; eh bien! nous allons voir le même courage offrir d'aussi nombreux exemples dans une ignoble arène que chez nos héros de guerre civile. Tout récemment un malheureux, conduit sur un chariot entouré de gardes pour servir au spectacle du matin, feignit d'être accablé de sommeil, laissa glisser sa tête vacillante jusque entre les rayons de la roue, et attendit, ferme sur son siège, qu'en tournant elle lui rompit le cou ; le chariot même qui le menait au supplice servit à l'y soustraire. Il n'est plus d'obstacles pour qui veut les rompre et sortir de la vie. Le lieu où la nature nous garde est ouvert de toutes parts. Tant que le permet la nécessité, voyons à trouver une issue plus douce ; avons-nous sous la main plus d'un moyen d'affranchissement, faisons notre choix, examinons lequel réussira le mieux : l'occasion est-elle difficile, la première venue sera la meilleure, saisissons-la, fût-elle inouïe et sans exemple. Les expédients ne sauraient manquer pour mourir là où le courage ne manque pas. Vois les derniers des esclaves : quand l'aiguillon du désespoir les presse, comme leur génie s'éveille et met en défaut toute la vigilance de leurs gardiens! Celui-là est grand qui s'impose pour loi le trépas et qui sait le trouver. Je t'ai promis plusieurs exemples de gladiateurs. Voici le dernier. Lors de la seconde naumachie, un Barbare se plongea dans la gorge la lance qu'il avait reçue pour combattre. « Pourquoi, se dit-il, ne pas me soustraire à l'instant même à tous ces supplices, à toutes ces risées? J'ai une arme, attendrai-je la mort? » Ce fut là une scène d'autant plus belle à voir qu'il est plus noble à l'homme d'apprendre à mourir qu'à tuer. Eh quoi! L'énergie qu'ont des âmes dégradées et des malfaiteurs, ne l'aurons-nous pas, nous qui pour braver les mêmes crises sommes armés par de longues études et par le grand maître de toutes choses, la raison? Nous savons par elle que le terme fatal a diverses avenues, mais est le même pour tous, et qu'il n'importe par où commence ce qui aboutit à même fin. Par elle nous savons mourir, si le sort le permet, sans douleur, sinon, par tout moyen possible, et nous saisir du premier objet propre à trancher nos jours. Il est inique de vivre de vol;[104] mais voler sa mort est sublime. LETTRE LXXI.Qu'il n'y a de bien que ce qui est honnête. Différents degrés de sagesse.Tu ne cesses de me consulter sur tel ou tel détail de conduite, oubliant que la vaste mer nous sépare. Comme le grand mérite d'un conseil est d'être donné à temps, il doit arriver que sur certains points mon avis te parvienne lorsque déjà l'avis contraire est préférable. Car un conseil doit s'adapter à l'état des choses, et les choses humaines sont emportées ou plutôt roulent sans fin. Le conseil doit donc naître au jour du besoin ; et un jour, c'est encore trop long : il doit naître, comme on dit, sous la main. Or comment le trouver, le voici. Quand tu voudras savoir ce qu'il faudra fuir ou rechercher, que le souverain bien, que les grands principes de toute la vie soient devant tes yeux. Là en effet doivent se rapporter toutes nos actions; ordonner les parties est impossible quand l'ensemble n'est pas arrêté. Jamais peintre, eût-il ses couleurs toutes prêtes, ne rendra la ressemblance, s'il n'est fixé d'avance sur ce qu'il veut représenter. Nos fautes viennent de ce que nos délibérations embrassent toujours des faits partiels, jamais un plan général de vie. On doit savoir, avant de lancer une flèche, quel but on veut frapper : alors la main règle et mesure la portée du trait. Notre prudence s'égare, faute d'avoir où se diriger. Qui ne sait pas vers quel port il doit tendre n'a pas de vent qui lui soit bon. Comment le hasard n'aurait-il point sur notre vie un pouvoir immense? Nous vivons au hasard. Or il arrive à certaines gens de savoir ce qu'ils croient ignorer, comme parfois nous cherchons telles personnes qui sont avec nous : ainsi le plus souvent nous ne savons où réside le souverain bien et nous en sommes tout près. Et il ne faut ni beaucoup de paroles ni long circuit d'arguments pour le définir : on le démontre pour ainsi dire au doigt sans le morceler par mille divisions. Que sert en effet de l'étendre en imperceptibles catégories, quand on peut dire : « Le souverain bien est l'honnête, » et, chose plus merveilleuse encore, « l'honnête est le seul bien ; tous les autres sont faux et entachés de mensonge? » Si tu te l'es persuadé, si tu t'es passionné pour, la vertu, car l'aimer serait peu, tout ce que tu éprouveras à cause d'elle sera pour toi, quoi qu'en jugent les autres, heureux et prospère, la torture même, quand sur le chevalet tu demeureras plus calme que tes bourreaux ; la maladie, si tu ne maudis point ton sort et ne cèdes point à la souffrance. En un mot, tout ce qui aux yeux des autres est réputé maux s'adoucira et se tournera en biens si tu parviens à le dominer. Qu'il te soit démontré qu'il n'y a de bien que l'honnête ; et tous les désagréments de la vie tu les appelleras à bon droit des biens, quand du moins la vertu les aura ennoblis. Bien des gens s'imaginent que nous promettons plus que ne peut tenir l'humaine condition ; et ils ont raison, s'ils ne considèrent que le corps : qu'ils regardent à l'âme : c'est sur Dieu qu'ils mesureront l'homme. Élève haut ta pensée, sage Lucilius, laisse là les puérilités littéraires de ces philosophes qui ravalent la plus magnifique chose à un jeu de syllabes ; dont les minutieux enseignements rapetissent et énervent l'esprit ; et tu te placeras au niveau des inventeurs non des précepteurs de ces dogmes, qui s'évertuent à faire voir dans la philosophie plus de difficultés que de grandeur. Socrate qui ramena toute la philosophie à la morale, a dit aussi que le sommaire de la sagesse est de savoir discerner les biens et les maux. Suis donc de pareils guides, si j'ai sur toi quelque crédit, et tu seras heureux; consens à passer pour déraisonnable aux yeux de certains hommes. Essaye qui voudra contre toi l'outrage et l'injustice ; tu n'en souffriras rien, si la vertu est avec toi. Oui, veux-tu être heureux et franchement homme de bien, il est des mépris qu'il te faut accepter.[105] Nul n'est capable de cet effort, que celui pour qui tous biens sont égaux, vu que le bien n'est pas sans l'honnête et que l'honnête est dans tout bien au même degré. « Mais quoi! Est-il égal que Caton soit nommé à la préture ou qu'il en soit exclu? Est-il égal qu'aux champs de Pharsale il soit défait ou victorieux? Ce bien, de demeurer invincible dans un parti vaincu, valait-il cet autre bien de rentrer vainqueur dans sa patrie et d'y rétablir la paix? » Pourquoi non? C'est la même vertu qui surmonte la mauvaise fortune et qui règle la bonne : or la vertu ne peut ni grandir ni décroître : elle est toujours de même stature. « Mais Cn. Pompée perdra son armée; mais cet imposant patriciat, cette élite de la République, avant-garde du parti pompéien, ce sénat romain sous les armes sera écrasé dans une seule action ; l'écroulement du colosse enverra ses débris tomber par tout le globe, les uns en Egypte, d'autres en Afrique, d'autres en Espagne, et cette malheureuse République n'aura pas môme la consolation de périr en une fois. » Oui, tous les malheurs dussent-ils éclater, Juba dans son royaume n'être point assez fort ni de la connaissance des lieux ni de l'obstiné dévouement du peuple à son roi; dût la foi même de ceux d'Utique fléchir brisée par le malheur, et Scipion voir en Afrique la fortune de son nom l'abandonner, Caton a pourvu dès longtemps à ce que nul dommage ne pût l'atteindre. « Il a été vaincu pourtant! » Eh bien! compte cela pour une exclusion de plus ; sa grande âme est prête à se voir interdire la victoire comme la préture. Le jour où celle-ci lui fut déniée, il joua à la paume; la nuit de sa mort il ne fit que lire : ce fut pour lui même chose de perdre la préture ou la vie; quoi qu'il pût arriver, il s'était fait une loi de le souffrir. Pourquoi n'aurait-il pas souffert aussi le renversement de la République avec constance et résignation? Car est-il rien qui soit excepté de la chance des révolutions? Ni terre ni ciel n'y échappent, ni cette belle contexture de l'immense univers, bien qu'un Dieu le gouverne et le guide. Cet ordre sublime n'est point éternel; ce cours harmonieux, un jour viendra qui doit le rompre. Tout a sa marche et ses périodes fixes : tout doit naître, croître, s'éteindre. Ces grands corps qui roulent sur nos têtes, cette masse dont nous faisons partie, ce support en apparence immuable, attendent leur déclin et leur[106] terme. Il n'est rien qui n'ait sa vieillesse : inégaux sont les intervalles, mais la destinée est la même. Tout ce qui est cessera d'être, non pour périr, mais pour se décomposer. A nos yeux la décomposition c'est la mort, car nous regardons au plus près de nous; notre vue obtuse ne va pas au delà, c'est à la matière qu'elle s'attache; mais qu'on verrait avec plus de courage mourir et soi-même et les siens, si on s'élevait à l'espoir que tout passe ainsi et alterne de la vie à la mort,[107] et se décompose pour se recomposer, et que c'est l'œuvre où s'emploie incessamment la toute-puissance du céleste ouvrier. Aussi, comme Caton, le sage en parcourant par la pensée l'ensemble des âges, se dira : « L'humanité entière, contemporains, race future, est condamnée à périr ; ces cités dominatrices, n'importe où elles soient, celles qui font l'honneur et l'orgueil des royaumes étrangers, un jour on cherchera quelle fut leur place; toutes par diverses causes auront disparu. La guerre détruira les unes, d'autres se consumeront dans les langueurs d'une paix dégénérée en apathie et dans le luxe, fléau des riches États. Toutes ces fertiles campagnes seront couvertes par la subite inondation des mers ; ou le sol brusquement affaissé les entraînera dans l'abîme. Pourquoi donc m'indigner ou gémir, si je devance de quelques moments la commune catastrophe? » Qu'une grande âme obéisse à Dieu : ce que la loi universelle prescrit, qu'elle n'hésite pas à le subir. Ou elle part pour une meilleure vie, pour habiter à jamais parmi les puissances divines un séjour de lumière et de paix ; ou du moins, désormais exempte de souffrir, elle va se réunir à son principe et rentrer dans le grand tout. Une honorable vie n'est donc point pour Caton un plus grand bien qu'une mort honorable, puisque la vertu ne renchérit pas sur elle-même. La vérité et la vertu, disait Socrate, sont même chose : pas plus que la vérité, la vertu ne peut croître, elle a toute sa perfection, toute sa plénitude. Ne t'étonne donc pas que les biens soient égaux, tant ceux qu'il faut embrasser par choix, que ceux qu'amène le cours des choses. Car admettre l'inégalité, et compter le courage dans les tortures parmi les biens de second ordre, c'est le compter par là même au nombre des maux, c'est proclamer Socrate malheureux dans les fers, Caton malheureux de rouvrir sa blessure avec plus d'héroïsme qu'il ne l'avait faite, et Régulus le plus infortuné des hommes, parce qu'il porte la peine de la foi gardée même à des ennemis. Et pourtant nul n'a osé le dire, pas même la secte la plus efféminée : on nie le bonheur d'un tel homme, mais on ne dit pas qu'il ait été malheureux. L'ancienne école académique avoue que l'homme peut être heureux au milieu de toutes ces souffrances, mais non pleinement ni d'une manière parfaite ; ce qui n'est nullement admissible. S'il est heureux, il l'est souverainement.[108] Et ce souverain bien n'a point de degré au delà de lui-même, dès que la vertu est trouvée, la vertu que l'adversité n'amoindrit pas, qui même en un corps tout mutilé demeure intacte, Telle elle demeure, car elle a, comme je la conçois, le cœur haut et intrépide; tout ce qui la persécute l'exalte. L'enthousiasme qu'éprouvent souvent de jeunes et généreuses natures, si quelque acte honorable, qui les saisit par sa beauté, les pousse à braver tous les coups du sort, la sagesse saura bien l'inspirer et le transmettre ; elle nous convaincra que le seul bien c'est l'honnête, qu'il n'est susceptible ni de déchoir ni d'augmenter, pas plus que le niveau, qui apprécie la rectitude des lignes, ne fléchira. Si peu qu'on y changerait serait aux dépens de l'exactitude. Il faut en dire autant de la vertu : c'est une règle aussi qui n'admet point de courbure ; elle peut prendre plus de rigidité, jamais plus d'extension. Elle est juge de tout, et n'a point de juge. Si elle ne peut être plus droite qu'elle-même, les actes qui se font par elle ne sont pas plus droits les uns que les autres ; car il faut qu'ils lui soient conformes ; ils sont donc égaux. « Mais encore! Est-il égal d'être sur un lit de festin ou sur un instrument de torture? » Cela te surprend? Voici qui te surprendra davantage : les joies de la table sont un mal, et les tortures du chevalet un bien, s'il y a honte dans le premier cas et gloire dans le second. Qui fait alors le bien ou le mal? Ce n'est pas la situation, c'est la vertu : n'importe où elle se montre, elle donne à tout la même mesure et le même prix. Je les vois d'ici me provoquer du geste, ceux qui jugent toutes les» âmes par la leur, parce que je dis qu'aussi heureux est l'homme qui porte l'adversité avec courage que celui qui use honnêtement de la prospérité ; aussi heureux le captif traîné devant un char, mais dont le cœur reste invincible, que le triomphateur lui-même. Nos adversaires jugent impossible tout ce qu'ils ne peuvent faire; c'est d'après leur faiblesse qu'ils décident de ce qu'est la vertu.[109] Qu'on ne s'étonne pas que le feu, les blessures, la mort, les plus durs cachots aient leur charme et quelquefois même soient choisis par l'homme! La diète est une peine pour l'intempérant ; le travail, un supplice pour le paresseux ; la continence[110] désole le débauché ; et l'activité, l'homme qui n'y est point fait ; l'étude semble une torture à un esprit inappliqué;[111] de même les épreuves pour lesquelles nous sommes tous si faibles, nous les croyons dures et intolérables, oubliant que pour bien des hommes c'est un tourment d'être privés de vin ou réveillés au point du jour. Ces épreuves ne sont pas difficiles en elles-mêmes ; c'est nous qui sommes lâches et énervés. Il faut apprécier avec une grande âme les grandes choses ; sans quoi nous voudrons voir en elles le vice qui est en nous. Ainsi le bâton le plus droit, plongé dans l'eau, présente l'apparence de lignes courbes et brisées. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais la façon dont nous le voyons qui importe : l'esprit de l'homme n'aperçoit la vérité qu'à travers un brouillard. Donne-moi un jeune homme qu'ait respecté la corruption, qui au moral ait toute sa force, il dira qu'il trouve plus heureux celui qui porte sans fléchir le poids de l'adversité la plus accablante, celui qu'il voit plus grand que le sort. Ce n'est pas merveille qu'au milieu du calme on garde son assiette : mais admirons qu'un homme s'élève où les autres s'abaissent, et reste debout quand tous sont par terre. Qu'y a-t-il dans les tourments et dans tout ce qu'on nomme adversité qui soit vraiment un mal? C'est, ce me semble, que l'âme faiblisse, et plie, et vienne à tomber : rien de tout cela ne peut arriver au sage. Il se tient droit, quelque charge qui lui incombe ; rien ne le rapetisse ; rien de ce que l'homme doit subir ne le rebute. S'il fond sur lui quelqu'un de ces maux qui peuvent fondre sur tous, il n'en murmure point. Il connaît sa force, il sait qu'elle répond à sa tâche. Je ne mets point le sage à part des autres hommes ; je ne le rêve pas inaccessible à la douleur, comme le serait un roc étranger à toute sensation. Je me souviens qu'il a été formé de deux substances : l'une, privée de raison, ressent les morsures, les flammes, la souffrance ; l'autre, en tant que raisonnable, est inébranlable dans ses convictions, intrépide, indomptée. En elle habite le souverain bien : tant qu'il n'a pas toute sa plénitude, l'âme s'agite incertaine ; mais quand il est parfait, l'immuable stabilité est conquise. Ainsi le néophyte, qui aspire au plus haut degré, l'adorateur de la vertu, lors même qu'il approche de ce bien parfait, comme il n'a pas su encore y mettre la main, se relâchera par intervalles, et laissera quelque peu se détendre le ressort moral ; car il n'a point franchi tout défilé suspect : il foule encore une terre glissante. Mais l'heureux mortel dont la sagesse est accomplie n'est jamais plus content de soi que quand il est fortement éprouvé ; ce qui épouvanterait les autres, lui, si l'exécution d'un noble devoir est à ce prix, non seulement s'y résigne, mais s'y dévoue et aime bien mieux s'entendre applaudir de sa constance que de sa fortune. Je viens maintenant où m'appelle ton impatience. Nous ne créons point une vertu hors de nature, une vague chimère : notre sage tremblera, souffrira, pâlira comme vous : sensations physiques que tout cela. Où donc y a-t-il calamité? Où y a-t-il mal véritable? Dans l'âme qui alors se voit abattue, réduite à confesser sa dépendance, à se repentir de sa vertu. Si la vertu du sage triomphe de la Fortune, trop de gens qui se piquent de sagesse s'effrayent souvent des plus légères menaces. Ici le tort est de notre côté : ce qui ne se dit que du sage, nous l'exigeons du commençant. Je me prêche cette vertu dont je fais l'éloge, mais je ne suis point encore converti;[112] quand je le serais, je n'aurais pas une résolution assez prompte, assez exercée pour courir à l'encontre de toutes les crises. Il est des couleurs que la laine prend du premier coup ; il en est dont elle ne peut s'imboire qu'après qu'on l'a mainte fois macérée et recuite : ainsi les enseignements vulgaires, à l'instant même où l'esprit les reçoit, sont réfléchis par lui ; mais si elle ne descend au fond de nous-mêmes et n'y séjourne longtemps, si au lieu d'imprimer une teinte légère, elle n'a coloré tout l'homme, la sagesse ne donne rien de ce qu'elle avait promis. Il faut peu de temps et fort peu de paroles pour enseigner que la vertu est l'unique bien, que tout au moins il n'en est point sans elle, et que cette vertu siège dans la meilleure partie de l'homme, dans la partie raisonnable. » Mais que sera cette vertu? Un jugement vrai, inébranlable, qui donnera tout mouvement à l'âme et lui fera voir à nu toutes les vaines apparences qui émeuvent ses passions. Ce jugement aura pour attribut de réputer biens, et biens égaux entre eux, toutes choses où la vertu aura mis la main. Or les biens corporels sont biens pour le corps, mais ne le sont pas pour tout l'homme. Ils auront sans doute quelque prix, du reste point de dignité : distants entre eux à de longs intervalles, ceux-ci seront plus grands, ceux-là moindres. Même chez les poursuivants de la sagesse il est de grandes inégalités, nous sommes forcés d'en convenir. L'un est arrivé à lever contre la Fortune un regard calme, mais non imperturbable, et qui cède ébloui par un trop vif éclat; un autre en est venu à l'envisager face à face ; s'il a franchi le dernier degré, le voilà plein d'une ferme confiance. L'imperfection nécessairement chancelle, et tantôt avance, tantôt glisse en arrière ou même tombe. Et on reculera, si l'on ne persiste à marcher d'effort en effort; pour peu que notre zèle, que notre consciencieux dévouement faiblissent, il faut rétrograder. Nul ne retrouve ses progrès où il les a laissés. Courage donc et persévérance! Nous avons dompté moins de difficultés qu'il n'en reste encore ; mais c'est déjà une grande avance que de vouloir avancer. Cette vérité-là, j'en ai la conscience : je veux, et je veux de toute mon âme. Chez toi aussi je vois la même inspiration précipiter ta course vers le plus noble de tous les buts. Hâtons-nous donc! ainsi seulement la vie sera un bienfait ; autrement ce n'est qu'un obstacle dont il faut rougir, s'il nous retient dans l'ignominie. Faisons que tout notre temps soit pour nous : il ne nous appartiendra que si nous commençons à nous appartenir. Quand nous sera-t-il donné de mépriser l'une et l'autre fortune! Quand pourrai-je, toutes mes passions réduites et mises à la chaîne, faire entendre ce cri : J'ai vaincu! « Quels ennemis? » vas-tu dire. Ce n'est ni le Persan ni l'habitant du fond de la Médie, ni les contrées belliqueuses qui s'étendent peut-être au delà des Dahes, mais la cupidité, mais l'ambition, mais la crainte de la mort, qui triomphèrent des triomphateurs du monde·. LETTRE LXXII.Tout abandonner pour embrasser la sagesse.L'éclaircissement que tu me demandes je l'avais présent, lorsque j'étudiais cette matière ; mais il y a longtemps que je n'ai interrogé ma mémoire, et elle a peine à me répondre. Je sens qu'il m'est arrivé comme à ces livres dont la moisissure a collé les feuillets ; l'esprit a besoin qu'on le déroule et qu'on secoue de temps, à autre ce qu'on y a déposé, pour le trouver prêt quand le besoin l'exigera. Pour le moment donc différons ma réponse ; elle demande trop de soin et d'application. Au premier endroit où je pourrai me promettre un séjour un peu long, je me mettrai à l'œuvre. Il est en effet des choses qui peuvent s'écrire même en litière : il en est d'autres qui veulent le lit, le repos et le silence du cabinet. Toutefois ne laissons pas de faire quelque chose et en ces jours d'occupation et tant que dure le jour, car jamais les occupations ne cesseront de se succéder ; nous les semons : une seule en fait éclore plusieurs, sans compter les délais que nous nous accordons. « Quand j'aurai mis fin à ceci, j'étudierai de toute mon âme ; si j'arrive à régler cette fâcheuse affaire, je m'adonnerai à la philosophie. » Ce n'est pas pour les jours de loisir qu'il faut réserver la philosophie:[113] négligeons tout le reste pour elle : pour elle nulle vie n'est assez longue, s'étendît-elle depuis l'enfance jusqu'au terme de la vieillesse la plus reculée. Il n'y a pas ici grande différence entre ne point travailler du tout et interrompre ses travaux, car ils n'en demeurent point où on les a quittés; comme ces ressorts mal tendus qui reviennent sur eux-mêmes, tout retombe bien vite jusqu'au point de départ, quand l'effort a discontinué. Il faut résister aux occupations et, loin de les poursuivre, les repousser toutes. Point de temps qui ne soit propre aux études salutaires : que d'hommes toutefois n'étudient rien dans les conjonctures même pour lesquelles il faut étudier! « Il surviendra des empêchements! » Qu'est cela pour une âme qui dans les affaires les plus graves demeure gaie et allègre? une sagesse imparfaite n'a que des joies entrecoupées ; le contentement du sage est continu : c'est un tissu que nul accident, nul coup de fortune ne peuvent rompre ; toujours et partout c'est le même calme, car il est indépendant d'autrui et n'attend de faveur ni du sort ni des hommes. Sa félicité est tout à fait interne : elle quitterait son âme, si elle venait d'ailleurs, mais elle naît en lui. De temps à autre quelque atteinte du dehors l'avertit qu'il est mortel ; mais l'atteinte est légère et ne passera point l'épiderme. Ce n'est plus qu'un souffle incommode : le bien suprême qui est en lui n'est pas ébranlé. En un mot si quelque désagrément lui arrive de l'extérieur, comme parfois sur un corps robuste et vigoureux des éruptions de pustules et de petits ulcères, l'intérieur n'éprouve aucun mal. Il y a la même différence entre le sage consommé et celui qui est en chemin de l'être qu'entre l'homme sain et l'homme qui, relevant d'une grave et longue maladie, trouve une sorte de santé dans la diminution des accès. Ce dernier, s'il ne s'observe, éprouvera des pesanteurs et des rechutes : le sage ne peut retomber ni dans son premier mal ni même dans tout autre. La santé du corps n'est en effet que pour un temps ; le médecin même qui l'a pu rétablir ne la garantit point : souvent il est rappelé chez celui qui l'avait fait quérir. L'âme une fois guérie l'est pour toujours. Voici les signes où l'on reconnaît l'âme saine : contentement d'elle-même ; confiance dans ses forces ; conviction complète que tous les vœux des mortels, toutes les grâces qui se donnent et se demandent ne sont de nulle importance pour la vie heureuse. Car ce qui peut recevoir une addition quelconque est imparfait ; ce qui peut subir des retranchements n'est point perpétuel ; pour jouir d'un contentement perpétuel il faut le puiser en soi. Toutes ces choses auxquelles le vulgaire aspire bouche béante ont leur flux et leur reflux : la Fortune ne nous livre rien en propre ; mais ses dons même accidentels ont leur charme quand la raison les règle et les mélange avec mesure. Elle seule assaisonne ces avantages extérieurs dont usent les âmes avides sans les apprécier. Attalus employait souvent cette comparaison : « Vous voyez quelquefois un chien happer à la volée des morceaux de pain ou de viande que lui jette son maître : tout ce qu'il saisit est englouti du même coup ; et il espère, il appelle toujours autre chose. Voilà les hommes : quoi que la Fortune jette à leur impatience, ils le dévorent sans le savourer, toujours alertes et attentifs à s'emparer d'une nouvelle proie. » Tel n'est point le sage : il est rassasié ; toute grâce ultérieure est reçue par lui tranquillement et mise en réserve : il jouit d'une satisfaction suprême, intime. Tel autre aura beaucoup de zèle et sera en progrès, mais loin encore de la perfection : on le verra abaissé et relevé tour à tour, tantôt porté jusqu'au ciel, tantôt retombé sur la terre. Les affairés et les apprentis en sagesse marchent sans cesse de chute en chute : ils tombent dans le chaos d'Epicure, dans ce grand vide qui n'a pas de fond. Il est encore une troisième classe, celle des hommes qui côtoient la sagesse ; ils ne l'ont pas touchée ; mais ils l'ont sous les yeux et pour ainsi dire à portée : ils n'éprouvent plus de secousses, ne dérivent même plus et, sans tenir terre, sont déjà au port. Puis donc qu'il y a si grande différence des premiers aux derniers, puisque la classe intermédiaire a aussi ses avantages à côté de l'immense péril d'être rejetée plus loin qu'auparavant, ne nous livrons point aux affaires, fermons-leur la porte : une fois entrées, elles en attireront d'autres après elles. Arrêtons-les dès le principe. Mieux vaut les empêcher de commencer, que d'avoir à y mettre fin. LETTRE LXXIII.Que les philosophes ne sont ni des séditieux ni de mauvais citoyens.Jupiter et l'homme de bien.C'est une erreur, à mon avis, de voir dans les fidèles serviteurs de la philosophie des citoyens rebelles et réfractaires, contempteurs des magistrats, des rois, de tous ceux qui administrent la chose publique.[114] Au contraire nul ne leur paye plus qu'eux le tribut d'une reconnaissance légitime, car nul ne fait plus pour eux que ceux qui leur permettent la jouissance d'un loisir tranquille. La sécurité publique concourant à leur noble projet de vivre vertueusement, comment l'auteur d'un si grand bien ne serait-il pas chéri d'eux comme un père? Et ils lui portent bien plus d'amour que ces esprits remuants, ces hommes d'intrigue qui doivent tant au prince et se prétendent encore ses créanciers, et sur qui ses grâces ne pleuvent jamais avec assez d'abondance pour désaltérer leur soif que l'on irrite en l'abreuvant. Or ne songer qu'à obtenir encore, c'est oublier ce qu'on a obtenu ; et de tous les vices de la cupidité le plus grand c'est qu'elle est ingrate. Ajoutons que de tous ces hommes qui ont des fonctions dans l'Etat nul ne considère qui il surpasse, mais par qui il est surpassé ; ils sont moins flattés de laisser mille rivaux derrière eux que rongés d'en voir un seul qui les précède. C'est le vice de toute ambition de ne point regarder derrière elle. Et ce n'est pas l'ambition seule qui ne s'arrête jamais; toute passion fait de même : elle part toujours du point d'arrivée.[115] Mais l'homme pur et sincère qui a dit adieu au sénat, au forum, à toute participation au gouvernement, pour occuper sa solitude d'un plus sublime emploi, un tel homme affectionne, ceux à qui il doit de le faire sans risque ; lui seul leur voue un hommage désintéressé, car il tient d'eux, sans qu'ils s'en doutent, un immense bienfait. Tout ce qu'il a de respect et d'estime pour les instituteurs dont le dévouement l'a tiré des inextricables voies de l'ignorance, il l'étend à ceux sous la tutelle desquels il cultive les plus nobles arts. « Mais le souverain protège aussi les autres de son autorité. » Qui le conteste? Toutefois, comme on se sent plus obligé à Neptune, si, par un beau temps dont d'autres aussi profitaient, on a débarqué des objets plus précieux, plus nombreux que les leurs ; comme le marchand acquitte son vœu de meilleur cœur que le passager; et comme, parmi les marchands mêmes, la gratitude a plus d'effusion chez ceux qui amenaient des parfums, de la pourpre, des choses à vendre au poids de l'or, que chez ceux qui avaient entassé à bord des denrées de vil prix bonnes pour servir de lest : de même le bienfait de la paix, auquel tous participent, touche plus profondément l'homme qui en fait le meilleur usage. Car que de gens, sous l'habit civil, subissent de plus durs travaux qu'à la guerre! Penses-tu qu'on soit aussi reconnaissant de la paix quand on en consume les loisirs dans l'ivresse, dans la débauche, dans tous ces vices dont, fût-ce même au prix de la guerre, il faudrait rompre le cours? A moins que tu ne supposes le sage assez peu juste pour se croire personnellement libre de toute obligation envers le bienfaiteur de tous. Je dois beaucoup au soleil et à la lune, et pourtant ils ne se lèvent pas pour moi seul; les saisons, le Dieu qui les règle, sont mes bienfaiteurs particuliers, quoique cette belle ordonnance n'ait pas été établie en mon honneur. L'absurde cupidité humaine, avec ses distinctions de jouissance et de propriété, croit que rien n'est à elle de ce qui est à tout le monde ; le sage au contraire estime que rien n'est mieux à lui que les choses qu'il partage avec le genre humain, qui ne seraient pas communes si chacun n'y avait sa part, et il fait sienne jusqu'à la moindre portion de cette communauté. D'ailleurs les grands, les véritables biens ne se morcellent point de manière à n'arriver à chacun que par minces dividendes : tout homme les obtient dans leur intégrité. Si dans les largesses solennelles on ne reçoit que ce qui fut promis par tête; si des festins publics, des distributions de victimes, de tout ce que la main peut saisir aucun n'emporte que son lot, il est des biens indivisibles, la paix, la liberté, qui appartiennent tout entiers à tous et à chacun.[116] De là le sage reporte sa pensée sur l'homme qui lui fait recueillir l'usage et le fruit de ces biens, sur l'homme qui ne l'appelle ni aux armes, ni à la garde des postes, ni à la défense des remparts ni à mille charges militaires, toutes de nécessité publique, et il rend grâce au pilote qui veille pour lui. Ce qu'enseigne surtout la philosophie, c'est de bien sentir comme de bien rendre les bienfaits dont l'aveu seul équivaut parfois au payement. Il confessera donc sa dette immense envers ce grand administrateur, cette seconde providence qui le gratifie d'un bienheureux repos, du libre emploi de ses journées, de cette tranquillité que ne trouble point l'embarras des devoirs publics. Ο Mélibée! un dieu nous a fait ce loisir : » Oui, toujours pour son dieu mon cœur le veut choisir. Si l'on est si fort obligé à l'auteur de ce loisir dont voici la grâce la plus haute : Il laisse errer en paix mes fidèles troupeaux, Et permet qu'à mon gré j'enfle ici mes pipeaux,[117] combien n'estimerons-nous pas cet autre loisir qui est le partage des dieux, qui nous fait dieux nous-mêmes?[118] Oui, Lucilius ; et je t'invite à monter au ciel par un bien court chemin. « Jupiter, disait souvent Sextius, n'est pas plus puissant que l'homme de bien. » Jupiter a plus à donner aux mortels ; mais de deux sages le meilleur n'est pas le plus riche, comme entre deux pilotes également habiles tu ne donneras point la palme à celui du navire le plus grand et le plus magnifique. En quoi l'emporte Jupiter sur l'homme de bien? Il est plus longtemps vertueux. Le sage s'en estimera-t-il moins parce qu'un moindre espace circonscrit ses vertus? Tout comme de deux sages celui qui meurt plus âgé n'est pas plus heureux que celui dont la vertu fut, limitée à un moindre chiffre d'années ; ainsi Dieu ne surpasse point le sage en bonheur, quoiqu'il le surpasse en durée. La durée n'ajoute point à la grandeur de la vertu. Jupiter possède tout, mais pour faire part aux hommes de ce qu'il possède. Le seul usage qui lui en revienne, c'est que tous en usent grâce à lui. Le sage voit avec autant d'indifférence et de dédain que le fait Jupiter les richesses concentrées dans les mains des autres : d'autant plus fier de lui-même que Jupiter ne peut, et que lui ne veut pas en user. Croyons donc Sextius qui nous indique la plus noble route et qui nous crie : « C'est par ici qu'on monte dans les cieux ; c'est par la voie de la frugalité, de la tempérance, par la voie du courage. » Les dieux ne sont ni dédaigneux, ni jaloux : ils ouvrent les bras, ils tendent la main à qui veut s'élever jusqu'à eux. Tu t'étonnes que l'homme puisse monter jusqu'à Dieu! C'est Dieu qui descend jusqu'à l'homme,[119] que dis-je? la relation est plus étroite, il entre dans l'homme. Il n'est aucune âme bonne sans Dieu.[120] Il est tombé dans chaque créature humaine des germes célestes dont une heureuse culture obtient une moisson de même nature que la semence et digne en tout du créateur ; mais faute de soin, comme en un sol stérile et marécageux, ils meurent, et on voit naître de viles herbes au lieu de bon grain. LETTRE LXXIV.Qu'il n'y a de bien que ce qui est honnête.Ta lettre m'a charmé et m'a réveillé de ma langueur; du même coup mes souvenirs, déjà paresseux et lents, se sont ravivés. Comment, cher Lucilius, n'admettrais-tu pas comme le grand moyen de vivre heureux cette persuasion qu'il n'y a de bien que l'honnête? L'homme en effet qui croit à d'autres biens tombe au pouvoir de la Fortune et à la discrétion d'autrui ; celui qui pose l'honnête pour limite de tout bien a son bonheur en lui-même. D'autres seront affligés de la perte ou inquiets de la maladie de leurs enfants, ou désolés de leur inconduite et de la flétrissure qu'ils ont encourue ; une passion adultère fera le supplice de l'un, et l'amour conjugal le malheur de l'autre. Il s'en trouve qu'un échec met à la torture ; il en est que les honneurs importunent. Mais dans l'immense famille des humains la plus nombreuse classe de malheureux est celle qu'agite l'attente de la mort qui de tous côtés nous menace ; car d'où ne surgit-elle point? Comme étrangers sur une terre hostile, il leur faut porter çà et là des regards inquiets et au moindre bruit tourner la tête. Qui n'a point banni cette crainte de son cœur vit dans les transes et les palpitations. Vous ne rencontrez que bannis, que propriétaires chassés de leurs biens; qu'indigents au sein de l'opulence, genre de misère pire que toute autre ; ici des naufragés ; plus loin, jouets d'un sort pareil, des victimes du courroux[121] populaire ou de l'envie, ce fléau des supériorités. Ils furent à l'improviste, en pleine sécurité, balayés comme par ces bourrasques qui, dans un jour serein auquel on a foi, nous surprennent,[122] ou comme frappés d'un foudre soudain, d'un de ces coups dont les alentours même ont tremblé. Car tout ce qui fut près de l'explosion reste aussi étourdi que ceux qui en furent atteints. Ainsi, dans les catastrophes violentes, pour un seul écrasé tout le reste est dans la terreur,[123] et les revers possibles contristent l'homme autant que les revers essuyés. Que le malheur fonde inattendu sur un voisin, tous s'alarment. Pareils à l'oiseau qu'effarouche le sifflement d'une fronde à vide, non seulement le coup nous fait tressaillir, mais le bruit seul du coup.[124] Donc pour personne le bonheur n'est possible sous l'influence d'un tel préjugé ; car il n'y a de bonheur qu'où la crainte n'est pas : où tout est suspect la vie est mauvaise. Quiconque se livre beaucoup au hasard s'est ouvert une source féconde d'inextricables sollicitudes; une seule voie mène à l'abri du trouble, le dédain de l'extérieur et une conscience à qui l'honnête suffit. Car l'homme qui préfère quoi que ce soit à la vertu ou reconnaît d'autre bien qu'elle, celui-là court tendre la main aux dons que sème la Fortune et attend avec anxiété qu'il en tombe sur lui quelque chose.[125] Figure-toi cette Fortune ouvrant une loterie, et sur tout ce Concours de mortels, secouant de sa robe honneurs, crédit, richesses : ici les lots sont mis en pièces par les mains qui se les disputent ; ailleurs la mauvaise foi fait les parts entre associés ; certains dons coûtent cher à saisir après qu'ils vous étaient échus, soit qu'ils tombent sur l'homme qui n'y pensait pas, soit que, de vouloir trop étreindre, on les perde tous, et que de l'avide envahisseur ils soient repoussés plus loin. Mais, même parmi les pillards heureux, pas un ne garde jusqu'au lendemain la joie de sa rapine. Aussi les mieux avisés, sitôt qu'ils voient venir les distributions, fuient l'amphithéâtre, sachant bien quel haut prix se payent ces chétifs objets. Point de lutte à craindre quand on fait retraite ; les coups ne suivent pas qui s'éloigne : autour du butin est toute la mêlée. Il en est ainsi des largesses que la Fortune jette du haut de sa roue. On se travaille misérablement, on se multiplie, on voudrait avoir plusieurs mains ; on lève à chaque instant les yeux vers la distributrice : comme elles semblent tarder ces faveurs qui irritent nos désirs, que peu obtiendront, que tous espèrent! On voudrait les saisir au vol ; on triomphe si l'on a pris et si l'espoir de prendre est déçu chez d'autres ; et ce vil butin on l'expie par quelque grande disgrâce ou par les mécomptes de la possession. Eloignons-nous donc de ces jeux funestes, cédons la place aux hommes de proie : que l'attente des vains appâts qui pendent sur leurs têtes les tienne eux-mêmes plus vainement suspendus. Quiconque a résolu d'être heureux ne doit reconnaître de bien que l'honnête. En admettre quelque autre, c'est d'abord mal juger de la Providence sur ce qu'elle envoie aux justes mille fâcheux accidents et que ses dons sont peu durables, sont exigus, comparés à la durée de l'ensemble des choses. Toutes ces plaintes font de nous d'ingrats appréciateurs des bienfaits célestes. Nous murmurons de ce qu'ils nous arrivent trop minces, trop précaires, de ce qu'ils nous quitteront. Voilà pourquoi nous ne consentons ni à vivre ni à mourir : vivre nous est odieux, mourir nous épouvante. Toutes nos résolutions chancellent, aucune félicité ne peut combler le vide de nos âmes. C'est que nous sommes encore loin de ce bien immense et suprême où il serait besoin que se fixât notre volonté, puisqu'au-dessus de la perfection il n'y a rien. « Tu demandes pourquoi la vertu n'a faute de quoi que ce soit! » Parce que, heureuse de ce qu'elle a, elle n'ambitionne pas ce qui est loin d'elle : tout lui est assez grand, car tout lui suffit. Qu'on s'écarte de ce système, plus de foi, ni de dévouement. Pour déployer ces deux vertus il faut supporter beaucoup de ce qu'on appelle maux, sacrifier beaucoup de ce qu'on affectionne comme biens. C'en est fait du courage, qui doit payer de sa personne ; c'en est fait de la grandeur d'âme, qui ne peut faire ses preuves qu'en méprisant comme mesquin tout ce que le vulgaire souhaite comme très grand ; c'en est fait de la reconnaissance, dont les témoignages sont autant de corvées pour l'homme qui connaît quelque chose de plus précieux que le devoir et un autre but que la vertu. Mais, sans m'arrêter sur ce dernier point, ou ces biens ne sont pas ce qu'on les appelle, ou l'homme est plus heureux que Dieu : car les choses qui sont sous notre main Dieu ne les a point à son usage ; la luxure, les banquets splendides, les richesses, et tout ce qui entraîne l'homme par l'appât d'une volupté vile, de tout cela Dieu n'a que faire. Il faut donc croire que Dieu a faute de biens, ou il est prouvé par le fait qu'elles ne sont pas des biens ces choses que Dieu n'a pas. Ajoute que beaucoup de ces biens prétendus sont plus amplement répartis aux animaux qu'à l'homme. Leur appétit est plus vorace; les plaisirs de l'amour les lassent moins; leurs forces sont plus grandes, plus également soutenues; les voilà donc bien plus heureux que l'homme. Ils vivent en effet sans iniquités et sans fraudes ; ils jouissent de voluptés et plus pleines et plus faciles, sans craindre aucunement la honte ou le repentir. Vois maintenant s'il faut qualifier bien ce en quoi l'homme l'emporte sur Dieu. C'est dans l'âme qu'il faut circonscrire le souverain bien : il dégénère, si de la plus noble partie de nous-mêmes il passe à la plus vile, si nous le transportons aux sens, plus actifs chez la brute. Non : notre félicité suprême ne doit point se placer dans la chair. Les vrais biens sont ceux que donne la raison : substantiels et permanents, ils ne peuvent ni périr, ni même décroître ou s'amoindrir. Hors de là sont des biens de convention, ayant même nom que les véritables, sans avoir même vertu. Nommons-les donc des avantages, et, pour parler philosophiquement, des emprunte : sachons du reste qu'ils sont esclaves de l'homme et non point parties de lui-même ; qu'ils soient chez nous, mais à condition, rappelons-nous-le, qu'ils soient hors de nous. Même demeurant chez nous, comptons-les pour des possessions peu dignes et abjectes, dont nul n'a droit de se montrer vain. Car quoi de plus absurde que de s'applaudir de ce qui n'est point notre ouvrage? Que tout cela s'approche de nous, mais n'y adhère pas, afin que si on nous l'enlève, la séparation s'opère sans déchirement.[126] Il faut en user, non en faire gloire, et en user modérément, comme de dépôts prêts à fuir de nos mains. Quiconque ne fut point sobre dans la possession ne les garda jamais longtemps : car la félicité qui ne se tempère pas croule sur elle-même. Compte-t-elle sur ses fugitifs avantages, elle s'en voit délaissée bien vite : les conserve-t-elle, ils l'écrasent. Peu d'hommes ont pu sans risque déposer doucement leur prospérité : la plupart trébuchent en même temps que leur grandeur, accablés sous l'échafaudage qui les tenait exhaussés. Recourons donc à la prudence pour imposer à ces choses la mesure et l'économie : l'esprit de désordre gaspille et précipite les jouissances, et rien d'immodéré ne dure, si la raison, cette grande modératrice, n'en contient les écarts. C'est ce que te montrera la destinée d'une foule d'États qui virent tomber dans sa fleur même leur puissance déréglée : tout ce qu'avait élevé la vertu s'écroula par l'intempérance. Prémunissons-nous contre de tels malheurs. Or, contre la Fortune, point d'enceinte inexpugnable : c'est le dedans qu'il faut armer. Si le dedans est en sûreté, on pourra battre la place, mais non l'emporter. « Qui peut ainsi fortifier l'homme? » Tu es curieux de l'apprendre? C'est, quoi qu'il arrive, de ne s'indigner de rien, de savoir que ce qui paraît nous blesser rentre dans le plan de conservation universelle et dans l'ordre des phénomènes qui assurent la marche et le rôle de la création. Que l'homme veuille tout ce qu'a voulu Dieu:[127] qu'il ne s'admire, lui et ce qui est en lui, que s'il est invincible, s'il tient le malheur sous ses pieds, si, fort de la raison, la plus puissante de toutes les armes, il triomphe du sort, de la douleur et de l'injustice. Aime la raison : cet amour sera pour toi un bouclier contre les plus rudes atteintes. L'amour de ses petits précipite la bête sauvage sur les épieux des chasseurs : son instinct farouche, son aveugle élan la rendent indomptable ; souvent la passion de la gloire envoie de jeunes courages braver et le fer et les feux ; il est des hommes qu'an fantôme d'honneur, une ombre de vertu jettent dans le suicide. Autant la raison est plus courageuse et plus constante que tout cela, autant elle se fera jour avec plus d'énergie à travers les épouvantails et les périls. « Tous ne gagnez rien, nous dit-on, à nier qu'il existe aucun autre bien que l'honnête. Ce rempart-là ne vous mettra point à l'abri de la Fortune et de ses coups. Tous comptez en effet au nombre des biens des enfants qui vous aiment, une patrie jouissant de bonnes institutions, des parents vertueux. Or vous ne sauriez être impassibles témoins de leurs dangers : votre patrie assiégée, la mort de vos enfants, la servitude de vos proches vous bouleverseront. » Écoute contre ces objections ce qu'ordinairement on répond pour nous : puis j'exposerai ce qu'à mon sens on pourrait dire de plus. Il n'en est pas ici comme de ces avantages dont la disparition fait place à quelque incommodité : la santé qui s'altère, par exemple, de bonne devient mauvaise ; que notre vue s'éteigne, nous voilà frappés de cécité ; les jarrets coupés ôtent à l'homme non seulement son agilité, mais l'usage de ses jambes. De tels risques n'existent point pour les biens dont j'ai parlé ci-dessus. Comment? si je perds un fidèle ami, serai-je pour cela victime de la perfidie d'un autre? si je vois mourir des enfants qui m'aiment, s'ensuit-il que des cœurs dénaturés prennent leur place? D'ailleurs ce ne sont pas mes amis, mes enfants qui sont morts, ce sont leurs personnes. Et le bien ne saurait périr que d'une manière ; en devenant mal, ce que la nature ne permet pas, parce que toute vertu et tout produit de la vertu demeure incorruptible. Fuis, quand j'aurais perdu des amis, des enfants irréprochables et qui répondaient aux vœux de leur père, il me reste de quoi m'en tenir lieu. Qui m'en tiendra lieu? Tu le demandes? Ce qui les avait faits bons : la vertu. Elle ne laisse point de vide dans l'âme, elle l'occupe tout entière, elle en bannit tous les regrets : seule elle nous suffit, car tous les biens tirent d'elle leur valeur et leur origine. Qu'importe qu'une eau courante soit détournée et se perde, si la source d'où elle coulait est respectée? Tu ne prétends pas qu'un homme soit plus juste, plus réglé, plus prudent, plus honorable quand ses enfants survivent que quand ils périssent : donc il n'en sera pas plus vertueux : donc il n'en sera pas meilleur. On n'en est ni plus sage parce qu'on a quelques amis de plus, ni plus insensé pour quelques amis de moins : on n'en est donc ni plus heureux ni plus misérable. Tant que la vertu reste sauve, on ne s'aperçoit pas qu'on ait rien perdu. « Qu'est-ce à dire? N'est-on pas plus heureux entouré d'un cercle d'amis et d'enfants? » Pourquoi le serait-on? Le souverain bien ne s'entame ni ne s'augmente : il est toujours en même état, quoi que la Fortune fasse, qu'une longue vieillesse nous soit octroyée, ou que nous finissions en deçà de la vieillesse : la mesure du souverain bien est égale, malgré l'inégalité d'âge. Four décrire un cercle ou plus grand ou moindre on ne modifie que l'espace, non la forme ; que l'un subsiste plus longtemps, et qu'on efface l'autre aussitôt et qu'il se perde sous la poussière[128] où il fut tracé, la forme de tous deux a été la même. La rectitude des lignes ne se juge ni par leur grandeur, ni par leur nombre, ni par le temps mis à les faire : qu'on les prolonge ou les raccourcisse, il n'importe. Pour une vie vertueuse prends l'espace d'un siècle et retranches-en tant qu'il te plaira ; ne lui donne qu'un jour, ce n'en sera pas moins une vertueuse vie. Tantôt la vertu agit dans une large sphère, gouverne des royaumes, des villes, des provinces, fait les lois, cultive ses amis, remplit librement ses devoirs envers ses enfants et ses proches ; tantôt elle se voit restreinte et comme circonscrite par l'indigence, l'exil, la perte d'héritiers. Toutefois elle n'est pas moindre, encore qu'elle soit tombée du faîte des honneurs à la vie privée, du trône au rang le plus obscur, du vaste exercice de la toute-puissance à l'étroit asile d'une cabane ou d'un coin déterre. Elle n'en est pas moins grande, fût-elle refoulée en elle-même et chassée de partout : car elle n'a rien perdu de la hauteur, de la noblesse de ses sentiments : sa prudence n'en est pas moins éclairée, ni sa justice moins inflexible.[129] Donc aussi elle n'en est pas moins heureuse, le bonheur n'ayant qu'un seul domicile qui est l'âme, où il apporte sa fixité, sa grandeur, son calme, ce qui sans la connaissance des choses divines et humaines serait impossible. Voici maintenant ma propre réponse, comme je l'ai promise. Le sage n'est point abattu par la perte de ses enfants ni par celle de ses amis ; il supporte leur mort avec le même calme qu'il attend la sienne ; il ne craint pas plus celle-là qu'il ne s'afflige de celle-ci. Car la vertu est tout harmonie : tous ses actes sont à l'unisson et en concordance parfaite avec elle, concordance qui sera détruite si l'âme, de la hauteur où elle devait être, se laisse plonger dans le deuil et le désespoir. Toute agitation de la peur, toute anxiété, toute paresse d'agir est contraire à l'honnête. L'honnête est chose pleine de sécurité, libre d'embarras, de frayeur, toujours alerte pour le combat. « Mais quoi? le sage ne ressentira-t-il pas alors quelque espèce de trouble? N'aura-t-il pas le teint altéré, le visage ému, les membres saisis d'un froid soudain? n'éprouvera-t-il rien de ces impressions qui agissent sans que la volonté y préside, par un mouvement indélibéré de la nature? » Je l'avoue, mais il n'en demeurera pas moins convaincu qu'aucune de ces pertes n'est un mal et ne mérite qu'une âme saine y succombe. Tout ce que son devoir lui dit de faire, il le fait hardiment, avec promptitude. Il n'appartient qu'à la folie, nul ne le niera, de faire lâchement et à contrecœur ce qu'elle doit faire, de pousser son corps d'un côté, son âme de l'autre, et d'être tiraillée par les mouvements les plus contraires. Ces désespoirs même, où elle triomphe et s'admire, ne lui valent que le mépris; et jusqu'aux choses dont elle se glorifie, elle ne les fait pas de plein gré. S'agit-il d'un mal qu'elle redoute, l'attente est pour elle aussi accablante que l'événement, et tout ce qu'elle craint de souffrir elle le souffre par la crainte seule. Dans une constitution débile la maladie s'annonce par des signes précurseurs : c'est une sorte d'engourdissement qui pèse sur les nerfs, une lassitude sans avoir rien fait, des bâillements, un frisson qui parcourt les membres ; ainsi une âme maladive, bien avant que les maux ne la terrassent, se sent ébranlée ; elle les anticipe, elle tombe avant l'heure. Or quelle plus grande extravagance que d'être en anxiété de l'avenir, et, au lieu de se réserver pour les douleurs futures, d'aller au-devant de ses misères et de rapprocher des crises que pour bien faire on doit reculer, si les dissiper est impossible. Veux-tu la preuve qu'on ne doit jamais se tourmenter de l'avenir? Qu'un homme apprenne que dans cinquante ans d'ici il subira quelque supplice, en sera-t-il troublé, si sa pensée ne franchit l'intervalle pour se plonger dans ces angoisses qui ne l'attendaient qu'au bout d'un demi-siècle? C'est par un même travers que certains esprits, amoureux du chagrin et en quête de sujets d'affliction, s'attristent de vieux souvenirs déjà effacés par le temps. Les peines passées, tout comme celles à venir, sont loin de nous : nous ne sentons ni les unes ni les autres. Or il faut que l'on sente pour qu'il y ait douleur. LETTRE LXXV.Ecrire simplement et comme on pense. Affections et maladies de l'âme.Trois classes d'aspirants à la sagesse.Tu te plains du style trop peu apprêté de mes lettres. Mais qui donc parle avec apprêt, s'il ne veut être un insipide parleur? Comme dans ma conversation avec toi, soit assis, soit en promenade, il n'y aurait ni travail ni gêne, ainsi je veux que soient mes lettres:[130] qu'elles n'aient rien de recherché, de factice. S'il était possible, je voudrais te montrer à nu ce que j'ai dans l'âme plutôt que te le dire. La discussion la plus vive ne me ferait ni frapper du pied, ni agiter les bras, ni renforcer ma voix ; je laisserais cela aux orateurs et me contenterais de te transmettre mes pensées sans vain ornement comme sans platitude. Il n'est qu'un point dont je sois jaloux de te convaincre, c'est que je pense toutes les choses que je dis, et que non seulement je les pense, mais que je suis passionné pour elles. Autre est le baiser qu'on donne à une maîtresse, autre celui qu'on donne à un fils; et toutefois ce baiser si chaste et si pur manifeste assez la tendresse d'un père. Aux dieux ne plaise que je condamne à la sécheresse et à la maigreur nos entretiens sur ces grands sujets ; la philosophie ne divorce point avec l'imagination ; mais il ne faut pas dépenser trop de travail en paroles. Il faut avoir pour but essentiel de parler comme on sent, de sentir comme on parle, de faire concorder son langage avec sa conduite. Il a rempli ses engagements celui qui, a le voir et à l'entendre, est toujours le même. Avant de juger quel il est, ce qu'il vaut, voyons s'il est un. Nos discours doivent tendre non à plaire, mais à être utiles. Si pourtant l'éloquence nous vient sans qu'on la cherche trop, si elle s'offre d'elle-même, ou coûte peu, qu'on l'admette, et qu'elle serve d'accompagnement à nos belles doctrines, de telle sorte qu'elle fasse ressortir les choses plutôt qu'elle-même. Il est des arts qui parlent exclusivement à l'esprit : celui-ci est l'affaire de l'âme. Le malade ne cherche pas un médecin qui parle bien, mais qui guérisse : si le hasard veut néanmoins que ce même homme qui sait guérir, discoure avec grâce sur le traitement à suivre, le malade en sera bien aise, mais ne s'estimera pas plus heureux pour lui avoir trouvé ce second talent, aussi peu nécessaire à un médecin qu'une belle figure à un pilote. Pourquoi me vouloir chatouiller et charmer l'oreille? Il s'agit d'autre chose. C'est le fer, c'est le feu, c'est la diète qu'il me faut. Voilà pourquoi tu es mandé : tu as à soigner un mal invétéré, grave, épidémique. Tu n'as pas moins à faire qu'un Hippocrate en temps de peste. Et c'est à peser des mots que tu t'amuses! Trop heureux si tu pouvais suffire aux choses[131]! Quand amasseras-tu les trésors de la science? Quand te l'appliqueras-tu assez intimement pour qu'elle ne puisse t'échapper? Quand la mettras-tu à l'épreuve? Il n'en est pas de celle-ci comme des autres qu'il suffit de confier à sa mémoire : c'est à l'œuvre qu'il faut l'essayer. Ici l'homme heureux n'est pas l'homme qui sait, mais qui pratique. « Mais quoi? N'y a-t-il pas des degrés intermédiaires? Hors de la sagesse, n'y a-t-il plus que précipices? » Non pas, à mon avis : les hommes qui sont en progrès sont encore au nombre des insensés, mais séparés d'eux par un vaste intervalle; et parmi ces premiers même on trouve de grandes différences. Ils se divisent, selon quelques-uns, en trois classes. La première comprend ceux qui n'ont pas encore la sagesse, mais qui déjà ont pris pied dans son voisinage. Toutefois, si près qu'on soit du but, on est en deçà. « Quels sont ces hommes, demandes-tu? » Ceux qui ont déjà dépouillé et passions et vices, qui ont appris à quoi ils doivent s'attacher, mais dont la confiance n'est pas allée jusqu'à l'épreuve et qui n'ont point usé de leur trésor. Néanmoins la situation qu'ils ont fui, ils n'y peuvent plus retomber ; ils en sont à ce point où l'on ne glisse plus en arrière ; mais ce n'est pas encore à leurs yeux chose bien claire, et, comme je me rappelle l'avoir écrit dans une de mes lettres,[132] ils ne savent pas qu'ils savent. Ils jouissent déjà d'un état meilleur, ils n'y ont pas foi encore. Ces hommes en progrès sont désignés par quelques-uns comme ayant échappé aux maladies de l'âme, mais non tout à fait à ses affections, et comme foulant encore une pente glissante, vu que personne n'est en dehors des tentations de la méchanceté, s'il ne s'est entièrement débarrassé d'elle, et que nul ne s'en est débarrassé s'il ne s'est, au lieu d'elle, revêtu de la sagesse. Quelle différence y a-t-il entre les maladies de l'âme et ses affections? Je l'ai souvent énoncé : je veux te le rappeler encore. Ces maladies sont les vices invétérés, endurcis, comme la cupidité, l'ambition excessive : une fois maîtres de l'âme, ils la tiennent enserrée et deviennent ses éternels vautours. Pour les définir brièvement, ces maladies sont les faux préjugés où l'on s'obstine, comme de croire vivement désirable ce qui ne l'est que faiblement ; ou, si tu l'aimes mieux, c'est convoiter trop fort des choses faiblement désirables ou qui ne le sont pas du tout; ou c'est priser trop haut ce qui a peu ou point de prix. Les affections sont des mouvements de l'âme répréhensibles, soudains et impétueux, qui, répétés et négligés, font les maladies ; de même qu'un catarrhe simple, qui n'a point passé à l'état chronique, produit la toux ; et la toux continue et invétérée, la phtisie. Ainsi les âmes qui ont fait le plus de progrès sont hors des maladies, mais ressentent encore des affections, si près qu'elles soient d'être parfaites. A la deuxième classe appartiennent ceux qui se sont délivrés et des plus dangereuses maladies et même des affections, mais qui à cet égard ne possèdent point la pleine sécurité : ils peuvent éprouver des rechutes. La troisième classe a laissé derrière elle des vices graves et nombreux, mais non pas tous les vices ; libre de l'avarice, elle reste sujette à la colère; l'aiguillon de la chair ne la tourmente plus, mais l'ambition ne l'a pas quittée ; elle ne convoite plus, mais elle craint encore ; ces craintes mêmes lui laissent assez de fermeté pour certaines choses, bien qu'elle faiblisse pour d'autres; elle méprise la mort, et la douleur l'épouvante. Une réflexion sur cette dernière classe : estimons-nous bien partagés, si nous y sommes admis. Il faut une riche et heureuse nature, un grand et assidu dévouement à l'étude pour occuper le second rang : mais la troisième nuance n'est pas non plus à dédaigner. Songe et regarde combien d'iniquités t'environnent ; vois s'il est un seul attentat sans exemple ; quels progrès fait chaque jour le génie du mal; que de méfaits politiques et privés ; tu sentiras que pour nous c'est assez faire que de ne pas être parmi les plus corrompus. « Mais j'espère, moi, pouvoir aussi m'élever plus haut. » Je le souhaiterais pour nous plutôt que je ne le promettrais. Le mal en [nous a pris l'avance ; nous marchons à la vertu, empêtrés de mille vices ; j'ai honte de le dire : nous cultivons l'honnête à nos moments perdus. Mais quel magnifique salaire nous est réservé, si nous rompons nos empêchements, nos mauvaises tendances si tenaces! Ni cupidité, ni crainte ne nous feront plus reculer; inébranlables à toutes les alarmes, incorruptibles aux voluptés, nous n'aurons point horreur de la mort, non plus que des dieux ; nous saurons que ni la mort n'est un mal, ni les dieux ne sont méchants. Il y a autant de faiblesse dans l'être qui fait souffrir que dans celui qui[133] souffre : aux êtres bons par excellence le pouvoir de nuire manque. Quel trésor nous attend si, quelque jour, de cette fange nous nous élevons à la hauteur sublime du sage, à cette tranquillité d'âme et, toute erreur bannie, à l'absolue indépendance! « Cette indépendance, quelle est-elle? » Ne craindre ni les hommes ni les dieux, ne vouloir rien de honteux, rien d'immodéré, exercer sans limites la royauté de soi-même. Inestimable bien que celui de s'appartenir! LETTRE LXXVI.Sénèque, quoique vieux, prend encore des leçons. Il prouve de nouveau que l'honnête est le seul bien. N'estimer dans l'homme que son âme.Tu me menaces d'une brouille sérieuse, si je te laisse rien ignorer de ce que je fais journellement. Vois comme j'en use franchement avec toi : quelle confidence je vais te faire! J'assiste aux leçons d'un philosophe,[134] et voilà cinq jours que je vais à son école où dès la huitième heure[135] je l'entends discuter. « Bel âge pour s'instruire! diras-tu. Pourquoi non? N'est-ce pas le comble de la sottise que de s'autoriser d'avoir été longtemps sans apprendre, pour n'apprendre plus? Qu'est-ce à dire? Me faut-il vivre en petit-maître, en jeune homme? Ah! je bénis ma vieillesse, si telle est la seule inconvenance qu'on lui reproche. Cette école est faite pour les hommes de tout âge : allons-y, nous autres vieillards, et les jeunes gens suivront. Quoi! j'irai au théâtre en cheveux blancs; je me ferai porter au cirque ; pas un combat de gladiateurs ne se donnera sans moi, et je rougirais d'aller entendre un philosophe! Il faut apprendre tant que l'on ignore; et, si j'en crois le proverbe, tant qu'on est en ce monde : proverbe qui ne s'applique à nulle autre chose mieux qu'à la philosophie ; il faut apprendre l'art de vivre aussi longtemps que dure la vie. D'ailleurs, moi aussi j'enseigne quelque chose en cette école. « Quoi? » diras-tu. Que le vieillard même doit apprendre.[136] Je rougis pour l'espèce humaine chaque fois que j'entre dans l'école de Métronacte. Il faut, pour y arriver, passer, comme tu sais, devant le théâtre napolitain, toujours encombré. Là on discute, avec une extrême chaleur, la supériorité d'un joueur de flûte : on fait foule autour d'un trompette grec ou d'un héraut qui proclame le vainqueur. Et ces bancs devant lesquels on recherche quel est l'homme vertueux, où l'on apprend à l'être, sont presque déserts. Ceux qu'on y voit passent dans le monde pour n'avoir rien de bon à faire : on les traite d'imbéciles et de fainéants. J'envie ces titres de dérision : écoutons sans nous émouvoir les sarcasmes de l'ignorance ; qui marche vers l'honnête doit mépriser tous ces mépris-là.[137] Poursuis, Lucilius, et hâte-toi : qu'il ne t'arrive pas, comme à moi, d'attendre si tard pour t'instruire ; hâte-toi même d'autant plus que l'étude entreprise par toi ne s'achèvera qu'à peine sur tes vieux jours. « Combien y ferai-je de progrès? » dis-tu. Autant que tu feras d'efforts. Qu'attends-tu? La sagesse n'est pour personne un don du hasard. L'argent peut venir de lui-même, les honneurs t'être déférés, la faveur et les dignités se jeter à ta tête ; la vertu ne tombera pas sur toi à l'improviste ; ce n'est pas au prix d'une légère peine, d'un mince travail qu'on la connaîtra ; mais est-ce trop qu'un labeur sérieux pour entrer en possession de tous les biens à la fois? Car le bien dans son unité c'est l'honnête ; tu ne peux trouver rien de vrai, rien de sûr dans tout ce qui séduit l'opinion. Etablissons pourquoi l'unique bien est l'honnête, puisque tu juges que ma précédente lettre ne l'a point assez expliqué, et que je te semble avoir fait plutôt un éloge qu'une démonstration : puis je résumerai en peu de mots ce que j'aurai dit. Toute chose a son mérite propre et constitutif : la vigne se recommande par sa fertilité et par la saveur de son vin, le cerf par sa vitesse. Veux-tu savoir pourquoi la force des bêtes de somme est dans les reins? Parce qu'elles ne sont bonnes qu'à porter des fardeaux. La première qualité dans un chien est la finesse de l'odorat, s'il doit aller enquête du gibier; l'agilité, s'il doit le poursuivre ; la hardiesse, s'il est fait pour mordre et attaquer. Ce que chaque être doit avoir de meilleur en soi, c'est l'aptitude pour laquelle il est né, qui lui donne son rang. Quelle est dans l'homme la meilleure chose? La raison : par elle il marche roi des animaux, il vient après les dieux. Cette raison perfectionnée est donc le bien propre de l'homme : tout le reste lui est commun avec les brutes et les plantes. Il est fort? le lion ne l'est-il pas? il a la beauté? le paon a la sienne. Il est prompt à la course, le cheval aussi. J'omets de dire : sous ces trois rapports il est inférieur. Je ne cherche point en quoi il excelle, mais ce qu'il possède seul. Il a un corps : les arbres en ont un. Il a des élans, des mouvements volontaires : de même la bête, et le vermisseau. Il a une voix : mais combien le chien l'a plus éclatante, l'aigle plus perçante, le taureau plus grave, le rossignol plus douce et plus flexible! Quel est le privilège de l'homme? La raison. Quand cette raison a toute sa rectitude, quand elle est consommée, la félicité humaine est complète. Si donc tout bien, perfectionné dans son essence, est digne d'éloge, est parvenu aux fins de sa nature, et si la raison est le bien de l'homme, l'homme est louable quand il l'a perfectionnée, quand il a satisfait à sa vocation ici-bas. Cette raison parfaite, on l'appelle vertu, ou, ce qui est même chose, l'honnête. Le seul mérite qui soit en l'homme est donc celui qui seul vient de l'homme : car nous ne cherchons pas maintenant ce que c'est que le bien, mais ce que c'est que le bien de l'homme. Si ce n'est pas autre chose que la raison, elle sera pour lui l'unique bien, mais qui compensera tous les biens du monde. L'homme méchant sans doute sera désapprouvé; bon, on l'approuvera; donc le premier, le seul bien de l'homme est ce par quoi on l'approuve ou le désapprouve. Tu ne doutes pas que ce ne soit un bien, tu doutes que ce soit le seul. Qu'un homme possède tous les autres avantages, santé, richesse, nombreuses images d'ancêtres, vestibule encombré de cliente, mais qu'on le reconnaisse pour malhonnête homme, il sera condamné par toi. Qu'un autre, n'ayant rien de ce que je viens d'énumérer, se trouve dénué de fortune, de clients, de noblesse, d'une longue série d'aïeux et de bisaïeux, mais que la voix publique le proclame vertueux, tu l'estimeras. Partant le seul vrai bien est celui qui rend louable son possesseur, abandonné même de tout le reste, et qui appelle sur ceux qui ne l'ont pas, fussent-ils comblés de tous les autres biens, la réprobation et le mépris. Il en est des hommes comme des choses. On entend par un bon navire non celui qui est peint de riches couleurs, ou dont la proue est d'or ou d'argent, et la divinité tutélaire sculptée en ivoire, ou qui porte l'argent du fisc et les trésors des rois, mais celui qui, ferme et solide, bien calfeutré contre les infiltrations de l'onde, assez fort pour rompre le choc des vagues, est docile au gouvernail, bon voilier, et garde au vent[138] son équilibre. L'épée que tu juges bonne n'est pas celle qui pend à un baudrier doré, ni dont le fourreau est constellé de pierres précieuses ; c'est celle qui pour frapper a le tranchant bien affilé et dont la pointe percerait les plus dures cuirasses. On ne s'enquiert pas si une règle est plus ou moins belle, mais si elle est bien droite. Toute chose se prise en raison de sa destination, de la propriété qu'elle a. Ainsi, dans l'homme, il n'importe ce qu'il exploite d'arpents et de capitaux, combien de saluts il recueille, quel est le haut prix de son lit de table, le transparent de son vase à boire : combien est-il bon, voilà ce qui importe ; or il est bon, si sa raison est développée dans toute sa rectitude et selon ce que veut de lui sa nature. Voilà ce qu'on nomme vertu, voilà l'honnête, et l'unique bien de l'homme. Car la raison seule nous rendant parfaits, la raison parfaite nous rend seule heureux ; par conséquent l'unique bien de l'homme est ce qui seul fait son bonheur. Nous donnons aussi le nom de biens à tout ce qui émane de la vertu et en porte le cachet, en un mot à toutes ses œuvres. Mais elle est elle-même l'unique bien à ce titre qu'il n'en existe aucun sans elle. Si tout bien réside dans l'âme, tout ce qui la fortifie, l'élève, l'agrandit est bien ; or qui rend l'âme forte, élevée, grande, sinon la vertu? Tout autre mobile, en excitant nos passions, abaisse en revanche et énerve l'âme, et, lorsqu'il semble la rehausser, la gonfle de mille chimères qui l'abusent. Il n'est donc qu'un vrai bien, celui qui améliore l'âme. Toutes les actions de la vie se règlent sur la considération de l'honneur ou de la honte qui en résulte ; c'est par là qu'on se détermine à faire ou à ne pas faire. Développons cette pensée. Ce que l'homme de bien croira qu'il est honnête de faire, il le fera, si pénible que ce soit ; il le fera, même à son détriment ; il le fera, quand il y aurait danger pour lui. Mais une chose honteuse, il ne la fera jamais, dût-elle lui valoir richesses, plaisir, pouvoir. Nulle crainte ne le détournera de l'honnête, nul espoir ne l'engagera dans la honte. Si donc on le voit suivre à tout prix l'honnête, fuir à tout prix ce qui ne l'est pas, et dans tous les actes de sa vie n'envisager que deux seuls points, à savoir qu'il n'est d'autre bien que l'honnête et d'autre mal que son contraire; si la vertu est la seule chose qui ne se fausse point, qui garde toujours sa même rectitude, il n'est dès lors de bien que la vertu : il ne peut arriver qu'elle cesse de l'être ; elle ne court plus risque de changer. L'erreur gravit vers la sagesse ; la sagesse ne retombe point dans l'erreur. J'ai dit, tu te le rappelles peut-être, que dans un élan indélibéré grand nombre d'hommes ont foulé aux pieds ce qu'ambitionne et ce que redoute le vulgaire. Il s'en est trouvé qui plongèrent leur main dans les flammes, ou dont le bourreau ne put interrompre les rires; d'autres, aux funérailles de leurs fils, n'ont pas versé une larme ; d'autres ont couru d'un pas intrépide au-devant de la mort. L'amour, la colère, la cupidité ont appelé de tous leurs vœux le péril. Ce que peut un entêtement passager, poussé par un mobile quelconque, combien la vertu ne le peut-elle pas davantage, elle qui ne va point par élan, par saillie, mais qui est soutenue dans son action, permanente dans son énergie! Il s'ensuit que des choses méprisées souvent par des gens sans lumières, toujours par le sage, ne sont ni des biens ni des maux ; et que l'unique bien, c'est cette même vertu qui marche tête haute entre l'une et l'autre fortune avec grand mépris pour toutes deux. Si tu admets l'opinion qu'il est encore d'autre bien que l'honnête, plus de vertu qui n'en soit ébranlée ; pas une en effet qui se puisse maintenir, si elle aspire, en dehors d'elle-même, à quoi que ce soit. Cet état de choses répugne à la raison, de laquelle les vertus procèdent, à la vérité, qui n'existe point sans la raison ; et toute opinion qui répugne à la vérité est fausse. Tu m'accorderas nécessairement que le dévouement de l'homme de bien envers les dieux est absolu : ainsi, quoiqu'il lui arrive, il le supportera sans murmure, sachant bien qu'ainsi l'a voulu la loi divine d'après laquelle marche l'univers. Cela étant, il n'y aura pour lui d'autre bien que l'honnête; car l'honnête a pour loi d'obéir aux dieux, de ne pas s'indigner des coups imprévus, de ne pas déplorer son sort, mais d'en subir patiemment la nécessité et de satisfaire aux ordres d'en haut. Si en effet il était d'autre bien que l'honnête, il s'ensuivrait pour nous un amour effréné de la vie et de tout ce qui fait le matériel de la vie, passion intolérable, illimitée, jamais stable. Le seul bien est donc l'honnête, dont la limite est fixe. Nous avons dit que les hommes vivraient plus heureux que les dieux, si les choses dont l'usage est étranger aux dieux étaient des biens, par exemple l'argent, les honneurs. Ajoute que, si toutefois l'âme dégagée du corps lui survit, son nouvel état est plus heureux que le premier qui la tenait plongée dans la matière. Or, dans le système où les choses dont le corps fait usage seraient des biens, l'âme séparée du corps y perdrait ; et il est contre la vraisemblance qu'une âme libre, en possession de l'immensité, perde à ne plus être close et investie dans sa prison. Si ce sont des biens, avais-je dit en outre, que ces avantages dont la brute jouit ainsi que l'homme, la brute aussi possède la vie heureuse, ce qui de tout point est impossible. Il n'est rien que pour l'honnête on ne doive souffrir : le devrait-on, s'il y avait d'autre bien que l'honnête? Ce que j'avais développé plus au long dans ma précédente lettre, le voilà en raccourci et dans un rapide exposé. Mais jamais tu n'admettras une pareille doctrine comme vraie, qu'en exaltant ton âme, qu'en t'interrogeant de la sorte : « Si le danger de la patrie exige que je meure pour elle et que je rachète le salut de tous par mon sang, présenterai-je la tête, non seulement avec résignation, mais encore avec joie? » Si tu es prêta le faire, c'est qu'il n'est point d'autre bien que l'honnête : tu quittes tout pour le posséder. Vois jusqu'où va sa puissance. Tu vas mourir pour la patrie, et, s'il le faut, à l'instant même, dès que tu sauras qu'il le faut. Cet acte sublime t'abreuve en un instant court et fugitif d'une immense félicité ; et bien que, chez les morts et notre rôle achevé sur la terre, on ne recueille aucun fruit de son sacrifice, la perspective du bien qu'il produira te comble de joie. Oui, l'homme de cœur, le juste, qui se représente comme prix de son trépas la liberté de son pays, le salut de tous ceux pour lesquels il s'immole, cet homme jouit d'une volupté suprême, et ses périls sont des délices. Et dût-on lui ravir cette grande et dernier» satisfaction que donne l'accomplissement d'une telle œuvre, il n'hésiterait pas à se précipiter dans la mort, heureux de son noble et pieux dévouement. Oppose-lui mille raisons pour retenir son élan, dis-lui : « Ton action sera suivie d'un prompt oubli, de la froideur, de l'ingratitude de la cité. — Tout cela, répondra-t-il, est en dehors de ce que je vais faire ; je vois mon acte en soi, ma conscience me dit qu'il est beau : quelque part qu'elle me guide et m'appelle, je la suis. » L'unique bien est d'une nature telle qu'il se fait sentir non seulement aux âmes parfaites, mais aux cœurs nobles par nature et bien doués ; tous les autres biens sont choses légères et changeantes. Aussi les possède-t-on avec anxiété : si haut que les entasse sur une même tête la bienveillance du sort, c'est pour leur maître une lourde charge, embarrassante toujours, parfois même écrasante. De tous ces hommes que tu vois éclatants de pourpre, pas un n'est heureux, non plus que ces princes de théâtre pour qui le sceptre et la chlamyde sont un attribut de leur rôle, et qui après avoir étalé en public leur haute stature et leurs cothurnes, à peine sortis de la scène se déchaussent et redescendent à leur taille naturelle. Non, de tous ces personnages guindés bien haut sur un échafaudage d'honneurs et de richesses, pas un n'est grand. Pourquoi donc le paraissent-ils? Tu mesures base et statue ensemble. Un nain sera toujours petit, eût-il une montagne pour piédestal, et un colosse toujours grand, fût-il descendu dans un puits. L'erreur dont nous souffrons, qui nous fascine, c'est que nous ne prisons jamais l'homme pour ce qu'il est ; nous ajoutons à la personne son entourage. Et pourtant, si l'on veut rechercher son vrai prix et savoir quel il est, c'est à nu qu'il faut l'examiner. Qu'il dépose devant toi ce patrimoine, ces honneurs et tous ces autres mensonges de la Fortune;[139] dépouille-le même de son corps, n'envisage que son âme, ce qu'elle est, tout ce qu'elle est, si sa grandeur est personnelle ou d'emprunt. Voit-il sans baisser la paupière les glaives étin-celants ; sait-il qu'il ne lui importe en rien que sa vie s'exhale de ses lèvres ou par sa gorge entr'ouverte, donne-lui le nom d'heureux ; donne-le-lui si à la menace de tortures physiques, de rigueurs du sort, d'iniquités d'un homme puissant, si en présence des chaînes, de l'exil, de tous les fantômes dont s'épouvantent nos imaginations, il demeure impassible et dit : Nul péril à ma vue ne présente, ô prêtresse, une face imprévue : J'ai tout pesé d'avance et je suis préparé.[140] « Ces menaces que tu me fais aujourd'hui, je me les suis faites en tous temps : homme, je me tiens prêt aux accidents de l'humanité. » D'un mal prévu le choc ne vient plus qu'amorti. Mais pour les âmes irréfléchies et qui ont foi en la Fortune, tous les événements ont une face nouvelle et inopinée ; et la nouveauté, chez ces sortes de gens, fait presque tout le mal. Vois pour preuve comme l'habitude leur donne le courage d'endurer ce qu'ils croyaient insupportable. C'est pourquoi le sage s'aguerrit contre les maux à venir ; et ce que les autres ne trouvent léger qu'après de longues souffrances, lui le rend tel en y pensant longtemps. On entend parfois cette exclamation échappée aux imprévoyants : « Pouvais-je me douter que ce coup m'attendait? » Mieux instruit, le sage les attend tous: quoi qu'il advienne, il dit : « Je le savais. » LETTRE LXXVII.La flotte d'Alexandrie. Mort volontaire de Marcellus.Juger d'une vie par son dénouement.Aujourd'hui, à l'improviste, nous avons vu paraître les navires d'Alexandrie,[141] qu'on dépêche toujours en avant pour annoncer la flotte qui doit les suivre. On les nomme tabellaires. Leur vue est une fête pour la Campanie : la population de Pouzzoles est toute sur les jetées et reconnaît à la forme des voiles, parmi une foule d'autres navires, les Alexandrins : car ils ont seuls le droit d'arborer la voile de perroquet, le siparum, dont les autres ne font usage qu'en pleine mer. Rien en effet ne facilite la course comme les hautes voiles : c'est de là que le bâtiment reçoit sa plus forte impulsion. Aussi, quand le vent augmente et devient plus grand qu'il ne faut, on baisse l'antenne : le souffle a moins de force quand il donne par le bas. Lorsque les vaisseaux sont dans les eaux de Caprée et de l'orageux promontoire D'où Pallas voit au loin les flots se balancer, la règle est qu'ils se contentent de la grande voile; ceux d'Alexandrie ont seuls le siparum pour insigne. Tandis que de divers points tout le monde courait au rivage, je me suis senti vraiment heureux de ma paresse. Au moment de recevoir des lettres de mes correspondants, je ne me suis point hâté de savoir en quel état se trouvaient mes affaires,[142] quelles nouvelles m'arrivaient. Depuis longtemps pertes et gains me sont étrangers. Je devrais prendre ainsi les choses, quand même je ne serais pas vieux, à plus forte raison dans un âge où, si peu que je posséderais, il me resterait plus de provisions que de chemin à faire, surtout quand celui où nous sommes entrés n'exige pas qu'on aille jusqu'au bout. Un voyage est inachevé si l'on s'arrête à mi-chemin ou en deçà du terme où l'on tend; là vie n'est point inachevée, si elle est honnête. N'importe où elle finit, si elle finit bien, elle est complète. Mais souvent il faut avoir le courage de finir, même sans motifs bien puissants ; sont-ils bien puissants ceux qui nous retiennent? Tullius Marcellinus,[143] que tu as très bien connu, paisible jeune homme et vieux de bonne heure, frappé d'une maladie qui, sans être incurable, devenait longue, assujettissante, exigeante, s'est avisé de délibérer s'il se ferait mourir. Ses amis convoqués vinrent en foule. Les pusillanimes lui donnaient le conseil qu'eux-mêmes se seraient donné; les autres, flatteurs et complaisants, opinaient dans le sens qu'ils présumaient lui devoir agréer le plus. Un stoïcien de nos amis, personnage d'un rare mérite, et, pour faire en deux mots son digne éloge, homme ferme et d'un vrai courage, lui adressa, selon moi, la plus belle des exhortations. Il débuta ainsi : « Mon cher Marcellinus, ne te mets pas l'esprit à la torture, comme s'il s'agissait d'une bien grande affaire. Ce n'est pas une chose si importante que de vivre : tous tes esclaves, tous les animaux vivent; l'important est de mourir noblement, en sage, en homme de cœur. Songe que de temps passé à ne faire que la même chose : la table, le sommeil, les femmes, voilà le cercle où roule la vie.[144] Et on peut vouloir mourir sans avoir grande sagesse ni grand courage, ou sans être fort malheureux; il suffit qu'on s'ennuie de vivre. » Marcellinus n'avait pas besoin qu'on l'excitât, mais qu'on l'aidât à mourir, en quoi ses esclaves lui refusaient l'obéissance.[145] Le stoïcien commença par dissiper leurs craintes, en leur apprenant que des esclaves ne couraient de risque qu'autant qu'il ne serait point certain que la mort du maître eût été volontaire; que d'ailleurs il était d'aussi mauvais exemple d'empêcher son maître de mourir que de l'assassiner.[146] Puis il rappelle à Marcellinus qu'il ne serait pas mal, tout comme au sortir de la table on partage la desserte aux valets qui l'entourent, de faire en sortant de ce monde quelque don à ceux qui avaient été les serviteurs de toute sa vie. Marcellinus était facile et libéral, au temps même où c'était encore du sien qu'il donnait. Il distribua de légères sommes à ses esclaves en pleurs, qu'il prenait lui-même soin de consoler. Il n'eut pas besoin de fer, d'effusion de sang : il s'abstint trois jours de nourriture. Il fit dresser dans sa chambre une tente à baignoire ; puis on apporta la baignoire même où il resta longtemps couché. L'eau chaude qu'on y versait de temps à autre le fit insensiblement défaillir, et cela, comme il disait, non sans une certaine jouissance que procure d'ordinaire ce doux anéantissement bien connu de moi, qui ai plus d'une fois perdu connaissance.[147] Je me suis laissé aller à ce récit qui t'intéressera sans doute : tu y verras comment a fini ton ami, sans agonie, et sans souffrir. Car bien qu'il l'eût provoquée, il est entré mollement dans la mort : il a glissé hors de cette vie. Ce récit d'ailleurs peut ne pas être inutile : souvent la nécessité nous appelle à donner de pareils exemples. Souvent le devoir nous dit de mourir, et nous résistons ; la nature nous y force, et nous résistons. Nul n'est stupide au point d'ignorer qu'il doit un jour cesser d'être ; pourtant, approche-t-il de ce jour, il tergiverse, il tremble, il gémit. Ne te semblerait-il point le plus fou des hommes, celui qui pleurerait de n'être pas au monde depuis mille ans? Non moins fou est celui qui pleure parce que dans mille ans il n'y sera plus. N'être plus, n'avoir pas été, n'est-ce point même chose? Ni l'une ni l'autre époque ne t'appartiennent. Jeté sur un point du temps, quand tu pourrais l'étendre ce point, jusqu'où l'étendras-tu? Pourquoi ces pleurs, ces souhaits? Peine perdue! N'espère rien du sort : il est sourd aux prières.[148] Tout est réglé sans retour, et tout marche d'après la grande et éternelle loi de fatalité. Tu iras où vont toutes choses. Est-ce donc pour toi une condition nouvelle? C'est celle de ta naissance ; c'a été le sort de ton père, de ta mère, de tes aïeux, de tous ceux qui t'ont précédé comme de tous ceux qui te suivront. Une chaîne indissoluble, où nul effort ne peut rien changer, embrasse et traîne tout avec elle. Que de morts ont peuplé les tombeaux avant toi! Combien s'y acheminent derrière toi! Combien y entreront avec toi! Tu serais, j'imagine, plus résolu, si tu mourais de compagnie avec plusieurs milliers d'hommes. Eh bien, des milliers d'hommes et d'animaux, en ce moment même où tu hésites à mourir, exhalent leurs vies de diverses manières. Et toi seul ne pensais pas qu'enfin tu arriverais où tu n'as cessé de tendre? Point de chemin qui n'aboutisse. Tu crois qu'ici je vais rapporter des exemples de grands hommes! Ce sont des enfants que je te veux citer. On nous a transmis le souvenir de ce Spartiate encore impubère qui, fait prisonnier, criait dans son dialecte dorien : « Non, je ne servirai pas! » et l'effet répondit à la parole. A la première chose servile et dégradante qui lui fut commandée (il s'agissait d'apporter un vase destiné à d'ignobles besoins), il se brisa la tête contre la muraille. La liberté est st près de nous! Et des hommes consentent à servir! Ne voudrais-tu pas voir ton fils plutôt périr ainsi que ramper lâchement pour vieillir? Pourquoi donc tant d'angoisses, quand une mort courageuse est l'acte d'un enfant? Si tu ne veux pas suivre, tu seras entraîné. Empare-toi des droits qu'a sur toi l'extérieur. N'auras-tu pas, comme cet enfant, le cœur de dire : Je ne suis plus esclave? » Hélas! tu es esclave des hommes, esclave des choses, esclave de la vie : car la vie, pour qui n'ose mourir, est un esclavage. Et qu'as-tu qui t'oblige d'attendre? Les plaisirs qui t'arrêtent, qui te retiennent, tu les as épuisés. Il n'en est plus qui soit nouveau pour toi, plus qui ne te rebute par la satiété même. La saveur du vin pur, du vin miellé, tu les connais : qu'importe que cent ou mille amphores passent par ta vessie? Tu n'es qu'un filtre à liqueurs. Blasée sur la délicatesse des coquillages, du rouget, ta soif de jouir ne t'a pas laissé pour l'avenir une seule fleur qui ne soit fanée.[149] Voilà pourtant à quoi tu as tant de peine à t'arracher. Qu'y a-t-il encore dont il te fâche d'être privé? Tes amis? Ta patrie? Pour l'amour d'elle, dis-moi, retarderais-tu ton souper, toi qui pour l'avancer éteindrais, si tu pouvais, le soleil? Car qu'as-tu jamais fait qui soit digne de la lumière? Confesse que ce n'est ni le sénat, ni le forum, ni même cette belle nature que tu regrettes, qui te rendent si lent à mourir : tu gémis de laisser à d'autres le marché aux vivres, où tu n'as rien laissé. Tu crains la mort! Et tu la braves si bien au sein de tes orgies! Tu veux vivre! Tu sais donc comment on doit vivre? Tu crains de mourir! Eh! ta vie n'est-elle, pas une vraie mort? Un jour que César traversait la voie Latine, il rencontra la chaîne des forçats, et l'un d'eux, vieillard dont la barbe descendait jusque sur la poitrine, lui demanda la grâce de mourir: Est-ce que tu vis? répondit Caïus. C'est la réponse à faire à tous ceux pour qui la mort serait un bienfait. Tu crains de mourir! Est-ce que tu vis? « Mais, diras-tu, je veux vivre, moi qui fais si bien ma tâche d'honnête homme : je quitte à regret des devoirs que je remplis avec conscience et avec zèle. » Quoi! ne sais-tu pas que mourir est aussi un des devoirs de la vie? Tes devoirs! auquel renonces-tu? Le chiffre ici n'est pas certain, le cercle à remplir bien précis. Point de vie qui ne soit courte? Comparée à la durée de l'univers, celles de Nestor et de Statilia ont fini trop tôt, de Statilia qui fit graver sur son tombeau qu'elle avait vécu quatre-vingt-dix-neuf ans. Admire la sotte vanité de cette vieille, et à quel degré plus choquant ne l'eût-elle pas poussée, s'il lui eût été donné de parfaire la centaine? Il en est de la vie comme d'un drame, où ce n'est pas la durée, mais la bonne conduite qui importe. Il est indifférent que tu finisses à tel ou tel point. Finis où tu voudras : seulement que le dénotaient soit bon.[150] LETTRE LXXVIII.Le mépris de la mort, remède à tous les maux.L'opinion, mesure des biens et des maux.Les catarrhes fréquents qui te tourmentent et tes petits accès de fièvre qu'amène le prolongement de ces affections devenues chroniques me chagrinent d'autant plus que j'ai éprouvé ce genre de mal. Dans le principe je n'en ai pas tenu compte : jeune encore, je pouvais supporter de pareilles atteintes et bravement tenir tête aux maladies. J'ai fini par être le moins fort, et j'ai vu se fondre jusqu'à mon corps réduit à une extrême maigreur. J'ai pris mainte fois le brusque parti de rompre avec la vie ; je fus retenu par la vieillesse du plus tendre des pères. Je calculai non pas combien j'avais de courage pour mourir, mais le peu qu'il en aurait pour supporter ma perte. Et je m'imposai la loi de vivre, ce qui souvent aussi est un acte de courage. Quelles furent alors mes consolations? Tu vas le savoir ; mais apprends d'abord que ces principes mêmes de résignation furent pour moi comme un remède souverain. Il est de hautes consolations qui arrivent à nous guérir ; et tout ce qui relève le moral est salutaire même au physique. Nos études m'ont sauvé ; je reporte à la philosophie l'honneur de mon rétablissement, du retour de mes forces : je lui dois la vie, et c'est la moindre de mes dettes envers elle. Ce qui n'a pas peu contribué à ma guérison ce sont mes amis, dont les exhortations, les veilles, les entretiens me soulageaient. Oui, mon excellent Lucilius, rien ne ranime et ne réconforte un malade comme l'affection de ses amis, rien ne le dérobe mieux à l'attente et aux terreurs de la mort. Je ne m'imaginais pas mourir en les laissant après moi : il me semblait, en vérité, que j'allais vivre en eux, sinon avec eux ; je ne croyais pas rendre l'âme, mais la leur transmettre. Voilà où j'ai puisé la volonté de m'aider moi-même, et d'endurer toute espèce de souffrance; autrement, c'est une grande misère, quand on a repoussé la résolution de mourir, de n'avoir pas le courage de vivre. Fais appel à ces mêmes remèdes. Le médecin te prescrira la mesure des promenades et des exercices : « Ne cédez pas, dira-t-il, à cette propension au rien faire vers lequel incline une santé languissante ; lisez à haute voix, exercez cette respiration dont les voies et le réservoir sont embarrassés ; montez sur un navire dont le doux balancement secouera vos viscères ; prenez telle nourriture ; ayez recours au vin, comme fortifiant ; suspendez-en l'usage, s'il peut irriter et aigrir votre toux. » Ce que je te prescris, moi, c'est le spécifique non seulement de ton mal actuel, mais de la vie entière, le mépris de la mort. Rien n'est pénible pour qui a cessé de la craindre. Trois choses dans toute maladie sont amères : crainte de la mort, douleur physique, interruption des plaisirs. J'en ai dit assez sur la mort ; n'ajoutons qu'un mot : ici ce n'est pas la maladie, c'est la nature qui craint. Que de gens dont la maladie a reculé la mort et dont le salut a tenu à ce qu'on les croyait mourants[151]! Tu mourras, non parce que tu es malade, mais parce que tu vis. Cette crise t'attend, même en santé : que tu guérisses, tu n'y échapperas point ; tu ne te sauveras que de la maladie. Quant à l'inconvénient d'être malade, sans doute de grandes souffrances accompagnent cet état ; mais, grâce aux intermittences, elles sont supportables : l'extrême intensité de la douleur en amène le terme. Nul ne peut souffrir avec violence et longtemps : la nature, en mère tendre, nous a conformés de telle sorte que la douleur ou nous fût supportable ou passât vite. Les plus violentes ont pour siège les parties les moins charnues du corps, les nerfs, les articulations : tout ce qu'il y a de tenu dans l'homme donne prise aux atteintes les plus vives, parce.que le mal y est à l'étroit. Mais ces mêmes parties s'engourdissent promptement : à force de douleur l'aiguillon douloureux se brise, soit que l'esprit vital, entravé dans son cours naturel, dégénère et perde cette vigueur agissante qui avertit nos sens ; soit que l'humeur viciée, n'ayant plus où s'épandre, se refoule sur elle-même, et frappe d'insensibilité les organes où elle afflue. La goutte aux pieds ou aux mains et toutes les douleurs des vertèbres et des nerfs ont des intervalles de repos, quand la partie torturée ne réagit plus : les premiers élancements causent un vif malaise qui, en se prolongeant, s'amortit, et la souffrance s'arrête à l'engourdissement. Les dents, les yeux, les oreilles sont le siège d'affections d'autant plus aiguës qu'elles naissent sur les points les moins étendus de notre corps ; il en est de même, certes, pour les maux de tête ; mais plus ils sont vifs, plus tôt l'insensibilité et l'assoupissement leur succèdent. Ce qui donc doit consoler dans les grandes souffrances, c'est que nécessairement la sensation cesse dès qu'elle est trop poignante. Mais pourquoi les douleurs physiques sont-elles si importunes au grossier vulgaire? C'est qu'il n'est point fait aux méditations de l'esprit; c'est qu'il a trop donné au corps. Aussi l'homme dont le cœur et les vues sont élevés tient-il son âme indépendante du corps : il cultive surtout la meilleure, la divine partie de lui-même; pour l'autre, quinteuse et fragile, il ne compte avec elle que le moins possible. « Mais il en coûte d'être sevré de ses plaisirs habituels, de s'abstenir de nourriture, de souffrir la soif et la faim! » Les premiers jours de privation sont durs : mais les désirs vont ensuite s'émoussant, à mesure que les organes de ces mêmes désirs se lassent et s'affaiblissent. De là les susceptibilités de l'estomac ; de là l'antipathie pour les choses dont on fut avide ; de là la mort même des désirs. Or qu'y a-t-il de pénible à n'avoir pas ce qu'on ne désire plus? Et puis toute douleur a ses heures de relâche ou du moins ses adoucissements. Et puis on peut et en prévenir la venue et en repousser l'approche par des préservatifs; car toujours elle est précédée de symptômes, surtout celles qui reviennent habituellement. Les souffrances de la maladie sont supportables pour qui brave sa suprême menace. Ne va pas toi-même aggraver tes maux et t'achever par tes plaintes. Ils pèseront peu, si l'opinion n'y ajoute point; et surtout si l'on s'encourage en disant : Ce n'est rien, ou du moins : C’est peu de chose, sachons l'endurer, cela va finir; tu rends le mal léger en le jugeant tel. Tout dépend de l'opinion : l'ambition, la mollesse, la cupidité ne sont pas seules à se régler sur elle : l'opinion est la mesure de nos douleurs ; on est misérable en proportion de ce qu'on croit l'être. Je voudrais qu'on renonçât à se lamenter sur des souffrances qui sont déjà loin; point de ces exclamations: « Jamais homme ne fut plus malheureux! Quels tourments, quels supplices j'ai endurés! Personne n'eût cru que j'y survivrais! Que de fois les miens m'ont pleuré comme mort! Que de fois les médecins m'ont abandonné! Ceux qu'on lie au chevalet ne sont pas torturés de la sorte! » Tout cela fût-il vrai, c'est chose passée.[152] Que sert de remanier des plaies qui sont fermées, et d'être malheureux parce qu'on l'a été jadis? Et quelle est cette manie qu'a tout homme d'exagérer ses misères et de se mentir à lui-même? Puis on aime à raconter ses peines; il est naturel qu'on se réjouisse de la fin de ses maux. Loin de nous donc tout à la fois et la crainte de l'avenir, et les retours sur un passé désagréable ; celui-ci ne m'est plus rien, l'autre ne me touche pas encore. Au sein même des crises les plus difficiles, que l'homme se dise : Ces souvenirs un jour peut-être auront leurs charmes[153]! Qu'il lutte de tout son courage contre la douleur : il sera vaincu, pour peu qu'il lui cède ; il la vaincra, s'il se roidit contre elle. Mais que font la plupart des hommes? Ils attirent sur eux la chute du fardeau qu'ils devraient soutenir. Cette masse qui est tout proche, qui descend, qui déjà te pèse, si tu veux t'y soustraire te suit et croule plus accablante encore ; tiens ferme et redouble d'efforts, tu la repousseras. Que de rudes coups l'athlète n'essuie-t-il pas sur le visage et surtout le corps! Point de tourment toutefois qu'il n'endure par amour de la gloire, et qu'il n'endure non seulement parce qu'il combat, mais pour combattre : ses exercices sont déjà des tourments. Nous aussi sachons tout surmonter : nous aurons pour prix, non point une couronne, une palme, ou le son de la trompette commandant le silence pour qu'on proclame notre nom, mais la vertu, et la fermeté de l'Ame et la paix du reste de nos jours, si une fois, dans quel· que rencontre, nous avons mis la Fortune hors de combat. « Mais je sens de cruelles douleurs! » Qu'est-ce à dire? Les sens-tu moins quand tu les supportes en femme? De même que l'ennemi est surtout fatal aux fuyards; ainsi les désagréments de l'extérieur · harcèlent bien plus quiconque veut s'y dérober et tourner le dos. « Mais la charge est lourde! » Eh! n'avons-nous reçu la force que pour de légers fardeaux? Lequel préfères-tu, que la maladie soit longue, ou qu'elle soit violente et courte? Longue, tu as du relâche, elle donne moyen de respirer, de longs moments où elle fait grâce : il lui faut ses heures d'irritation et de calme. Une maladie courte et précipitée s'éteindra d'elle-même ou elle m'éteindra. Or où est la différence, qu'elle finisse ou que je finisse? Dans les deux cas plus de souffrance. Tu te trouveras bien aussi de distraire ton esprit vers d'autres pensées et de l'enlever à celle de la douleur. Rappelle-toi tout ce que tu as fait d'honorable et de courageux : considère les beaux cotés du rôle humain, promène tes souvenirs sur les grands traits qui ont le plus excité ton admiration. Evoque ces hommes intrépides qui triomphèrent de la douleur, celui qui pendant que l'on incisait ses varices n'en poursuivait pas moins sa lecture ; celui qui ne cessa pas de rire, alors qu'irrités par là même les bourreaux épuisaient sur lui tous les raffinements de la cruauté. La raison ne vaincra-t-elle pas la douleur que le rire a vaincu? Cite-moi telle affection que tu voudras, catarrhe, toux violente et continue qui arrache les poumons par lambeaux, fièvre qui dévore les entrailles, tourments de la soif, membres distordus par le mal qui en déjette les articulations ; ce qui est pire, c'est la flamme des tortures, le chevalet, les lames ardentes, et le fer enfoncé dans la tumeur même de la plaie pour la raviver, pour creuser encore plus avant. Au milieu pourtant de tous ces supplices, tel homme a pu ne point gémir, que dis-je? ne point supplier, ne rien répondre : il a pu rire et rire franchement.[154] Et tu n'oserais pas, après cela, te railler de la douleur? c Mais la maladie ne me permet de rien faire, de vaquer à aucun devoir. » Ton corps seul est valétudinaire, ton âme ne l'est point. La maladie arrête les pieds du coureur, enchaîne les mains du cordonnier et de l'artisan. Mais si tu as coutume d'employer ton intelligence, tu pourras donner conseils et leçons, écouter, apprendre, interroger, te ressouvenir. Après tout, n'est-ce rien faire que d'être un malade raisonnable? Tu feras voir qu'on peut surmonter la maladie ou du moins la supporter. Ah! crois-moi, même chez l'homme gisant dans son lit il y a place pour le courage. Ce n'est pas seulement dans le choc des armes et dans la mêlée que l'on juge une âme énergique, indomptable à toute espèce d'effroi : même sur sa couche l'homme de cœur se révèle. Tu as ton œuvre à faire : lutte bravement contre le mal ; s'il ne t'arrache rien de force ou de surprise, tu donnes un noble exemple aux hommes. Oh! que de gloire à recueillir de la maladie, si nous y étions en spectacle! Sois à toi-même ton spectateur, ton admirateur. Mais poursuivons : il est deux sortes de voluptés. Celles du corps, la maladie les suspend sans en tarir la source, ou, pour dire vrai, en la ravivant. On boit avec plus de plaisir quand on a soif, et l'affamé trouve les mets bien plus savoureux : toute jouissance qui suit la privation est plus avidement[155] saisie. Mais les voluptés de l'âme, plus grandes et plus certaines, nul médecin ne les défend au malade : quiconque les recherche et les goûte avec intelligence dédaigne tout ce qui chatouille les sens. Que je te plains d'être malade! Tu ne bois plus ton vin à la neige ; tu ne renouvelles plus la fraîcheur de ton breuvage en laissant tomber dans ta large coupe des morceaux de glace ; l'huître du Lucrin ne s'ouvre plus pour toi sur ta table même ; des valets d'office ne s'agitent plus en foule autour de tes convives, apportant les fourneaux[156] mêmes avec les plats. Car tel est le procédé que vient d'inventer la mollesse : de peur qu'un mets ne tiédisse et ne soit pas assez brûlant pour des palais que rien ne réveille plus, le festin entre avec la cuisine. Que je te plains d'être malade! Tu ne mangeras que ce que tu pourras digérer; tu n'auras pas, étalé sous tes yeux, un sanglier[157] renvoyé ensuite comme viande trop grossière; tu n'entasseras pas en pyramide sur un bassin des poitrines d'oiseaux, car l'oiseau entier rebute à voir. Où est pour toi le mal? Tu mangeras en malade, disons mieux, comme doit manger souvent l'homme sain. Mais nous supporterons tout cela sans peine, et la tisane et l'eau chaude, et tout ce qui semble intolérable à notre délicatesse énervée par le luxe, à nos âmes plus maladives que nos corps, pourvu qu'à nos yeux la mort cesse d'être un objet d'horreur. Elle cessera de l'être si la limite des biens et des maux nous est connue : alors enfin ni dégoût de la vie ni frayeur de la mort. Comment en effet y aurait-il place pour la satiété dans une existence occupée de tant de choses si variées, si grandes, si divines? Ce qui toujours nous rend à charge à nous-mêmes, c'est l'inertie dans le loisir. A l'homme qui parcourt le domaine de la nature jamais la vérité n'apporte l'ennui : mais le faux rassasie bien vite. D'autre part si la mort approche et l'appelle, fût-ce prématurément, fût-ce au milieu de sa carrière brisée, il n'en a pas moins cueilli longtemps les fruits de la vie et connu en grande partie la nature : il sait que la vertu ne croît pas en raison du temps. Ceux-là trouvent nécessairement la vie courte qui lui donnent pour mesure des voluptés chimériques, dès lors sans limites. Que de telles pensées te réconfortent et que le travail de notre correspondance y contribue aussi parfois. Un jour viendra où, rapprochés de nouveau, nous ne ferons plus qu'un; et si courts que soient ces moments, nous les ferons longs en les utilisant. Car, comme le dit Posidonius, « un seul jour de l'homme instruit a plus d'étendue que la plus longue vie de l'ignorant.[158] » En attendant, attache-toi, cramponne-toi à ce principe : ne point succomber aux rigueurs du sort, ne pas nous fier à ses faveurs ; ne jamais perdre de vue jusqu'où vont ses caprices, et nous figurer que tout ce qu'il peut faire, il le fera. Toute épreuve longtemps attendue est plus légère quand elle arrive. LETTRE LXXIXScylla, Charybde, l'Etna. La gloire est l'ombre de la vertuJ'attends que tes lettres me signalent ce que ta tournée dans la Sicile entière t'aura fait voir de nouveau, et tout ce qu'on a de positif sur Charybde. Qu'en effet Scylla ne soit qu'un rocher, qui même n'effraye point les navigateurs, je le sais parfaitement; mais Charybde répond-elle bien aux histoires qu'on en fait : je le voudrais savoir au juste. Et si par hasard tu l'as observé, la chose en vaut la peine, éclaire-nous sur cette question : le tournoiement du détroit n'a-t-il lieu que sous l'action d'un seul vent, ou bien toute espèce de bourrasque produit-elle le même résultat?[159] est-il vrai enfin que tout ce que saisit ce courant circulaire est entraîné sous l'eau l'espace de plusieurs milles et ne reparaît que vers la côte de Tauroménium?[160] Quand tu m'auras bien marqué tout cela, j'oserai alors te prier de gravir en mon honneur le mont Etna, qui se consume et s'affaisse insensiblement, selon certains raisonneurs, attendu qu'autrefois on le voyait de plus loin en mer. Cela peut provenir, non de ce que la montagne a baissé de hauteur, mais de l'évaporation du feu, moins violent, moins large dans ses éruptions, et qui par là même exhale de jour une fumée plus faible. Au reste il est également croyable qu'une montagne minée journellement par le feu s'amoindrisse et que ce feu diminue, puisqu'il ne procède pas de lui-même, puisqu'il s'engendre dans quelque vallée souterraine d'où il sort en torrent, et qu'enfin il se nourrit d'autres feux et trouve dans la montagne non un aliment, mais un soupirail. Il y a en Lycie une contrée bien connue, que les habitants nomment Héphestion:[161] c'est un sol percé en plusieurs endroits et entouré d'une ceinture de feux inoffensifs qui n'endommagent nullement ses productions : pays fertile, couvert d'herbages, où rien ne souffre de cette flamme amortie et languissante comme la lueur qu'elle donne. Mais remettons à traiter ces questions après que tu m'auras écrit à quelle distance du cratère de l'Etna se trouvent ces neiges que l'été même ne fond pas, que dis-je? qui craignent si peu le voisinage du feu volcanique. Toutefois ne me rends pas comptable de toute cette peine, ta passion pour les vers gagnerait sur toi, quand nul ne t'en viendrait prier, de compléter ta description de l'Etna, car ta modestie ne t'empêche pas d'aborder ce texte favori de tous les poètes. Ovide l'a traité sans être découragé par Virgile qui l'avait, si heureusement fait,[162] et enfin Sévérus Cornélius[163] n'en fut pas détourné par ces deux grands noms. Le sujet d'ailleurs, a été fécond pour tous ; et les premiers venus n'ont pas épuisé, ce me semble, ce qu'on pouvait en dire : ils ont ouvert la mine. Il y a bien de la différence entre une matière épuisée et celle qu'on attaque déjà exploitée par d'autres : chaque jour elle se montre plus riche, et les anciennes découvertes ne font point obstacle aux nouvelles. Et puis l'avantage est pour le dernier venu : il trouve des mots tout prêts qui, différemment mis en œuvre, prennent une physionomie nouvelle; ce n'est point là mettre la main sur le bien d'autrui ; car ils sont du domaine public, et les jurisconsultes nient que le domaine public s'acquière par usucapion. Si je te connais bien, l'Etna te fait déjà, comme on dit, venir l'eau à la bouche. Tu brûles d'enfanter quelque œuvre grandiose et digne de tes devanciers. Ta modestie ne te permet pas d'espérer plus : elle est telle, que tu enchaînerais toi-même, je crois, l'essor de ton génie, si tu risquais de vaincre tes modèles, tant tu as pour eux de vénération! Entre autres avantages la sagesse a celui-ci, que ses poursuivants ne peuvent se dépasser les uns les autres qu'en gravissant vers elle ; arrivés au sommet, tout est égal : plus d'avancement possible, c'est le point d'arrêt. Le soleil peut-il gagner quelque chose en grandeur, la lune excéder les dimensions ordinaires de son disque? Les mers ne s'accroissent point; le monde conserve la même forme et les mêmes limites. Tout ce qui a rempli ses proportions naturelles ne peut plus grandir. Tous ceux qui auront atteint la sagesse seront égaux, seront pairs entre eux ; chacun d'eux aura ses qualités à lui : tel sera plus affable ou plus alerte, ou parlera plus facilement, plus éloquemment que tel autre ; mais le point essentiel, mais ce qui fait le bonheur sera égal chez tous. Que ton Etna puisse s'affaisser et crouler sur lui-même; que cette gigantesque cime, qui frappe les regards de si loin en mer, soit minée continuellement par l'action du feu, c'est ce que j'ignore; mais la vertu, ni flamme, ni écroulement ne la feront tomber au-dessous d'elle-même. C'est la seule grandeur qui ne connaisse point d'abaissement, qu'on ne puisse ni porter au delà, ni refouler en arrière. Elle est, comme les corps célestes, invariable dans sa hauteur. Efforçons-nous de nous élever jusqu'à elle. Nous avons déjà fait beaucoup; ou, pour dire mieux et plus vrai, nous avons fait trop peu. Car ce n'est pas être bon que de valoir mieux que les plus mauvais. Se vante-t-il d'avoir de bons yeux celui qui est en doute s'il fait jour, et pour qui le soleil ne luit qu'à travers un brouillard? Il a beau parfois se trouver heureux d'avoir échappé à la cécité, il ne jouit pas encore du bienfait de la lumière. Notre âme aura lieu de se féliciter, lorsqu'affranchie des ténèbres où elle se débat elle pourra, non plus entrevoir d'indécises lueurs, mais se pénétrer toute du grand jour, lorsque, rendue au ciel sa patrie, elle retrouvera la place qu'elle occupait déjà quand le sort la fit naître. Là-haut l'appelle sa naissance ; elle y sera, même avant de quitter cette prison du corps, quand, jetant loin d'elle toute souillure, elle s'élancera, pure et légère, dans la sphère des célestes pensées! Voilà notre tâche, mon cher Lucilius, voilà où se doit porter toute notre ardeur, n'y eût-il que peu d'hommes, n'y eût-il personne pour le savoir. La gloire est l'ombre de la vertu : elle l'accompagne même en dépit d'elle. Mais comme l'ombre tantôt marche devant, tantôt à côté de nous, et tantôt derrière, ainsi la gloire quelquefois nous précède et frappe tous les regards ; d'autres fois elle nous suit, d'autant plus grande qu'elle est plus tardive : l'envie alors s'est retirée. Combien de temps Démocrite n'a-t-il point passé pour un fou? La Renommée eut peine à accueillir Socrate. Combien de temps Caton ne fut-il pas méconnu de Rome? On le repoussa, on ne le comprit qu'après l'avoir perdu. L'innocence et la vertu de Rutilius seraient ignorées, sans l'iniquité qu'il a subie : l'outrage l'a fait resplendir.[164] Ne dut-il pas rendre grâce à son infortune et chérir son exil? Je parle ici d'hommes que le sort a illustrés en les persécutant. Mais combien d'œuvres méritoires venues au grand jour après la mort de leurs auteurs! Que de noms négligés et puis exhumés par la gloire! Vois Epicure, si fort admiré non seulement des hommes qu'a polis l'étude, mais aussi de la masse ignorante. Il était inconnu, même à Athènes, aux environs de laquelle il cacha sa vie. Aussi, comme il survivait déjà de plusieurs années à son cher Métrodore, dans une lettre, véritable hymne de reconnaissance dicté par les souvenirs d'une mutuelle tendresse, il termine en disant « que les charmes de leur union n'avaient rien perdu à ce que cette Grèce si riche en illustrations les eût laissés, Métrodore et lui, dans l'obscurité et presque dans un oubli absolu. » Plus tard pourtant, quand il eut cessé d'être, n'a-t-on pas su le découvrir? Sa doctrine en a-t-elle eu moins d'éclat? Métrodore aussi nous apprend par une de ses lettres qu'Épicure et lui n'avaient point été placés à leur hauteur, mais que leurs noms faits pour l'avenir grandiraient, comme celui de quiconque aurait marché résolument sur leurs traces. Aucune vertu ne demeure cachée : le fût-elle pour un temps, elle n'en souffrira point. Le jour viendra qui, des ténèbres où la tenait plongée l'envie contemporaine, doit la produire à la lumière. Il est né pour peu d'hommes celui dont la pensée ne s'adresse qu'à son siècle. Des milliers d'années, des générations nouvelles vont te suivre : c'est là qu'il faut jeter la vue. L'envie eût-elle imposé silence à tous les hommes de ton époque, il te naîtra des juges qui, sans faveur ni haine, sauront t'apprécier. Si la renommée est pour la vertu une récompense de plus, celle-là même n'est jamais perdue. Les discours de la postérité ne nous toucheront plus sans doute, mais tout insensibles que nous y serons, elle aura pour nous des hommages et de fréquents ressouvenirs. Il n'est personne qui, vivant et après sa mort, n'ait été payé de sa vertu, s'il l'a franchement embrassée, s'il ne l'a point prise comme un costume et un fard trompeur, s'il a été trouvé le même et dans les visites annoncées et quand on l'a surpris à l'improviste. Rien ne sert de se déguiser : trop peu d'yeux s'en laissent imposer par un extérieur qu'un vernis léger décore. Au dehors comme au dedans, le vrai seul est toujours le même. Les faux-semblants[165] n'ont point de consistance. Rien n'est plus mince que le mensonge ; il est transparent, si l'on y regarde de près. LETTRE LXXX.Futilité des spectacles. Certains grands comparés à des comédiens.Je m'appartiens pour cette journée, et je le dois moins à moi-même qu'au spectacle, qui chasse tous les importuns vers le jeu de paume. Nul ne vient fondre jusqu'à moi ; nul ne troublera mes pensées qui dans cette confiance même se développent plus hardies. Je n'entends pas crier ma porte à chaque instant : le rideau de mon cabinet ne se soulèvera point; je pourrai poursuivre mon pas, chose essentielle, surtout à qui marche de lui-même et dans la voie qu'il s'est tracée. Est-ce donc que je ne suis pas les anciens? — Si fait ; mais je me permets de faire aussi quelques découvertes, de modifier, d'abandonner les leurs. Mon acquiescement n'est point un esclavage.[166] Mais non : c'était trop dire; je me promettais du silence, une solitude que rien n'interromprait ; et voici qu'une bruyante clameur, partie de l'amphithéâtre, vient, non m'arracher à mon calme, mais me faire songer à ce débat si passionné des spectateurs. Je considère à part moi combien de gens exercent leur corps, et combien peu leur esprit; quel concours de peuple à un spectacle de mensonge et d'illusion, et quel désert autour de la science ; quels imbéciles esprits dans ces hommes dont on admire l'encolure et les muscles. Voici sur quoi j'arrête spécialement mes réflexions. Si le corps peut arriver par l'exercice à cette force passive qui endure les coups de pied et de poing de plusieurs assaillants ; qui lui fait braver les plus vives ardeurs du soleil au milieu d'une poussière brûlante, dégouttant du sang qu'il perd, et cela durant tout un jour; combien plus aisément l'âme ne pourrait-elle point s'endurcir à recevoir sans se briser les coups de la Fortune, à être terrassée, foulée par elle pour se relever encore! Le corps a besoin de mille choses pour soutenir sa vigueur ; l'âme croît par sa propre énergie : elle s'alimente et s'exerce elle-même. Il faut au corps force nourriture, force boisson, force huile, en un mot des soins continus; la vertu, tu l'obtiendras sans tant de provisions, sans dépense. Tout ce qui peut te rendre bon est en toi. Que te faut-il pour l'être? Le vouloir. Et que peux-tu vouloir de mieux que de t'arracher à cette servitude qui se fait sentir à tout homme, et que les esclaves même du dernier rang, du sein de cette fange où ils sont nés, s'efforcent de briser par tous les moyens? Ce pécule amassé en fraudant leur appétit, ils le donnent pour racheter leur tête ; et tu n'ambitionnerais pas de conquérir à tout prix la liberté, toi qui te crois né libre! Tu jettes les yeux sur ton or : l'or ne l'achète point. Chimère donc que cette liberté qui s'inscrit aux registres publics : elle n'est pas plus à ceux qui la payèrent qu'à ceux qui la vendirent. C'est à toi de te la donner; ne la demande qu'à toi. Affranchis-toi premièrement des terreurs de la mort, avant tout autre ce joug-là nous pèse, ensuite de la crainte de la pauvreté. Pour savoir combien elle est loin d'être un mal, compare la physionomie du pauvre avec celle du riche. Le pauvre rit plus souvent et de meilleur cœur ; ses soucis n'ont rien de profond ; s'il lui survient quelque inquiétude, c'est un léger nuage qui passe. Mais les heureux, comme on les appelle, n'ont que des joies factices ou des tristesses poignantes et concentrées, d'autant plus poignantes qu'il ne leur est jamais permis d'être ouvertement misérables, et qu'au fort même de ces chagrins qui rongent le cœur, il faut jouer son rôle d'heureux.[167] Cette métaphore-là j'ai trop occasion d'en user,[168] car rien ne caractérise mieux le drame de la rie, qui assigne à chacun de nous un personnage si mal soutenu. Cet homme qui s'avance majestueusement sur la scène, et qui dit, renversant sa tête : Héritier de Pélops, je suis maître d'Argos; L'isthme que l'Hellespont vient battre de ses flots, Et qui commande au loin sur la mer d'Ionie, Reconnaît mon empire.... [169] c'est un esclave qui reçoit par mois cinq boisseaux[170] de froment et cinq deniers. Ce héros superbe, impérieux, gonflé du sentiment de sa puissance, et qui dit : Arrête, Ménélas! ou tu meurs de ma main; est un gagiste à tant par jour, qui dort dans un galetas.[171] Autant peux-tu en dire de tous ces voluptueux en litière qui planent sur les tètes et dominent la foule : leur bonheur à tous est un masque. Arrache-le, ils feront pitié. Avant d'acheter un cheval, tu fais déboucler son harnais ; tu déshabilles l'esclave que tu marchandes, il peut cacher quelque vice physique ; et tout autre homme tu le prises avec son enveloppe! Chez les vendeurs d'esclaves, tout ce qui pourrait choquer se déguise sous quelque artifice; aussi, pour l'acheteur, tout ajustement est suspect ; qu'un lien quelconque à la jambe ou au bras frappe ta vue, tu fais tout découvrir, tu veux voirie corps bien à nu.[172] Vois ce roi de Scythie ou de Sarmatie, le front paré du diadème : si tu le veux apprécier et savoir au fond tout ce qu'il est, détache son bandeau : que de misères cachées là-dessous! Mais que parlé-je des autres? Si tu veux te peser toi-même, mets à l'écart ta fortune, ta maison, ton rang, et considère l'homme intérieur. Jusque-là tu t'estimes sur la foi d'autrui. [1] Énéide, VIII, 352. [2] Quel calme universel! Je marche; l'ombre immense, L'ombre de ces grands bois sur mon front suspendus, Vaste et noir labyrinthe où mes pas sont perdus, S'entasse a chaque pas, s'agrandit, se prolonge; Et dans la sainte horreur où mon âme se plonge, Au palais d'Herminsul je me vois transporté. Sous ce tronc gigantesque aurait-il habité? Les dieux au pied d'un chêne ont instruit plus d'un sage ; L'aigle au vol prophétique apportait leur message. L'antre mystérieux entendit Apollon. (Fontanes, Forêt de Navarre.) Voy. Chateaubr., Martyrs, IX. Saint Lambert, Saisons, ch. i. Lemierre, Fastes, IX. Lucos, atque in iis silentia ipsa adoramus. Plin., Hist., XII, ii.) [3] J'admire plus cent fois ce lion furieux Oui la gueule béante et le sang dans les yeux, Les ongles tressaillant d'une effroyable joie, Suit son instinct féroce et déchire sa proie, Que ces ours baladins, sous le bâton dressés, Étalant aux regards leurs ongles émoussés, Leur gueule sans honneur que le fer a flétrie, Attributs impuissants d'une race avilie. (Cas. Delavigne, Ép. à l'Académ.) [4] Voir Lettres xlv et lxxvi, et Balzac, Dissert. xxiii. De tes aïeux la mémoire honorable, L'autorité de ton emploi, Ton palais, tes meubles, ta table, Tout cela, pauvre homme, est-ce toi? (Lamothe, Fab. ix, liv. IV) [5] « Il y a en nous une certaine malignité qui a gâté notre nature jusqu'à la racine, qui a répandu dans nos cœurs les principes de tous les vices. Ils sont cachés et enveloppés en cent replis tortueux, et ils ne demandent qu'à montrer la tête. « Pour guérir la volonté, dit saint Augustin, il faut réprimer la puissance : frenetur facultat, ut « sanetur voluntat.... » Que si je pouvais-vous découvrir le cœur d'un Néron ou de quelque autre monstre dans les histoires profanes, vous verriez ce que peut faire dans le cœur humain cette terrible pensée de ne voir rien sur sa tête. » (Bossuet, Serm. sur l'ambition.) [6] « La marchandise est chère que l'on acheste avec perte de loz et gloire. » (L'Hospital, Au parl. de Rouen.) Il faut appeler perte et non pas avantage Tout gain dont notre honneur souffre quelque dommage. (Corneille.) « N'envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses : ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accommoderait point. Ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir : cela est trop cher; et il n'y a rien à gagner à un tel marché.» (La Bruyère, Biens de fortune.) [7] Souvenir des largesses de Néron à Sénèque. [8] Comparer cette lettre arec le chap. xxviii, liv. III, Des bienfaits. [9] Personarum acceptio non est apud Deum (Act. apost. X, xxxiv) [10] La vertu d'un cœur noble est la marque certaine. (Boileau.) [11] Nobiles non sunt mihi Avi nec altis inclitum titulis genus; Sed clara virtus ι qui genus jactat suum Aliena laudat. (Sénèq., Herc. Fur., act I, sc. ii.) [12] Voy. Lettre xxxi, et de la Vie heureuse iii. [13] Voy. Lettre cxx. Sæpe latet vitium proximitate boni. (Ovide, Art. amandi, II, 662.) « Il n'y a point de vice qui n'ait une fausse ressemblance avec quelque vertu et qui ne s'en aide. « (La Bruyère, du Cœur.) « Le vice ne s'insinue guère en choquant l'honnêteté, mais en prenant son image. » (Rouss., Emile.) [14] On supposait un homme qui disait je mens, et, de ce qu'il disait vrai en cela, on concluait qu'il mentait, et, de ce qu'il mentait, on concluait qu'il disait vrai. [16] De desseins en regrets, et d'erreurs en désirs Les mortels insensés promènent leur folie Dans des malheurs présents, dans l'espoir des plaisirs. Nous ne vivons jamais, nous attendons la vie. Demain, demain, dites, doit combler tous nos vœux; Demain vient et nous laisse encor plus malheureux. (Dryden, trad. par Volt.) [17] « Vous, maîtres, rendez a vos serviteur» ce que l’équité et la justice demandent de vous, sachant que voua avez aussi bien qu'eux un maître qui est dans le ciel. » (Saint Paul, aux Coloss., ch. iv.) [18] Mot de Caton l'Ancien, comme de saint Matthieu, x, 36. Notre ennemi, c'est notre maître. (La Fontaine.) [19] Voy. Lettre cxxii et la note. [20] Affranchi de l'empereur Claude, et puissant à sa cour. [21] « Mes amis, s'écrie Trimalchion, les esclaves aussi sont des hommes : ils ont sucé le même lait que nous, quoique un mauvais destin ait pesé sur eux. (Pétrone, ch. lxxi.) [22] Nous approchons des temps de crise et du siècle des révolutions. Alors le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet..., etc. (Rousseau, Emile.) [23] Passage imité par Pline le Jeune, liv. V, Lettre xix. « Ces noms d'affection vont mieux au cœur que les titres de leur pouvoir : on les nomme pères de famille plutôt que maîtres. » « Tertull., Apolog. xxxiii.) « Servi non sunt, sed eos et habemus et dicimus spiritu fratres, religione conservos. » (Lactant., Instit., V, xv.). [24] Tout ce qui vit au monde, au destin se rangeant Est serf de la fortune ou serf de son argent, La peur le tyrannise ou quelque autre manie. (Desportes, Diane, I, xxxviii.) [25] Je lis querendo avec J. Lipse, au lieu de quærendo. [26] Macrobe, l. X, copie presque mot pour mot certains passages de cette admirable lettre. Voir aussi (Nouvelle Héloïse, IVe partie, lettre X.) Cicéron, sur ce sujet, dit sèchement : « Il faut être juste même envers les gens de la condition la plus vile. Il faut traiter les esclaves en salariés, exiger leurs services, leur donner le nécessaire. » (De Offic.) Ailleurs, dans ses lettres, il rougit du regret qu'il éprouve de la mort d'un de ses esclaves. [27] C'est-à-dire en mesurant l'amitié sur l'intérêt. Voir lettre ix. [28] Quidquid loquaris, respondent obmnes. Telle est la leçon que j'adopte pour ce passage diversement tourmenté. [29] Admoveri lineas. Allusion, selon tous les commentateurs, aux courses du stade où une ligne tracée sur le sol marquait la limite d'arrivée. Mors ultima linea rerum. (Horace.) Mais le pluriel lineas me fait croire qu'il s'agit ici de l'enceinte de cordons garnis de plumes flottantes et bigarrées, nommés épouvantails, qui repoussaient les bêtes fauves dans l'enceinte où on les traquait. [30] Énéide, VIII. 385. [31] Aussitôt que le jour te luit, Doute si jusques à la nuit Ta vie étendra sa dorée ; Et la nuit reçois le sommeil Sans la croire plus assurée D'atteindre au retour du soleil. (Corneille., Imit. De J.-C., I, xxiii.) [32] Tous les hommes sont fous ; et qui n'en veut point voir Doit rester dans sa chambre et casser son miroir. (Regnard.) [33] Voir Lettre liv. Qui ne sent point son mal est d'autant plus malade. (Corneille, Rodog., III, sc. ii.) [34] Les éditions portent : tot morbos, tantasve œgritudines, les mss., tantas ve res, ce qui n'a point de sens. Je propose tam veteres. [35] Ville d'Egypte, située où est aujourd'hui Aboukir. Elle était fameuse par un temple de Sérapis, et par les monstrueuses débauches de ses habitants. [36] Voir, sur les ruines de Baïes, Dupaty, Lett. sur l'Italie, « Peut-être est-il des climats dangereux à la vertu par leur extrême volupté. Et n'est-ce point ce que voulut enseigner une fable ingénieuse, en racontant que Parthénope fut bâtie sur le tombeau d'une sirène? » (Chateaubr., Martyrs, V.) [37] « Il y a ici comme un retour de Sénèque sur lui-même. Exilé, sous Claude, dans la Corse sauvage et montagneuse, il avait pu faire sur son âme l'expérience philosophique qu'il recommande à son ami. » (Gebhard, Thèse pour le doctorat) Bien qu'il ait trop imité dans ses plaintes Ovide, relégué aux bords du Danube, ici du moins il parle plus dignement que lui. 23. [38] Mica, miette, parcelle, diminutif. Ainsi, sous Louis XV, les petites-maisons, bagatelle, etc. Je m'appelle Mica, salle étroite et jolie D'où tu vois dans son temple un César inhumé. Foule mes lits; de rose et de nard parfumé, Bois, et pense à la mort : ce dieu, mort t'y convie. (Martial, II, lix. Trad. inéd.) [39] Je lis avec Fickert : quod in unam noctem manu sua duxisset. Lemaire quam unam noctem inter talia duxisse. [40] « Les plaisirs nous chatouillent pour nous étrangler : si la douleur de tête nous venait avant l'ivresse, nous nous garderions de trop boire; mais la volupté, pour nous tromper, marche devant et nous cache sa suite. » (Montaigne, I, xxxviii.) [41] Voir saint Paul, aux Rom., vii, 19, 20, 24, traduit par Racine : Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi.... Je veux et n'accomplis jamais. Je veux; mais ô misère extrême! Je ne fais pas le bien que j'aime, Et je fais le mal que je hais. Video meliora, proboque, Deteriora sequor. (Ovide) Voir aussi Racine fils, la Grâce, ch. i. « Toujours dans l'homme, dit saint Augustin, une partie qui marche et une partie qui se traîne, toujours une ardeur qui presse, un poids qui accable; toujours aimer et haïr, vouloir et ne vouloir pas, craindre et désirer la même chose! La volonté commande, et elle-même qui commande ne s'obéit pas. Éternel obstacle à ses désirs propres, elle se dissipe elle-même; et cette dissipation, quoiqu'elle se fasse malgré nous, c'est nous néanmoins qui la faisons. » (Bossuet, Analyse des chap. vii et ix des Conf. de saint August.) [42] Voy. Lettres vi et xxiii. [43] Tous les Mss. : vitam docent; un seul : vita, sens plus beau que j'ai suivi [44] C'est-à-dire qu'il se gratte la tête d'un seul doigt pour ne pas déranger sa coiffure. [45] « L'homme se connaît a la vue; on remarque un homme sensé à la rencontre; l'habit, le ris, la démarche découvrent l'homme. » (Eccles., xix, xxvi, xxvii.) Les Latins disaient en proverbe : Corpus hominem tegit et detegit : in facie legitur homo. [46] Quemadmodum laudet, leçon vulgaire; je préfère laudetur d'un Mss. [47] Comparer, pour toute cette lettre, saint J. Chrysost., Homélie II, sur la sédition d’Antioche. Saint Jér. à Népot. Ép. xxxiv. Bossuet, Serm. du 2e dim. du car., et La Bruyère, de la Chaire. [48] Enéide, VI, vers 2 et 902. [49] « Les maux du corps s'éclaircissent en augmentant : nous trouvons que c'est goutte, ce que nous nommions rhume ou foulure. » (Montaigne, III, v.) Voy. Horace, I, Ép. xvi. Pers., Sat. iii, et Boileau : A quoi bon, quand la fièvre en nos artères brûle.... (Ép. iii.) [50] Voy. Lettres xvii et lxii. [51] D'après Fickert et la plupart des mss. je lis simplement ; Mors est non esse : id quale sit, jam scio. [52] Personnage vertueux, haï de Tibère qui le fit mourir après une longue captivité. [53] Ainsi après la révolution Sieyès disait : J'ai vécu. [54] Quæ in delicis est, vivent mortua est. (Saint Paul à Timoth., I, iii.) « Là dedans on les engraisse comme victimes à immoler; on les parfume comme des corps qu'on veut embaumer; on leur allume des flambeaux dès le midy, afin que la pompe de leur vie commence l'appareil de leurs funérailles, et quand on passe devant leur porte on puisse dire : Ici gist le prince un tel. » (Balzac, le Prince, chap. ii.) [55] Détroit qui séparait l'Ile d'Eubée de la Béotie, laissant à peine passage à un navire [56] Eh! qu'importe une terre ou riante ou maudite? Ce ne sont pas les lieux, c'est son cœur qu'on habite. Le cœur, de notre sort cet arbitre éternel, Fait du ciel, un enfer et de l'enfer un ciel. (Delille, trad. de Milton, ch. i.) [57] Quique lavantes : Suave locus voci resonat conclusus. (Horace, I, Sat. iv.) « Invité par la sonorité du bain, il ouvrit jusqu'au plafond sa bouche d'ivrogne et se mit à écorcher des chansons de Hénécrate, au dire de ceux qui comprenaient son jargon. » (Pétrone, ch. lxxiii.) [58] Borne suante, fontaine dont les restes se voient encore à quelques pas du Colysée, en face de l'arc de Constantin. [59] Térentius Varron. Voy. Sénèque le rhéteur, III, 16e Controv. [60] Ainsi Mme de Sévigné disait de son fils : « Sa jeunesse lui fait du bruit. » Illi obstrepit. [61] Aux mss.: obirata, obruta, abjecta, objecta. Tout cela ne concorde point avec la métaphore d'excisa. Je lirais obtrita. [62] Enéide, II, 725. Trad. de Delille pour les deux derniers vers. [63] Préparation dont les athlètes oignaient leur corps avant la lutte : ils ajoutaient, pour mieux l'y fixer, une couche de poussière. [64] Aujourd'hui grotte de Pausilippe, longue de 700 pas. La description de Sénèque est encore vraie à présent. [65] Permanere leçon de presque tous les Mss. Pincianus, permeare. Je crois qu'il faut lire permanare. [66] Texte corrompu. Ficltert : perimi illum nullo.... Lemaire: ...genere mori. Je lirais nullo genere teneri posse, ou quelque mot analogue. [67] C'est le mot de Voltaire : « La langue française est une gueuse fière; il faut lui faire l'aumône malgré elle. » [68] Géorg., III, 146. [69] Énéide, XII, 709. [70] Enéide, XI, 175. [71] Plus tard les scolastiques ont créé le mot ens, entis. [72] « Je suis ; dites quelle chose? Car ce que j'étais a disparu de moi; et maintenant je suis autre chose. Que serai-je demain si je suis encore? Rien de durable. Je passe et me précipite, tel que le cours d'un fleuve. Dis-moi ce que je te parais être le plus, et t'arrêtant ici, regarde avant que j'échappe. On ne repasse pas les mêmes flots que l'on a passés ; on ne revoit pas le même homme que l'on a vu. » (Vers de saint Grégoire de Nazianze.) Voir aussi Fénelon, 3e Lettre sur la religion.) Ah! de nos jours mortels trop rapide est la course! On regrette la vie avant d'avoir vécu! Et le flot, qui jamais ne remonte à sa source, Ne revoit pas deux fois le doux bord qu'il a vu. (Lamart., Harm. iv, liv. III.) [73] Nous nous aimons un peu, c'est notre faible à tous. Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous? Et puis la mode en est, et la cour l'autorise, Nous parlons de nous-même avec toute franchise; La fausse humilité ne met plus en crédit. Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit. (Corneille, Excus. à Ariste.) [74] On sait que les anciens ne connaissaient pas les étriers. [75] « Semblable à ces montagnes élevées qui trouvent leur sérénité dans leur hauteur. » (Bossuet.) Voy. de la Colère, III, vi. [76] Enéide, VI, 446. [77] Voy. Lettre xxx. Des Bienfaits, II, xiv. J. B. Rouss., Ep. iv. liv. II. Le 2e Alcibiade, dialogue attribué à Platon, roule tout entier sur ce sujet. [78] Voy. Lettre lxxxix, et Consol. à Helvia, x. [79] Voir la Lettre iv. [80] Voir, sur Démétrius, De la Providence, iii. [81] Voir Lettre xcix. De quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, La douleur est toujours moins forte que la plainte; Toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. (La Fontaine, Matrone d'Éph.) [82] Dominus dedit, dominai abstulit; sit nomen domini benedictum. (Job.) [83] Impetret ratio quod dies impetratura est. (Cic, ad Attic.) Voir Consol. à Marcia, viii. [84] Voir Lettre lix et Quest. natur., VII, chap. dernier. [85] Énéide, IV, 158. [86] Deux statues de Polyclète. Voir Pline, Hist. nat., XXXIV, viii. [87] « L'âme resserrée de toutes parts ne peut plus respirer que du coté du ciel. » (Bossuet.) [88] Voir Consol. à Marcia, xiii : Animo cum hoc carne grave certamen, « Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem ; hæc enim sibi invicem adversantur. » (Saint Paul, ad Galat., v, 17.) [89] Enéide, V, 344. [90] Lemaire : Dulces esse tortores. Alias torqueri; les meilleurs mss. : dulces.... terrores d'où je tire.... dulce.... torreri. [91] Au lieu de : at si hodie magii, édit. Lemaire, Je lis avec les mss. : Et si hoc est, magis., … Et dans le sens de at. [92] Ithacam saxis tanquam nidulum affixam. (Cic.) [93] Romains, j'aime la gloire et ne veux point m'en taire ; Des travaux des humains c'est le digne salaire : Sénat, en vous servant il la faut acheter : Qui n'ose la vouloir n'ose la mériter. (Volt., Catil.,V, sc. ii.) [94] Enéide, I, 93. [95] Voir Lettre xcvi, in fine. « Le monde est plus dangereux lors qu'il nous rit que lorsqu'il nous maltraite; et les faveurs qui nous le rendent aimable sont plus à craindre que les rebuts qui nous forcent à le mépriser. » (Saint Augustin, Ép. cxliv) [96] Quand on se vante de l'avoir (le bonheur), On en est privé par l'envie; Pour le garder il faut savoir Le cacher, et cacher sa vie. (Volt., Thélème et Macare.) [97] « La deffense attire l'entreprise, et la deffense l'offense.... Je leur rends la conqueste de ma maison lasche et traistresse. Elle n'est close à personne qui y heurte. » (Montaigne, II, xv.) Voir Manuel d'Épictète, ch. xxii. [98] « Tous les hommes sont tellement dépendants les uns des autres, que je ne sais si les grandes retraites du monde que nous voyons quelquefois ne sont pas faites pour le monde même : le désespoir a sa recherche, et la solitude sa coquetterie. On prétend que les plus sombres ermites n'ont pu se retenir de s'informer de ce qu'on disait d'eux. » (De Vigny, Cinq-Mars.) [99] Enéide, III, 72. [100] Télesphore. Voir De la colère, III, xvii. [101] « La plus volontaire mort, c'est la plus belle.» (Montaigne, II, iii.) [102] « Le commun train de la guérison se conduict aux dépens de la vie : on nous incise, on nous cautérise, on nous détranche les membres, on nous soustrait l'aliment et le sang : un pas plus outre, nous voylà guéris tout à fait. » (Montaigne, II, iii.) [103] Tant notre esprit esclave en son obscurité Ressemble au vieux captif qu'on met en liberté; A force d'habiter l'ombre fétide et noire, Des splendeurs du soleil il n'a plus la mémoire. Sa prison exiguë est un monde à ses yeux. (Reboul, L'esprit et les sens.) [104] Comme les malfaiteurs dont il vient de parler. [105] Voir Lettre lxxvi. [106] Voy. Consolat. à Polybe, xxi. [107] Voy. Consolat. à Marcia, lvi. Quest. natur., ΙII, x. [108] Je lis avec un mss : Si beatus est, in summo bonο est, Lemaire ; Nisi beatus ... non est, [109] Voir Lettre cxvi in fine et Constance du sage, xv. [110] Je lis avec les Mss. et J. Lipse continentia, au lieu de industria, leçon vulg., puis indoctis industria. [111] Cité et commenté par Montaigne, I, xl. [112] Aveu modeste, souvent répété par Sénèque. Voir Lettre vi. De la Vie heureuse, xvii. [113] Voir Lettre xvii. [114] Cette lettre trahit les inquiétudes de Sénèque. Néron, comme tous les tyrans, comme Vespasien lui-même, qui bannit Epictète, tenait pour suspects les philosophes, les stoïciens surtout, dont Thraséas était alors avec Sénèque le plus incommode représentant. Quand Tigillin veut perdre Plautus auprès de Néron, il dit : « En affectant l'orgueil des stoïciens, il a pris les principes d'une secte qui ne produit que des séditieux et des intrigants. » [115] Voir Des bienfaits, II, xxvii. De la colère, III, xxxi. [116] La tendresse d'une mère Se partage entre tous, et tous l'ont tout entière. (V. Hugo.) [117] Virg., Eglog., I [118] Le repos, le repos, trésor si précieux Qu'on en faisait jadis le partage des dieux! (La Fontaine.) [119] « Encore que Dieu soit éloigné de nous par ses divins attributs, il descend quand il lui plaît par sa bonté, ou plutôt il nous élève. » (Bossuet, Fragm. sur la Nat.) [120] Voir la magnifique Lettre xli. [121] « Parlez plus franchement, Sénèque, dit J. Lipse, pour le temps où vous vivez, et dites : la colère ou la haine du prince. » [122] Le plus sage s'endort sur la foi des zéphirs. (La Fontaine, Ode à Louis XIV.) [124] « Non seulement le coup, mais le vent et le pet nous frappent. » (Montaigne, III, ii.) [125] Voir Lettre cxviii. Imité par Young, 7e Nuit. [126] « Qu'il ne s'y attache point jusqu'à en faire une portion de son âme, ce qui a lieu dans l'amour; de peur que, lorsqu'on les lui retranchera, son cœur n'en soit déchiré et n'en porte la honteuse plaie. » (Saint Augustin, Libre arbitre, I, xv.) [127] C'est notre fiat voluntas tua. Voir aussi de la Providence, à la fin. [128] Au lieu de craie pour tracer sur un tableau des figures géométriques, les anciens avaient des cadres couverts de sable fin où l'on opérait avec une baguette. D'où le pulvis eruditus de Cicéron (Nat. Deor, II, xviii). [129] Voir Lettre lxxxv. De la vie heureuse, xxv. Tranquillité de l'âme, iii. [130] « Je me sers d'un parler tel sur le papier qu'à la bouche. » (Montaigne.) [131] « Que direz-vous de cette éloquence qui ne va qu'à plaire et qu'à faire de belles peintures, lorsqu'il faudrait, comme dit Platon (voir le Gorgias), brûler, couper jusqu'au vif et chercher sérieusement la guérison par l'amertume des remèdes.et par la sévérité du régime? Trouveriez-vous bon qu'un médecin qui vous traiterait s'amusât, dans l'extrémité de votre maladie, à débiter des phrases élégantes et des pensées subtiles? L'amour de la vie fait assez sentir ce ridicule-là ; mais l'indifférence où l'on vit pour les bonnes mœurs et pour la religion fait qu'on ne le remarque point dans les orateurs, qui devraient être les censeurs et les médecins du peuple. (Fénelon, sur l'Éloquence, dial. I.) [132] Dans la Lettre lxxi. [133] « Toute méchanceté vient de faiblesse, et qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. » (J. J. Rousseau.) [134] Métronacte, qui ne nous est connu que par Sénèque. Voir Lettre xciii. [135] Deux heures après midi. Les Romains comptaient comme nous douze heures de jour et douze heures de nuit; la première du jour commençait à nos six heures du matin. [136] Axiome de Solon. « Un jour que Marc Aurèle sortait de son palais, un philosophe, Lucius, lui demanda pour quelle affaire il sortait. Il est beau de s'instruire, répondit l'empereur; même quand on est vieux. Je vais chez le philosophe Sextus, pour y apprendre ce que je ne sais pas encore. — O Jupiter! s'écrie Lucius, heureux les Romains dont l'empereur, au déclin de son âge, ne dédaigne pas de s'instruire encore et se rend à l'école, comme un enfant, des tablettes pendues à sa ceinture! » (Philostrate.) [137] Mépriser le mépris, rendre haine pour haine, Est le parti qu'il faut que l'honnête homme prenne. (Quinault, Mère coq., V, sc. ii.) [138] Nil pictis timidus navita puppïbus Fidit. (Horace, I, Ode xiv.) Qu'importe, quand l'orage a soulevé les flots, Que ta poupe soit peinte et que ton mât déploie Une voile de pourpre et des câbles de soie? L'art du pilote est tout ; et pour dompter les vents Il faut la main du sage et non des ornements. (Voltaire, Variantes du 1er disc. sur l'homme.) [139] Dele fucum fugacis honoris hujus, et male coloratæ nitorem gloriæ, ut nude nudum consideres. (Saint Bern., de Consider., II, ix.) [140] Enéide, VI, 103. [141] Qui transportaient d'Egypte à Rome le blé nécessaire à la subsistance du peuple. [142] Ceci nous apprend que Sénèque avait des terres ou de l'argent placé en Egypte, où son oncle (Voir Consolat. à Marcia, xvii) avait été préfet. [143] Dont il est parlé dans la Lettre xxix. [144] Voir Lettre xxiv in fine. [145] Celui à qui son maître aurait ordonné de le tuer, et qui aurait obéi, aurait été coupable. (Leg. I, § xxii, ff. de Sénat. consult.) Celui qui ne l'aurait point empêché de se tuer aurait été puni. (Leg. I, § xxxi, ff. ibid.) [146] Qui cogit mort Nolentem, in æquo est quique properantem impedit. (Senec., Phœniss., v. 98.) Invitum qui servat, idem facit occidenti. (Horace, Art poét.) Ah! c'est m'assassiner que me sauver la vie. (Racine, Thébaid., V, sc. vii.) [147] Sur cette facilité des Romains à se donner la mort, voir Montesq., Grandeur et décad. des Rom., ch. xii, in finem. [148] Enéide. VI, 376. [149] Voir Lettre xxiv. Nec nova vivendo procuditur ulla voluptas. (Lucret., III, 1094.) [150] « Celui qui a appris le matin la manière de bien vivre peut mourir tranquillement le soir. » (Confucius.) [151] Ceci parait être un souvenir personnel de l'auteur. Voir sa vie. [152] Le malheur qui n'est plus n'a jamais existé. (Colardeau.) [153] Énéide, I, 203. [154] Voy. Lettre lxxxv. [155] Voy. Lettre xcv et Quest. natur. IV, xii. [156] Sénèque entend par là des réchauds. On trouve la description d'un de ces réchauds en bronze dans les Antiquités romaines de Caylus, tome I. [157] Voir Pétrone, Satyricon, xii. [158] « O philosophie! guide de la vie! source des vertus et fléau des vices! Un seul jour bien passé et conforme à tes préceptes est préférable à l'immortalité dans le vice. » (Cicèron, Tusc, V, ii.) [159] Ce tourbillon n'est ni profond ni dangereux. Il n'est point produit par un gouffre, mais par deux courants opposés, l'un du côté du nord, l'autre du côté du sud, dans le détroit. Comme ils ne s'y portent pas avec la même force ni dans le même temps, ils donnent lieu à une espèce de flux et de reflux sur lesquels les marins se dirigent en faisant canal. La traversée s'effectue aisément, sans rames ni voiles. [160] Taormina. Cette tradition fabuleuse est admise par Salluste. (Pragm.) [161] Fait rapporté aussi par Pline, Hist. nat., V, xxvii. [162] Énéide, III, v. 203. [163] Ami d'Ovide, mort fort jeune, l'an 14 avant J. C. On lui attribue un petit poème, qui nous est resté, sur l'Etna. L'auteur de l'Etna est plus philosophe que poète; il parle avec mépris des fictions poétiques; il scrute avec soin les causes de l'éruption du volcan. Il semble répondre à la question de Sénèque dans les vers 361 et suivants. On voit au reste qu'il était très familiarisé avec les écrits de notre auteur. [164] Labeoni commendatio ex injuria; Dolabellæ negatus honor gloriam intendit. (Tacite, Ann., III.) La gloire est plus solide après la calomnie Et brille d'autant mieux qu'elle s'en vit ternie. (Corn., Nicom., IV, sc. i.) C'est ce que Bossuet nomme « ce je ne sais quoi d'achevé que le malheur ajoute à la vertu. » (Orais. funèbres.) Voir aussi Sénèque, de la Providence, IV et note. « Il faut songer uniquement à bien faire, et laisser venir la gloire après la vertu. » (Bossuet, Orais. funèb.) [165] « Les fausses couleurs, quelque industrieusement qu'on les applique, ne tiennent pas. » (Bossuet, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.) [166] Voy. Lettres xxxiii, xlv, lxxxiv. [167] Encor dans mon malheur de trop près observée, Je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir ; Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir, Et sous un front serein déguisant mes alarmes, Il fallait bien souvent me priver de mes larmes. (Racine, Phèdre.) Nous nous voyons sans cesse assiégés de témoins, Et les plus malheureux osent pleurer le moins. (Voltaire, Œdipe.) Voir Consolation à Polybe, xxv. [168] Voy. Lettre lxxvi. [169] Vers d'Attius, tragédie d'Atrée. [170] 42 litres 20 centilitres. [171] Race gueuse, fière et vénale, Portant avec habits dorés Diamants faux et linge sale ; Hurlant pour l'empire romain, Ou pour quelque fière inhumaine, Gouvernant trois fois par semaine L'univers, pour gagner du pain. (Voltaire, Epître au roi de Prusse.) [172] Voir Lettre lxxvi. Apulée, Démon de Socrate. Lucien, Dialog. Ménipp. |
|
|