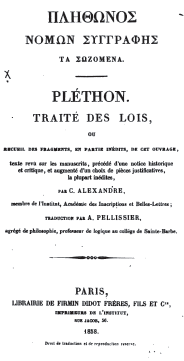
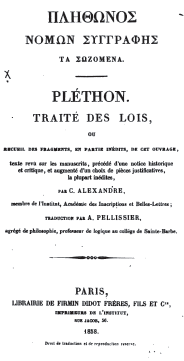
Mon savant et honorable ami, M. Vincent, dans le cours de ses intéressantes recherches sur la musique ancienne, rencontra, il y a déjà plusieurs années, parmi les manuscrits grecs de la Bibliothèque impériale, sous le n° 66 du supplément, des morceaux assez considérables d'un rituel païen, découverte qui s'annonçait comme devant jeter un nouveau jour sur les liturgies et sur les croyances de l'antiquité classique. Le nom de Pléthon, mis en tête de ces fragments, mais d'une main plus récente, n'empêcha pas le docte investigateur, de nourrir quelque temps cette espérance, et il en fit part à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres par une note lue dans la séance du 22 avril 1842. M. Vincent voulut bien me communiquer les textes qu'il avait révélés ; nous en fîmes ensemble l'objet d'un examen plus approfondi, et nous ne tardâmes pas à nous convaincre que le hasard avait fait tomber entre nos mains, au lieu d'un monument de l'antique religion païenne, quelques chapitres jusqu'à présent inédits et inconnus du grand ouvrage de Pléthon sur les Lois, reste d'une tentative avortée pour reconstruire à neuf le paganisme sur les ruines du culte chrétien avec les matériaux de la philosophie néo-platonique. Ce résultat bien constaté fut pour M. Vincent le sujet d'une seconde communication faite à l'Académie le 27 mai de la même année.
Réduite à ces proportions, la découverte avait certainement perdu de son importance; elle conservait pourtant un assez grand intérêt, parce qu'elle tranchait la question longtemps débattue sur le reproche adressé à Pléthon d'avoir voulu se faire le chef d'une religion nouvelle, reproche repoussé avec force, mais avec une partialité trop visible, par Allatius dans un de ses plus savants traités,[2] repris ensuite et soutenu avec non moins d'érudition et plus de critique par Boivin le jeune dans les mémoires de l'Académie.[3]
Malgré l'excellent travail de ce dernier, les savants même les plus distingués ont continué, par intérêt pour Pléthon, à envelopper de doutes officieux l'imputation faite à sa mémoire. Fabricius, dans sa Bibliothèque grecque, et son nouvel éditeur Harles, ont évité de se prononcer à ce sujet.[4] M. Hardt lui-même, qui, le premier, au commencement de ce siècle, a recueilli des morceaux considérables du Traité des Lois, en a méconnu, par trop de faveur, l'esprit et la portée[5] ; et plus récemment, M. W. Gass, dans son ouvrage sur Gennadius et Pléthon,[6] n'a pu se défendre de pencher encore vers le même système d'indulgence. C'était donc une question à éclaircir. Elle n'intéressait pas moins la mémoire du patriarche Gennadius, qui condamna le livre au feu, que celle de Pléthon lui-même. Elle se rattachait d'ailleurs à l'histoire de la renaissance, à l'influence des idées classiques sur les opinions religieuses dans ce grand mouvement de l'esprit humain, et a d'autres tentatives païennes faites vers le même temps en Italie, nu centre même de la chrétienté, tristes indices d'un relâchement qui bientôt, par une réaction inévitable, devait amener Luther et la réforme.
Nous crûmes, en conséquence, M. Vincent et moi, qu'il serait utile ou du moins curieux de rassembler les autres débris du même ouvrage qui pouvaient avoir échappé à la destruction. J'insiste à dessein sur ces détails, parce que je tiens à rendre à mon docte ami sa part dans l'idée première de mon livre et dans les commencements d'exécution. Nos recherches communes dans les manuscrits et les imprimés des bibliothèques de Paris ne furent pas vaines, mais bientôt, distrait par des élucubrations plus importantes, M. Vincent m'abandonna la poursuite de cette entreprise. Le catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque royale de Bavière par M. Hardt, non seulement me fournit plusieurs morceaux qui manquaient à celle de Paris, mais encore me servit à exhumer de celle même de Munich d'autres pièces que l'habile rédacteur du catalogue n'avait pas assez remarquées ou qu'il avait négligé de publier. Ces pièces m'ont été communiquées avec une rare complaisance par un des premiers philologues de la Suisse, M. Albert Jahn, qui en avait pris copie sur place. Je ne saurais trop en témoigner à ce savant ma reconnaissance : car c'est à lui que je dois d'avoir pu compléter les derniers chapitres contenant les prières et les hymnes, une des parties les plus considérables de l'ouvrage.[7]
Je ne voyais plus rien d'important à recueillir, lorsque M. Le Barbier, ancien élève de l'école française d'Athènes, rapporta de cette ville, ou plutôt d'une excursion à Constantinople, un très bon manuscrit[8] qu'il voulut bien me prêter, et où je retrouvai la plupart les fragments édités par M. Hardt, pour lesquels je n'avais jusqu'alors d'autre autorité que le texte imprimé. J'ai donc pu à mon aise collationner ces morceaux et en amener le texte à un plus haut degré de précision. Que le jeune professeur à qui je dois ce secours, en reçoive ici mes remerciements.
Ainsi j'avais en main les moyens de rétablir l'œuvre de Pléthon, sinon dans son entier (car je n'ai pu retirer du feu les pages brûlées), du moins dans des proportions assez larges et dans des conditions d'exactitude suffisantes pour en donner une juste idée. Il fallait, après cela, de tous ces matériaux faire un livre, et ce livre, le mettre en état d'aborder la publicité. Je m'en occupai activement d'abord, selon mon usage; puis, à mesure que j'avançais, mon ardeur se ralentit ; je me laissai à mon tour entraîner par d'autres occupations ; je ne revins à Pléthon que fort tard ; et c'est après quinze ans que je me décide à laisser sortir de mes cartons ce vieux travail récemment achevé.
Voici donc tout ce qu'il a été possible de recouvrer d'un livre souvent regretté, dont la réputation s'est accrue par sa perte même, et qui, à ce titre seul, méritait de revoir le jour. Mais comme l'intérêt de cette publication repose en grande partie sur les souvenirs historiques qui s'y rattachent, j'essaierai d'abord de retracer la vie de Pléthon avec plus de détails et, si je le puis, avec plus d'exactitude qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, en insistant particulièrement sur les circonstances relatives à ses opinions et à son ouvrage.
George Gémistus, plus connu depuis sous le nom de Pléthon, naquit à Constantinople[9] vers 1355,[10] d'une famille qui ne manquait pas, dit-on, d’illustration. On ignore les causes qui l'obligèrent de quitter cette ville. Nous savons seulement qu'à une époque mal déterminée de sa vie, probablement vers la fin de sa jeunesse, il dut chercher un asile à Andrinople, alors capitale de l'empire ottoman : il s'y attacha à un certain juif Elisée, très influent auprès de la Sublime-Porte, lequel s'occupait de sciences occultes, et, finit par être brûlé vif.[11] C'est sans doute après In disgrâce et la mort de ce juif qu'il transporta sa résidence en Morée, où il s'établit à Mizithra, l'ancienne Sparte, chef-lieu dans ce temps-là d'une principauté grecque sous le gouvernement d'un des Paléologues. Il y passa presque tout le reste de sa vie, occupé de littérature et de philosophie, dont il semble qu'il tenait école, et investi, au moins dans les derniers temps, de hautes fonctions judiciaires.
On peut assigner aux commencements de cette époque son traité des Vertus,[12] où règne une doctrine saine, étrangère aux idées de sa vieillesse; peut-être aussi un autre ouvrage cité de lui, mais que nous n'avons pu nous procurer : Preuves physiques (ou naturelles) de l’existence de Dieu,[13] et la Prière au Dieu unique, que nous donnons en tête de nos pièces justificatives.[14]
C'est encore ici que nous placerions, mais sans nous renfermer dans des limites bien précises, la plupart de ses ouvrages historiques, géographiques et astronomiques.[15] Ces livres, pour la plupart simples compilations, témoignent d'une érudition laborieuse plutôt que d'une grande force de conception. Mais le génie qui conçoit et qui crée, n'était pas à cette époque une condition nécessaire pour se faire admirer, surtout en Grèce, dans ce pays tombé en dissolution, où les restes d'une littérature morte étaient abandonnés aux grammairiens et aux théologiens. D'ailleurs les qualités réelles de Gémistus, son instruction étendue dans tous les genres, sa profonde connaissance de l'antiquité classique, l'élégance même de son style, quoique un peu factice, et cette fleur d'atticisme dont il faisait parade, genre d'agrément si recherché des Grecs du Bas-Empire, suffisent pour expliquer la grande réputation qu'il obtint parmi ses compatriotes.
Il l'augmenta par quelques ouvrages qui annonçaient la direction de son esprit vers les idées politiques. Ainsi, vers l’an 1415, on le voit adresser un mémoire à l'empereur Manuel, et un autre au prince Théodore (le jeune), fils de l'empereur et nouveau despote de Morée, sur les affaires du Péloponnèse,[16] c'est-à-dire, sur l'organisation intérieure de ce pays. Il y trace d'une main ferme des plans hardis de réforme plutôt sociale qu'administrative, et ne craint pas de s'offrir lui-même pour les mettre à exécution. Un autre mémoire au même empereur sur les fortifications de l'Isthme[17] doit être à peu près de la même date, ainsi qu'un développement admiratif et emphatique de l'oraison funèbre prononcée par ce prince en l'honneur de son frère, éloge d'un éloge, rhétorique sur rhétorique, où le rhéteur ne cherche même pas à déguiser le courtisan.[18]
Tout cela prouve qu'il y avait dans le caractère de Pléthon quelque chose qui le poussait en dehors des études purement littéraires et spéculatives.[19] Je ne sais si, les circonstances aidant, il serait devenu un grand homme d'Etat ; les utopies qui règnent dans ses ouvrages en feraient douter. Néanmoins, les avis qu'il donna en plusieurs occasions sur des affaires politiques d'une haute importance[20] décèlent en lui beaucoup de jugement pratique; et le talent qu'il eut de conserver sa position intacte, malgré la hardiesse de ses opinions, jusqu'à la fin de sa vie, peur être considéré comme une preuve d'habileté plus qu'ordinaire.
Mais ce n'est pas ici sous ce rapport que nous avons à l'examiner. Comme littérateur, comme érudit, comme savant, sa supériorité sur la plupart de ses contemporains était incontestable ; et c'est à tous ces titres qu'il eut l'honneur de compter parmi ses disciples l'illustre Bessarion. Ce grand homme, dont rien n'annonçait alors la haute destinée, jeune encore et n'ayant d'autre ambition que celle de se préparer à l'état monastique, était venu se fixer dans un couvent de Morée. Il fut heureux, comme nous l'apprend son panégyriste Platina,[21] de pouvoir y profiter des leçons d'un maître si habile. Nous trouvons donc Pléthon à cette époque, c'est-à-dire, vers l'an 1420, en pleine possession de sa renommée, quoiqu'il eût dépassé la maturité de l'Age, sinon encore du talent; il devait avoir plus de soixante ans. Hâtons-nous de dire, à la louange du maître et de l'élève, que ces rapports laissèrent dans l'âme de Bessarion l'impression d'une reconnaissance profonde et durable. Plus tard, malgré l'élévation de sa fortune et les exigences politiques de sa position, il ne cessa point d'avouer le sage de Sparte pour son maître et d'entretenir avec lui une correspondance philosophique[22] : vivant, il l'avait honoré de ses respects, il les lui continua même après sa mort,[23] et il protégea sa mémoire contre les attaques de ses ennemis.[24]
En 1428, Gémistus reçut un autre grand hommage. L'empereur Jean Paléologue, voyageant en Morée, le consulta[25] sur la plus importante affaire politique qui occupât les esprits de ce temps, celle de la réunion des deux Eglises.[26] On sait que la cour de Constantinople, impuissante désormais à se défendre par elle-même contre les envahissements toujours croissants de la puissance musulmane, n'attendait plus de secours que du côté de l'Occident; mais la protection des Latins devait s'acheter au prix d'une conversion, et ce prix ne pouvait être débattu que dans un concile. L'empereur avait envoyé des ambassadeurs en Italie pour négocier la convocation d'un concile général, où lui-même assisterait avec les chefs de son clergé. Gémistus, sans approuver ce projet, convint que l'on pourrait cependant, à force de prudence et d'habileté, en retirer quelques-uns des fruits qu'on en espérait. Mais il dissuada l'empereur de livrer l'église grecque à la merci de l'église latine en les réunissant toutes deux dans une même assemblée sans avoir bien stipulé auparavant la manière de compter les voix, et sans avoir assuré aux deux parties une égale influence dans les délibérations : conseil excellent, s'il eût été praticable ! Nous croyons que dans l'esprit de Pléthon il cachait une opinion bien arrêtée sur l'impossibilité absolue de toute tentative de réconciliation.
Remarquons, au reste, que, dans le temps même où Gémistus était ainsi consulté sur les grands intérêts de la religion, à cette époque où, il faut bien le dire, il comptait encore Bessarion parmi ses plus fervents disciples, la pureté de ses opinions religieuses était déjà plus que douteuse. Il passait dès lors pour avoir en portefeuille un ouvrage contre le christianisme[27] : c'est Gennadius qui nous l'atteste, et son témoignage, quelque partial qu'on le suppose, est ici trop précis pour pouvoir être facilement rejeté. « Je savais, dit-il, et depuis longtemps, quel homme c'était; j'étais même instruit de l'existence de son ouvrage, tant par les rapports de plusieurs personnes dignes de foi que par les indices que j'avais pu moi-même en recueillir, d'abord en Morée, et plus tard en Italie.[28] » Or Gennadius, attaché à la cour par ses fonctions, ne semble guère avoir pu voyager en Morée autrement qu'à la suite de l'empereur et probablement dans la circonstance mentionnée ci-dessus. Gémistus passait donc dès lors pour ce qu'il fut toute sa vie, pour un esprit fort,[29] de là n'empêcha pas qu'il ne fût choisi pour accompagner au concile l'empereur Jean Paléologue, en 1437. Tiraboschi croit qu'il dut cet honneur à la recommandation de Bessarion, nouvellement promu à l'évêché de Nicée. Il put aussi être proposé pour cette distinction par son souverain immédiat, le prince Théodore (le jeune) ; ou peut-être l’Empereur se ressouvint-il des conseils qu'il avait autrefois demandés à ce même Pléthon, précisément sur les questions qui se débattaient en ce moment : mais la réputation du savant philosophe suffisait seule pour expliquer le choix dont il fut l'objet. Sa position sociale lui assignait d'ailleurs un rang honorable dans le cortège byzantin. Les historiens lui donnent à cette époque le titre de docteur[30] et de membre du sénat ou conseil impérial.[31] Ces honneurs étaient rehaussés par la dignité naturelle d'une vieillesse déjà octogénaire, mais belle comme les vieillesses de l'Orient, et forte encore de quinze ans de vie et de santé.
Au concile, il fit partie de la commission des six membres[32] choisis parmi les Grecs et chargés de soutenir pour eux la discussion, c'est-à-dire seulement, de préparer le travail de chaque session, d'y assister au nom de leur Église et d'y apporter le tribut de leurs lumières; car le droit de parler en assemblée générale était réservé spécialement à deux d'entre eux en leur qualité d'évêques, Bessarion de Nicée et Isidore de Russie. L'empereur l'avait expressément voulu ainsi, soit respect des règles canoniques, soit instinct des convenances, soit précaution contre la théologie toujours un peu suspecte des docteurs laïques. Nous voyons cependant Gémistus prendre une fois la parole dans le concile, peut être par forme de simple observation, et clore une des sessions[33] par une remarque fort judicieuse. Singulier contraste de son rôle officiel avec ses sentiments personnels, s'il est vrai qu'à Florence même, pendant la durée du concile, il tenait le propos qu'on lui prête : « qu'avant peu d'années une seule religion serait enseignée partout et universellement adoptée, religion qui ne serait ni celle du Christ, ni celle de Mahomet, mais une autre peu différente de celle des anciens Grecs.[34] » Ici ce n'est plus Gennadius, c'est un autre adversaire, et il faut le dire, un violent ennemi, George de Trébizonde, qui lui attribue ce langage, attestant l'avoir entendu lui-même : témoignage suspect, croyable pourtant, quand on le rapproche de l'extrême licence d'opinions qui régnait alors, et de tout ce que nous savons et saurons plus tard des idées religieuses de notre auteur. Avec une telle disposition d'esprit, on peut deviner comment il employa son séjour en Italie. Hors sa participation nécessaire aux travaux du concile et les conseils auxquels il était souvent appelé,[35] nous croyons qu'il s'occupa beaucoup moins des affaires de son église que du soin de sa propre réputation. Il était fort lancé dans la société des gens de lettres et des gens du monde,[36] fort avant surtout dans la faveur de Cosme de Médicis,[37] à qui il expliquait la philosophie de Platon, toute neuve encore pour les oreilles italiennes. Telle fut l'impression de ces entretiens, que Médicis, au rapport de Ficin,[38] conçut dès lors le projet, plus tard réalisé, de son académie platonicienne. Enfin ce fut dans ce temps qu'à la demande de plusieurs personnes et probablement de Médicis lui-même, il composa son petit traité sur les Différences entre les doctrines d'Aristote et celles de Platon,[39] premier signal de la controverse entre les deux écoles, et du mouvement qui devait ébranler d'abord et, deux siècles après, renverser la scolastique du moyen âge. Est-ce alors, ou seulement à son retour en Grèce, que, dans son enthousiasme classique, il imagina de quitter son nom de Gémistus pour celui de Pléthon, qui en grec signifie la même chose ? Il y trouvait deux avantages : d'abord le nouveau nom sonnait mieux à une oreille attique,[40] ensuite il ressemblait à celui de Platon.[41] C'était une petitesse ; on la lui passa dans un temps où ces changements commençaient à devenir ordinaires.[42] Ce nom, adopté d'enthousiasme par ses disciples et ses admirateurs, fit presque aussitôt oublier l'autre. Ses ennemis seuls en rirent ou le parodièrent ; quelques-uns eurent la faiblesse de s'en indigner, comme d'un pas de plus vers le paganisme.[43]
Pléthon, après le concile, retourna en Grèce, et sans doute immédiatement à Mizithra, où Filelfe nous le montre, en 1441, dans l'exercice de sa magistrature.[44] On ne peut douter que, dans l'ivresse de ses succès d'Italie, il n'ait repris alors avec plus d'ardeur et de suite son grand ouvrage de la Législation ou fies Lois, destiné, selon lui, à produire dans le monde une révolution morale et religieuse ; ouvrage depuis longtemps préparé dans l'ombre, auquel Gennadius faisait allusion tout à l'heure, et dont nous publions aujourd'hui les fragments. Que cet ouvrage fut déjà non seulement conçu en projet, mais rédigé en partie, avant l'époque du concile, c'est ce qui résulte du témoignage déjà cité de Gennadius ; mais c'est aussi ce que démontrent les fragments presque textuels de ce livre qu'on trouve épars et dans le commentaire de Pléthon sur les oracles de Zoroastre et dans le traité même sur les différences entre Aristote et Platon, ainsi qu'on s'en convaincra par nos extraits de ces deux ouvrages à la fin de notre volume.[45]
Certes, c'était alors ou jamais, à un âge où il ne reste plus guère d avenir que dans la postérité, le moment de mettre la dernière main à ce livre qui, dans sa pensée, devait consacrer sa gloire et assurer le triomphe de ses opinions. Mais nous le verrons interrompu dans ce travail par d'autres occupations, et surtout par les attaques que lui attira sa levée de boucliers contre Aristote.
Boivin le jeune[46] remarque avec raison que la dispute sur Aristote s'émut d'abord entre les Grecs seuls et que les Italiens n’y prirent aucune part, trop peu familiers alors avec les doctrines de Platon, dont les ouvrages récemment importés en Occident n'étaient pas encore traduits.[47] Même entre les Grecs, les hostilités ne s'engagèrent que lentement. Les objections de Bessarion à Pléthon et les réponses de ce dernier,[48] conçues dans les termes de la plus haute estime, ne ressemblent ni à un combat ni même à une escarmouche.[49] Le premier qui releva fièrement le gant jeté à Aristote fut Gennadius. Obligé de parler souvent de cet bomme célèbre, je l'appelle ainsi dès à présent, par anticipation du nom qu'il prit un peu plus tard en se faisant moine[50] et sous lequel il parvint au trône patriarcal. A l'époque qui nous occupe, c'était encore George Scholarius,[51] grand juge et président du tribunal impérial,[52] en même temps secrétaire général de l'empereur et docteur laïque à la suite de la cour,[53] qualités qu'il portait déjà au concile de Florence, lorsqu'il s'y faisait remarquer par ses efforts en faveur de l'union. Mais ses idées avaient bien changé depuis cette époque; car il travaillait maintenant à rompre l'union avec autant de zèle qu'il en avait mis autrefois à la former.[54] Il semblait qu'un secret pressentiment l'avertît de combattre d'avance pour l'indépendance du siège qu'il devait occuper un jour. Il fit trêve néanmoins à ses occupations théologiques pour défendre Aristote dans un écrit aujourd'hui perdu,[55] sauf quelques extraits conservés par Pléthon lui-même dans sa réplique.[56]
Gennadius a toujours prétendu qu'il s'était engagé dans cette querelle beaucoup plus par zèle pour la religion que par amour d'Aristote, et qu'il eut gardé le silence s'il n'eût aperçu la pensée païenne de Pléthon sous sa tentative de réforme philosophique. Il le fait entendre dans sa lettre d'envoi à Marc d'Ephèse, morceau peu connu que nous publions pour la première fois.[57] Il le répétera dans sa lettre à Joseph l'Exarque, que nous publions aussi[58] et que nous aurons souvent occasion de citer. Mais quelle que fût au fond la pureté du motif, garda-t-il dans la forme toute la mesure convenable ? Pléthon lui reproche des injures, des invectives, des menaces.[59] Nous ne trouvons, dans les extraits qui nous restent, qu'un ton de persiflage,[60] offensant à la vérité, mais non jusqu'à justifier de violentes représailles. Quoi qu'il en soit, l'amour propre du philosophe se soulagea en jetant sur le papier, sous forme de réplique, une amère diatribe ; mais elle ne parut pas tout de suite. Avant de la publier, Pléthon l'envoya secrètement à l'empereur, comme pour la soumettre au jugement de ce prince, mais en effet pour s'assurer d'avance sa protection ou sa neutralité : en attendant il dissimula. Gennadius put même espérer que les choses n'en viendraient pas à une rupture ouverte, et il y eut une correspondance polie dans la forme, un peu aigre au fond, dont nous donnerons plus bas un échantillon curieux. Cette suspension d'armes s'explique par deux circonstances : d'abord, Pléthon craignait peut-être l'influence de Gennadius à la cour; ensuite, il s'occupait alors de composer par ordre, dit-il, c'est-à-dire, à l'instigation de quelque personnage influent, peut-être du prince Démétrius, grand partisan du schisme, un traité sur la Procession du Saint-Esprit,[61] qui parut quelque temps après.
Nous ne parlerions pas de ce dernier ouvrage, tout théologique en apparence, s'il ne se rattachait précisément à notre sujet, et s'il n'était venu comme exprès pour justifier les méfiances de Gennadius. Nulle part, en effet, dans les précédents ouvrages de Pléthon, son système païen ne se montre aussi nettement arrêté que dans celui-ci. En voici les principaux traits dessinés avec une exactitude assez bizarre au début d'un traité sur le Saint-Esprit :
« L'ouvrage qui vient de paraître en faveur des Latins (il s'agit de quelque nouvelle publication de Bessarion ou d'Argyropule[62] s'appuie sur un principe très cher à la théologie grecque (c'est-à-dire, païenne), mais très-contraire à celle de l'Eglise, savoir, que des puissances ou facultés différentes ne peuvent appartenir qu'à des essences différentes... Quoi de plus contraire, en effet, au système de l'Église ? Car la théologie grecque (ou païenne) plaçant au-dessus de tous les êtres un Dieu unique, le Dieu suprême, indivisible dans sa substance, et lui donnant plusieurs enfants et descendants de divers ordres, inférieurs ou supérieurs les uns aux autres, chargés de présider chacun à une partie plus ou moins importante du grand Tout, n'admet pourtant pas qu'aucun d'eux puisse être égal à son père ni même en approcher : elle leur donne, au contraire, une essence de beaucoup inférieure, et par conséquent une divinité d'un ordre différent. En même temps donc qu'elle les appelle fils de Dieu et Dieux eux-mêmes, elle les reconnaît ouvrages de ce même Dieu, ne croyant pas devoir, en parlant d'actes divins, distinguer la génération de la création, non plus que séparer la nature de Dieu de son activité. Elle établit ainsi entre les fils de Dieu des degrés différents d'essence et de divinité, en vertu de quel principe ? sinon que des puissances différentes ne peuvent appartenir qu'à des essences différentes. Mais l'Eglise évidemment rejette cet axiome : autrement elle ne dirait pas que le Fils est égal au Père et de la même essence. Comme en effet le Père, etc. » Il poursuit sa discussion, désormais étrangère à notre sujet, s'appuyant ou feignant de s'appuyer sur les principes de la théologie ecclésiastique, comme il l'appelle par opposition à la théologie grecque ou païenne. Il ne parle même plus de cette dernière ; mais n’a-t-on pas vu sa prédilection pour elle percer à chaque mot dans le passage que nous venons de citer? N'est-il pas même évident que sa prétendue théologie grecque n'est point celle des anciens, mais la sienne? Et s'il restait quelque doute à ce sujet, il cesserait bientôt par la comparaison de ce même passage avec les chapitres conservés du Traité des Lois.
Gennadius ne s'y méprit point : aussi s'empressa-t-il de composer une réponse qu'il adressa sous forme de lettre à Pléthon lui-même, et qui sans doute fut en même temps publiée.[63] Cette lettre, dont le seul défaut'est d'être trop longue, est un chef-d'œuvre d'habileté oratoire. La position était délicate : il fallait tout à la fois louer Pléthon d'avoir défendu la bonne cause et lui reprocher de l'avoir mal défendue, le féliciter sur son orthodoxie et lui faire sentir qu'on n'y croyait pas, le ménager comme un homme dangereux et l'intimider en lui montrant qu'on le connaissait et qu'on était prêt à le démasquer, le tout en gardant les ménagements de la politesse et les dehors d'une liaison encore existante, mais déjà bien près de se rompre. L'exorde peut donner une idée des rapports qui subsistaient alors entre ces deux hommes : « J'ai reçu, ô le meilleur de mes amis et le plus savant, la lettre où vous m'assurez que vous m'aimez, que vous n'avez rien contre moi, et ne voulez rien faire par colère. Vous me dites aussi que vous avez envoyé à l'Empereur votre réplique à mon plaidoyer pour Aristote. Mais en même temps il paraissait de vous un traité contre les Latins dont vous ne me parlez pas, et votre silence sur ce sujet ressemble un peu à de la rancune... Le hasard a fait tomber ce traité entre mes mains. Quant à votre réplique au sujet d'Aristote, le très-auguste Empereur n'a pas jugé à propos de me la communiquer, et, si j'ose le dire, il s'est montré en cela plus jaloux que vous-même de votre gloire... Peut-être cet écrit que je regrette, quelqu'un viendra-t-il me l'offrir un jour, sans que je le demande, soit dans l'intention de me faire plaisir, soit dans l'espoir de me chagriner. » L'auteur passe ensuite en revue tous les arguments de Pléthon, les appuyant d'autres preuves plus solides ou les réfutant sous la forme d'une approbation polie. C'est ainsi qu'il félicite beaucoup Pléthon de n'avoir pas adopté les principes cités dans son discours comme empruntés à la philosophie grecque ou païenne. « Que s'il se trouvait, ajoute-t-il,[64] des hommes assez insensés pour vouloir aujourd'hui renouveler ces antiques folies du paganisme, leur aveuglement serait impardonnable. En effet, depuis que le Verbe lui-même est venu enseigner au monde le grand principe de l'unité divine, quel crime ne serait-ce pas de vouloir refaire des Dieux multiples, de réchauffer après tant de siècles les cendres éteintes du polythéisme, et de demander à la philosophie non-seulement la reconnaissance d'un nouvel Olympe que n'avait pas rêvé le cerveau des poètes, mais un culte nouveau, une religion simplifiée,[65] comme disent quelques-uns, destinée à refondre la société et les mœurs d'après les idées de Zoroastre, de Platon et des Stoïciens[66]... S'il arrivait que de telles impiétés vissent le jour dans quelque ouvrage, je m'engage à les confondre : d'autres sans doute le feraient aussi bien, mais je réclame l'honneur d'un tel combat; j'attaquerai ce livre non par le feu,[67] mais par la raison et la vérité. Le feu, c'est aux auteurs qu'il faudrait le réserver. » Ce dernier trait est trop fort sans doute, et nous aimons à ne pas le prendre au sérieux ; la charité nous oblige à croire que c'est un tour oratoire plutôt qu'une menace, menace qui, d'ailleurs, dans le pays où Gennadius écrivait n'avait de sens que comme allusion aux mœurs occidentales.[68]
Pléthon ne répondit pas, mais Gennadius observe quelque part[69] que cette lettre eut du moins le bon effet de l'engager à plus de circonspection. D'ailleurs, qu'aurait-il répondu ? des injures ? Son arsenal était vide ; il l'avait épuisé dans sa réplique en faveur d'Aristote. Il n'eut donc, qu'à faire paraître alors cette pièce jusqu'alors gardée en portefeuille. Gennadius, qui avait désiré la connaître, sut au juste à quoi s'en tenir, et assurément, quelque idée qu'il eût pu s'en faire, il ne s'était pas attendu à un tel excès de violence. Nous avons cette diatribe; elle existe dans plusieurs manuscrits des bibliothèques de France et d'Allemagne ; elle a été publiée récemment par M. W. Gass, à la suite de son ouvrage intitulé Gennadius und Pletho, Breslau, 1844. Elle donne une idée du caractère de Pléthon, et de la fureur que l'orgueil irrité d'un philosophe peut porter dans la controverse.
Gennadius, à son tour, garda le silence ; c'était le parti le plus sage. D'autres causes, d'ailleurs, ne lui permirent pas de donner suite à ce triste débat. « J'en fus empêché, dit-il, par le malheur de ma patrie.[70] » Ce mot semble d'abord se rapporter à la prise de Constantinople, et l'on serait tenté d'en conclure que tout ceci se passait la veille même de cette grande catastrophe. On aurait tort pourtant de le croire. Gennadius, dans sa lettre sur le Saint-Esprit, qui dut suivre de près et tout au plus à quelques mois de distance le traité de Pléthon sur le même sujet, fait évidemment allusion à l'avènement récent de l'empereur Constantin, qui commença, comme on sait, de régner en novembre 1448. On y voit aussi que Gennadius venait de prendre l'habit monastique, ce qu'il fit, à ce qu'il paraît, dès l'ouverture du nouveau règne, en haine du culte latin placé sur le trône. La réplique de Pléthon au sujet d'Aristote parut bientôt après, comme une vengeance pressée de se satisfaire. On voit donc que la publication de ces trois ouvrages reste à peu près renfermée entre les années 1448 et 1449 et par conséquent il faut croire qu'en parlant du malheur de sa patrie, qui lui aurait imposé le silence, Gennadius confond dans sa pensée toutes les calamités du dernier règne.[71]
Les dates que nous venons d'indiquer nous paraissent confirmées par d'autres indices. Ainsi, dans une réplique aux objections de Bessarion à son traité sur le Saint-Esprit, Pléthon parle du patriarche actuel comme s'étant opposé, lors du concile de Florence, à ce que la parole fut donnée aux laïques. Or, il s'agit évidemment de Grégoire Mammas, de qui Syropule rapporte la même chose presque dans les mêmes termes.[72] Il fut fait patriarche en 1445, et s'enfuit de Constantinople, pour échapper aux fureurs des fanatiques, en 1451 : c'est juste au milieu de l'espace entre ces deux limites que nous étions placés tout à l'heure.
De plus, nous avons vu Pléthon prendre subitement le parti de publier sa diatribe contre Gennadius, déposée, comme nous le savions déjà, entre les mains de l'empereur Jean Paléologue. De hautes convenances se seraient opposées à cette publication du vivant de ce prince ; au contraire, après sa mort, il n'y avait plus d'obstacle. Mais combien de temps cet ouvrage était-il ainsi resté en dépôt ? Quatre ans au moins ; car nous devons croire que sa composition suivit de près l'apparition du livre auquel il répondait. Or nous supposons celui-ci écrit en 1443 ou 1444. On peut même trouver que c'est trop tard. En effet, le premier écrit de Pléthon contre Aristote fut composé, comme nous l'avons vu, en Italie, par conséquent en 1438 ou 1439, et Gennadius n'aurait répondu que quatre ans après ! Mais ce dernier, dans le début de son plaidoyer, va lui-même au-devant de l'objection : « Le livre des calomnies contre Aristote étant, dit-il, venu tard entre mes mains… » Et en effet, il se peut que cet ouvrage, composé pour quelques savants italiens, en vue peut-être d'une publicité assez restreinte, peut-être à la veille de la clôture du concile, n'ait pas été connu de Gennadius pendant son séjour en Italie. Plus tard, les embarras du voyage, la dispersion des Grecs dans leurs diverses résidences, l'éloignement des lieux et la difficulté des communications, mais plus que tout cela les troubles religieux auxquels Gennadius ne prit que trop de part, purent fort bien, pendant quelque temps, dérober à sa connaissance le factum platonicien, ou lui ôter le loisir d'y répondre. Il semblerait même, d'après la réplique de Pléthon, que Gennadius avait hésité longtemps à faire paraître cet ouvrage, qu'il avait promis et qu'on attendait avec impatience ; il ne s'y serait décide que malgré lui, lorsqu'un plus long retard devenait impossible, soit qu'il ne fut pas content de son travail, soit qu'il lui en coûtât de s'engager dans une polémique dangereuse contre un homme moins théologien que lui, mais plus exercé sur les matières philosophiques. L'objection perd ainsi toute sa force, et ne saurait prévaloir contre les raisons chronologiques que nous avons données et qui peuvent se résumer ainsi :
1438-39. Première attaque de Pléthon contre Aristote.
1443 (ou environ). Plaidoyer de Gennadius en faveur d'Aristote.
1444 (ou environ). Réplique de Pléthon, mais non publiée à cette époque.
Traité de Pléthon sur le Saint-Esprit.
1448-1449 Réponse de Gennadius à ce traité.
Publication tardive de la réplique de Pléthon un plaidoyer en faveur d'Aristote.
A partir de cette controverse, nous n'entendons presque plus parler de Pléthon : seulement en 1450 il composa une courte oraison funèbre en l'honneur de l'impératrice douairière Hélène, veuve de l'empereur Manuel,[73] comme en 1433 il en avait composé une en l'honneur de la princesse Cléopa, femme de Théodore le jeune.[74] Son dernier opuscule paraît être le petit compliment qu'il adressa sans doute aussi vers 1450 au prince Démétrius, nouveau despote de Sparte, sur sa réconciliation avec son frère Thomas, despote d'Achaïe.[75]
Ces morceaux font pressentir l'affaiblissement de l'âge. Cependant on peut croire que, jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa pas de travailler à son ouvrage sur les Lois, puisqu'il est certain que, même dans cette grande et prodigieuse vieillesse, il conserva toujours le libre usage de ses facultés.[76]
Nous le voyons jusqu'à ses dernières années exercer paisiblement ses fonctions judiciaires à Mizithra, environné de la considération publique, objet d'une sorte de culte pour un cercle choisi de disciples qui se pressaient autour de lui. Il fut emporté par une courte maladie,[77] laissant deux fils, à qui Bessarion écrivit pour les consoler. L'Eglise lui donna une tombe, et il fut honoré de plusieurs oraisons funèbres, dont deux nous sont parvenues.[78]
L'année de sa mort est incertaine. Précéda-t-elle ou suivit-elle la chute de l'Empire ? Car on sait qu'après la prise de Constantinople, la Morée, tributaire, mais non sujette des Turcs, conserva encore pendant quelques années ses princes Paléologues et une ombre d'existence nationale. Ainsi ce grand malheur, tout en affligeant la vieillesse de notre philosophe, n'eut rien changé à sa position, et ce que nous avons dit de ses dernières années s'explique dans l'une et l'autre hypothèse. Attachons-nous donc au seul document authentique que nous ayons[79] pour fixer le terme de sa vie. George de Trébizonde, dans son livre sur la comparaison de Platon et d'Aristote, dirigé en grande partie contre Pléthon, le fait mourir presque centenaire[80] trois ans avant l'époque où il écrivait. C'est cette époque qu'il s'agit d'établir.
Apostolo Zéno, dans ses curieuses recherches sur la biographie de quelques savants italiens de ce temps-là,[81] suppose que l'ouvrage de George de Trébizonde fut écrit à Rome et devint même la cause principale de la disgrâce qui lui fit quitter cette ville en 1453. Mais cela n'est pas possible : car dans une note autographe citée par Zeno lui-même, il attribue son malheur à une autre cause, à ses commentaires sur l'Almageste,[82] et dans l'ouvrage même qui nous occupe, il fait allusion à des faits plus récents[83] ; il cite lui-même deux autres de ses écrits, composés notoirement à Naples pendant son exil;[84] il se représente pauvre, infirme, persécuté, accablé de chagrin et de misère,[85] ce qu'il n'eût point fait avant sa disgrâce, étant secrétaire du pape Nicolas V. Il résulte enfin d'un examen plus attentif de cet ouvrage qu'il fut composé à Naples, lorsque l'auteur songeait à quitter cette ville pour Venise,[86] où en effet il vint s'établir après la mort du roi Alfonse son bienfaiteur. Or, la date de son arrivée à Venise est connue : un document certain la fixe à 1459.[87] C'est donc entre 1453 et 1459, qu'il faut fixer la composition de son ouvrage. Aussi vers la fin de son troisième livre,[88] fait-il allusion à Démétrius comme étant encore sur le trône du Péloponnèse, et ce prince cessa de régner en mai 1460.[89] Pléthon, mort trois ans auparavant, aurait donc achevé sa vie entre 1450 et 1456. Une note anonyme d'un manuscrit de Munich fixe sa mort au mois de juin 1452, il n'y a point d'objection valable à y opposer; et s'il est vrai qu'il mourut presque centenaire, nous avons eu raison de le faire naître vers l'an 1355.[90]
Nous avons dit qu'en 1460 Démétrius fut détrôné. Ménagé cependant comme beau-père du sultan, il fut transféré à Andrinople pour y unir ses jours dans une sorte de demi-captivité, qu'il ne sut même pas rendre honorable.[91] Sa femme dut suivre la sultane sa fille à Constantinople.[92] Ici commence une ère nouvelle dans l'histoire du livre de Pléthon, et, pour la connaître, nous n'avons plus qu'à laisser parler le patriarche. Gennadius dans sa lettre à Joseph l'Exarque.[93] « Après la mort de Gémistus, dit-il, son livre passa entre les mains de ceux qui gouvernaient le Péloponnèse.[94] Dès qu'ils en eurent pris connaissance, ils résolurent de me l'envoyer, et ils résistèrent aux instances de ceux qui demandaient à en prendre des copies.[95] Néanmoins, les circonstances ne leur permettant pas d'exécuter immédiatement leur projet, ils conservèrent le volume, et plus tard, la suite des mêmes circonstances leur donna lieu de me l'apporter eux-mêmes. A l'ouverture du livre, quelle ne fut pas ma douleur, etc. » Ici Gennadius donne une analyse du Traité des Lois, ou plutôt une simple indication des matières, parfaitement conforme à la table et aux fragments que nous possédons. Il hésita d'abord si, sur les simples titres des chapitres, il ne condamnerait pas l'ouvrage entier. Il se décida pourtant à le lire d'un bout à l'autre pour juger en parfaite connaissance de cause. « Cette lecture, dit-il, m'occupa quatre heures, et je vis comment le texte répondait aux promesses des titres. En même temps, je me sentis agité par une foule de sentiments divers. Je riais d'un tel excès d'absurdité; je gémissais sur la perte de cette âme autrefois chrétienne; je détestais la malice des démons qui, en l'éloignant des sentiers de la grâce, l'avaient précipitée dans l'erreur. Et puis je maudissais la folle impiété dont le monde fut esclave pendant tant de siècles, et je remerciais Dieu de nous en avoir délivrés. Je déplorais enfin le malheur, la honte, l'opprobre, de notre nation. Fallait-il, hélas! à tant de maux ajouter ce comble ! Fallait-il que tout l'honneur des lettres grecques reposât sur la tête d'un seul homme, et que tel fût pour cet homme le fruit d'une si longue vie et de tant d'études !... Je m'affligeais de voir un vieillard perdre tant de peine à choisir et à combiner des mots pour en revêtir de si détestables idées : on eut dit d'un habile artiste consumant sur une matière vile et fragile le talent dont il pouvait faire un noble usage... Et quand, après cette lecture, pour la résumer dans ma pensée, j'eus repassé les titres et les préambules, mes yeux se remplirent de larmes,... et, comme si je parlais à Pléthon lui-même, comme s'il comparaissait devant moi pour entendre sa sentence : Insensé, lui dis-je, il n'y a qu'une loi, qu'une règle de la société humaine, c'est la doctrine sainte. Et toi, l'abandonnant pour de coupables systèmes, tu oses t'ériger en législateur ! Mais qui donc as-tu pensé séduire, etc. »
Il poursuit avec l'éloquence de la conviction, et nous regrettons de ne pouvoir ici donner en entier ce morceau remarquable. Par les grandes idées qu'il expose sur Dieu, sur la religion, sur les lois éternelles de la morale, ce passage seul justifierait la résolution que nous avons prise d'insérer la lettre tout entière à la fin de notre volume.
« Après avoir ainsi, ajoute-t-il,[96] fait le procès à l'auteur, je refermai le volume, et le renvoyai à l'auguste princesse, en lui mandant de le jeter au feu; mais elle me le renvoya à son tour, en me marquant que c'était à moi qu'il appartenait à tous les titres d'exécuter la condamnation. » On voit par cette phrase que la princesse, épouse de Démétrius,[97] avait joué un très-grand rôle dans cette affaire ; et c'est là ce qu'entend l'auteur anonyme dont nous publions la complainte oratoire sur la perte du livre de Pléthon, quand il attribue ce malheur à une intrigue de femme.[98]
Gennadius continue[99] : « Je voulus, alors essayer d'en conserver du moins quelques parties, celles qui se rapportaient aux sciences physiques, à la logique bu à d'autres matières semblables. Mais après un nouvel examen, je reconnus qu'aucune partie ne pouvait échapper à la censure, non-seulement à cause du paganisme qui dominait tout l'ensemble, mais aussi parce que l'erreur se glissait partout dans les détails. »
Ici sont relatées plusieurs propositions étranges en morale, ou évidemment hostiles au christianisme, qui se trouvaient répandues dans le corps de l'ouvrage, et dont quelques-unes subsistent dans les morceaux qui nous restent. La conséquence fut que Gennadius livra tout au feu, à l'exception de quelques feuillets conservés comme pièces de conviction.[100]
Tous ces détails, tirés de la lettre de Gennadius, ne sont pas sous sa plume un simple récit, mais bien un compte-rendu de sa conduite ; et la preuve que cette lettre est un acte officiel et, sous l'adresse de Joseph l'Exarque,[101] une véritable circulaire, un mandement pastoral destiné à la plus grande publicité, c'est le dispositif qu'il y ajoute : « Et comme, dit-il,[102] il est possible qu'il existe quelque part une copie de cet ouvrage prise par les amis de l'auteur, soit de son vivant, soit après sa mort, nous ordonnons, de la part de Dieu, à tous et à chacun, de quelque manière et en quelque lieu que ce livre leur tombe entre les mains, de le brûler à l'instant même, s'ils en ont la faculté, et quiconque sera convaincu de l'avoir recelé, après une première et une seconde admonition, s'il refuse ou s'il ne s'empresse pas de le détruire, qu'il soit retranché de la communion des fidèles. « C'est bien là le langage de l'autorité épiscopale, et il faut en conclure que Gennadius écrivit cette lettre étant encore patriarche. A quel titre, en effet, après son abdication, aurait-il prononcé ces anathèmes ? La date de la lettre, et celle par conséquent de la destruction du livre, est donc à peu près certaine. Cette lettre n'a pu être écrite avant 1460, puisque la translation de la famille régnante de Sparte, selon Phrantza, IV, § 16, est du printemps de cette année ; et elle ne peut être de beaucoup postérieure. Elle devrait même être antérieure, si l'on admettait, d'après l'histoire anonyme publiée par Martin Crusius, que Gennadius n'a occupé le trône patriarcal que cinq ans et quelques mois. Car en plaçant l'époque de sa consécration et de son institution définitive au printemps de 1454 (ce qui est le plus tard possible),[103] on n'arriverait qu'à la fin de l'année 1459. Pour que la destruction du livre puisse s'expliquer, il faut donc allonger au moins d'un an la durée du patriarcat de Gennadius, et rejeter son abdication à la fin de 1460. Mais le plus simple est d'admettre plusieurs abdications ou destitutions et plusieurs réintégrations successives, ce qui résulte au reste du titre d'un manuscrit cité par Renaudot dans la Bibl. gr. de Fabricius, tom. XI, p. 374, n° 9, éd. Harles. Comme il y a doute sur l'époque précise où Gennadius cessa définitivement d'être patriarche, notre renseignement peut servir à combler une lacune dans la chronologie de l'Eglise grecque.[104]
Ainsi périt l'ouvrage que nous essayons de ressusciter au moins en partie. Editeurs de Pléthon, protesterons-nous contre l'arrêt de sa condamnation, et y verrons-nous, comme ses partisans d'autrefois[105] ou comme quelques critiques plus modernes,[106] un acte de fanatisme intolérant ou de basse jalousie ? Je pense, pour moi, tout différemment : à mes yeux, Gennadius fit son devoir. Chef de la religion de son pays, juge en matière de foi, il jugea, il condamna l'ouvrage déféré à son tribunal : à défaut du bras séculier, il exécuta lui-même la sentence. Et pourquoi aurait-il épargné un livre dont l'existence dangereuse, selon lui, pour la foi et pour les mœurs, était remise entre ses mains ? Est-ce que ce livre, par sa bizarrerie, qui pour nous en fait l'intérêt, mais n'en augmente pas le mérite, acquérait des droits à l'indulgence ? Est-il offert plus d'intérêt encore, fallait-il que le patriarche se plaçât au point de vue du philosophe ou du littérateur ? Car, ne nous faisons pas illusion, il est peut-être curieux aujourd'hui d'éclaircir un point obscur d'histoire littéraire ; il y a du plaisir à observer à cette distance la fermentation des idées dans certaines têtes, et le rapport de ces idées avec d'autres qui se sont développées un peu plus tard. Cette étude peut même donner lieu à des rapprochements de quelque utilité ; mais rien de tout cela n'existait pour les contemporains. Ce qui existait, c'était le danger d'ajouter une cause nouvelle d'ébranlement à toutes celles qui déjà faisaient chanceler la foi dans les âmes : en Grèce, le triomphe matériel de l'islamisme et l'ascendant de la force physique sur une population grossière et ignorante ; dans tout le reste de l'Europe, le relâchement général du principe religieux et l'engouement pour les souvenirs rajeunis du paganisme.[107] Etait-ce le moment de laisser mettre la sape aux fondements mêmes du christianisme, et d'abandonner la religion, comme déjà vaincue, aux sarcasmes de son ennemi ? Je dis aux sarcasmes, car Pléthon ne se faisait pas faute de ce genre d'attaques. « Trouve-t-il, dit Gennadius,[108] dans nos lois ou dans nos usages quelque chose de contraire à ses idées, aussitôt ce sont à ses yeux des inventions de charlatans et de sophistes, des pratiques d'insensés, et, en un mot, tous ses chapitres sont pleins du fiel qu'il vomit contre le christianisme, injuriant nos dogmes au lieu de les réfuter, imposant les siens sans les démontrer. » A la vérité, dans ce qui nous reste, nous ne trouvons point cette violence de langage; elle est cachée sous une ironie dédaigneuse ou sous des périphrases transparentes. Mais tout le chapitre 1er de son premier livre, sous prétexte d'exposer les différences d'opinions entre les hommes, n'est-il pas une suite de critiques obliquement dirigées contre les pratiques de notre religion, contre le célibat, contre l'abstinence, contre les ordres religieux, contre la promesse des récompenses divines, contre l'efficacité des prières ? Ces expressions mêmes de sophistes et de charlatans s'y lisent en toutes lettres; et à qui fait-il allusion dans son chapitre 2 du livre I, quand il parle des plus charlatans d'entre les sophistes, de ceux qui réussissent à tromper les masses par de faux miracles, miracles qui agissent d'abord sur l'esprit des faibles, sont ensuite grossis par les rapports oraux et par les récits des écrivains, puis entrent par l'éducation dans nos croyances, et font le plus grand tort aux États en accréditant des idées absurdes sur les choses les plus importantes de la société[109] ? » Avec nos habitudes de liberté philosophique, nous serions disposés à tolérer tout cela : mais un esprit vraiment religieux ne saurait se prêter à cette connivence, à plus forte raison un prêtre, un évêque ; surtout si vous le constituez juge, et juge d'un ouvrage posthume non publié ; s'il s'agit par conséquent d'exhumer les idées d'un mort, de violer le secret de son portefeuille, dernier asile de sa conscience, et de faire en son nom le mal qui n'existait encore que dans sa pensée.
Tels furent, n'en doutons pas, les motifs déterminants de Gennadius. Mais, encore une fois, la faiblesse du cœur humain mêla-t-elle à ces considérations religieuses quelque ombre de sentiments moins purs ? Rien ne le prouve. Seulement on est tenté de le soupçonner, quand on songe aux derniers rapports de ces deux hommes, et aux circonstances qui avaient préparé de loin leur rupture. En effet, depuis le départ pour le concile,[110] il semblait que la fortune eût pris plaisir à les tenir constamment en regard l'un de l'autre, avec tout ce qui peut éveiller l'instinct de la jalousie : les mêmes titres et une position à peu près égale, malgré une grande différence d'âge; un talent égal, quoique divers, et une complète opposition de caractère et de principes. Gennadius pourtant s'est défendu contre ce soupçon avec l'accent de la vérité : « Quelques-uns, dit-il,[111] ne voulant ni tenir compte des faits, ni s'en rapporter à l'opinion de ceux qui me connaissent et au témoignage de ma vie entière, ont prétendu que, dans mes rapports avec Pléthon, la jalousie m'avait poussé à la calomnie. Mais, j'en atteste Dieu, dont le nom ne saurait sans crime être invoqué à l'appui du mensonge, jamais, pendant tout le cours de ma vie, je n'ai déguisé ma pensée pour nuire à autrui. Il m'est plutôt arrivé de faire fléchir la vérité en faveur de quelqu'un par obligeance, quand cela ne pouvait porter préjudice à personne, et j'en ai souvent été récompensé par l'ingratitude... Mais quels pouvaient donc être mes motifs de jalousie contre Pléthon ? Dieu m'avait accordé assez d'avantages pour n'avoir rien à lui envier. C'eût été le comble de la bassesse d'attaquer, sous prétexte de religion, un homme qui n'avait eu aucun tort envers moi, et qui, à tout prendre, ne le cédait en mérite à aucun de ses contemporains. »
Et ce qui semble confirmer ces protestations, c'est en effet la modération générale de sa conduite. On le voit, dans un de ses écrits, regretter et même désavouer tout ce qui, dans son plaidoyer pour Aristote, aurait pu blesser la partie adverse. Et ailleurs, tout en s'élevant avec force contre les doctrines du nouveau philosophe, il s'empresse de rendre justice à ses mœurs et à son talent. « Du reste, écrit-il à Marc d'Ephèse, c'est un homme d'un vrai mérite, qui ne le cède à « personne pour l'étude approfondie du plus noble dialecte de notre langue[112]... Il y joint une infinité d'autres belles connaissances. Et quant à ses mœurs, il mérite d'être proposé pour exemple aux jeunes gens qui attachent du prix à la vertu.[113] »
Ce n'est point là le langage d'un ennemi. Pourquoi donc serions-nous envers Gennadius plus sévères que sa propre conscience ? Mais quand même on s'obstinerait à lui supposer quelque animosité personnelle, il est certain que cette partialité, réelle ou non, dut avoir peu d'influence sur sa décision; car nous avons vu que, comme magistrat ecclésiastique, sa ligne de conduite était impérieusement tracée.
Pour nous, plus libres dans nos jugements, essayons d'examiner l'ouvrage, abstraction faite de toute préoccupation religieuse, par son côté purement philosophique. Le plan en était aussi large que le titre : Traité, des Lois ou Code de Lois, par Pléthon.[114] C'était un code complet de réforme sociale, politique, morale et religieuse. Nous pouvons juger de son contenu, soit par ce qui nous en reste et notamment par l’Epinomis qui le termine, soit par l'analyse qu'en fait Gennadius dans sa lettre à Joseph l'Exarque, soit par l'espèce d'abrégé qu'en a donné Pléthon lui-même sous ce titre : Résumé des dogmes de Zoroastre et de Pythagore.[115] Quoique les idées, ainsi que l'a remarqué Gennadius,[116] en fussent présentées sans apparence d'ordre ni de méthode[117] elles étaient pourtant liées dans la pensée de l'auteur, et formaient un ensemble complet. La morale s'y appuyait sur la philosophie, dont la religion n'était que la forme ; la politique maintenait par les lois l'établissement fondé sur la théorie.
Quant à cette philosophie sur laquelle reposait tout le système, la partie métaphysique, qui elle-même en faisait la base, s'offrait sous les dehors d'une cosmogonie antique, classant les différentes natures d'êtres d'après leur ordre de génération, en sorte que la place de l'un étant donnée, on pût en déduire sa nature, ses attributions, ses qualités, ses rapports, ses actions ou ses effets.
La grande idée qui dominait tout était celle d'un Dieu suprême communiquant son essence, d'une manière plus ou moins médiate et par des degrés toujours descendants, d'abord aux Dieux intérieurs, partagés eux-mêmes en plusieurs catégories, puis aux autres substances immatérielles, puis aux choses corporelles. Cette échelle d'êtres rappelle les Eons du gnosticisme, les Séphiroth de la cabale, et l'on retrouve ici cette manie commune à toutes les philosophies restées dans l'enfance, de vouloir combler la lacune entre Dieu et l'être fini par un certain nombre d'êtres intermédiaires, qui tous sont des émanations divergentes et de plus en plus affaiblies du Dieu central : sorte de panthéisme rayonnant, bien différent de celui qui, depuis Pythagore, s'est perpétué sous diverses formes jusqu'à nos jours, et qui, répandant la vie dans la masse, sans mettre le centre nulle part, revient logiquement à l'athéisme.
Le nombre des Dieux intermédiaires, selon Pléthon, est considérable ; car chacun des principes constituants et des modes généraux de l'univers est placé par lui sous la garde de quelqu'un d'eux. Les noms païens qu'il leur donne sont, de son propre aveu, à peu près arbitraires.[118] Qu'importent, en effet, les noms ? On sait bien que les langues humaines n'ont point de termes propres pour exprimer les choses divines. Mais ces noms, dans la pensée de Pléthon, ne sont pas purement allégoriques. Il fait bien de ses Dieux des idées,[119] selon le langage de Platon : mais ces idées ne sont pas seulement des abstractions conçues en Dieu, images préexistantes des réalités concrètes ; ce ne sont pas non plus seulement des lois, des forces, des rapports, susceptibles d'être envisagés soit comme des attributs divers d'une substance unique, soit comme des formes purement subjectives de notre manière de concevoir. Tous ces Dieux, selon Pléthon, quoiqu'ils répondent à des idées philosophiques, ont bien leur individualité propre : ce sont des essences pensantes, voulantes, agissantes, capables de s'accoupler, par des unions sans doute purement spirituelles, et de procréer, spirituellement aussi; ou, disons vrai, ce sont des personnes et non des idées : autrement on ne pourrait les adorer, les prier, leur offrir un culte, des sacrifices ; cette philosophie, sans cela, ne serait pas une religion.
Arrivons aux détails : tous les êtres, y compris l'Être des êtres, le Dieu suprême, Jupiter (ou Zeus, comme il l'appelle en grec, mais nous préférons garder ici les noms latins[120]), se partagent en quatre classes et en six sous-classes ou sections dans l'ordre suivant :
I. Dieu suprême............................ Jupiter seul.
II. Dieux supra-célestes ou de 2e classe. 1°Dieux olympiens Junon, Neptune, etc.
2° Dieux tartariens Saturne, Vénus, Pan, etc.
ou Titans
III Dieux intra-célestes ou de 3e classe. 1° Dieux célestes Soleil, Planètes, Etoiles.
proprement dits
2° Dieux terrestres Démons ou Génies.
IV. Etres intra-célestes non divins. 1° Êtres pourvus de raison L’âme humaine.
2° Etres dépourvus de raison Eléments, Animaux, Plantes.
Après Jupiter,[121] les êtres de la seconde et de la troisième classe sont Dieux, tous immortels et impeccables, mais avec des degrés divers dénature et de puissance, comme aussi d'élévation, ceux de la deuxième classe habitant au-dessus du ciel, ceux de la troisième dans l'enceinte même de notre ciel.
La seconde classe se partage elle-même en deux sections, et d'abord celle des Dieux olympiens, tous fils légitimes de Jupiter, nés sans mère, immatériels, supérieurs au temps qui n'existe pas pour eux; ils président aux choses éternelles, savoir :
Neptune, le plus ancien et le plus puissant fils de Jupiter, le chef de tous ses frères, préside à l'ensemble de la création et de l'Univers. C'est le second démiurge ; en lui réside l'espèce (ou la forme spécifique), le terme (ou le fini), et le beau ; il correspond au nus des Platoniciens, au logos ou verbe de Philon et des Chrétiens ;
Junon, sœur et femme de Neptune, préside au nombre et à la multiplication des êtres ; elle est le principe de la matière et, en quelque sorte, la troisième personne de la Trinité de Pléthon, quoique nulle part il n'emploie ce mot ;
Apollon préside à l'identité ;
Diane, à la diversité ;
Vulcain, à la stabilité ;
Bacchus, au mouvement spontané et toujours progressif;
Minerve, au mouvement communiqué et limité ;
Atlas, aux astres en général ;
Tithon, aux planètes ;
Dioné, aux étoiles fixes ;
Mercure, aux Démons;
Pluton, aux âmes humaines ;
Rhée, aux éléments en général,
Latone, à l'éther;
Hécate, à l'air ;
Téthys, à l'eau ;
Vesta, à la terre.
Comme on le voit, les attributions de ces Dieux sont de moins en moins générales, depuis Neptune, qui domine tout l'ensemble, jusqu'à ceux de ses frères qui nu président qu'aux éléments ou seulement à quelque élément en particulier. Cette dégradation successive d'attributions est la règle constante de la classification pléthonienne. Le domaine spécial de ces Dieux de la seconde classe (première section) finit aux éléments, c'est-à-dire à la limite extrême des choses immortelles : les choses mortelles relèvent pourtant d'eux, mais médiatement par les Dieux de l'autre section et des autres classes que nous allons énumérer.
Les Dieux tartariens ou Titans (seconde section de la deuxième classe), sont aussi fils de Jupiter, nés sans mère ainsi que leurs frères, mais illégitimes. Comment illégitimes, n'ayant pas de mère ? C'est un mystère que Pléthon ne nous paraît pas expliquer suffisamment, et il semble ne leur refuser la légitimité que parce qu'il les fait moins puissants. Toujours est-il qu'ils sont, comme les autres, éternels et immatériels ; mais ils ne président qu'aux choses mortelles, savoir :
Saturne, l'aîné et le chef des Titans, créateur en sous-ordre, et seulement des choses périssables, partageant même sa puissance créatrice avec le Soleil, préside à l'ensemble des choses mortelles ;
Vénus, femme de Saturne, préside à la propagation des espèces ;
Pan, au règne animal;
Cérès, au règne végétal ;
D'autres Titans, à d'autres parties du monde corporel ;
Proserpine, entre autres, au corps humain.
Pléthon suppose que Proserpine (le corps humain) a été enlevée par Pluton (l'âme humaine), et que l’homme, substance complexe, est résulté de leur union ; on voit que même des mythes secondaires du paganisme il tire quelquefois un parti très-ingénieux.
Les astres (première section d'une troisième classe de Dieux) commencent une autre série d'êtres : ils sont Dieux encore, non plus éternels, mais immortels ; non plus abstraits, mais unis à la matière. Ils ne sont plus les propres fils de Jupiter, et ils n'ont plus ce caractère commun aux deux classes précédentes d'être nés sans mère. Ils descendent, à la vérité, de Jupiter, mais indirectement par. Neptune, qui leur a donné l'Ame, conjointement avec quelqu'un de ses frères légitimes, et le corps, conjointement avec Junon leur mère. Comme Dieux, ils sont impeccables, infaillibles. De plus, ils voient tout, ils savent tout ; ils règnent, d'ailleurs, en commun avec les Titans, sur toutes les choses mortelles qui sont sous le ciel, et leur classe comprend :
Le Soleil, chef de tous les astres, démiurge des classes inférieures, lequel, en commun avec Saturne, préside à tout l'ensemble des choses mortelles ;
La Lune ;
Les autres planètes;
Les autres astres.
Viennent ensuite les Démons ou Génies (seconde section de la 3e classe de Dieux). Ils sont également fils de Neptune, engendrés par ce dieu avec la coopération de Mercure, et ils ont un corps emprunté à Junon. Immatériels par eux-mêmes, ils habitent la terre ; comme Dieux, ils sont immortels (quoique non éternels et quoique unis à la matière), impeccables, infaillibles, mais leur science ne s'exerce que par voie d'opinion ou de conjecture, bornée par conséquent, quoique toujours exacte. Ce sont les derniers de tous les Dieux et les exécuteurs de leurs ordres ici-bas. Le nombre en est très considérable. Pléthon ne donne pas leurs noms.
Nous sortons ici de la sphère des Dieux, et nous arrivons à la première section de la 4e classe d'êtres, composée de l'âme humaine seulement. L'âme tient le milieu entre les Dieux et les êtres sans raison ; elle est raisonnable comme les Dieux et comme eux immortelle, immatérielle (bien qu'unie à la matière) ; mais elle n'est pas Dieu, car elle est peccable et faillible. Elle est, comme les Dieux des deux sections précédentes, l'ouvrage de Jupiter, mais médiatement par Neptune, de concert avec Pluton, qui, tous deux, ont emprunté pour elle un corps à Junon, déesse de la matière.
Enfin arrivent au dernier rang (seconde section de la quatrième classe d'êtres) les choses privées de raison, purement matérielles ; et d'abord les éléments, qui semblent les dominer toutes : eux seuls, de toute cette section, sont immortels. Puis les animaux (y compris le corps humain), et les plantes. Toutes ces choses, comme nous l'avons vu, sont produites par Neptune et Junon; elles sont régies par les Titans de concert avec les astres.
Que dire de toute cette cosmogonie ? sinon quelle est poétique, ingénieuse, parfaitement symétrique, très-habilement, quoique péniblement, élaborée, mais que, pareille à tous les systèmes issus de l'école platonicienne, elle ne repose sur rien : c'est de l'imagination, sans doute, mais non pas de la philosophie.
C'est de l'ensemble de tous ces êtres divins et non divins, les uns pures intelligences résidant au-dessus du ciel, les autres formés d'une a me et d'un corps, ou simplement d'un corps, les unes habitant au-dessus du ciel, les autres dans son enceinte (en dedans du ciel, comme porte habituellement le texte), que se compose le grand Tout, l'Univers de Pléthon, émané de la pensée de Jupiter, coéternel cependant à Jupiter lui-même, dont il procède en cause, mais non dans le temps. La volonté de Jupiter, qui a fait et organisé tout ce grand ouvrage, est une loi coéternelle aussi à son auteur, loi qu'il ne peut changer, parce qu'il ne peut se changer lui-même, qui est pour lui, par conséquent, une nécessité et la plus grande des nécessités,[122] en sorte qu'on voit partout, dans ce système, Jupiter, comme les autres Dieux, agissant dans les limites du possible, c'est à-dire, de sa propre loi, inséparable de sa nature. De là le dogme du fatalisme, qui est fondamental dans le système de Pléthon, qu'il développe longuement dans un chapitre exprès du Traité des Lois,[123] et qu'il soutenait opiniâtrement, même en dehors des idées de son livre, dans sa correspondance avec Bessarion, cherchant à s'appuyer de quelques passages équivoques recueillis çà et là dans les ouvrages de Platon, son maître.[124]
Les autres idées métaphysiques de Pléthon, entant qu'elles s'écartent des banalités élémentaires, se rattachent à son système général et en ont tous les défauts, c'est-à-dire, le vague, l'arbitraire, le fantastique. Quant à la psychologie, nous en avons vu les principaux traits. Il fait l'âme immortelle, immatérielle, quoique habituellement unie à la matière; éclairée, mais bornée et par conséquent faillible; soumise comme toute chose à la fatalité, libre cependant à sa manière, et par conséquent peccable.[125] Mais si l'âme est immortelle, que devient-elle après sa séparation du corps? ici les textes nous manquent, et dans les fragments qui nous restent, nous ne trouvons rien d'assez explicite. Dans nos idées, et en cherchant à les rapprocher de celles de Pléthon, nous voudrions que l'âme, ou du moins l'âme vertueuse, se réunit à la classe supérieure, à celle des Démons ou Génies. Mais le système ne le permet pas; ce serait rompre la hiérarchie et détruire l'éternelle démarcation entre les différentes natures d'êtres. Aussi Gennadius, dans son analyse,[126] dit-il formellement que dans ce système « jamais l'âme ne monte aux cieux. » Que devient-elle donc? « Elle revient, ajoute-t-il, dans le corps et recommence le cercle de la vie après des intervalles déterminés. » Ainsi nous retrouvons, et Gennadius le dit expressément, la métempsychose, rêverie commune au brahmanisme, au pythagorisme, au platonisme et à tous les systèmes puisés directement ou indirectement aux sources indiennes.[127]
Remarquez, au reste, dans la métempsychose de Pléthon, comme dans tous les systèmes du même genre, ces intervalles entre les migrations : le but en est facile à comprendre. Car si l'âme, quoique son-mise au destin, est libre et peccable, si par conséquent il y a lieu chez elle au mérite et au démérite, et si les Dieux se réservent le droit de punir ses fautes, comme Pléthon le reconnaît formellement dans son chapitre du Destin, où sera la punition ? Sans doute dans le choix des régions que l'Ame habitera dans l'intervalle de ses migrations. C'est ce que nous ne voyons formellement exprimé nulle part dans les fragments du Traité des Lois : c'est pourtant indiqué assez clairement à la fin de la prière du soir, et plus clairement encore dans le commentaire sur les oracles en vers de Zoroastre, ouvrage où Pléthon, sous le voile transparent d'un nom antique, a déposé le germe de ses propres idées.
Voilà pour la nature et les destinées de l'âme. Mais ses opérations, ses facultés ? Assurément on pouvait se dispenser de répondre à ces questions dans un traité des lois; mais, comme tout s'enchaîne, et comme cet ouvrage est moins, après tout, un code de législation qu'un ensemble complet de philosophie, cherchons ce qui devait y être et ce que sans doute les lacunes nous ont dérobé, cherchons-le dans les ouvrages du même auteur écrits sous la même inspiration. Déjà, dans la comparaison d'Aristote et de Platon publiée en Italie, l'auteur avait formellement adopté l'opinion platonicienne que toutes les choses du monde inférieur ne sont que les images des idées d'en haut.[128] Cette théorie n'est aujourd'hui qu'indiquée dans quelques passages du Traité des Lois[129] ; mais elle a dû y être plus développée, car l'auteur y tenait beaucoup. Il en a fait tout un chapitre de son traité sur Aristote et Platon: Il la reproduit deux ou trois fois dans son commentaire sur les prétendus oracles de Zoroastre, où il dit que l'Esprit du Père, le second démiurge, a fait toutes les choses en dedans du ciel simples images des choses supra célestes, en leur donnant pour support[130] la matière. Et, en effet, c'est là, comme nous l'avons dit, la base de l'idéologie platonicienne sur laquelle Pléthon a construit tout son système, ses Dieux, comme nous l'avons dit, n'étant originairement que des idées personnifiées.
Il est évident que ce système est contraire à tout progrès en psychologie ; car il ne laisse aucune place à l'observation et à l'expérience dans l'étude de la généalogie des idées. Il explique tout à priori, d'après une vue sans doute ingénieuse, mais tout à fait arbitraire et fantastique. Pléthon aurait dû s'en défier, lui qui, dans le partage des attributions entre l'âme et le corps, place l'imagination tout près des sens, dans une région inférieure de l'âme, et en fait la source de toutes les illusions, par opposition à l'intelligence[131] dont il fait notre attribut supérieur.
On doit s'attendre à trouver dans sa morale le même arbitraire, et par conséquent les mêmes aberrations. En effet, on ne le voit nulle part fonder l'idée du devoir sur une autre base que la nécessité de ressembler aux Dieux autant qu'il est en nous, pour nous maintenir dans le rang qui nous est assigné, intermédiaire entre les Dieux et les créatures sans raison. Car laisser asservir la partie immortelle de notre être à la partie mortelle, ce serait nous confondre avec les animaux, rompre, en quelque sorte, un des anneaux de la grande chaîne des êtres, et troubler ainsi, en ce qui nous concerne, l'ordre général. Mais on sent combien cette nécessité de ressembler aux Dieux, outre qu'elle n'est pas très-évidente pour tout le monde, outre qu'elle s'accorde assez mal avec la distinction absolue des différentes classes d'êtres, est une base mauvaise pour la morale : mauvaise en ce que la ressemblance ou la dissemblance est impossible à constater, les Dieux ne nous étant qu'imparfaitement connus ; en ce que, d'ailleurs, c'est appuyer presque uniquement la notion du devoir sur celle de notre propre dignité, c'est-à-dire, sur le plus dangereux de tous les sentiments, l'orgueil, qui a perdu le stoïcisme. Néanmoins, comme, dans les choses qui tiennent aux besoins pratiques de la société, toutes les philosophies bonnes ou mauvaises, de quelque principe qu'elles partent, doivent nécessairement se rencontrer en beaucoup de points, les lois morales de Pléthon sont justes en général et conformes à la doctrine universelle, par suite à la morale chrétienne qui en est la plus pure expression, sauf pourtant dans le philosophe réformateur un excès d'indulgence pour les plaisirs des sens,[132] qui lui fait admettre la polygamie au profit des hommes,[133] et qui contraste avec le témoignage rendu par ses ennemis mêmes à la pureté de ses mœurs.[134]
Quant au gouvernement, il n'en dessine pas nettement les formes, au moins dans ce qui nous reste de ses trois livres. Cette matière était traitée ex professo dans le livre I, chap. 20, et dans le livre III, chap. 6. Je pense, d'après quelques indices, que l'auteur inclinait vers une sorte de théocratie républicaine, analogue au gouvernement des Hébreux sous les Juges.[135] Si son ouvrage nous fut resté entier, sans doute nous y retrouverions aussi quelques unes des idées administratives qu'il exposait longtemps auparavant dans ses lettres sur les affaires du Péloponnèse, comme le partage des citoyens en trois classes, les prêtres, les guerriers et les travailleurs.[136] Mais nous n'insistons point sur des conjectures qui n'ont rien de solidement établi.[137]
La législation civile était renfermée, sans doute, dans quelques chapitres du premier livre où nous trouvons ces titres : « chap. 18, sur les héritages; chap. 19, sur les contrats; chap. 24, sur les jugements,[138] mais nous en ignorons complètement les dispositions.
La législation pénale était rigoureuse : la mort y était prodiguée sans mesure, et presque toujours par le feu : mort et supplice du feu contre tous ceux qui se livrent à des crimes contre nature; mort pour le viol et même la tentative de viol ; mort pour l'inceste entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs ; mort pour le simple commerce avec une jeune fille non adulte ; mort pour le meurtre d'une personne sacrée ; et comme la philosophie ne se pique pas toujours d'être tolérante, à plus forte raison quand elle prétend s'ériger en religion, mort et supplice du feu contre tout sophiste convaincu d'avoir dogmatisé contre les principes posés dans ce livre.[139]
Quant à la procédure criminelle, elle était plus indulgente que la pénalité ; peut-être même était-elle destinée à en tempérer les rigueurs. Nous ne savons comment était composé le tribunal que Pléthon appelle Synédrion,[140] c'est-à-dire, conseil. Les jugements s'y rendaient à la pluralité des voix ; l'égalité de partage entraînait l'absolution. Il était permis aux juges de tenir compte des antécédents favorables de l'accusé, et si sa vie passée semblait plaider en sa faveur, la peine de mort pouvait être commuée en un simple emprisonnement à temps. Une grande latitude était laissée aux juges, beaucoup trop grande même : car dans tous les cas non prévus par la loi, ils étaient autorisés, même en matière pénale, à prononcer d'après leur conscience.[141]
Mais les lois, les mœurs, le gouvernement, tout cela, dans la pensée de Pléthon, repose, comme nous l'avons dit, sur l'élément philosophique passé à l'état de religion. Aussi est-ce le culte qui couronne toute son œuvre, comme pouvant seul entretenir les croyances qui font la base de son système. Il y consacre toute la moitié du troisième livre.[142] Ce culte se compose en grande partie de prières faites en assemblée commune par le prêtre ou, à défaut de prêtre, par le plus notable de l'assistance. Ces prières sont de deux espèces, savoir de longues allocutions en prose et des hymnes très-courts en vers, ces derniers chantés en musique, si les ressources du lieu le permettent, et sur des modes différents[143] selon les jours. Car l'année tout entière est partagée en jours fériés et non fériés, et les prières sont indiquées pour chaque jour, férié ou non, dans l'espèce de bréviaire qui termine l'ouvrage et que nous devons à la découverte de M. Vincent.[144] Il en résultait la nécessité d'un nouveau calendrier, qui nous est resté, du moins dans ses idées fondamentales, et n'est pas la partie la moins ingénieuse ni la moins curieuse de l'ouvrage.[145] Les prêtres dont nous avons parlé devaient être régulièrement institués,[146] mais nous ne savons rien de l’organisation du sacerdoce. Leur fonction principale était sans doute de présider chaque jour aux prières, comme il est dit ci-dessus, et de temps en temps aux sacrifices : car il y avait aussi des sacrifices,[147] mais cette partie du rituel nous manque. Il y avait des jours de jeûne,[148] et des examens de conscience à la fin du mois,[149] sans doute pour préparer aux sacrifices. Il y avait même une espèce de confession ; car nous voyons, au titre des Jugements,[150] l'homme qui s'est senti atteint d'un désir adultère, se présenter à l'exégète, c'est-à-dire, à l'interprète des choses saintes, probablement au prêtre, pour lui confier le secret de sa faiblesse, et lui demander les moyens de s'en purifier. Il y avait un culte spécial pour les morts, et Pléthon insistait dans son livre sur les formalités de la sépulture.[151] Il est clairement question d'une espèce d'excommunication au chapitre des Jugements.[152] Tout cela évidemment imité du christianisme : les formules mêmes des prières portent en quelques endroits des marques sensibles d'imitation,[153] et cette imitation devient impie dans un ouvrage précisément dirigé contre la religion dont elle parodie les pratiques.
Tel est dans son ensemble le système de Pléthon et le fidèle résumé de son livre. Nous n'insisterons point sur le coté littéraire, parce qu'il nous paraît n'avoir ici qu'une importance très-secondaire. Le style de Pléthon est lourd en général, chargé d'incises et embarrassé dans sa marche périodique ; le coloris en est terne, la diction plus correcte qu'élégante, si on ne lui compte pour élégances les idiotismes dont elle cherche à se parer et une affectation de formes attiques dont Lucien peut-être se serait beaucoup diverti.[154]
Les prières que Pléthon appelle Allocutions, et où du moins il aurait dû chercher à mettre un peu de couleur, un peu d'onction, ne se distinguent, sauf les passages empruntés à nos rituels, que par leur longueur interminable et leur sécheresse désespérante. C'est toujours, et presque dans les mêmes termes, la répétition des mêmes idées cosmogoniques.[155] Quant aux hymnes en vers, ils valent encore moins que la prose, et n'ont de vers que le rythme, encore fort saccadé, fort gêné et à peine reconnaissable.[156]
Mais encore une fois, ce n'est pas là ce qui nous intéresse. La forme est peu de chose dans un sujet aussi grave. Ce qui doit fixer notre attention, c'est l'effort de Pléthon pour arriver par la philosophie à une nouvelle forme de civilisation, c'est la direction des idées d'un esprit fort au quinzième siècle. On voit combien, même dans les têtes les mieux organisées de cette époque, le véritable esprit philosophique était peu développé. Pléthon veut échapper à la scolastique, et il ne trouve de refuge contre elle que dans le néo-platonisme, la plus mauvaise de toutes les philosophies, puisque c'est la seule qui n'ait laissé aucune trace utile de son passage. Il se lance dans ces régions inconnues, et il ne s'aperçoit pas qu'en se traînant ainsi sur les errements d'une vieille école, il fait lui-même de la scolastique à sa manière. Seulement, au lieu d'emprunter ses idées à Aristote, il les emprunte à Platon, et encore les prend-il moins dans Platon lui-même que dans Platon arrangé, systématisé, refait par ses interprètes d'Alexandrie, qu'il imite dans leur travail de remaniement et dans leur licence d'interprétation. Puis, averti, comme eux, par un instinct de conscience ou de bon sens, de la faiblesse d'un système philosophique appuyé seulement sur l'imagination de ses inventeurs, il essaye de le renforcer en lui donnant les caractères d'une espèce de tradition qui se rattacherait au berceau même des souvenirs historiques. On sait que ce tut la mante des néo-pythagoriciens du premier siècle[157] et plus tard des néo-platoniciens,[158] de faire remonter leurs doctrines aux plus anciens sages de la Grèce, de l'Asie et de l'Egypte. De là tant d'ouvrages apocryphes sous les noms d'Orphée, d'Hermès et de Zoroastre; de Zoroastre surtout, dont les prétendus oracles formulés en mauvais vers grecs au commencement de notre ère, sont cités avec tant de complaisance dans les ouvrages de Proclus,[159] et dont Pléthon s'était fait, on voit maintenant pourquoi, le commentateur.[160] A ces noms fameux, il ajoute arbitrairement ceux de plusieurs sages de l’ancienne Grèce; il ne craint pas d'y joindre les brahmanes de l'Inde, les mages de l'Asie, les Curètes mêmes de la fable;[161] et s'il ne remonte pas à Men ou Ménès, premier roi d'Egypte, antérieur de trois mille ans, dit-il, à Zoroastre, c'est que, par exception, au lieu d'admirer sa doctrine à titre d'antiquité, il la condamne, et même en termes assez durs.[162]
Mais Gennadius, dans sa lettre à Joseph l'Exarque, réduit ces prétentions à leur juste valeur : « Ce Zoroastre, dit-il, et tant d'autres dont tu invoques les noms, Minos, Eumolpe, Polyide, Tirésias, tu n'as pu voir leurs livres, ni leur emprunter leur doctrine. Le peu que nous savons d'eux, tu as pu seulement rapprendre, comme tout le monde, soit par les témoignages d'écrivains beaucoup plus récents, soit par les faux ouvrages publiés sous leurs noms. Mais après eux, et par-dessus tous, ton maître, c'est Proclus, dont tu as glané les idées éparses dans ses longs et nombreux ouvrages; car tu cites bien à l'appui de tes opinions Plutarque, Plotin, Jamblique, Porphyre ; mais Proclus, dont tu t'es le plus servi, tu ne le nommes pas une seule fois, sans doute pour n'avoir pas à partager avec lui la gloire de tes inventions : vaine précaution, s'il est encore des hommes qui aient lu Proclus, qui aient compris et condamné sa doctrine, et si ces hommes voient et reconnaissent la source de tes erreurs.[163] »
Elle encouragea la persécution sous les derniers empereurs païens, triompha un moment sous Julien, et continua ses sourdes attaques jusqu'au temps de Justinien qui les fit cesser, malheureusement par des mesures de rigueur. Elle s'éteignit alors dans l'exil ou dans le silence. Au moyen âge, le seul qui remua ses cendres, Psellus l'Ancien fut obligé, dit-on, de composer un poème pour se justifier du reproche de paganisme.[164] Elle renaît au quinzième siècle avec Pléthon, et nous voyons sous quelle forme. Cette fois, elle n'essaie plus de se déguiser : c'est la restauration du polythéisme ; ce sont les anciens Dieux avec leurs noms et leurs attributs, affublés seulement du manteau d'une philosophie qu'on croyait morte, venant redemander leurs temples, leurs autels et leur culte.
Quelle que fût, au reste, l'influence du nom et du talent de Pléthon, il n'est pas probable que son paganisme eût jamais fait beaucoup d'adeptes dans son pays. Nous savons, il est vrai, qu'il avait formé à Mizithra, de ses disciples les plus affidés, une société secrète. Michel Apostolius, dans une lettre que nous publions à la fin de ce volume, témoigne le désir d'en faire partie.[165] Un de ses grands admirateurs, Charitonyme ou Hermonyme, auteur d'une oraison funèbre en son honneur,[166] se plaint de n'avoir pas été admis dans ce cercle privilégié. Que se passait-il dans ces réunions ? Nous l'ignorons. Mais il est à croire que le maître v développait sa doctrine et y posait les fondements de sa réforme. Là, sans doute, on se dédommageait de la contrainte qu'imposaient extérieurement les convenances. On y parlait un singulier langage, si c'est à un souvenir de ses anciennes relations que Bessarion, le grand cardinal, empruntait cette expression au moins étrange d'une de ses lettres, où, en déplorant la mort de Pléthon, il le félicite d'être allé rejoindre les Dieux de l'Olympe et célébrer avec eux le chœur mystique d'Iacchus.[167] Mais enfin l'habileté pratique du maître, sa position sociale et les ménagements qu'elle lui imposait, durent pendant sa vie opposer de grands obstacles à la propagation de ses idées religieuses. Après sa mort, et surtout après l'occupation de Mizithra par les Turcs, son école fut nécessairement fermée et dispersée.[168] L'évangile même de cette petite secte ayant péri avant sa publication par l'arrêt de Gennadius, elle n'eut plus d'étendard ni de point de ralliement. Sans cela, Pléthon aurait eu peut-être, comme de nos jours Saint-Simon, le rare honneur de donner son nom à une religion nouvelle.
Ses idées ne furent pourtant pas sans influence, du moins en Italie. Ce fut par l'inspiration de ses souvenirs, comme nous l'avons dit plus haut, que s'établit à Florence la plus ancienne de toutes les Académies, et d'abord sous la direction de Marsile Ficin. Les idées panthéistiques de l'école néo-platonicienne se font assez jour dans les écrits de ce dernier à travers l'obscurité mystique de son style pour qu'on puisse le regarder comme le disciple et le successeur immédiat de Pléthon.[169] Nous avons dit la passion des premiers Médicis et de leur savant entourage pour les doctrines académiciennes qui apparaissaient alors pour la première fois aux hommes de la renaissance.[170] Toutefois, l'esprit philosophique se développa moins vite dans cette société fort peu sérieuse que l'élément païen favorisé par les études de la renaissance et par la corruption des mœurs. On voit ce dernier régner seul dans une autre espèce d'Académie[171] qui se forma vers le même temps à Rome, sans caractère officiel, par les soins de Pomponius Laetus, un des hommes les plus savants et des esprits les plus aventureux de son temps, un véritable païen du quinzième siècle, qui se vantait devant les papes eux-mêmes de vouloir défaire l'œuvre du Christ.[172] Or, ce Pomponius Laetus ou Sabinus n'est autre que Pierre de Calabre[173] dont Pléthon fait l'éloge dans sa réplique à Gennadius au sujet d’Aristote. Il parle des relations qu'il avait eues en Italie avec ce savant (savant bien précoce, s'il fallait en croire ses biographes, qui le font naître en 1425, mais beaucoup trop tard[174]), et de la préférence donnée par ce dernier aux interprètes grecs d'Aristote sur les interprètes latins. Or, qui peut douter que la conversation n'ait souvent été beaucoup plus loin, et n'ait abordé le sujet cher à Pléthon d'une réhabilitation du paganisme ? A ce compte, le maître de Pomponius Laetus pourrait être, jusqu'à un certain point, responsable de toutes les folies païennes des quinzième et seizième siècles.[175] On ne peut du moins lui contester son influence sur le mouvement philosophique de son époque ; et dans ces fêtes où l'Académie de Florence brûlait sur les autels de Platon un encens profane, sinon sacrilège, elle aurait dû en réserver quelques grains pour le restaurateur de la doctrine du grand philosophe. Si Platon était le Dieu de la nouvelle religion, Pléthon en pouvait bien être le prophète. Mais si l'on n'en fit ni un Dieu ni un prophète, peu s'en fallut qu'on n'en fît un saint. Ses dépouilles mortelles, exhumées de la tombe où elles reposaient à Sparte, furent en 1475 transportées par un de ses admirateurs à Rimini, où elles dorment, probablement ignorées, sous les dalles de l'église Saint François.[176]
Nous ne reviendrons pas sur les attaques dirigées, en Grèce même, contre le paganisme de Pléthon, peu de temps après sa mort, par suite de la révélation de quelques parties de son grand ouvrage,[177] ni des clameurs en sens contraire auxquelles donna lieu la destruction de ce livre.[178] Nous dirons aussi très peu de chose des dissentiments qui, en Italie, continuèrent d'agiter la petite cour de Bessarion à propos de la guerre soulevée en faveur de Platon contre Aristote. Nous remarquerons seulement que les hommes les plus graves et les plus instruits de cette société, Gaza, Segondin, Andronic, se rangèrent du côté d'Aristote.[179] Bessarion lui-même, quoique au fond dévoué à Platon, s'était fait contre ce dernier le défenseur d'Aristote sur quelques points de doctrine. Mais sa prédilection éclata dans son immense diatribe contre George de Trébizonde, adversus calumniatorem Platonis.[180] Jusque-là il avait essayé de tenir la balance égale ; et nous avons un monument de son impartialité dans sa belle lettre à Michel Apostolius, qui s'était permis, croyant faire sa cour au cardinal, d'écrire trop légèrement contre Aristote.[181] Ces discussions, souvent racontées avant nous,[182] nous éloigneraient trop du Traité des Lois.
Quant aux débris de ce dernier ouvrage, dispersés, comme nous l'avons dit, dans les bibliothèques de l'Europe, ils y furent longtemps oubliés des savants. Le fragment le plus connu a toujours été le chapitre du Destin,[183] que l'auteur, à ce qu'il paraît, avait laissé transpirer de son vivant, probablement en le communiquant à quelqu'un de ses amis.[184] La preuve ou du moins l'indice très-probable que ce chapitre était connu du vivant de Pléthon, c'est que, fort peu de temps après sa mort, il provoqua une réponse en deux livres de Matthieu Camariote. Comme cette réfutation est antérieure à la destruction du livre des Lois,[185] et comme il n'avait été pris de ce livre aucune copie,[186] il faut bien que le chapitre ait été publié séparément; aussi se trouve-t-il dans un grand nombre de manuscrits,[187] et il a été imprimé plusieurs fois.[188]
On peut croire aussi que le chapitre 21 du Ier livre, ou du moins la partie de ce chapitre qui contient une réforme assez ingénieuse du calendrier, avait vu le jour du vivant de l'auteur. Gaza, qui le cite souvent dans son Traité des mois, le connaissait, et même plus complet que nous ; car il fait allusion à des détails aujourd'hui perdus ; mais il n'en parle, il est vrai, qu'après la destruction de l'ouvrage. Ce morceau paraît n'exister aujourd'hui en manuscrit que sous le n° 336 de la bibliothèque de Munich, d'où il a été exhumé et reproduit textuellement par M. Hardt dans le troisième volume de son catalogue. Mais déjà, bien auparavant, il avait été publié, et même avec une phrase de plus, par Allatius, dans son Traité, aujourd'hui fort rare, de Mensura temporum, chap. XII, p. 140. Il n'est pas impossible qu'il se retrouve un jour en entier.[189]
A ces exceptions près, tout ce qui nous reste du Traité des Lois provient de l'exemplaire original détruit par les flammes. Gennadius lui-même nous apprend qu'il en conserva les tables des matières, adhérentes à la couverture, et les hymnes à la fin de l'ouvrage.[190] Mais il ne le pouvait guère sans laisser en même temps subsister quelques feuillets voisins. Aussi presque tout ce qui nous reste appartient-il au commencement du premier livre ou à la fin du troisième. Le peu de fragments intermédiaires qui ont survécu (sauf toujours le chapitre sur le Destin) doivent provenir de deux ou trois feuillets que la flamme aura épargnés et qui auront été retirés du feu par les personnes présentes.
En somme, voici tout ce que nous possédons : du premier livre, le préambule, la table des matières et les cinq premiers chapitres. Ces morceaux existent manuscrits dans les bibliothèques de Munich, de Vienne, de Naples,[191] etc. Allatius les avait eus entre les mains,[192] et même il en avait publié deux fois le préambule.[193] Ils ont tous été édités par Hardt[194] d'après le texte de Munich, et c'est d'après lui que nous les publions de nouveau, après les avoir collationnés toutefois avec les manuscrits que nous avons pu consulter.[195]
Au premier livre appartient encore, d'après Allatius,[196] l'extrait dont nous avons plusieurs fois parlé, du calendrier de Pléthon, extrait qui nous a paru ne pouvoir se rapporter qu'au chap. 21, sur le Culte des Dieux.
Au second livre, outre le chapitre sur le Destin,[197] il faut rapporter encore celui qui traite de l’Instinct des animaux, publié également par Hardt dans les recueils déjà cités. Les dernières lignes de ce chapitre, vingt-sixième du livre, nous ont paru devoir en être détachées pour former le commencement du chapitre 27 sous un nouveau titre, de l'Eternité de l'Univers.
Vient enfin le troisième livre, et en particulier le chapitre 11, sur la Mesure et la Proportion, déjà publié par Hardt;[198] de plus un morceau considérable du chapitre 31 sur les Jugements, et le commencement du chapitre 32, fragment déjà imprimé par Fabricius dans sa bibliothèque grecque.[199] Nous ne donnons donc comme inédits, et encore sous toutes réserves, que les chapitres 14 et 15, sur la Génération des Dieux, retrouvés par M. Vincent dans un manuscrit de notre bibliothèque,[200] et les chapitres 34, 35 et 36, dont la découverte, également due à M. Vincent,[201] nous a mis sur la voie de toutes ces recherches, et qui contiennent, comme nous l'avons dit en commençant, presque tout le rituel, une des parties les plus curieuses de l'ouvrage. Cette partie, toutefois, serait restée fort incomplète si la bibliothèque de Munich, grâce au savant dont nous avons signalé l'obligeance, ne nous avait fourni des morceaux importants qui nous manquaient.
Quant à l’Epinomis qui termine ce livre, et qui est comme le résumé de l'ouvrage entier, Hardt l'avait publiée dans son tome V, d'après le m s. 490 du fonds d'Augsbourg. Elle se trouve manuscrite dans plusieurs grandes bibliothèques.[202] Nous en donnons une nouvelle édition, corrigée en plusieurs endroits d'après un manuscrit de Paris.
Un dernier morceau qui ne faisait point partie du Traité des Lois, mais que nous avons dû nécessairement y rattacher, parce qu'il formule la doctrine contenue dans ce livre, c'est le Résumé des dogmes de Zoroastre et de Platon,[203] déjà édité deux fois au moins,[204] mais dont nous publions un nouveau texte revu avec soin sur les manuscrits.
Enfin, comme Appendice de notre travail, et à titre de pièces justificatives, nous avons réuni à la fin de ce volume un certain nombre de morceaux, les uns inédits, les autres fort rares, dont quelques-uns sont importants. Ils se rattachent soit à l'ouvrage même de Pléthon, soit à l'histoire de ses opinions dans les dernières années de sa vie, soit à ses anciens démêlés avec Gennadius qui ne furent pas sans influence sur la destruction de son livre, soit à cette destruction même, soit aux jugements des contemporains sur l'auteur et sur l'ouvrage. En voici la liste rangée à peu près par ordre chronologique[205] :
1° Prière de Pléthon au Dieu unique : inédite.
2° Extraits du commentaire de Pléthon sur les oracles de Zoroastre.
3° Extraits de l'ouvrage de Pléthon contre Aristote, intitulé : sur les Différences entre les doctrines, de Platon et celles d'Aristote.
4° Lettre de Gennadius à Marc d'Éphèse, en lui envoyant sa réfutation de l'ouvrage de Pléthon contre Aristote : inédite.
5° Extraits de cette réfutation.
6° Extraits de la réplique de Pléthon.
7° Traité de Pléthon sur la procession du Saint-Esprit : inédit ?
8° Extrait de la réponse de Pléthon aux observations de Bessarion sur l'ouvrage précédent : inédit.
9° Réponse de Gennadius au Traité sur le saint Esprit : inédite.
10° Lettre de Michel Apostolius à Pléthon pour être admis au nombre de ses disciples : inédite.
11° Lettre du même à Argyropule : inédite.
12° Autre lettre du même au même : inédite:
13° Oraison funèbre de Pléthon par Jérôme Charitonyme.
14° Autre oraison funèbre, par Grégoire le Moine.
15° Lettre de consolation de Bessarion aux enfants de Pléthon.
16° Vers de Bessarion en forme d'épitaphe pour Pléthon.
17° Envoi de cette lettre et de ces vers par Bessarion à Segondin.
18° Lamentation d'un anonyme sur la destruction du livre de Pléthon : inédite.
19° Lettre de Gennadius à Joseph l'Exarque, où il justifie sa conduite à l'égard de ce livre : inédite.
20° Extrait du discours de Gennadius contre les athées ou partisans du hasard, passage relatif à la condamnation du livre de Pléthon.
Le choix de ces morceaux n'a pas été fortuit, ni inspiré par le seul désir de mettre au jour quelques pièces inédites. On y verra les idées théologiques de Pléthon, d'abord saines en apparence (n° 1), s'altérer et déjà se trahir, quoique sous des formes voilées (n° 2, 3); Gennadius commencer ses attaques moins contre Pléthon lui-même que contre ses doctrines déjà suspectes (nos 4, 5) ; la guerre entre ces deux rivaux s'animer de plus en plus (n° 6), et s'échauffer surtout à propos du Traité de Pléthon sur le Saint-Esprit (nos 7, 9); la petite secte Pléthonienne se grossir de quelques noms connus ( nos 10, 11, 12) ; la mort du maître ouvrir carrière aux éloges enthousiastes de ses disciples et de ses admirateurs (nos 13, 14), et donner lieu aux témoignages d'estime de Bessarion (nos 15, 16, 17); la condamnation de son livre exciter la fureur de ses partisans (n° 18), et donner lieu par deux fois à Gennadius de publier sa propre justification (nos 19, 20).
Ici s'est arrêté mon travail d'éditeur, et ici s'arrêtera cette analyse. Ce que je viens de dire suffit, je crois, pour montrer avec quel soin j'ai évité de m'écarter de mon sujet, qui a toujours été exclusivement le Traité des Lois, c'est-à-dire, les doctrines, les pensées et les intentions cachées sous l'enveloppe de ce livre. Texte, notice et pièces justificatives ont constamment tendu vers le même but. Je ne m'étais pas proposé d'abord d'y joindre une traduction : il me semblait qu'un tel secours était inutile pour la classe de lecteurs à qui mon ouvrage était destiné. Néanmoins, un des jeunes professeurs les plus distingués que l'agrégation ait donnés à l'enseignement, M. Pellissier, m'ayant proposé, pour mettre en français les idées de Pléthon, le concours de sa plume, connue depuis par l'élégante traduction des Soliloques de saint Augustin, je n'ai pas cru pouvoir rejeter une offre si obligeante. Je déclare donc que la traduction appartient en entier à M. Pellissier, sauf quelques changements de détail concertés entre lui et moi. Je me plais à rendre à mon habile collaborateur l'hommage que je dois à son talent et à sa complaisance.
Paris, 15 mars 1858.
C. ALEXANDRE.
Cet ouvrage contient :
La théologie d'après Zoroastre et Platon : l'on a conservé aux Dieux reconnus par la philosophie les noms traditionnels des Dieux de la Grèce, mais en ramenant chacun de ces noms du sens moins philosophique qu'il a pris dans les fictions des poètes au sens le plus conforme à la philosophie ;
La morale d'après les mêmes sages, et en outre d'après les Stoïciens;
La politique sur le modèle de celle de Sparte, en retranchant d'une part les rigueurs excessives que le plus grand nombre ne saurait supporter, et en ajoutant de l'autre, surtout à l'usage des gouvernants, la philosophie, qui fait le principal mérite des institutions platoniciennes ;
Le culte réduit à des pratiques simples, sans superfluité, et cependant suffisantes;
La physique en grande partie d'après Aristote.
Cet ouvrage touche encore aux principes de la logique, aux antiquités grecques et à quelques points d'hygiène.
PREMIER LIVRE.
Chapitres.
I. De la diversité des opinions entre les hommes sur les objets les plus importants.
II. Des meilleurs guides pour la recherche du vrai.
III. Sur les doctrines opposées de Protagoras et de Pyrrhon.
IV. Prière aux Dieux arbitres de la raison.
V. Principes généraux sur les Dieux.
VI. De Jupiter roi.
VII. Des Dieux supra célestes.
VIII. Des Dieux qui sont dans l'enceinte du ciel.
IX. De l'éternité de tous les Dieux.
X. De la génération de Neptune et des autres Dieux supra célestes.
XI. De la génération des êtres immortels qui habitent l'enceinte de notre ciel.
XII. De la génération des êtres mortels.
XIII. De la génération de l'homme.
XIV. De la diversité des aptitudes des hommes pour le bien ou le mal.
XV. De la permanence des choses établies.
XVI. De la meilleure constitution morale.
XVII. Des constitutions individuelles.
XVIII. Sur les héritages.
XIX. Sur les contrats.
XX. Sur le gouvernement.
XXI. Sur le culte des Dieux.
XXII. Sur les prêtres et leur régime de vie.
XXIII. Sur les purifications.
XXIV. Sur les jugements.
XXV. Sur les sépultures.
XXVI. Sur le culte des morts.
XXV. Sur le bien qui doit résulter des présentes lois.
XXVIII. Division de l'être.
XXIX. De la différence des causes.
XXX. De la nécessité des causes.
XXXI. Sur les noms des plus anciens Dieux.
DEUXIÈME LIVRE.
I. De la méthode à suivre dans l'étude des sujets qu'on se propose ici de traiter.
II. Exposé préalable des idées générales.
III. Qu'il y a des Dieux.
IV. Sur la providence des Dieux.
V. Que les Dieux ne sont point auteurs du mal.
VI. Du Destin.
VII. De la multitude des Dieux.
VIII. De la différence entre les classes de Dieux.
IX. Du culte divin d'après les Curetés.
X. Des sept Dieux les plus anciens, et des autres Dieux supra célestes.
XI. De la génération des Dieux qui habitent l'enceinte du ciel.
XII. Démonstration générale des trois espèces de l'âme.
XIII. Des différentes espèces d'astres.
XIV. Des propriétés des sept planètes.
XV. Du cours particulier de chaque planète.
XVI. Du mouvement commun des astres et de tout l'éther.
XVII. De l'âme des astres.
XVIII. Qu'il y a des Démons.
XIX. Que les Démons ne sont pas méchants.
XX. Réfutation des calomnies contre les Démons.
XXI. Des différences entre les Démons.
XXII. De l'immortalité de l'âme humaine,
XXIII. De la création des êtres mortels.
XXIV. De la création de la substance mortelle de l'homme.
XXV. Des sensations et de leurs caractères propres.
XXVI. Des actes raisonnables de certains animaux.
XXVII. De l'éternité de l'Univers.
TROISIÈME LIVRE.
Chapitres.
I. Retour sur la question du Destin.
II. Retour sur la question de l'immortalité de l'âme humaine.
III. Sur le but de la vie.
IV. Sur l'intelligence et ses diverses espèces.
V. Sur l'éducation.
VI. Sur la forme du gouvernement.
VII. Du courage.
VIII. Des choses qui sont et de celles qui ne sont pas en notre pouvoir, d'après la théorie du courage.
IX. Des diverses espèces de courage.
X. De la tempérance.
XI. De la mesure et de la symétrie.
XII. Des diverses espèces de tempérance.
XIII. De la force, d'après la théorie des diverses espèces de tempérance.
XIV. De la prohibition du commerce entre les parents et leurs enfants.
XV. De la génération des Dieux, d'après la théorie de la prohibition du commerce entre les parents et leurs enfants.
XVI. De l'union d'un seul homme avec plusieurs femmes.
XVII. De la communauté des femmes.
XVIII. De l'usage des viandes.
XIX. De l'unité de la propriété dans une même famille.
XX. Comment éviter la ruine des propriétés à la mort du propriétaire.
XXI. Du mode d'existence.
XXII. De Jupiter; qu'il n'existe en lui aucune division, même nominale.
XXIII. De l'Univers et de son unité multiple.
XXIV. De la différence des biens.
XXV. De la justice.
XXVI. Des diverses espèces de justice.
XXVII. Comparaison des diverses espèces de vertu.
XXVIII. De la perversité des mœurs.
XXIX. De la convenance dans les dons.
XXX. Des contributions à verser au trésor public.
XXXI. Des jugements.
XXXII. Des noms des Dieux.
XXXIII. De la prière.
XXXIV. Allocutions aux Dieux.
XXXV. Hymnes aux Dieux.
XXXVI. Ordre à suivre pour les allocutions et les hymnes.
XXXXVII. Des sacrifices qui conviennent aux différents Dieux.
XXXVIII. En quelles occasions, à quels Dieux et comment il faut sacrifier.
XXXIX. Des dispositions où il faut être pour sacrifier.
XL. De l'exactitude dans les pratiques religieuses.
XLI. Contre qui l'on doit prier les Dieux.
XLII. Des oracles.
XLIII. Epinomis ou Conclusion.
Chapitre I. — De la diversité des opinions entre les hommes sur les objets les plus importants.
Cet ouvrage traite des lois, des institutions, des croyances et des pratiques qui peuvent assurer aux hommes, dans la vie privée et dans la vie publique, le sort le meilleur, le plus beau, et aussi le plus heureux possible. En effet, telle est la nature de l'homme, qu'il tend avant et par-dessus tout au bonheur; c'est à la fois la fin unique et commune de l'humanité, et le but particulier de la vie de chacun ; c'est en vue d'y parvenir qu'on poursuit et qu'on pratique toutes les autres choses. Tous sont emportés vers ce but commun, mais tous n'y vont pas par les mêmes voies, c'est là qu'ils se séparent. Les uns pensent trouver le bonheur principalement dans le plaisir ; ils font tout en vue du plaisir seul ; ils veulent, autant que possible, le goûter tout entier, sous toutes ses formes, de quelque nature qu'il soit, de, quelque source qu'il vienne. Les autres placent le bonheur dans la possession des richesses ; le seul travail de toute leur vie, c'est de s'enrichir toujours de plus-en plus. D'autres courent après la gloire; ils n'ont d'autre ambition que celle des éloges et de l'admiration de la foule. D'autres, enfin, négligent tout le reste pour consacrer leur vie entière au bien et à la vertu, persuadés que la vertu seule peut donner le vrai bonheur'. La vertu elle-même n'a pas pour tous les mêmes caractères; on voit le bien et le mal changer selon les opinions et les usages. Ainsi, les uns croient que l'étude et la science ne sont d'aucune utilité pour la vertu; il en est même qui raient scrupuleusement tout exercice d'esprit, quelques sophistes imposteurs leur ayant persuadé que la science n'est que mal et corruption; d'autres, au contraire, considèrent la science comme le principe de toute vertu, ils font tous leurs efforts pour acquérir le plus de savoir et le plus de sagesse possible. Ceux-ci mettent tous leurs soins à multiplier les sacrifices et les cérémonies religieuses ; ceux-là vont jusqu'à condamner toutes ces pratiques ; d'autres admettent les unes et rejettent les autres, mais avec si peu d'accord entre eux que les mêmes pratiques paraissent aux uns religieuses et aux autres sacrilèges. Ceux-ci placent dans le célibat et dans l'abstinence complète des plaisirs sensuels la vie la plus belle et la plus divine ; pour ceux-là, c'est une chose plus belle et plus divine de se marier et d'avoir des enfants. Quelques-uns font un choix parmi les alimente dont les hommes se nourrissent d'habitude, ils décident que les uns sont défendus et que c'est un crime de s'en nourrir, tandis que les autres sont permis ; d'autres laissent une pleine liberté à cet égard, il n'est point d'aliment dont l'usage leur paraisse devoir être prohibé comme impie, c'est dans la tempérance seule qu'ils placent le bien. Ceux-ci consentent à croupir dans une malpropreté repoussante ; ceux-là trouvent quelque mérite dans la propreté, et la recherchent. Les uns vantent la pauvreté et l'indigence; d'autres admettent la richesse dans une certaine mesure. Les uns affichent hautement l'impudeur ; les autres respectent la pudeur et les lois générales des convenances, ils préfèrent en tout la décence à l'indécence. Il en est encore qui établissent en principe de rechercher la vertu, non pas pour elle-même, mais en vue de quelque récompense que les Dieux lui accorderaient, selon eux la vertu ne suffit pas à elle seule pour le bonheur; quelques-uns croient devoir la rechercher pour elle seule, et non dans l'espoir d'une récompense; d'autres enfin poursuivent la vertu, et pour elle-même, et pour les récompenses que les Dieux accordent à ceux qui la pratiquent.
Quand nous voyons sur ces points-là et d'autres encore les hommes se conduire d'après des principes aussi contradictoires, aussi confus, il est clair que si nous voulons choisir à coup sûr la meilleure règle de conduite et ne pas nous écarter du but commun que tous poursuivent, à savoir le bonheur, nous devons ne pas prendre au hasard la première roule venue, mais d'abord rechercher avec soin quel est ce genre de vie, le meilleur de tous, où se rencontre le vrai bonheur, puis fixer notre choix. Mais auparavant encore, il faudra examiner ce qu'est l'homme, quelle est sa nature, quelles sont ses facultés. Sans cette étude préliminaire, nous ne pourrions savoir ce que nous avons de mieux à faire, ni connaître quel emploi nous devons faire de nos facultés. Car il en est ainsi de tout instrument et de tout objet quelconque : si l'on n'en connaît ni la nature ni les propriétés, on ne pourra en faire l'usage convenable. Or il est impossible de bien savoir ce qu'est l'homme si l'on n'a commencé par étudier à fond la nature des choses, si l'on n'a reconnu quel est le premier principe, quels sont les êtres du second, du troisième, du dernier ordre, quels sont les attributs propres à chacun de ces êtres. C'est après les avoir tous examinés qu'on pourra légitimement étudier l'homme au milieu d'eux, chercher quels sont les êtres dont il se rapproche et par quels côtés, quels sont ceux dont il s'éloigne et à quel degré, quels sont les éléments dont il a été formé ; enfin, étant donnée sa nature, quelle est sa puissance. C'est après avoir suffisamment éclairci ces questions, qu'on pourra en tirer les règles pour la vie de l'homme ; alors on connaîtra quelle est la conduite la meilleure et la plus utile, et cela sans peine et sans difficulté.
Mais la question de la nature des autres êtres n'est pas sujette à moins de discussions. Les uns pensent qu'il n'y a absolument pas de Dieux ; les autres croient que les Dieux existent, mais qu'ils ne veillent pas sur les affaires humaines ; d'autres enfin qu'ils veillent sur les affaires humaines et sur toutes choses. Mais parmi ces derniers, les uns pensent que les Dieux sont les auteurs du mal comme du bien, les autres, qu'ils ne produisent que le bien et jamais le mal. Les uns admettent qu'ils peuvent se laisser fléchir par lee prières des hommes et détourner des choses que dans leur sagesse ils croyaient devoir faire ; les autres qu'ils sont absolument inflexibles, et que fidèles à leur pensée toujours conforme aux arrêts du destin, ils conduisent chaque chose à la plus grande perfection possible. Ceux-ci croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et nulle autre chose ne leur semble digne d'être respectée et honorée par les hommes; ceux-là reconnaissent plusieurs Dieux unis par la communauté de nature en une même divinité ; selon d'autres, il y a un Dieu par excellence, un Dieu suprême, premier principe de toutes choses, et d'autres Dieux placés sur un deuxième et un troisième rang. Ceux-ci pensent qu'à l'exception du seul Dieu créateur tout a reçu l'être aussi bien dans le temps que par une cause, et que tout doit un jour périr et disparaître ; ceux-là, que le monde a été créé, mais qu'il subsistera éternellement ; d'autres enfin, qu'une partie du monde se forme et naît tandis qu'une autre se dissout et périt, cette succession ne devant jamais finir. Quelques-uns avancent que l'univers est l'effet d'une cause, mais qu'il n'a pas été créé dans le temps, et que par conséquent il est éternel et ne peut subir aucun changement de la part du Dieu qui l'a produit et qui veille sur lui, parce que ce Dieu est de sa nature immuable, que jamais il ne se repose, mais travaille sans cesse, et d'après des principes toujours les mêmes, à la production de cet Univers.
Les dissentiments ne sont pas moindres au sujet de la nature humaine. Plusieurs pensent qu'elle est semblable à celle de tous les autres êtres mortels et des animaux, qu'elle n'a rien de plus noble ni de plus divin; d'autres lui permettent d'élever ses espérances jusqu'à la pureté parfaite de l'essence divine ; quelques-uns assignent à l'homme une place intermédiaire qu'il doit toujours occuper, ils le considèrent comme un mélange de la nature divine et éternelle avec la nature mortelle.
Au milieu de l'incertitude, de la confusion qui obscurcit ces problèmes, si l'on n'examine pas avec soin chaque opinion, si l'on ne parvient pas à distinguer une fois pour toutes de quel côté sont les raisons les meilleures, de manière à trouver la vérité et à s'en assurer la possession, on ne pourra savoir-comment régler sa vie, on hésitera sur la manière de se diriger, on embrassera, on suivra au hasard tout parti qui se présentera; enfin on deviendra, sans s'en douter, de tous les hommes peut-être le plus misérable, au lieu d'être heureux comme on espérait.
Chapitre II. — Des meilleurs guides pour la recherche du vrai.
Quelle est donc la manière de procéder dans l'examen de ces opinions, quels guides doit-on suivre dans cette étude ? Car ces sujets ont été traités par une foule de poètes, de sophistes, de législateurs, de philosophes. Mais on peut à bon droit tenir les poètes et les sophistes pour de mauvais guides en pareille matière : les poètes sont fort enclins à la flatterie, ils n'ont d'autre but que de plaire aux hommes et font bon marché de ce qui est vrai, de ce qui est bien; les sophistes ne songent qu'à en imposer, aucun moyen ne leur coûte pour se faire une réputation, quelques-uns même élèvent leurs prétentions plus haut que la nature humaine ; quant à la vérité, ils n'en ont aucun souci, ils cherchent même mille expédients pour la déguiser. Les uns et les autres rabaissent les Dieux jusqu'à l'homme, élèvent l'homme jusqu'à la Divinité, bouleversent toutes choses et ainsi font le plus grand tort à ceux qui les écoutent. Tels sont les poètes et les sophistes pour la plupart. Mais les législateurs et les philosophes peuvent mieux que personne émettre sur les sujets qui nous occupent quelque opinion sensée. En effet, les législateurs se proposant toujours le bien commun, il n'est pas probable qu'ils s'en écartent toujours; et les philosophes, estimant que la vérité est l'élément principal du bonheur et la poursuivant de préférence à tous les trésors, doivent probablement la rencontrer mieux que personne. Toutefois, comme la plupart des hommes sont par leur nature incapables d'arriver pleinement à la connaissance et à la possession des plus grandes choses, il y a deux choses à craindre : c'est que, même parmi les philosophes et les législateurs, il ne s'en trouve qui aient été trop faibles pour découvrir le bien et le vrai, et d'autre part qu'on ne se trompe en prenant pour de sages législateurs ou pour des philosophes quelques sophistes ou quelques poètes habiles à s'emparer de l'esprit ignorant du vulgaire.
Quant à nous, voici les guides que nous choisissons parmi les législateurs et les sages : c'est d'abord le plus ancien dont le nom nous soit parvenu, Zoroastre, qui a révélé, avec le plus grand éclat, aux Mèdes, aux Perses et à la plupart des anciens peuples de l'Asie, la vérité sur les choses divines et sur la plupart des autres grandes questions. Après lui viennent, entre autres, Eumolpe, qui a établi chez les Athéniens les mystères d'Eleusis pour y enseigner le dogme de l'immortalité de l'âme ; Minos, législateur des Crétois ; Lycurgue, des Spartiates : ajoutons Iphitus et Numa, dont le premier, de concert avec Lycurgue, fonda les jeux Olympiens en l'honneur de Jupiter, le plus grand des Dieux, et le second donna aux Romains un grand nombre de lois dont plusieurs relatives aux Dieux, et notamment aux cérémonies religieuses. Parmi les législateurs, voilà ceux que nous préférons. Parmi les autres sages nous choisissons, chez les Barbares, les Brahmanes de l'Inde et les Mages de Médie; chez les Grecs, entre autres et surtout les Curetés, que la tradition donne pour les plus anciens législateurs : ce sont eux qui ont rappelé l'existence des Dieux du second et du troisième ordre, l'immortalité des œuvres et des enfants de Jupiter, et celle de l'Univers tout entier, croyances qui avaient été détruites en Grèce par les Géants, ces êtres impies qui luttèrent contre les Dieux. Par la force de raisonnements invincibles, et par la guerre qu'ils firent aux Géants, les Curetés triomphèrent de leurs adversaires qui prétendaient que tout est mortel, excepté le seul créateur, antique principe de toutes choses. Après eux nous citerons les prêtres de Jupiter à Dodone et les interprètes de ses oracles ; plusieurs autres hommes inspirés, et en particulier le devin Polyide, que Minos lui-même cultivait pour sa sagesse; Tirésias, qui donna aux Grecs un grand nombre de connaissances élevées, qui développa avec le plus d'éclat la théorie des migrations de l'âme et de ses retours sans fin sur la terre ; Chiron, précepteur d'un grand nombre de héros de son temps, auquel on doit beaucoup de connaissances et de découvertes importantes ; ajoutons les sept sages qui fleurirent avec éclat à l'époque où Anaxandride et Ariston régnaient à Sparte : Chilon de Lacédémone, Solon d'Athènes, Bias de Priène, Thalès de Milet, Cléobule le Lydien, Pittacus de Mitylène et Myson de Chêne. A tous ces maîtres joignons encore Pythagore, Platon, ainsi que tous les philosophes distingués qui se sont formés à leur école, et dont les plus illustres sont Parménide, Timée, Plutarque, Plotin, Porphyre «et Jamblique. Tous s'étant accordés sur la plupart des questions et sur les plus importantes, ils semblent avoir dicté leurs opinions, comme les meilleures, aux hommes les plus sensés qui se sont succédé après eux. Nous les suivrons donc, · sans chercher à rien innover par nous-même sur de si grands sujets et sans accueillir aucune des innovations modernes de quelques sophistes. Il existe cette différence capitale entre les sages et les sophistes, que les sages émettent des opinions toujours en harmonie avec les croyances plus anciennes, en sorte que, même par leur antiquité, les doctrines vraies l'emportent sur les propositions erronées qui ont été avancées ou qui le sont encore, tandis que les sophistes visent toujours au nouveau, seul objet de leur ambition. C'est, en effet, le meilleur moyen de parvenir à cette vaine gloire en vue de laquelle ils s'agitent. Pour nous, nous adopterons les doctrines et les paroles des hommes les plus sensés de l'antiquité; puis, à l'aide du raisonnement, le plus puissant et le plus divin de nos moyens de connaître, nous comparerons aussi exactement que possible tous les systèmes pour juger quelle est la meilleure opinion en toutes choses. Car le grand vice des poètes et des sophistes, c'est de ne jamais donner aucune raison valable des opinions qu'ils mettent en avant ; c'est à une inspiration prophétique des Dieux, qui sans doute vient les visiter, qu'ils feignent les uns et les autres de devoir ces connaissances. Ainsi les poètes, ornant leurs paroles des charmes de l'expression et du rythme, séduisent ceux qui les écoutent, et entraînent les esprits qui ne savent pas distinguer l'agrément du style et de l'harmonie d'avec la vérité ou la fausseté des pensées. Du reste, les poètes s'inquiètent assez peu de persuader ceux qui les écoutent, il leur suffit de les amuser, qu'ils les persuadent ou non; mais il se trouve des hommes sur lesquels ils agissent plus même qu'ils ne cherchent à le faire. Pour les sophistes, les uns emploient de faux raisonnements au lieu d'arguments justes et vrais, et trompent ainsi les esprits grossiers; d'autres, les plus charlatans de tous, feignent d'opérer certains miracles et semblent accomplir de grandes choses par un pouvoir divin, mais en réalité, moyens et résultats, tout n'est qu'imposture : cependant ils frappent les esprits faibles et incapables d'examen ; puis leurs mensonges grossis par des discours et des écrits venus plus tard en égarent beaucoup d'autres ; enfin ces doctrines reçoivent de l'habitude de les entendre répéter dès l'enfance, une autorité qui fait le plus grand mal aux Etats en accréditant mille principes absurdes qui ont pour la conduite de la vie humaine les plus graves conséquences. Au contraire, les raisonnements bien déduits enseignent clairement la vérité sur les objets soumis à l'examen, et s'offrant d'eux-mêmes à la discussion d'une critique attentive, ils conduisent les derniers venus aussi bien que les premiers à une science personnelle et non pas empruntée, au rebours de ceux qui, trompés par les enseignements des sophistes, empruntent aveuglément leur persuasion à ceux qui se sont laissé persuader avant eux.
Chapitre III. — Sur les doctrines opposées de Protagoras et de Pyrrhon.
Ces deux doctrines, tout à fait opposées l'une à l'autre, mais également vaines et pernicieuses, doivent être également rejetées. Protagoras dit que tout est vrai, que l'homme est la mesure de toute chose, et que ce que chacun s'imagine existe par cela même; Pyrrhon soutient que rien n'est vrai, que l'homme est incapable d'être juge de rien, et qu'il n'en faut pas même croire le témoignage des choses. Leurs deux propositions sont faciles à retourner et par conséquent à réfuter : si l'on dit que tout est vrai, l'on sera forcé d'accorder la vérité de l'opinion contraire, qui est celle de la plupart des hommes, à savoir que toutes choses ne sont pas vraies ; si l'on dit que rien n'est vrai, l'on convient que cette affirmation même ne l'est pas. En outre, la plupart des hommes reconnaissent des degrés dans le savoir et dans l'ignorance, ils vont demander des leçons aux savants et accusent les ignorants de ne pas posséder assez bien ce qu'ils prétendent connaître; en serait-il ainsi si les hommes croyaient que le vrai est partout ou qu'il n'est nulle part? Jamais non plus on ne dira que deux propositions contradictoires sont toutes deux vraies ou toutes deux fausses en même temps; c'est une opinion que personne ne discutera. Ainsi tout le monde dira que cette proposition : l'Univers est éternel, a pour contradictoire celle-ci : l'Univers n'est pas éternel, et qu'il ne peut se faire que ces deux propositions soient à la fois toutes deux vraies ou toutes deux fausses; dans tous les cas semblables, l'une des propositions est seule vraie et l'autre est fausse. De même pour l'avenir, personne ne soutiendra que tous les faits viendront nécessairement justifier ses prévisions ou que tous tiendront les démentir, mais chacun sait d'avance que certains faits les contrediront, tandis que d'autres seront d'accord avec elles, en sorte que certaines prévisions auront été vraies et les autres fausses. Ainsi ces deux doctrines sont également convaincues de fausseté et d'absurdité. Il ne faut pas tenir compte non plus de cette autre opinion, que, fussions-nous capables d'atteindre en quelque chose a la connaissance du vrai, il ne nous appartiendrait pas, en notre qualité d'hommes, de porter nos recherches sur les choses divines, à cause de l'infériorité de notre intelligence, et parce que les Dieux ne veulent pas que leur nature soit l'objet d'une indiscrète curiosité. En effet, les Dieux ne pourraient nous avoir donné en vain le désir d'étudier leur nature, s'ils avaient voulu nous interdire cette étude, et nous refuser la faculté d'acquérir sur eux quelques notions claires. D'ailleurs, il serait également absurde d'admettre que nous devons, ou bien n'avoir aucune idée de ces choses et vivre ainsi comme les brutes, ou bien accepter au hasard et sans examen toutes les imaginations qui se présentent, ce qui ne nous permettrait pas d'atteindre le bonheur que nous poursuivons. En effet, quand même, par un hasard divin, quelqu'un, sans le secours de la raison, rencontrerait la vérité sur ces matières, jamais, après l'avoir ainsi acquise, il ne la posséderait sûrement, et il ne pourrait jouir ni d'un bonheur parfait ni même d'aucun bonheur, n'ayant ni la raison ni la science nécessaires pour s'éclairer sur les questions les plus importantes, et ignorant même s'il est heureux ou non. Car ce n'est pas assez de s'imaginer être heureux, cela peut arriver même à des fous; il faut encore savoir en quoi et comment l'on est heureux, ce qui est bon pour l'homme et ce qui est mauvais, et pourquoi. De plus, les choses divines ne renferment aucun vice qui puisse obliger les Dieux à les cacher, et ces Dieux sont incapables d'un sentiment de jalousie qui les empêcherait de joindre à leurs autres bienfaits celui de se laisser connaître. Et quoique la nature divine soit extrêmement au-dessus de celle de l'homme, on ne peut pas dire pour cela qu'il soit condamné à ne pas la connaître puisqu'il possède aussi la raison et des facultés qui ne sont pas tout à fait étrangères à la nature divine. Enfin, si les Dieux nous ont disposés à rechercher leur nature, c'est précisément pour que nous la recherchions, que nous la connaissions, du moins en partie, et retirions de cette connaissance les plus grands avantages. En effet, prenant pour principes les idées et les révélations données en commun par les Dieux à tous les hommes au sujet de la nature divine, ou du moins les idées du plus grand nombre et des plus vertueux, nous nous en pénétrerons fortement ; puis, par des raisonnements rigoureux, tirant de ces principes les conséquences auxquelles les sages nous ouvriront la voie, avec l'aide des Dieux, nous ne pourrons manquer d'avoir sur chaque chose la meilleure opinion. C'est donc aux Dieux arbitres de la raison que nous devons, avant d'aller plus loin, adresser nos prières pour qu'ils favorisent ce travail de leur inspiration.
Chapitre IV. — Prière aux Dieux arbitres de la raison.
Venez à nous, Dieux arbitres de la raison, qui que vous soyez, en quelque nombre que vous soyez, vous qui présidez à la science et à la vérité, qui les distribuez à qui bon vous semble, suivant les décrets du père tout-puissant, du roi de toutes choses, Jupiter. Sans votre assistance, nous serions incapables d'accomplir une si grande œuvre. Venez donc guider nos raisonnements, et accordez à cet ouvrage d'obtenir le meilleur succès possible, et d'être comme un trésor toujours ouvert à ceux d'entre les hommes qui veulent mener dans la vie publique ou privée la conduite la plus belle et la meilleure.
Chapitre V. — Principes généraux sur les Dieux.
Voici les croyances dont on peut le mieux affirmer qu'elles nous ont été transmises par une succession d'hommes divins. Les Dieux sont tous les êtres d'une nature plus élevée et plus heureuse que celle de l'homme. Ils déversent sur nous par leur providence le trop-plein de leur bonheur : aucun mal ne peut venir d'eux, ils sont les auteurs de tout bien ; par une loi fatale et immuable ils attribuent à chacun le sort le meilleur passible. Il y a plusieurs Dieux, mais à des degrés différents de divinité. L'un d'eux, le plus grand de tous, c'est le Dieu suprême, le roi Jupiter, qui, en effet, les surpasse tous infiniment par sa majesté et l'excellence de sa nature : il a existé de toute éternité, il ne doit l'être ni la naissance ù personne, il est son propre principe, et, seul de tous les êtres, n'ayant d'autre père que lui-même, il est le père et le premier auteur de toutes choses; il est d'une essence tout à fait essentielle, absolument un, éternellement identique à lui-même; il est le bien par essence. Les autres Dieux sont partagés en Dieux du deuxième et du troisième ordre, dont les premiers sont les œuvres, les enfants de Jupiter, les seconds sont les œuvres de ses œuvres, les enfants de ses enfants : ce sont, les instruments par lesquels le roi Jupiter gouverne toutes choses et en particulier les choses humaines; chacun d'eux est établi chef d'une partie plus ou moins grande de cet Univers ; mais tous sont gouvernés par le grand Neptune, l'aîné et le plus puissant de tous les enfants de Jupiter, le plus beau possible de ses ouvrages et le plus parfait. Les Dieux nés immédiatement de Jupiter lui-même sont les Dieux supra célestes ; ils ont une divinité de second ordre dégagée de tout lien des corps et de la matière; ce sont des formes essentiellement pures, des esprits immuables, toujours et en toutes choses agissant par la seule force de leur propre pensée ; chacun d'eux tient de Jupiter lui-même une essence qui est indivisible comme celle de son auteur, mais qui renferme on soi, d'une manière collective à la fois et individuelle, tout ce qu'elle donne ensuite en le multipliant aux êtres inférieurs. Quant à leurs attributs, tous ces Dieux, excepté Neptune seul, le plus ancien d'entre eux, les reçoivent les uns des autres, leur roi et leur père ayant établi entre ses enfants une communauté et une réciprocité de biens, le plus beau don qu'il leur ait fait après la participation à son essence. Quant à Neptune, gouverné par Jupiter seul, il gouverne tous les autres. Parmi les autres Dieux, ceux-là sont plus élevés qui ont le moins de supérieurs et qui font dans l'Univers plus et de plus grandes choses ; moins élevés sont ceux qui font moins et de moindres choses et qui reconnaissent plus de supérieurs. On trouve encore à établir d'autres divisions dans cette classe de Dieux. D'après la plus importante, elle se divise en deux grandes familles : d'abord celle des fils légitimes de Jupiter, que leur père a doués de la faculté de produire aussi des êtres immortels; les autres Dieux, qui forment la famille illégitime des Titans, ne produisent que des êtres mortels et périssables ; ils sont pareils aux premiers Dieux par la communauté d'origine, mais ils leur sont fort inférieurs en puissance et en grandeur. Tous ces Dieux sont à tous égards en dehors du temps, car ils subsistent toujours et sont absolument immuables. En effet, le temps est la mesure du changement, et ils ont l'éternité pour mesure de leur vie ; il n'y a pour eux ni passé, ni avenir, ni avant, ni après ; tout est pour eux éternellement présent. Ils ne peuvent être non plus circonscrits par le lieu dans l'espace, car c'est le propre des corps d'être ainsi circonscrits dans un lieu, et ils ne sont pas des corps, mais des essences pures. Cependant ils ont leur lieu propre, en ce sens qu'ils sont classés dans un ordre déterminé, de façon que chacun d'eux tient le milieu entre celui qui le précède et celui qui le suit. Ainsi tout le domaine supra céleste est partagé entre ces Dieux, mais la principale division de ce monde supérieur est une division en deux parties qui correspondent aux deux familles de Dieux, et sont le siège particulier de chacune d'elles : les enfants légitimes de Jupiter habitent l'Olympe, région la plus élevée des cieux et la plus pure ; la race illégitime occupe le Tartare, séjour inférieur à l'autre. Ces deux familles distinctes, celle de l'Olympe et celle du Tartare, forment un ensemble grand et saint, monde intelligible et supra céleste ordonné par Jupiter roi, monde éternel, riche de tous les biens, renfermant tous ces Dieux du second ordre constitués en nombre suffisant et ne manquant de rien pour former un ensemble complet. Ces Dieux, séparés les uns des autres de la manière la plus exacte, en sorte que chacun d'eux soit dans ses attributions le plus parfait, le plus indépendant possible, sont en même temps réunis par la communauté des biens et par les liens d'une affection réciproque. Car, en même temps qu'ils ont un caractère individuel, ils forment cependant un tout, comme il convient à des êtres qui procèdent d'un même principe et tendent à une même fin, à savoir, leur père, leur auteur, le grand Jupiter, absolument un et tout-puissant. Toutes choses lui sont soumises et dévouées, sans lutte, sans opposition, sans mauvais vouloir ; mais ces Dieux surtout acceptent avec amour sa domination. Entre eux ils sont unis par un commerce amical et par la communauté de vues : d'un côté, ils dirigent les Dieux moins puissants et plus jeunes qu'eux ; de l'autre, ils se laissent guider par les plus anciens ; car, dans ce monde supérieur, il règne en toutes choses une harmonie et un ordre parfaits. Tel est l'état constant dans lequel tous ces Dieux se maintiennent.
Neptune et ses frères légitimes les Dieux de l’Olympe ont des enfants qui forment des Dieux d'un troisième ordre ; ces Dieux habitent l'enceinte de notre ciel, ce sont des êtres raisonnables et immortels, ils ont une âme impeccable et un corps qui échappe à la vieillesse et à la corruption, leur nature ne peut admettre aucun mal. Leurs créateurs les ont aussi repartis en deux classes. L'une est la famille légitime et céleste des astres, dont les âmes sont de l'espèce la plus pure et atteignent tout par leur science, et dont les corps sont les plus beaux et les plus actifs possible ; ce sont des Dieux qui se meuvent et se déplacent, mais suivant une marche régulière. Vient ensuite la famille illégitime et terrestre des Démons : leur corps n'a pas la même vertu, non plus que leur âme, qui est d'une espèce inférieure et n'atteint pas à la science de toutes choses, bien qu'ils en conçoivent plusieurs par conjecture seulement, mais toujours avec exactitude, parce que toujours ils peuvent suivre les traces des Dieux de la classe supérieure, et, grâce à ceux-ci, toujours et en toutes choses demeurer infaillibles. Cette classe est chargée d'exécuter les ordres des autres Dieux, et touche immédiatement à la nature humaine. On distingue donc quatre classes de Dieux, deux sont supra célestes, l'une habite l'Olympe, l'autre le Tartare ; les deux dernières habitent l'enceinte du ciel, l'une est céleste, l'autre est terrestre. Tous ces Dieux sont engendrés en ce sens qu'ils procèdent d'une cause et qu'ils ont reçu d'un autre l'existence ; mais dans le temps, ils sont incréés et impérissables, car ils procèdent de Jupiter, qui est éternellement actif, qui n'est pas et n'a jamais été borné à la simple puissance sans acte; c'est pourquoi ils n'ont ni commencement ni fin. Dans Jupiter, l'essence et l'action sont identiques, il n'y a entre elles nulle distinction, car ce Dieu est essentiellement un, jamais il n'est différent de lui-même. Dans l'intelligence, l'action est distincte de l'essence, mais l'action est toujours en exercice, jamais en repos ; aussi les créatures que l'intelligence produit sans le concours d'aucun être d'une autre classe sont-elles immortelles. Dans l'âme, on distingue de même l'essence et l'action ; mais quoique active en partie, l'âme est le plus souvent limitée dans son action et réduite au rôle de force inerte. Enfin, dans le corps, outre tout cela, l'essence est divisée en forme et matière, matière qui est non seulement mobile, mais encore décomposable et divisible à l'infini. Voici encore une différence et la plus essentielle entre les êtres. Les Dieux supra célestes sont incréés non seulement dans le temps, mais aussi par leur permanence, car ils sont absolument immuables et éternels, il n'est rien en eux qui n'étant pas auparavant se soit produit ensuite, enfin ils ne sont engendrés que par rapport à la cause ; en effet, tout ce qui tire l'existence d'une cause est engendré en ce sens qu'il continue toujours de recevoir l'être d'une autre puissance et qu'il est incapable de suffire à sa propre existence. Les Dieux qui sont dans l'enceinte du ciel sont aussi engendrés quant à la cause : car par rapport à la substance de leur âme, ils sont incréés, puisque leur âme est immuable et par suite éternelle; pour ce qui est de l'action de l’âme et de la nature du corps, ils sont véritablement créés, car ils sont soumis au mouvement, au renouvellement continu, et au temps divisible et mesurable. En effet, le temps a son principe dans cette âme qui gouverne notre ciel ; il est premièrement pour elle la mesure du mouvement continu de son action ; puis il se mêle à l'essence de toute âme et de tout corps : image de l'éternité, passé il n'est déjà plus; avenir, il n'est pas encore ; il est un instant insaisissable, toujours et maintenant renouvelé, limite du passé et de l'avenir. Quant au lieu, ces mêmes Dieux peuvent aussi être circonscrits dans une partie déterminée de l'espace, parce qu'ils sont unis à des corps; c'est pourquoi on peut les nommer intra célestes, tandis qu'on nomme supra célestes les autres Dieux qu'on ne peut enfermer ni dans le corps ni dans aucun lieu. En grandeur, les Dieux de l'Olympe s'élèvent au-dessus de tous les autres Dieux, quelle que soit leur origine, mais en nombre, ils sont les plus limités. Il en est de même pour les Démons : ceux qui sont réellement plus près de Jupiter, qui est l'unité pure, sont aussi moins nombreux, ceux qui sont plus éloignés sont plus nombreux ; ainsi les uns se rapprochent plus, les autres s'éloignent plus de l'unité. Mais au-dessus des Dieux de l'Olympe et de cet Univers est placé Neptune, auquel Jupiter roi a confié après lui le gouvernement de toutes choses, comme au plus puissant, au plus grand, à l'aîné de ses enfants. Cependant Jupiter ne l'a pas égalé à lui-même, parce qu'il serait contraire à l'équité de placer au même rang que l'être qui se suffit à lui même celui qui tient l'existence d’un autre…………………………………………….
Chapitre XXI. — Sur le culte des Dieux.
……. On suivra pour les mois et les années l'ordre indiqué par la nature, c'est-à-dire qu'on fera les mois lunaires et les années solaires, en réglant ces dernières sur les solstices et en prenant pour point de départ le solstice d'hiver, époque où le Soleil, arrivé à son point le plus éloigné, commence à se rapprocher de nous. On appellera vieille et nouvelle lune le jour où la Lune se trouvera en conjonction avec le Soleil d'après le calcul des personnes les plus entendues en astronomie. Le jour suivant, à partir du milieu de la nuit qui suivra la conjonction de ces deux divinités, sera la nouvelle lune ou premier du mois, à partir duquel on comptera tous les autres jours du mois au nombre de 30 pour les mois pleins, de 29 pour les mois caves, de manière que le soir de chaque nuit appartienne toujours à la veille, et le matin au jour présent, le milieu de la nuit étant la limite des deux jours. Voici donc la manière de compter les jours de chaque mois : après la nouvelle lune on aura le deux du mois commençant, puis le trois, le quatre et ainsi jusqu'au huit ; après le huit, viendra le sept du mois moyennant, puis le six, et ainsi en descendant jusqu'au deux qui précédera la dichoménie ou milieu du mois. On reprendra alors le deux du mois déclinant, le trois, et ainsi jusqu'au huit, après quoi viendra le sept du mois finissant, le six, et ainsi de suite, à rebours, jusqu'au deux, qui sera suivi de la vieille lune d'abord, et ensuite de la vieille et nouvelle lune, dans les mois pleins, ou immédiatement de la vieille et nouvelle lune, si le mois est cave. Quant aux mois, on appellera mois nouveau celui qui suivra le solstice d'hiver, et les autres seront désignés seulement par leur rang jusqu'au douzième dans les années normales, jusqu'au treizième dans les années à intercalation, le treizième mois ou mois intercalaire se composant des jours qui resteront, quand le douzième mois n'atteindra pas exactement le solstice d'hiver. Pour la détermination du solstice, on se servira de cadrans exécutés avec la plus grande précision possible……………………….
« Pléthon, dans son traité des Lois, ayant à s'occuper des jours, des mois et des ans, ne désigne pas les mois par leurs noms attiques,.... il les nomme simplement, d'après la place qu'ils occupent, par leurs numéros d'ordre, premier mois, deuxième mois et ainsi de suite...
« Il veut que pour le calcul des jours les mois soient partagés en quatre périodes, le mois commençant, le mois moyennant, le mois déclinant et le mois finissant sans doute parce qu'il trouve cela plus commode pour la distribution des nouvelles fêtes qu'il juge à propos d'instituer
« Il donne à chaque mois six jours de fête ou hiéroménies, ce qui retranche beaucoup trop de temps aux travaux nécessaires à la vie sociale ; car il faut » bien que ces fêtes soient chômées. Ajoutez qu'il place de suite trois hiéroménies, la vieille lune consacrée à Pluton, la vieille et nouvelle lune occupée par l'examen de conscience, la nouvelle lune consacrée à Jupiter... Mais qu'est-ce que ces hiéroménies ? c'est à lui de le dire, puisqu'il veut les créer en remplacement des fêtes établies... Pour ce qui est de l'examen de conscience à la fin du mois, et une seule fois par mois, ce peut être son avis, ce n'est pas le nôtre ; « selon nous, ce n'est pas trop de faire cet examen chaque jour...
« Pléthon appelle vieille lune le vingt-neuvième jour du mois, et le trentième, vieille et nouvelle lune. En cela, il ne diffère pas beaucoup de nous quant au fond des choses. Seulement, nous appelons second jour du mois finissant celui qu'il aime mieux appeler vieille lune, sans doute, parce que, voulant faire de ce jour une hiéroménie consacrée à Pluton, il a cru devoir lui donner un nom imposant et grave : il faut bien passer ces sortes de choses à ceux qui se mêlent d'innover en matière de religion. » (Gâza.)
Chapitre VI. — Du Destin.
Les choses futures sont-elles toutes déterminées et fixées à l'avance par le destin, ou bien en est-il qui n'aient rien d'arrêté et qui se produisent sans ordre et sans loi, comme le hasard les amène ? Sans nul doute, toutes choses sont soumises à une loi ; car si quelque événement se produisait sans être déterminé par une loi, ou bien il n'aurait pas sa cause, et il y aurait alors un fait qui se produirait sans cause, ou bien la cause qui le produit agirait sans détermination, sans nécessité, et il y aurait alors une cause qui ne produirait pas ses effets nécessairement et d'une manière déterminée : les deux choses sont également impossibles. Mais il est bien moins possible encore que les Dieux changent ce qu'ils ont résolu pour l'avenir et fassent autre chose que ce qu'ils ont fixé, déterminés à ce changement, par les prières des hommes, par certains présents ou par quelque autre raison semblable. En effet, en niant la nécessité et la prédétermination des faits à venir, on s'expose à refuser entièrement aux Dieux la prévision des choses humaines ou à les accuser d'être les auteurs du pire, au lieu du mieux possible, puisque nécessairement, des choses qu'ils ont résolues en premier ou en second lieu, l'une doit être pire que l'autre : ceux qui nient absolument le destin tombent donc dans l'une ou l'autre de ces impiétés. Mais ces deux suppositions sont tout à fait impossibles; tous les événements à venir sont fixés dès l'éternité, ils sont rangés dans le meilleur ordre possible sous l'autorité de Jupiter, maître unique et suprême de toutes choses. Seul de tous les êtres, Jupiter ne connaît pas de bornes, puisqu'il n'y a rien qui puisse le borner, rien ne pouvant être borné que par sa propre cause ; mais, trop grand pour pouvoir être borné, il demeure éternellement et parfaitement identique à lui-même, il a pour essence la nécessité la plus grande de toutes et la plus puissante, qui est par soi d'une manière absolue et ne dérive d'aucune puissance étrangère ; car ce qui est nécessaire vaut mieux que ce qui est contingent, et la nécessité la plus grande convient à l'être essentiellement bon. A ceux qui procèdent immédiatement de lui, Jupiter communique le même attribut à un degré inférieur, car les êtres qu'il produit sont nécessairement de même nature que lui; il détermine ces choses et toutes les autres à cause de lui, et il n'y a rien de si grand ni de si petit à quoi il ne puisse de lui-même assigner sa limite, parce qu'il n'y a rien dont il ne soit la cause suprême. D'ailleurs, si l'avenir n'était pas fixé, la prescience serait impossible, et pour les hommes, et même pour les Dieux ; car on ne peut pas connaître avec certitude l'indéterminé, dont on ne saurait dire à l'avance avec exactitude s'il sera ou ne sera pas. Or, les Dieux connaissent l'avenir, puisque ce sont eux qui le fixent, et qu'ils l'ont présent en eux, comme en étant la cause, avant même qu'il ait reçu l'existence. Ils le connaissent uniquement parce qu'ils le disposent et le produisent; car ils ne peuvent le connaître comme étant eux-mêmes affectés par lui; en effet, il répugne, il est impossible d'admettre que les Dieux soient affectés par des choses d'une nature inférieure, et qui n'existent même pas encore. Ainsi, ceux qui pensent que les Dieux existent et qui leur refusent en même temps la prescience et la prédétermination des choses de ce monde, sont conduits à leur en refuser jusqu'à la connaissance ; car ils ne les connaîtraient ni comme soumis à l'action de ces choses, puisque le moins parfait ne peut agir sur le plus parfait, ni comme agissant sur elles, parce qu'ils n'en seraient même pas les auteurs. Il est nécessaire, en effet, que ce qui connaît entre en rapport avec la chose connue, soit à titre de participation en subissant son action, soit à titre de cause en agissant sur elle, toute connaissance étant impossible à une autre condition qu'à celle d'un rapport entre le connaissant et le connu. Et quand bien même les Dieux seraient les auteurs des choses de ce monde, s'ils ne l'étaient pas d'une façon déterminée et nécessaire, jamais ils ne sauraient ce qu'ils doivent faire un jour, puisqu'ils ne le fixeraient pas nécessairement et de toute éternité d'une manière immuable. Mais les Dieux connaissent l'avenir, et parmi les hommes ils en choisissent auxquels ils le font connaître dans une certaine mesure. Quelques-uns de ces hommes ont voulu mettre à profit cette prévision d'une partie de l'avenir pour tenter d'y échapper, mais, comme les autres, ils ont trouvé les arrêts du Destin nécessaires et inévitables ; il en est même qui par cette prévision de leurs destinées et par leurs efforts pour s'y soustraire en ont amené l'accomplissement, Cela même étant dans leur destinée. Il n'y a donc aucun moyen d'échapper, de se soustraire aux choses une fois décidées de toute éternité par Jupiter et fixées par le Destin.
Mais, dira-t-on, si tout est déterminé à l'avance, si aucun des faits présents ou à venir n'échappe à la nécessité, c'en est fait de la liberté humaine et de la justice divine : car, d'une part, les hommes agiront sous l'empire de la fatalité, ils ne seront pas maîtres d'eux-mêmes, ils ne seront pas libres; d'autre part, les Dieux renonceront complètement à punir les méchants, car ils ne seraient pas justes en les punissant, puisque leur méchanceté est fatale et involontaire. Mais les hommes sont maîtres d'eux-mêmes, non pas comme n'ayant personne qui les gouverne, ni parmi les autres êtres, ni parmi les Dieux eux-mêmes, mais comme ayant en eux un seul principe qui commande, c'est-à-dire l'âme, et tout le reste qui obéit; c'est ce principe unique, le meilleur de notre nature, qui dispose de tout le reste. Mais cette âme elle-même, personne n'oserait soutenir qu'elle ne subit aucune domination. Elle est d'abord évidemment soumise à l’impression des choses extérieures ; de plus, s'il est vrai que dans tous les hommes l'âme n'est pas soumise de la même manière aux mêmes influences, il n'en serait pas moins absurde de penser qu'elle ne subit pas nécessairement ces influences, puisque évidemment cela dépend du caractère propre à chaque âme en particulier, et aussi de l'exercice. En effet, un même événement quelconque venant à agir sur plusieurs hommes différents, produira nécessairement sur eux des impressions différentes ; car leurs âmes diffèrent et par la nature et par l'exercice : or, la nature de l'âme dépend des Dieux, l'exercice dépend de l’intention préalable de celui qui le pratique, intention qui ne peut naître dans l'homme sans lui avoir été suggérée par un Dieu. Ainsi, les hommes sont maîtres d'eux en tant que gouvernant leur conduite, bien que cette domination soit soumise à une domination supérieure, et l'on peut dire qu'ils sont libres et ne le sont pas. En effet, ce serait évidemment une erreur de dire que la liberté est le contraire de la nécessité, car il faudrait alors appeler esclavage la nécessité: or, l'esclavage suppose une domination à laquelle l'esclave est soumis en sa qualité d'esclave ; mais cette nécessité première qui seule existe absolument et par soi, tandis que c'est par elle que toutes choses existent, cette nécessité que nous appelons le bien absolu, Jupiter, à quelle domination sera-t-elle donc soumise? Car assurément, ce qui est domination ne peut être en même temps esclavage. Si d'un autre côté on appelle esclavage la soumission à un supérieur, et liberté l'affranchissement de toute domination, il n'y aura de libre ni un seul homme, ni même un seul des Dieux, excepté Jupiter ; car chaque inférieur sera l'esclave de celui qui le gouverne, et tous seront esclaves de leur maître commun, Jupiter. De cette façon, la servitude n'aurait absolument rien de pénible ni que l'on dût fuir. En effet, l'esclavage sous un bon maître ne peut être fâcheux, bien plus, il est profitable et doux à l'esclave lui-même, parce qu'on ne peut attendre que du bien d'un bon maître. Mais si l'on n'accepte pas cette définition de l'esclavage et de la liberté, si l'on dit que ces deux états consistent à être empêché ou non de vivre comme on veut; chacun voulant vivre heureux et content, quiconque sera heureux sera en même temps libre, qu'il ait un maître ou non, puisqu'il vivra comme il veut ; le malheureux, au contraire, ne vivant pas comme il aurait voulu, ne sera pas libre. Or les hommes ne peuvent être malheureux que lorsqu'ils sont méchants; ainsi personne ne veut être méchant, puisque personne ne veut être malheureux : c'est donc contre sa volonté et par erreur qu'on devient méchant ; par conséquent aucun méchant n'est libre, c'est le privilège des hommes honnêtes et vertueux. Que si les Dieux châtient les méchants, le but qu'ils se proposent et auquel ils aboutissent, n'est pas la punition en elle-même, mais le redressement des fautes. En effet, il est impossible que l'homme ne pèche jamais, puisqu'il est composé de deux natures, l'une divine, l'autre mortelle ; tantôt il est entraîné par ce qu'il a de divin en lui vers limitation de cette perfection dont il participe, alors il est vertueux, il est heureux; tantôt emporté par ses instincts mortels, il tourne à mal ; c'est alors que les Dieux viennent à son secours et qu'ils cherchent à le corriger par des punitions : ils veulent que ces châtiments qui lui sont infligés le délivrent de sa méchanceté, comme les remèdes amers et douloureux délivrent notre corps de la maladie; ils veulent que l'homme soit par là conduit à un état meilleur, et passe de l'esclavage à la liberté, quand ils jugent qu'à cause de sa mauvaise nature, des moyens de correction plus doux ne sauraient l'atteindre. Ainsi, rien n'empêche que l'homme ne soit puni, quoique sa méchanceté soit involontaire, puisque la punition, loin d'ajouter à ses maux, lui procure un bien. En résumé, il y a des Dieux, ils veillent sur les hommes, ils ne sont la cause d'aucun mal ; enfin selon la loi inévitable du destin ils accordent à chacun ce qui lui vaut le mieux. Pour ne pas dépasser les bornes, nous nous arrêterons ici.
Chapitre XXII. — De l'immortalité de l'âme humaine.
En parlant de l'immortalité de l'âme, Pléthon essaie d'établir, selon le système de la métempsychose, que les âmes rentrent dans les corps et reviennent à la vie après certaines périodes de temps déterminées, mais sans s'élever jamais jusqu'au céleste séjour. (Gennadius)
Chapitre XXVI. — Des actes raisonnables de quelques animaux.
Les actes de certains animaux qui paraissent attester une inspiration de la raison, comme, entre mille, ceux-ci, qui sont les plus connus : le gouvernement des abeilles, la prévoyance des fourmis, l'habileté de l'araignée à tendre ses filets, sont-ils l'œuvre d'une raison propre à ces animaux ? Cette raison serait alors ou supérieure, ou inférieure, ou égale à celle de l'homme. Mais si ces animaux avaient une raison plus éclairée que la nôtre, dans toutes ou presque toutes les circonstances ils agiraient mieux que l'homme, et il est visible que le plus souvent ils restent au-dessous de lui. Si cette raison était inférieure, chacun d'eux ne s'attacherait pas exclusivement à un seul ouvrage pour le porter presque à la perfection ; car il semble que ce soit le propre d'une intelligence accomplie et supérieure à celle de l'homme de s'appliquer toujours à un seul ouvrage pour le rendre le plus parfait possible. Si enfin leur esprit était égal à celui de l'homme, il ne se concentrerait pas ainsi sur un seul travail, pour se montrer ensuite dans tout le reste inférieur aux œuvres humaines. Il est donc évident que les animaux obéissent, non pas à une raison individuelle, mais à l'influence de cette âme qui gouverne notre monde, et des intelligences abstraites qu'elle fait présider à chacun de ces êtres et auxquelles elle attache chacun d'eux en particulier. Il en est ainsi non seulement des animaux, mais encore des choses inanimées ; on peut citer entre autres les vrilles de la vigne et de la citrouille, qui, si elles ne rencontrent rien à quoi s'enlacer, restent droites, et, si une branche se présente, s'y enroulent aussitôt. Par l'action de cette même âme, l'aimant attire le fer ; le mercure mis en contact avec l'or ou avec quelque autre métal du même genre, s'y attache d'une manière merveilleuse et se volatilise : tous les phénomènes semblables doivent être rapportés à la même cause. C'est cette âme qui embrasse notre monde d'ici bas, qui, par sa puissance, en gouverne toutes les parties, accomplit tout d'après la raison, et entre autres choses rapproche les êtres qui ont entre eux quelque affinité.
Chapitre XXVII. De l'éternité de l'univers.
Quand le Soleil et Saturne eurent terminé cette dernière création mortelle d'.après les plans de Neptune, chef de tout ce qui existe, alors non seulement notre monde fut complètement achevé, grâce à ce même Dieu ; mais aussi, par la puissance de Jupiter le maître suprême, cet ensemble de créations composé d'une multitude d'êtres différents, éternels, temporels, immortels, mortels, forma un système universel aussi beau et aussi parfait que possible…………………………………
Chapitre XI. — De la mesure et de la proportion.
Le beau, dont nous venons de parler, doit être cherché dans la mesure et dans la proportion ; il a besoin d'une limite fixe, et ne peut être ni une grandeur non mesurable ni un indéfini qui s'accroisse sans cesse. Cependant on fera peut-être cette objection : si le plus d'existence est en même temps le mieux, pourquoi n'est-ce pas ce qui s'accroît indéfiniment, mais ce qui reste dans la mesure, qui est le beau et le bien ? C'est que ce n'est ni le plus en nombre, ni le plus en volume, ni en un mot le plus en quantité qui existe au plus haut degré, mais bien plutôt ce qui est le mieux doué pour durer toujours : et ce qui est le mieux doué pour durer toujours, c'est l'unité et ce qui s'en rapproche le plus. Or le simple est plus un que le composé, ce qui est symétrique plus un que ce qui manque de symétrie, ce qui est proportionné plus un que ce qui ne l'est pas. En effet, la communauté de mesure ou l'identité de rapport est précisément ce qui fait l'unité des choses symétriques ou proportionnées. Mais ce qui n'a ni mesure ni proportion, soit entre ses propres parties, soit avec les choses auxquelles il se rapporte et dont il fait soi-même partie, manque d'unité et par conséquent ne saurait durer toujours. Ainsi, c'est surtout dans la mesure définie que se trouvent au plus haut degré la plénitude d'existence, le beau et le bien tout à la fois, et non pas dans l'indéfini toujours croissant. C'en est assez sur ce sujet.
Chapitre XIV. — De la prohibition du commerce entre les parents et leurs enfants.
Il faut d'abord arrêter notre attention sur la prohibition du commerce entre les parents et leurs enfants, non pour discuter la convenance de cette loi ; son universalité et sa perpétuité suffisent à démontrer que ce sont bien les Dieux qui l'ont imposée aux hommes, et puisqu'elle vient des Dieux, elle est excellente. Sans doute, quand les législations humaines sont en contradiction, il nous appartient de chercher quelle est la meilleure d'entre elles; mais lorsqu'elles s'accordent toutes, il n'est pas permis de mettre en doute la justice de leur décision ; il faut dans cette unanimité, quel qu'en soit l'objet, reconnaître la marque d'une révélation divine. Mais la recherche des motifs est une étude digne de celui qui veut posséder à fond la connaissance des lois : car il en est plusieurs dont la raison échappe au vulgaire. Ainsi les hommes ont toujours été unanimes pour interdire le commerce entre les parents et leurs enfants, mais bien peu sauraient dire pourquoi cette défense est juste : cette recherche ne sera donc pas sans intérêt.
D'abord on conviendra que le commerce des sens a été institué par les Dieux pour perpétuer la race des mortels et pour lui donner, à elle aussi, une sorte d'immortalité ; en second lieu, que de la part de l'homme qui l'accomplit, cet acte est la cause efficiente qui produit un être semblable à lui ; enfin que ces deux choses, l'immortalité et la procréation d'un être semblable à soi, conviennent essentiellement aux Dieux ; car tous les Dieux sont immortels, et ceux qui sont plus puissants que les autres produisent des êtres semblables à eux-mêmes, soit immortels comme eux, soit mortels comme ceux d'ici bas. Dès lors, pour que cet acte soit bien accompli, il faut qu'il se rapproche autant que possible du mode de génération qui appartient aux Dieux : c'est un raisonnement que la plus faible intelligence doit comprendre et accepter. Il n'est pas moins évident que, plus une action est importante, plus nous devons chercher à la bien faire ; et l'on ne peut nier l'importance de cet acte qui dans notre nature mortelle est l'imitation de l'immortalité des Dieux et de leur manière de procréer. Car ce serait une erreur de croire que si nous n'accomplissons pas cet acte en public, c'est qu'il a quelque chose de honteux. En effet, beaucoup d'hommes ne veulent pas faire en public les actes religieux qu'ils regardent comme les plus saints ; pour célébrer leurs plus grands mystères, ils se cachent de la foule, dans la crainte que quelque spectateur, faute d'être suffisamment préparé à y assister, n'en fasse un objet de risée. Pour l'acte procréateur, si les hommes ne l'accomplissent pas en public, c'est de peur de porter le trouble chez ceux qui en seraient témoins, parce qu'en effet la faiblesse humaine les rend faciles à s'enflammer, sinon jusqu'au désir, du moins jusqu'à l'imagination d'un pareil acte, et cela pour le moindre sujet. Comment donc serait-il bien à l'homme qui doit partager son lit avec une seule femme, de l'exposer nue à tous les regards pendant ses rapports avec elle ? Les spectateurs, hommes ou femmes, n'ayant aucune part à cet acte, seraient agités sinon par le désir, du moins par l'imagination d'une jouissance pour eux illicite; les hommes voudraient avoir part aux faveurs de la même femme, les femmes voudraient se livrer avec le même homme aux mêmes plaisirs, bien que les uns ni les autres ne pussent se porter sans crime à cette action. Or, l'imagination seule des actions illégitimes est coupable, et ce serait chose encore plus coupable d'éveiller chez les autres de pareils désirs. Telles sont les raisons qui font dérober aux yeux le commerce des sens. Du reste, une preuve que ce n'est pas parce qu'ils le croient honteux que les hommes l'enveloppent de mystère, c'est la publicité qu'ils donnent au mariage : ils y appellent, comme à un acte grave et solennel, le plus de personnes qu'ils peuvent, et les font témoins de l'union nuptiale, quand tous savent quel est le but de cette union! Ainsi l'acte dont nous parlons étant un des plus importants qu'il soit donné à l'homme de faire, mérite que son accomplissement soit le plus parfait possible. En effet, il n'est rien de plus honteux qu'un acte important mal accompli. Car autre chose est jouer mal un simple jeu, autre chose ne pas apporter à un acte important les soins qu'il réclame. Puis donc qu'il faut que celui-ci soit le plus parfait possible, il conviendra, comme nous l'avons dit, qu'il soit une image de la génération des Dieux·
Chapitre XV. — De la génération des Dieux, d'après le principe de la prohibition du commerce entre les parents et leurs enfants.
Commençons par étudier la génération des Dieux et la manière dont ils procréent : nous comprendrons alors comment, si les parents avaient commerce avec leurs enfants, ils accompliraient des actes contraires aux lois de la procréation divine. Jupiter, le roi suprême, l'antique père des Dieux, a produit sans mère les Dieux auxquels il a donné naissance ; en effet il n'v avait aucun être qui put concourir à titre de mère à la production de ce qu'il créait. De plus, en l'absence d'une participation de cette espèce, la matière n'entre absolument pour rien dans la création et la vie des êtres qui procèdent immédiatement de Jupiter. Car, dans toute génération, le principe femelle est celui qui contribue à l'existence matérielle, en sorte que les êtres à la production desquels aucun principe femelle ne concourt ne peuvent ni recevoir du dehors, ni avoir en eux-mêmes rien de matériel. Si Jupiter fait usage de ses créations pour la génération de créatures nouvelles, il emploie chacune à titre de modèle et non de mère. Ainsi il a engendré sans intermédiaire, à sa propre ressemblance, le plus puissant des Dieux, que nous appelons Neptune. Tous les autres il les a produits les uns par l’intermédiaire des autres en créant chacun d'eux à l'image des autres Dieux créés par lui ; à peu près, si l'on peut assimiler cette grande œuvre à une chose bien petite, comme les images sont reproduites et multipliées à l'aide de plusieurs miroirs. En effet, le corps qui est réfléchi, en produisant une imago immédiate de lui-même, crée en même temps toutes les autres images, qui sont une reproduction les unes des autres. Et si l'on dit qu'au moins faut-il plusieurs miroirs différents pour cette production d'images, prenons pour autre exemple l'unité, qui d'elle-même engendre tous les nombres en se les ajoutant successivement, sans avoir besoin d'aucun autre élément. Cependant cette production des nombres diffère encore de celle des Dieux supra célestes engendrés par Jupiter, à plusieurs égards, et notamment en ce que la première se perpétue virtuellement à l'infini, tandis que la seconde est virtuellement et effectivement limitée à un certain nombre d'êtres. En effet, l'unité s'adjoint le nombre à mesure qu'il se produit pour en former un autre ; c'est ainsi qu'elle-même perpétue à l'infini la production des nombres, puisqu'elle peut toujours s'adjoindre le dernier, formé : mais Jupiter, au lieu de s'adjoindre les êtres déjà créés, les divise; il fait sortir de chacun d'eux les éléments qui y étaient implicitement renfermés, enlève l'un et laisse l'autre, c'est ainsi qu'il opère la création de nouveaux êtres. Or, comme ces divisions procèdent par la voie des contraires sans qu'il y ait jamais de milieu, elles ne peuvent se renouveler à l'infini, et doivent cesser enfin. Ainsi Jupiter produit un nombre borné de créatures, et de tous ces êtres différents il compose un seul et même système. Maintenant, que ce soit bien là la manière dont il engendre toute la classe des Dieux supra célestes, et non en se servant de l'un pour créer l'autre, c'est ce qu'il faut prouver, puisque nous en sommes venus à parler de la génération de ces Dieux par Jupiter. L'ensemble des substances créées est triple de sa nature, et n'est point primitivement divisible en plus de trois parties : la première est éternelle, partout et toujours immuable ; elle n'admet ni passé ni avenir, mais elle est de toute éternité. La seconde existe dans le temps et est essentiellement soumise au changement ; cependant elle est immortelle, elle n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin. La troisième est à la fois temporelle et mortelle, elle a dans le temps un commencement et une fin. Comme il y a trois espèces de substances, il doit y avoir trois modes de générations, et si les substances diffèrent essentiellement entre elles, cette différence essentielle devra se trouver aussi entre les modes de génération ; car les générations doivent être en rapport avec les essences, et les essences avec les générations. Par conséquent, si quelqu'un des êtres appartenant à la substance éternelle vient de Jupiter qui domine l'éternité et qui seul de tous les êtres existe par lui-même, tous les êtres de la même substance devront procéder également de· Jupiter seul. Car s'ils procédaient en partie du principe prééternel, en partie d'un autre principe non prééternel, cette classe d'êtres ne serait pas tout entière éternelle Mais Jupiter, supérieur à l'éternité, a créé lui-même toute la substance éternelle; il a confié à cette substance éternelle la production de la substance temporelle et immortelle, et à celle-ci la production de celle qui est à la fois temporelle et mortelle ; en sorte que chaque substance est produite par la génération qui lui convient, et chacune sort de la source d'où elle doit sortir, à savoir, de la substance qui lui est immédiatement supérieure. Que si les êtres appartenant à la substance éternelle étaient tous égaux entre eux, et qu'aucun ne fût supérieur ni inférieur à un autre, Jupiter serait par lui-même l'auteur unique de toute cette substance. Mais rien de semblable n'a dû arriver et n'est arrivé en effet : car il fallait d'abord que cette substance contint toutes les espèces les plus diverses pour posséder la perfection de la Variété ; ensuite que ces espèces fussent chacune simple et une en soi, et toutes réunies dans un tout qui fut un par son ensemble, pour que, dans chacune de ses parties et, dans l'ensemble, cette substance fût aussi semblable que possible à son créateur, qui existe par lui-même. Les choses étant nécessairement ainsi, Jupiter commence par engendrer de lui-même un seul être à son image; il en fait la plus noble et la plus belle de toutes les choses créées ; puis il en fait une autre à l'image de celle-là, et enfin toutes les autres créatures à l'image les unes des autres, leur perfection allant toujours en décroissant, comme il convient à des images. Il en est à peu près comme d'un homme qui engendrerait l'un de ses enfants aussi semblable que possible à lui-même, et les autres semblables à celui-là et semblables entre eux. Mais quand cela a lieu pour l'homme, c'est toujours en raison de la force ou de la faiblesse de la semence projetée. En effet, si cette semence est projetée dans toute sa force, grâce à une maturité suffisante, elle produit un mâle tout à fait semblable à son père ; quand elle est moins puissante, son produit est femelle et semblable au père, ou mâle et semblable à la mère, ou semblable à la mère et en même temps femelle, ou sans ressemblance ni avec le père ni avec la mère, mais avec quelque autre membre de la même famille, selon son plus ou moins de maturité ; ou bien ce rejeton ne ressemble pas même à un parent, mais simplement à un homme, ou enfin il n'est pas même tout à fait semblable à l'homme, mais il penche quelquefois vers une autre nature, quand il n'avorte pas par le manque absolu de maturité. Car la génération n'est pas soumise à la volonté de l'homme ; sans doute l'acte procréateur dépend de sa volonté, mais la génération dépend de la nature qui met son corps dans telle ou telle disposition. Mais pour la nature parfaitement simple de Jupiter, engendrer n'est pas une chose, créer une autre; il n'y a pas certaines créatures qu'il engendre et certaines autres qu'il crée ; engendrer et créer sont pour lui une même chose : il engendre par l'intelligence qu'il a de ce qu'il convient de produire, et il crée par sa nature qui est de produire. Ainsi l'homme ne peut pas engendrer des enfants tels qu'il les voudrait, mais il peut construire son habitation et en créer les accessoires comme il lui plaît et quand il veut. Jupiter, au contraire, dont l'essence éternelle est l'identité du vouloir et du pouvoir, produit tous les êtres qu'il juge propres à concourir à la perfection de son œuvre; tout à la fois il les crée et les engendre. Il fait chaque être un dans sa nature, car il ne fait rien de superflu, et à l'ensemble qui résulte de ses créations il donne toute l'unité possible. Or il n'y avait ici d'autre unité possible que celle de la communauté, et aucune communauté ne sied mieux à ces choses que d'être l'image les unes des autres ; car ainsi chaque chose a son existence propre et séparée, et il existe en même temps une certaine communauté entre l'image et le modèle. non seulement les espèces sont les images des genres, mais elles le sont encore de toutes les espèces qui sortent d'un même genre par division successive et qui se partagent toujours en plus parfaites et moins parfaites, les moins parfaites étant l'image des plus parfaites, l'essence temporelle de l'essence éternelle, la nature mortelle de la nature immortelle, l'irrationnel du rationnel, et ainsi de suite. Dans cette communication d'essence, les êtres inférieurs tiennent, comme de juste, de ceux qui leur sont supérieurs tout ce qu'ils ont d'attributs, d'où résulte entre les êtres un nouveau lien d'affinité, attendu qu'outre leur état de subordination, ils sont intimement liés à ceux qui les précèdent, comme doit naturellement l'être celui qui reçoit à celui qui donne. En effet, les natures inférieures doivent tout à la fois être subordonnées et ne pas rester étrangères à celles dont elles reçoivent quelque chose. Jupiter procure donc par lui-même l'existence à chacune de ces substances éternelles,· et celles qu'il a produites ne sont employées par lui pour la création des autres qu'en qualité de modèles, afin de maintenir l'union mutuelle de ces êtres, les images se retrouvant dans les modèles et les modèles dans les images par la ressemblance, et en même temps leur distinction, chacun de ces êtres se trouvant ainsi, comme il le faut, dans le rapport de l'effet à la cause, et tous ayant pour cause commune Jupiter, lequel en effet produit par lui-même et de lui-même un seul être, puis sur le modèle de celui-ci en produit un autre, et d'après ce dernier un autre encore, et ainsi de suite, jusqu'à l'achèvement du système entier et complet. Leur ayant ainsi procuré l'existence, puisque c'est à lui qu'appartient la création des essences supérieures qui forment toute la substance éternelle, il leur laisse le soin de se dispenser les uns aux autres leurs attributs, dont les êtres supérieurs doivent orner ceux qui sont au-dessous d'eux. Le but et la fin de cette communauté entre les Dieux, c'est de former par leur réunion un seul système, un seul monde aussi parfait que possible. C'est ainsi que nos âmes sont évidemment ornées de leurs attributs par les âmes divines qui leur sont supérieures, non qu'elles soient produites par elles, mais elles sortent de la même source, étant comme elles d'une essence immortelle. Or, s'il en est ainsi de nos âmes, il doit en être de même des Dieux du monde supérieur ; ils reçoivent leur existence et leurs attributs de la manière que nous avons dite, afin qu'il y ait analogie et rapport des choses d'ici-bas à celles de là-haut, et des choses de là-haut à celles d'ici-bas. Cependant la génération des Dieux supra célestes par Jupiter se faisant sans mère, ne peut être exactement rapprochée de la génération des hommes : celle-ci a plus de rapport avec la génération des autres êtres immortels et mortels par ces mêmes Dieux et par leurs enfants. En effet, le premier des enfants de Jupiter, Neptune, quoiqu'il soit réellement une forme, une espèce, n'est pas telle forme, telle espèce en particulier, mais il comprend en lui seul toutes les formes constitutives des espèces, et il est après Jupiter la cause première de la forme de cet Univers ; aussi est-il le principe mâle par excellence, car c'est le principe mâle qui donne aux êtres leur caractère spécifique. Son image créée comme lui-même par Jupiter et la première après lui, c'est Junon qui renferme aussi toutes les espèces, mais qui cependant ne possède pas une puissance égale à celle de Neptune. Car Neptune possède en lui-même toutes les formes, et est effectivement et en acte, pour toutes les choses de ce monde et pour ce monde entier, la cause de leur forme : Junon les possède aussi toutes, mais elle ne devient effectivement pour aucune chose la cause de sa forme; seulement elle produit la matière primitive qui renferme toutes les formes en puissance, sinon en acte; car, en acte, loin de les contenir toutes, elle n'en possède pas une seule. Ainsi, cette divinité est un principe femelle et le premier principe de ce genre. Telle est, en effet, la nature du principe femelle : il fournit à tous les êtres la matière et la nourriture. Entre ces deux divinités il existe à peu près la même corrélation qu'entre le sperme et le sang menstruel, qui tous deux renferment, non pas en fait, mais en puissance, un être à venir ; mais le premier a plus de rapport avec la force productrice, il donne plutôt la forme, tandis que le second, moins doué de la force productrice, est plutôt la matière propre à former l'être nouveau. Ainsi ces deux divinités possèdent effectivement en commun toutes les espèces : Neptune est la cause productrice de la forme ; Junon, de la matière. En sorte que notre comparaison, tout imparfaite et tout indigne qu'elle est de la pureté divine, rend assez bien compte du rapport mutuel et de l'action respective de ces deux divinités. Par leur union, elles produisent les créatures immortelles de notre monde, dont les plus puissantes, le Soleil et la Lune sont unies ensemble par les mêmes rapports, et de la même manière qu'elles-mêmes ont été produites, produisent à leur tour les êtres mortels. En effet, le Soleil fournit à ces êtres la forme qu'il emprunte à des êtres supérieurs, c'est-à-dire, aux Dieux du Tartare ; la Lune leur fournit la matière placée spécialement sous son influence. Le Soleil est le premier des Dieux mâles qui habitent l'enceinte du ciel ; la Lune, la première des divinités femelles. Les Dieux éternels leur ont associé, pour la création des êtres mortels, Saturne et Vénus, qui, parmi les dieux du Tartare, sont dans les mêmes rapports que Neptune et Junon parmi les Dieux de l'Olympe, et qui créent de la même manière les êtres mortels : Saturne donne également à chaque chose la forme, Vénus la matière. Sans doute, ce n'est pas la matière à la fois primitive et impérissable, mais une matière extraite des corps primitifs et des autres éléments, capable comme eux de revêtir les formes qui se trouvaient dans ces corps dont elle est extraite, mais ne les revêtant que passées déjà à l'état périssable, et devenant ainsi la matière la plus propre à former les corps mortels. Mais la génération des êtres mortels n'est pas dévolue seulement au Soleil et aux Dieux de cet ordre ; parmi les Dieux immortels, il en est plusieurs, les Titans et les Dieux du Tartare soumis à Saturne, qui prennent part à cette génération ; il sera facile de s'en convaincre par le raisonnement. Car on pourrait penser que le Soleil, ayant dans son intelligence les formes des êtres mortels encore purement intelligibles et n'existant de fait nulle part, enfante chacun de ces êtres de la même manière que les artistes produisent l'œuvre qu'ils ont conçue. Mais nous voyons que les ouvrages des artistes ne sont pas achevés de la même manière que les créations naturelles du Soleil. En effet, toutes les compositions des artistes, tant qu'elles sont dans la main de leur auteur, tant qu'il y travaille, s'avancent vers la perfection ; mais si jamais elles sont abandonnées avant la fin, elles ne font plus aucun progrès : enfin elles ne se perfectionnent jamais qu'en proportion du travail que les artistes y donnent. Au contraire, les créations de la nature ne sont pas soumises nécessairement à la présence et à l'absence du Soleil en ce qui concerne leur développement et leur vie. Autrement, tout serait éphémère ou annuel, et de plus, pendant la nuit, rien n'avancerait vers la perfection, tandis que nous voyons évidemment que les plantes et les fruits se développent même pendant la nuit. Or, ce ne peut être le Soleil qui les mène à leur perfection aussi bien absent que présent ; car il n'est pas permis d'attribuer cet effet à l'action de son intelligence séparée de son corps En effet, ces intelligences qui ont une existence en participation ne peuvent agir sans leur corps sur les autres corps ; et quant aux corps, ils ont besoin pour agir sur les autres d'être dans telle ou telle position par rapport à ceux sur lesquels ils doivent agir. On ne dira pas que ces choses se perfectionnent par elles-mêmes : car aucune puissance ne vient à l'acte sans y être poussée par l'action d'une force antérieure ; ainsi ce qui est parfait en puissance ne le deviendrait jamais en fait s'il n'était poussé à la perfection par une autre essence qui déjà possède en fait cette perfection. Ce n'est pas la chaleur reçue du Soleil ou une autre modification quelconque cachée sous l'enveloppe de chacune des choses mortelles qui pourrait les mener à leur perfection en l'absence du Soleil : car ce qui achève doit toujours être antérieur à ce qui lui doit son achèvement, et aucune modification d'une espèce ou d'une substance quelconque ne peut être antérieure à l'objet modifié. Il reste donc à admettre la nécessité de certaines essences qui subsistent par elles-mêmes dans le domaine supra céleste. Elles sont incapables de rien produire entre elles seules de ce qu'elles produisent ici-bas. Ainsi, par exemple, les plus élevées d'entre elles ont bien pu produire le Soleil et la Lune et les autres êtres immortels existants dans l'enceinte du ciel : mais pour former ici-bas les êtres dont la production les concerne, ces divinités ont besoin du concours du Soleil et des autres Dieux de sa classe. Cependant, une fois la création achevée, quand l'objet a déjà pris quelque consistance, alors elles peuvent par elles-mêmes l'achever et le conserver pour quelque temps, les plus parfaites usant sans doute de cette faculté plus pleinement et plus longtemps que celles qui sont douées d'une moindre perfection. C'est ce qui fait que la perfection et la vie des ouvrages de la nature ne sont pas en proportion du voisinage ou de l'éloignement du Soleil. Il leur arrive quelque chose d'analogue à ce qu'éprouvent les corps lancés dans l'espace : car les corps lancés ne le seraient pas si quelqu'un ne les lançait; cependant, une fois lancés, ils continuent de se mouvoir, parce que l'air s'en empare et les porte pendant quelque temps par l'effet même de la résistance, sans que celui qui les a lancés continue d'y toucher ni de les mouvoir. Ainsi donc, les œuvres de l'homme sont conservées autant que la nature les conserve, parce qu'elles sont toutes formées d'éléments naturels; mais elles ne peuvent être achevées qu'à proportion du travail que les artistes consacrent à chacune d'elles. A moins que quelqu'une de leurs parties ayant besoin d'une certaine maturité, ne soit abandonnée aux soins de la nature. Mais, en général, elles n'avancent vers la perfection que dans la mesure que nous avons dite ; car rien ne peut les reprendre en sous-œuvre et les achever. En effet, dès que la main de l'artiste leur fait défaut, la forme qui était dans la pensée de l'artiste et qui lui fournissait son modèle s'éloigne en même temps que lui. En effet, il n'y a point de forme ici-bas qui existe par elle-même. Elles n'existent toutes qu'en Pluton, qui préside à toute forme humaine et renferme en lui seul les choses humaines dans leur tout et dans chacune de leurs parties, tandis que les artistes les renferment dans leur esprit seulement une à une et séparées les unes des autres. Il en est de même à peu près du nombre mathématique et des grandeurs mathématiques, qui existent les unes et les autres en Junon, laquelle en effet préside à leur infini, puisqu'elle préside à la matière en général, et qui sont ensuite reçues par l'âme humaine sous une forme étendue, ombres et fantômes en quelque sorte des idées divines, mais néanmoins propres à conduire l'homme à une connaissance exacte de ces idées. Telle est donc la manière dont les œuvres des hommes arrivent à leur perfection. Quant aux substances naturelles, étant formées d'après des modèles qui existent par eux-mêmes, il est clair que leur perfection ne doit pas dépendre également de la présence et de la disparition du Soleil, car elles ont pour soutiens ces modèles, les uns plus parfaits, les autres moins, les premiers pouvant mieux perfectionner leurs ouvrages, les seconds moins doués de cette faculté. Rien de plus rationnel, en effet, que cette convenance entre les différentes classes d'essences et les causes de chacune d'elles : la première, éternelle, a pour cause Jupiter seul; celle qui la suit, existant déjà dans le temps, mais immortelle, a pour cause créatrice les seuls enfants de Jupiter, qui sont plusieurs, tous frères entre eux, puisqu'ils procèdent de Jupiter lui-même ; mais nous attribuons spécialement cette création à Neptune leur chef, comme à l'architecte la construction d'un édifice, et au général le gain d'une bataille. La troisième et dernière essence, qui est à la fois temporelle et mortelle, ne doit pas sa naissance à des Dieux qui soient tous frères entre eux ; mais ceux qui la produisent sont nés les uns de Jupiter lui-même, les autres de Neptune ; et en général nous en attribuons la génération à Saturne et au Soleil, chefs des Dieux qui produisent cette sorte d'essence. Mais c'en est assez sur la génération des Dieux ; revenons maintenant à notre premier sujet.
Nous avons démontré que les Dieux se divisent en mâles et femelles ; que les mâles fournissent la forme aux êtres qui proviennent d'eux, que les femelles donnent la matière ; il est donc évident maintenant que tous les Dieux doivent appartenir par leurs attributs les uns à la nature mâle, les autres à la nature femelle. Car ceux des Dieux qui sont doués de la faculté créatrice, doivent nécessairement être pour leurs créatures la cause ou de la forme qui les spécifie ou de la matière et de ses propriétés. Ceux qui ne sont pas doués de cette faculté créatrice, tels que la plupart de ceux qui habitent l'enceinte de notre ciel, doivent nécessairement avoir quelque occupation et ne peuvent rester entièrement désœuvrés : car ce n'est pas une vie que le repos absolu. Or chacun d'eux devant avoir une tâche à remplir, cette tâche devra tenir en quelque chose au principe mâle ou au principe femelle. Car nécessairement ils doivent jouer un rôle actif ou passif; et de ces deux rôles, celui-là convient évidemment au principe mâle, celui-ci au principe femelle. La forme, qui est la cause et l'élément nécessaire du principe mâle, représente l'action ; la matière, qui est l'élément du principe femelle, représente essentiellement la passivité. Ce ne sont donc pas seulement les Dieux qui se rapportent les uns à la nature mâle, les autres à la nature femelle ; mais encore, parmi tous les êtres, ceux en qui dominent la forme et l'action se rattachent surtout à la nature mâle, ceux en qui dominent la matière et la passivité se rapportent au principe femelle ; par suite, il serait très difficile de trouver un être parfaitement neutre entre ces deux natures. Tous les êtres, quels qu'ils soient, étant ainsi destinés à un commerce mutuel d'une nature diverse selon ceux qu'il rapproche, ce commerce, pour quelques-uns, présente seulement une image des rapports entre les deux sexes ; mais pour les êtres matériels, lorsqu'ils travaillent à la production d'autres êtres, ces rapports sont tout à fait sexuels dans le sens propre du mot. Or, dans ce commerce, jamais un Dieu ne s'unit à ceux qui sont issus de lui. En effet, Jupiter n'a pas avec Junon, pas plus qu'avec une autre divinité quelconque, les rapports du mâle avec la femelle ; il ne s'en sert que comme d'un modèle pour la production des êtres divins qui ont besoin que cette Déesse contribue en tant que modèle à leur génération. On peut en dire autant de Neptune avec la Lune, du Soleil avec Junon...
Chapitre XXXI. — Des jugements.
.... Ils agissent (les animaux sans raison), non d'après leur propre intelligence, mais sous la direction de l'âme qui gouverne notre ciel, je veux dire de l'âme du Soleil, et aussi sous la direction de Saturne et des autres esprits qui ont leur existence séparée de la matière, et qui président aux différentes parties de l'Univers. Ceux-ci, empruntant leurs sujets au Soleil, qui est pour les animaux le principe de la génération et de la vie, les gouvernent suivant la puissance qui leur a été donnée, puissance qui pour eux est une, mais qui se partage entre les différents êtres soumis à leur action. Ainsi guidés par ces esprits plus divins, les animaux ne sauraient jamais rien faire qui ne fût à faire : car ce ne serait pas d'après leur propre intelligence, ils n'en ont pas ; ce ne serait pas non plus par l'influence extérieure de ces esprits divins, il n'est pas permis de le supposer. C'est encore pour cela qu'ils accomplissent leurs actes, et en particulier celui-là (l'acte procréateur), bien mieux que les hommes. Car les hommes, placés sous l'influence de leur propre intelligence et d'un jugement faillible, se trompent souvent, aussi bien dans cet acte que dans tout le reste, faisant de leurs facultés un usage tantôt conforme à la nature, mais superflu, tantôt même, ce qui est bien plus honteux, contraire à la nature. Or les animaux ne sauraient commettre aucune faute semblable. Que si quelqu'un d'eux s'unit à des espèces différentes, mais voisines de la sienne, on doit croire que cela tient aux rapports physiques des espèces entre elles. Au reste si l'ardeur des sens était moins forte chez les hommes, on n'aurait pas besoin d'une législation aussi sévère. Mais les Dieux savaient que les hommes se gouvernent par une imagination sujette à l'erreur, et qu'ils devraient, par suite, quelques-uns du moins, se tromper aussi dans l'usage de leurs facultés sensuelles, tandis que d'autres s'en interdiraient complètement l'exercice, soit comme illégitime, soit comme moins parfait que l'abstention de ces jouissances; que d'autres en seraient détournés par la misanthropie de leur caractère qui leur ferait fuir l'embarras de nourrir une femme et des enfants ; que d'autres enfin seraient retenus par la crainte de perdre leurs enfants, malheur à leurs yeux plus redoutable que de n'en point avoir du tout, au lieu de s'en remettre à cet égard à la volonté des Dieux, et de n'en accomplir pas moins le devoir qui nous est imposé de concourir à la propagation de l'espèce et à la conservation du grand tout. Les Dieux donc, sachant tout cela, et que la faiblesse du jugement de l'homme l'entraînerait dans toutes ces erreurs, comme nous en avons des exemples autour de nous, n'ont pas voulu qu'un trop grand nombre d'hommes s'abstenant des plaisirs des sens missent en défaut la prévoyance avec laquelle Jupiter maintient par l'intermédiaire de l'espèce humaine un lien entre les êtres mortels et les êtres immortels ; c'est pourquoi ils ont inspiré aux hommes une telle passion pour ces jouissances, qu'elle l'emporte sur toutes les autres, et qu'il est bien difficile d'en triompher, à moins qu'elle ne soit combattue par la force d'une opinion plus puissante encore. Mais cette opinion qu'il faut s'abstenir complètement des plaisirs sensuels, ils savaient qu'elle trouverait, au fond, peu de partisans, et que si elle tombait dans quelques esprits, la plupart du temps elle n'y serait pas assez forte pour ne pas céder facilement aux persécutions incessantes du plus puissant de tous les désirs. Mais bien plus qu'une abstinence complète [ils ont craint l'usage dépravé de ces plaisirs] parce que l'homme, entre les autres devoirs de sa nature, doit vivre comme un citoyen, comme un être sociable, et non comme un solitaire. C'est pour cela que nous punissons de mort la plupart de ceux qui se dégradent par de telles actions; nous voulons en même temps les délivrer de cet état misérable et sauver à leur patrie une pareille honte. Ceux qui commettraient des actes contre nature, par exemple, ceux qui seraient convaincus du crime de pédérastie ou de bestialité, ou de quelqu'une de ces infamies qui ne se rencontrent que chez les hommes les plus corrompus, ceux-là doivent être punis par le feu, et il faut brûler en même temps le criminel et sa victime, ou s'il a exercé sa brutalité sur quelque animal, brûler l'animal avec lui. Il faut également brûler et les hommes coupables d'adultère, et ceux, hommes ou femmes, qui les auront poussés ou aidés à ce crime. Quant aux femmes adultères, elles auront les cheveux rasés et seront livrées à l'inspectrice des femmes publiques pour être abandonnées à la prostitution, afin que si elles n'ont pu conserver leur fidélité à celui à qui elles la devaient, elles servent du moins à maintenir les autres femmes dans la fidélité conjugale, en offrant aux passions des hommes trop enclins à la luxure un remède tolérable aux yeux de la loi. On condamnera au même supplice du feu celui qui violerait une femme quelconque, à moins que ce ne fût une femme publique, fût-elle même convaincue de libertinage, si elle ne fait pas publiquement métier de son corps, et fût-ce même une femme publique, si on lui fait violence aux époques où la nature interdit l'approche de ce sexe. Tous ceux qui se seront souillés de ces crimes, les plus infâmes de tous, seront brûlés dans les enceintes désignées pour contenir leurs restes, et non dans les cimetières communs. Car il y aura dans chaque lieu trois cimetières séparés par des clôtures très apparentes, un pour les prêtres, un autre pour le commun des citoyens, un troisième pour ces grands criminels, et c'est aussi dans ce dernier qu'on brûlera vif le sophiste qui oserait attaquer nos croyances. Ce même supplice est réservé au coupable d'inceste avec une mère, une sœur, ou toute parente en ligne directe ascendante ou descendante. Si un homme est convaincu d'avoir eu commerce avec quelque autre parente à un degré prohibé, il sera puni de la flétrissure, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment purifié, et en outre l'accès des choses sacrées lui sera interdit. On brûlera encore dans le cimetière des impurs et des infâmes celui qui sera jugé par les magistrats coupable d'un meurtre sujet à expiation. Si quelqu'un est convaincu de commerce avec une jeune fille vierge, ou qui, sans être vierge ou sans être fiancée à personne, serait encore en tutelle, le coupable, quand même cette jeune fille se serait donnée volontairement à lui, sera puni de mort, mais brûlé et enseveli dans le cimetière commun, qui sera également accordé comme lieu de sépulture aux coupables d'un meurtre non sujet à expiation. Au reste, le viol et l'adultère ne seront pas punis seulement quand ils auront été accomplis, mais la tentative même-en sera punie également quand elle aurait échoué; car pour ces crimes la tentative est regardée comme aussi criminelle que l'action. Quant à l'homme qui se sentirait violemment épris d'une per sonne fiancée ou mariée à un autre, nous voulons qu'il aille aussitôt trouver l'interprète des choses sain tes, lui révéler la maladie de son âme et lui demander un moyen de s'en purifier ou un préservatif contre le mal plus grand où il tomberait si la passion venait à triompher de son âme. Alors, s'approchant des lieux saints ……………………….. et dès lors le punir de mort. Mais quand le crime n'est pas évident, l'accusé est jugé à la pluralité des voix ; et en ce cas, il sera juste de l'absoudre non seulement s'il n'a contre lui que la minorité des voix, mais encore si elles sont également partagées. Ajoutons à ce chapitre sur les jugements un dernier article. Si un homme convaincu par le tribunal d'un de ces crimes qui sont punis de mort, prouve qu'il a fait antérieurement quelques bonnes actions dont l'importance ou le nombre semble dépasser la grandeur de sa faute, on devra le considérer comme n'étant ni incorrigible ni naturellement pervers, mais comme ayant été victime de quelque circonstance malheureuse en dehors de sa nature, par exemple, de l'insuffisance de son éducation, et alors, au lieu de le punir de mort, il faudra le corriger par une prison temporaire. Mais c'est assez parler de ce sujet : car si nous avons laissé quelque lacune, les lumières répandues dans le cours de cet ouvrage suffiront, avec l'aide des Dieux, pour mettre nos magistrats en état d'éclaircir parfaitement eux-mêmes les points que nous aurions pu laisser dans l'obscurité.
Chapitre XXXII. — Sur les noms des Dieux.
Il nous reste encore à traiter de ce qui concerne le culte des Dieux ; et certes il n'est pas sans importance que les cérémonies en soient bien ou mal réglées : car si elles sont en harmonie avec les croyances religieuses, elles peuvent les affermir; sinon, les ébranler. Or, pour peu qu'on ait de sens, on reconnaîtra aisément que toute la conduite de notre vie et toutes nos actions, en tant que bonnes ou mauvaises, dépendent de nos croyances religieuses. C'est donc un sujet que nous devons traiter à fond. Mais il faut d'abord parler des noms des Dieux, et prouver que nous avons eu raison de conserver leurs noms antiques aux Dieux dont la philosophie nous a fait reconnaître l'existence. On ne pouvait pas désigner chaque Dieu par une périphrase au lieu d'un nom, ce qui serait embarrassant pour le commun des hommes, ni leur donner des noms de notre invention, ni leur en appliquer de barbares, quand il était si aisé d'employer ceux qui furent en usage chez nos ancêtres. Cependant, dira-t-on, ces noms ont été souillés par les poètes qui ont dénaturé les révélations de la philosophie au sujet des Dieux pour en faire des fables mensongères, et à ce titre ils devaient être rejetés. Mais on ne peut pas dire, en parlant des noms, qu'une fois souillés ils le demeurent à jamais ; leur nature est d'être souillés quand ils sont employés dans un sens mauvais et criminel, mais dès qu'ils sont pris dans un sens pur et sain, ils perdent aussitôt toute trace de souillure dans la bouche de la personne qui les emploie. En effet, il serait difficile de trouver un nom si saint et si pur, qu'il n'ait jamais été souillé par personne. Car on pourrait dire que le nom même de Dieu l’a été, lorsque des hommes chargés des plus grands crimes ont...
Chapitre XXXIV. — Allocutions aux dieux. Allocution du matin.
Jupiter roi, être, unité, bonté absolue, tu es grand d'une grandeur réelle et suprême. Tu n'as été produit par rien, tu ne procèdes d'aucune cause, nul être n'est et n'a été avant toi. Car tu es par toi-même éternel et prééternel ; seul de toutes choses, tu es essentiellement incréé, tandis que tu es la cause première et productrice de tout ce qui participe à l'être. Par toi et de toi tout vient, tout naît, tout s'établit et se maintient dans le meilleur ordre possible ; soit les essences éternelles et supra célestes ; soit celles qui habitent l'enceinte de notre ciel et qui existent dans le temps, les unes immortelles, les autres mortelles, et celles-ci placées au dernier degré des êtres. Aux premières tu communiques par toi-même immédiatement l'existence avec tous les biens ; aux autres, tu la donnes par l'intermédiaire de tel ou tel des êtres nés directement de toi, et tu veilles à ce qu'elles soient les plus parfaites possibles, non seulement en elles-mêmes, mais plus encore par rapport à l'ordre de l'univers, qui est ton but suprême.
Après Jupiter, tu es grand aussi, Neptune roi, le plus grand et le premier né du plus grand et du premier des pères, toi qu'une mère n'a pas enfanté, mais qui es la plus puissante et la plus parfaite possible des œuvres de. Jupiter. Tu es le chef des êtres après ton père, souverain du ciel avec lui, second père et second créateur de notre monde. Après lui et avec lui, sois honorée, Junon reine, première fille de Jupiter, épouse de Neptune, mère des Dieux que renferme notre ciel, cause permanente de la multiplication des êtres inférieurs. Et vous, autres Dieux de l'Olympe, enfants légitimes du grand Jupiter, nés sans mère, vous qui contribuez à produire tous les êtres immortels renfermés dans l'enceinte du ciel, en commun avec Neptune votre chef et le premier de vos frères. Ta place est avec eux, Pluton roi, Dieu tutélaire de notre principe immortel. Et toi aussi, tu es bienheureux, ô Saturne roi : entre les fils illégitimes de Jupiter, nés sans mère, comme tous ceux qui procèdent directement de Jupiter, tu es le premier et le plus auguste, et c'est toi qui présides à tout l'ensemble de la nature mortelle. Après lui et avec lui, vous venez, Titans, Dieux du Tartare, vous qui prenez chacun votre part dans la création de cette même nature mortelle, de concert avec Saturne votre chef et le premier de vos frères, et cela sans rien perdre de la plénitude de votre essence éternelle.
Tu es bienheureux aussi, Soleil roi, le premier et le plus puissant des fils légitimes de Neptune et de Junon. Neptune ayant reçu de Jupiter pour aide et pour associé un frère plus jeune que lui, une intelligence supra-céleste, a par lui-même, et avec le concours de ce frère, créé une âme ; puis, avec Junon, et surtout par elle, puisqu'à elle appartient spécialement la production de la matière, il a créé un corps : âme et corps les plus beaux et les plus parfaits de toutes les âmes et de tous les corps : puis, les unissant à cette intelligence elle-même, et soumettant le corps à l'âme et l'âme à l'intelligence, il a formé de cet assemblage une sorte de lien et de terme commun entre la nature supra céleste et celle qui est renfermée dans notre ciel : cet être intermédiaire, c'est toi, ô Soleil, chef de tout le ciel, et créateur, en commun avec Saturne, de toute la nature mortelle que le ciel renferme. Après le Soleil et avec lui, nous vous saluons, Planètes, astres errants, vous dont l'origine et la formation sont semblables à celles de votre chef, de votre premier frère, vous qui partagez avec lui la souveraineté de la nature mortelle et en même temps la direction des Démons terrestres ainsi que celle de nos âmes, selon la part assignée à chacun de vous. Après eux, nous nous adressons à vous, astres supérieurs, vous qui avez été créés pour surveiller l'ensemble des êtres aven une science certaine de toutes choses, et lancés dans l'espace pour célébrer en chœur le grand hymne en l'honneur principalement de Jupiter. Je vous invoque enfin, Démons terrestres, Dieux du dernier degré, vous qui, inférieurs aux autres Dieux et soumis à leurs ordres, touchez immédiatement à la nature humaine, mais qui êtes, comme tous les Dieux, infaillibles et à l'abri de tous les maux.
Que toute la race bienheureuse des Dieux prête une oreille propice et bienveillante à cette prière du matin. Oui, c'est vous, ô Dieux, qui, sous la direction de Jupiter, veillez à la conduite des choses humaines ; c'est vous qui, entre autres marques de votre prévoyance à notre égard, avez séparé la vie en deux parts, le sommeil et la veille, alternative nécessaire à la conservation de ce corps mortel pendant la durée qui lui est assignée. A partir donc de ce moment où nous nous éveillons et sortons de notre couche, donnez-nous de bien passer, c'est-à-dire, en la manière qui vous convient le mieux, ce jour, ce mois, cette année que nous allons parcourir, et le reste de notre vie. Car vous avez le droit de communiquer une part de vos biens à qui il vous plait dans la mesure du possible. Répandez-les sur nous dont la nature est immortelle, mais non sans mélange ; et puisque vous nous avez attachés à ce corps périssable en vue de la plénitude et de l'harmonie du grand tout, pour qu'il y eût un lien commun entre les deux natures, la vôtre immortelle et parfaite, l'autre mortelle et imparfaite, du moins faites en sorte que nous ne soyons pas entièrement dominés par l'élément mortel. Puisse la partie supérieure et excellente de notre être, qui est semblable à votre nature, s'attacher à vous, autant que possible, en tout et partout ; puisse-t-elle dominer et gouverner la partie moins noble de nous-mêmes ; et à cette fin soutenez-la, ô Dieux, autant que possible : faites que toutes les actions, toutes les œuvres que nous entreprendrons soient dirigées selon votre raison et votre sagesse; que le principe mortel et irrationnel ne s'empare pas exclusivement de nous, et que la partie faible de notre nature, prenant le dessus, ne nous entraîne pas loin de vous ; faites au contraire que nous exercions la partie supérieure de notre être, essence immortelle semblable à la vôtre, à vous suivre sans cesse, autant que possible, et à se rapprocher de vous, qui êtes toujours bons et heureux, à entretenir avec vous, autant qu'il est en notre pouvoir, une alliance intime, une communion familière, en adaptant chacune de nos actions aux règles que nous impose la parenté de notre nature avec, la vôtre. Qu'ainsi se perfectionne, le plus qu'il se peut, notre nature mortelle, et que dans la mesure de nos forces, cette participation à votre être nous rapproche de la plus grande félicité possible. Surtout accordez-nous, ô Dieux, et maintenant et toujours, comme première faveur, d'avoir de vous une juste idée ; ce sera pour nous la source de tous les biens. Car il ne peut y avoir en nous rien de plus beau ni de plus divin que la pensée en général, qui est l'acte le plus divin de notre partie la plus divine : et aucun usage de la pensée ne saurait être plus beau ni plus heureux que celui qui se rapporte à vous et au grand Jupiter, puisqu'il est impossible, sans connaître Jupiter, de se faire une juste idée de vous, de même qu'on ne peut, sans vous connaître, se faire une juste idée de Jupiter. En effet, on n'embrasse pas toute l'étendue de sa bonté si on ne le considère comme artisan suprême de votre essence, Dieux bons et heureux, sortis de lui. Car ce roi de toutes choses, qui est la bonté même, a voulu être le principe et la cause de Dieux puissants et excellents, semblables à lui-même, et il vous a engendrés au second rang des Dieux : puis il a donné aux plus élevés d'entre vous la force de produire un troisième ordre de divinités, afin, de vous rendre encore, autant que possible, semblables à lui sous ce rapport. Ainsi la divinité se compose de trois essences dont la première, la plus grande et la plus auguste, est celle de Jupiter; les deux autres en émanent, celle-ci immédiatement, celle-là par l'intermédiaire de la seconde ; et de là tous les biens qui remplissent l'univers. Mais c'est le roi Jupiter, auteur de ce tout admirable, qui en a fait la perfection et l'unité. Il l'a composé d'êtres immortels et d'êtres mortels, dont il a partagé la génération entre vous, ô Dieux ; de plus, il a voulu qu'entre ces deux sortes d'êtres il y eût un lien : ce lien, c'est notre nature, la nature humaine. Vous donc, exécuteurs de la pensée de Jupiter, vous nous avez donné une place parmi les êtres, vous avez uni une substance immortelle analogue à votre nature, à savoir notre âme, avec une nature mortelle, et vous avez placé notre bonheur d'abord dans ce lien qui nous rattache au principe immortel, ensuite dans le beau et dans la participation du beau, c'est-à-dire, dans l’imitation de vous-mêmes, en qui réside primitivement le beau absolu. Mais la contemplation des êtres est pour vous un des plus grands biens attachés à votre nature : ce doit donc être aussi pour nous la meilleure des actions et le comble de la félicité, surtout quand nous élevons notre pensée vers ce qu'il y a de plus grand et de plus beau entre tous les êtres, c'est-à-dire, vers vous, et vers celui qui commande et à vous et à toutes choses, Jupiter, le roi suprême, ensuite vers l'ensemble de l'univers, et enfin vers la connaissance de nous-mêmes qui en faisons partie. Pour obtenir chacun de ces biens et tous les autres où nous pouvons aspirer, aidez-nous, ô Dieux, vous sans lesquels aucun bien n'est possible. Mais, comme premier de tous les biens, affermissez en nous ces croyances que nous venons d'exprimer, et les autres pareilles : et puisque vous avez daigné nous instruire de notre origine, de notre essence et de la place que nous occupons dans l'Univers, conservez-nous libres autant que possible, sauvez-nous du malheur et de l'humiliation d'être asservis à la partie la plus basse de notre être, et empêchez que nous ne soyons troublés de tout ce qui peut lui arriver de contraire à nos désirs. Car d'abord ces choses ne doivent être rien pour nous, puisqu'elles n'atteignent en nous que la nature mortelle, et non la partie supérieure de notre être, cette nature immortelle à laquelle vous avez attaché pour nous le bonheur. Et en second lieu, il n'est pas possible que les choses nous soient toujours données telles que nous les voudrions : car il n'y aurait rien de mortel en nous, si nous étions à l'abri de tous ces accidents, et nous ne serions plus un composé de deux essences, l'une éternelle, l'autre périssable, tels enfin que vous avez voulu que nous fussions au milieu du grand tout. Puis donc que nous devons, dans la mesure de notre condition et selon la part qu'il vous plait de nous faire, user des biens que vous nous donnez, faites que nous en usions avec le calme et la liberté, caractères de cette raison supérieure que vous nous avez départie comme une arme destinée à combattre les funestes influences du dehors, si nous avons le bonheur de savoir nous en servir. Car ce serait folie de nous révolter contre ceux qui sont plus puissants que nous ; ce serait injustice de regretter les biens que vous ne nous avez pas donnés, au lieu d'être pleins de reconnaissance pour ceux que vous nous avez accordés, et qui certes ne sont pas à mépriser. Puissions-nous donc ne jamais nous plaindre de voue pour aucune de ces choses, ni la désirer autre qu'il ne vous a plu de la faire ; mais, acceptant sans résistance tout ce que vous avez décrété, et sachant que vous nous traitez toujours le plus favorablement possible, entre autres rapports de notre intelligence avec la vôtre, ayons celui de partager en tout votre volonté. Faites que nous n'ayons jamais de ressentiment contre l'homme, qui après tout est né pour agir selon son propre arbitre, et qui ne peut nous atteindre si nous savons fixer sur nous-mêmes notre attention et nous contenter des biens qui seuls nous sont propres. Faites aussi que nous ne reculions point devant une action belle et en rapport avec votre volonté et notre devoir, par la crainte ou des peines qu'elle nous coûterait ou de la perte de quelqu'un des biens qui ne nous sont pas réellement propres ou de la désapprobation des hommes peu sensés. Fortifiez la partie pensante et divine de notre être, afin qu'elle règne et domine en nous autant qu'il se pourra, qu'elle soit la maîtresse et la souveraine de toutes nos autres facultés, comme il convient à ce qui est supérieur relativement à ce qui est inférieur, et qu'elle impose à chacune d'elles ses justes limites. Quant aux plaisirs qui viennent par les sens, jouissons-en le plus modérément possible, en tant qu'ils nous semblent ne pouvoir nuire en rien au bon état de notre corps et de notre âme, sinon même contribuer pour leur part à rendre cet état le meilleur possible. Ne laissons pas un plaisir trompeur et insensé s'emparer de nous pour ravaler notre âme et quelquefois endommager notre corps. Ne considérons les richesses, instruments des plaisirs, que comme un moyen de satisfaire aux besoins raisonnables de la vie, et prenons garde d'en laisser croître en nous jusqu'à l'infini le désir, qui deviendrait une source intarissable de maux. Quant à l'opinion, ne tenons compte que de celle des hommes vertueux, sûrs de trouver en eux des témoins prêts à nous encourager et à nous soutenir toutes les fois que vous nous aurez donné d'accomplir quelque action belle et honnête. Pour celle des hommes qui, bien au contraire, n'ont que des idées fausses sur la vertu, n'en faisons cas et ne cherchons à mériter leur estime qu'autant qu'elle ne coûte aucun sacrifice à la vertu, dans toutes les circonstances où le devoir est engagé. Ainsi puissions-nous ne jamais nous abandonner au désir de je ne sais quelle gloire stérile et funeste à la vertu. Les liens et les rapports que vous avez établis entre nous et chacun des êtres avec lesquels nous participons, faites, ô Dieux, que nous les conservions fidèlement en rendant à chacun ce qui lui est dû en vertu de ces rapports ; et particulièrement à ceux avec lesquels nous vivons d'un commerce habituel, à commencer par nos parents, qui sont pour nous vos propres images, puisqu'ils sont la cause de notre nature mortelle. Soyons bons en procurant à chacun tout le bien qu'il a droit d'attendre de nos rapports avec lui ; mais ne soyons jamais causes volontaires d'un mal, et ne jouons pas le rôle d'un être odieux, malfaisant et insociable. Puissions-nous, dévoués au bien de la ville et de la famille dont nous faisons partie, faire toujours passer ce bien avant le nôtre, marchant ainsi sur vos traces, ô Dieux issus du grand Jupiter. Car, si ce Dieu, qui est la bonté par excellence, l'être absolu, a créé et produit l'Univers dans son tout et dans ses parties; dans ses parties, dont chacune est la meilleure et la plus belle possible ; dans son tout, un et multiple à la fois, et parfaitement proportionné avec lui-même pour en être encore plus beau et meilleur; vous, ô Dieux, vous travaillez pour votre part à produire sans cesse le bien, soit entre vous, soit pour les autres êtres que vous présidez et gouvernez, et cela en toutes choses, pour les parties comme pour le tout, préférant néanmoins toujours l'intérêt du tout à celui des parties. Accomplissons vos rites sacrés le mieux possible et surtout comme il convient à qui sait que vous n'en avez pas besoin, mais que c'est un moyen d'agir sur notre imagination, faculté la plus voisine de la partie divine de notre être, de la former, de l'élever jusqu'à ce qui est beau et divin, et en même temps de la rendre plus soumise et plus docile à notre raison. Faisons consister la sainteté et la piété à ne rien négliger des cérémonies qui vous sont consacrées, mais sans dépasser la mesure suffisante pour régler notre imagination. Ainsi rendez-nous en toutes choses aussi parfaits que possible, et dans nos actions conservez-nous à l'abri des fautes et des erreurs, en nous dirigeant dans toute la conduite de la vie par ces lois et autres semblables dignes de nous servir dérègles. Si nous tombons dans quelque faute, relevez-nous le plus tôt possible, et ramenez-nous au bien en faisant luire à nos yeux une raison plus saine, un discernement exact du bien et du mal, moyen le plus sûr de nous guérir de nos erreurs et de nos vices. De cette manière, unis à vous dans la mesure de nos forces, nous jouirons, autant qu'il nous est permis, des biens infinis qui existent en vous, et où l'envie ne saurait trouver aucune place. Attachés ainsi à vous suivre, autant que possible, dans toute notre conduite, nous vous serons associés par l'identité de nos actes. Dans nos hymnes en votre honneur, nous emprunterons les images les plus dignes de vous à la partie la plus élevée de notre être. Et avec vous, et par-dessus vous, nous célébrerons le grand Jupiter, dans la contemplation duquel tous ceux qui peuvent y prendre une part quelconque, trouvent l'état le plus parfait et le plus heureux. Ο Jupiter, le plus grand et le plus éminent des Dieux, père qui n'as d'autre père que toi-même, premier auteur de toutes choses, roi tout-puissant et absolu, par qui sur les autres êtres toute royauté et toute puissance est établie, dirigée, gouvernée, sous toi et sous ton autorité suprême; ô maître souverain, et en même temps le meilleur de tous les maîtres, à qui toutes choses sont soumises en toute justice et pour leur propre bien; si ces choses sont nées et si elles existent, c'est par toi, c'est aussi pour toi, pour toi qui n'as pas besoin d'elles, mais qui, étant essentiellement bon, as voulu foire toutes choses aussi bonnes que possible. De tous les biens, en effet, tu es le premier et le dernier, en sorte qu'il ne faut pas chercher le bien ailleurs qu'en toi, dont il est la propre essence. Tu es pour les bienheureux le dispensateur inépuisable de leur félicité. Tu es le bienfaiteur qui prodigue à tous les êtres les plus grands biens et les plus conformes possible au bien universel. Tout est plein de ta gloire ; toutes les classes de Dieux te célèbrent, et regardent ce culte comme le plus beau et le plus heureux de leurs actes. A cette adoration s'associe Neptune, le premier et le plus puissant de tes enfants, qui préside pour les autres êtres à tous les biens et à celui-là par-dessus tous les autres ; de même aussi Junon son épouse, mère, elle-même sans mère, de tous les Dieux qui habitent l'enceinte de notre ciel ; de même tous les autres Dieux de l'Olympe ; et Saturne aussi et les Titans qui gouvernent les mortels ; le Soleil, roi de notre ciel, ainsi que ses frères et subordonnés, les astres appelés errants ou planètes ; le chœur entier des astres supérieurs ; la race terrestre des Démons qui touche immédiatement à notre espèce; enfin au dernier rang l'espèce humaine ; tous les êtres en un mot, chacun selon sa puissance. Nous donc aussi, nous te célébrons, et nous te supplions de répandre sur nous les plus grands biens dans la mesure possible des choses. Sois-nous favorable, conserve-nous, gouverne-nous au milieu de ce grand Univers, accorde-nous enfin ce que tu peux vouloir pour nous de plus favorable dans ta bonté parfaite et en même temps selon l'arrêt fixé de toute éternité.
Cette allocution doit être récitée chacun des trois jours qui commencent le premier mois, avec l'hymne du mois et celui de l'année. Dans les autres mois, on ne la récitera qu'une fois le jour de la nouvelle lune ou premier du mois, en y joignant l'hymne du mois, et supprimant celui de l'année. Dans les autres hiéroménies, et aussi pendant les jours profanes, il faudra supprimer ces deux morceaux, à savoir, l'hymne mensuel et celui de l'année. Enfin, pendant les jours profanes, après ce passage : « Et que, dans la mesure de nos forces, cette participation à votre être nous rapproche de l'éternelle félicité, » pour abréger, il faut passer tout ce qui suit, et reprendre à : « Attachés ainsi à vous suivre autant que possible, dans toutes nos actions, » et le reste jusqu'à la fin de l'allocution.
Suite des allocutions aux Dieux.
Première allocution de l'après-midi.
Neptune roi, c'est toi qui de tous les enfants de Jupiter, le roi suprême, es le plus ancien et le plus puissant. Tu es né d'un père absolument incréé et qui n'a eu d'autre père que lui-même. On ne peut dire que tu sois toi-même incréé, puisque tu procèdes d'une cause ; mais tu surpasses par la grandeur et la dignité de ta puissance tous les êtres créés. Aussi ton père t'a-t-il confié l'autorité sur toutes les créatures, à toi qui es essentiellement la forme, le fini et le beau, à toi de qui tous les êtres reçoivent la forme et le fini avec la part de beauté qui leur convient. Tu es, après le grand Jupiter, le père et l'auteur le plus ancien des Dieux de la troisième classe, de ceux qui habitent dans l'enceinte de notre ciel. Après toi, vient la reine Junon, née du même père que toi, mais inférieure à toi en dignité comme en nature : car il ne faut pas que dans les régions supra célestes où vous régnez se trouvent plusieurs divinités égales; elles doivent être chacune seule de son espèce, afin d'avoir encore ce rapport de plus avec l'être par excellence qui tous a tous engendrés. Telle est l'origine et la nature de Junon chargée de présider à la naissance, à l'accroissement et à la multiplication infinie des choses d'un ordre inférieur, et avec raison : car, procédant primitivement de toi, qui es la plus parfaite des choses créées, elle a commencé en soi la pluralité des êtres, et s'unissant à toi par des liens chastes et divins, elle est devenue la mère de tes enfante célestes. Après elle, viennent dans leur ordre tous les autres Dieux de l'Olympe, qui sont tes frères, comme toi fils légitimes de Jupiter roi : leur nature varie, supérieure chez les uns, inférieure chez les autres; mais tous ont reçu dans l'ensemble des choses les attributions qui leur conviennent et qu'ils exercent sous ton autorité : Apollon a sous sa loi l'identité, Diane, la diversité; Vulcain, l'immobilité et le repos; Bacchus, le mouvement volontaire, et l'élan vers la perfection; Minerve, le mouvement communiqué, l'impulsion qui se borne à son effet et repousse le superflu ; Atlas, l'empire général des astres tes enfants légitimes; Tithon, en particulier, celui des planètes, et Dioné, celui des étoiles fuies ; Mercure, l'autorité sur les Démons terrestres, dernière classe des divinités subalternes; Pluton, sur la partie la plus relevée de notre être qui constitue notre nature immortelle ; Rhée, sur les corps primitifs et les éléments en général ; mais en particulier, Latone préside à l'éther et à la chaleur qui sépare les éléments; Hécate, à l'air et au froid qui les rapproche ; Téthys, à l'eau et à l'humidité qui les rend fluides; Vesta, à la terre et à la sécheresse qui les rend compactes. Tous ces Dieux, enfants légitimes et les plus puissants de Jupiter roi, occupent l'Olympe, c'est-à-dire, le sommet de la région supra céleste, la partie la plus pure de l'espace; c'est de là que, chacun selon ses attributs, ils gouvernent sous ta direction la nature muable, qu'on peut dire créée parce qu'elle est le produit d'une cause et qu'elle est l'objet d'une création continuelle par le mouvement, mais incréée en ce sens qu'elle n'a jamais commencé. Toi, soumis au seul Jupiter, tu es le guide et le chef de tous les autres ; c'est toi qui marques la limite de leur action et qui ordonnes le grand tout. Aussi c'est à toi que nous adressons d'abord nos invocations, comme cela est juste, puisque l'ordre même de notre création nous a placés sous ta direction immédiate, ta nature te mettant en rapport direct avec la partie principale de notre être, celle qui est immortelle. Nous t'honorons et te rendons grâces pour les biens que tu nous as donnés et que tu nous donnes; nous chantons des hymnes à ta gloire, et nous célébrons après toi et avec toi tes frères, les Dieux de l'Olympe. Ο vous, divinités éternelles et supérieures au temps, vous qui ne connaissez ni passé ni avenir, mais pour qui tout est présent et actuel, recevez favorablement cette allocution que nous vous adressons du degré inférieur où nous sommes placés dans l'échelle des êtres, à cette heure où déjà plus de la moitié du jour est passée, afin que, s'il est en nous quelque disposition vertueuse, elle se fortifie par la présence de votre pensée, et que nous ne laissions pas dépérir, par la succession des jours, des mois et des années, ce qu'il y a de divin en nous, mais qu'au contraire nous le conservions, grâce à vous, sans corruption et sans mélange. Neptune roi, et toi, Pluton, qui veilles sur les mortels, et vous tous, Dieux de l'Olympe, sans vous il ne nous est permis de jouir d'aucun bien ; venez-nous en aide pour nous rendre la vertu facile, et assistez-nous dans les bonnes actions, qui nous assurent, à nous aussi, une part de félicité. Toutes sont dignes de votre assistance, mais surtout celle qui consiste à fêter et célébrer le grand Jupiter, vers qui nous nous tournons en dernier lieu, comme à celui qui est pour nous comme pour vous et pour tous les êtres le dispensateur suprême de toutes les grâces, et qui, nous accordant, en notre qualité d'êtres raisonnables, la faculté de nous élever, autant que le comporte la nature de chacun de nous, vers la contemplation et la célébration de son essence, met ainsi le comble à tous ses bienfaits.
Dans cette allocution, aux jours non consacrés, après ce passage : « Mais tous ont reçu dans l'ensemble des choses les attributions qui leur conviennent et qu'ils exercent sous ta direction, » il faut supprimer ce qui suit pour reprendre à : « Toi, soumis au seul Jupiter, tu es le guide et le chef de tous les autres, » et continuer l'allocution jusqu'à la fin.
Suite des allocutions aux Dieux.
Seconde allocution de l'après-midi.
Saturne roi, tu es le premier de toute la race des Dieux du Tartare, enfants illégitimes de Jupiter, le roi suprême : c'est pourquoi tu as reçu l'autorité sur eux. Avec le Soleil, chef de notre monde, tu as été chargé de la création de la nature mortelle. Tu as pour compagne Vénus, qui préside à la transmission de l'éternité dans le monde mortel par la succession des êtres. Sous toi se rangent tous ceux qui gouvernent ces êtres selon les différentes attributions qu'ils ont reçues : Pan, qui règne sur la classe entière des animaux dépourvus de raison, Gères, protectrice des plantes, et tous les autres Dieux auxquels ont été confiées des parts différentes du domaine mortel. Parmi eux est Proserpine, qui dirige la partie mortelle de notre être. Pluton, qui préside à notre nature immortelle, a enlevé cette déesse, et il la retient comme épouse : ainsi un Dieu de l'Olympe, épris d'une déesse du Tartare, établit un lien entre le Tartare et l'Olympe d'après les décrets de Jupiter. Et toi, Soleil roi, fils le plus ancien et le plus puissant du grand Jupiter par l'intelligence divine qui est en toi, comme aussi de Neptune par la nature de ton âme et de ton corps, limite commune outre les Dieux supra célestes et ceux qui habitent l'enceinte du ciel, tu as été chargé par ton père Neptune du gouvernement de tout ce ciel qui nous environne. Toi donc et tes six frères et compagnons : la Lune, Lucifer, Stilbon, Phaenon, Phaéton et Pyroïs, vous parcoures le ciel ; et tous, vous unissant à Saturne et aux autres Titans, vous parfaites l'ensemble de la nature mortelle. C'est toi qui conduis dans les régions les · plus élevées de notre ciel ce chœur brillant et nombreux des astres. Sous toi vient se ranger aussi cette race terrestre de Démons chargée d'exécuter les ordres des autres Dieux. Enfin tu présides encore à la partie immortelle de notre nature, et avec le concours de Saturne et des Titans qui lui obéissent, tu formes l'autre partie, à savoir, notre corps mortel, et tu la conserves autant que le permet la destinée de chacun de nous. C'est pourquoi, après Neptune et les autres Dieux de l'Olympe, nous vous invoquons aussi et vous adressons des actions de grâces en reconnaissance des biens que nous tenons de vous. Nous prions ceux d'entre vous que ce soin concerne, de guider notre nature immortelle vers le bien et le beau, et de rendre autant que possible notre nature mortelle soumise et docile. Accordez-nous, ô Dieux, maintenant que nous avons consacré la plus grande partie de ce jour à l'accomplissement de nos devoirs, de prendre le repas nécessaire à notre corps mortel dans les conditions qui conviennent à des hommes vertueux, c'est-à-dire, d'abord avec la conscience de l'avoir gagné justement, puis avec reconnaissance pour ceux qui l'ont préparé et amitié pour ceux qui le partagent avec nous, enfin avec tempérance et profit pour notre santé, comme avec propreté et sans recherche. Donnez-nous d'employer le reste de ce jour et de notre vie de la manière la meilleure et la plus belle qui soit en notre pouvoir. Aidez-nous enfin à contempler le roi Jupiter et à le célébrer par nos hymnes toutes les fois qu'il le faut, mais surtout en ce moment, afin que nos prières soient aussi dignes de lui que possible.
Dans cette allocution, aux jours non consacrés, après ce passage : « Selon les différentes attributions qu'ils ont reçues, » il faut supprimer ce qui suit pour reprendre à : « Et toi, Soleil roi, » continuer jusqu'à : « Toi donc et tes six autres frères et compagnons, » retrancher ici les noms des six planètes pour reprendre à : « Vous parcourez le ciel, et tous, vous unissant à Saturne et aux autres Titans, » et continuer jusqu'à la fin de la prière. Aux jours de jeûne, il ne faut rien retrancher; on supprimera seulement le passage relatif au repas, puisqu'il ne doit avoir lieu que plus tard.
Suite des allocutions aux Dieux.
Troisième allocution de l'après-midi, la plus importante de toutes, adressée à Jupiter roi.
Être, unité, bonté absolue, Jupiter, toi seul ne dois l'existence à aucune autre cause que toi-même, toi seul es d'une essence vraiment essentielle et d'une unité absolue, non pas d'une unité multiple, car il ne se pourrait faire ni que plusieurs êtres tous incréés se réunissent en un seul tout, puisqu'ils auraient besoin d'un autre être plus puissant pour les assembler, ni qu'un seul être étant incréé, d'autres procédant de lui vinssent se fondre en lui, parce qu'il n'y aurait plus communauté de nature entre ce principe existant par soi-même et les êtres qui, tirant d'ailleurs leur origine, se distingueraient de lui par cette différence capitale. Mais seul tu es l'unité, tu es toujours et en tout identique à toi-même, tu es le bien absolu : aussi es-tu souverainement bon en toi-même ; et par rapport aux autres êtres descendus de toi et constitués par toi dans un état de perfection, tu as sur eux tous une supériorité incommensurable. Père des pères, qui es à toi-même ton propre père, créateur des créateurs, auteur incréé de toutes les choses créées, roi des rois, qui domines sur toutes les puissances ; seul tu es maître absolu, indépendant, rien ne peut contre toi, mais, commandant à tous ceux qui commandent, grands ou petits, tu fixes à chacun d'eux son état et ses lois, tu les règles et les diriges tous de la manière la plus droite par ton immuable volonté; maître souverain, maître des maîtres, et en même temps maître doux et bon entre tous, auquel tout se rattache comme à son principe originel depuis le premier jusqu'au dernier des êtres, pour servir dans une juste servitude qui est le bien suprême de ceux qu'elle enchaîne ; car c'est par toi qu'ils ont été créés et qu'ils existent, par toi et pour toi qui n'avais aucun besoin d'eux, mais qui as voulu satisfaire à ta bonté suprême en produisant tous les biens possibles au degré le plus parfait possible. C'est pourquoi nous te chantons et nous exaltons tes bienfaits par de pieux hommages, nous tous placés, bien qu'au dernier degré, dans le domaine de la nature raisonnable ; nous te célébrons et nous t'offrons les hommages les plus pieux qu'il soit en nous de t'offrir. Un exercice religieux dont tu es l'objet est pour nous le plus fortuné de tous les actes. Mais nos hommages sont dès longtemps devancés par ceux de la nature intelligente et raisonnable des Dieux. En effet, Dieu prééternel et incréé, dans la suprême bonté de ta pensée, tu n'as pas dédaigné de procréer d'autres Dieux, les uns par toi-même sans le secours d'une mère, les autres par l'intermédiaire du plus ancien de ces mêmes Dieux qui sont sortis de toi. Car d'abord tu es par toi-même l'auteur des êtres qui forment la classe la plus rapprochée de ta nature, de ceux dont la substance est immuable et éternelle; et sans le concours de la matière divisible à l'infini, toi-même par toi-même, tu produis des êtres existants en eux-mêmes, des Dieux plus que tous les autres semblables à toi, à savoir, les Dieux supra célestes. Séparément, aucun d'eux n'est égal à l'autre, puisqu'ils sont tous relativement inférieurs ou supérieurs, afin que chacun d'eux étant un dans son individualité, par là encore se rapproche de toi autant que possible ; mais, collectivement, ils forment un nombre suffisant et un grand et parfait ensemble qui constitue le système supra céleste ; de sorte que chacun jouit de sa personnalité et se fond pourtant dans l'unité générale. Tu as divisé ces Dieux en deux familles, l'une composée de tes enfants légitimes : ce sont les Dieux de l'Olympe; l'autre est la race des Titans, Dieux du Tartare, tes enfants illégitimes. Ceux-ci tirent de toi leur origine comme les autres, mais ils sont borgnes à une infériorité de puissance et de dignité. Le plus ancien des Titans, celui que tu as créé pour être leur chef à tous, est Saturne. Le plus ancien et le plus puissant des Dieux de l'Olympe, et en même temps-de tous les Dieux, est le grand Neptune, celui que tu as fait ton image la plus parfaite possible, le terme extrême de la perfection dans tout l'ensemble des êtres. Pour l'assimiler encore plus à toi, tu lui as donné l'autorité souveraine sur le monde, et de plus la faculté de produire et de créer tous les êtres renfermés dans l'enceinte du ciel, en s'adjoignant toutefois quelqu'un de ses frères pour chacune de ces créations partielles. Lui, alors, organisant notre ciel pour toi et à ton exemple, cherchant en vue de toi à mener les choses à leur plus haut point de beauté, crée une troisième nature de Dieux composés de corps et d'âme qui de plus près veillent à l'ordre et à la conservation des choses. Or, voici comme il les engendre : prenant pour modèle sa propre nature et toute la nature intelligente et immatérielle qui l'environne, il crée aussi des idées pour notre monde, mais des idées à qui il ne donne pas une existence tout à fait séparée ; il les fait au contraire unies à la matière que lui fournit Junon sa sœur et son épouse, de sorte toutefois qu'elles n'en soient pas-moins les images des autres idées, c'est-à-dire, des idées du monde supérieur sur lesquelles elles sont modelées. Il en forme une double catégorie, l'une entièrement dépendante de la matière : ce sont tous les êtres sans raison ; l'autre qui n'en dépend plus, mais qui au contraire la tient sous sa dépendance. Celle-ci, sans avoir une existence séparée de fait, l'a cependant virtuellement, et par là se rapproche plus de ta nature, c'est-à-dire, de celle des êtres supra célestes : c'est l'âme raisonnable. Cette âme se partage en trois espèces : la plus élevée, celle qui connaît tout, est fille légitime de Neptune lui-même, elle forme la race des astres divins ; l'âme qui ne connaît pas tout, mais qui a une opinion saine de tout ce qu'elle connaît, est une fille illégitime de Neptune, c'est l'âme déjà terrestre des Démons ou Dieux du dernier ordre, n'agissant que sous la direction des grands Dieux; enfin vient l'âme qui n'a point de toutes choses une opinion exacte, qui est sujette à l'erreur et qui n'est pas la plus parfaite des œuvres de son Créateur : c'est notre âme, l'âme humaine, qui vient immédiatement après celle des Démons. Quant à l'autre substance, celle qui est privée de raison, Neptune en a fait quatre espèces principales de corps : le feu, l'air, l'eau et la terre. Choisissant le plus beau de ces éléments, celui qui contient le moins de matière sous le plus grand volume, à savoir, le feu, il a fait de sa partie la plus pure et la plus brillante le véhicule des âmes des astres, et de l'autre, invisible et éthérée, le véhicule de nos âmes et de celle des Démons. Ainsi unissant toujours une âme à un corps, il en a composé les trois classes inférieures d'êtres immortels et raisonnables. Toutefois il n'a pas agi seul, mais il s'est servi du concours de ses frères, les autres Dieux Olympiens, dont chacun a pris sa part dans la création des êtres immortels de notre ciel, à savoir des trois espèces d'âmes, et dans celle des quatre espèces de corps les plus anciennes de toutes et les plus importantes. Pour les astres, il en a établi deux classes : l'une, nombreuse, immobile, occupée à contempler les êtres et à te glorifier; l'autre, composée de sept astres errants qui ressemblent et correspondent chacun à quelqu'une des idées éternelles : et pour cela il a d'abord uni chaque astre à l'idée ou intelligence qui lui est propre ; il l'a composé d'une intelligence éternelle, d'une âme et d'un corps, et ainsi il en a fait une triple nature qui sert de lien et de rapport entre ce monde et le monde supra céleste, rapport admirable établi par tes lois toutes-puissantes. Il a fait le plus beau et le meilleur d'entre eux, le Soleil, terme suprême de la perfection des créatures contenues dans l'enceinte du ciel. Il l'a uni à la plus puissante de ces intelligences susceptibles de se communiquer, et l'a chargé du gouvernement du ciel : car il fallait que l'Univers eut aussi sa part de la nature mortelle, afin que rien ne manquât à ton ouvrage. La production des êtres dont se compose notre monde a été confiée au Soleil et en même temps à Saturne, le premier de tes enfants illégitimes. Tous deux, chargés de cette mission, produisent les animaux, les plantes de toute espèce et tous les êtres d'une nature analogue, aidés dans cette création chacun par ses autres frères, à savoir, l'un par les Dieux du Tartare, l'autre par les planètes. Celles-ci, dans leur mouvement et leur révolution, se rapprochant ou s'éloignant tour à tour des êtres sur lesquels elles agissent, en font ainsi des créatures mortelles. Car les autres Dieux préposés à la naissance de ces dernières, habitants immuables du Tartare, sont incapables de rien produire sans le concours des planètes : leur fonction est de prendre nos âmes que Neptune a créées immortelles, mais non tout à fait pures, de les attacher, pendant le temps marqué pour chacun de nous, à la nature mortelle, et plus tard de les dégager de ce monde terrestre, de manière à établir, d'après tes lois et sous les ordres de Neptune, un lien entre les deux essences distinctes qui composent le monde, l'essence immortelle et l'essence mortelle. Ainsi, tout l'ensemble des êtres créés par toi se divise en trois ordres d'êtres : le premier, immuable et éternel, dont toi-même es le créateur immédiat; le second, immortel aussi, mais soumis aux lois du mouvement et du temps, à la génération duquel préside Neptune, le plus puissant de tes fils; le dernier enfin, inférieur et mortel, dont le Soleil et Saturne dirigent ensemble la création. Toi, tu as uni entre eux ces trois mondes, le premier au second par le système que forment le Soleil et les autres astres, et le second au dernier par la création de notre nature et de tout ce qui s'y rattache. De cette création tu as fait un tout parfait, un tout immortel et non sorti subitement du néant où il aurait été d'abord, ni condamné à y rentrer plus tard. En même temps il conserve perpétuellement une forme immuable; car tu ne pouvais ni te dispenser de le produire, parce que tu es infiniment bon, ni le faire inférieur au plus haut degré de perfection qu'il pût atteindre. Dans cet Univers, tu as donné à toute la nature raisonnable un sublime privilège, c'est la faculté de te connaître et de te contempler, et tu nous y as admis les derniers comme étant au dernier rang de cette nature. De concert donc avec toutes les races de Dieux, nous te célébrons selon la mesure de nos forces, et sous la direction du grand Neptune, qui préside aussi à cet acte comme à tout ce qui est beau. Oui, tu es grand et souverain par excellence, toi qui, étant le terme extrême et suprême de toute grandeur, dispenses-à chacun des êtres, divins ou autres, la part de dignité qui appartient à chacun d'eux en particulier et s'accorde le mieux avec l'ensemble. C'est ainsi que tu nous as fait une condition à la fois mortelle et immortelle, qui tient le milieu et sert de lien entre les deux natures. Telle est la place que tu as voulu nous assigner dans l'Univers, et pour nous, comme pour les Dieux, ta as fait, consister le bonheur dans le bien, le mesurant aux uns avec plus d'abondance, aux autres avec plus de parcimonie, toujours en vue de l'harmonie générale. En même temps tu as rendu toujours possible aux pécheurs le retour à l'ordre, plus facile pour les uns, plus pénible pour les autres. Ainsi tu as tout disposé pour le plus grand bien de chaque être et pour le plus grand avantage de l'ensemble, plaçant toutes choses sous la loi éternelle d'un destin inévitable, et accomplissant les détails de ton œuvre par les Dieux auxquels tu as confié ce soin. Sois-nous donc propice, conserve-nous, gouverne-nous avec cet Univers selon ce que tu peux vouloir pour nous de plus-favorable dans ta bonté parfaite et en même temps selon l'arrêt fixé de toute éternité.
Suite des allocutions aux Dieux.
Allocution du soir.
A toi d'abord, à toi surtout, Jupiter roi, nous rendons grâces de tous les biens que nous avons jamais possédés, que nous possédons, ou que nous posséderons jamais. Le bien c'est toi, hors de toi il n'est pas d'autre bien ; car tu es à la fois pour tous les êtres le premier et le dernier, en un mot, le souverain principe de tout bien. Après Jupiter, c'est toi, Neptune, et vous tous autres Dieux, qui nous transmettez les bienfaits de Jupiter; c'est vous que nous remercions toujours et en toute occasion pour tous vos dons, mais surtout pour ceux-ci, les plus grands et les plus parfaits dont nous ayons ou puissions avoir la jouissance. D'abord, vous nous avez placés comme en un milieu, entre la nature des êtres mortels et la vôtre qui est immortelle. Vous avez fait de nous la commune limite de ces deux natures et la chaîne qui les rattache l'une à l'autre. Vous nous avez élevés au-dessus de tout ce qui est mortel en nous unissant à vous par des liens de parenté, en nous communiquant votre immortalité et cette glorieuse béatitude qui nous est donnée dans un degré sans doute inférieur, mais pourtant à votre ressemblance. Vous voulez bien que nous vous touchions encore par d'autres points, et d'abord par la connaissance que nous avons de vous, puis par notre intelligence capable d'embrasser tout ce qui existe, un des plus beaux privilèges de votre propre nature, dont vous avez daigné nous faire part. Enfin, nous nous connaissons nous-mêmes, et aucun autre de vos dons ne nous rapproche plus étroitement de vous puisque nul ne possède à un plus haut degré que vous la connaissance de soi-même. C'est ainsi que vous avez particulièrement perfectionné ce qu'il y a de meilleur en nous, ce qui doit commander chez nous à tout le reste. Vous avez voulu, en outre, que la faculté qui vient ensuite la première, qui touche de plus près à ce qu'il y a de meilleur en nous, et domine tout le reste, en un mot, que l'imagination fut utilement pour elle appliquée aux cérémonies du culte, se formant et se modelant ainsi autant que possible sar ce qu'il y a de plus beau dans notre partie supérieure, pour obéir ensuite plus docilement à la raison et toucher encore par cet autre côté au beau et à la nature divine. Vous avez permis en outre que par notre bonté envers nos proches et envers tout le genre humain, nous puissions imiter votre bonté, ô Dieux qui êtes la source de tout bien et qui ne causez jamais de mal à personne. C'est à vous que nous devons cette société civile qui nous unit les uns aux autres, et nous rapproche aussi de vous, en nous assimilant autant que possible à la conformité de nature qui vous unit, vous, fils d'un même père, de Jupiter roi, qui est l'unité même, et liés en conséquence les uns aux autres par la plus étroite communauté possible. En outre, pour que la partie de notre être qui se laisse naturellement aller à l'opinion, pour que l'imagination n'exerçât pas sur nous trop d'empire, vous l'avez soumise à la raison, cette meilleure partie de nous-mêmes, qui méprise dans l'opinion tout ce qu'elle a de vain pour n'en considérer que ce qui peut être utile même au progrès dans la vertu. Ainsi, vous n'avez pas permis que nous fussions entièrement assujettis à notre nature mortelle ; vous nous avez accordé, si nous sommes sages, le pouvoir de nous gouverner à l'aide de la partie supérieure de notre être, jouissant, quand cela est permis, des plaisirs du corps, mais modérément et sans tomber dans la licence, c'est-à-dire, en leur imposant la règle et la borne convenables, en prenant pour mesure des jouissances de cette espèce les besoins raisonnables du corps, de manière à rester libres même pendant notre séjour sur cette terre, et à ne pas regarder comme un grand malheur ce qui peut arriver à cette partie mortelle de notre être contrairement à nos désirs, lorsqu'il vous plaît, ô Dieux, de nous détacher ainsi de la participation à votre bonheur, soit par l'entremise des Démons exécuteurs de vos ordres, soit par la faute de nos semblables, pour notre expiation et notre pacification dans le premier cas, dans l'autre par l'effet de mauvais sentiments dus chez les hommes au défaut d'éducation morale. Vous nous donnez même souvent de préférer volontairement, bien plus, de rechercher ce qui doit blesser cette partie inférieure, au point de la sacrifier quelquefois entièrement en vue du beau et pour l'utilité de la meilleure partie de notre être, tant vous avez attribué de puissance à notre nature immortelle sur celle qui ne l'est pas. Telles sont, avec d'autres plus grandes encore, les faveurs dont vous nous avez comblés, élevant et embellissant ce qu'il y a en nous de meilleur et de plus puissant par les raisonnements salutaires que vous daignez en chaque occasion nous inspirer.
Mais que de facultés n'avez-vous pas aussi données à notre corps, soit pour servir notre partie immortelle et dominante, soit pour profiter de son secours, soit pour goûter certaines jouissances qui nous sont propres, parfaitement innocentes et sans danger pour cette meilleure partie de nous-mêmes ! Ainsi, entre vos autres dons, les yeux sont doués de la vue, le plus utile de nos sens pour l'observation de tous les objets extérieurs et principalement de ces grands corps célestes dont la connaissance nous procure celle de tant de belles choses, notamment du cours des années, des mois et des jours, mesure nécessaire de notre vie pour que la plu part de nos actions puissent se faire à propos et en ordre. De même, les oreilles sont disposées pour l'ouïe, et la bouche pour la voix ; ce sont des organes indispensables pour communiquer entre nous par la manifestation mutuelle de ce que chacun a dans l'esprit, en sorte que l'obstacle matériel du corps n'empêche pas toute relation entre les intelligences. Vous nous avez donné aussi l'odorat, dont le siège est dans les narines, comme un moyen de goûter le plaisir innocent des odeurs, et aussi de distinguer souvent à distance, avant même de la goûter, la nourriture saine de celle qui ne l'est pas, d'après sa bonne ou sa mauvaise odeur. Vous avez placé le goût dans la bouche pour juger au passage les sucs destinés à notre alimentation, les savourer souvent avec plaisir et les apprécier, dès l'instant même où nous les touchons. Vous avez attribué à cet organe du goût des instincts variés pour-choisir la nourriture qui soutient notre vie, tribut nécessaire à notre corps, aliment indispensable de ce renouvellement de la matière qui toujours vient ou s'en va pendant le temps que le destin nous permet, avec votre aide, de conserver notre enveloppe mortelle. C'est encore en vue de cette partie mortelle et périssable que vous avez institué cette union des deux sexes, si attrayante par le plaisir. Par là se maintient toujours dans le même état l'ensemble de l'espèce, une succession non interrompue faisant prendre à un nouvel individu la place de celui qui s'en va. Ainsi les âmes, toujours en égal nombre, trouvent à la fin de chaque période des corps qui viennent successivement leur prêter leur ministère pour les emplois que vous leur avez assignés. En outre, vous nous avez permis de suppléer à l'insuffisance de nos moyens physiques par les procédés des arts variés selon leur objet, et pour cela vous nous avez donné les mains, instruments nécessaires à la confection de tant d'ouvrages de toute sorte. Vous nous avez encore permis d'employer à nos usages la force et les aptitudes particulières des animaux, et de nous approprier ainsi les avantages de leur nature. Pour tous ces biens, ô Jupiter roi, c'est à toi, d'abord et surtout, que nous devons rendre grâces, comme au premier et au plus puissant de nos bienfaiteurs. Après lui, c'est à vous, ô Dieux, par l'entremise desquels ces biens nous viennent de Jupiter. N'est-il pas bien juste que nous soyons animés de la reconnaissance ta plus profonde envers vous, qui, sans rien nous devoir et sans aucun espoir de retour, nous avez accordé et nous accordez encore tant de bienfaits, et qui, bons par essence, voulez ainsi répandre abondamment autour de vous tout ce qui est bon, prodigues de vos dons autant qu'il vous est possible. Grâces vous soient rendues pour tous vos bienfaits en général, mais d'abord et surtout pour ceux par lesquels vous faites entrer notre âme dans les voies du beau et de la vertu : car ce sont là les premiers de tous les biens, et vous les accordez à la meilleure partie de notre être; aucun d'eux ne vient que de vous ou par vous jusqu'à nous qui en jouissons. Car c'est vous qui recevez au premier et au second degré les biens émanés de Jupiter : vous les recevez les uns égaux en durée à l'éternité, les autres sinon éternels, perpétuels du moins, et absolument purs de tout mélange de maux. Après vous et par vous, nous les recevons à notre tour, mais non plus parfaitement continus et sans intermittence, toutefois perpétuels encore à cause de leur renouvellement successif et de l'immortalité de notre âme. Car vous donnez toute votre sollicitude à cette intelligence, notre attribut le plus divin, qui nous rattache à vous par une sorte de parenté; vous nous poussez sans cesse vers le bien et nous dirigez dans le droit chemin, sachant que nous serons heureux, nous aussi, tant que nous serons capables de marcher sur vos traces et d'atteindre par vous au beau. Mais lorsque, cédant l'empire à notre partie mortelle, nous nous éloignons de vous, lorsque nous cessons de vous suivre et dirigeons mal nos pensées, nous tombons, par suite de cet abandon, dans des fautes, dans des vices, et dans un état aussi malheureux que coupable. Vous alors, vous nous relevez et nous redressez, soit à l'instant même par l'inspiration de sentiments meilleurs, soit en nous frappant de châtiments divers si nos mauvaises dispositions nous empêchent de céder tout de suite à la sagesse qui nous inspire : c'est ainsi que vous nous ramenez au bien de toutes façons, soit pendant, soit après cette vie. Quand il vous arrive de nous punir, c'est pour réparer nos fautes et nous guérir des vices dont il est impossible que nous n'ayons pas une part à cause de cette nature inférieure que vous avez associée à l'autre, mêlant ainsi en nous ce qui semblait incompatible dans les deux natures mortelle et immortelle, d'abord parce que cela vous a paru nécessaire en vue de l'harmonie universelle, ensuite parce que dans cette société générale des êtres vous nous destiniez des fonctions qui ne sont certes ni inutiles ni méprisables. Nous vous rendons grâces à vous qui ne punissez que pour faire le bien, et qui, nous ayant créés immortels par notre côté le meilleur et le plus parfait, nous prodiguez des bienfaits immortels aussi par leur perpétuel renouvellement. Exaucez, ô Dieux, cette prière du soir que nous vous adressons. Si dans cette journée nous avons failli par infraction de vos lois, ou si ayant failli dans notre vie passée, nous n'avons pas encore réparé nos fautes, accordez-nous-en le pardon et faites-nous rentrer dans la bonne voie. Préparez-nous par de bonnes pensées à de bonnes actions, accordez-nous la raison pour distinguer les bonnes pensées des mauvaises, et purifiez-nous ainsi des souillures attachées à notre âme. Donnez-nous, avec le progrès dans le bien, la prompte réparation et le prompt repentir du mal que nous avons commis ou que nous commettons. Qu'un jour enfin, après avoir accompli le temps que vous avez assigné à cette vie, nous jouissions de cette autre vie plus heureuse et plus divine, dans laquelle nous serons délivrés des entraves de notre corps mortel. Car si, pour, nous faire servir de lien à l'ensemble du grand tout, vous nous avez attachés à cette nature périssable, vous nous avez aussi assigné un temps après lequel notre partie supérieure rendue à elle-même, chaque fois que son tour sera venu, entrera dans une existence plus divine et plus conforme à sa nature; elle ira célébrer des fêtes avec ceux qui l'auront précédée, entrera plus intimement en communauté avec ceux d'entre vous dont la nature est plus rapprochée de la sienne, apprendra dans cette société ce qu'il lui importe de savoir, et jouira en tout d'un sort meilleur et plus beau, afin qu'elle ne soit pas toujours remplie des misères de ce corps mortel, mais qu'elle goûte aussi d'une vie meilleure et plus divine, préférable à l'autre sous tous les rapports et notamment par sa durée beaucoup plus longue. Car, par votre nature, en nous donnant les biens, vous êtes toujours disposés à nous les donner plus durables, autant que possible, et plus grands que les maux. Ils seront plus grands surtout lorsque vous nous donnerez, dans cette vie future, de mieux connaître tout ce qui nous concerne, de nous souvenir de nos vies passées soit ici, soit là bas, et de les comparer toutes alors présentes à notre mémoire, elles qui sont aujourd'hui pour nous complètement effacées, parce que nous avons, pendant le premier âge de cette vie, traversé le fleuve de l'oubli, et que le reste du temps, nous sommes enveloppés des ténèbres de notre nature mortelle. Bien plus, nous posséderons alors une prescience plus claire de l'avenir, dont nous avons à peine aujourd'hui une image incomplète, qui nous arrive par l'entremise des Démons, race la plus voisine de la nôtre, alors que le sommeil nous débarrasse du tumulte des sensations, ou qui même parfois se révèle à certains hommes dans l'état de veille par une tension plus forte et une excitation plus divine de leur faculté de penser. Et vous, bienheureux héros, dont la nature s'élevant au-dessus de la nôtre se rapproche le plus de la divinité, vous qui, pendant votre séjour sur cette terre, êtes pour le genre humain les auteurs visibles des grands biens qu'il plaît aux Dieux de lui envoyer, salut à vous. Salut encore à vous, nos ancêtres, nos parents, qui êtes pour nous des images de la divinité, comme auteurs immédiats de notre nature mortelle; à vous aussi, familiers et commensaux, confrères et parents, qui plus vieux ou plus jeunes que nous, êtes entrés avant nous dans la vie plus heureuse qui nous attend ; et vous tous, compagnons et amis, et vous, nos concitoyens, vous notamment qui avez bien présidé à nos intérêts communs, vous surtout qui avez fait le sacrifice de votre vie pour la liberté de vos compatriotes et de ceux qui pensent comme vous, ou pour le maintien de leur prospérité, ou au besoin pour sauver la chose publique en danger. Honneur à vous tous, et lorsque la volonté inébranlable des Dieux nous appellera, comme elle vous a appelés, faites-nous un accueil doux et favorable, voyez en nous des amis qui viennent trouver des amis. Et vous tous, Démons, principalement ceux d'entre vous dont l'espèce est la plus rapprochée de la nôtre, et au-dessus de vous, Pluton, protecteur de la nature humaine, soyez bienveillants pour nous, assistez-nous ici-bas, afin que nous devenions bons et honnêtes, et quand nous irons là où vous êtes, au temps fixé, accueillez-nous favorablement. Vous tous, Dieux qui veillez sur nous, protégez-nous aujourd'hui et toujours, pour que la vertu dirige notre conduite, et cette nuit faites-nous trouver sur une couche pure, exempte de toute souillure déshonnête, le repos indispensable à notre nature mortelle. Inspirez-nous heureusement pendant notre sommeil ; unissez-vous en songe à notre âme pour la diriger, et réveillez-nous demain à l'abri de toute influence pernicieuse, disposés à marcher dans cette bonne voie qui nous conduira au bien et à tout ce qui vous plaît. Accordez-nous de faire en tout ce qui est bien, et entre autres choses de chanter convenablement vos louanges, et avec vous et par-dessus vous de bien célébrer le grand Jupiter. Ο Jupiter, qui ne procèdes que de toi-même, père et auteur immédiat de tous les Dieux nés sans mère, des Dieux supra célestes ; premier auteur aussi de tout ce qui existe, même par voie de procession médiate ; ô roi véritablement suprême et souverain, qui seul indépendant tiens sous ta dépendance toutes les puissances, ô maître le plus absolu de toutes choses, tu es grand, d'une grandeur réelle et supérieure à tout; l'Univers est plein de ton pouvoir et de ta magnificence. Sois-nous propice, conserve-nous, gouverne-nous avec cet Univers selon ce que tu peux vouloir pour nous de plus favorable dans ta bonté parfaite et en même temps selon l'arrêt fixé de toute éternité.
Chapitre XXXV. — Hymnes aux Dieux.
Hymne Ier, annuel ou pour toute l'année, à Jupiter.
Jupiter, qui es ton père à toi-même, premier et universel créateur, roi tout-puissant qui domines sur tous les êtres et qui les gouvernes tous, qui es l'être, l'unité, le bien même, qui de toute éternité as fait toutes les choses existantes, les plus grandes par toi-même, les autres par celles-ci, en donnant à toutes le plus haut degré de perfection possible, sois-nous propice, protège-nous, en nous guidant avec tout le reste de la nature par le ministère de tes fils toujours vénérables, auxquels tu as départi ton autorité, en sorte que nos destinées s'accomplissent telles qu'elles doivent être et telles que tu les as fixées toi-même.
Hymne II, également pour toute l'année, aux Dieux.
Fils vénérables de Jupiter, de ce Dieu qui existe par lui-même et qui a tout créé, vous qui nous gouvernez sous son autorité avec justice, faites que nous ne cessions jamais de vous prendre pour guides et d'obéir selon notre pouvoir aux lois que vous approuvez et qui seules peuvent nous diriger dans la bonne voie. Réglez vous-mêmes l'esprit qui nous conduit et que vous avez créé d'une nature semblable à la vôtre ; accordez-nous de bien ordonner en tout notre vie, mais surtout de bien célébrer avec vous le grand Jupiter.
Hymne III, le premier des hymnes mensuels, à Jupiter.
Le grand Jupiter, véritable Janus, qui est son père à lui-même, père suprême de tout ce qui reçoit l'être et la naissance, n'a rien produit par une création instantanée; mais depuis qu'il existe lui-même, il fait ses créatures semblables à lui, n'étant jamais inactif et, dans le bien qu'il fait, ne restant jamais au-dessous de sa puissance, ainsi qu'il convient à sa nature puisqu'il est par essence le bien même. Salut, Jupiter, roi tout-puissant et souverain ; salut, Dieu infiniment heureux ; salut, généreux dispensateur de tous les biens.
Hymne IV, le deuxième des hymnes mensuels, à Neptune.
Ο grand roi, le premier né de Jupiter, Neptune, qui l'emportes par la beauté et par la force sur toute créature émanée de Jupiter; ta puissance dirige et gouverne toutes choses en second ordre après ton père, qui l'emporte infiniment sur tous les êtres, comme étant, seul de tous, absolument incréé. C'est à toi que la volonté de ton père a confié la création de ce vaste ciel dans lequel tu nous as placés. Ο notre père, sois donc toujours pour nous bienveillant et propice.
Hymne V, le troisième des hymnes mensuels, à Junon.
Junon, auguste déesse, fille du grand Jupiter, épouse de Neptune qui est le beau par essence, mère des Dieux qui habitent l'enceinte du ciel, toi qui produis la matière, et donnes aux espèces existantes dans ce monde le siège de toutes leurs facultés, notamment de celles qui les portent au bien et au beau ; c'est encore toi qui donnes au monde les lois selon lesquelles s'effectue la propagation des êtres et par là leur perpétuité : accorde-nous de bien vivre, et que ta bonté nous inspire la vertu.
Hymne VI, le quatrième des hymnes mensuels, aux Dieux de l'Olympe.
Neptune roi, le plus noble fils du grand Jupiter, toi qui as reçu de ton père le gouvernement de toute la création; et toi, Junon, sa chaste épouse, reine également bienveillante ; Apollon, Diane, et vous aussi, Vulcain, Bacchus et Minerve; vous les sept divinités supérieures à toutes les autres après le maître suprême et souverain ; et vous tous habitants de l'Olympe, pères des créatures immortelles et entre autres des âmes humaines, soyez-nous bienveillants et propices.
Hymne VII, le cinquième des hymnes mensuels, à Apollon.
Apollon roi, toi qui règles et gouvernes l'identité en toute chose, qui établis l'unité entre tous les êtres, qui soumets aux lois de l'harmonie ce vaste Univers, si varié, si multiple, c'est encore toi qui établis l'accord entre les âmes et en fais sortir la sagesse et la justice, les plus précieux des biens ; c'est toi qui donnes aux corps la santé et la grâce. Inspire donc toujours à nos âmes l'amour des beautés divines; salut, ô Péan.
Hymne VIII, le sixième des hymnes mensuels, à Diane.
Diane reine, toi qui règles et gouvernes la diversité, tu as reçu l'Univers dans son unité primitive, et tu le divises ensuite jusqu'aux limites du possible d'abord en espèces, puis les espèces en individus, enfin chaque tout en ses parties. En séparant les âmes de la partie grossière qui les accompagne, tu leur donnes la force et la prudence, en même temps que tu donnes aux corps la vigueur et la bonne constitution qui les cou-serve. Ο Déesse vénérable, accorde-nous de fuir tout ce qui est mal, et dirige les différents actes de notre vie trop sujette à l'erreur.
Hymne IX, le septième des hymnes mensuels, aux Dieux du ciel.
Ο Soleil, roi de notre ciel, sois-nous propice; toi aussi, sois-nous propice, Lune, vénérable déesse ; et toi, Lucifer (astre de Vénus), et toi Stilbon (astre de Mercure), tous deux compagnons assidus de l'éclatant Soleil, et vous, Phénon, Phaéton, Pyroïs (astres de Saturne, de Jupiter, de Mars), qui tous obéissez au Soleil, votre roi, et qui l'assistez, en tout ce qui convient, dans le gouvernement des choses humaines, nous vous célébrons comme nos brillants protecteurs, avec les autres astres qu'une providence divine a lancés dans l'espace.
Hymne X, le huitième des hymnes mensuels, à Minerve.
Minerve reine, toi qui régis et gouvernes la forme concrète non séparée de la matière, c'est toi aussi qui la produis, après le puissant Neptune qui tire de toi toute forme ; tu es aussi la cause de tout mouvement communiqué par impulsion ; enfin tu repousses de chaque chose tout ce qui serait inutile ou superflu. Toutes les fois que notre folie nous portera à commettre quelque faute, que tes inspirations, ô Déesse, d'accord avec celles de l'intelligence, ramènent notre âme au devoir.
Hymne XI, le neuvième des hymnes mensuels, à Bacchus.
Bacchus, que toutes les âmes raisonnables, tant celles des Dieux du ciel et des Démons que celles des hommes, reconnaissent comme leur père, toutefois après le puissant Neptune, c'est toi qui es la cause du mouvement produit par l'amour de la vertu et l'aspiration vers le mieux. Si quelquefois, par un égarement de notre esprit, nous cessons de tenir une conduite digne des Dieux, accorde-nous d'être aussitôt ramenés au bien par la raison, et ne nous laisse pas trop longtemps errer loin de la vertu.
Hymne XII, le dixième des hymnes mensuels, aux Titans.
Allons chantons le créateur de toute la nature mortelle, Saturne roi, fils de Jupiter, le plus ancien de ses enfants illégitimes, qui sont les Titans, Dieux du Tartare. Nous les chanterons aussi avec lui : car tous sont bons et exempts de tout mal, quoiqu'ils aient créé des êtres mortels et sujets au mal. Chantons aussi Vénus, épouse sacrée de Saturne, Pan qui préside aux animaux, Cérès aux plantes, Proserpine à notre nature mortelle, enfin tous les autres.
Hymne XIII, le onzième des hymnes mensuels, à Vulcain.
Vulcain roi, toi qui marches à la tête de tous les Dieux supra célestes, de ceux de l'Olympe et du Tartare, chef de toute cette classe d'êtres après le tout-puissant Neptune, toi qui fixes à chacun son domaine et sa place, qui maintiens dans son identité l'ensemble des choses et chacune de ces choses en particulier, leur donnant ainsi l'immortalité de concert avec Neptune, d'après les décrets de son père ; veille sur nous, accorde-nous, une fois venus à l'existence, de rester toujours dans la voie de la vertu.
Hymne XIV, le douzième des hymnes mensuels, aux Démons.
Avec les autres immortels, célébrons aussi les Démons bienfaisants, dont la nature touche immédiatement à la nôtre. Chargés d'exécuter les ordres des Dieux supérieurs en tout ce qui nous concerne, ils répandent sur nous tous les biens qu'ils reçoivent eux-mêmes de Jupiter par l'intermédiaire des autres Dieux. Ainsi les uns nous purifient, les autres nous élèvent au-dessus de nous-mêmes, d'autres nous protègent et nous sauvent en redressant facilement notre esprit. Soyez-nous favorables.
Hymne XV, le treizième des hymnes mensuels, à tous les Dieux.
Jupiter souverainement grand, supérieur à tous les Dieux, créateur tout-puissant et le premier auteur de toutes choses ; vous tous, Dieux de l'Olympe, Dieux du Tartare, Dieux du ciel et Dieux de la terre, accordez-nous, dans le cas où nous commettrions une faute grave, une action impie, d'en être purifiés, et de nous rapprocher de vous, êtres impeccables, afin d'assurer ainsi le bonheur de notre vie. Nous t'implorons par-dessus tous, Jupiter, le plus puissant de tous, toi qui es en même temps, le premier et le dernier des biens.
Hymne XVI, le premier des hymnes sacrés, à Jupiter.
Jupiter est le seul être absolument incréé, il est son principe à lui-même ; créateur et conservateur de l'Univers, il renferme toutes les choses sans exception dans son unité, d'où il les fait sortir chacune séparément pour les faire ainsi contribuer à l'unité de son œuvre, œuvre aussi complète et aussi belle que possible, la seule sur laquelle l'envie n'ait point de prise. Ο Jupiter, dirige-nous donc avec l'Univers, par l'intermédiaire de tes vénérables enfants, vers le but marqué dans ta sagesse; pour cela fais-nous bien commencer et bien finir chacune de nos actions.
Hymne XVII, le deuxième des hymnes sacrés, aux Dieux de l'Olympe.
Allons, chantons Neptune roi, le premier et le plus puissant de tous les enfants de Jupiter, second chef après son père de toute la création, et immédiatement après lui l'auteur de notre propre existence. Avec lui, Junon reine, la première des Déesses nées de Jupiter. Chantons encore tous les Dieux qui habitent l'Olympe, et qui sont les auteurs secondaires et les protecteurs de tout ce qu'il y a d'immortel dans l'enceinte du ciel. Soyez-nous tous propices.
Hymne XVIII, le troisième des hymnes sacrés, à tous les Dieux.
Ο Dieux, vous tous qui, après Jupiter, le Dieu éminemment bon et parfait, êtes comme lui exempts de toute souillure et de tout mal, vous à qui Jupiter a donné pour chef et pour coryphée le grand Neptune, soit que vous habitiez au-dessus ou en dedans du ciel, êtres vénérables, recevez nos hommages ; car nous participons à votre nature, et sommes vos parents, quoique au degré le plus éloigné. Salut, vous qui possédez et dispensez tous les biens ; faites que, sujets au mal par notre nature, nous soyons cependant relevés sans cesse de nos infirmités par tout ce que vous nous accorderez de bien et de beau.
Hymne XIX, le quatrième des hymnes sacrés, à loue les Dieux inférieurs à ceux de l'Olympe.
Ο Saturne roi, qui gouvernes les Titans, ces Dieux supra célestes, et toi qui règnes sur tout notre ciel, Soleil, chef de toutes les autres planètes, vous les deux grandes sources d'où est sortie la race des mortels issue à la fois de Saturne et du Soleil, et vous tous, Titans et planètes, qui obéissez à ces deux divinités et qui vous associez diversement à leurs travaux, nous vous célébrons aussi, car nous tenons de vous de grands biens, et avec vous nous chantons encore les astres fixes et les Démons bienfaisants.
Hymne XX, le cinquième des hymnes sacres, à Plu ton.
Platon roi, chef et protecteur de la nature humaine par la fonction que tu as reçue de Jupiter lui-même, toi qui possèdes, réunis en toi, tous les divers attributs qui se partagent entre nous, protège-nous en toutes choses ici-bas maintenant, et lorsqu'un jour tu nous élèveras vers les régions supérieures. Autour de toi se rangent les héros, dont la nature excelle par-dessus la nôtre, et tous nos autres amis bons et vertueux. Heureux époux de Proserpine, déesse du Tartare, dont la fonction est de nous attacher autant qu'il le faut à la partie mortelle de notre être, sois-nous propice.
Hymne XXI, le sixième des hymnes sacrés, à Jupiter.
Ο Jupiter, puissant par ta force et par tes œuvres, principe de tout bien, créateur de toutes choses, par la vertu de ton intelligence et de ta nature qui est le bien même, nous ne sommes pas étrangers aux biens dont jouissent les Dieux ; mais par la loi de notre nature mortelle, nous sommes capables de tomber dans des fautes, capables aussi de nous en relever. Donne-nous donc d'échapper aux liens dangereux du vice, et, par l'entremise de tes enfants, auxquels tu as confié ce soin, rapproche-nous des hommes justes dont l'intelligence est droite, afin qu'ainsi nous te trouvions toujours bienveillant et favorable.
Hymne XXII, le premier des hymnes quotidiens, se chante le deuxième jour.
Puissé-je ne jamais cesser, ô Dieux bienheureux, de vous rendre grâces pour les biens que je dois à votre bonté et dont Jupiter est le suprême dispensateur. Puissé-je ne pas négliger de contribuer au bien commun de ma race selon mon pouvoir, n'ignorant pas que travailler pour le bien commun, c'est servir mon propre intérêt. Loin d'être jamais l'auteur du mal qui pourrait arriver aux hommes, puissé-je faire leur bien autant qu'il sera en moi, pour approcher ainsi de votre béatitude.
Hymne XXIII, le deuxième des hymnes quotidiens, se chante le troisième jour.
Puissé-je ne pas m'abandonner à un usage immodéré des plaisirs, mais y mettre des bornes telles qu'ils ne puissent être nuisibles ni à mon âme ni à mon corps. Puissé-je, au lieu d'être insatiable de richesses, donner pour mesure à mes désirs les besoins modérés du corps, afin que j'aie le bonheur de me suffire à moi-même. Puissé-je ne pas me laisser prendre aux séductions d'une vaine gloire, et me souvenir que l'opinion des hommes n'a de prix qu'autant qu'elle peut nous porter à la vertu divine et véritable.
Hymne XXIV, le troisième des hymnes quotidiens, se chante le quatrième jour.
Faites, grands Dieux, qu'en présence des maux qui peuvent frapper la partie mortelle de mon être, je ne me laisse pas abattre, mais que je songe à mon âme immortelle, distincte du corps et toute divine. Que les difficultés qui naissent du commerce avec les hommes ne me troublent pas dans l'exercice de ma liberté, et que de mauvaises illusions ne me rendent pas esclave du mal. Toutes les fois qu'il s'agira pour moi de faire le bien, que je n'épargne point mon corps mortel, mais que la plus grande perfection possible de mon âme immortelle soit toujours l'objet de mes soins.
Hymne XXV, le quatrième des hymnes quotidien», se chante le cinquième jour.
Heureux celui qui veille toujours à la perfection de son âme immortelle, n'ayant que peu de souci de son corps mortel, et même, s'il le faut, prêt à le sacrifier. Heureux celui qui ne se rend pas l'esclave des hommes dont la méchanceté le frappe, celui dont l'âme impassible s'élève au-dessus de la perversité de ses ennemis, Heureux celui qui, loin de s'affliger des calamités de cette vie, les supporte sans se plaindre, bornant son bonheur à sa nature immortelle.
Hymne XXVI, le cinquième des hymnes quotidiens, se chante le sixième jour.
Heureux celui qui ne s'attache pas follement aux vaines opinions des hommes, mais qui, n'écoutant que les conseils de sa raison, marche d'un esprit ferme et droit à la recherche de la divine vertu. Heureux celui qui ne poursuit pas aveuglément la possession de richesses sans bornes, mais qui donne pour mesure à ses désirs les besoins raisonnables de son corps. Heureux celui qui se laisse sagement aller au vent favorable des plaisirs permis, tant que son âme n'en peut recevoir de fâcheuses impressions non plus que son corps, et en se conformant toujours aux divines lois de la vertu.
Hymne XXVII, le sixième des hymnes quotidiens, se chante le septième jour.
Heureux celui qui ne cherche point à tout prix son propre avantage, et ne se laisse pas emporter par une passion insensée à faire du mal aux autres hommes, mais qui leur fait au contraire tout le bien passible, semblable en cela aux bienheureux immortels. Heureux celui qui ne néglige pas l'intérêt commun de sa race, mais qui, sachant que les Dieux eux-mêmes s'intéressent au bien général, se garde d'y faire obstacle. Heureux celui qui rend grâces aux Dieux des bienfaits qu'ils lui accordent, et qui, par-dessus tout, remercie Jupiter, source première du bon et du beau.
Ces hymnes en l'honneur des Dieux sont au nombre de vingt-sept en tout, chacun de neuf vers. On les chante sur la mesure de l'hexamètre héroïque, qui est le plus beau de tous les rythmes. En effet, il y a deux sortes de syllabes, la longue et la brève ; la brève toujours d'un temps, et la longue le plus ordinairement de deux temps, mais quelquefois d'un plus grand nombre lorsque les paroles sont chantées. Or le vers héroïque n'emploie que deux pieds, le dactyle et le spondée. Le dactyle est formé d'une longue pour le temps frappé, suivie, de deux brèves pour le temps levé ; le spondée est formé d'une longue pour le frappé et d'une longue encore pour le levé. Ainsi ces deux pieds commençant tous deux par une longue et se terminant au temps levé, étant de plus égaux pour la mesure, donnent à ce rythme un caractère de majesté dont nul autre n'approche.
Chapitre XXXVI. — Instruction pour l'usage des allocutions et des hymnes.
Maintenant que nous avons fait connaître les allocutions et les hymnes, nous devons expliquer la manière de s'en servir, et d'abord le moment qu'il faut choisir pour chaque allocution. Celle du matin doit être faite entre le lever et le déjeuner, pour ceux qui déjeunent, bien entendu ; pour les autres, c'est avant de se livrer à leurs affaires. L'allocution de l'après-midi doit être faite entre le milieu du jour et l'instant du repas; enfin, celle du soir entre le repas et le coucher, excepté les jours de jeûne : car ces jours-là elle sera faite après le coucher du soleil et toujours avant le repas. Telles sont donc les heures marquées pour chaque allocution. Quant aux lieux, ce sont d'abord les temples, et ensuite un endroit quelconque pur de toute souillure humaine, de tout reste mortel humain et de tout ce qui pourrait en contenir.
Voici maintenant la manière de procéder aux diverses invocations. D'abord pour chacune d'elles une proclamation est faite par le héraut sacré, si toutefois il s'en trouve un régulièrement institué par en prêtre pour remplir cette fonction : dans le cas contraire, il en sera désigné un pour la circonstance, soit par le prêtre, s'il y en a un, soit par celle des personnes présentes qui sera la plus respectable par son âge ou à tout autre titre. La proclamation se fait en ces termes : « Écoutez, vous tous qui honorez la divinité ; voici l'heure d'adresser « aux Dieux la prière du matin (ou de l'après midi, ou du soir). Invoquons les Dieux de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme; invoquons-les tous, et en particulier Jupiter qui règne sur eux. » Cette proclamation se fait aux jours consacrés une fois seulement, deux fois aux hiéroménies, et trois fois aux néoménies. Aussitôt, tout le monde doit porter ses regards en haut, se mettre sur les deux genoux, lever les mains en les renversant en arrière, puis chanter : « Ο Dieux, soyez-nous propices. » En même temps qu'on fera cette invocation, il faut adorer les Dieux, d'abord ceux de l'Olympe, en appliquant la main droite sur le sol et soulevant en même temps l'un des deux genoux. L'invocation étant ainsi faite une fois et l'adoration une fois, il faut ensuite adorer de même, mais de la main gauche, tous les autres Dieux en chantant la même formule. En troisième lieu, il faut s'adresser à Jupiter roi en chantant : « Jupiter roi, sois-nous propice, » cette fois se prosterner des deux genoux et des deux mains et appliquer la tête contre le sol. Cette invocation doit être répétée trois fois, et trois fois suivie d'une adoration, mais le tout ensemble ne compte que pour une seule adoration. Tous les jours il faut en user ainsi une fois à chaque allocution ; mais aux hiéroménies il faut répéter le tout trois fois. L'adoration doit être commencée par un prêtre ou par la plus considérable des personnes présentes. De plus, le chant de l'invocation aux Dieux doit être sur le ton hypophrygien dans l'adoration sur la main droite, sur le ton phrygien dans l'adoration de la main gauche, et sur le ton hypodorien dans celle que l'on fait à Jupiter. Ensuite, le héraut sacré fera une nouvelle proclamation en ces termes : « Ecoutons l'allocution qui va être faite, » soit celle du matin adressée aux Dieux, soit la première, la seconde de l'après-midi on la troisième adressée à Jupiter roi, soit enfin celle du soir aux Dieux. Aussitôt tout le monde se mettra à deux genoux, et celui qui aura été désigné par la personne la plus importante de l'assemblée lira pour tous les assistants l'allocution propre à la circonstance.
L'allocution ou les allocutions étant terminées, le héraut sacré fait cette nouvelle proclamation : « Ecoutons les hymnes aux Dieux, et aussitôt on chante les hymnes, aux jours non consacrés sans accompagnement pour l'ordinaire ; mais aux hiéroménies, le plus souvent avec accompagnement de musique. Aux jours non consacrés, on commence toujours par l'hymne mensuel, puis vient celui des hymnes quotidiens qui convient à la cérémonie, et en troisième lieu le premier hymne annuel à Jupiter ; chacun d'eux doit être chanté une fois. Mais dans les hiéroménies on commence par l'hymne sacré qui convient à la cérémonie, et on continue par l'hymne mensuel, à moine que ce ne soit le premier des hymnes mensuels, qui par exception doit précéder tous les hymnes sacrés. Chacun des deux hymnes sera chanté deux fois dans les hiéroménies, et trois fois ensuite l'hymne annuel en l'honneur de Jupiter. Le second hymne annuel, adressé aux Dieux, doit être chanté au milieu des prières de l'après-midi à deux reprises, entre la première et la deuxième et entre la deuxième et la troisième, et chaque fois en entier dans les hiéroménies ; mais aux jours non consacrés, les deux tiers seulement, c'est-à-dire, les six premiers vers, se chantent dans le premier intervalle, et le reste dans le second. Quand les hymnes sont chantés en musique, les deux annuels, le premier et le treizième des mensuels, le premier, le troisième et le sixième des hymnes sacrés se chantent sur le ton hypodorien : car nous assignons cette harmonie à Jupiter roi et à tous les Dieux collectivement, à cause de son caractère de grandeur et parce qu'aucune ne convient mieux à l'expression des sentiments fiers et héroïques. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et onzième des hymnes mensuels, en outre, le deuxième des hymnes sacrés, se chantent sur le ton hypophrygien, parce que nous attribuons aux Dieux de l'Olympe cette harmonie qui tient le second rang pour la grandeur et qui est propre à exprimer l'admiration des belles choses. Le septième, le dixième et le douzième des hymnes mensuels, aussi bien que le quatrième des-hymnes sacrés se chantent sur le ton phrygien, attendu que bous attribuons aux Dieux d'une classe inférieure à ceux de l'Olympe cette harmonie qui pour la grandeur occupe un rang intermédiaire et qui convient à l'expression des sentiments doux et paisibles.
Enfin le cinquième des hymnes sacrés, et tous les hymnes quotidiens lorsque ceux-ci se chantent en musique, reçoivent l'harmonie dorienne, harmonie par nous réservée aux hommes et à celui des Dieux qui préside aux destinées humaines, parce qu'elle a un caractère guerrier et, comme tel, propre à peindre les combats que notre nature fragile a sans cesse à soutenir dans les affaires de la vie.
Les hymnes mensuels étant au nombre de treize et les mois ayant le même nombre, quand l'année admet un mois intercalaire, nous chantons ces hymnes suivant leur rang, chacun pendant le mois qui lui correspond, en commençant au soir qui précède la néoménie et finissant à l'après-midi du dernier jour du mois. Seulement, quand l'année n'a que douze mois, le douzième hymne se chante à l'invocation du soir du douzième mois, et l'hymne treizième aux invocations du matin et du milieu de la journée.
Quant aux hymnes sacrés, comme ils sont au nombre de six, et comme les mois pleins ont juste autant d'hiéroménies, à l'exception seulement du premier et du dernier mois qui en ont davantage, on chante le premier de ces hymnes à la néoménie, le deuxième au huitième jour du mois, le troisième au milieu du mois, le quatrième au huitième jour avant la fin du mois, le cinquième au jour de la vieille lune et le sixième au jour de la vieille et nouvelle lune, en observant que pour le chant des hymnes chaque jour est censé commencer au soir qui précède l'hiéroménie correspondante et finir dans l'après-midi du jour même. Mais lorsque le mois n'est pas plein, comme alors le jour de la vieille lune manque, l'hymne cinquième se chante le soir qui précède le dernier jour, et le sixième le matin et l'après-midi de ce dernier jour.
Le deuxième et le troisième jour du premier mois étant des hiéroménies, le soir qui précède chacun de ces jours on ajoute l'hymne du jour à l'hymne mensuel, à savoir, le premier hymne la veille du second jour, et le second la veille du troisième jour, chacun d'eux par deux fois et en musique, chaque soir appartenant à l'hiéroménie du jour suivant. Le matin même et l'après-midi du deuxième et du troisième jour, on chante les mêmes hymnes et de la même manière que le premier jour du mois. Pendant le reste de cette première semaine du mois nouveau, on chante chaque jour l'hymne quotidien avec l'hymne mensuel, une fois seulement et en musique, quoique la musique ne soit pas d'usage en général aux jours non consacrés, mais seulement aux hiéroménies, où elle s'emploie toujours, à moins qu'on ne manque de musiciens. Les hymnes se chantent de même, une fois et en musique, pendant la dernière partie du dernier mois, du septième au quatrième jour; et aussi la veille et le lendemain de trois hiéroménies spéciales placées dans le corps de l'année, savoir, le huitième jour du quatrième mois, le milieu du septième mois, et le huitième jour avant la fin du dixième. Dans ces jours, quoique non consacrés, on chante une fois en musique l'hymne quotidien du jour. Le quatrième jour avant la fin du dernier mois, c'est-à-dire, la veille au soir des hiéroménies qui le terminent, il faut chanter, avec l'hymne mensuel, le deuxième des hymnes quotidiens, chacun deux fois et en musique. Le matin et l'après-midi du troisième jour on chante le cinquième des hymnes sacrés avant l'hymne mensuel. Le soir qui précède le second jour, on joint le premier des hymnes quotidiens à l'hymne mensuel, et tous deux se chantent deux fois et en musique ; le matin et l'après-midi de ce second jour, on chante les mêmes hymnes et de la même manière qu'au dernier jour du mois. Le jour suivant, qui est celui de la vieille lune, si le mois est plein, le matin et l'après-midi on chante les mêmes hymnes, et le soir le cinquième des hymnes sacrés, puis l'hymne mensuel. Si le mois est cave, et qu'au lieu de la vieille lune, qui manque, on célèbre le jeûne au quatrième jour avant la fin du mois, la veille au soir on chantera le troisième des hymnes quotidiens, et le jour du jeûne on chantera les mêmes hymnes et de la même manière que le dernier jour du mois. Il est bien entendu que l'hymne annuel à Jupiter doit être chanté le troisième et dernier après les autres, toutes les fois que les hymnes…
Chapitre XLIII. — Épinomis ou Conclusion.
Ce que nous nous étions proposé au début de cet ouvrage a été accompli avec le secours de ceux d'entre les Dieux qui président à ce genre de travaux ; à eux ainsi qu'à Neptune leur chef nous faisons hommage de cette œuvre. Elle est achevée dans la mesure suffisante : car nous avons montré quel est le principe de toutes choses, et entre toutes choses quelles sont les natures de premier ordre immédiatement attenantes au principe suprême, quelles sont celles du second et celles du troisième et dernier ordre, quelle place l'homme occupe parmi elles, de quels éléments il est composé, et d'après sa nature quel genre de vie convient à son bonheur. Le bonheur est le but suprême et commun que tous les hommes poursuivent ; seulement tous ne le cherchent pas dans le même genre de vie. Où faut-il le chercher, et par quelle conduite y arrive-t-on, c'est ce que nous avons fait voir en détail, par des idées et des propositions qui ne sont ni faibles ni contestables, mais qui reposent sur trois axiomes fondamentaux. Le premier est que le principe de toutes choses, ce Dieu suprême qui, dans la langue de nos pères, s'appelle Jupiter, est infiniment bon, aucune perfection ne lui manquant pour être le meilleur possible; le second, qu'il doit y avoir un rapport réciproque entre les essences et leur mode de génération ; le troisième enfin que les actes des différents êtres doivent avoir une certaine relation avec leurs essences, et leurs essences avec leurs actes.
Une fois ces principes solidement établis, le premier nous révèle, entre autres vérités importantes, que l'univers coexiste éternellement à Jupiter, que ce merveilleux ensemble restera toute l'éternité immuable dans son état, constant dans la forme qui lui a été primitivement donnée. Il ne serait pas possible, en effet, qu'un Dieu qui est l'essence même du plus grand bien possible, ne produisît pas son œuvre et ne fît aucun bien ; car ce qui est le bien par excellence doit nécessairement faire participer à ce bien d'autres êtres autant que possible; et s'il fait le bien, s'il produit son œuvre, il ne peut pas la faire à moitié, ni produire un ouvrage qui soit au-dessous de sa puissance, ou qui puisse jamais être ou devenir moins parfait que le mieux possible. Car il est évident que si Jupiter changeait quelque chose à l'ordre établi, il rendrait l'ensemble inférieur à ce qu'il est, soit dès à présent, soit plus tard. En effet, si la moindre parcelle du tout est changée, soit qu'elle n'ait pas l'habitude de changer, soit qu'elle change autrement que d'habitude, il est impossible que par cela même l'ensemble ne change pas de figure ; car il ne peut se faire que la même figure se conserve, quand toutes les parties ne demeurent pas dans le même état.
Le second principe nous éclaire sur la constitution des choses divines. Car l'essence de toutes choses se partageant en trois ordres : d'abord la nature toujours la même et essentiellement immuable ; ensuite celle qui est perpétuelle, mais soumise au changement dans le temps; enfin la nature mortelle ; comme il faut à chaque essence une génération propre et conforme à sa nature, nous attribuons la première création au principe de toutes choses, Jupiter; le second ordre de créations à Neptune, qui est le premier dans le premier ordre de substances, et qui se fait aider pour chacun de ses ouvrages par quelques-uns de ses frères légitimes; enfin le troisième ordre de créations au premier des fils illégitimes de Jupiter, Saturne, et au Soleil, le plus puissant des fils légitimes de Neptune, tous deux étant assistés dans cette œuvre, Saturne par ses frères illégitimes comme lui, le Soleil par tous ses frères légitimes appelés Planètes à cause de l'irrégularité de leur cours.
Le troisième principe nous dévoile la nature de l’homme, à savoir, que c'est un composé de deux natures, l'une animale et mortelle, l'autre immortelle et semblable à celle des Dieux. Car, puisque évidemment l'homme accomplit des actes tantôt dignes de la bête et tantôt semblables à ceux des Dieux, il faut nécessairement assigner à ces deux sortes d'actes une substance propre et qui soit en rapport avec eux. Certains actes humains sont semblables à ceux des Dieux, ce sont évidemment les plus importants. En effet, on ne peut dire que pour les Dieux il y ait une occupation plus importante que la contemplation des êtres, dont l'acte principal est l'intuition de Jupiter : or l'homme peut évidemment s'associer à cette contemplation des êtres, il participe même à l'intuition de Jupiter, dernière limite à laquelle les Dieux eux-mêmes puissent parvenir, L'homme a donc besoin d'une substance semblable à celle des Dieux, qui puisse produire des effets semblables à ceux qu'ils produisent, enfin qui soit immortelle, puisque la substance des Dieux est immortelle. Car il ne peut y avoir la moindre ressemblance entre une nature mortelle et une nature immortelle. Comment, en effet, comparer ce qui n'a qu'une puissance d'être imparfaite et bornée avec ce qui en possède une infinie et sans limites ? Aussi est-ce dans l'accomplissement des actes qui conviennent à sa parenté avec les Dieux que nous venons, après plusieurs maîtres illustres, montrer à l'homme son bonheur, le but de cet ouvrage étant de rendre ceux qui écoutent nos leçons aussi heureux qu'il est permis à une créature humaine de l'être.
Que l'homme soit un composé de deux natures, cette vérité nous la démontrons par un autre principe également incontestable, c'est qu'il n'y a pas un seul être qui aille de soi-même au-devant de sa destruction; tous au contraire font leurs efforts pour soutenir et conserver, autant qu'il dépend d'eux, leur existence. Ce principe posé, quand on voit certains hommes se donner la mort, on comprend bien clairement que ce n'est pas la partie mortelle de notre être, qui se tue elle même, mais que c'est l'acte d'une partie différente et meilleure qui ne peut périr avec le corps, et qui ne lui est pas subordonnée comme le sont toutes les espèces mortelles, soumises aux corps auxquels elles sont attachées, et incapables de leur survivre lorsqu'ils périssent. Car si cette partie de notre être dépendait du corps, elle ne lui résisterait ni jusqu'à cet excès de violence, ni dans la moindre chose. Mais ayant une essence propre et qui subsiste par soi-même, dès qu'elle a jugé que la vie commune avec l'élément mortel ne lui serait plus utile (qu'elle ait bien ou mal jugé, peu importe), elle tue ce corps comme lui étant étranger et se délivre ainsi d'un compagnon qui lui paraît fâcheux et incommode.
Ce mélange de deux natures, l'une mortelle et l'autre immortelle, dans l'homme, nous jugeons qu'il a été fait d'après les ordres de Jupiter, en vue de l'harmonie universelle, par les Dieux qui nous ont créés. Ils ont voulu que ces deux éléments de toutes choses,-l'essence mortelle et l'essence immortelle, s'unissent dans la nature humaine qui est placée comme au milieu d'elles. En effet, pour être complet et entier, l'Univers devait contenir, rapprochés et soudés ensemble, ces deux éléments, le mortel et l'immortel ; c'est ainsi qu'au lieu d'être divisé et déchiré il forme un système réellement un. Car, de même que dans l'Univers bien des choses fort différentes entre elles peuvent s'unir grâce à leurs limites communes, de même l'essence mortelle et l'essence immortelle s'unissent dans la nature humaine qui leur sert à toutes deux de limite. Si dans l'homme la partie mortelle restait toujours unie à la partie immortelle, la première deviendrait elle-même immortelle, rendue telle en effet par cette union constante avec la nature immortelle, et l'homme ne serait plus comme il doit l'être la limite entre les deux natures, il rentrerait tout à fait dans la classe des Dieux. Si, d'un autre côté, la nature immortelle s'unissait un instant à la nature mortelle pour l'abandonner le reste du temps, c'en serait fait de cette union des deux natures qui ne serait plus un lien permanent entre les deux éléments mortel et immortel, mais une union passagère, laquelle, une fois l'élément mortel enlevé, serait aussitôt dissoute et dissoudrait avec elle l'harmonie générale. Il reste donc à dire que l'union des deux natures existe partiellement, temporairement, et que chaque fois que le corps est détruit, elles rentrent toutes deux dans leur indépendance respective, ce qui se renouvelle indéfiniment pendant toute l'éternité.
Ces principes ont été professés surtout par les philosophes de l'école de Pythagore et de celle de Platon. Ils ont également inspiré plusieurs législateurs chez d'autres peuples, et ont subsisté chez ceux de nos ancêtres qui ont recueilli par tradition la saine doctrine des Curètes. On les retrouve encore chez Zoroastre et ses disciples. C'est à ce sage, le plus ancien de ceux dont l'existence nous est connue, que nous les attribuons, non que nous pensions cependant qu'il les ait découverts : car ces principes, aussi vieux que le monde, ont existé de tout temps parmi les hommes ; s'ils réunissent tantôt plus, tantôt moins de suffrages, du moins ont-ils toujours ceux des hommes qui se conduisent d'après les principes généraux que les Dieux ont mis dans nos âmes; mais c'est que de tous ceux dont les noms sont venus jusqu'à nous, Zoroastre est le plus ancien interprète de ces dogmes purs : il est, dit-on, antérieur de plus de cinq mille ans au retour des Héraclides. Quant à Menés, le législateur des Egyptiens, qui passe pour antérieur encore de plus de trois mille ans, il ne peut être considéré comme un législateur gage et digne d'estime. Jamais il n'aurait établi une religion aussi chargée de pratiques inutiles et mauvaises, si le fond même de sa doctrine n'eût été vicieux. Si les prêtres qui le suivirent eurent des principes semblables à ceux de Zoroastre, il ne faut pas croire qu'ils les aient reçus de Ménès ; ils les trouvèrent plus tard dans leur recherche de la sagesse, et cependant ils ne purent apporter aucune réforme au culte qu'ils professaient, parce que Menés leur avait imposé une loi utile sans doute et salutaire aux peuples qui ont une bonne législation, mais non à ceux dont les lois sont mauvaises : il leur avait défendu de faire jamais le moindre changement aux lois du pays ; ainsi, tandis qu'eux-mêmes reconnaissaient les vrais principes, ils laissaient le peuple livré à ses pratiques insensées. De plus, quelques autres législations ont pu avoir leurs bons côtés, plusieurs même n'ont pas été sans rapport avec les principes de Zoroastre, cependant elles sont restées loin encore de la perfection. Telles sont les lois des Indiens et des Ibères occidentaux, qui datent presque de la même époque que celles de Zoroastre. Le nom du législateur des Ibères n'est pas venu jusqu'à nous, et il ne s'est rien conservé de leurs lois. Quant aux Indiens, une partie de leur législation subsiste encore, et leur législateur s'appelait Dionysus ou Bacchus. Venu du dehors, il conquit les Indes, y établit son empire, et par la sagesse de ses institutions civilisa, dit-on, les habitants. Un autre Bacchus, fils de Sémélé, né beaucoup plus tard, doit avoir été identique au premier quant à l'âme, ou au moins imitateur de sa vie et de ses principes : tous deux, quoi qu'il en soit, n'ont rien eu de guerrier.
On peut croire à peu près la même chose des deux Hercule, l'un fils d'Amphitryon et d'Alcmène, l'autre né plus anciennement à Tyr, qui tous deux au contraire ont été très guerriers. C'est qu'en effet les périodes de temps amènent et amèneront toujours, à des époques réglées, des vies et des actions identiques, en sorte que jamais rien n'est arrivé de précisément nouveau, rien n'arrive qui ne soit déjà arrivé dans son espèce et ne doive se reproduire un jour.
Quoique aucun peuple ne soit athée, cependant les hommes ont sur la divinité dès opinions très diverses. Il faut donc de toute nécessité qu'il y en ait une toujours la même, qui soit la meilleure ; les autres lui sont inférieures, plus rapprochées ou plus éloignées de la vérité, et quelques-unes nécessairement plus éloignées que toutes les autres. Pour nous, nous restons attachés à la doctrine que nous savons la meilleure, à celle de Zoroastre, professée aussi par Pythagore et par Platon : elle l'emporte sur toutes les autres par l'exactitude, et de plus elle est chez nous nationale. C'est donc à elle seule que nous demandons le plus pur bonheur auquel il nous soit permis de prétendre. Quant aux autres doctrines, plus elles s'éloignent de la nôtre, plus ceux qui s'y attachent s'éloignent du bonheur, et se rapprochent de l'infortune ; et ceux qui professent les opinions les plus différentes de la nôtre sont ceux qui tombent au dernier degré du malheur, puisqu'ils sont plongés dans d'effrayantes ténèbres par leur ignorance des principes les plus importants.
Mais, dira-t-on peut-être, quelques sophistes admirés de la foule promettent hautement à ceux qui les suivent des biens plus grands que ceux que nous annonçons au genre humain; ils promettent une brillante immortalité que ne souillera aucun mélange mortel, tandis que, selon notre doctrine, les âmes ne cesseront pas, chaque fois que leur tour sera venu, d'être attachées de nouveau à quelque corps mortel. Mais, d'abord, il est sage en général de traiter de préférence non avec ceux qui promettent le plus, mais avec ceux qui méritent le plus de confiance, et de même, il ne faut pas préférer les discours qui étalent de plus belles espérances à ceux qui sont plus dignes de crédit. Quel profit y a-t-il à conserver, sur les questions les plus importantes, des espérances brillantes, mais vaines et sans effet, et à se laisser charmer ainsi par de beaux mensonges au lieu d'opinions vraies et saines ? C'est le comble du malheur d'être trompé sur les Dieux et sur les croyances les plus importantes pour l'homme, et d'avoir à ce sujet des opinions contraires à la vérité. Mais d'ailleurs, il ne serait pas étonnant que les destinées annoncées par nous au genre humain parussent à de bons juges préférables encore aux promesses de ces sophistes. D'abord, ces prétendus sages ne reconnaissent une éternité absolue et complète ni à l'Univers, ni à l'âme humaine, accordant aux êtres l'éternité non dans les deux sens, mais dans un seul, celui de l'avenir. Ils avancent que le monde a eu un commencement dans le temps, et qu'il sera soumis au même changement que les choses humaines. Ils croient ainsi faire plus d'illusion à ceux qui les écoutent, d'un côté en soutenant que les choses humaines ne changeront pas seules, mais avec tout l'Univers; d'autre part, en annonçant que le règne du mal doit être court et qu'en suite Dieu donnera aux hommes un bonheur éternel et absolu. Et en effet, cette doctrine est plus spécieuse que s'ils plaçaient une éternité de maux avant une éternité de biens. Pour nous, en reconnaissant à l'âme humaine une éternité entière, non pas amputée et boiteuse, nous lui faisons par cela même une plus belle part. N'est-il pas évident, en effet, que cette immortalité qui embrasse le passé et l'avenir est bien meilleure, bien plus belle que cette immortalité tronquée, et que les natures qui en jouissent sont plus élevées et plus parfaites? Mais peut-être viendra-t-on m'objecter que ce qui est passé n'est plus et qu'on n'aura plus à l'éprouver, tandis que l'avenir, s'il n'est pas encore, ayant cependant, par cela seul qu'il doit être un jour, plus d'existence que ce qui ne doit plus jamais être, lui est en ce sens préférable. C'est ainsi, dira-t-on, que le désir néglige le passé pour se tourner vers l'avenir comme ayant plus d'existence. En conséquence, cette éternité dans les deux sens ne surpassant celle qui embrasse l'avenir que par un non être, n'est en réalité ni plus grande, ni meilleure. Mais nous…
Voici les principes les plus nécessaires à connaître pour qui veut penser en homme sage.
D'abord, touchant les Dieux (I), il faut croire qu'ils existent réellement. L'un d'eux est Jupiter roi, le plu: grand de tous et le meilleur dans la seule limite du possible. Il préside à tout cet univers ; sa divinité est d'un ordre tout à fait à part ; il est lui-même en tout et dans tous les sens incréé, en même temps qu'il est le père et le premier auteur de tous les êtres. Son plus ancien fils, engendré sans mère, est Neptune : c'est le second Dieu, et il a reçu de son père la seconde place dans le gouvernement de toutes choses, et en outre le droit de produire et de créer tous les êtres renfermés dans l'enceinte de notre ciel, toutefois avec le concours et par le ministère d'autres Dieux, dont les uns sont ses frères, nés comme lui sans mère, tous habitant au-dessus du ciel, tant ceux de l'Olympe que ceux du Tartare; d'autres sont engendrés par lui-même, avec le concours de Junon, déesse productrice de la matière : ce sont les Dieux qui habitent dans l'enceinte de notre ciel, savoir, les Astres, race céleste, et les Démons, race terrestre, qui déjà touche immédiatement à l'espèce humaine. Au Soleil, l'aîné de ses enfants, Neptune a confié le gouvernement du ciel et la génération des êtres mortels qui y sont contenus, mais en lui associant, pour l'exercice de ce dernier pouvoir, Saturne, frère et chef des Titans, dieux du Tartare. Une différence entre les Dieux de l'Olympe et ceux du Tartare, c'est que les Dieux de l'Olympe produisent et gouvernent toutes les choses immortelles dans l'enceinte du ciel et que les Dieux du Tartare président aux choses mortelles d'ici-bas. Ainsi Saturne, chef des Dieux du Tartare ou des Titans, préside en même temps au gouvernement de toute créature mortelle. Junon, qui, parmi les Dieux de l'Olympe, est placée la seconde après Neptune, lui fournit pour ses œuvres la matière primitive, éternelle, à laquelle elle-même préside. Quant à Neptune, il gouverne tous les êtres ; chef des immortels et des mortels, il préside à tout, et toutefois il est lui-même coordonné à l'ensemble des choses. Car Jupiter seul, par sa divinité prééminente, domine l'Univers d'une manière tout à fait à part.
Voilà, pour le premier article, le sommaire le plus exact de ce qu'il faut croire. De plus (II), ces Dieux, par leur providence veillent particulièrement à nos destinées, les uns immédiatement par eux-mêmes, les autres par l'intermédiaire des Dieux inférieurs, mais toujours d'après les décrets de Jupiter qui règle toutes choses. (III). Ils ne sont cause d'aucun mal, ni pour nous, ni pour aucun des êtres; au contraire ils sont essentiellement les auteurs de tout bien. En outre (IV), c'est d'après la loi d'un destin immuable, inflexible, émané de Jupiter, qu'ils accomplissent tous leurs actes dans la limite dû mieux possible. Tels sont les principes pour les Dieux.
Quant à l'Univers (V), y compris les Dieux du second et du troisième ordre, il faut croire qu'il est éternel, c'est-à-dire, qu'il est l'œuvre coéternelle de Jupiter, qu'il n'a pas eu de commencement dans le temps et n'aura pas de fin. (VI). Il est composé de parties rassemblées et coordonnées en un seul tout. (VII). Il a été créé de la manière la plus parfaite possible par l'ouvrier infiniment parfait, qui n'y a laissé rien à ajouter. (VIII). Toujours le même dans son état primitif, il se conserve éternellement immuable. Tels sont les principes sur l'Univers.
Quant à nous-mêmes (IX), notre âme étant d'une nature semblable aux Dieux, demeure immortelle et éternelle dans l'enceinte qui est la limite de notre monde. (X). Toujours attachée à une enveloppe mortelle, elle est envoyée par les Dieux, tantôt dans un corps, tantôt dans un autre, en vue de l'harmonie universelle, afin que l'union de la nature mortelle et de la nature immortelle dans la nature humaine contribue à l'unité de l'ensemble. (XI). Pour être à la hauteur de notre nature divine, nous devons considérer le beau et le bien comme la fin qui convient à notre vie. Enfin (XII), les Dieux, en fixant les lois de notre existence, ont placé notre bonheur dans la partie immortelle de notre être qui en est aussi la plus importante.
Voilà, sur les Dieux, sur l'Univers et sur la nature humaine, les douze principes qu'il faut connaître et admettre si l'on veut penser le mieux possible et mériter vraiment le nom de sage.
L’abaissement (a) de la voix est un mouvement vers le grave; son élévation(b) est un mouvement vers l’aigu; et le ton (c) est l’intonation est une station de la voix sur le même degré, soit de gravité, soit d’acuité. Les sons graves se forment dans les régions inférieures de l’organe, aux environs du larynx; les sons aigus, dans la partie supérieure, vers le palais. La moindre partie d’une émission mélodique de la voix se nomme un son (d). On distingue, quant à la durée, celle de la syllabe brève, qui est d’un temps, et celle de la syllabe longue, qui est de deux temps pour l’ordinaire, bien qu’elle puisse en avoir davantage dans la poésie chantée.
L’intervalle est la grandeur ou l’étendue vocale comprise entre deux sons. L’intervalle le plus simple et le plus fondamental est le ton (e) : c’est celui qui a pour définition et pour mesure le rapport de 9 à 8. La quarte ou le système épitrite se compose de deux tons et d’un demi-ton (au reste, quand nous disons d’un demi-ton, c’est une manière de parler: car, à la rigueur, cet intervalle est un peu moindre). Le plus petit intervalle perceptible aux sens est le diésis, valant à peu près un quart de ton; il est, en nombres plus exacts, représenté par le rapport de 33 à 32 (f): c’est un intervalle très difficile à moduler; et il n’est pas donné à tout le monde d’y parvenir. Le système épitrite est celui qui tient le premier rang; c’est dans ce système, conjointement avec le système hémiole, que tous les autres se résolvent; le rapport hémiole surpasse l’épitrite d’un ton
L’arsis est l’emploi d’un son aigu succédant à celui d’un son grave; la thésis, au contraire, l’emploi d’un son grave après celui d’un son aigu (g). L’étendue de la voix humaine, depuis le son le plus grave qu’elle peut rendre, jusqu’au plus aigu, atteint jusqu’au rapport quadruple [c’est-à-dire jusqu’à la double octave]: elle est donc de 12 tons, [ou, plus exactement de 10 tons] et 4 demi-tons. En effet, l’intervalle mesuré par le rapport double [ou l’octave] est de 6 tons, [ou, plus exactement, de 5 tons] et 2 demi-tons, et il comprend deux systèmes, l’épitrite [ou la quarte] et l’hémiole [ou la quinte], ou bien encore, deux fois le rapport épitrite, plus un ton. Telle est donc la composition de l’octave, mesurée par le rapport double.
Le plus beau de tous les mètres est le dactylique : il y a dans sa marche quelque chose d’égal et de noble d’où il tire sa supériorité. Il dérive de deux pieds seulement, le dactyle et le spondée : le premier, composé d’une longue à la thésis et de deux brèves à l’arsis; le second, d’une longue à la thésis et d’une longue à l’arsis. Or, ces deux pieds commençant ainsi toujours par une longue et finissant toujours par l’arsis, il en résulte dans le chant un caractère remarquable de noblesse et de dignité. Ce mètre emploie aussi la synecphonèse (h) : on nomme ainsi la figure par laquelle deux syllabes quelconques, pourvu qu’il n’y ait pas de consonne dans le passage de l’une à l’autre, sont prises pour une seule longue.
Quant aux syllabes, les unes sont longues, d’autres sont brèves, d’autres encore sont communes. — Une syllabe est longue par nature quand elle emploie dans son émission une voyelle longue, c’est-à-dire de deux temps distincts, ou bien une diphtongue; elle est longue par position lorsque, brève d’ailleurs par nature, elle est suivie de deux consonnes ou d’une seule consonne double. — La syllabe est brève par nature lorsque son émission s’opère au moyen d’une voyelle brève, ou même d’une voyelle de deux temps réduits à un seul. — Enfin, la syllabe commune petit naître de ces [quatre] manières:
1° Lorsqu’elle est émise en deux temps qui ne sont précisément ni distincts ni réunis car un, mais qui participent des deux modes;
2° Lorsqu’étant brève par nature, elle est suivie de deux consonnes dont la première est muette et la seconde immuable [ou liquide], tontes deux réunies par syllepse (i);
3° Lorsqu’étant la dernière d’un mot et longue par nature, elle est suivie d’une voyelle;
Et 4° lorsqu’étant la dernière d’un mot et brève par nature, elle est suivie d’une consonne ou d’une voyelle aspirée.
Sur ces quatre manières dont se produit la syllabe commune, il y en a deux, la troisième et la quatrième, qui, comme la synecphonése, sont particulières au mètre dactylique. Ce mètre se mesure monopodie, et alors il constitue l’hexamètre parfait; ou bien c’est le vers élégiaque, dactylique aussi, mais partagé alors en deux segments comprenant chacun deux pieds et une syllabe supplémentaire. Il est de rigueur que la syllabe supplémentaire du premier segment soit longue, et que les pieds du second soient tous deux des dactyles.
Le mètre dactylique parfait est susceptible de trente-deux formes, comme on le verra par le calcul suivant.
D’abord, pour le dernier pied, le spondée est toujours exigé; toutefois on peut aussi bien y admettre le trochée, vu la nature arbitraire de la dernière syllabe en toute sorte de mètres. Ainsi donc, à l’égard du dernier pied, il n’y a lieu d’y appliquer de distinction de forme, puisque, dans tous les cas, ce pied compte pour un spondée. Mais pour les cinq autres pieds, comme on petit admettre toutes les permutations que sont susceptibles de présenter le dactyle et le spondée, il en résulte les trente-deux formes en question, ainsi qu’on va le voir;
En premier lieu, les cinq pieds peuvent être tous à la fois des dactyles: cela fait une première forme. De même ils peuvent être tous des spondées: c’en est une seconde. Si un seul pied est un dactyle et les quatre autres des spondées, le dactyle pouvant occuper cinq places différentes, cela fait cinq formes. Même nombre de formes si l’un des cinq pieds est tin spondée et les autres des dactyles.
Maintenant, il peut y avoir deux dactyles, successifs ou non successifs, et trois spondées, ce qui fait dix nouvelles formes.
Dix autres formes encore s’il y a, de même, deux spondées et trois dactyles.
Telles sont les variétés de formes que présente le rythme de ce mètre (j).
Observations sur le morceau précédent.
(a) Mot à mot: le relâchement (ἄνεσις).
(b) Mot à mot l’accroissement de tension (ἐπίτασις).
(c) Mot à mot: la tension (τάσις).
(d) En grec, (φθόγγος).
(e) Si un intervalle diminue jusqu’à se réduire à sa limite inférieure la plus petite, on a ce que l’auteur appelle la moindre partie de la voix modulée, c’est là, pour les anciens, le son musical.
(f) La leçon du manuscrit d’Athènes, donne pour valeur du quart de ton le rapport 35 : 34, tandis que le texte du manuscrit de Munich suivi par nous, donne 33: 32. Nous trouvons dans le manuscrit grec 3027 de la Bibl. impér. f° 33, un diagramme propre à faire comprendre comment s’obtiennent ces sortes dévaluations. Ou partage le rapport de 9 à 8 en deux autres, ainsi qu’il suit 9/8 = 18/16= 18/17 x 17/16. En considérant les deux fractions 18/17 et 17/16 comme étant égales, elles mesureront le demi-ton. Puis on opère de même sur celles-ci pour avoir des quarts de ton, et l’on a 18/17 x 17/16 = 36/35 x 35/34 x 34/33 x 33/32. (Voyez les Notices et extraits des manuscrits, t. XVI, 2 part., p. 236)
(g) L’acception que l’auteur donne ici aux ἄρσις et θέσις ne prouve pas qu’il soit bien versé dans la doctrine des anciens: il faudrait dans le texte τάσις et ἄνεσις, à moins que l’auteur n’ait voulu indiquer l’accent aigu et l’accent grave.
(h) Le mot grec que nous francisons ici (συνεκφώνησις) signifie proprement coémission de plusieurs voix. Cette figure se nomme autrement συνίζησις, comme l’indique un petit scholie en marge du manuscrit d’Athènes. Exemple en latin : suavis, prononcé en deux syllabes. (Cf. Héphestion, éd. Gaisford, pages 20, 152, 194, 220; Isaac Monachus, ms. 2731, f° 195 v.; Bachmann, Anecd., t. II, p. 169 et suiv.
(i) La syllepse dont il s’agit ici n’est pas celle des grammairiens : c’est la fusion de deux consonnes en une seule articulation, ce qui n’empêche pas la voyelle précédente d’être brève si l’on veut, comme dans ἔκλεψα il n’en serait pas de même dans ἐκλέγω.
(j) On arrive beaucoup plus simplement à ce résultat par la considération du nombre des permutations que produisent cinq objets placés à la suite l’un de l’autre sous la condition que chacun d’eux soit à volonté blanc ou noir. On reconnaît immédiatement que le produit doit être représenté par la cinquième puissance de 2, c’est-à-dire par le nombre 32.
Sur les modes musicaux adoptés par Pléthon.
Il est nécessaire, pour avoir une connaissance complète du système liturgique de Pléthon, de savoir au juste ce qu’il entend lorsqu’il parle des modes phrygien, dorien, hypophrygien et hypodorien, les seuls qu’il admette dans son Rituel.
D’abord, sur ce point comme sur tous les autres, il se montre essentiellement éclectique, puisqu’il rejette les autres modes de la musique ancienne, affectant de suivre servilement les préceptes de Platon, qui, au IIIe livre de République, proscrit tout autre mode que le dorien et le phrygien. Mais Pléthon ne s’est-il pas conformé bien plus à la lettre des paroles qu’à la pensée même de son maître? c’est ce qu’il est permis de croire.
En effet, notre auteur, qui tenait à remonter autant que possible aux sources antiques, doit nécessairement avoir voulu désigner, par le mot φρυγιστί, l’octave phrygienne, ou l’octave de ré qui correspond au mode protus du chant ambrosien; par le mot δωριστί, l’octave dorienne, ayant mi pour note extrême, et correspondant au deutérus de l’Église latine; par le mot ὑποδωριστί, l’octave hypophrygienne, caractérisée par la note sol et correspondant au tétartus;[206] et enfin, par le mot ὑποφρυγιστί, l’octave hypodorienne comprise entre deux la.
Mais, l’étendue et les limites d’une échelle mélodique ne suffisant pas pour déterminer le caractère de la mélodie indépendamment du choix de la note finale, qui en est en quelque façon le véritable sceau, nous en sommes à cet égard réduits aux conjectures; et le silence de Pléthon semble indiquer et même exiger l’adoption de la plus simple et de la plus naturelle (le toutes les hypothèses que l’on peut faire sur le sujet, laquelle consiste évidemment à prendre pour finale la note grave de chaque octave, précisément comme cela a lieu dans les modes authentiques du chant ambrosien.[207]
Il résulte de là que, pour connaitre le véritable caractère des anodes de Pléthon, ce n’est point aux noms mêmes imposés à ses modes que l’on doit s’attacher; mais il faut au contraire rechercher ce caractère dans les modes antiques qui ont pour mèses respectives les notes finales des modes de Pléthon, c’est-à-dire, comme on l’a vu ci-dessus, lés notes ré, mi, sol, la.
Or, la note ré est la mèse de l’hypodorien antique, la note mi celle du mixolydien, la note sol celle du phrygien, et enfin la note la celle du dorien. Ces quatre derniers modes sont donc véritablement les modes antiques que Pléthon adoptait Jour sa liturgie, et ceux dont le caractère résout la question qui nous occupe.
Mais déjà, dans plusieurs circonstances, j’ai eu l’occasion de faire la comparaison des deux séries de modes : je me bornerai donc à y renvoyer.[208] Qu’il me suffise ici de résumer les résultats de mes recherches sur ce sujet, en disant: 1° que le mode hypodorien de Pléthon, celui qu’il attribue Jupiter, correspond exactement à notre mode mineur (repos sur la note la, A de la notation germanique); 2° que le mode hypophrygien de Pléthon, celui qu’il attribue aux Dieux de l’Olympe, correspond à notre mode majeur sans note sensible (la mélodie faisant son repos sur la note sol, G des Allemands) : c’est le mode que l’Église latine nomme angélique; 3° que son mode phrygien, hypodorien antique, celui qu’il attribue aux Dieux inférieurs, correspond aussi à notre mode mineur avec sixte majeure (finale ré ou D): c’est celui que l’Église latine nomme mode grave; 4° enfin, que dans le dorien de Pléthon on reconnaît bien le mixolydien antique (finale E ou mi), mode que l’Église latine nomme mystique, et dont le musicien Blainville avait essayé la résurrection il y a un siècle, sous le nom de mode mixte. Il me semble même qu’il ne serait pas déraisonnable de voir dans l’expression εὐόλισθον, une sorte d’allusion à la nature changeante de la note si, tantôt bécarre, tantôt bémol (bfa bmi des musiciens du moyen Age), changement inhérent spécialement à ce mode à cause de la fréquence du triton qui lui est propre, de même que le mot mixolydien faisait allusion au mélange dont cette double valeur de la paramèse du système grec affectait le mode lydien. C’est là, si je ne m’abuse, une notable confirmation, fournie par Pléthon lui- même, de l’explication que je donne ici de sa théorie.
Peut-être croira-t-on apercevoir une difficulté en ce point, que c’est sur une comparaison avec le chant latin que cette explication est fondée. Mais nous répondrions à l’objection en faisant observer que le chant latin a lui-même pour base la théorie grecque, et que les chants dits ambrosien et grégorien sont réglés sur l’échelle du genre ditonié, et conformes par conséquent au diagramme de Platon, ce que confirment les règles données par les auteurs ecclésiastiques latins pour la division du monocorde et le calcul, des longueurs des tuyaux de l’orgue (M. Gerb. Script. eccles. de musica sacra, tom. II, p. 279 et suiv.).
Notre explication est donc parfaitement légitime. De plus, et pour les mêmes raisons que nous avons données ci-dessus, Pléthon a dû rejeter les genres chromatique et enharmonique des Grecs anciens comme des Grecs modernes, aussi bien que les nuances du genre diatonique différentes du ditonié, le seul admis par Platon.
Cette conclusion nous dispense d’entrer dans aucun détail sur le caractère esthétique de la musique pléthonienne, puisqu’il suffira de recourir aux documents que nous avons indiqués plus haut, pour s’en faire une idée aussi exacte que possible. Cependant on doit trouver assez remarquable que, tout en prenant pour guide et pour base des dénominations qu’il semble avoir mal interprétées, notre auteur n’en soit pas moins arrivé à composer son système des modes les plus nobles de la musique ancienne.
A. J. H. VINCENT.
[1] Pour un ouvrage plus récent, cf. Brigitte Tambrun, Pléthon le retour de Platon, éd. Vrin, 2007.
[2] Allatius, de Georgiis, dans la collection Byzantine, à la suite de George Acropolite, Par. 1651, fol. et depuis, avec des retranchements et des additions, dans la Bibliothèque grecque de Fabricius, tom. X, ancienne éd. ; tom. XII, éd. Harl.
[3] Tom. II, p. 775, et suiv.
[4] On chercherait en vain l'opinion de ces deux savants dans les notes qu'ils ont ajoutées au traité d'Allatius, cité plus haut, ou à celui de Renaudot sur Gennadius, inséré dans le même tome X de la Biblioth. gr.; tom. XI, éd. Harl.
[5] Préface aux fragments de Pléthon, dans le tom. III du catalogue des mss. grecs du roi de Bavière, Munich, 1806, 4° : « Quae fragmenta vel sola demonstrant contra affectatas quorumdam calumnias, eum eloquentissimum fuisse simul et omni scientiarum genere instructissimum. Ex sequenti autem prologo auctoris liquet illum nonnisi Zoroastricam et Platonicam theologiam simul et philosophiam explicare voluisse. Hinc religiosus nimium patriarcha religioni nostrae timere haud debuit. » Notre publication permettra d'apprécier ce jugement de M. Hardt.
[6] Gennadius und Pletho, Aristotelismus und Platonismus, von W. Gass, Breslau, 1844, 8°, première partie, p. 35 et suiv.
[7] M. Jahn a bien voulu me fournir en outre plusieurs autres morceaux inédits, empruntés à la même bibliothèque, qui figurent à la fin de ce volume dans notre Appendice.
[8] M. Le Barbier devait ce manuscrit à l'obligeance du patriarche grec de Jérusalem à Constantinople. En le citant, ce qui m'arrive souvent, je l'appelle toujours manuscrit d'Athènes, par allusion à la source d'où il m'est venu et à une école dont le nom réveille en moi de précieux souvenirs.
[9] Bessarion, qui avait vécu longtemps dans son intimité, l'appelle formellement Pléthon Constantinopolitanus, dans le début de son traité de Natura et arte. Les titres des manuscrits de ses ouvrages et les mémoires du temps le désignent souvent par l'épithète de Byzantin.
[10] On n'arrive à cette date qu'approximativement, en combinant l'époque probable de sa mort avec l'âge presque centenaire qu'on lui attribue ; nous y reviendrons.
[11] Ces détails ne nous sont connus que par la lettre de Gennadius à Joseph l’Exarque, que nous aurons souvent occasion de citer. Nous disons qu'il fut oblige de quitter Constantinople. Quant à la ville où il se réfugia, et où était cette cour barbare, ce ne peut être qu'Andrinople, résidence ordinaire des sultans depuis 1366, quoique le siège officiel de l'empire n'y ait été définitivement transféré de Broussa (l'ancienne Pruse) qu'assez longtemps après (Phranza, livre I, ch. 30). Sur le juif Elisée, nous n'avons trouvé nulle part aucun renseignement.
[12] Ce traité a été imprimé plusieurs fois, et on en a fait deux traductions latines. Nous avons eu entre les mains deux éditions de Bale, 1552 et 1586, in-8°, avec la traduction d'Adolphe Occon. C'est toujours la grande division classique en quatre vertus principales avec les sous-divisions. Comme il est rédigé à la manière d'Aristote plutôt que de Platon, nous le croyons un des premiers ouvrages de l'auteur.
[13] Titre cité par Allatius, de Georgiis, dans Fabricius, tom. XII, p. 90, éd. Harl., avec les premiers mots de l'ouvrage. Nous trouvons un autre traité du même genre indiqué dans un autre catalogue donné par Fabricius, tom. V, p. 797, même éd., sous ce titre. Mais ces morceaux pourraient se rapporter aussi à une époque beaucoup plus avancée de la vie de leur auteur, à celle de sa controverse sur le platonisme. Ne les ayant pas vus, nous sommes réduits à de simples conjectures.
[14] Dans notre Appendice, pièce I. Il est curieux de comparer cette prière, encore chrétienne et orthodoxe, avec les hymnes païens du Traité des lois.
[15] Le plus connu de ces ouvrages est l'Histoire de la Grèce après la bataille de Mantinée (depuis la mort d'Epaminondas jusqu'à celle de Philippe), imprimée à Venise, en 1503, à la suite du Xénophon des Aldes, et plusieurs fois depuis, morceau estimable, composé principalement avec les matériaux fournis par Diodore et par Plutarque. On ne peut citer comme des ouvrages les extraits d'auteurs anciens simplement copiés ou abrégés par Pléthon, tels que les extraits de Xénophon, de Polybe, de Diodore, d'Arrien, de Procope, de Zonaras, pour l'histoire ; de Strabon et de Ptolémée pour la géographie; de ce dernier pour l'astronomie; de Théophraste pour l'histoire nat.: d'Aristoxène et d'Aristide Quint, pour la rythmique. Mais il existe en outre quelques traités sortis de la plume même de Pléthon, traités de philosophie, de rhétorique, de géographie, d'astronomie, avouons-le même, d'astrologie, les uns déjà imprimés, la plupart inédits et épars dans les bibliothèques : on peut consulter à leur sujet Allatius, de Georgiis, déjà cité; Fabricius avec les notes de Harles, Bibl. gr., tom. VIII, p. 80, et tom. XII, p. 87, sqq. ; les catalogues des grandes bibliothèques, notamment de celle de Saint Marc à Venise, par Morelli, p. 245, sqq. et 269, sqq. ; Kollarius, de codd. mis. Georgii Gemisti operum, dans le supplément à Lambécius, p. 553, sqq. Un petit morceau que nous trouvons indiqué par M. Miller, p. 379 de son catalogue, parmi les mss. perdus de l'Escurial, sous ce titre : « Oraison funèbre des guerriers morts dans le Péloponnèse, par Gémistus Pléthon, » n'était sans doute qu'un extrait de Thucydide, copié et peut-être commenté par Pléthon : il rentrerait ainsi dans la classe de ses compilations historiques. Quant à ses travaux sur Zoroastre, qui tiennent de plus près à notre sujet, et aux autres opuscules composés dans sa vieillesse, nous aurons occasion d'en parler plus tard.
[16] Ces deux Mémoires, dont le premier se trouve manuscrit à la Biblioth. de Paris dans le n° 60 (suppl.), parurent à la suite des Eclogues de Stobée, édit. de Canter, Anvers, 1575, in-fol. ; ils n'ont pas été réimprimés. Au commencement du premier, Gémistus félicite l'empereur d'avoir enfin reconquis par la valeur de ses Mis tout le Péloponnèse. Cela ne peut s'entendre que de la soumission des derniers seigneurs italiens et catalans de l'Achaïe (Ducas, chap. 20, p. 102, éd. Bonn), fait qui se rapporte au dernier voyage de l'empereur Manuel en Morée, l'an 1415, après la mort de son frère Théodore, pour y consolider sur le trône de cette principauté son propre fils, Théodore le jeune (Ducas, ibid.). En effet, il ne resta plus dès lors aux étrangers que les villes de Clarence en Elide et de Patras en Achaïe, qui devaient être recouvrées par les Grecs sous le règne suivant (Chalcocondyl., liv. V, p. 240, éd. Bonn). C'est encore dans ce voyage que l'empereur acheva de fortifier l'isthme de Corinthe, et il en est beaucoup question dans les deux Mémoires de Pléthon, qu'il ne faut pas pour cela confondre avec le troisième Mémoire, dont on va parler.
[17] Ce morceau, encore inédit, se trouve manuscrit dans la bibliothèque de Florence, cod. xxxiii, n° 6 du catalogue de Bandini, et dans celle de Vienne, cod. xc, n° 4 du catalogue de Lambécius.
Quant à sa date, elle est marquée par son sujet. Les fortifications de l'isthme, commencées par ordre de l'empereur Manuel, en 1405 (Phranza, livre I, ch. 35), furent terminées sous ses yeux en 1415 (Chalcocondyl., livre IV, p. 183, sqq., éd. Bonn) : or il semble que ce Mémoire dut être adressé à l'empereur avec les deux précédents, ou peu de temps après. Voir la note précédente.
[18] C'est, en effet, pendant ce voyage de 1415 que l'empereur Manuel prononça l'oraison funèbre de son frère (Chalcocond., liv. IV, p. 210), et que Pléthon put songer à faire l'éloge de ce discours. L'un et l'autre morceau sont imprimés dans l’Auctarium novum Biblioth. Patr., t. II, p. 1037 et suiv.
[19] Un autre petit morceau politique, προσφωνημάτιον, appartient à l'extrême vieillesse de Pléthon ; nous en parlerons plus tard.
[20] Voir Syropule, ou, comme on s'obstine à l'appeler, Sguropule, Hist. du concile de Florence, sect. vi, chap. 10 et 12 ; sect. vii, chap. 8, etc. Le vrai nom de cet auteur, du moins son nom officiel, est bien Syropule ; c'est ainsi qu'il signe lui-même au bas des actes du concile de Florence, et nous avons à Paris un manuscrit de sa main, Biblioth. impér., 1291.
[21] Platina, Paneg. in laudem Bessarionis, avec les vies des Papes, Leipz. 1312, in-8°, p. 2, sq.: « Postremo autem, nealiquid tanto ingenio deesset, Platonem (leg. Plethonem) quem alii Gemisto (leg. Gemiston) vocant, doctissimum praeceptorem et quem omnes secundum a Platone vocant, in Peloponneso, quo se contulerat doctrinae causa, nactus, malhematicis accurate imbuitur. » Ce mot nactus semble opposé à l'opinion de ceux qui ont écrit, comme Tiraboschi, t. VI, livre II. ch. 2, § 13, que Bessarion était venu tout exprès en Morée pour y prendre des leçons de Gémistus. Il y vint peut-être sans autre but que d'y faire l'apprentissage de la vie religieuse sous la direction de Dosithée, évêque de Sparte, qui bientôt, reconnaissant ses dispositions merveilleuses, les tourna vers la littérature et les sciences (Platina, l. cit.) Au reste, si l'on veut des détails curieux sur le séjour de Bessarion en Morée, et sur l'extrême pauvreté de ce grand homme au début de sa vie, il faut les chercher dans un discours que lui prête Syropule, sect. v. c. 11.
[22] Nous parlerons plus tard de cette correspondance.
[23] Voir sa lettre aux enfants de Pléthon pour les consoler de la mort de leur père, et celle qu'il écrivit à Nicolas Segondin sur le même sujet Elles ont déjà été publiées par Allatius, de Consensu, p. 937, et plus tard par Morelli, dans le catalogue des mss. de Saint Marc. Nous les reproduisons cependant, avec les inscriptions funéraires composées par Bessarion lui-même en l'honneur de son ancien maître, dans notre Appendice, pièce XV et suiv.
[24] Nous y reviendrons vers la fin de cette notice.
[25] C'est Pléthon lui-même qui raconte ce fait dans Syropule, sect. vi, chap. 10. A la vérité, il le fait remonter à douze ans (on était alors en 1438); mais sa mémoire le trompe, c'est dix ans qu'il devait dire. Le voyage de l'empereur Jean en Morée eut lieu un an et demi après son avènement au trône. Il partit le 26 décembre 1427 (Phranza, liv. ii, chap. 1), et il était de retour à Constantinople vers la fin de 1428 (même livre, ch. 2).
[26] Réunion déjà tentée vainement sous presque tous les empereurs depuis Michel Paléologue.
[27] Cet ouvrage est justement celui que nous publions. On pourrait croire que l'existence d'un pareil livre à cette époque de la vie de Pléthon, est une anticipation gratuite de la part de ses ennemis; mais voir ci-après.
[28] Lettre à Joseph l'Exarque, dans notre Appendice.
[29] Aussi Gennadius lui reproche-t-il d'avoir nourri ces opinions des sa jeunesse.
[30] Toutefois il ne faudrait pas attacher trop d'importance à ce titre : te n'est peut-être ici, comme souvent dans les écrits de ce temps, qu'une qualification honorifique applicable à tous les savants. Nous le verrons plus bas donné aussi à Gennadius.
[31] Ducas, ch. 31, p. 213, sq., éd. Bonn. Par sénat, on doit en tendre le conseil impérial composé des principaux fonctionnaires de l'État : Phranza, liv. I, ch. I, 12, 19, 35, etc. Il faut que Pléthon ait reçu ce titre à l'occasion de son départ pour le concile ; car la principauté de Morée, où il résidait, était, comme nous l'avons dit, tout à fait distincte de l'Empire sous le rapport administratif, et ses fonctionnaires par conséquent n'avaient rien de commun avec ceux de Constantinople.
[32] Syropule, sect. vi, chap. 13. — 3. Ibid., fin du chapitre.
[33] Syropule, sect. vi, chap. 19. Ce fut dans la session du 14 octobre 1438, la troisième, selon le calcul de Syropule. Cependant les actes du concile, soit grecs, soit latins, ne font aucune mention de l'observation de Gémistus, ce qui lui ôte son caractère officiel, mais non son importance.
[34] George de Trébizonde, Compar. Plat. et Arist., chap. avant-dernier : « Audivi ego ipsum Florentiae, venit enim ad concilium cum Graecis, asserentem unam eamdemque religionem uno animo, una mente, una praedicatione, universum orbem paucis post annis esse suscepturum. Cumque rogassem, Christine an Machumeti ? Neutram, inquit, sednon a gentilitate differentem... Percepi etiam a nonnullis Graecis qui ex Peloponneso bue profugerunt, palam dixisse ipsum, anteaquam modem obiisset jam fere triennio, non multis annis post mortem suam et Machumetum et Christum lapsum iri, et veram in omnes orbis oras veri totem perfulsuram. »
[35] Syropule, passim, et notamment sect. vii, ch. 8; sect. viii, ch. 17; sect. ix, ch. 6.
[36] Gennadius le lui reprochait, dans sa réponse en faveur d'Aristote, p. 55 de l'édition de M. Gass, 292 et 294 du notre Appendice, et lui-même s'en fait gloire dans sa réplique, App.: « Il ne te manquait, lui dit-il, que d'envelopper ainsi dans les calomnies des hommes beaucoup plus savants que toi... Nous savons bien que, pendant ton séjour en Italie, tu as toujours évité leur société, sans doute pour ne pas laisser surprendre le secret de son ignorance... Mais moi, je les ai fréquentés, je les ai connus, et j'ai pu me faire une idée de leurs opinions philosophiques. » Il nomme ensuite quelques-uns de ces hommes, et entre autres Pomponius Laetus, dont nous aurons à reparler. Syropule, sect. v, ch. 2, nous le représente dinant chez les cardinaux, au grand scandale des Grecs schismatiques, et parlant philosophie à table.
[37] Tiraboschi, t. VI, loc. cit.
[38] Dans la préface de sa traduction de Plotin, Flor., 1492, fol. : « Magnus Cosmus, senatus consulto Patrice Pater, quo tempore concilium inter Graecos atque Latinos sub Eugenio pontif. Florentia; tractabatur, philosophum Graecum nomine Gemistum, cognomine Plethonem, quasi Platonem alterum, de mysteriis Platonicis disputantem frequenter audivit. E cujus ore fenente sic afflatus est protinus, ut inde academiam quamdam alta mente conceperit, hanc opportuno primo tempore pariturus. Deinde cum conceptum tantum magnus ille Medices parturiret, me electissimi medici sui filium, adhuc puerum, tanto operi destinavit, etc. »
[39] Ce petit ouvrage, imprimé plusieurs fois dans le seizième siècle (voir Fabricius, l. XII, p. 89, éd. Harles), est devenu fort rare. Comme il marque une époque, il a un grand intérêt pour les personnes qui s'occupent de l'histoire de la philosophie, et mériterait d'être réimprimé avec les pièces principales de la controverse entre Pléthon, Bessarion, Gennadius et quelques autres Grecs de ce temps-là, ce que M. W. Gass aurait bien dû faire dans son ouvrage : Gennadius und Pletho, déjà plusieurs fois cité, où il a publié des pièces moins importantes. Celle-ci est capitale, parce qu'elle fut l'origine de toute la querelle. La date en est certaine : Pléthon la composa à Florence, étant malade, comme il nous l'apprend dans sa réplique à Gennadius, p. 113, éd. Gass. On ne peut, au reste, mieux faire que de consulter, sur cette guerre philosophique, l'important mémoire de Boivin le jeune, cité ci-dessus. Bien que ce sujet ait été traité ou au moins effleuré par tous ceux qui ont écrit sur l'histoire de la philosophie on sur celle de la renaissance, principalement en Allemagne et en Italie, nous ne voyons pas qu'ils aient beaucoup ajouté au travail de l'académicien français.
[40] Le mot Γεμιστός, rempli, n'est pas attique; le premier exemple qu'on en cite est d'Athénée, qui l'emploie comme terme de cuisine, dans le sens de farci. Γεμίζω lui-même, quoique employé par Eschyle et par Euripide, et fort commun dans les écrivains postérieurs, semble d'un atticisme suspect.
[41] « Plethonem, quasi Platonem alterum. » Ficin, loc. cit.
[42] La manie de quitter un nom d'origine barbare, pour en prendre un plus classique, ordinairement de même signification, commençait à se répandre en Italie, du temps de Pléthon. C'est à tort que quelques-uns ont fait honneur de cette invention à Pomponius Laetus : il est vrai qu'il y tenait plus que personne, et qu'il en avait fait une loi dans sa petite académie romaine, dont nous parlerons plus tard. A mesure que l'érudition gagnait du terrain, cette mode se propagea d'Italie en France, et surtout en Allemagne, où elle dura plus qu'ailleurs.
[43] Mathieu Camariote, dans son ouvrage contre Pléthon sur le Destin, au commencement du liv. I, prétend que ce sont les démons qui ont suggéré à notre auteur l'idée de prendre ce nouveau nom comme plus païen. Manuel Holobulus, dans sa réfutation inédite du traité de Pléthon sur le Saint-Esprit, citée par Allatius, de Georgiis, dans Fabric, tom. XII, p. 85, éd. Harl.; George de Trébizonde, Compar. Plat, et Aristot., chapitre déjà cité : « Is vulgo Gemistus, a se ipso Plethon est agnominatus,... credo, ut se facile de coelo lapsum crederemus, et citius doctrinam et legem ejus susciperemus. » Nous reviendrons sur ces trois ouvrages, inspirés, comme on le voit, par un violent esprit de dénigrement contre Pléthon.
[44] Lettres de Filelfe, liv. V, fol. lvii, édition de Paris, 1503 : Franciscus Philelphus Saxolo Pratensi salutem. De tua in Peloponnesum, quam instituisti, profectione accipe sententiam meam. Fuit olim Peloponnesus in universa Graecia et viris et opibus pollens, nunc iis vacua prorsus. Nam propter continuas barbarorum incursiones, incolarumque ignaviam, adeo est bonis exinanita omnibus, ut praeter unum Georgium Gemystum (sic), virum perte et doctum et gravem et disertum, nihil invenias dignum laude. Principes enim illi Palaelogi, ipsi quoque inopia pressi, vel suis sunt ridiculo ac praedae. Itaque, praeter unum Gemystum, cetera illic omnia commiserationis sunt plena. Accedit quod lingua etiam ipsa adeo est depravata, ut nihil omnino sapiat priscae illius et eloquentissimae Gracia. Mores vero barbaria omni barbariores. Quare, si me audias, non Peloponnesus tibi, sed Thracia, hoc est, nova Roma Constantinopolis petenda est. Illic enim et viri eruditi sunt nonnulli, et culti mores, et sermo etiam nitidus. Quod eo magis tibi faciundum censeo, quod nesciam quanta sit tibi Georgii Gemysti futura copia, si Peloponnesum petieris : est enim jam admodum senex, quique magistratum perit nescio quem. Caeterum Constantinopolim petiturus, poteris, si videbitur, ad virum ex itinere tantisper divertere, donec praesens ipse coranique dijudices et regionem et viros.Vale. Ex Mediolano, vi idus junias MCCCCXLI. »
[45] Appendice, pièces II et III.
[46] Mémoire déjà cité : Acad. des Inscript., t. II, p. 776.
[47] Pétrarque et quelques autres littérateurs du siècle précédent, ainsi que le remarque Tiraboschi, tom. VI, loc. cit., ne furent pas étrangers à la philosophie de Platon ; mais ils ne la connaissaient guère que par l'intermédiaire des anciens auteurs latins. Le pro-i-i-s entre Aristote et Platon n'avait donc pu jusque là être jugé en Italie, faute de pièces suffisantes. C'est ce qui résulte du passage formel de Pléthon dans sa réplique à Gennadius, p. 57, éd. Gass. de notre Append. C'est aussi la remarque de George de Trébizonde, Compar. Plat. Et Aristot. lib. I, cap. 2 : « Id latina oralione nunquam ferme alias (Plato enim latinus non erat) commode fieri potuit. Nunc vero, quoniam multa ejus in Romanam linguam traducta volumina, etc. » Et encore dans ces nombreux volumes dont il parle, comprend-il probablement les douze livres de Platon sur les Lois et un ou deux dialogues traduits par lui-même.
[48] Une partie de cette correspondance nous a été conservée. La date en est incertaine ; nous la croyons pourtant antérieure aux attaques de Gennadius, et elle paraît devoir se placer entre 1441 et 1444. Elle roule principalement sur quatre thèses philosophiques, y compris celle du fatalisme, la plus importante de toutes, que M. Orelli en a extraite pour l'insérer dans son recueil de divers ouvrages grecs sur le Destin, Zurich, 1824, in-8°. Ces discussions, d'ailleurs assez courtes, ont pour point de départ les objections faites par Bessarion à diverses propositions du livre de Pléthon contre Aristote, et n'ont rien de commun avec le Traité des Lois. Viennent d'abord les quatre objections, ensuite les quatre réponses, et comme, à ce qu'il parait, Bessarion, dans une lettre aujourd'hui perdue, avait insisté et demandé à connaître les passages de Platon ou de ses disciples en faveur du fatalisme, Pléthon, dans une dernière lettre, cite quelques-uns de ces passages, dont l'autorité, à vrai dire, ne nous paraît pas très décisive. Toutes ces pièces ont été imprimées en entier à la suite de Mathieu Camariote, Leyd. 1722, in-8°. Elles se trouvent manuscrites dans un grand nombre de bibliothèques, notamment à Paris, sous les nos 462, 1739, 2376, 2964. Il faudrait y joindre le petit traité cité par Allatius, de Georgiis, et par Renaudot, dans la Bibl. gr. de Fabricius, t. XI. p. 431, éd. Harl. Ce traité, inconnu en France, existe manuscrit à Venise, Florence, Munich, etc.
[49] Nous verrons plus tard la part que prirent à cette guerre philosophique Théodore Gaza, Michel Apostolius, George de Trébizonde, et les violences auxquelles les deux derniers s'emportèrent. Ces faits se rapportent à une époque postérieure à la mort de Pléthon. Il ne s'agit ici que de la controverse qui eut lieu d'abord entre Bessarion et son ancien maître.
[50] On le nomma Gennadius en le faisant patriarche, est-il dit dans la Tttrco-Grxcia de Martin Crusius, p. 107, sans doute d'après Phranza, p. 305, éd. Bonn : mais c'est une erreur fort bien relevée par Renaudot dans son excellent article sur la vie et les écrits de ce personnage, article inséré par Fabricius dans sa Biblioth. gr. t. XI, p. 349 et suiv., éd. Maries. Le fait est que Gennadius était déjà moine sous ce nom en 1451 (Ducas, cap. 36, p. 252), avant la prise de Constantinople et par conséquent avant d'être patriarche (voir ci-après, p. xxiv, not. 2). L'usage de changer de nom en entrant dans la vie monastique est commun aux Églises d'Orient et d'Occident. On remarquera qu'en général les moines grecs, dans le choix de leur nouveau nom, tiennent à conserver la lettre initiale de l'ancien; George devenu Gennadius en est un exemple.
[51] L'origine de ce nom est incertaine. Au moyen âge, à Constantinople, le mot σχολάριος; avait perdu sa signification naturelle et s'appliquait aux gardes du palais, comme σχολή signifiait cohorte, etc. Cependant je penche à croire que ce mot servait aussi à désigner l'un des fonctionnaires laïques ou simplement minorés du clergé inférieur de Constantinople. On trouve dans les suppléments à Du Cange par Carpentier les mots Scholarius et Scholasticus employés dans les églises d'Occident avec le sens d'Ecolâtre. Il serait possible que Gennadius eût débuté par cet emploi. Dans les actes grecs du concile de Florence, son surnom Σχολάριος; est quelquefois place comme un titre avant son nom.
[52] Ducas, cap. 31, p. 214. Il portait déjà ce titre, au moment du départ pour le concile (Ducas, ibid.), et lui-même se le donne encore après le concile, dans le préambule d'un de ses ouvrages, ms. de Paris, 1290. (Voir Fabricius, tom. XI, p. 384, éd. Harl.) L'histoire turco-grecque le lui conserve jusqu'au moment où il fut fait patriarche, mais probablement en se reportant à l'époque où il quitta la vie séculière. Toujours est-il qu'il conserva ses fonctions judiciaires plus de dix ans. Voir encore Fabricius, p. 362.
[53] Ici le mot διδάσκαλος; peut être, comme on voudra, une qualification honorifique ou un titre : car on appelait ainsi, dans le clergé inférieur, celui qui était chargé d'expliquer telle ou telle partie du Nouveau Testament (voir encore Du Cange sur ce mot.) C'est sans doute en sa qualité de docteur que Scholarius, quoique laïque, faisait à l'empereur tous les vendredis, comme il nous l'apprend lui-même, une instruction sur l'Ecriture sainte Fabricius, p. 355 et 384). Il est probable qu'il garda ces fonctions à la cour jusqu'à la mort de l'empereur Jean, époque où il se retira dans un cloître pour en sortir patriarche. Quant à ce que dit Phranza, p. 305, passage déjà cité, qu'on le fit patriarche étant encore laïque, il faut entendre que, bien qu'ayant pris l'habit religieux, il n'était pas encore dans les ordres, ce que nous verrons confirmé dans la suite de cette notice : autrement Phranza serait démenti par Ducas, chap. 6, p. 253. éd. Bonn, et par Gennadius lui-même, dans son mandement d'abdication, cité en latin par Fabricius, loc. cit., p. 360.
[54] Ce changement total d'opinions et de conduite, et la bigarrure qui en résulte dans les œuvres de Scholarius, composées les unes pour, les autres contre l'Eglise latine, ont tellement étonné les savants, que plusieurs, ayant à leur tête Allatius, ont soutenu l'existence de deux écrivains différents sous un même nom. Mais cette opinion, réfutée par Renaudot dans son article déjà cité, est, je crois, abandonnée par tous les critiques de quelque valeur. Scholarius apporta au concile une véritable foi dans l'excellence des doctrines grecques, et la conviction, partagée par le patriarche Joseph, que le simple exposé des preuves suffirait pour faire revenir à la vérité tous les théologiens d'Occident. De là ses ménagements et ses flatteries pour la cour de Rome, qu'il espérait toujours regagner. Il ne faisait d'ailleurs en cela que se conformer au désir de l'empereur, qui voulait l'union à tout prix. Plus tard, la discussion ayant pris une tournure évidemment défavorable aux Grecs, qui n'étaient ni en nombre ni en force pour se défendre, il fallut se rabattre sur une transaction, et c'est alors que Scholarius, au nom d'une commission nommée à cet effet par les Grecs, rédigea la formule ambiguë que nous a conservée Syropule, sect. viii, chap. 17. Cette formule, comme on devait s'y attendre, et comme Pléthon, meilleur politique, l'avait prévu, ne contenta personne. Les Latins exigèrent avec raison une déclaration plus explicite, et l'empereur insistant toujours, le temps s'écoulant, la misère se faisant sentir, les évêques d'Orient, moitié persuasion moitié lassitude, finirent par signer tout ce qu'on voulut. Mais Scholarius, qui, en sa qualité de laïque, n'avait point signé, conserva sa liberté de penser et d'agir. Son attachement à ses idées n'avait fait que s'accroître par l'inutilité de ses efforts. Il se rapprocha de Marc d'Éphèse, le seul évêque qui au concile eût protesté jusqu'à la fin, et devint après lui le chef de l'opposition.
[55] Nous avons l'espoir de retrouver ce traité : il paraît qu'il est compris dans les manuscrits découverts en Grèce par M. Minoïde Mynas, mais qui malheureusement n'ont pas tous été rapportés en France ou n'ont pas été publiés. Il comblera une lacune regrettable dans l'histoire de la philosophie au quinzième siècle, et dans l'ouvrage de M. W. Gass, Gennadius und Pletho.
[56] Voir notre Appendice, pièces V et VI.
[57] Dans notre Appendice, pièce IV.
[58] Append. pièce XIX.
[59] Dans sa réplique, pages 60, 64 et 116, éd. Gass ; voir notre Appendice.
[60] Par exemple, dans ce passage, déjà indiqué : « Pléthon nous parle de ses amis d'Italie, à la prière desquels il prétend avoir composé son acte d'accusation contre Aristote. Ces amis-là, dans la compagnie desquels tout le monde a pu le voir, nous savons fort bien qui ils étaient, tous gens aussi passionnés pour la philosophie que Pléthon peut l'être pour la danse. » Le ton est un peu leste. Mais après tout ce n'est là qu'une plaisanterie, déplacée sans doute dans un sujet grave. Gennadius semble s'être reproché plus tard ce défaut de formes : App. Mais, au fond, il croyait si peu avoir manqué de modération dans cet ouvrage qu'il en appelle au jugement de tous ceux qui l'ont lu, et en recommande surtout à leur attention le commencement et la fin : Lettre à Joseph l'Exarque. Il est vrai cependant qu'il y avait glissé quelques allusions plus ou moins indirectes aux doctrines de Pléthon, et que celui-ci les avait prises pour des menaces, car il en parle dans sa réplique : « Je m'effraie fort peu, lui dit-il, de la menace que tu me fais de poursuivre tes invectives contre moi... Car tu n'es pas une Méduse, mais tout au plus un épouvantail pour les enfants. » Et plus clairement encore, à propos d'un passage où Gennadius lui reprochait de nier l'inspiration et la révélation, de n'admettre que la raison humaine, Pléthon répond un peu en normand : « Je sais quelles sont les inspirations et les raisons qu'il faut admettre ou ne pas admettre ; pour toi tu ne sais que médire et calomnier. »
[61] Ce traité existe manuscrit dans un grand nombre de bibliothèques, notamment à la Bibl. imp. de Paris, sous les numéros 949, 2045 et 66 du supplément; nous le publions à la fin de ce volume, App., pièce VII. Nous l'avions cru longtemps inédit; mais une note en marge du catalogue, sous le n° 66 (suppl.), nous apprend qu'il ligure dans la collection de Dosithée, imprimée à Jassi en 1698, recueil très-rare et que nous n'avons pu nous procurer.
[62] D'Argyropule, selon une note de Constantin Lascaris en marge du manuscrit de Madrid, d'après Iriarte, cité par Harles sur Fabricius, Bibl. gr. t. XII, p. 95. Mais j'ai parcouru le discoure d'Argyropule sur ce sujet dans Allatius, Graecia orthodoxa, t. 1. p. 400, sqq., et dans le ms. 1191 de la Bibliothèque impériale; je n'y trouve point la fameuse proposition qui devrait être au commencement, et sur laquelle portent les premiers coups de Pléthon. D'ailleurs, comme indépendamment du titre de cet ouvrage, la dédicace par Argyropule à Cosme de Médicis y est fort explicite et occupe tout l'exorde, on ne concevrait pas que Pléthon en eût ignoré l'auteur, et se fût borné a l'indiquer partout si vaguement. Il paraît donc qu'il s'agit d'un autre ouvrage, composé non par un laïque comme Argyropule, mais par un des prélats grecs du concile de Florence (cela semble résulter très clairement de l'épilogue de Pléthon, dans notre Append. pièce VIII); et ce prélat n'était autre probablement que Bessarion lui-même, qui avait eu des raisons pour cacher son nom fort impopulaire parmi les Grecs schismatiques Cette supposition expliquerait comment Pléthon, eût il perce le voile de l'anonyme, aurait, par ménagement pour son illustre élève, évité partout de le nommer. Elle semble d'ailleurs confirmée par l'inscription du ms. de Florence, n° xviii, rapportée dans Bandini. En effet, le titre annonce trois pièces. 1° le traité de Pléthon sur le Saint Esprit, en réponse à l'ouvrage de l'évêque de Nicée (Bessarion), c'est-à-dire en réponse à l'ouvrage dont nous cherchons l'auteur; 2° une réplique de Bessarion ; mais il paraît que cette réplique consistait seulement en quelques annotations marginales qui sont dans ce ms. de Florence; 3° une contre-réplique de Pléthon, aujourd'hui inconnue, mais à laquelle appartenait, selon toute vraisemblance, l'épilogue reproduit par nous (App. pièce VIII), le même qui est dans le ms. de Florence, et qui a pour titre dans celui d'Athènes. Toujours Bessarion, comme on le voit.
[63] Elle se trouve dans le ms. 1297 de la bibliothèque de Paris ; nous la donnons à la fin de ce volume, Append., pièce IX.
[64] Même lettre. Voir ci-après comment Pléthon répondit à cette espèce de provocation par la publication de sa réplique au plaidoyer pour Aristote.
[65] Le texte porte ἀγιστείας εὐσταλεῖς. Ces mots qui appartiennent au prologue du Traité des lois, y sont évidemment employés par opposition au culte chrétien. Ce prologue n'aurait pas du, ce semble, être connu de Gennadius à cette époque; il en fait pourtant une analyse presque littérale dans tout ce passage de sa lettre sur le Saint-Esprit. Il faut qu'il lui ait été révélé par quelque indiscrétion.
[66] C'est encore au même prologue que Gennadius emprunte ces détails sur les sources où son adversaire a puisé, à moins que le petit morceau de Pléthon : « Résumé des dogmes de Zoroastre et de Platon, » n'eût déjà été lancé dans le public, pour juger de son effet sur l'opinion. Cet opuscule, dont le titre est un mensonge, n'est qu'un exposé sommaire des doctrines développées dans le Traité des Lois, à la suite duquel nous l'avons placé. Il ne faut pas le confondre avec le commentaire sur les oracles en vers de Zoroastre, dont nous aurons à parler plus tard.
[67] Nous verrons que Gennadius ne tint point parole, et ne recula pas devant l'emploi du feu. Il est vrai que ce fut le livre, et non l'auteur, qui fournit la matière de son autodafé. Si sa promesse de ne pas brûler le livre eût été sérieuse, il l'aurait donc oubliée plus tard. Mais plus tard, comme nous le verrons, sa position changée lui imposait d'autres devoirs. Il faut croire aussi que, lorsqu'il s'exprimait de cette manière, il ne s'attendait pas à tenir un jour entre ses mains l'existence de cet ouvrage.
[68] En effet, il n'y avait point en Grèce de bûchers pour les hérétiques. C'est Pléthon, au contraire, qui veut introduire cet usage dans sa république : voir le Traité des lois, et nos remarques ci-après.
[69] Dans sa lettre à Joseph l'Exarque.
[70] Lettre à Joseph l'Exarque.
[71] Pour beaucoup de Grecs, le règne du malheureux Constantin passa comme inaperçu dans l'ombre des derniers jours de l'empire. Prince hérétique, selon eux, il fut, même après sa mort, méconnu et renié par ses sujets ingrats. Quelques-uns effacèrent de la liste des empereurs grecs le nom de ce prince dont le courage et la vertu jetèrent sur l'agonie de Byzance un dernier reflet de gloire. Un tel excès d'ingratitude ne s'explique que par l'aveuglement du zèle fanatique qui, pendant le siège de Constantinople, faisait dire à Luc Notaras, un des grands partisans de Gennadius, qu'il aimait mieux voir régner dans sa ville le turban turc que le chapeau latin (Ducas, § 37, p. 264, éd. Bonn), vœu impie dont il fut plus tard cruellement puni.
[72] Sect, vi, chap. 23 : C'est presque en propres termes le langage que lui prête Pléthon. Ce silence imposé aux laïques s'accordait d'ailleurs avec la politique de l'empereur : voir ci-dessus.
[73] On y trouve quelques renseignements sur l'origine de cette princesse, qui eut de l'influence sous les deux règnes de son mari et de son fils. C'est à tort que les manuscrits de Phranza, livre III, § 1, en mentionnant sa mort, lui donnent le nom d'Irène : car on peut voir dans Du Cange, Hist. byz. Part. i, la gravure de son portrait authentique, où elle est représentée entourée de sa famille, avec son nom Ἑλένη, très lisiblement écrit. Du reste, tous les détails contenus dans le discours de Pléthon s'accordent parfaitement avec le titre qu'on lit dans le ms. de Paris 1760. Il faut donc se tenir en garde contre la confusion qui pourrait résulter d'un passage du même Phranza, liv. IV, § 23, sur la mort d'une autre Hélène Paléologue, également nommée en religion Hypomoné. Celle-ci était la fille du prince Thomas Paléologue, veuve du dernier crale de Servie, Phranz. II, § 19, et IV, § 1. Elle mourut au monastère de Sainte-Maure, en 1474; son éloge, par conséquent, n'aurait pu être prononcé par Pléthon. Le discours en l'honneur de son aïeule a été publié dans les Anecdota de MM. Mustoxidi et Schinas, à Venise, 1810, in-8°. Nous n'avons pu nous procurer ce recueil. Mais le discours lui-même est conservé manuscrit à Paris, sous les nos 1760 et.903 ; seulement, dans le titre de cette dernière copie, il est attribué à Démétrius de Cydone.
[74] Italienne, fille d'un Malatesta, mariée au prince Théodore en 1419 (Dumas, ch. 20, p. 100), morte en 1433 (Phranza, liv. II, en. 10). L'oraison funèbre de cette princesse a été éditée par Fülleborn à Leipzig, 1703, in-8°, avec celle de Bessarion par Michel Apostolius, en une petite brochure de quelques pages.
[75] Ce petit discours se trouve manuscrit dans plusieurs bibliothèques ; il est cité par Allatius de Georgiis, dans la Bibl. gr. de Fabricius. Nous l'avons trouvé à Paris, sous le n° 60 du supplément, et dans le ms. rapporté d'Athènes par M. Le Barbier (voir ci-dessus.) Nous le croyons encore inédit. C'est vers la fin qu'on y parle de l'ambassade de Matthieu Asan, et de la joie que doit éprouver de cette issue pacifique le grand empereur de Constantinople (l'empereur Constantin), joie tempérée cependant par le regret de n'avoir pas mieux réglé tout d'abord le partage des principautés et fait à Démétrius une meilleure part. Voir Chalcocondyle, liv. VII, p. 374, éd. Bonn.; Phranz. liv. III, ch. 1.
[76] Ces détails et quelques-uns de ceux qui suivent sont empruntés aux deux oraisons funèbres dont nous allons parler.
[77] Oraisons funèbres, p. 381 et 393.
[78] Par Jérôme Charitonyme et Grégoire le Moine. Voir ces deux morceaux dans notre Appendice, pièces XIII et XIV; et sur la vie de Jérôme ou Hiéronyme, Charitonyme ou Christonyme, le même sans doute que Hermonyme de Sparte, un des plus anciens professeurs de grec à Paris, consulter Fabricius, t. XII, p. 102, sqq. éd. Harl., dont l'article a été rectifié à tort par l'éditeur, t. XI, p. 635, not. Quant à Grégoire le Moine, il n'est pas connu, et probablement il méritait peu de l'être.
[79] Nous ne pouvons regarder comme authentique la petite note anonyme dont nous parlerons: nous sommes loin pourtant de la mépriser, et, bien que dépourvue d'autorité, elle nous servira à contrôler nos conjectures.
[80] Compar. Plat. et Arist. lib. III, cap. penult. « Centum enim pene misera aetate annos complevit. » Plus haut il avait dit : « Antea quam mortem obiisset, jam fere triennio. » Voir ci-dessus.
[81] Dissertazioni Vossiane, t. II, p. 21, sqq.
[82] A la fin d'un manuscrit autographe de sa traduction de l'Almageste, conservé à la bibliothèque de Milan : « Pontifex summus Nicolaus V volumen traducendum mense martii tradidit, et mense decerabris anni ejusdom et librum traductum et commentarios vidit absolutos, propter quos postea me destruxit. » Dissert. Voss. t. II, p. 13. L'année désignée dans cette note ne peut être que 1452. Le mécontentement du pape provint sans doute de la négligence et de l'infidélité du travail. Celle traduction, au reste, ne parut que longtemps après, à Venise, en 1527, avec d'amples et encore insuffisantes corrections par Luc Gaurico de Naples.
[83] Il y parle en plusieurs endroits de Constantinople au pouvoir des Turcs comme d'un fait accompli depuis quelque temps, et, au liv. III, ch. 8, il loue la belle conduite du cardinal Isidore de Russie, qui, lors du siège de cette malheureuse ville, tint bravement sa place auprès de l'empereur pendant le dernier assaut, et fut fait prisonnier, heureusement sans avoir été reconnu (voir Chalcocondyle, liv. VIII, p. 399, éd. Bonn.) Il représente ce même cardinal, après sa captivité, de retour à Rome, et dans un état de fortune plus que modeste, trouvant encore dans sa noble indigence les moyens de se faire chérir par ses bienfaits : « Et nunc, quamvis in summa inopia, si suam dignitatem consideres, vivat, magnitudine tamen animi plura solus indigentibus largitur quam cacteri pene omnes. » Ces seuls mots et nunc annoncent une époque postérieure au moins d'une ou deux années aux faits qu'on rapportait tout à l'heure.
[84] Au liv. II, ch. 18, il parle de son commentaire sur le Centiloquium de Ptolémée, et au livre III, avant-dern. chap., il rappelle sa Défense des Problèmes d'Aristote, ou plutôt la défense de sa propre traduction des Problèmes contre les critiques de Gaza. Or, de l'aveu même de Zeno, p. 14 et 20, ces deux ouvrages furent composés à Naples et dédiés au roi Alphonse.
[85] Liv. II, ch. 8 : « Neque laborem senes agrotique recusaverimus. » Liv.III, ch. 18 : « Senex, aegrotus, magno laborum numero et paupertate oppressus. » Liv. III, ch. 19 : « Sed si authoritate non persuasero, Graecus a Graecis, Cretensis a Thracibus aut a Scythis, voluptatis inimicus a voluptatis amicis, veritatis filius a falsitatis parentibus, tenuis a locupletibus amicis, privatus a summa dignitate, notatus, oppugnatus. »
[86] Au liv. III, ch. 11 et 12, il s'étend avec une complaisance affectée sur les louanges de Venise: pas un mot de Naples, et quant à Rome, il en parle comme d'un pays qu'il n'habite plus.
[87] Vies des doges de Venise, dans le grand recueil de Muratori, t. XXII, col. 1167, passage cité par Zeno, Diss. Voss. t. Il, p. 12. On y lit, sous la date de 1459 : « Venne d'agosto in questa terra Giorgio Trabesouzio, e presenta al Doge il libro di Platone de Legibus. » Il n'en résulte pas que la traduction des Lois de Pléthon soit de cette année : au contraire elle avait été faite à Rome par ordre de Nicolas V, à qui d'abord elle avait été dédiée. George, mécontent du pape, changea la dédicace. Il y conserva cependant un bel éloge de Platon, que Bessarion lui reproche, Adv. calumn. Platonis, lib V : « Reliquum est ut ipsum adversarium audiatis laudantem Platoni doctrinam, mores, etc., ita ut virtutes Platonis quas praedicarit et... commendarit, nunc neget. » Assurément ce reproche semble fondé. Mais ce que Zeno n'a pas assez remarqué, c'est que du passage même qu'on vient de citer, il résulte que l'ouvrage contre Platon est postérieur à ce morceau de préface en son honneur. Il semble que l'auteur ait pris plaisir à rétracter un éloge arraché par les circonstances à sa haine originelle : « Ita ut ex adolescentia Platonem oderim, » dit-il dans le dernier ouvrage, liv. III, ch. 4; et c'est sans doute pour expliquer ou atténuer cette contradiction qu'au chapitre II du même livre il consent à louer une pensée, une seule, de Platon, sur la fusion des trois formes de gouvernement, pensée qu'il applique précisément à la république de Venise pour vanter son excellente constitution.
[88] Chap. avant-dernier : « Nam librum quem de his rebus composuit... ne publice legeretur et multis officeret, a Peloponnesi principe Demetrio, sicut fertur, ereptus celatusque est. Quare nisi diligenter ab iis qui similibus rebus praesunt, quaesitus igni tradatur, scioquiddico,... major clades generi humaiio futurs est quani Machumetus invexit. » Ces mois, « ab iis qui similibus rebus praesunt, » et ceux-ci, « scio quid dico, » semblent une dénonciation indirecte et une demande de destruction du livre proscrit, adressée au patriarche Gennadius, que George de Trébizonde ne pouvait interpeller ouvertement à cause du schisme.
[89] Les Bénédictins, dans l'Art de vérifier les dates, éd. 1770, p. 391, disent 1458, mais par erreur.
[90] C'est la note sans nom d'auteur, il est vrai, et sans origine connue, que nous trouvons indiquée au ms. 495 de Munich (fonds d'Augsbourg), fol. 50. « Le docteur Gémistus est mort le 26 juin de la 15e indiction, un lundi, à la première heure du jour. » Or le 16 juin n'a pu tomber un lundi qu'en 1452, si l'on veut que ce soit une quinzième année d'indiction. C'est donc à cette date qu'il faut s'attacher.
Cela lui donne, comme nous l'avons dit, environ quatre-vingt-deux ans à l'époque du concile de Florence. Tiraboschi, et d'après lui M. Walz, dans sa préface à un ouvrage de rhétorique attribué a Pléthon (Collection des rhéteurs grecs, tom. VI), ont préféré l'année 1451, faute de connaître la note de Munich.
[91] Phranza, liv. xiv, § 16, p. 396, éd. de Bonn.
[92] Phranza, ibid., § 18, p. 405. Chronicon breve, à l'année 1460. Gennadius, épitre à Joseph l'Exarque, passage cité plus bas.
[93] Voir à la fin de ce volume, p. 412 et suiv. Le vrai nom de Joseph l'Exarque nous est donné par le ms. de Paris 1294, écrit tout entier de la main de Gennadius lui-même. Renaudot, dans son article sur Gennadius, reproduit dans la Bibl. gr. de Fabricius, t. XI, p. 349, éd. Harl. et Boivin le Jeune, dans les Mém. de l'Acad. des inscr. tom. II, l'appellent Jean l'Exarque, trompes par le ms. 1289, où le nom est écrit en abrégé, ce qui en effet signifierait Jean plutôt que Joseph, et de ces deux savants l'erreur a passé à Fabricius et à tous ceux qui l'ont copié. Avouons cependant que le prénom de Jean se trouve aussi dans quelques manuscrits étrangers, toujours par suite de cette malheureuse abréviation, qui aura trompé les copistes. Ce Joseph est le même à qui Gennadius adresse plusieurs de ses traités sur la Providence, dans le ms. 1294, et nous apprenons par le titre d'un de ces traités que c'était un moine de Thessalonique. Quant à sa qualité d'exarque, nous aurons occasion d'en parler ailleurs.
[94] S'il fallait prendre à la lettre le passage de George de Trébizonde, rapporté ci-dessus, ce ne serait point le hasard qui aurait fait tomber cet ouvrage, après la mort de l'auteur, entre les mains de Démétrius. Le prince, sans doute par un motif religieux et dans l'intérêt de la foi, s'en serait emparé d'autorité : « Ereptus celatusque est. »
[95] Cela explique pourquoi il s'est conservé si peu de fragments de cet ouvrage en dehors des quelques débris rassemblés dans notre édition et qui proviennent tous ou presque tous de l'exemplaire original.
[96] Lettre à Joseph l'Exarque.
[97] C'était la princesse Asanina, Aile de Paul Asan, d'une famille puissante à la cour. Son père l'avait mariée furtivement au prince Démétrius, malgré la volonté impériale, en 1441 : voir Phranza, liv. II, § 18. Elle mourut peu de temps après son mari, vers 1471 : ibid. liv. IV, § 23, p. 449, éd. Bonn.
[98] Plainte d'un Anonyme, à la Un de ce volume, p. 410 : « Je sais (c'est Pléthon qu'on y fait parler) comment s'est ourdie cette trame contre mon livre, par les relations d'un homme superstitieux (Démétrius) et de son sérail (c'est-à-dire, de la princesse Asanina et de son entourage) avec un fourbe aussi méchant qu'ignorant (Gennadius). » Cette opinion sur les sentiments hostiles de la princesse avait germé de bonne heure dans la tête de Pléthon lui-même; et nous pensons que c'était elle qu'il soupçonnait d'avoir excité Gennadius contre lui. C'est ainsi du moins que nous, entendons ces mots de sa réplique à son adversaire, p. ao de l'édition de H. W. Gass : « Tu ne rougis pas de te vanter de l'influence d'une femme, » littéralement d'une « femmelette, » et il ajoute une expression bien irrévérencieuse, ne fût-elle même pas appliquée à une princesse.
[99] Lettre à Joseph l'Exarque.
[100] C’est lui-même qui nous l'apprend dans une note en marge de cette même lettre : « Je laissai, dit-il, attachées aux couvertures du livre les tables des matières, et à la fin, les hymnes composés par Pléthon en l'honneur de ses Dieux, pour que ces pièces restassent l'appui de mon jugement. S'il devait être un jour attaqué; tout le reste fut arraché et jeté aux flammes en présence de témoins. »
[101] Les exarques étaient dans ce temps-là les délégués du patriarche, espèce de légats qu'il entretenait dans les diocèses pour y transmettre ses ordres et y percevoir les droits dus a son siège. Il n'est donc pas étonnant qu'une lettre encyclique soit adressée à l'un de ces fonctionnaires.
[102] Lettre à Joseph l'Exarque.
[103] Gennadius fut en effet choisi pour patriarche par le sultan peu de jours après la prise de Constantinople (Phranza, livre III, ch. 11 ; Crusius, Turcogr.) Mais comme il n'était que moine laïque ou, si l'on veut, frère lai, ses fonctions furent d'abord purement administratives. Il s'occupa de rassembler les débris du clergé et de restaurer le matériel de quelques églises. Sa position était d'autant moins régulière que son prédécesseur, le patriarche Grégoire Mammas, obligé de quitter Constantinople en 1451 et de se réfugier à Rome, vivait encore et n'avait point abdiqué. Il fallut, pour régler cette affaire, convoquer à Constantinople un synode épiscopal, où Gennadius fut fait le même jour diacre, prêtre, évoque, patriarche. C'est lui-même qui nous l'apprend dans son mandement d'abdication dont nous n'avons sous les yeux que la traduction latine, donnée par Allatius, de Georgiis, dans Fabric. t. XI, p. 368, éd. Harles. Il a même bien soin d'insister sur le grand nombre d'évêques d'Europe et d'Asie dont la présence donna à cette réunion l'apparence d'un concile national : « Synodus multorum episcoporum ex Europa et Asia coufluentium. » Quand on songe au désordre qui régnait alors à Constantinople et dans une partie de l'empire, à la nécessité d'envoyer les ordres du sultan dans les provinces, et de mettre en mouvement tous ces vieillards, on conçoit facilement que, la ville ayant été prise au mois de mai 1453, ils n'aient pu s'assembler avant l'automne de cette même année, ou peut-être avant le printemps de l'année suivante : toutefois ce dernier délai est le plus long qu'on puisse supposer; il est même difficile de l'admettre.
[104] La succession des patriarches est très-obscure après la prise de Constantinople, et tout ce qui peut jeter quelque jour sur cette partie de l'histoire ecclésiastique est d'un intérêt précieux.
[105] Voir l'amère diatribe insérée dans notre Appendice, pièce XVIII, et déjà citée. Gennadius s'était attendu à ces attaques (voir sa lettre à Joseph l'Exarque), et l'on en trouve déjà le pressentiment dans sa lettre à Marc d'Éphèse.
[106] Le savant et très-catholique Allatius a souscrit lui-même à ces accusations dans son traité de Georgiis, si souvent cité par nous, et elles ont été aveuglément répétées par les compilateurs.
[107] Cet engouement commence avec la renaissance, vers le temps de Pétrarque ; il est dans toute sa force à la fin du quinzième siècle, en Italie du moins (car il gagna plus tard les autres contrées), et nous verrons à quels excès il fut porté dans certains esprits.
[108] Lettre à Joseph l'Exarque.
[109] Au commencement du même chapitre, il parlait des sophistes « qui ont voulu élever leurs prétentions au-dessus de l'humanité ». Voir en outre des allusions trop claires au mystère de la Trinité, liv. I, ch. 1, vers la fin, et au commencement de la troisième prière de l'après-midi, ainsi que dans l'index du livre III, ch. 22. Une grande partie de l'Épinomis ou Conclusion est presque ouvertement dirigée contre le christianisme.
[110] Il est curieux de suivre au concile la conduite de ces deux personnages. Pléthon, malgré son absence complète de principes religieux, et peut-être à cause de cela, s'était toujours montré fort opposé aux projets d'union (Syropul. sect. vi, ch. 9.) Gennadius, d'un esprit profondément religieux et convaincu, apportait à Florence des dispositions toutes différentes (voir ci-dessus, p. xxiv, not. 3.) Pendant tout le concile, Pléthon ne cessa de faire une opposition railleuse et méprisante jusque dans le conseil de l'empereur (Syropul. sect. vii, ch. 9); il représente assez bien l'esprit du petit groupe d'opposants qui s'était formé autour du prince Démétrius (sur la conduite de ce prince, voir Syropul. sect. ix, ch. 11). Gennadius, au contraire, dévoué à l'empereur et attaché au patriarche, poursuit avec persévérance l'union projetée, et, pendant que Pléthon néglige la théologie pour la philosophie, l'Église pour le monde (voir ci-dessus), Gennadius absorbé dans les graves discussions qui s'agitent, occupé à chercher des citations et à rassembler des matériaux qui ne furent pas inutiles à Bessarion lui-même (Syropul., sect. vi, ch. 21), vit renfermé avec ses livres, étranger à la société des gens du monde : c'est son ennemi même qui lui rend involontairement ce témoignage, dans notre Append. Ce fut pourtant Pléthon que l'on choisit pour faire partie de la commission des six, qui représentait dans le concile les intérêts et les opinions de l'Église grecque; il dut cet honneur sans doute à son grand âge, à sa science reconnue et à sa réputation de profond philosophe. Cette préférence ne ralentit point le zèle de Gennadius. On voit celui-ci, vers la fin du concile, rédiger consciencieusement la formule où il posait les dernières limites de ses concessions (Syropul. sect. viii, cap. 17). Pléthon, qui n'avait jamais fait de concessions, ne fut pas réduit à se rétracter, et eut du moins cet avantage sur son rival.
[111] Lettre à Joseph l'Exarque.
[112] C'est-à-dire du dialecte attique, dont Pléthon s'était particulièrement occupé. Voir ci-après.
[113] Plus tard, dans son discours contre les Automatistes, où il voit les choses d'une plus grande distance, il le traite plus sévèrement à quelques égards ; mais cependant il rend encore hommage à sa grande réputation, à son instruction profonde et à l'élégance attique de son style, p. 41 de l'édition de M. W. Gass, ou dans notre Appendice, pièce XX.
[114] C'est le titre que lui reconnaissent les manuscrits, et il est confirmé par Gennadius, dans sa Lettre à Joseph l'Exarque, de notre éd. Ce même Gennadius, dans un passage de notre Append., pièce XX, semble pourtant reconnaître un autre titre et Gaza, en effet, emploie quelque part cette désignation de notre texte. Mais l'usage a adopté le premier titre sous la forme abrégée, en latin de Legibus.
[115] Ce petit écrit paraît avoir été publié par Pléthon pour sonder l'opinion publique et répandre un avant-goût de ses doctrines. Présenté simplement comme un résumé des anciennes philosophie», il échappait à la censure. Peut-être aussi était-ce le manuel des initiés Nous ne savons s'il était venu à la connaissance de Gennadius. Nous le donnons à la suite du Traité des Lois, comme supplément nécessaire aux lacunes de ce dernier ouvrage.
[116] Lettre à Joseph l'Exarque.
[117] Pour s'en convaincre on n'a qu'à parcourir la table des matières conservée en tête de l'ouvrage. On sera étonné du décousu qui y règne. Gennadius, loc. cit., a raison d'insister sur ce défaut capital, et d'en tirer une induction contre la justesse d'esprit de Pléthon; car, ainsi qu'il le fait observer, l'ordre est la marque d'un esprit sain.
[118] Traité des Lois, liv. III, ch. 32.
[119] Εἵδη, proprement formes, apparences, et par extension, espèces; dans Platon, espèces essentielles, ou comme on traduit ordinairement, idées, c'est-à-dire types primitifs des choses, existant en dehors des choses elles-mêmes et en dehors de l'entendement dans un monde supérieur. Εἵδος, chez Pléthon, est aussi la forme qui, soit en elle-même à l'état abstrait, soit unie avec la matière à l'état concret, constitue l’espèce. De là vient qu'il applique ce nom à toutes les espèces d'êtres, même purement matériels, pour peu qu'ils soient envisagés d'une manière générale. Aussi est-ce dans le langage de cet auteur un mot des plus difficiles à traduire.
[120] Dans cette notice, comme partout dans la traduction, nous donnons aux dénominations grecques des Dieux de Pléthon la forme latine, plus familière à la plupart de nos lecteurs.
[121] Nous prenons cet exposé du système théologique de notre auteur dans le chapitre 5 du premier livre et le ch. 15 du livre II, dans les allocutions et les hymnes du livre III, dans l'Épinomis à la fin de ce même livre, et dans le résumé prétendu des dogmes de Zoroastre et de Pythagore, ajouté par nous à la suite du Traité des Lois, dont il n'est réellement qu'un abrégé.
[122] Propres paroles du livre II, chapitre du Destin.
[123] Même livre, même chapitre.
[124] Corresp. avec Bessarion, citée plus haut.
[125] Voir à ce sujet les distinctions beaucoup trop subtiles de Pléthon dans son chapitre du Destin.
[126] Lettre à Joseph l'Exarque, à la fin de ce volume. Ce témoignage est confirmé par divers passages de Pléthon lui-même, notamment dans la prière du soir, et dans l'Épinomis.
[127] La métempsycose de Pléthon se rapprochait sans doute de celle de Philon, dans son Traité des Songes, p. 585, éd. 1640. Tous deux l'ont empruntée à Platon, Républ. liv. X, et l'ont accommodée à leur manière. Platon, sans aucun doute, l'avait empruntée à Pythagore, le premier ou un des premiers qui ait apporté cette doctrine en Grèce : Ménage, sur Diog. de Laert. VIII, § 14.
[128] Traité des Différences entre Arist. et Plat., chap. 10 et 20, de nos extraits. George de Trébizonde relève cette proposition dans son ouvrage sur le même sujet, Compar. Aristot. et Platon., lib. I, chap. 7 : « Sed base inferiora imagines idearum esse scribit Gemistos. »
[129] Notamment liv. III, chap. 15, où il est dit que les grandeurs mathématiques ne sont que des ombres et des images des idées divines.
[130] Ou plutôt pour véhicule, ὄχημα; c'est le mot favori de Platon et de son école.
[131] Νοῦς
[132] Voir comment il parle des plaisirs des sens. liv. III, ch. 31. Il est certain qu'il prescrivait dans certains cas, comme peine infamante, la prostitution légale, ibidem, page 124, vers la fin. Mais pour l'adultère et certains vices infâmes, il était impitoyable, ibid.
[133] C'est le témoignage formel de Gennadius, lettre à Joseph l'Exarque, à la fin de ce volume, et cela semble s'accorder avec le titre du chapitre 16 du livre III, et du chapitre suivant. Cependant, sans l'affirmation de Gennadius, on ne pourrait conclure rigoureusement du premier titre qu'une seule chose, c'est que dans ce chapitre le, il discutait, peut-être sans l'approuver, la polygamie telle qu'il la voyait pratiquée autour de lui par les musulmans; et quant à la communauté des femmes, peut-être la restreignait-il à celles qui étaient vouées à la prostitution, soit volontaire, soit légale. Voir la note précédente, et, à défaut de textes plus précis, comparer le passage du livre III.
[134] Lettre de Gennadius, citée plus haut.
[135] Voir ce qui nous reste du livre III, ch. 31, sur les Jugements, et le rôle qu'il y fait jouer, page 128, à l'exégète ou interprète des choses sacrées, c'est-à-dire sans doute, au prêtre. Il avait donc cherché à donner dans l'organisation sociale une grande influence à l'élément religieux. Cependant au même chapitre, même page, il est question d'un conseil, tout à la fois tribunal, συνέδριον, où siègent des juges sous le nom d'archontes ou magistrats, ἄρχοντες, probablement simple institution municipale.
[136] Mémoire au prince Théodore, cité plus haut.
[137] Dans le catalogue des manuscrits de l'Escurial, par M. B. Miller, se trouvent indiqués, ms. 137, fol. 121. Mais nous croyons qu'il s'agit tout simplement des restes par nous publiés du ch. 31 du livre III, parce que ce manuscrit de l'Escurial s'accorde en général avec ceux de Bavière.
[138] Ce même titre, sur les Jugements, revient au livre III, ch. 31. Mais au livre I, il s'appliquait vraisemblablement à la législation civile, et au livre III, c'était, d'après ce qui nous en reste, un code de justice criminelle.
[139] Traité des lois, livre III, chap. 31.
[140] Même chapitre.
[141] Même chapitre.
[142] A partir du chapitre 34, et cette partie nous a été conservée tout entière.
[143] Livre III, ch. 36. On y distingue quatre modes de musique : l'hypodorien, consacré, comme le plus majestueux, à Jupiter et à tous les dieux ensemble ; l'hypophrygien, le second en majesté, consacré aux dieux olympiens; le phrygien, propre à exprimer la gaieté, consacré aux autres dieux ; le dorien, vif, animé, belliqueux, consacré aux hommes, dont la vie est un combat, et au dieu qui préside à leurs destinées. On n'y dit rien des autres variétés de ton énumérées dans Aristoxène, liv. II, p. 37, dans Aristide, liv. I, p. 23, et dans tous les ouvrages sur la musique antique. Mais quelle idée Pléthon pouvait-il se faire de celles même qu'il a conservées? Il est probable qu'il a appliqué un peu arbitrairement des noms anciens aux quatre tons qu'il trouvait les plus usités dans la musique grecque ou dans le plain-chant grec de son temps ; c'est donc à cette époque qu'il faut se reporter, et non au delà. Les évaluations qu'on tirerait des divers systèmes sur la musique antique, outre qu'elles seraient peut être contestables, n'auraient pas ici d'application, et elles sont d'avance rendues inutiles par une note de M. Vincent, à la fin de ce volume.
[144] Nous avons déjà dit que cette découverte avait été l'origine de notre ouvrage.
[145] Le calendrier de Pléthon (voir ce qui nous en reste, liv. I, ch. 21) mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est ni celui de Méton ni celui de Jules César ; c'est un mélange de tous les deux avec des changements ingénieux qui en rendent la symétrie plus exacte. Malheureusement la nécessité de compter les jours n rebours deux fois dans chaque mois, de deux semaines l'une, en rendrait l'usage fort incommode pour nous, bien que les Athéniens suivissent une pareille marche rétrograde dans la troisième décade de chaque mois; quant aux Romains, on peut dire qu'ils la suivaient constamment, puisqu'ils rapportaient chaque jour aux nones, aux ides ou aux calendes qui devaient suivre. Gaza, qui a connu le chapitre de Pléthon (voir les fragments à la suite de ce chapitre), le traite injustement, selon Allatius, de Mensura temporum, ou du moins, selon nous, trop lestement. On ne peut nier cependant que quelques-unes de ses critiques ne soient fondées, surtout lorsqu'il se plaint de la multiplicité des jours fériés, hiéroménies, qui enlève raient trop de temps à l'agriculture et à l'industrie. Voir l'excellente note de M. Vincent à la fin de ce volume.
[146] Pléthon emploie positivement le nom de prêtres, ἰερέων, livr. III, ch. 38, et dans sa Table de matières au livre I, cb. 22, où l'on voit même qu'il avait tracé pour eux des règles de vie. Il parle aussi de hérauts sacrés, espèce de muezzim ou de crieurs publics qu'il attache au service du culte, et qui devront être institués par un des prêtres liv. III, ibid.
[147] Voir, dans la Table en tête de l'ouvrage, les titres des chapitres 37, 38 et 39 du livre III.
[148] Pléthon lui-même parle de ces jeunes, au commencement du chapitre 36 de son livre III, et il les fait durer jusqu'au coucher de soleil, à la manière grecque.
[149] Extraits de Gaza insérés par nous au Traité des Lois, à la suite du livre I, chap. 51.
[150] Liv. III, chap. 31.
[151] A en juger par les titres des chapitres 26 et 27 du livre I.
[152] Liv. III, chap. 31.
[153] Voir notamment à la fin de la grande allocution du matin, des imitations très sensibles de la préface qu'on chante à la Messe, et du Te Deum.
[154] Lucien, Anti-attic., se moque de cette manie des atticistes de son temps, qui croyaient ajouter beaucoup à l'élégance de leur style, en ramassant de vieilles formes déjà tombées en désuétude à Athènes dès le siècle d'Alexandre. Biais ce défaut était une très-grande qualité pour les Grecs du Bas-Empire, et nous avons vu Gennadius lui-même en faire à Pléthon un sujet d'éloge. Cependant Théodore Gaza, fort supérieur comme littérateur et comme critique à la plupart des Grecs de son temps, ne partage pas cette admiration, et semble même, dans son livre des Mois, ch. 12, parler assez légèrement de l'atticisme de Pléthon, qu'il montre travaillant et tourmentant son style pour lui donner ce vernis d'antiquité.
[155] On s'en convaincra en essayant de lire de suite le chapitre 36 du livre III du Traité des lois.
[156] Ces hymnes font suite au chapitre 36. Ils sont au nombre de vingt-sept, chacun de neuf vers hexamètres, coupés en trois tercets, afin de pouvoir être divisés selon les besoins du rituel. Ils sont mal versifiés, et ne justifient pas du tout l'éloge de Lilius Gyraldus.rfe Poetis nostri temporis, lib. II, sub inlt. : « Hic quidem Pléthon et aliquando versibus lusit, dignis illis quidem tanto philosophe», sed paucis admodum. » Pléthon eût mieux fait de n'écrire qu'en prose, et il y a en effet de lui un hymne en prose au Dieu unique, qui ne manque pas de majesté; nous le donnons en tête des pièces justificatives, p. 273. L'hymne au soleil, attribué à notre auteur par Allatius, de Georgiis, g 23, dans Fabricius, Biblioth. gr., p. 98, éd. Harl., pourrait bien n'être autre que l'hymne de Proclus au même Dieu, retouché et remanié par notre auteur : on lu trouve en effet, avec des corrections qui le défigurent, parmi des extraits de Pléthon, dans un ms. de Venise, analysé par Morelli, tom. I, cod. 406. Cependant George de Trébizonde, Comp. Aristot. et Plat., chapitre déjà cité, semble avoir eu entre les mains un autre hymne au soleil dont il parle comme d'un morceau plus considérable : « Vidi, vidi ego et legi preces in Solem ejus, quibus, sicut creatorem tolius, hymnis extollit atque adorat, tanta verborum elegantia, compositionis; suavitate, numeri sonoritate. schematum rebus accommodata dignitate distinctum, ut nihil addi posse videatur, sententiis autem ita caute divinos Solis honores efferentem, ut ne doctiasiroi quidem [nisi] attentius saepiusque perlegerint, animadvertere possint. » On ne sait s'il s'agit d'un hymne en vers ou d'une prière en prose : dans tous les cas, cette pièce paraît, perdue, si toutefois ce n'est pas celle de Proclus citée plus haut; car on ne peut avoir grande confiance dans les affirmations de George de Trébizonde, quoiqu'il prétende parler de visu.
[157] Les hymnes, bien différents de ceux de Pléthon et bien supérieure pour le style, qui nous restent sous le nom d'Orphée, et dont Hermann a donné une excellente édition, sont, ainsi que les oracles de Zoroastre, dont nous parlerons tout à l'heure, des productions néo-pythagoriciennes du premier siècle avant et après notre ère. Les livres attribués à Hermès sont d'un néo-pythagoricien converti, d'un chrétien du premier siècle, mal dépouillé des traditions de son école. Les titres seuls de ces ouvrages prouvent la tendance que nous signalons à étayer les nouvelles doctrines du nom des anciens philosophes.
[158] Proclus, que Pléthon a beaucoup imité, comme Gennadius le lui reproche et comme nous le verrons tout à l'heure, avait écrit un livre aujourd'hui perdu. Nous empruntons ces titres à Fabricius, Bibl. gr. tom. IX, p. 429, éd. Harles.
[159] Proclus cite à tous moments, dans ses divers ouvrages, de prétendus oracles de Zoroastre, qu'il appelle λογία, quoique écrits en vers, et, soit dit par parenthèse, en assez mauvais vers grecs. On en trouve également des traces chez les autres néo-platoniciens, et c'est de leurs écrits qu'ont été recueillis les nombreux fragments qui ont servi à Patrizzi, et d'après lui à Jean Leclerc, pour augmenter le texte si incomplet donné par les manuscrits et commenté par Psellus et par Pléthon.
[160] Le travail de Pléthon sur l'interprétation des oracles de Zoroastre, travail antérieur selon nous à sa déclaration de guerre contre Aristote et auquel nous avons déjà fait allusion page vu, note 4, a été imprimé avec celui de Psellus (probablement Psellus l'ancien) sur le même sujet, à la suite de ces mêmes oracles, dans l'édition qu'en a donnée Opsopœus, Paris, 1599, et qui se trouve ordinairement à la suite des Sibylles du même éditeur. Si l'on rencontre ci et là dans le commentaire de Psellus quelques opinions hétérodoxes empruntées à ses études néo-platoniciennes, on remarque à chaque page dans celui de Pléthon des indices bien reconnaissables de ses fausses idées théologiques, notamment sur la hiérarchie des êtres, sur le second démiurge, sur les divers modes de création, sur les destinées de l'âme humaine, sur les rapports de la philosophie de Zoroastre avec celle de Platon, etc. Voir les extraits que nous en donnons à la fin de ce volume, p. 274 et suiv., avec les rapprochements indiqués en note.
[161] Voir le Traité des Lois, liv. I, ch. 2, et l'Epinomis à la fin du livre III. Les mêmes noms et les mêmes idées reviennent, à propos d'une autre discussion, dans la réplique au plaidoyer de Gennadius pour Aristote, p. 59 de l'édition de M. W. Gags, page 297 de notre Appendice.
[162] Mêmes ouvrages et mêmes passages. Les manuscrits de Pléthon donnent partout à ce législateur des Égyptiens le nom de Miv, gén. Mivôc, ce qui pourrait faire croire, faute d'attention, qu'il s'agit du législateur des Crétois et ce qui a en effet trompé M. Hardt dans sa traduction latine. Il ne faut attribuer qu'à l'iotacisme des copistes cette forme extraordinaire du nom égyptien ; sa vraie forme grecque est Μήν, gén. Μηνός, dans Hérodote, II, § 4 et 99, passages que Pléthon avait certainement dans l'esprit.
[163] Proclus, en effet, dans sa Théologie de Platon et dans son Institution théologique, mais surtout dans le premier de ces deux ouvrages, dont l'autre n'est guère qu'une répétition fort diffuse, présente des rapports frappants avec la théodicée et la théogonie de Pléthon : les détails différent, mais il y a proche parenté d'idées. Citons, pour exemples, cette unité première, Dieu par excellence, qui se ramifie en unités secondaires, formant un réseau de trinités entrelacées (Théol. III, ch. 1, sqq.); cette progression descendante d'êtres subordonnés les uns aux autres et partagés en cinq ordres : l'être proprement dit, la vie, l'intelligence, l'âme, le corps (même livre, ch. 6) ; ces deux divinités principales, ou plutôt ces deux modes d'essence d'une seule divinité, Jupiter et Vesta (dans Pléthon ce serait Neptune et Junon), présidant a trois triades de dieux, et les reliant ensemble a peu près dans cet ordre (ch. 22) :
Jupiter, en dehors et au-dessus de tous les autres;
Toutefois, hâtons-nous de le dire, ce que Pléthon emprunta surtout aux néo-platoniciens, ce fut l'orgueilleuse présomption d'une secte qui s'annonça comme devant rebâtir de fond en comble, sur les plans de son ancien maître, l'édifice de la connaissance humaine, et qui, sans faire apport à la science d'une seule donnée positive, prétendit dominer toutes les philosophie» et toutes les religions. Ce qu'il leur emprunta encore, ce fut ce recours continuel aux emblèmes pour déguiser le vague des idées, ce goût ou plutôt ce besoin d'allégories qui aboutit chez eux tantôt aux absurdités du mysticisme, tantôt aux extravagances de la démonologie et de la théurgie. Ce fut enfin la haine du christianisme, caractère dominant de cette école. En effet, nous la voyons s'allier, dès sa naissance, avec le paganisme où elle trouvait plus de complaisance pour les systèmes et une plus grande flexibilité de dogmes.
Cérès, Junon, Diane;
Veste (unissant la 2e triade à la 1ère), Minerve, Mars;
Mercure (unissant la 3e triade à la 2e), Vénus, Apollon ;
Au-dessus de ces neuf grands Dieux, la Nécessité et les Parques, ses filles, ch. 23 : au-dessous, les Curètes ou Corybantes, ch. 13, les Démons ou Génies, ch. 16 ; et au-dessous encore, les âmes, et enfin les corps, ch. 6.
Toute cette hiérarchie, très-embrouillée dans Proclus, ressemble certainement a celle de Pléthon, qui, malgré de nombreuses différences, n'en est qu'une imitation un peu moins subtile et moins confuse. Gennadius a donc raison de s'étonner que le nom de Proclus ne soit pas cité une seule fois par son imitateur dans le Traité des Lois, où ses idées ont été mises si largement a contribution. Mais pour être juste, il faut ajouter qu'on le trouve cité plusieurs fois avec éloge dans d'autres ouvrages du même auteur, notamment dans sa correspondance philosophique avec Bessarion, extr. d'Orelli, p. 336, et aussi dans sa réplique à Gennadius au sujet d'Aristote, p. 55, éd. Gass.
[164] Voir l'article de Psellis, § 11, dans la Biblioth. gr. de Fabricius, tom. X, p. 41, éd. Harl.
[165] A la fin de ce volume. Ce même Apostolius, dans deux lettres à Argyropule, ibid., se montre un des croyants de la nouvelle Église. Est-ce qu'Argyropule, au moins pendant quelque temps, en aurait lui-même fait partie?
[166] A la fin de ce volume. Il est remarquable que tout en avouant qu'il n'était pas admis à ces réunions, il ne laisse pas d'en faire le plus grand éloge. A l'entendre, Pléthon seul attirait à Sparte le reste de savants que possédait encore la Grèce, réduite à peu près au Péloponnèse. Après lui, que vont-ils devenir? Ils se disperseront dans toutes les parties du globe, ibid. Et nous les voyons en effet, peu de temps après, se réfugier dans le reste de l'Europe, a Paris même, où Hermonyme de Sparte (sans doute l'auteur de cette oraison funèbre) porta l'un des premiers la connaissance et le goût du grec.
[167] A la fin de ce volume. Cette phrase, souvent citée et commentée, a fait beaucoup de tort à la mémoire de Bessarion. Il ne faut cependant pas s'en exagérer la portée. Le chœur d'Iacchus était la danse ou le chant des initiés aux mystères d'Eleusis, un des jours où ils sortaient du temple en procession solennelle; elle avait pris le nom d'Iacchus ou Bacchus, divinité mystique qu'on célébrait dans ces chants, et dont probablement le nom était répété à chaque refrain, comme celui de Paean dans les hymnes en l'honneur d'Apollon. Le cardinal a donc voulu seulement exprimer que l'âme de Pléthon se réunirait dans le ciel à la troupe des bienheureux pour y célébrer éternellement les louanges de Dieu. C'est là, ce semble, la meilleure explication et celle à laquelle s'est arrêté Allatius, premier éditeur et traducteur de cette lettre. Voir dans ces expressions autre chose que des métaphores de mauvais goût, et surtout dans le nom d'Iacchus une allusion au saint nom du Rédempteur, ce serait prêter gratuitement à Bessarion une sorte de blasphème. Il n'en est pas moins vrai que, même dans le style mythologique dont la mode s'introduisait à cette époque, un tel abus de mots a quelque chose d'étrange et de blâmable sous la plume d'un prince de l'Église écrivant, dans une circonstance aussi grave, aux fils d'un homme dont il ne pouvait ignorer les idées païennes ; il devait, après la mort de son ami, ou déplorer ouvertement ces idées, ou du moins éviter d'y faire allusion.
[168] Charitonyme ou Hermonyme, dans son oraison funèbre de Pléthon, pressentait et prédisait cette dispersion.
[169] On se demande souvent en parcourant les œuvres de Ficin, si ce chanoine de Florence était chrétien, ou quel mélange bizarre s'était fait dans sa tête de deux théologies antipathiques et inconciliables. Il vécut pourtant tranquille et honoré dans sa patrie ; et s'il ne put éviter les attaques de quelques théologiens moins tolérants, leurs coups ne purent l'atteindre sous la protection des Médicis. Il revint, au reste, dans sa vieillesse, à des idées plus saines et plus conformes à son état. Il avait pu voir, mais non connaître Pléthon, étant né seulement en 1433, six ans avant le concile.
[170] Témoin encore la lettre de Cosme à Ficin, dans les œuvres de ce dernier, lib. i, p. 608, éd. de Bale : « Contuli heri me in agrum Charegium, non agri, sed animi colendi gratia. Veni ad nos, Marsili, quam primum. Fer tecum Platonis nostri librum de summo bono, quem te isthic arbitrer jam e graeca lingua in latinam, ut promiseras, transtulisse. Nihil enim ardentius cupio quam, quae via commodius ad felicilatem ducat, cognoscere. Vale, et veni, non absque Orphica lyra. » Et enfin le récit des derniers moments de Cosme fait par Ficin, dans sa lettre à Laurent de Médicis: « Denique Solonem philosophai imitatus, quum per omnem vitam vel in summis negotiis egregie philosophatus esset, illis tamen diebus quibus ex hac umbra migravit ad lucem, quam maxime philosophabatur. Itaque postquam Platonis librum de uno rerum principio ac de summo bono legimus, sicut tu nosti qui aderas, paulo post discessit, tanquam eo ipso bono quod disputatione gustaverat, re ipsa abunde jam potiturus. »
[171] Sur cette première académie de Rome (si toutefois on peut donner ce nom à une association libre de savants, de gens de lettres et d'amateurs), voir les détails par Mich. Cannesio, dans sa Vie de Paul II, éd. du cardinal Quirini, p. 78 et suiv, citée par Tiraboschi, tom. VI, p. 108, sqq. éd. Modrn. Le pape Paul II, qui la persécuta et ne vint pas à bout de la détruire, lui reprochait d'être une réunion d'hérétiques et d'incrédules, où l'on affectait de ne porter que des noms païens, où l'on ne jurait plus que par Platon, etc. Le récit de ces persécutions est dans Platina, Vie de Paul II, p. ccclvi et suiv, de l'éd. de Lyon, 1512.
[172] Sur les projets et les propos de Pomponius Laetus, tous les biographes sont d'accord : mais peut-être ont-ils adopté trop légèrement beaucoup d'anecdotes répandues à ce sujet; voir Chaufepié, suppl. de Bayle, et les sources qu'il indique.
[173] L'identité de Pierre de Calabre avec Pomponius Laetus ou Sabinus ne saurait être douteuse. Elle est reconnue par Thomas Blount, par Baillet, par Apostolo Zeno, et aujourd'hui par Cous les savants. Ce bâtard de l'illustre maison de Sanseverini, né à Amendolara, dans la haute Calabre, s'obstina toujours, par une noble fierté, à refuser la reconnaissance tardive de sa famille naturelle. Il ne pouvait donc guère porter dans sa jeunesse que son nom de baptême et le nom de son pays. Les noms latins qu'il adopta plus tard tiennent en partie à la mode de son temps, en partie à ses opinions païennes : c'était ce qu'il appelait se débaptiser.
[174] Il n'aurait eu que treize ans à l'époque du concile! Donnons-lui en vingt, pour qu'il ait pu causer science avec Pléthon.
[175] Au commencement du seizième siècle, et à 1b veille de la réforme provoquée par tant d'abus, le cardinal Bembo, secrétaire de Léon X, ne comptait-il pas dans le sacré collège quatorze cardinaux païens? Les goûts, sinon les opinions, du paganisme passèrent d'Italie dans le reste de l'Europe. Et de là, dans tous les ouvrages, à partir de la renaissance, l'abus de la mythologie mêlée a l'exposition de nos dogmes les plus saints, non-seulement dans les poèmes (Sannazar, le Mantuan, Vida, le Camoens, etc.), mais encore au milieu de la prose la plus sévère. Nous en avons vu un singulier exemple dans une lettre de Bessarion, ci-dessus. Le style même de la chaire en fut infecté, et les prescriptions, d'ailleurs si sages, du Ve concile de Latran n'essayèrent pas d'attaquer ce mal. La peinture ne resta pas en arrière de la littérature, et peut-être avec plus d'excuse; aussi conserva-t-elle plus longtemps ces habitudes profanes : témoins tous les plafonds de nos palais; témoins ces mélanges de prélats en costume d'église et de divinités païennes dans les tableaux de Rubens. La mode de ces fades allégories a traversé trois siècles, et est venue expirer de nos jours, au commencement du dix-neuvième.
[176] Sur l'exhumation des restes de Pléthon et sur leur translation dans l'église Saint-François à Rimini, par Sigismond-Pandolfe Malatesta, seigneur de cette ville, l'auteur à qui nous devons ce détail, Tiraboschi, tom. VI, éd. Moden. p. 354, en note, renvoie aux Miscellanea de Lucques, tom. V, p. 120. Après bien des démarches pour nous procurer ce recueil, nous avons reconnu qu'il n'ajoutait rien au simple renseignement de Tiraboschi.
[177] De ces attaques, la première en date est celle qui a pour titre : Matlhaei Camariotae orationes dux contra Pethonem de Fato, imprimée en grec et en latin par Samuel Reimar, à Leyde, 1721, in-8°. Elle est partagée en deux discours, ou plutôt en deux diatribes pleines de fiel et de violence. Dès le commencement du premier discours on y traite Pléthon d'athée, et un peu plus bas, de restaurateur des anciennes abominations du paganisme, d'âme ouverte à tous les démons; et dans le second discours, on lui reproche d'avoir dans sa vieillesse caché sa doctrine par hypocrisie, vivant d'une vie de lièvre, ne se révélant qu'à ses adeptes, mais gardant pour cire publiés après sa mort des livres destinés à corrompre le genre humain,. Et cependant Matthieu, homme très-pieux et même très-dévot, à en juger par ses autres ouvrages, ne connaissait encore que le chapitre sur le Destin ; il savait que le reste de l'ouvrage était gardé entre des mains sûres, celles du prince Démétrius, fort peu disposé à le laisser circuler dans le public, p. 47 du premier discours. Qu'eût-il dit s'il eût connu tout ce que nous possédons de cet ouvrage? La seconde attaque, non moins virulente, est dans l'avant-dernier chapitre de la dissertation de George de Trébizonde, Compar. Arlstot. et Plat., dont nous avons déjà vu plusieurs passages fort injurieux à l'adresse de Pléthon, ouvrage rédigé, comme nous l'avons dit ailleurs, vers 1455, imprimé à Venise en 1523, in-8. Une autre diatribe, mais plus récente de près d'un demi-siècle, est celle de Manuel Holobulus, orateur de la grande église grecque (comme il s'intitule), contrôle traité de Pléthon sur le Saint-Esprit, traité déjà réfuté par Gennadius, et qui ne méritait pas de l'être une seconde fois. Nous n'avons pas à Paris l'œuvre d'Holobulus, mais elle existe manuscrite dans plusieurs bibliothèques, et Allatius, de Georgiis, dans Fabricius, t. XII, p. 98, en cite en latin un morceau assez considérable.
[178] Nous publions une lamentation inédite sur ce sujet, parmi nos pièces justificatives.
[179] Voir la dissertation déjà plusieurs fois citée de Boivin le jeune, Mém. de. l'Acad. des Inscr, tom. II, p. 715.
[180] D'après ce que nous avons dit des attaques de George de Trébizonde contre Pléthon dans son livre sur la comparaison de Platon et d'Aristote, on peut s'étonner que Bessarion, dans les cinq livres de son grand ouvrage en réponse à celui de George, n'ait pas fait une seule allusion directe à son ancien maitre et ami. Il le nomme une fois, au commencement du sixième livre, intitulé de Natura et arte: « Plethon Constantinopolitanus, vir nostra aetate opinionum Platonis aemulus atque defensor, » et une autre fois, à la fin de ce même livre : « Equidem si quid ex meo judicio in hanc quaestionem attuli, non Aristotelem damnans, non pro Plethone coutendens id feci. » Mais ce livre VI ne fait point partie intrinsèque de l'ouvrage, et lui est même antérieur. Le silence de Bessarion ne peut s'expliquer que par une discrétion facile à comprendre dans sa position officielle, après le bruit qu'avait dû faire la condamnation du Traité des Lois. Mais si dans l'ouvrage du cardinal le nom de Pléthon reste voilé, on n'en sent pas moins, à chaque instant, que l'avocat du philosophe d'Athènes est en même temps l'ami et le défenseur du philosophe de Sparte.
[181] Cette lettre a été publiée par Boivin le jeune, en français, dans son mémoire déjà souvent cité, et en grec, avec une traduction latine, dans le tome III du même recueil académique, 1ère part., p. 303 et suiv.
[182] Outre un grand nombre d'histoires de la philosophie, de la littérature et de la renaissance, on peut consulter les savants grecs de cette dernière époque, les ouvrages spéciaux de Börner et de Humphr. Hody.
[183] Ce morceau se trouve dans un très grand nombre de manuscrits, à Vienne, à Munich, à Florence, à Naples, à Madrid, etc. Il y en a quatre à la seule bibliothèque de Paris : 1996, 2077, 2826 (Falc.) et 66 du suppl. Il a été édité par Samuel Reimar, à Leyde, en 1722, et d'après lui, par Gasp. Orelli, avec le traité d'Alexandre d'Aphrodise sur le Destin et d'autres opuscules sur le même sujet. Hardt l'a également publié, dans le tome V de son catalogue, d'après le ms. 490 du fonds d'Augsbourg. Nous avons mis tous ces matériaux à profit dans notre édition. Nous ne croyons pas, au reste, qu'il puisse s'élever de doutes sur le point de savoir si cette dissertation de Pléthon faisait véritablement partie du Traité des Lois. D'abord, il est certain que ce dernier ouvrage contenait un chapitre sur le même sujet, Περὶ Εἰμαρμένης. C'est le chapitre 6 du livre II, où notre morceau trouve sa place naturelle; et, en effet, dans le ms. de Vienne, au témoignage de Lambécius, il porte pour titre : Πότερα δὲ ὥρισταί τε, κ. τ. λ., indication précieuse et concluante. D'ailleurs, l'opuscule que nous avons, débute évidemment comme un extrait d'un plus grand ouvrage. Enfin Pléthon y parle à chaque instant des Dieux au pluriel, et de Jupiter, leur chef, leur père et leur maître. C'est bien là le même système théologique que dans le livre des Lois, et un tel langage, à l'époque où Pléthon écrivait, n'aurait pas même eu de sens en dehors de ce système et de cet ouvrage.
[184] Rien ne nous porte à croire que cet ami fût Bessarion, ni même que celui-ci ait jamais eu connaissance du chapitre dont il s'agit, au moins du vivant de son auteur. Ce qui semble prouver le contraire, c'est sa correspondance avec Pléthon sur diverses questions philosophiques, et entre autres sur celle du Destin (voir ci-dessus p. xi, not. 3), sans aucune allusion au chapitre qui nous occupe ni au paganisme dont il est infecté. Quant à une lettre ad Demterium Porphyrogenetum, dont parle ou semble parler Allatius, de Georgiis, apud Fabr. t. XII, p. 95, éd. Harl. et qui aurait existé dans la bibliothèque des clercs réguliers de l'église des Saints-Anges à Naples, il ne faut pas s'en préoccuper : il y a eu là quelque erreur de copiste, et la lettre en question n'est autre que le προσφωνημάτιον dont nous avons parlé plus haut. Déjà M. Hardt, tom. V de son catalogue, p. 128, en avait fait l'observation.
[185] Cela résulte clairement du passage même où Mathieu Camariote se plaint de ceux qui s'obstinent à garder entre leurs mains le livre de Pléthon. Mais cela n'est pas vrai : car nous savons, par la lettre à Joseph l'Exarque (voir la note suivante), que le livre était gardé en dépôt, précisément pour en empêcher la publication, par Démétrius, despote de Sparte, qu'on ne peut accuser d'avoir partagé les idées païennes de Pléthon.
[186] C'est le témoignage formel de Gennadius à Joseph l'Exarque
[187] A Paris, à Vienne et partout. Nous avons collationné tous ceux de Paris, et nous en donnons la liste dans la note en bas de ce même chapitre.
[188] D'abord, par Samuel Reimar, en grec et en latin, Leyde, 1772, in-8°, à la suite, comme nous l'avons déjà dit, de l'ouvrage de Mathieu Camariote, avec la correspondance philosophique entre Bessarion et Pléthon, dont nous avons parlé ci-dessus ; ensuite, mais sans la correspondance, par Hardt, dans le recueil d'Arétin, Beytrage zur Geschichte, etc. tom. VIII, p. 680, sqq. et plus tard par le même, dans son Catalogue des mss. grecs de la bibliothèque de Munich, tom. V, p. 92, sqq. ; enfin d'après Reimar et assez négligemment, par M. Gaspard Orelli, dans son recueil d'opuscules grecs sur le Destin, avec un extrait de la correspondance susdite.
[189] Il a existé autrefois dans le ms. de don Hurtado, déjà cité anciennement par Gesner, et plus tard par Allatius, de Georgiis, et qui est aujourd'hui à la bibliothèque de l'Escurial, n° 137 du catalogue de M. Miller. En effet, on le trouve mentionné dans la table en tête de ce manuscrit; mais le feuillet qui le contenait a été arraché-Nous n'avons aucune raison de supposer qu'il contint autre chose que ce qu'on trouve dans le ms. de Munich, presque en tout con forme à celui-ci.
[190] Voir cette partie du récit dans une note de la main de Gennadius lui-même au bas de sa Lettre à Joseph l'Exarque.
[191] A Munich, dans le ms. 336, fol. 134, sqq. d'après lequel ils ont été reproduits par Hardt. Le chap. 4 se trouve aussi à Munich, dans le ms. 495 du fonds d'Augsbourg. A Vienne, dans le ms. 91, analysé par Lambécius dans son VIIe volume, on retrouve le préambule et les cinq chapitres; mais le commencement de la table des matières a disparu jusqu'au chapitre 29 du IIIe livre, et, chose assez bizarre, le préambule est rejeté après la table. Les mêmes morceaux nous ont été signalés à Naples, par le savant bibliothécaire, M. Scotti. Le manuscrit d'Athènes, ou, si l'on veut, de Constantinople, dont nous devons la communication a la bienveillance de M. Le Barbier, contient aussi la table des matières (sans le préambule) et les chapitres 1, 3, 5, mais avec quelques omissions faites à dessein par le copiste.
[192] Sans doute à la bibliothèque Barberine, où il atteste leur présence dans le ms. 263, avec cette note d'un anonyme : « Hoc tantum ex divino illo volumine politicoruin sive de legibus Gemisti ad nos pervenit; reliquum sacrilegus Scholarius flammis consumpsit, veterique odio et inimicitiis adeo induisit, ut ne communi quidem utilitati pepercerit, saeviens in libros quando in auctorem nequiverit. » Fabric. t. XII, p. 100, éd Harl.
[193] Dans son livre, aujourd'hui fort rare, de Mensura temporum, cap. 11, p. 103, et dans son traité de Georgiis. Ce même préambule a été reproduit par Lambécius, dans son catalogue des manuscrits de Vienne, tom. VII, p. 565, éd. Kollar, et par Hardt, avec les morceaux suivants.
[194] Dans le recueil d'Arétin, tom. VI, p. 270, et dans le catalogue de Munich, tom. III, p. 365, avec d'autres extraits du Traité des Lois. Mais la table des matières figure à part dans le même tome III, p. 330, sqq.
[195] Notamment avec le manuscrit d'Athènes.
[196] Allat., de Mensura temporum, loc. cit.
[197] Toujours d'après le ms. de Munich 336, où il vient immédiatement à la suite du morceau sur la Mesure et la Proportion. Il paraît qu'il en est de même dans te ms. de Vienne 91, analysé par Lambécius, et que ces deux manuscrits ne présentent, quant à ce fragment, aucune différence.
[198] Toujours d'après le même manuscrit 336.
[199] Biblioth. gr. (ancienne éd.), tom. XIV, p. 140, d'après une brochure de Thryllitius, publiée à Wittemberg, en 1719, et que nous n'avons pu nous procurer. Dans le manuscrit d'où ce morceau a été tiré par son premier éditeur, il faisait suite immédiatement et sans lacune aux Zoroastrea (voir ci-dessous), en sorte que Thryllitius et Fabricius lui-même ont cru qu'il faisait partie de ce dernier ouvrage. On remarque absolument la même chose dans le ms. de Paris, n° 462, dont nous nous sommes servis. Hardt a donné la On de ce morceau d'après son ms. 336, au tom. III, p. 403 de son catalogue, et il paraît l'avoir aussi rencontré dans le ms. 48, dont il nous a donné l'analyse, sans en rien publier. Enfin, c'est sans doute encore ce même morceau qui figure au ms. de l'Escurial 137 du catalogue de M. Miller.
[200] Dans le ms. 2045, où personne avant M. Vincent n'y avait lait attention (voir le commencement de cette notice). Ils sont aussi à Vienne dans le ms. 28 du catalogue de Lambécius.
[201] Ces morceaux avaient frappé l'attention de M. Vincent, à la Bibliothèque impériale de Paris, dans le ms. 66 du supplément. Hardt en a signalé aussi une grande partie dans le ms. de Munich 237 ; mais il ne paraît pas y avoir attaché assez d'importance, puisqu'il ne les a pas édiles comme d'autres fragments du même ouvrage. Au reste, le ms. de Munich donne bien tous les hymnes en vers, mais il n'offre qu'une bible partie des prières en prose ou allocutions. Celui de Paris renferme toutes les allocutions et seulement une petite partie des hymnes, en sorte que ces deux manuscrits se complètent l'un par l'autre. Un autre manuscrit de Munich, 495, contient seulement trois hymnes : à Apollon, à Bacchus et à tous les Dieux, de notre édit. 7, 11 et 18, qu'on retrouve dans le ms. 137 de l'Escurial, d'après le catalogue de M. Miller.
[202] A Florence, à Venise, à Naples, à Vienne, à Munich. Il manquait à Paris, au moins dans l'ancien catalogue ; mais on l'y trouve maintenant dans le ms. 66 du supplément, sur lequel nous l'avons collationné.
[203] Ce morceau existe manuscrit dans un très-grand nombre de bibliothèques ; nous en avons à Paris seulement quatre copies sous les nos 462, 1603, 1739 (omis dans l'index du catalogue) et 2376.
[204] D'abord par Thryllitius, dans la brochure déjà citée tout à l'heure, brochure dont la perle n'est pas fort à regretter, parce que Fabricius, dans son tome XIV, endroit déjà cité, l'a reproduite textuellement et, on peut dire, trop fidèlement, même avec les fautes.
[205] Les sources où nous avons puisé ces documents et les manuscrits que nous avons consultés sont indiqués au bas de chaque morceau; c'est pourquoi nous nous bornons ici à une simple table des matières.
[206] Tétrardus par corruption.
[207] Cette raison pourrait ne pas paraître suffisante si nous n’ajoutions ici que notre hypothèse sur la position de la finale est la seule qui, à notre jugement du moins, s’accorde avec la suite du texte de Pléthon.
[208] Voir Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque, etc., t. XVI, 2e partie, p. 97 et suiv. (Notes). — Congrès scientifique d’Arras, Discours sur la musique des anciens Grecs, 1853, p. 378. — Revue archéologique, t. XIV, p. 620: Note sur la modalité du chant ecclésiastique.