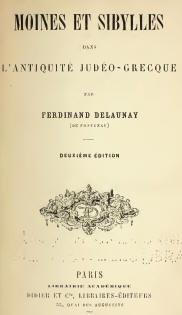
PHILON D'ALEXANDRIE
DE LA VΙΕ CONTEMPLATIVE OU DES VERTUS DES SUPPLIANTS
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
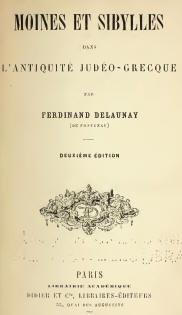
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
MOINES ET SIBYLLES
DANS
L'ANTIQUITÉ JUDÉO-GRECQUE
par
FERDINAND DELAUNAY
(de fontenay)
DEUXIÈME ÉDITION

PARIS
LIBRAIRIE ACADÉMIQUE
DIDIER ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS
35, QUAI DES AUGUSTINS
1874
Tous droits réservés
LE MONACHISME JUDÉO-ALEXANDRIN
------------------
Après avoir parlé des Esséniens, qui aiment et pratiquent la vie active mieux que tous les hommes, ou, afin de me servir d'une expression plus acceptable, mieux que la plupart des hommes, pour suivre l'ordre du sujet, je dirai ce qui concerne ceux qui ont embrassé la vie contemplative.[2]
Je ne tirerai de mon fonds aucun ornement, comme il arrive d'ordinaire aux poètes et aux faiseurs de discours,[3] auxquels la beauté de la matière manque ; je procéderai avec simplicité, et ne viserai qu'à l'exactitude. Il n'y a pas d'éloquence qui puisse atteindre ici la vérité. J'y ferai cependant tous mes efforts : il ne faut pas que la grandeur de la vertu chez ces hommes réduise au silence ceux qui estiment que rien de ce qui est beau ne doit être tenu caché.
La doctrine de ces philosophes apparaît tout d'abord dans leur nom : on les appelle avec raison Thérapeutes et Thérapeutrides,[4] soit parce qu'ils font profession d'une médecine supérieure à celle qui a cours dans les villes, qui ne guérit que le corps, tandis que la leur délivre les âmes de ces maladies graves et rebelles dont nous affligent les voluptés, les désirs, les soucis, la crainte, l'avarice, l'irréflexion, l'injustice elles autres passions qui forment l'innombrable multitude des vices ; soit parce qu'ils ont appris par l'étude de la nature et des saintes lois à servir l'Être, qui est meilleur que le bien, plus pur que l'unité, préexistant à la monade.[5]
Qui pourrait-on leur comparer parmi ceux qui font montre de leur piété?
Sera-ce ceux qui adorent les éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, auquel chacun donne les noms qu'il lui plaît? Ainsi le feu, ce me semble, a été appelé Hêphaestos du mot Exapsis, qui signifie l'action d'allumer; l'air a été appelé Hêra, du mot Hœresthai, qui signifie s'élever, parce qu'il tend à monter ; l'eau a été appelée Poséidon, sans doute du mot Potos, qui signifie boisson; la terre a été appelée Déméter,[6] parce qu'elle paraît être la mère (mêter) des végétaux et des animaux. Ces noms sont des inventions de sophistes. Les éléments ne sont rien qu'une matière inanimée, inerte, soumise à l'ouvrier pour recevoir de lui les formes[7] d'où résultent l'aspect et la qualité des choses.
Sera-ce ceux qui adorent les influences célestes, le soleil, la lune, les autres astres, fixes ou errants, le ciel entier et le monde? Ces êtres, pas plus que les autres, ne se sont faits d'eux-mêmes ; ils sont l'œuvre d'un démiurge[8] d'une science profonde.
Sera-ce ceux qui adorent les demi-dieux? culte ridicule ! Comment, en effet, une même personne peut-elle être à la fois mortelle et immortelle? Et puis, en remontant à l'origine de leur naissance, on voit qu'elle est blâmable, le résultat d'une débauche juvénile, qu'on ose absurdement attribuer à la sérénité des Puissances divines ; comme si ces Puissances, qui sont à l'abri de toute passion, et trois fois heureuses pouvaient avoir eu commerce amoureux avec des femmes mortelles !
Sera-ce ceux qui adorent les statues et les images, objets de pierre et de bois, choses informes, il n'y a qu'un instant, faisant partie d'un bloc que le maçon ou le menuisier a divisé, et dont les autres morceaux, de même provenance et de même espèce que l'idole, sont devenus cruches, bassins et autres vases encore plus abjects, destinés aux besoins que l'on satisfait dans l'ombre plutôt qu'au jour?
Quant aux divinités des Égyptiens, il est honteux d'en parler. Ils prodiguent les honneurs divins à des brutes, et non pas seulement à celles qui sont inoffensives, mais aux plus féroces des bêtes sauvages; ils en choisissent dans chacune des régions sublunaires : sur la terre, c'est le lion; dans l'eau, le crocodile de leur pays ; dans l'air, l'épervier et l'ibis d'Egypte. Et pourtant, ils voient ces animaux naître, avoir besoin de nourriture, être voraces, insatiables, sales, venimeux, avides de chair humaine, sujets à toutes sortes de maladies, souvent périr de mort naturelle ou même violente ; et des hommes doux et traitables adorent des êtres indomptables et féroces ; des hommes doués de raison adorent des brutes ; des créatures apparentées à la Divinité adorent des animaux inférieurs à certaines bêtes fauves; les seigneurs et maîtres se prosternent devant ceux que la nature a faits leurs sujets et leurs serviteurs![9] O vous qui souillez de telles impuretés vos compatriotes et ceux qui vous fréquentent, restez donc à jamais incurables dans votre cécité, privés du plus précieux des sens, de la vue, j'entends celle, non pas du corps, mais de l'âme, qui, seule, distingue la vérité du mensonge. Et vous, Thérapeutes,[10] dont tous les efforts tendent à aiguiser la vue de l'esprit, montez jusqu'à la contemplation de l'Etre, dépassez le soleil sensible et n'abandonnez jamais cette voie qui mène à la félicité parfaite.
Ceux qui embrassent la vie des Thérapeutes[11] ne cèdent ni à la coutume, ni à l'influence des conseils, mais à l'entraînement de l'amour céleste ; pareils à ceux qui célèbrent les fêtes de Bacchus et aux Corybantes, ils ressentent des transports qui ne s'apaisent que quand ils sont parvenus à voir l'objet de leurs désirs. Dans l'ardeur qui les porte vers cette vie immortelle et bienheureuse, et dans la pensée qu'ils ont achevé la vie mortelle, ils ouvrent de leur propre gré leur héritage et laissent leurs biens soit à leurs enfants, soit à leurs proches. Ceux qui n'ont pas de parents font cet abandon à leurs compagnons et à leurs amis. Il faut, en effet, que ceux qui ont acquis les trésors de la vue intellectuelle, laissent les biens qui aveuglent à ceux dont la pensée est encore enveloppée de ténèbres.
Les Grecs vantent Anaxagore et Démocrite qui, saisis d'ardeur pour la philosophie, laissèrent leurs champs incultes; moi aussi,[12] j'aime en ces hommes le dédain des richesses ; mais combien je leur préfère ceux qui ne laissent pas leurs biens en pâture aux troupeaux, et qui, secourant la misère de leurs proches ou de leurs amis, de pauvres les rendent riches!
J'appellerai cet acte irréfléchi, ne voulant pas qualifier d'insensée la conduite d'hommes que la Grèce a admirés;[13] la conduite des Thérapeutes est au contraire prudente et inspirée par une sagesse plus élevée. Des ennemis qui dévastent et ravagent le pays de leurs adversaires pour les réduire par la famine, ne font rien autre chose que ceux qui, comme Démocrite, causent l'indigence de leurs proches, moins par inimitié que par imprévoyance et pour n'avoir pas songé à l'intérêt d'autrui. Combien les Thérapeutes me paraissent supérieurs et plus dignes d'admiration! Ils sont portés vers la philosophie par un élan non moins passionné, mais leur générosité surpasse leur mépris des richesses; ils aiment mieux donner leurs biens que de les perdre ; ils cherchent à la fois le profit d'autrui et le leur, puisque les autres trouvent le bonheur dans l'abondance des biens et eux dans la pratique de la philosophie.
En effet, le soin des richesses et des biens nous prend le temps, et il convient d'en être avare ; car, suivant le médecin Hippocrate, « courte est la vie, longue est la science. » Homère aussi me paraît exprimer la même pensée, au commencement du treizième chant de l’Iliade, dans ces vers :
Des valeureux Mysiens surgissent les rivages.
Ils combattent de près ; ces guerriers sont des sages
Dont la frugalité se contente de lait.
Comme si la préoccupation de satisfaire aux besoins de la vie engendrait le gain et l'injustice, à cause de l'inégalité; tandis que la justice, résultat de l'égalité, provient d'une manière d'agir opposée;[14] or, c'est la justice qui nous manifeste la vraie richesse, celle de la nature,[15] bien supérieure à celle qui consiste dans de vaines opinions.
Lorsqu'ils se sont débarrassés de leurs biens, et qu'aucun charme ne les relient plus, ils s'enfuient sans retour,[16] abandonnant frères, enfants, femmes et parents, loin des lieux fréquentés où sont leurs familles, leurs amis, leurs compagnons, loin de la patrie qui les a vus naître et grandir : car le commerce des autres hommes peut beaucoup pour entraver et séduire. Ils émigrent, non pas dans une autre ville, comme ces esclaves qui obtiennent de leurs possesseurs qu'on les vende ; infortunés et misérables qui n'échappent pas à la servitude parce qu'ils changent de maîtres ! D'ailleurs il n'y a pas de ville, même la mieux policée, qui ne soit remplie de troubles, de désordres, de tracas sans nombre, intolérables à celui qui s'est voué à la sagesse.[17] Ils s'établissent hors des murs des cités, dans des jardins ou des lieux solitaires, recherchant la solitude, non par une misanthropie farouche, mais pour éviter le contact avec des hommes de mœurs opposées, sachant que ce contact est dangereux et nuisible.
Cette espèce de sages existe en beaucoup d'endroits de la terre habitée; car il convenait que la Grèce et les pays barbares possédassent également ces modèles de vertu[18] ? On les trouve en plus grand nombre en Egypte, dans chacune des provinces qu'on appelle Nomes, et surtout aux environs d'Alexandrie.
De toutes parts les Thérapeutes les plus éminents sont envoyés en colonie dans un lieu fort propice, qui paraît considéré comme la patrie[19] de la secte; ce lieu est situé au bord du lac Maria, sur une colline peu élevée, aussi bien choisie pour la sûreté du lieu que pour la pureté de l'air. La sûreté est fournie par une ceinture de métairies et de villages, et la bonté de l'air provient des brises continuelles qui s'élèvent non-seulement du lac à son embouchure dans la mer, mais encore de la mer elle-même qui est voisine. Les brises du large sont subtiles, celles de l'embouchure du lac sont épaisses, et de leur mélange résulte un état atmosphérique très salubre.
Les habitations des solitaires réunis sont très simples et leur fournissent un abri contre deux choses qu'il faut de toute nécessité combattre, l'ardeur du soleil et les rigueurs du froid ; elles ne sont pas contiguës, comme dans les villes (les embarras du voisinage seraient importuns à des gens qui désirent et recherchent la solitude) ; elles ne sont pas éloignées, à cause de la communauté qu'ils aiment, et afin de pouvoir se porter mutuellement secours, s'ils étaient attaqués par les voleurs.
Dans chaque habitation se trouve un lieu sacré, qu'on appelle Semnée[20] ou Monastère.[21] C'est là que dans l'isolement ils accomplissent les mystères[22] de leur sainte vie. Ils n'y apportent ni boisson ni aliment, ni rien de ce qui est nécessaire aux besoins du corps, mais la loi, les oracles sortis de la bouche des prophètes, des hymnes et ce qui est de nature à accroître et perfectionner la science et la piété.
La pensée de Dieu leur est toujours présente, au point que, même dans leurs songes, ils n'aperçoivent rien autre chose que les beautés des Vertus[23] de Dieu et de ses Puissances. Beaucoup d'entre eux parlent durant le sommeil[24] et reçoivent en songe la révélation des plus hauts enseignements de la science sacrée.
Ils ont l'habitude de prier deux fois chaque jour, le matin et le soir. Au lever du soleil, ils implorent un jour heureux, véritablement heureux, et demandent que leur intelligence s'emplisse de la lumière céleste ; au coucher du soleil, ils demandent que leur âme, entièrement affranchie des entraves des sens et du poids des choses sensibles, puisse retirée en elle-même et comme dans son conseil,[25] se livrer à la recherche de la vérité.
L'espace compris entre le matin et le soir est tout entier employé à la méditation. Ils étudient les saintes Écritures et appliquent à la philosophie de nos ancêtres la méthode de l'allégorie. Ils croient, en effet, que le sens littéral couvre un sens mystérieux que l'interprétation dévoile. Ils possèdent aussi des écrits composés à une époque reculée par les fondateurs de la secte. Ces fondateurs ont laissé de nombreux commentaires qui contiennent des modèles d'allégories et dont leurs successeurs se servent pour en composer d'autres en les imitant[26]…
Ils ne se livrent pas seulement à la contemplation, ils composent aussi à la louange de Dieu des hymnes et des cantiques, dont le mètre et la mélodie[27] varient, mais qu'ils adaptent, comme il convient, à un rythme grave.
Pendant six jours, chacun d'eux reste isolé, occupé à la philosophie, dans le monastère dont j'ai parlé, sans franchir le seuil de sa retraite, même sans jeter dehors un regard. Le septième jour, ils se réunissent comme pour un entretien commun. Ils s'assoient suivant l'ordre de l'âge, dans une attitude recueillie, ayant les mains ramenées vers le corps,[28] la droite entre la poitrine et la barbe, la gauche tombant sur le flanc.
Alors s'avance et prend la parole le plus âgé et le plus versé en science. Sa physionomie est grave, sa voix est grave; son discours est plein de raison et de sagesse; il n'a pas l'éclat de ceux des rhéteurs et des sophistes de notre temps : il ne vise qu'à la clarté de l'expression et à la précision des pensées, et, de la sorte, n'effleure pas seulement les oreilles, mais, par l'ouïe, pénètre dans l'esprit et s'y établit fermement. Tous les autres l'écoutent en silence et ne manifestent leur approbation que par un clin d'yeux ou un signe de tête.
Le Semnée commun dans lequel ils se réunissent le septième jour est formé par une double enceinte, l'une réservée aux hommes, l'autre aux femmes : car il est d'usage d'admettre à écouter ce discours les femmes qui ont embrassé le genre de vie de la secte. L'édifice est partagé par un mur de trois ou quatre coudées[29] de haut, en forme de parapet. Du sommet de ce mur jusqu'au toit l'espace est vide. Il y a de cette disposition deux motifs ; le premier, c'est de respecter la pudeur qui convient au sexe de la femme ; le second, de ne pas arrêter la voix de l'orateur.[30]
Apres avoir fait de la tempérance le fondement de leur âme,[31] ils édifient sur cette base les autres vertus. Aucun d'eux ne goûte d'aliment ou de boisson avant le coucher du soleil, car ils estiment que si l'étude de la philosophie est digne de la lumière, les nécessités du corps ne méritent que les ténèbres ; c'est pourquoi, à la philosophie ils consacrent le jour, au corps ils ne donnent qu'un court espace de la nuit.[32]
Quelques-uns, chez lesquels la passion de la science est encore plus forte, restent trois jours sans songer à la nourriture. Il y en a même qui trouvent tant de charmes et de jouissance à ce festin où la sagesse leur prodigue les trésors de ses enseignements, qu'ils supportent l'abstinence deux fois plus longtemps, et prennent à peine, au bout de six jours, la nourriture nécessaire.[33] Ainsi les cigales vivent, dit-on, de rosée, et trompent, à mon avis, la faim par leurs chants.
Il y a une réunion du septième jour qu'ils considèrent comme la plus sainte et la plus solennelle, et qu'ils ont jugée digne d'une célébration particulière. Ce jour-là, après les soins donnés à l'âme, ils fêtent le corps, qu'ils traitent comme une bête de somme, et dont ils suspendent pour un temps le labeur. Ils ne mangent rien de recherché, mais simplement du pain, assaisonné de sel, et auquel les plus délicats joignent de l'hysope ; ils ont pour boisson l'eau des sources. Ils cherchent à satisfaire les deux maîtresses que nous a données la nature, la faim et la soif, et ne leur offrent rien qui puisse les flatter, mais seulement les choses nécessaires et sans lesquelles on ne peut vivre. Pour ce motif, ils mangent de façon à n'avoir plus faim, ils boivent de façon à n'avoir plus soif, évitant la satiété comme un ennemi dangereux de l'âme et du corps.
Ils ont deux sortes d'abris, le vêtement et l'habitation. J'ai déjà dit de leur habitation qu'elle était sans recherche, construite à la hâte et en vue de la nécessité seule; leur vêtement est de même très simple, destiné à les protéger contre le froid et la chaleur : c'est, l'hiver, un épais manteau, en place de peau de bête avec sa fourrure, et l'été, une exomide, ou une tunique de lin.[34]
En toute chose, ils pratiquent l'humilité ; sachant bien que l'orgueil vient du mensonge, et l'humilité de la vérité; que ces deux choses sont comme deux sources ; que du mensonge découlent toutes les espèces de maux, et de la vérité tous les trésors des biens humains et divins.[35]
Je veux aussi décrire leurs réunions, raconter les réjouissances de leurs festins et les opposer à ce qui se passe ailleurs.
D'un côté, voici des convives, qui, après s'être gorgés de boissons, comme s'ils eussent absorbé, non du vin, mais quelque breuvage excitant à la folie ou à quelque chose de pis, dans les transports où les jette la perle de la raison, poussent des cris, et, pareils à des chiens enragés, se lèvent, se mordent entre eux, se coupent le nez, les oreilles, les doigts, et les autres parties du corps. Ils réalisent la fable du Cyclope et des compagnons d'Ulysse ; selon l'expression du poète, ils mangent des morceaux d'homme, mais avec plus de férocité que le cyclope. Celui-ci, en effet, croyant qu'il avait affaire à des ennemis, en fit sa proie ; les autres traitent ainsi dés compagnons et des amis, même leurs proches. C'est dans le partage de la table et du sel, c'est dans une réjouissance qu'ils commettent ces atrocités ; ils changent la salle du festin en arène, imitant les luttes gymniques, de la même façon que les faux monnayeurs imitent, en l'altérant, la monnaie ; car, ce ne sont pas des athlètes, mais des misérables.[36] Il faut, en effet, rappeler à leur honte que les athlètes descendent dans le stade à jeun, sous les regards des spectateurs, en plein jour, et que c'est avec adresse, pour remporter la victoire et obtenir les couronnes olympiques, qu'ils combattent.
Leurs banquets ne sont-ils pas comme la fausse monnaie de ces luttes? C'est la nuit, dans l'ombre, au sein de l'ivresse que verse le vin, c'est grossièrement et méchamment qu'ils insultent, qu'ils outragent et blessent ceux qui leur tombent sous la main. S'il n'y a personne pour s'interposer en arbitre, ils frappent avec un redoublement de force; ils donnent et reçoivent la mort. On ne leur fait pas moins de mal qu'ils n'en font; ils portent des coups sans le savoir. Comme le dit le poète comique, le vin qu'ils ont bu leur cause autant de mal qu'à leurs voisins. Ainsi, des gens qui venaient tout à l'heure au festin bien portants et amis, en sortent bientôt après ennemis et mutilés; les uns ont recours à l'assistance des avocats et des juges, les autres à celle des chirurgiens et des médecins.
Ceux des convives qui paraissent les plus modérés, comme si en place de vin ils avaient absorbé une purge de mandragore, sont pris de nausées. On les voit appuyés sur leur coude gauche, le cou tendu et oblique, souiller les coupes de leurs vomissements. Puis, ils tombent dans un profond sommeil ; ils ne voient, ils n'entendent plus rien ; on dirait qu'ils n'ont conservé de tous les sens qu'un seul, le plus vil, qui est le goût. J'en connais quelques-uns qui, se sentant déjà échauffés par le vin, avant de se plonger entièrement dans l'ivresse, calculent sur la diminution du vin et le nombre des jetons déposés[37] ce qui reste à boire pour le lendemain, persuadés que l'espoir de l'ivresse future ajoute à la jouissance du moment.
Ceux qui vivent de la sorte sans feu ni lieu,[38] sont ennemis de leurs parents, de leurs femmes et de leurs enfants, ennemis de leur patrie et d'eux-mêmes : car celle vie de mollesse et d'excès est pernicieuse à tous.
Peut-être prendra-t-on la défense de cette mode de banquets, reçue maintenant partout, que les Grecs et les barbares ont adoptée, dans leur empressement à copier la profusion et le luxe des Romains, et dont l'ordonnance vise plutôt à la montre qu'à la bonne chère. Les triclinia et les periclinia[39] sont d'écaille ou d'ivoire ou même d'une matière plus précieuse, enrichis pour la plupart de pierreries ; les tapis,[40] de pourpre, sont brodés d'or et d'argent ; les autres étoffes sont teintes de fleurs aux mille couleurs qui attirent le regard; il y a une multitude de vases rangés par catégories, des rhytons,[41] des patères,[42] des coupes,[43] et d'autres encore de toute forme et d'un art parfait, des Thériclées[44] et des ouvrages dus au burin des ciseleurs les plus habiles. Les serviteurs sont des esclaves d'une forme et d'une beauté irréprochables, qui paraissent moins destinés au service qu'à réjouir par leur aspect la vue de ceux qui les regardent.
Parmi ces esclaves, ceux qui sont encore enfants versent le vin, ceux qui sont adolescents portent l'eau. Ils sont parés et parfumés; ils ont le visage peint et fardé, les cheveux entrelacés et frisés avec art. Leur chevelure est longue; les uns la portent entière, d'autres l'ont coupée, à l'extrémité, sur le front, également de chaque côté, et en cercle. Ils sont revêtus de tuniques d'une finesse extrême, d'une blancheur éclatante, tombant par devant un peu au-dessous du genou, en arrière un peu au-dessous du jarret. Sur chaque bord, les fentes de la tunique sont rattachées par de grosses tresses doubles qui drapent obliquement l'étoffe et forment de larges plis sur les côtés. Ainsi parés, ils se tiennent en observation.
Il y a encore d'autres esclaves : sur leurs joues fleurit à peine le premier duvet ; ils faisaient tout à l'heure les délices des pédérastes ; car on les a dressés avec le dernier soin à cet important office. Pur étalage de l'opulence de l'amphitryon, ou plutôt, à vrai dire, de son mauvais goût, comme le savent ceux qui ont pris part à ces festins !
Avec cela, il y a une profusion de gâteaux, de sauces, de friandises élaborés par les pâtissiers et les cuisiniers, qui songent moins, comme il le faudrait, à réjouir le goût que la vue par l'élégance de leurs préparations. Sept services, et même davantage, se succèdent, étalant tout ce que la terre, la mer, les fleuves et l'air produisent, chargés des viandes les plus rares et les plus exquises des animaux terrestres, aquatiques ou ailés, tous différents d'appareil et d'assaisonnement. Pour n'omettre aucune espèce des productions de la nature, le dernier service qu'on apporte est rempli de fruits, sans compter ce qu'on réserve pour le souper et ce qu'on nomme les collations. Puis, on enlève les plats, les uns vidés par la· voracité des convives, qui, pareils à des foulques,[45] se sont gorgés au point de ne pas même laisser les os, les autres, où l'on voit des débris pêle-mêle, et des lambeaux à demi rongés.
Lorsqu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont l'estomac plein jusqu'à la gorge, affamés par leurs désirs, rassasiés par la chair, on les voit tendre le cou à la ronde, courir du regard après la qualité et la quantité des viandes, et de l'odorat après le fumet qu'elles exhalent. Enfin, quand ils ont pleinement repu leurs yeux et leurs narines, ils s'excitent encore à manger, en faisant l'éloge de la bonne chère et se récriant sur la magnificence de leur hôte.
Mais pourquoi insister sur des choses que la plupart des gens qui ont conservé quelque modération, blâment, comme surexcitant des désirs qu'il faudrait réprimer? La faim et la soif, malgré leurs horreurs, sont préférables à la profusion excessive de mets et de boissons que l'on recherche dans ces réjouissances.
Il y a chez les Grecs deux festins célèbres et dignes de remarque, auxquels Socrate assista. L'un fut donné par Callias, pour fêter la victoire d'Autolycus, qui avait remporté une couronne aux jeux olympiques ; l’autre fut donné par Agathon. Deux hommes, qui furent philosophes aussi bien dans leur conduite que dans leurs discours, Platon et Xénophon, ont jugé ces festins dignes de mémoire, et les ont consignés dans leurs écrits, les offrant à la postérité comme des modèles de la bonne ordonnance d'un banquet.
Et pourtant, si on les compare aux banquets des nôtres qui ont embrassé la vie contemplative, ils paraîtront ridicules. Ils ont chacun leurs plaisirs. Celui de Xénophon en offre de plus conformes à la nature humaine : il y est question de joueuses de flûte, de danseuses, de jongleurs, de bouffons qui sont fiers de leurs farces et de leurs quolibets ; il s'y agit de tout ce qui peut exciter la gaieté. Celui de Platon roule presque tout entier sur l'amour, non pas celui qui inspire aux hommes pour les femmes et à celles-ci pour les hommes des transports passionnés, qui n'ont toutefois rien de contraire à la loi de nature, mais sur cet amour dont les hommes brûlent pour d'autres hommes, qui ne diffèrent d'eux que par l'âge. S'il s'y rencontre quelque passage d'un ton plus élevé, où l'on parle de l'amour vrai et de la volupté céleste, c'est pure élégance; car la plus grande partie du livre est consacrée à célébrer la passion, impure et si répandue, qui détruit la virilité et cette vigueur aussi utile dans la paix que dans la guerre, qui engendre dans les âmes un mal énervant, qui transforme en androgynes[46] des hommes qu'il faudrait, par toutes sortes de soins, affermir et fortifier, qui déshonore le jeune âge, en lui donnant le rôle et le tempérament propres au sexe, objet de nos désirs, qui cause enfin aux pédérastes eux-mêmes les plus grands dommages, en ruinant leur corps, leur âme, leurs biens.
Qu'arrive-t-il, en effet? C'est que l'esprit du débauché, tendu vers sa passion, n'a de clairvoyance que pour elle, et dans tout le reste, qu'il s'agisse d'affaires publiques ou privées, apporte une vue hébétée, à cause de ses infâmes désirs, surtout s'ils sont inassouvis. Ses biens diminuent de deux manières, soit par incurie, soit par les dépenses que lui impose l'objet de sa passion. A tout cela s'ajoute un autre mal plus général et plus grand. Ce vice odieux cause la désolation des États, la destruction de la meilleure partie du genre humain, la stérilité et le dépérissement ; il rend le débauché pareil à ces laboureurs ignorants, qui, au lieu du sol profond de la plaine, ensemencent des endroits sablonneux, pierreux, escarpés, condamnés à ne jamais rien produire ou à étouffer les germes qui pourraient s'y développer.
Je passe sous silence les fictions de la fable, ces êtres possédant deux corps, que dans l'origine la puissance de l'amour avait réunis, et qui se sont séparés ensuite,[47] quand le lien harmonique qui les enchaînait s'est rompu. Ce sont là des contes, qui peuvent bien, par leur nouveauté, charmer les oreilles, mais que méprisent, comme de vaines superfluités, les disciples de Moïse, instruits dès leur enfance à aimer la vérité et à n'en point quitter les sentiers.
Ces banquets renommés contiennent assez de niaiseries pour porter en eux-mêmes leur condamnation, aux yeux de quiconque voudra ne pas s'en tenir à l'opinion reçue, qui les présente comme de parfaits modèles.[48] Je vais mettre en regard les banquets des hommes qui ont consacré d'une manière spéciale leur vie et leurs personnes à la connaissance et à la contemplation des choses de la nature, sous l'inspiration des saints préceptes du prophète Moïse.[49]
Ils se réunissent d'abord après un intervalle de sept semaines ; car ils n'honorent pas seulement le nombre sept en lui-même, mais aussi son carré,[50] qu'ils savent être pur et toujours vierge. Le jour de cette réunion arrive la veille de leur plus grande fête, laquelle tombe au cinquantième jour; il représente le plus saint et le plus naturel[51] des nombres, résultant du carré du triangle rectangle, principe de la génération et de l'agencement de l'univers.
Ils se rassemblent donc en habits blancs,[52] portant dans l'allégresse une gravité profonde. Au signal donné par l'un des éphiméreutes[53] (c'est le nom qu'ils ont l'habitude de donner à ceux qui remplissent cet office), avant de se mettre à table, ils se placent tous à la suite, en rang, avec ordre, et lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel ; leurs yeux, car ils sont formés à regarder les choses dignes de contemplation ; leurs mains, car elles sont pures de toute tache, et rien de ce qui touche la recherche du gain ne les a jamais souillées. Ils prient Dieu de leur être propice et de leur accorder un festin intellectuel.
Après la prière, les plus âgés prennent place à la table, selon le rang que donne l'admission dans la secte. En effet, ils ne considèrent pas comme des vieillards ceux qui sont avancés en âge et ont les cheveux blancs;[54] ils les considèrent comme des jeunes gens ou des adolescents, s'ils se sont senti tardivement du goût pour la vie contemplative. Ceux-là sont réputés vieux, qui, depuis le premier âge, ont passé leur jeunesse et atteint la maturité dans la partie contemplative de la philosophie, qui est assurément la plus belle et la plus divine.
Les femmes prennent part au repas. Elles sont pour la plupart âgées et vierges ; elles conservent la chasteté, non par nécessité, comme certaines prêtresses chez les Grecs, mais volontairement, obéissant à l'attrait et au désir de la sagesse, qui les pousse à embrasser la vie des solitaires. Dédaignant les plaisirs du corps, elles aspirent, non pas à la génération charnelle, mais à cette génération céleste, que, seule, l'âme éprise de Dieu peut accomplir d'elle-même, fécondée par les rayons intellectuels que le Père fait descendre en elle comme une semence, et qui lui manifestent les enseignements de la sagesse.[55]
Les places à table sont réglées de sorte que les hommes et les femmes demeurent séparés, les premiers à droite, les secondes à gauche.
On songe ici sans doute aux tapis, je ne dis pas somptueux, mais du moins moelleux, que l'on a dû préparer à ces hommes qui sont bien nés, de mœurs polies, et qui pratiquent la philosophie. Ces tapissent d'une matière commune, des nattes de la dernière simplicité, faites avec le papyrus du pays, et qui se relèvent légèrement à l'endroit où se posent les coudes, afin de servir d'appui. Ils se relâchent un peu de la rigidité lacédémonienne; mais, s'ils observent en tout et toujours une noble frugalité, ils n'en abhorrent pas moins les charmes de la volupté.
Ils ne sont pas servis par des esclaves, car ils pensent que posséder des serviteurs et des esclaves est chose tout à fait contraire au droit de la nature. La nature nous a tous engendrés libres; les injustices et l'avarice de quelques hommes, qui cherchaient à établir l'inégalité, source de tous maux, ont courbé les plus faibles sous le joug des plus forts.[56]
Dans ce festin sacré, il n'y a, je le répète, aucun esclave : ce sont des hommes libres qui servent et satisfont aux besoins de la table, non pas contraints, ou sur les ordres qu'ils attendent, mais en prévenant spontanément, avec zèle et empressement, les demandes des convives. Parmi les hommes libres, cet office n'est pas dévolu aux premiers venus, mais aux jeunes gens de la communauté, que l'on choisit avec le plus grand soin, par rang de mérite, en sorte qu'ils doivent être à la fois élégants, nobles, et sur le chemin de la plus haute vertu. Ces jeunes gens semblent des fils heureux et empressés autour de leurs pères et de leurs mères ; car ils voient dans les convives des parents communs auxquels les attache un lien plus étroit que celui du sang. Pour ceux qui jugent sainement, rien, en effet, ne crée une plus forte attache que la pratique du beau et du bien.
Au moment du repas, ils entrent dans la salle, vêtus de tuniques longues, sans ceinture, pour bannir de ce festin tout ce qui pourrait avoir un aspect de servilité.
Il y en a, je le sais, qui riront en entendant cela; mais ceux-là seuls riront dont la conduite est de nature à exciter les gémissements et les larmes.
Dans ces jours, ils ne boivent pas de vin, mais de l'eau très limpide, froide pour le plus grand nombre, tiède pour les vieillards les plus délicats.
La table est pure de mets sanglants;[57] elle offre pour nourriture du pain, pour condiment du sel ; on y joint de l'hysope pour assaisonnement, à l'usage de ceux qui veulent se régaler. Comme les prêtres dans les Niphales,[58] ils s'abstiennent de vin, et la droite raison leur prescrit ce genre de vie, car le vin est un breuvage de folie, et la variété des mets excite la plus insatiable des bêtes, la concupiscence.
Tels sont les préliminaires du banquet. Quand les convives ont pris place à table dans l'ordre que j'ai dit, quand les servants se tiennent debout rangés, prêts à remplir leur office, n'est-il pas question de boire, dira quelqu'un? Tout au contraire, un silence plus profond qu'auparavant s'établit, à ce point que nul n'oserait murmurer ou même respirer trop fort. L'un d'entre eux propose une question tirée de l'Écriture Sainte ou bien résout une question posée par un autre, sans s'inquiéter de la solution qu'il apporte ; car il ne cherche pas la gloire qui s'attache à l'éclat du discours; il n'a d'autre désir que de voir exactement ce dont il s'agit, et, l'ayant vu, de ne pas s'en prévaloir sur ceux qui lui sont inférieurs en perspicacité, parce qu'ils ont un désir d'apprendre égal au sien.[59]
Il enseigne donc à loisir, sans crainte des répétitions ou des longueurs, gravant les pensées dans les âmes. Dans les explications, données d'une manière rapide et sans pause, il arrive, en effet, que l'esprit de ceux qui écoutent, ne pouvant suivre, reste en arrière, et que l'intelligence des choses qu'on dit lui échappe.
Tourné vers l'orateur, l'auditoire attentif, dans une seule et même attitude, l'écoute ; il témoigne qu'il suit et comprend par un signe de tête ou le jeu de la physionomie ; qu'il approuve, par un air d'allégresse et une expression épanouie; qu'il est d'un autre avis, en branlant doucement la tête et en dressant un doigt de la main droite.[60] Les jeunes gens qui assistent n'écoutent pas avec moins de soin que ceux qui sont à table.
Les commentaires des saintes Écritures consistent en interprétations au moyen des allégories. L'ensemble de la loi leur paraît ressembler à un animal : les préceptes en sont le corps, et l'âme est représentée par l'esprit invisible caché sous les expressions. C'est dans cet esprit que la Raison,[61] à laquelle les mots servent de miroir, commence à s'apercevoir clairement elle-même et découvre sous les phrases les beautés extraordinaires des pensées; elle ouvre ensuite l'enveloppe qui les recouvre, et met à nu et au jour l'objet de sa recherche, mais pour ceux-là seuls qui peuvent, sur le moindre indice, voir l'invisible à travers le visible.
Quand il semble que le président[62] a assez parlé, et que tout s'est passé à souhait, l'orateur ayant discouru à propos, et l'auditoire ayant profité de son discours, un applaudissement unanime s'élève qui marque le plaisir qu'ils éprouvent.
Alors, le président se lève et chante un hymne à Dieu, qu'il a récemment composé lui-même ou tiré de quelque ancien poète. Les poètes[63] ont, en effet, laissé des mètres et des chants, sous forme, de vers trimètres, de cantiques, destinés à être chantés pendant les libations, autour de l'autel, en repos, en procession, en marche, bien adaptés aux nombreuses évolutions du chœur.[64]
A la suite du président chacun en fait autant, avec ordre, avec la décence qui convient, les autres écoulant dans le plus grand silence, excepté quand il faut chanter les dernières paroles de l'hymne et du refrain, car alors tous, hommes et femmes, unissent leurs voix.[65]
Lorsque chacun a chanté son hymne, les jeunes gens apportent la table dont j'ai parlé, sur laquelle se trouve le mets sacré par excellence, c'est-à-dire du pain fermenté, assaisonné de sel, auquel on joint de l'hysope. C'est par vénération pour la table sainte, dressée dans le vestibule du temple. Sur cette table, en effet, il y a des pains et du sel, mais sans aucune douceur : car le pain est azyme,[66] le sel est sans mélange. Pourquoi? C'est qu'il convenait d'accorder à la classe éminente des prêtres, en récompense du service divin, des choses d'une simplicité et d'une pureté extrêmes; les autres hommes doivent se former là-dessus, mais pourtant s'abstenir de ces pains, afin de conserver leur privilège à ceux qui sont supérieurs.[67]
Après le repas, ils célèbrent la veillée sacrée. Voici comment :
Ils se lèvent tous et se groupent d'abord, au milieu de la salle du festin, de façon à former deux chœurs, celui des hommes et celui des femmes. On choisit pour conduire chacun d'eux la personne la plus respectée et qui sait le mieux chanter. Ensuite, ils entonnent à la louange de Dieu des hymnes composés avec des mètres et sur des airs différents; tantôt leurs voix s'unissent, tantôt elles se répondent[68] en harmonies dont leurs gestes marquent la cadence. Ils dansent au milieu de saints transports ; tantôt ils marchent, tantôt ils s'arrêtent, exécutant les strophes et les antistrophes en rapport avec ces mouvements.[69]
Lorsque chacun des chœurs s'est séparément rassasié de ce plaisir, comme il arrive dans les fêtes de Bacchus, enivrés du vin de l'amour de Dieu, ils se mêlent.[70] Les deux chœurs n'en forment plus qu'un, à l'imitation de celui qui fut formé jadis au bord de la mer Rouge, à cause de l'étonnant prodige qui s'y était opéré. En effet, la mer, à l'ordre de Dieu, sauva un peuple et engloutit l'autre ; les flots furent violemment séparés et affermis des deux côtés en forme de murailles; l'espace intermédiaire, rendu libre, fournit au peuple hébreu une route large et sèche qui lui permit de traverser la haute mer et d'atteindre le rivage du continent opposé ; puis, les eaux refluant inondèrent de part et d'autre le sol laissé à découvert, et les ennemis dans leur poursuite furent engloutis et périrent. A la vue de ce prodige accompli pour eux, et qui dépassait l'imagination et l'espérance, les hommes et les femmes, saisis d'enthousiasme, célébrèrent par leurs chants Dieu leur sauveur. Le chœur des hommes était conduit par le prophète Moïse, celui des femmes par la prophétesse Marie.
C'est surtout à l'image de ce chœur que celui des Thérapeutes et des Thérapeutrides est composé de chants[71] qui se combinent et se répondent ; les voix graves des hommes, mêlées aux voies aiguës des femmes, produisent un ensemble harmonieux et véritablement musical. Les pensées sont très belles, les paroles ne le sont pas moins ; les danses sont graves. Pensées, paroles et danses ont le même but, la piété.
Ils se plongent jusqu'au matin dans cette noble ivresse, qui, loin d'alourdir leur tête, d'appesantir leurs paupières, les tient plus alertes que quand ils sont arrivés au festin. Le matin venu, leurs regards et tout leur corps se tournent vers l'Orient. Quand ils aperçoivent les premiers rayons du soleil, ils lèvent leurs mains au ciel, implorent un jour heureux, la connaissance de la vérité et la lucidité de l'intelligence.
Après cette prière, chacun regagne son semnée pour y reprendre, comme à l'ordinaire, la culture de la philosophie.
Voilà ce que j'avais à dire des Thérapeutes, qui, s'étant adonnés à la contemplation de la nature,[72] vouent tous les instants de leur vie à cette contemplation et au soin exclusif de l'âme. Citoyens du ciel et du monde,[73] leur vertu les a rendus chers au Père et au Créateur de l'univers ; dans cette amitié céleste ils ont trouvé la plus digne des récompenses, et, préférant à toute sorte de bonheur la pratique du beau et du bien, ils se sont élevés au comble de la félicité.
[1] Nous avons mis tous nos soins à établir le texte grec ; pour cela, nous avons comparé les éditions aux meilleurs manuscrits de Paris et de Florence. De ce travail il est résulté un assez grand nombre de leçons nouvelles; ne pouvant les indiquer toutes ici, il faudra nous contenter de noter les plus importantes.
[2] C'est dans cette phrase, ou nous ne voyons, quant à nous, qu'une simple opposition entre la vie contemplative et la vie pratique, que Scaliger a voulu trouver la preuve que Philon confond les Esséniens et les Thérapeutes.
[3] Le Grec les appelle λογογράφοι. Les rhéteurs avaient l'habitude de composer, pour être récités en public, des discours qui s'appliquaient, soit aux événements passés, soit à des thèses philosophiques ou littéraires. En opposant ce traité aux exercices rhétoriques ou littéraires des Grecs, Philon ne saurait affirmer plus énergiquement le caractère-historique de la Vie contemplative.
[4] Du mot θεραπεύειν, qui a les deux sens de guérir et de servir.
[5] Philon veut dire que les trois principaux aspects de Dieu sont la Bonté, l'Unité, la Monade (mot employé dans un sens différent par Leibnitz). Dieu est le souverain Bien : de lui découlent l'ordre et l'harmonie dans le monde; il est Un, parce qu'il n'est pas composé de parties; il est Seul, retiré dans les profondeurs infinies des a toute-puissance, où nul être ne peut l'atteindre, même par la pensée. Mais son premier attribut, celui dans lequel réside l'essence même de la divine substance, c'est l'Être, Jéhovah, tel que l'a défini Moïse : Je suis Celui qui suis.
[6] Excepté la dernière, toutes ces étymologies sont de purs jeux de mots. Les anciens ne soupçonnaient pas, d'ailleurs, ce que nous appelons l'étymologie, et qui tend, grâce aux progrès de la philologie comparée, à devenir une science. Pour grouper les mots et en rechercher la filiation ou la parenté, ils s'en tenaient à leur physionomie générale, et rencontraient tantôt bien, tantôt mal.
[7] Le Grec emploie le mot ἰδέας, qui, dans la philosophie de notre auteur, emporte toujours le sens de moule et de patron.
[8] Ce nom signifie créateur.
[9] La plupart des arguments dont les apologistes chrétiens se serviront, dans deux siècles, pour battre en brèche le paganisme, sont ici en substance, ou en germe. Philon les avait sans doute développés dans le livre perdu, mentionné par Eusèbe, sous le titre de : Περὶ Ιουδαίων, et que nous avons nommé Apologie du judaïsme. Josèphe (Contre Apion, liv. II) reprendra, un demi-siècle plus tard, et presque dans les mêmes termes, la défense de Philon.
[10] Il y a dans le texte grec un jeu de mots impossible à traduire; le terme incurable (ἀθεράπευτος), dont l'auteur se sert pour désigner les Égyptiens idolâtres, s'oppose à celui de θεράπευτης (guérisseur). Il est superflu de faire remarquer que cette violente diatribe contre le culte des animaux ne touche pas au fond même et à l'essence des dogmes religieux de l'Egypte ; ces dogmes étaient élevés, et toute cette mythologie, comme l’ont démontré les travaux de M. Rougé, couvrait une grande et noble idée de la Divinité, idée parfois très rapprochée du véritable monothéisme.
[11] Le grec est beaucoup plus expressif : Ceux qui vont vers la guérison. Οἱ ἐπὶ θεραπείαν ἴοντες.
[12] Les éditions portent : ‘Αγαμαι τοὺς ἄνδρας καὶ αὐτούς. J'aime ces hommes, eux aussi. Nous substituons, d'après le manuscrit Coislin, de la Bibliothèque nationale, le mot αὐτός à αὐτούς, ce qui donne le sens de : moi aussi, qui nous semble préférable.
[13] Il y a dans la phrase grecque une amphibologie qu'on pourrait rendre de la sorte : « J'appellerai irréfléchi, pour ne pas dire insensé, l'acte des hommes que la Grèce a admirés. » Philon est un apologiste habile, auquel il est permis d'attribuer de la modération et une certaine courtoisie à l'égard de ceux qu'il veut convaincre, c'est-à-dire à l'égard des Grecs.
[14] On comprendrait mal ce passage, si l'on donnait au mot égalité le sens politique qu'il a dans notre langue. Ce mot est ici dépouillé de toute allusion à l'état social, et se rapproche assez du terme équilibre. Philon s'explique très nettement à cet égard dans le livre de l'Établissement du prince : « L'égalité, comme l'affirment tous ceux qui étudient la nature, est mère de la justice... ; c'est elle qui a tout réglé au ciel et sur la terre, et posé les bases éternelles du droit divin et humain... Au sein de l'univers, c'est l'ordre; dans les États, c'est la forme de gouvernement la-meilleure et la plus légitime, la démocratie; dans le corps, c'est la santé ; dans l'âme, c'est la vertu. »
[15] Lorsque Philon parle de l'étude de la nature, il entend désigner la science vraie, la saine philosophie, par opposition à la sophistique qu'il reproche souvent aux Grecs. On sait que les philosophes d'une des plus anciennes et des plus illustres écoles de la Grèce portaient le nom de physiciens. Par extension, lorsque notre auteur parle des richesses de la nature, il fait allusion aux richesses qui sont sérieuses et réelles.
[16] Le mot que nous traduisons par : sans retour, ἀμεταστρπτί, a en grec l'ambiguïté que nous conservons dans notre traduction. Ce terme signifie-t-il que le Thérapeute se voue pour toujours à la vie ascétique, sans possibilité de revenir à la vie du siècle, ou bien signifie-t-il que l'ascète, possédé de l'amour divin, s'enfuit dans la solitude sans regret, sans retour sur lui-même, sans regarder en arrière? Malgré l'intérêt qui s'attache à la solution de cette difficulté, nous n'hésiterons pas à déclarer qu'elle nous semble insurmontable.
[17] Σοφία a ici le sens de science.
[18] Le grec dit : de bien parfait.
[19] On appelle maintenant encore, dans les ordres religieux chrétiens, maisons-mères les établissements centraux qui fondent, gouvernent et administrent leurs pareils.
[20] C'est-à-dire : lieu saint. Nous rétablissons ce passage d'après les manuscrits. Les éditions portent : Εκάστῳ δὲ ἔστιν οἴκημα ἱερόν... Chacun possède une habitation sacrée... On comprendra mieux que chaque habitation possède un endroit retiré et sacré pour la méditation et la prière) un oratoire.
[21] C'est-à-dire : lieu destiné à recevoir un homme seul.
[22] Mystères (μηστήρια) se dit de toute cérémonie secrète, de tout rite qui concerne la religion.
[23] Nous restituons, d'après les manuscrits, au texte de Philon, les mois ἀρετῶν καὶ... Il faut, en effet, distinguer les Vertus des Puissances divines chez notre philosophe. Les Puissances sont des entités, des Logoi ou Verbes, qui gouvernent un certain ordre de choses, et relient l'univers au Créateur. Les Vertus sont les manifestations très nombreuses de l'Être, les divers aspects sous lesquels il s'offre à la vue de notre intelligence.
[24] Évidemment nous sommes ici en présence des phénomènes propres à l'extase, que Jamblique décrira avec tant de complaisance dans son livre sur les Mystères. Philon admet sans peine l'inspiration réelle des saints ascètes; il professe que les songes sont un des moyens dont Dieu se sert le plus ordinairement pour entrer en communication avec l'homme. Il a composé un traité sous ce titre : Les songes viennent de Dieu. Il ressort, en outre, de ce curieux passage, que le don de prophétie devait être fréquent chez les Thérapeutes. A l'opinion qui leur attribue la rédaction des oracles pseudo-sibyllins, qui seront étudiés plus loin, on peut objecter que les solitaires sont trop préoccupés de science sacrée pour acquérir le talent littéraire et profane nécessaire au sibylliste ; mais l'objection tombe et la vrai semblance de l'opinion subsiste, si l'on réfléchit qu'il a dû arriver souvent que les couvents de Thérapeutes ont reçu et inspiré des Juifs antérieurement hellénisés par un contact soutenu avec les Grecs, et qui embrassaient la vie ascétique sur la fin de leur carrière.
[25] L'âme est ici personnifiée et assimilée à un prince qui réunit autour de lui son conseil pour délibérer.
[26] Nous pensons, avec Thomas Mangey, qu'il y a probablement ici une lacune. Il semble naturel que Philon ne s'est pas borné, sur un point aussi important que le système des allégories, à cette brève indication. Les passages supprimés contenaient peut-être des renseignements sur l'origine des Thérapeutes et la nature des écrits attribués à leurs fondateurs, qui ont paru peu en accord avec l'opinion qui taisait d'eux des disciples de saint Marc.
[27] Le mètre détermine l'espèce du vers par la combinaison et le nombre des pieds; la mélodie, c'est l'air sur lequel se chantent les paroles du vers; le rythme, c'est la manière lente ou rapide, uniforme ou saccadée qui règle le chant.
[28] Le grec dit: ayant les mains en dedans (τὰς χεῖρας ἔχοντες εἴσω), pour indiquer que les moindres détails de l'attitude sont réglés et composés en vue de la décence et de la gravité religieuse; qu'enfin ces détails font partie du rite.
[29] C'est-à-dire 2,25 ou 3 mètres.
[30] Cette disposition se retrouve dans nos temples chrétiens : le chœur est élevé de quelques marches, qui figurent ou rappellent le parapet ; il est exclusivement réservé aux hommes, comme la nef est attribuée exclusivement aux femmes, là ou les vieux usages se sont maintenus.
[31] Nous rétablissons dans le texte grec le génitif τῆς ψυχῆς, que donnent les manuscrits. Les éditions offrent un sens un peu différent : « Après avoir mis dans leur âme la tempérance comme un fondement solide... »
[32] La vie du Thérapeute est, on le voit, une protestation perpétuelle de l'esprit contre le corps ; c'est un duel de chaque instant entre l'âme et la chair. Le fait de ne prendre de la nourriture qu'après le coucher du soleil constitue le jeûne chez les Israélites.
[33] Il ne faut pas, je crois, se hâter d'accuser notre auteur d'exagération ; les faits, aujourd'hui mieux connus, relatifs aux phénomènes du sommeil magnétique et de l'extase, ont, sur bien des pointe, montré la réalité de choses tenues jadis pour mensongères.
[34] L'exomide est une tunique, appropriée au travail manuel, qui laisse libre le bras droit, et qui servait de vêtement aux gens du peuple. Le texte grec appelle ὀθόνη ce que nous traduisons par : tunique de lin. L'othonê est un vêtement long. Le manteau d'hiver, dont il s'agit ici, est la chlaina des anciens Grecs, que l'on trouve mentionnée dans Homère, et qui n'est pas sans analogie avec l'ample couverture dont les Romains ont fait la toge.
[35] Ici commence ce qu'on pourrait nommer la seconde partie du livre ; nous y trouverons, surtout vers la fin, plus d'une fois la répétition de ce qui vient d'être dit.
[36] Le grec a un jeu de mots impossible à rendre : Οἱ, ἀντὶ ἀθλητῶν ἄθλιοι. Comme si on disait : Ces hommes, au lieu d'être forts, sont forçats.
[37] On distribuait aux convives, dans certains banquets de phratries, des jetons. Chacun, en entrant, donnait un jeton (σύμβολον) à l'ordonnateur du festin, peut-être au clinarque, et, sur la remise ultérieure de son symbolon, payait son écot. Plus les jetons déposés étaient nombreux, plus la consommation du vin devait être considérable, moins il devait rester de liquide à absorber le lendemain. Il est évident que Philon a en vue dans cette description les banquets, ou plutôt les orgies des phratries alexandrines, dont il parle dans le Contre Flaccus. (Voy. nos Écrits historiques de Philon, p. 250.)
[38] Philon semble indiquer ici que la phratrie (ou thiase) en était venue à créer (comme nos cercles modernes) un genre de vie en dehors du foyer domestique.
[39] Le triclinium est un lit de table pour trois convives; le periclinium désigne un lit sur lequel un plus grand nombre de personnes pouvaient s'asseoir.
[40] Le mot grec (στρωμνή) désigne proprement une étoffe multicolore et bigarrée. Il s'agit ici soit des nappes dont on couvrait les tables, soit des couvertures jetées sur les lits.
[41] Vases en forme de cornet, troués à la petite extrémité, et desquels les vins les plus précieux tombaient goutte à goutte.
[42] La patère (φιάλη) est une espèce de bol, sans pied et sans anse.
[43] La coupe (κύλιξ) est un vase de forme ronde et aplatie, élevé sur un support élégant, lequel repose sur un pied évasé.
[44] Grandes coupes de terre noire, inventées par un potier de Corinthe, nommé Thériclès.
[45] Oiseau de mer, auquel lés anciens avaient fait une grande réputation de gloutonnerie.
[46] C'est-à-dire en êtres dépourvus de sexe, parce qu'ils opèrent un odieux mélange des attributs de chaque sexe. Androgyne signifie homme-femme.
[47] Voici le passage de Platon, auquel il est fait allusion : Ανδρόγυνον γὰρ ἕν τότε μὲν ἦν τὸ εἶδος, καὶ ὄνομα ἐξ ἀμφοτέρων κοινὸν τοῦτε ἄῥῤενος καὶ θήλεος χεῖρας δὲ τέσσαρας εἰχε καὶ σκέλη τὰ ἴσα ταῖς χεπσὶ, καὶ πρόσωπα δύο... — « L'androgyne était alors une forme unique; son nom était emprunté au mâle et à la femelle. Il avait quatre mains, des jambes en pareil nombre, et deux visages... »
[48] Il est difficile, après avoir lu cette critique aussi vive que juste des écrits de Platon et de Xénophon, de partager l'opinion de ceux qui ne veulent voir dans notre philosophe qu'un timide copiste des maîtres grecs. Dans l'œuvre de Philon, il y a cent passages analogues qui attestent avec éclat l'indépendance de son génie, la liberté de ses appréciations, et la valeur de son éclectisme.
[49] Comment se fait-il que l'historien des Thérapeutes, s'il parle de disciples du Christ, oublie ici de mentionner l'origine récente des moines alexandrins, et se contente de les rattacher à Moïse?
[50] Ce carré est 49. Nous nous abstiendrons de tout commentaire sur la doctrine relative aux nombres, à laquelle il est fait allusion ici. Cette doctrine, de source pythagoricienne, était, comme on voit, en honneur dans les monastères alexandrins, et peut-être n'était-elle pas tout à fait inconnue dans ceux de la Palestine. Il est certain qu'elle était acceptée par l'école philosophique des juifs d'Alexandrie; le traité de Philon sur la Création du monde le prouve. Nous réservons pour l'étude de ce traité les réflexions que nous inspirent ces prétendues vertus des nombres.
[51] Le grec porte φυσικώτατος, ce qui signifie dans la langue de notre auteur : le nombre le plus élevé en dignité dans l'ordre des choses.
[52] De même, les Esséniens se revêtent d'habits blancs pour la célébration de leur repas.
[53] L'Ephiméreute est, suivant Josèphe, le prêtre de service dans le temple de Jérusalem.
[54] Nous corrigeons, dans le texte des éditions, παλαιούς (anciens), qui répète πολυετή, et nous le remplaçons par πολυετεῖς (qui a les cheveux blancs).
[55] Il y a là une série d'expressions remarquables et conformes à l'esprit et à la langue du christianisme.
[56] Cette condamnation de l'esclavage n'est pas ici une vaine déclamation ; elle est à la fois dans les mœurs et dans la doctrine. Nous aurons occasion d'y revenir quand nous étudierons la politique de Philon, et nous le trouverons encore, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, supérieur aux philosophes grecs. M. Paul Janet, dans son Histoire de la politique, a bien montré ce que fut la question de l'esclavage dans les Églises primitives et chez les Pères (t. Ier p. 315 et suiv.), et comment les philosophes grecs, notamment Aristote (t. Ier, p. 177 et suiv.), ont compris le même problème. On remarquera l'allusion à la théorie déjà signalée plus haut, qui explique les inégalités sociales par la rupture de l'équilibre naturel, par l'injustice et l'amour du gain.
[57] L'absence de mets sanglants est un nouvel indice qui porte à croire que l'influence des doctrines pythagoriciennes se faisait sentir jusque dans les rites des solitaires alexandrins. Il est vrai que l'auteur des Philosophumena accuse Pythagore et les autres philosophes grecs d'avoir pillé les enseignements de la sagesse hébraïque; mais l'accusation, déjà soutenue par Aristobule, nous semble au moins étrange en ce qui concerne Pythagore. Ce passage répète les indications données plus haut, relatives au pain, au sel et à l'hysope.
[58] Sacrifices où les libations se font sans vin.
[59] Il est impossible de mieux exprimer les plus exquises délicatesses du sentiment de l'humilité chrétienne.
[60] Ces détails, comme on voit, répètent, en les complétant, ceux qui nous ont été déjà fournis, à l'occasion des réunions hebdomadaires. Quelques lignes plus loin, on lira un passage qui reproduit les indications déjà fournies sur la méthode allégorique appliquée à l'interprétation des Écritures. La Vie contemplative semble ainsi se composer de deux parties parallèles : l'une, générale, qui nous a paru mutilée, l'autre, spéciale; la première est consacrée à formuler la règle de la secte; la seconde, à raconter la célébration de la Grande Fête.
[61] Le grec dit : L'âme rationnelle, λογικὴ ψυχή, c'est-à-dire la raison universelle répandue dans le monde, dont l'intelligence humaine est comme une parcelle. Cette âme rationnelle est l'image, suivant Philon, du Verbe divin.
[62] On voit que la hiérarchie est, sinon absente dans la secte, du moins assez vaguement indiquée. Les fonctions de président peuvent être remplies par tous, et l'éphiméreute est plutôt un maître des cérémonies qu'un homme investi du sacerdoce. Il n'y a pas, d'ailleurs, de sacrifice, et l'office du prêtre n'a pas de raison d'être.
[63] Il s'agit, bien entendu, des poètes de la secte.
[64] Le Grec nomme ces chants : παρασπόνδεια, παρβώμια, στάσιμα, χορικά. Les prosodia étaient des supplications, analogues aux litanies du rituel chrétien, qui se chantaient en procession dans les fêtes du culte païen. Nous lisons : προσόδια et non : προσῳδία, comme la plupart des éditions, ce qui donnerait le sens bizarre de cantiques marqués d'accents. Il nous semble au contraire que l'épithète de προσόδια concorde bien mieux avec le sens général de rémunération. L'auteur, comme on voit, désigne, par les dénominations propres à la poésie lyrique des Grecs, les chants pieux des Thérapeutes. Cela semble prouver que cette poésie était composée en langue grecque, et par conséquent ne remontait pas à une antiquité reculée. On verra plus loin que ces chants, adaptés aux évolutions chorales, sont en rapport avec les rites des Thérapeutes; leur fête se termine, en effet, par des danses sacrées.
[65] Nous savons, par les indications relatives aux mètres et à la forme des vers et des chants, qu'ils étaient écrits dans la langue grecque; mais ce détail nous montre que ces chants avaient pourtant des allures propres, qui rappelaient sans doute les usages de la poésie hébraïque. Nous sommes ici en présence d'un refrain tout à fait semblable à la doxologie (Gloria Patri, etc.) qui, dans le rite chrétien, termine le chant des psaumes ; analogue aussi à la formule Per Dominum, etc., qui termine les oraisons.
[66] Sur la table des pains de proposition étaient placés douze pains sans levain, représentant les prémices des douze tribus d'Israël.
[67] Philon, comme on voit, ne supprime ni le sacerdoce, ni par suite le sacrifice sanglant. Tout en admirant la piété et la vertu des solitaires, il ne songe point à les élever au niveau des prêtres. Leurs rites, dans la pensée de notre auteur, ne se substituent donc pas au culte national, accompli à Jérusalem, dans le temple. Philon nous donne ici la meilleure preuve de son orthodoxie. Josèphe nous apprend, en effet, qu'il y avait dans le monachisme juif une tendance à placer les rites et les pratiques de la secte au-dessus des cérémonies du culte officiel : les Esséniens estimaient leur repas mystique plus agréable à Dieu que le sang des boucs et des génisses, et ne croyaient pas être astreints à visiter le temple. Les Thérapeutes sans doute professaient les mêmes opinions.
[68] Le grec dit : ἀντιφώνοις ἁρμονίκις ἐπιχειρονομοῦντες, accompagnant d'une vive pantomime et en cadence les accords des chants alternés. Dans le rituel chrétien, c'est le même mot, ἀντιρώνον, qui a servi à désigner le chant du répons ou antienne. Il n'est pas invraisemblable qu'il s'agit ici d'une sorte de répons.
[69] Cet entretien, ce banquet, ces chants, ces danses, offrent l'occasion de plus d'un rapprochement entre les rites des Thérapeutes et ceux des mystères, importés d'Asie en Grèce dès le sixième siècle. Nous nous bornerons à signaler cette analogie, un peu vague sans doute, mais qui n'est pourtant pas sans valeur, puisqu'elle semble inviter le critique et l'historien à admettre la réalité de l'influence des cultes orientaux de l'Asie sur les rites du monachisme juif.
[70] Cette promiscuité de la fin des mystères avait assurément son analogue dans le culte chrétien primitif; elle fournit le prétexte à l'accusation d'immoralité formulée contre les chrétiens dans la lettre de Pline. Les chrétiens, dit le gouverneur romain, convenaient bien de cette promiscuité, mais soutenaient qu'elle n'entraînait aucun acte répréhensible.
[71] Le texte distingue nettement dans ce chant l'élément du timbre (ἀντήχος) et l'élément de l'alternance (ἀντιφώνος).
[72] La nature (φύσις), dans le langage de Philon, désigne, on l'a déjà vu, par opposition aux choses provenant de l'erreur et des préjugés, l'ordre réel et véritable établi par Dieu dans la création. Ainsi, à ses yeux, il n'y a de solides que les biens de la nature, il n'y a de profitable que l'étude et la connaissance de la nature. Cette dernière expression n'indique pas seulement l'étude des phénomènes physiques, astronomiques, etc., mais aussi et surtout celle des phénomènes intellectuels et moraux.
[73] Dans la doctrine de notre philosophe, l'homme, à mesure qu'il s'élève et se perfectionne dans la vertu, acquiert des titres à une condition supérieure; tant qu'il ne dépasse point par ses efforts la sphère des qualités ordinaires, il reste citoyen de la terre ; il devient citoyen du ciel quand il s'est amélioré, par la pratique du bien et la connaissance des choses, au point de conquérir l'amitié de Dieu ; il devient enfin citoyen du monde, quand il parvient au degré le plus haut qu'il soit permis d'atteindre à l'homme vertueux.