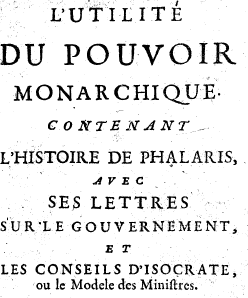|
HISTOIRE DE PHALARIS ROI D’AGRIGENTE EN SICILE.
Ceux qui établissent pour principe
certain que l'on doit juger des hommes par leurs actions, peuvent se
tromper ; l'Histoire nous en fournit un exemple fameux dans la
personne de Phalaris ; toute l'Antiquité l'a regardé comme le plus
grand tyran de son siècle, néanmoins il peut passer pour le plus
sage et le plus grand politique de la Grèce. Il est vrai que pour se
maintenir dans une principauté que le suffrage du peuple, et son
ambition lui acquirent, il fut contraint de se servir d'une autorité
absolue, et même des supplices les plus affreux pour punir les
conspirateurs de sa vie,
Ce grand homme a eu le malheur de ne trouver que des censeurs de ses
vices ; personne n'a fait 1'éloge de ses vertus ; il serait enseveli
dans l'obscurité comme bien d'autres, si je n'avais reconnu en
parcourant ses Lettres, qu'il savait joindre à une valeur, et une
grandeur d'âme héroïque la morale la plus épurée.
Jamais prince ne s'est mieux connu lui-même, et n'a poussé ses
sentiments à un plus haut degré d'élévation, il répand dans ses
Épîtres les plus familières, une noblesse d'expression et une pureté
d'esprit qui fait comprendre qu'il ne cherchait qu'à s'élever
au-dessus de lui-même :
il paraît que son génie supérieur ne pouvait supporter la bassesse
et l'obscurité du paganisme ; son âme plus élevée reconnaissait un
être supérieur et ce n'était qu'avec contrainte qu'il se voyait
réduit à sacrifier aux dieux.
La véritable vertu et la bon ne foi sont les seuls caractères de
religion qu'il se propose. Enfin, la dignité de l'homme et sa
création lui font faire des réflexions qui n'ont jamais été faites
par le philosophe le plus sage.
Comme ce n'en point ici son éloge que je prétends faire, et que je
n'ai d'autre but que celui de justifier sa domination par la
domination même, j'ai cru qu’il était à propos, avant que de
produire ses Lettres au public, de donner un abrégé de l’histoire de
sa vie.
HISTOIRE.
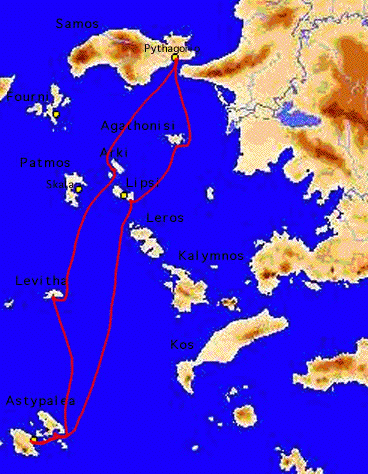
Phalaris prit naissance en Astypalée,
laquelle fut nommée ainsi parce qu’Apollon y était honoré
(Nabuchodonosor régnait lors en Assyrie). Lesdamente son père, fort
estimé parmi les grecs, tant par le rang que par sa vertu, ne
négligea rien pour donner une éducation convenable à Phalaris son
fils ; les dispositions naturelles que ce fils eut avec avantage dès
sa plus tendre jeunesse, sa vivacité et les empressements pour
apprendre ce qu’on lui enseignait, le faisaient admirer de tous ses
maîtres. En effet, rien ne lui paraissait difficile, ses occupations
ne tenaient rien de l'enfance, les amusements ordinaires des jeunes
gens commençaient dès ce temps à lui paraître trop frivoles : il
semblait même se révolter contre son âge qui ne permettait que de
s'appliquer à des matières peu sérieuses. Il interrogeait souvent
ses maîtres, leur faisait quelquefois des questions si savantes que
ces vénérables philosophes surpris, ne pouvaient s'empêcher de dire
que ce serait un jour un des plus grands hommes de la Grèce. Enfin,
dans un âge où les autres à peine savent les principes de la
science, il cherchait déjà à approfondir les merveilleux secrets de
la nature et de sa création.
Ce fut dans ce temps qu’il eut le malheur de perdre son père : perte
qui lui fut aussi pénible que s'il avait été dans l'âge le plus
avancé. Après lui avait rendu les derniers devoirs, il ne songea
plus qu'à se rendre par lui-même digne de mériter l’estime que les
Grecs avaient eu pour lui : une noble émulation jointe à une
heureuse éducation le mirent dans sa vingtième année en état
d’entreprendre les plus grandes choses ; son père ne lui avait
laissé qu’un beau nom ; la fortune lui avait été si peu favorable
qu’il fallait la forcer par lui-même à se déclarer en sa faveur. Son
ambition lui fournissait des moyens que sa sagesse éloignait ; il
sentait bien qu’il était né pour les plus grands emplois ; il
n’ignorait pas en même temps que ce n’est pas toujours la véritable
vertu qui nous y conduit ; ainsi combattu par l’ardeur naturelle de
s’élever, il prit dès lors la résolution d'en chercher les voies les
plus convenables. Il s’agissait de faire paraître par une conduite
sage et réglée, qu'il avait des sentiments et une expérience
au-dessus de son âge, pour pouvoir posséder les postes les plus
distingués de la république ; c’était une entreprise des plus
difficiles.
Les Grecs n'admettaient ordinairement, soit pour le gouvernement du
peuple ; soit pour les emplois militaires, que des hommes d'une
prudence consommée et d'une expérience connue ; ainsi Phalaris que
l’inclination naturelle portait à se distinguer par les armes, fit
connaître en vain qu'un heureux génie peut former en peu d'années un
grand homme ; il fut obligé de commencer par les plus petits emplois
de la guerre ; sa fierté souffrit avec peine la triste nécessité
d’obéir, lui qui se sentait né pour commander : la raison cependant
l'emporta ; mais dès qu'il trouva l'occasion de se signaler, il le
fit avec tant de valeur et de prudence que les commandants ne purent
lui refuser la gloire du triomphe.
Il reçut ces marques d'honneur, sans rien donner à l'amour propre ;
il ne fut sensible qu’à la satisfaction de pouvoir être utile au
bien de la république.
Ces premiers coups d’essai le rendirent respectable parmi les
troupes et elles parurent dès lors avait tant de confiance en lui,
que se trouvant dans un château où il commandait avec cent hommes
d’armes ; étant attaqué par deux cents, il soutint avec tant
d’intrépidité les différents assauts de ses ennemis, qu’impatient de
se voir borné seulement à se défendre, il proposa à ses soldats dans
ces termes à sortir du château.
“Mes amis, j'ai cru qu'il ne suffisait point à des gens d'honneur de
faire simplement leur devoir, en défendant vigoureusement une place
confiée à leurs soins, je me suis encore imaginé que pour s'élever
au-dessus des autres, il fallait se distinguer par des actions
extraordinaires ; que des braves soldats ne devaient point mettre de
bornes à leur gloire, et que quand il s'agissait de se rendre maître
de la victoire, la vie ne devait paraître précieuse que pour la
perdre en s'immortalisant. Ainsi mes compagnons, n’attendons point
que la supériorité de nos ennemis nous force dans ce château,
cherchons à les prévenir par une sortie vigoureuse et songeons que
nous combattons pour la patrie.”
Après ce discours, auquel ils ne répondirent que par des cris de
joie, il sortit le premier et donna tête baissée suivi de sa troupe,
dans celle des Tauronemitains. La fermeté de ce jeune conquérant et
l’intrépidité de ses soldats répandirent tant de frayeur parmi ses
ennemis, que ceux qui échappèrent à leur fureur, prirent la fuite et
leur cédèrent le champ de bataille. Après avoir rendu grâces aux
dieux de cette victoire, il partagea le butin à ses soldats et eut
assez de clémence pour envoyer ses chirurgiens aux prisonniers
ennemis blessés qu’il renvoya avec de grands présents.
Cette action particulière lui acquit une si grande réputation que
dans un combat qui se donna peu de temps après, le général ayant été
tué, toute l'armée le nomma pour commander ; sa modestie ne voulut
jamais l'accepter, mais comme il s'agissait de l'intérêt public et
que le soldat animé le demandait à grands cris, il leur dit : "Mes
amis, comme vous partagez le danger, vous partagerez le
commandement." Et avant que de charger une seconde fois les ennemis,
il consulta les vieux soldats de son armée et profita de leurs avis
pour attaquer à propos : leur défaite fut générale, quoiqu'ils se
défendissent avec opiniâtreté et que même ce jeune général se
trouvât pendant un certain temps perdu dans la mêlée ; il eut besoin
de toute sa valeur pour ne pas demeurer prisonnier ; il se fit jour
au travers d'une foule d'ennemis et eut l'avantage de tuer de sa
propre main leur général, avant que de joindre les siens ; son
retour leur fut plus agréable que la victoire, et ils se préparaient
à lui rendre les honneurs dus pour une telle bataille, ce qu’il
refusa généreusement par des paroles :
“O vous, compagnons de notre victoire, pourquoi voulez-vous m’en
attribuer tout l’honneur ; n’est-ce point à votre courage que la
patrie le doit ? Qu’ai-je fait de plus que vous ? Je n’ai suivi que
votre exemple ; vous m’avez choisi pour commander, je n’ai exécuté
que vos projets ; ainsi, n’est-il pas juste que nous en partagions
toute la gloire ? La seule grâce que je vous demande, c’est de me
donner vous-même un mémoire de ceux qui ont le plus mérité, afin que
par vos propres suffrages ils puissent recueillir le fuit de leurs
travaux.”
Toute l’armée fut surprise d’une réponse aussi sage ; les soldats et
les chefs remplis d’admiration et de reconnaissance pour la bonté de
leur général, firent à l’instant retentir tout le camp par des
acclamations de joie et de victoire.
On peut proposer aux plus grands hommes ce jeune conquérant pour
modèle. En effet, il ne suffit pas qu’un général ait de la prudence,
de l’expérience et de la valeur pour conduire une armée ; il faut
encore qu’il ait une assez grande connaissance de lui-même, pour ne
pas donner dans cet excès d’ambition, qui, souvent le porte à
s’attribuer le succès d’une bataille.
Il est vrai qu’un général y contribue par une bonne disposition et
par une sage conduite : mais aussi il faut avouer que le soldat est
l’âme des actions, que les victoires dépendent de la fermeté, et
qu’ainsi il est en droit d’en partager tout l’honneur et d’en
demander la récompense ; la confiance du soldat ne se gagne que par
l’affabilité et la familiarité du général ; c’est, pour ainsi dire,
la seule consolation qui lui reste après avoir exposé sa vie ;
c’était aussi par ses manières douces et insinuantes que notre jeune
héros s’était attiré l’amour de ses troupes : il disait souvent
qu’il regardait ses soldats comme ses amis, et qu’ainsi connaissant
leur fidélité, il trouvait que la victoire lui coûtait moins cher
qu’à un autre. C’est une armée formidable qu’une armée qui a de la
confiance et qui aime personnellement son chef, l’amitié et le
respect tiennent lieu d'honneur aux soldats et les officiers
redoublent leurs soins lorsqu'ils regardent leur commandant comme
leur maître et leur camarade.
Jamais héros ne promit plus ; la victoire l’avait déjà suivi
partout, le métier de la guerre ne lui paraissait qu'un amusement ;
les difficultés les plus insurmontables ne l'embarrassaient point ;
il savait prendre son parti sur tout ; il avait un point de vue
admirable ; prudent dans le projet, il était vif dans l'exécution et
il disait souvent qu'il fallait être né soldat pour réussir dans les
armes, comme il fallait être né poète pour exceller dans la poésie.
La fortune jalouse des grands avantages que son mérite lui avait
acquis trouva bientôt l'occasion de le traverser dans la guerre que
la république entreprit contre les Levintins, ce qui l'éleva dans la
suite à un plus haut rang. Phalaris fut encore nommé par les soldats
pour leur chef. Ces peuples connaissant la réputation de ce général,
résolurent de se servir d'un artifice pour éviter le même sort que
leurs voisins avaient éprouvé : c'est pourquoi se voyant pressés et
presque hors d’état de reculer le combat, ils se déterminèrent, sous
prétexte de quelques propositions de paix, d’envoyer à Phalaris des
ambassadeurs suivis de leurs femmes et enfants, (ce qui était en
usage parmi eux.) Leur dessein était d’amuser ce général ; ils se
flattaient que, dans un âge où les sens sont les maîtres absolus, la
vue de la plus belle femme qu'il y eût parmi eux, pourrait toucher
notre héros et lui oublier la gloire. Il est vrai que Cornélie,
c’était le nom de la femme de Polinestor, un des députés, était si
accomplie, que Caton même aurait eu peine à résister à ses charmes.
Phalaris sentit en la voyant, de ces émotions si naturelles à
l’homme ; mais la raison n’en prit aucun ombrage. La gloire s’était
jusqu’alors rendue la maîtresse absolue de son coeur ; toute autre
passion lui aurait paru indigne de lui ; en effet, que peut inspirer
un camp, une armée, que des sentiments de fureur, et que le carnage
et le sang ? Ce fut néanmoins dans les champs de Mars, où notre
héros se laissa séduire sans s’en apercevoir, par les attraits de la
belle Cornélie. D’abord il rejeta fièrement les propositions de ces
députés ; ils semblaient même disposés à s’en retourner avec le
désespoir de n’avoir point réussi dans leurs négociations ; ils
pensaient avec chagrin et néanmoins avec admiration, que ce grand
capitaine n’était sensible qu’à la victoire, lorsque cette même
fortune qui voulait l’abaisser, suscita une autre Cléopâtre
paraissant les yeux baignés de pleurs et aux genoux de notre
général. Dieux ! Quels combats il eut à soutenir ! D’un côté la
gloire lui reprochait les moments qu’il perdait ; il sentait bien
que ces irrésolutions donnaient le temps à ses ennemis de prendre
leur parti et de s’éloigner : le gain d’une bataille aussi
considérable que celle qui s’offrait, réveillait son ambition et
ranimait sa vertu. Mais d’un autre côté, pour écouter ces nobles
mouvements, il fallait renvoyer les députés et l’adorable Cornélie ;
l’honneur et le devoir l’auraient emporté ; mais comment soutenir la
vue de la plus belle personne dans un état de suppliante, les yeux
baignés de larmes ? Notre jeune Mars ne put résister à tant de
traits ; il promit à Cornélie ce qu'elle voulut ; il lui avoua sa
défaite, mais avec plus d'embarras que s'il avait été sur le point
de donner une bataille. Ce grand capitaine qui n'avait pas
jusqu’alors connu de danger, qui méprisait la mort et dont la
fermeté et l'intrépidité étaient admirables, se trouve immobile et
tremblant devant une simple femme. Quelle punition pour l'homme qui
cherche tant à s'élever au-dessus de lui-même, d'être sujet à de
telles faiblesses ! Ce fut cette passion cruelle qui fut l'écueil de
la sagesse et de la vertu de ce chef si estimé de ses soldats et si
redouté par ses ennemis. Les Levintins profitèrent de sa faiblesse,
ils feignirent de conclure la paix ; il y eut de part et d’autre une
suspension d’armes. Phalaris était tranquille dans son camp ; la
paix lui paraissait déjà plus aimable que la guerre ; il jouissait
de la vue de celle qui devait faire le bonheur de sa vie ; il
prolongeait les articles de ce traité et faisait naître des
difficultés pour ne pas être privé du seul plaisir qu'il eut au
monde. Les soldats à l'exemple du général, cherchaient dans le camp
à se délasser des travaux de Mars : les plus vieux néanmoins
commençaient à murmurer cette paix leur paraissait honteuse, étant
sûrs de la victoire. Enfin, les Levintins informés par leurs espions
que tout le camp de Phalaris était enseveli dans un profond sommeil
et que le général n'était occupé que des plaisirs de sa nouvelle
passion, ils vinrent armés fondre sur ce camp tranquille, se
saisirent des armes, massacrèrent ceux qui voulurent se mettre en
état de se défendre, firent le reste prisonniers : peu échappèrent à
cette surprise, Phalaris lui-même fut enlevé ; on ne lui donna pas
le temps de la réflexion. Enfin la défaite fut entière.
Il n'est pas possible d'exprimer les regrets du malheureux Phalaris
; il reconnut, mais trop tard, sa faiblesse et il eut besoin de
toute sa vertu pour soutenir une pareille disgrâce. Cet homme, qui,
quelque temps auparavant faisait tous les délices du peuple, dont la
réputation était si grande que les Grecs le plaçaient au rang des
demi-dieux, triste jouet de l'amour se trouve abandonné même de ses
plus fidèles amis et réduit à une honteuse servitude. Ils oublièrent
ses actions et sa gloire passée, on ne se ressouvint plus que de sa
faiblesse et l'injustice du peuple alla si loin, que par leurs
indignes suffrages, la république le bannit comme un criminel. Ce
qui fait bien connaître le peu de fond que l'on doit faire sur les
hommes ; les événements heureux nous les rendent favorables, le
moindre revers ternit notre gloire et nous rend odieux : ainsi,
concluons que c'est la seule fortune, et non la véritable vertu
qu'ils estiment.
La captivité de Phalaris donna une si rude atteinte à sa renommée,
que les Grecs eurent en horreur jusqu'à son nom. La sagesse était si
recommandable parmi ces peuples, qu'ils tenaient pour principe qu'un
homme vertueux était en état de tout entreprendre.
Notre malheureux prisonnier avait été tellement frappé de ce funeste
changement de fortune, qu'accablé sous le poids de sa misère, il
n'avait point encore eu le temps de faire des réflexions sérieuses
sur le sujet de sa détention. Il ne fut pas longtemps dans cet état
; son indigne faiblesse se présenta bientôt à son imagination, mais
avec des traits si cruels, qu'il ne pouvait se la pardonner. Ces
tristes pensées le révoltèrent contre la nature même ; il aurait
souhaité se trouver encore enseveli dans le néant. "Quoi !
disait-il, une passion si frivole et si indigne de l'homme de coeur,
peut-elle l'aveugler jusqu'au point de s'oublier lui-même et de
perdre dans un moment tous les sentiments d'honneur et d'élévation ?
Mais n'est-il pas juste aussi que les dieux nous punissent de notre
excès d'ambition ? rendons-nous justice. Ces actions éclatantes et
héroïques qui nous font mériter l'estime et l'approbation des hommes
ont-elles d'autre but que celui de sacrifier à l'idole de notre
amour propre ? Est-ce le bien public que nous recherchons dans une
bataille ? Non c'est pour satisfaire notre propre gloire que nous
nous donnons les soins de la remporter, et souvent notre aveuglement
va si loin que nous avons même la témérité de nous applaudir sur les
événements heureux.
Ainsi je ne dois pas me plaindre de l'affreuse situation où je me
suis plongé. N'aurais-je pas dû me connaître !
Pourquoi entreprendre témérairement de commander les autres, moi qui
ne sais pas me rendre maître de moi-même ! Je reconnais, mais trop
tard, que la fatale prévention que quelques succès nous ont donnée
de nous-même, nous fait croire mal à propos que toutes nos actions
sont prudentes ; ce qui nous fait commettre les plus grossières
fautes ; nous tombons insensiblement dans l'abîme le plus affreux,
sans nous apercevoir de notre chute."
Ces traits sévères de morale auraient été capables de le faire
tomber dans un égarement que toute sa raison n'aurait pu soutenir,
si la confiance n'était venue à son secours. Il était destiné à de
trop grandes choses, pour en demeurer là ; ainsi, jusqu’au moment
que sa fortune le voulut faire reparaître sur le théâtre du monde,
il fit toute son étude de la recherche des plus anciens philosophes,
pour pouvoir dompter ses passions et affaiblir l'ambition qui était
sa passion favorite : car il sentait bien que s'il avait suivi son
penchant, le vice aurait eu pour lui plus d'agrément que la vertu ;
et c'est cette dépravation naturelle qui le forçait à combattre si
souvent contre lui-même. Il demeura deux ans dans cette triste
situation, lorsque le sort qui voulait encore l'exposer à d'autres
revers, l'en fit sortir par une occasion assez particulière.
Les Levintins ayant perdu leur général, et ne trouvant point parmi
eux personne capable de remplir sa place, résolurent de nommer
Phalaris pour leur chef ; deux des plus vénérables furent proposés
pour lui en porter la nouvelle ; dans le temps qu'ils entraient dans
son appartement il était occupé à faire des réflexions sur les
différents caprices de la fortune ; la vue de ces vieillards le
surprit ; il s'imagina qu'ils venaient lui annoncer la mort, la
coutume étant parmi ces peuples de faire mourir après un certain
temps leurs prisonniers. La mort lui avait paru douce et souhaitable
au moment de sa disgrâce, il avait même pensé que c'était un terme
heureux lorsqu'un homme d'un certain nom avait flétri sa gloire ;
mais les longues réflexions qu'il avait eu le temps de faire,
avaient éloigné cette idée, et la nature pour lors se trouva seule
la maîtresse ; en sorte que ce grand homme, que rien n'avait pu
ébranler sentit dans cet instant toutes les horreurs d'une
destruction prochaine. Ces députés le voyant embarrassé, après lui
avoir fait les civilités convenables au poste qu'ils allaient lui
annoncer, l'un d'entre eux prit la parole et lui dit :
" Les Levintins instruits par la renommée avaient cru ne pouvoir
vous donner des marques plus sensibles du respect et de la crainte
que cette haute réputation leur avait inspirée, qu'en se servant de
l'artifice et des ruses de guerre pour vous dérober la victoire ;
ils ne font pas moins de cas de votre vertu quoiqu'elle ait été en
apparence obscurcie par la servitude, où la faiblesse si naturelle à
l'homme vous a réduit.
Les plus grands héros ont été contraints de sacrifier à l'amour, ils
n'en sont pas moins illustres dans l'histoire ; car puisque les
dieux mêmes n'ont pu résister à cette passion dominante, doit-on
regarder comme un crime un penchant naturel que les maîtres du monde
autorisent par leurs exemples ? ainsi, nous espérons que vous ne
refuserez point le commandement des armées que nous venons vous
offrir ; nous savons que votre délicatesse aurait peine à souffrir
une pareille proposition, si en même temps nous n'étions informés de
l'injustice des Siciliens."
Phalaris eut peine à croire ce qu'il venait d'entendre ; lui qui
s'était déjà disposé à souffrir une mort honteuse, se voit dans le
même instant élevé au plus haut degré d'honneur ; ce changement
démonta tout son raisonnement, et après y avoir rêvé quelque temps
il leur répondit : Qu'il estimait trop les Levintins pour leur
donner un général qui n'avait point eu assez de vertu pour se
surmonter lui-même ; qu'il était vrai qu'il s'était acquis quelque
gloire, mais qu'il la devait au hasard, et que la preuve la plus
forte était sa faiblesse et l'état où il se trouvait ; qu'ainsi il
leur conseillait de choisir pour le commandement un homme d'une
expérience et d'un âge assez avancé pour ne point tomber dans les
pièges où la force du tempérament et la vivacité des sens entraînent
ordinairement ; que pour lui il avait résolu de s'imposer une peine
conforme à sa faute, et que la punition qu'il avait choisie, était
une vie obscure et privée pour pouvoir faire tête à son ambition.
Ces vieillards surpris de ces sentiments pleins de sagesse,
redoublèrent leurs empressements, en lui faisant connaître, que, qui
était capable de se former des impressions d'une si haute vertu,
devait prendre les rênes du gouvernement ; que toute la république
le souhaitait avec ardeur, et qu'il se devait plus au peuple qu'à
lui-même. Ces discours flatteurs et séduisants ne purent pas encore
l'ébranler et il refusa généreusement ce qui devait tant flatter son
amour propre.
Les députés s'en retournèrent et rendirent compte à la république de
sa réponse : elle ne fit qu'augmenter et relever l'idée qu'ils
avaient de sa vertu ; et le sénat assemblé, tout d'une commune voix
opinèrent qu'il était seul digne de les commander.
Il est aisé de penser l'effet que produisirent ces avantageuses
propositions dans l'esprit de Phalaris ; son ambition que
l'infortune semblait avoir éteint, se ralluma ; sa fierté naturelle
l'emporta sur toutes ses réflexions ; et admirant la bizarrerie de
sa destinée, il oublia et sa captivité et la cause même, pour ne
plus penser qu'à sa nouvelle élévation. Il comprenait bien que le
refus qu'il avait fait d'un poste qu'il souhaitait avec tant
d'ardeur, ne servirait qu'à augmenter les empressements des
Levintins. En effet ils le prièrent une seconde fois de prendre le
timon des affaires, et il ne put pas se dispenser de l'accepter.
Il serait difficile d'exprimer ici la joie que cette nouvelle
répandit parmi ces peuples, tout retentissait du nom de Phalaris,
tous les poètes chantaient ses louanges : la populace par des
acclamations et des cris de joie marquait la satisfaction qu'ils
avaient de l'avoir pour chef ; ils le portèrent en triomphe dans
leur ville capitale et le nommèrent leur dieu tutélaire et le
protecteur de la patrie.
Ce triomphe nouveau, ces excès d'honneur pourraient étonner ceux qui
ne connaissent point le caractère du peuple ; mais peu de gens
ignorent que la nouveauté a tant de charmes pour lui qu'il sacrifie
tout à cette idole.
Phalaris ne pouvait pas trouver une plus belle occasion de se venger
du mauvais traitement que les Siciliens lui avaient fait après sa
défaite ; il s'informa de ce qui se passait parmi eux depuis son
absence, du nom et du mérite de leur nouveau chef. Après qu'il eut
su par des espions fidèles l'état des troupes des ennemis et leur
nombre, il fit la revue de son armée et résolut de les prévenir par
une marche qu'il leur déroba. En effet, les deux armées parurent en
présence ; un grand ruisseau couvrait celle des ennemis et il était
fort difficile, n'étant pas guéable, d'y construire des ponts à la
vue de leur armée. Mais comme Phalaris voulait faire connaître à sa
patrie qu'il était toujours le même, il assembla le conseil de
guerre et tous les avis étant qu'il fallait attaquer, il harangua
ses soldats ; et comme il disposait son armée à passer ce ruisseau,
le général des ennemis qui n’avait pas moins d'émulation pour la
gloire que lui faisait déjà jeter des ponts pour aller l'attaquer ;
il était impossible que le combat ne fût pas des plus opiniâtres.
Ces deux armées brûlant d'en venir aux mains ; ils semblaient se
disputer l'honneur d'attaquer les premiers et ils se mêlèrent avec
tant de fureur que jamais il ne s'est vu un si grand carnage, la
victoire fut presque toujours incertaine ; comme ils combattaient
tous avec une égale valeur, elle ne se déclarait pour aucun et les
deux partis furent contraints, pour ralentir leur ardeur opiniâtre
et cruelle, de faire une cessation d'armes ! Nos deux généraux
également désespérés de ce que la fortune n'avoir point favorisé ni
l'un, ni l'autre, se proposèrent mutuellement de vider entr’ eux la
querelle publique ; il faisait beau voir ces deux lions s'avancer
fièrement l'un vers l'autre et commencer un combat qui n'aurait fini
qu’avec leurs vies si les soldats de chaque parti, fâchés de voir
ces deux héros si acharnés à se perdre, ne les avaient séparés ; la
nuit qui survint à propos obligea les deux armées à se retirer, mais
avec la résolution de recommencer le combat à la pointe du jour ;
pendant la nuit une troupe de corbeaux vint fondre sur le camp des
ennemis, et l'un d'eux fit tomber de son bec sur la tête du général
une flèche à moitié brisée ; d'abord les vieux capitaines et les
vieux soldats interprétèrent cette aventure et dirent que c'était un
présage certain de la perte de la bataille. Ce prodige se répandit
dans le camp et causa une consternation générale. Il se tint dans le
même temps un grand conseil, où la commune opinion fut qu'il fallait
se retirer, la nuit favorisant la retraite ; pour Phalaris, il
n'était occupé que de l'empressement de revoir le jour, afin de
forcer par des actions extraordinaires le sort à se déclarer pour
lui. L'Aurore paraissant, son premier soin fut de faire donner la
sépulture aux morts et d'ordonner de conduire les blessés hors du
camp ; et comme il se préparait à faire marcher son armée aux
ennemis, ne s'étant point encore aperçu de leur retraite, parce
qu'ils avaient eu le soin de mettre le feu dans leur camp, ce qui
avait causé une fumée si épaisse qu'on ne pouvait rien distinguer ;
il fut surpris lorsqu'un espion lui rapporta que les ennemis étaient
décampés : cette fuite inopinée, qui ne laissait pas d'être pour lui
une marque de victoire, le chagrina néanmoins ; il aurait souhaité
devoir à sa valeur et à l'intrépidité de ses troupes la gloire
d'être maître du champ de bataille ; mais il s'agissait de prendre
son parti et de se faire informer des mouvements de l'armée ennemie,
il ne fut 'pas longtemps sans en apprendre des nouvelles et cette
ridicule superstition les avait tellement éloignés qu'ils étaient à
plus de six milles de lui. C'était trop hasardeux que de vouloir les
suivre ; outre des marais qu'il aurait fallu passer et la fatigue de
ses troupes, ils s'étaient postés si avantageusement qu'il était
presque impossible de les y aller forcer. Il fut donc contraint pour
ne point demeurer dans 1'inaction, de faire marcher son armée à
petites journées et d'approcher de celle des ennemis pour pouvoir
les attirer; mais ce fut en vain, ils ne sortirent point de leurs
retranchements. Il est bon de remarquer ici un trait de la grandeur
d'âme de notre héros. Un des soldats ennemis demanda à lui parler,
ayant, disait-il, un secret des plus importants à lui confier ; il
le reçut avec sa bonté ordinaire. Ce soldat charmé de son projet lui
dit : qu'il avait conçu le dessein d'assassiner son général, et
qu'il était certain de la réussite ; il s'applaudissait déjà et en
attendait la récompense lorsque Phalaris lui dit d'un ton sévère :
Malheureux ! qui t'a fait concevoir un dessein si noir et si barbare
? apprends que ce grand homme, quoique notre ennemi, doit être
respectable par sa valeur et que la pensée d'un tel attentat mérite
la mort ; et en même temps il ordonna de lui faire lier les pieds et
les mains et renvoya dans cet état au chef des Siciliens, en
l'instruisant de son crime pour qu'il ordonnât lui-même sa punition
: mais ce général, qui ne voulait point lui céder en générosité, lui
donna sa grâce.
La saison étant devenue fâcheuse, les armées furent obligées de se
retirer, et Phalaris fut reçu par les Levintins avec des
applaudissements dus à la glorieuse campagne qu'il avait faite.
Après qu'il eut rendu compte à la république de tout ce qui s'était
passé, il résolut pour vaincre son penchant, de reprendre les
occupations de sa solitude ; mais il n'était pas né pour une vie
tranquille, l'amour s'était trop offensé de son retour à la vertu
pour ne pas chercher les moyens de se venger. L'objet dont il
s'était servi pour séduire le coeur de notre héros, n'était pas
assez éloigné pour qu'il en changeât, dans le dessein de le
surprendre une seconde fois, Cornelie, qui autrefois n'avait cherché
à le charmer que pour contenter et l'amour qu'elle avait pour sa
patrie et sa propre ambition, se trouve elle-même sensible au mérite
personnel et à la haute réputation de Phalaris. .
Elle ne l'avait vu depuis sa détention qu'en public, et même elle
avait pris soin de se cacher, honteuse d'avoir été l'instrument de
sa perte, elle s'était déjà mille fois reproché la bassesse de cette
action et elle aurait souhaité trouver quelques occasions favorables
pour s'en justifier. Mais comment oser paraître devant un homme dont
on a trompé la bonne foi ? la chose lui avait paru impossible, et
elle cherchait même des amusements qui pussent la détourner de cette
pensée : mais l'amour qui la voulait punir elle-même s'insinua avec
tant de violence dans son coeur que l'absence de Phalaris et sa
victoire remportée augmentèrent la passion : d'un autre côté toute
sa philosophie et toute la morale n'eurent pas assez de force pour
faire oublier entièrement Cornélie à ce général ; malgré la sévérité
des maximes et des principes qu'il voulait se former, l'idée de
cette aimable personne l'occupait sans cesse ; il aurait voulu
qu'elle ne se fût point servie d'un artifice aussi bas et aussi
indigne d'elle, c'était là le seul défaut qu'il lui trouvait, il
était même des moments où il cherchait à l'excuser et puis se
révoltant contre lui-même, il avait honte de tant de faiblesse : je
crois même que sa raison l'aurait empêché de succomber si le hasard
ne lui avait fourni la fatale occasion de revoir Cornélie. Comme
elle avait plus d'empressement que lui de pouvoir le joindre et que
c'était pour elle un cruel tourment d'en être séparée, son amour lui
fit inventer un moyen sûr pour y réussir.
Les officiers de l'armée avaient coutume dans de certains jours, de
venir rendre compte à Phalaris de l'état des troupes et dans ce
temps tout le monde avait la liberté de lui parler ; elle résolut
donc de prendre un habit de cavalier, afin que sous ce déguisement
elle eût plus de liberté et ne fût pas sitôt reconnue . Phalaris
d'abord ne la distingua point de la foule ; mais bientôt après,
jetant par hasard les yeux sur elle, il se sentit tout d'un coup
frappé, sans savoir la cause de son émotion : cependant tous les
officiers s'étaient déjà retirés, il ne restait plus que
l'infortunée Cornelie que l'amour et la crainte avaient rendue
immobile. Phalaris n'était pas plus tranquille ; plus il examinait
ce faux cavalier, plus il reconnaissait les traits de son infidèle.
Enfin il voulut s'éclaircir de ce doute cruel et lui demanda ce
qu'il souhaitait ; Cornelie se jeta d'abord à ses genoux et lui dit,
en poussant un profond soupir : qu'elle venait implorer sa clémence,
puisqu'elle méritait d'être immolée à sa justice ; qu'elle avouait
que son crime était grand ; mais que son remords de l'avoir commis
l'avait tellement tourmentée, qu'elle n'avait pu résister à
l'empressement de s'entendre condamner par lui-même.
La posture humiliante de Cornélie et l'aveu de son crime
embarrassèrent autant le juge que le criminel: l'amour lui fit
sentir que c'était la même qui avait su le séduire dans les troubles
d'un camp et qui venait réveiller sa passion jusque dans sa
solitude.
Les différentes pensées qui l'agitaient furent cause qu'il laissa
quelque temps dans la même situation cette belle esclave. Mais
enfin, ces mêmes pleurs qui jadis lui coûtèrent sa liberté, furent
encore assez puissantes pour dissiper toutes les sages réflexions,
que sa chute lui avait fait faire.
Il se rendit à lui-même, et relevant cette aimable suppliante, il le
devint à son tour. Ce fut dans ce moment où tout l'amour qu'il avait
eu pour elle se ralluma avec tant de vivacité, qu'oubliant même la
gravité de son caractère et la perfidie de cette belle Grecque, il
allait se jeter à ses pieds , si Cornélie voulant profiter de ces
heureux instants, ne l'en eût empêché par un effort tendre et ne lui
eût dit pour se justifier tout ce que l'amour lui put inspirer et de
plus touchant et de plus gracieux : cette justification acheva sa
défaite, et sa captivité qui lui avait paru si odieuse, lui sembla
pour lors si douce et si heureuse que loin de la blâmer et de lui
reprocher son ingratitude; sa passion l'aveugla à tel point, qu'il
eut la faiblesse de lui avouer que de pareilles chaînes devaient
faire plus de plaisir que la plus grande liberté; que la cause en
était si belle, qu'il se reprochait tous les regrets qu'il en avait
eus ; qu'il connaissait bien présentement que ce n'était point sa
prison qui lui avait causé tant d'inquiétudes, que l'absence du seul
objet qui pouvait faire sa félicité avait excité tous ses troubles,
et que la démarche qu'elle venait de faire lui tenait lieu de tout,
et qu'il voulait dorénavant mettre toute sa gloire à mériter les
bontés qu'elle paraissait avoir pour lui.
Il est aisé de comprendre l'effet que produisit un pareil langage ;
notre belle n'y répondit que par des regards si passionnés, que ce
silence heureux porta tant de coups à la fois au coeur de ce tendre
amant, qu'il lui promit une fidélité éternelle. Et enfin, après
s'être éclaircis entre eux de tout ce qui s'était passé depuis leur
absence et que Cornelie lui eut bien assuré que l'amour de la
patrie, l'obéissance et le devoir avaient fait tout son crime, que
désormais elle ne voulait mesurer son amour qu'a la gloire que sa
valeur lui acquerrait, que c'était sa réputation autant que son
propre mérite qui l'avaient attachée à lui ; et qu'ainsi elle
regarderait l'amant dans le héros et le héros dans l'amant, que
toute son ambition serait de ne lui point céder en sentiments; de
sorte que l'amour, qui chez le vulgaire est ordinairement une
passion sujette à mille faiblesses, deviendrait entre eux une noble
occupation, plus capable de réveiller la vertu que de l'altérer, et
plus propre par sa délicatesse à exciter à la victoire, qu'à la
mollesse ; car il est naturel de chercher à plaire à l'objet aimé;
et lorsque le véritable honneur et l'élévation en sont les seuls
moyens, un général n'en est que plus animé et n'en a que plus de
delà de courir à la gloire.
Ces sentiments charmèrent Phalaris, il les trouva dignes de lui ; et
après lui avoir dit tout ce que sa passion et sa politesse naturelle
lui inspirèrent, ils prirent des mesures ensemble pour se voir, et
pour cacher un commerce dont le secret leur était si important ; et
enfin, se séparèrent, en se faisant mille serments d'un amour
inviolable.
Phalaris aurait été moins sensible, malgré toute son ambition à la
possession d'une couronne, qu'il le fut à cette entrevue ; il
n'aurait pas voulu céder sa fortune pour l'empire du monde : ce qui
doit bien nous faire connaître que le bonheur de l'homme ne dépend
que de son imagination, et que l'objet le plus bas comme le plus
élevé le peut fixer lorsque ses sens se trouvent satisfaits. Ce font
les maîtres absolus de l'âme; et les grands hommes que l'histoire
nous a tant vantés, ne diffèrent de ceux qui se sont ensevelis dans
le néant, que parce qu'ils ne s'abandonnaient à toutes les passions,
que légèrement, et par amusement; et qu'une seule les maîtrisait,
qui est l'amour propre : il est certain que les héros et les savants
ne sont parvenus, les uns à ce haut degré de gloire et les autres à
cette grande perfection apparente, qu'en satisfaisant et s'immolant
à cette passion dominante.
Les philosophes qui avaient le plus combattu l'amour et ses
emportements paraissent présentement à Phalaris d'une morale outrée,
contraire à la société et contre la nature même. Il a déjà su
accorder et sa raison et sa passion: tout ensemble l'autorise à
brûler de ce feu violent, et il s'est déjà fait un principe assuré
de croire que l'amour doit être inséparable du héros ; son âme n'est
plus occupée que des moyens de plaire à sa chère Cornelie : il
commence par ses ajustements ; et enfin ce n'est plus ce cynique qui
se frondant lui-même, ne s'appliquait qu'à censurer les autres ; les
plaisirs et les jeux qui autrefois lui avaient parus indignes de
l'homme, lui deviennent familiers : un air de vivacité prend la
place de sa gravité et de son sang froid ;
l'amour ne put mieux se venger qu'en faisant une pareille
métamorphose. Il ne négligea aucun moment de voir sa belle ; ils
jouissaient de tous les agréments qu'un commerce de coeur établi par
la délicatesse des sentiments et par une vivacité d'esprit égale,
peut faire goûter. Leur étude était d'épurer l'amour et d'en
corriger tout le grossier. Enfin, rien ne manquait à leur félicité;
tous leurs désirs étaient prévenus ; la fortune les favorisait ;
l'amant était comblé de gloire et la maîtresse, de beauté et
d'agréments ; ils avaient l'avantage de tromper un mari jaloux et
surveillant, qui en effet ne pouvait reprocher à son épouse, que
d'avoir trop de goût pour le vrai mérite, puisqu'elle ne laissait
pas de s'immoler à son devoir.
Phalaris ne négligeait point pour cela les affaires publiques; toute
la république était charmée, et de sa bonne conduite et de son
expérience : elle venait même d'en recevoir des marques dans la paix
qu'il avait déjà faite avec les Magariens, paix plus avantageuse à
cet état que la plus brillante victoire .
Sa valeur avait porté ces peuples à implorer sa bonté : leurs
voisins cherchaient à suivre cet exemple; la guerre allait finir, si
Cornelie confidente de tous ses secrets, ne lui avait conseillé de
la continuer, lui faisant entendre que ces mêmes peuples qui
l'avaient élevé aujourd'hui au plus haut rang, parce qu'ils avaient
besoin de son bras, demain le regarderaient comme un homme privé et
inutile, s'il cessait de leur être nécessaire, et qu'il n'y avait
que la guerre qui pût maintenir son autorité et satisfaire son
ambition.
Ces raisons parurent trop fortes à notre général pour ne pas les
préférer au bien commun, en sorte qu'il fit une harangue peu de
temps après en pleine assemblée, où il prouva avec éloquence aux
Levintins que la paix qu'ils venaient de faire avec les Magariens,
les mettait plus en état que jamais de continuer la guerre avec le
Siciliens. Les plus sages ne furent point de cet avis ; mais comme
la fausse complaisance avait entraîné les uns, et l'intérêt
particulier les autres, il fut résolu de disposer tout pour se
mettre en campagne.
Voilà le moment fatal qui va séparer nos amants. Que ne se
dirent-ils point avant ce funeste départ? La belle aurait souhaité
posséder toujours Phalaris, et cependant elle le voulait voir voler
à la victoire ; mais l'ambition l'emporta sur tous les deux ; ils
renouvelèrent leurs promesses; Cornelie le pria de se ménager ,
puisque .sa vie en dépendait; avec ces assurances et ces témoignages
d'une constance éternelle, nôtre héros parut presque certain du
succès de cette campagne; les larmes furent retranchées ; on ne les
regardait plus que comme des marques de faiblesses en usage parmi le
commun des femmes.
Laissons notre héroïne en proie à ses grandes idées, et conduisons
notre héros à la tête d'une belle armée disposée à bien faire et
ayant toute confiance en lui. Il occupa d'abord un poste avantageux
pour mieux observer le mouvement des ennemis ; et comme il ne
cherchait qu'à se signaler, il en trouva bientôt l'occasion, et en
aurait même profité, si la dissension ne s'était mise parmi ses
troupes pour le rang ; les gens du pays voulaient faire la tête, et
les étrangers soutenaient que ce poste leur était dû. Toute sa
prudence et sa bonté ne furent pas capables d'apaiser les séditieux,
il fut obligé de se servir de son autorité; il eut même recours aux
supplices, ce qui diminua beaucoup le crédit qu'il avait parmi eux ;
ils murmuraient déjà de sa sévérité ; la douceur ne pouvait plus
rien sur leurs esprits ; la violence et la force les révoltaient, ce
qui pensa le perdre par :leurs fréquentes désertions. Si les ennemis
eussent voulu profiter de ces révolutions, la défaite eût été
certaine ; mais comme la mortalité s'était mise parmi eux ils ne se
trouvèrent point en état de le faire.
Cependant les soldats et les officiers avaient écrit à la république
contre Phalaris ; le bon ordre qu'il avait voulu faire, succéder au
désordre fut traité de tyrannie par ces rebelles : ils osaient même
dire tout haut, que cet étranger ne s'était servi d'abord de la
clémence et de la douceur, que pour pouvoir dans la suite se rendre
maître du gouvernement ; ces bruits injurieux parvenus jusqu'à lui,
l'obligèrent encore d'en punir les auteurs, et de faire publier,
que, qui dorénavant sortirait du camp sans ses ordres serait écorché
tout vif.
Ce genre de supplice leur parut si affreux, qu'ils conspirèrent dès
lors contre sa vie ; il se vit réduit à se retrancher jusqu'aux
dents pour éviter une affaire, ne se trouvant pas en état de la
soutenir. Le jour pris pour l'assassiner, il en fut heureusement
averti par un de ceux me qui avaient été du complot, et qui ayant
horreur de cet attentat, vint généreusement le lui découvrir. Il
reçut cette nouvelle avec un sang froid digne de lui, et loin de
retenir ce soldat, il le renvoya avec un présent proportionné à
l'action qu'il venait de faire, en lui disant fièrement que la vie
de Phalaris était entre les mains des dieux qui protégeaient la
vertu et qui punissaient le crime : qu'il était certain que ses
conspirateurs ne soutiendraient pas sa vue et qu'il avait lui seul
fait trembler tant de peuples divers, que des malheureux échappés à
vengeance n'auraient jamais la témérité de l'aborder. Néanmoins
comme il était de sa prudence de faire un exemple public de ces
scélérats, il redoubla sa garde avec ordre au premier signal de
l'entourer.
Ces traîtres aveuglés par l'espérance du butin et par le désir de la
vengeance, se mirent en devoir d'exécuter leur indigne projet ; et
ce général eut l'assurance de se présenter à eux.
Sa fierté et fa fermeté les démonta ; mais sa garde impatiente de se
saisir de ces téméraires, les enveloppa et les désarma ; ils ne
firent pas la moindre résistance tant il est vrai que le crime porte
en soi tant d'horreur, que les plus déterminés tremblent et
pâlissent en s'y abandonnant.
Phalaris fit assembler son conseil de guerre, ne voulant pas
lui-même être juge en sa propre cause. Tous les officiers d'une
commune voix les condamnèrent à la mort ; il leur accorda seulement
le choix du supplice. On les conduisit à la tête de l'armée pour
être justiciés. Et dans le temps que ces malheureux n'attendaient
que le trépas, ce grand homme, qui naturellement accordait tout à la
vengeance, fit un assez grand effort sur lui pour leur pardonner et
se contenta de leur dire: vous êtes assez punis par la honte et
l'infamie du supplice, et par les remords de votre crime ; que
désormais votre valeur ait de plus nobles motifs, puisque je ne
voulais vous servir que de père; tournez toute votre haine contre
vos ennemis en défendant l'honneur de votre patrie, et montrez-vous
par des actions éclatantes, véritables citoyens ; ne respectez en
moi que le caractère, si vous ne voulez pas estimer Phalaris. Ces
grâces inespérées lui regagnèrent la confiance du soldat, et tous
dès ce moment ne demandèrent plus qu'à combattre.
Les ennemis instruits de tout ce qui s'était passé dans son camp,
avaient enfin résolu de tenter à le forcer dans ses retranchements ;
mais ils y trouvèrent tant de résistance, et firent une perte si
considérable qu'ils furent obligés de se retirer.
Phalaris ne jugea pas à propos de les poursuivre, ayant perdu la
confiance qu'il avait auparavant en ses troupes ; la prudence
s'opposa à la valeur et il crut qu'il serait plus glorieux pour lui
après ce tumulte, de borner là les conquêtes, que de faire de
nouvelles entreprises. Les ennemis dont les projets avaient échoué,
craignant que ce général ne sortît de ses retranchements, en avaient
fait eux-mêmes en sorte que ces deux armées ne firent plus que
s'escarmoucher et finirent ainsi cette Campagne.
Cornélie, qui avait été informée et de la sédition et de la
conspiration, était tombée dans de si terribles alarmes, qu'il n'y
eut que la seule présence de son héros qui les pût dissiper. Elle le
reçut avec d'autant plus de joie, que sa perte lui avait paru
presque assurée. En effet il avait eu tout à craindre. La république
après avoir reçu les avis des soldats, avait pris ombrage de la
grande autorité de Phalaris. La crainte de perdre sa liberté,
l'avait emporté sur la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir pour
ses services. Et comme dans un état il se trouve toujours des hommes
jaloux de l'élévation des autres, la fortune de ce général lui avait
suscité des ennemis secrets qui cherchaient à empoisonner ses
actions et à insinuer dans l'esprit des Peuples , que cet étranger
était d'une ambition démesurée, qu'il pourrait bien dans la suite
usurper le gouvernement.
Les Levintins commençaient déjà à se lasser de leur nouveau chef,
les uns par le goût de la nouveauté, et les autres accoutumés à une
vie licencieuse ne pouvaient souffrir sa sévérité, L'orage se
préparait, et peut-être que. sans Cornélie il n'aurait point échappé
au naufrage : mais cette amante attentive. à tout ce qui intéressait
son amant, sut bientôt les brigues qui se formaient contre lui.
Sa perte était jurée et il n'était pas difficile à un peuple mutin
et changeant, d'en faire naître des causes. La plus forte, quoique
supposée, était la trop grande rigueur et la cruauté avec laquelle
il avait puni les soldats. La seconde émit la grande dissipation
d'argent qu'il avait faite. Ces deux chefs d'accusation n'étaient
fondés que sur leur fausse prévention. Car à l'égard du premier, un
général ne saurait trop imposer aux troupes et leur faire observer
avec trop d'exactitude la discipline militaire. Pour le second,
jamais homme n'a été moins capable de concussion ; il ne connaissait
point le prix des richesses et l'usage ne lui en paraissait agréable
que parce qu'il faut soutenir son rang , et les répandre
libéralement quand il s'agit du service de l'état.
Phalaris remarqua bien le changement du peuple, il chercha dès ce
moments les moyens de le prévenir : il consulta sur ce sujet celle
qui pouvait seule l'attacher dans ce pays ; ce qui les embarrassait
c'était qu'il fallait que Cornélie prit le parti d'abandonner sa
famille et son époux, pour suivre le sort d'un homme qu'elle aimait
plus qu'elle-même.
Le devoir et vertu étaient bien contraires à ces projets leur
commune délicatesse s'y opposait ; et néanmoins comment faire pour
se séparer si cruellement ? mais le sort qui s'était appliqué à
tourmenter plus Phalaris qu'un autre, ne se contentait pas de le
troubler dans ses projets d'élévation ; il voulait encore désunir
deux coeurs que l'amour avoir pris plaisir de faire naître l'un pour
l'autre.
Après s'être dit tout ce qu'en pareille occasion deux personnes qui
s'aiment tendrement peuvent se dire, la prudence et le soin de la
réputation l'emportèrent et Phalaris jugea à propos de chercher à se
fier, et d'essuyer plutôt l'orage prêt à tomber, que de s'exposer à
un éloignement plus cruel que la mort.
Les choses en cet état, Phalaris fit convoquer l'assemblée et pour
que l'on ne prît aucun soupçon de lui, il y alla sans gardes, ce qui
ne lui était point encore arrivé : cette confiance désarma les plus
révoltés ; et quand ils furent tous assemblés, il leur: parla en ces
termes :
J'ai appris que les troupes s'étaient plaintes de ma trop grande
exactitude ; je m'étais imaginé, ô Levintins ! qu'un bon général. ne
pouvait apporter trop de soin pour contenir le soldat dans son
devoir; il faut les châtier de leur trop grande licence, et
récompenser avec discernement leur valeur : j'ai fait l'un et
l'autre, voilà mon crime. Je ne vous dirai point qu'ils ont eu la
témérité d'attenter à ma propre vie, ni que l'ayant découvert je
leur ai fait grâce, cela ne regardant point le bien commun.
Je ne vous ai fait ici assembler que pour vous faire connaître que
la seule vertu a toujours été le principe de mes actions, et la fin.
Vous m'avez retiré de la solitude où j'avais appris à. mépriser les
grandeurs et les vains applaudissements des hommes ; vos
empressements m'en ont arraché : mais comme je n'ai pas encore perdu
le souvenir des douceurs que la vie privée entraîne après elle, je
vous demande la liberté de rentrer dans mon désert, après vous
avoir. rendu compte de tout ce que j'ai fait pendant mon
gouvernement ; la simplicité me tiendra lieu de tout ; mon état ne
fera point d'envieux ; ma conduite ne rendra point de mécontents, et
j'aurai eu du moins la satisfaction d'abandonner sans regret de
vains titres dont les apparences nous séduisent mais qui dans le
fonds ne sont qu'une fumée que le moindre vent dissipe.
Tout le Peuple avait gardé un profond silence ; ils se regardaient
les uns les autres, surpris de la fermeté de ce général. Et enfin ,
les plus respectables d'entre eux prirent la parole et dirent :
Qu'ils savaient trop bien mesurer la reconnaissance aux services
qu'on leur avait rendus, et qu'ils connaissaient trop bien et son
intrépidité et sa grandeur d'âme pour pouvoir désapprouver sa
conduite que s'il leur pouvait paraître suspect en quelque chose, ce
ne serait que parce que le trouvant digne d'une couronne,
l'ambition; lui pourrait bien faire concevoir le dessein de la
posséder et que la liberté leur était si précieuse, que leur vie
l'était bien moins.
Phalaris n'eut point de peine à les rassurer sur ce point : c'était
moins l'ardeur de régner qui l'occupait, que le plaisir de posséder
sa chère Cornelie : ainsi , il leur prouva avec éloquence, qu'il se
regardait comme un simple citoyen, qu'il n'avait accepté le
gouvernement que pour les maintenir dans cette même liberté qu'il
regardait comme le souverain bien de l'homme.
Ce discours le rétablit mieux que jamais dans l'esprit de ces
peuples ; la démarche qu'il venait de faire marquait assez
l'empressement qu'il avait de ménager leur bienveillance ; ce
qui produisit deux effets bien différents. L'un fut que ceux qui
sans intérêt particulier s'étaient laissés entraîner par la foule
devinrent ses plus fidèles partisans, et l'autre imposa silence aux
envieux de son bonheur. La seule Cornelie profita de ce
raccommodement ; c'était une preuve assez forte de la passion de son
amant, puisqu'il lui sacrifiait sa fierté naturelle et son ambition
: car il est certain que pour tout autre sujet il ne se serait
jamais abaissé jusqu'au point de prévenir ses ennemis.
Mais rien ne paraît impossible à ce souverain de nos coeurs, et ce
qui hors de son empire semblerait déshonorer, devient un sujet de
gloire lorsqu'il s'agit de le servir.
Après ce calme heureux nos amants ne songeaient plus qu'à donner de
nouvelles forces à leur passion, en l'entretenant par les désirs et
par la connaissance qu'ils avaient tous les jours entre eux d'un
nouveau mérite ; mais leur bonheur était trop grand, ils ne
goûtaient que les douceurs, sans essuyer les peines.
Le Soleil se levait serein pour eux, tout favorisait leurs désirs;
les dieux mêmes dispensateurs de la félicité, ne jouissaient point
des mêmes avantages. Mais qu'ils vont payer cher ces doux moments !
une tempête affreuse va succéder à ce grand calme ; et la fortune
qui jadis s'était servie de la femme pour perdre Phalaris, va se
servir aujourd'hui de l'époux pour les accabler tous deux.
Polinestor jaloux, à la fureur de Cornélie, commençait à
s'apercevoir que l'indifférence de son épouse ne provenait que d'un
autre engagement; cependant l'idée qu'il avait de sa vertu le
rassura pendant quelque temps: mais comme sur la fin sa nouvelle
passion l'avait porté à un tel excès de délicatesse, qu'elle
refusait au devoir et à la raison les droits légitimes et naturels.
Cette manière de vivre causa de furieux soupçons à notre Argus, il
en devint plus surveillant : et enfin, après une longue recherche,
il examina sa femme de si près, et posta tant d'espions pour
découvrir sa marche, qu'enfin sa jalousie et la perfidie d'un
domestique de Phalaris le conduisirent au rendez-vous.
Phalaris, pour avoir plus de liberté d'entretenir sa belle Cornélie,
avait acheté à deux mille de la ville un lieu de plaisance, où l'art
et la nature semblaient par émulation s'être surpassés. Ce fut dans
ce lieu champêtre et solitaire où nos deux amants furent découverts
par Polinestor; un domestique de Phalaris qu'il avait gagné par
présent, le conduisit dans ce séjour où la présence du mari n'était
nullement nécessaire.
Nos tranquilles amants goûtaient les plaisirs d'une table
délicatement servie, lorsque cet époux écumant de rage, entra
brusquement un poignard à la main, et en frappa la malheureuse
Cornélie avant que Phalaris eût pu se mettre en état de la défendre.
Elle fut si surprise du coup et de la présence de son mari, qu'elle
tomba évanouie, et sans sentiment. L'action de ce furieux anima
tellement notre infortuné amant, que sans penser que c'était un mari
qui se vengeait de l'infidélité prétendue de sa femme, il l'attaqua
comme un assassin et son plus cruel ennemi. Ils commencèrent entre
eux un combat si sanglant, que Polinestor, quoique transporté de
rage et de colère, ne put soutenir les terribles efforts de Phalaris
et reçut deux coups qui lui coûtèrent la vie.
Cette tragique scène s'était passée dans un lieu si reculé de la
maison, qu'aucun domestique ne s'en aperçut, Phalaris ayant coutume
d'y rester seul.
Ce fut un cruel spectacle pour lui que de voir le mari mort et
l'épouse expirante. Son premier soin fut de songer à lui racheter la
vie, il négligea celui de cacher cet horrible attentat, il appela à
son secours, et imposant le secret à ses domestiques, il fit
transporter Cornelie dans un autre lieu. Le combat qu'il venait
d'avoir avec l'époux de cette infortunée lui avoir causé plus
d'alarmes que sa blessure ; mais elle n'avait point encore senti
toute la violence de son mal : l'image affreuse de tout ce qui
venait de se passer se présenta à ses yeux, l'horreur qu'elle en
conçut lui causa un transport si violent, qu'elle perdit encore
toute connaissance. Notre amant désespéré se tourmentait pour la
soulager; il promettait aux chirurgiens tout ce qu'il possédait,
s'ils pouvaient lui conserver la vie. Jamais trouble n'a été plus
grand.
Avant ce dernier accident, Cornélie avait été si agitée, qu'elle ne
l'avait point reconnu : il consultait à chaque instant les médecins
; il observait leur visage ; tout le faisait pâlir. Enfin, il aurait
succombé à ces mortelles inquiétudes, si un des chirurgiens ayant
fait respirer à notre belle mourante je ne sais qu'elle essence,
elle n'était revenue de sa léthargie. Phalaris l'embrassa tout
transporté de joie. Le premier objet qui se présenta à elle, au
retour de cet évanouissement fut ce malheureux amant, elle poussa un
profond soupir et le regardant languissamment, elle lui fit ligne de
faire retirer tout le monde. Il donna cet ordre, après s'être bien
informé de l'état de la plaie ; et lorsque les chirurgiens l'eurent
assuré qu'elle n'était point dangereuse, mais qu'il lui fallait du
repos : il rentra et se jetant aux genoux de sa maîtresse, il les
arrosa de ses larmes ; elle le fit relever, et comme si elle sortait
d'un profond sommeil, elle lui demanda ce qu'était devenu son
perfide époux : comme il balançait à lui répondre ; c'en est donc
fait, lui dit-elle, il est mort ; et il faut, cruel, que ce soit par
vos mains ; il voulut lui cacher, mais en vain ; l'incertitude où il
l'aurait mise était trop dangereuse dans l'état où elle était ; il
fallut lui avouer, que n'ayant pu soutenir l'action de ce barbare,
l'amour l'avait emporté sur la prudence et la raison ; que
d'ailleurs ce furieux l'avait contraint de se défendre, que le sort
des armes en avait décidé. Ha ! s'écria-t-elle, les yeux baignés de
pleurs, il est donc mort ? malheureuse que je suis ; faut-il que je
trouve son assassin dans mon amant ? Ha ! funeste pensée ; puis-je
survivre à cette disgrâce ? Pourquoi la cruelle mort n'est-elle
point venue à mon secours ? ou pourquoi trop malheureux amant ne
m'arrachez-vous pas une vie, qui ne me peut être qu'odieuse ? Ces
funestes pensées lui pensèrent coûter la vie. Phalaris lui dit tout
ce qu'il crut de plus capable et de se justifier et de la consoler ;
mais rien ne la put gagner. Non, s'écria-t-elle hors d'elle-même,
tendresse et vous funeste amour, vous ne l'emporterez point sur le
devoir ! Oui, je vous regarde dès ce moment, Phalaris, comme mon
plus cruel ennemi ; je plains votre sort et le mien ; mis il y va de
ma gloire, il faut que je venge la mort de mon mari ; vous en êtes
l'assassin, et je me croirais indigne de vous, si j'avais la
faiblesse de vous pardonner ce meurtre.
Il est vrai que si je ne consultais que mes sens, sa barbarie me
consolerait de sa perte ; mais la vengeance est une bassesse ;
l'honneur veut que j'immole mon amant à ses Mânes, j'en mourrai ;
mais du moins ma mort fera le triomphe de ma vertu.
Phalaris ne voulut point se défendre davantage, il lui laissa le
temps de donner un libre cours à sa douleur ; il admirait
l'élévation et la grandeur d'âme de cette femme illustre. Ces
sentiments ne faisaient qu'augmenter sa passion ; était plus occupé
du rétablissement de sa santé qu'il n'était alarmé de ses grands
projets ; il attendait tout du temps et de sa tendresse. Comme il
faisait ces réflexions, un doux sommeil succéda au trouble mortel de
Cornélie ; notre amant en fut charmé; il eut le loisir de
s'abandonner aux plus tristes pensées ; il comprit d'abord que sa
perte était certaine, qu'un secret confié à des domestiques, ne
pouvait être longtemps caché : d'un autre côte la blessure de sa
maîtresse l'inquiétait ; ses ressentiments le troublaient ; tout
était à craindre pour lui ; sa mort devait causer la sienne ; son
indifférence, ou son inimitié au¬raient produit le même effet : il
devait tout appréhender du peuple. Ce combat étant connu, il perdait
sa réputation ; il était exposé à souffrir la mort la plus
ignominieuse. Mais hélas ! quel parti prendre ? ce n'est point le
trépas qui lui fait horreur ; sa situation le lui fait regarder
comme un terme heureux ; la honte et l'ignominie du supplice, la
perte de sa gloire et de sa chère Cornelie le saisissent d'effroi ;
sa première vertu se réveille; elle lui fait sentir toute sa
faiblesse, et il a besoin dans ces funestes moments de son secours
pour se dérober au désespoir.
Mille funestes desseins s'emparent de son âme, la vie lui paraît un
supplice ; et enfin, tous ces fâcheux projets ne s'évanouissent
qu'au réveil de l'objet de tous ses malheurs. Il oublie tout dès
lors pour ne s'appliquer qu'à la soulager, et à lui rassurer
l'esprit; le repos dont elle vient de jouir, ne la va que rendre
plus vive sur ses malheurs; la présence de Phalaris la gêne ; elle
essuie un si rude combat entre l'amour et la gloire, que toute sa
constance n'y peut suffire ; elle sent bien que quelques efforts
qu'elle fasse, elle ne peut le haïr, un silence affreux est le seul
parti qu'elle puisse prendre.
Phalaris croyant entrevoir plus de calme, se jette encore à ses
pieds et la regardant d'un air tendre, il lui dit : qu'il est vrai
qu'il est criminel, mais que l'amour a fait son crime : que
néanmoins il est prêt de l'expier ; qu'elle dispose du supplice ;
que son sang ne demande qu'à se répandre, et qu'il est de sa gloire
de le verser; trop heureux en expirant de recevoir le coup de sa
propre main.
Poursuis, cruel, lui dit-elle en l'interrompant ; ne te contente pas
d'avoir poignardé le mari , perce encore de mille coups la femme,
barbare que tu es, qu'oses-tu me proposer ? Non, non, ma main est
trop faible pour me venger, une autre plus puissante doit te porter
les coups. Mais que dis-je, malheureuse, dois-je m'armer contre
d'autre que moi-même ! ne suis-je pas seule la cause funeste de
cette sanglante tragédie ? Hé bien, mon cher Phalaris, si tu m'aimes
encore, laisse-moi mourir, laisse-moi ensevelir dans le tombeau
toute ma honte et toute ma douleur ; fuis de ces lieux cruels, va
chercher une contrée moins funeste, et ressouviens-toi de
l'infortunée Cornélie.
Ses larmes et les différents mouvements que sa disgrâce lui avait
fait sentir, rouvrirent sa plaie ; Phalaris fit appeler les
chirurgiens, qui, d'abord qu'ils eurent levé le premier appareil, la
trouvèrent en si mauvais état, jointe à une grosse fièvre qui lui
survint, qu'ils commencèrent à désespérer de sa vie. En effet peu
après elle expira entre les bras de son malheureux amant.
Je n'entreprendrai point de peindre ici les transports furieux et le
désespoir de Phalaris ; il suffit de dire que cette perte lui fut si
sensible, qu'elle le rendit immobile et hors d'état de se livrer à
toute sa rage. Car il est certain que l'excès de douleur nous rend
insensible et que l'âme trop pénétrée, ne fait plus aucune fonction
humaine. Ce fut dans ce temps que le plus fidèle des domestiques de
Phalaris, qu'il avait envoyé à la ville pour savoir ce qui se disait
de l'absence de Polinestor et de Cornélie vint lui rapporter avec
empressement que tout était découvert, qu'il se sauvât et qu'on le
cherchait ; qu'il n'y avait pas un moment à perdre ; qu'un de ses
gens l'avait trahi, dans l'espérance d'une récompense ; que le
peuple était en rumeur ; qu'ils criaient vengeance et que s'il ne
prenait tout à l'instant son parti , il ne pourrait échapper à leur
fureur. Il écouta tout cela sans émotion; et si le zèle de ce valet
avait été mains grand, il se ferait abandonné à la rage de ses
ennemis Mais Epicarme (c'est le nom de ce zélé domestique,) après
s'être chargé de tout ce qu'il trouva de plus précieux, obligea son
maître de se déguiser et de sortir par une porte de derrière. Ils
virent en sortant une troupe, qui venait entourer la maison ; ce qui
leur fit redoubler le pas.
Comme aucuns des autres domestiques ne savaient cette fuite, il leur
fut aisé de se sauver.
Ces furieux assemblés autour de cette maison en enfoncèrent les
portes, et croyant y trouver Phalaris, le cherchèrent partout, mais
en vain, il était déjà bien loin. Ils entrèrent dans l'appartement
où était Cornélie ; les chirurgiens y étaient encore appliqués à
faire l'ouverture de son corps (c'était une subtilité d'Epicarme ;)
il leur avait dit pour les amuser, que son maître leur ordonnait de
faire cette opération, parce qu'il voulait savoir si sans l'accident
qui lui était arrivé elle aurait pu vivre longtemps.
Parmi ce grand nombre de soldats il y avait des parents de
Polinestor qui furent bien surpris de ce spectacle ; ils s'écrièrent
que Phalaris avait aussi assassiné la femme, et vomirent cent
imprécations contre lui ; ils cherchèrent inutilement le corps de
Polinestor, on l'avait enterré
dans un coin du jardin ; et plus désespérés de ce que Phalaris leur
était échappé, ils se mirent en campagne pour le suivre ; mais il
était déjà hors de danger, car ils avaient fait tant de chemin,
qu'ils arrivèrent à la seconde journée chez les Gamarins peuples
barbares ; c'était une sure retraite pour eux.
Ainsi, Phalaris résolut d'y séjourner pour pouvoir se reposer, et
réfléchir plus à loisir sur sa situation.
Ceux qui s'étaient mis en marche pour le chercher, s'en retournèrent
ne le trouvant point.
Les Levintins furent partagés sur ce sujet. Les sages outrés et
sévères, condamnèrent hautement cette action ; les autres dont la
vertu était plus humaine et qui connaissaient mieux le coeur de
l'homme, plaignirent le sort de Phalaris, désapprouvèrent
l'imprudence de Polinestor et la faiblesse de Cornélie.
Pour Phalaris, il était inconsolable ; il se reprochait la mort de
cette belle infortunée ; les révolutions de sa fortune démontaient
tous ses raisonnements ; il tombait d'une résolution dans une autre,
toujours incertain sur le parti qu'il avait à prendre : tantôt il
formait le dessein de se retirer dans la solitude la plus affreuse ;
tantôt il voulait se livrer aux Levintins.
Enfin après avoir longtemps combattu, son ambition prit le dessus ;
il s'arma de toute sa raison : il s'étudia à éloigner des souvenirs
fâcheux, et le temps acheva ce que la constance et la fermeté
avaient commencé.
Ces différents événements n'étaient qu'un prélude de ce qui devait
lui arriver. C'est la plus faible des passions qu'il a à combattre
pendant sa jeunesse ; une bien plus forte va succéder, qui le
maîtrisera à un tel point, qu'il ne sera désormais plus capable
d'aucune autre impression.
L'ardeur de régner va faire toute son occupation, il ne s'appliquera
plus qu'à chercher les moyens d'y parvenir : l'éclat du trône l'a
ébloui ; il n'en voit que le brillant ; il n'en connaît point le
fardeau et les amertumes ; rien ne lui paraît si beau que de
s'élever ; tout lui semble légitime, lorsqu'il s'agit de commander,
et il s'imagine que le sceptre et le diadème sont la vraie félicité
de l'homme ; pénétré de ces idées ambitieuses, il reprend sa
vivacité, et se promet tout de sa témérité ; il se vante même déjà
de fixer la fortune, et croit que la seule constance et une louable
audace suffisent, qu'il est honteux à l'homme de se laisser
accabler, et qu'il est de sa grandeur d'être plus ferme dans
l'adversité, que dans l'état heureux : que cette même
fortune si changeante et si légère ne nous doit pas étonner par ses
revers, qu'il est un temps où elle ne peut pas nous refuser ses
faveurs; mais qu'il est vrai que c'est à l'homme à bien ménager ces
heureux instants; et lorsqu'il a saisi le moment favorable, c'est à
lui-même après à se faire un bonheur à l'épreuve de l'inconstance.
Ces grands sentiments le devaient conduire loin ; mais le temps n'en
était pas encore venu ; le chemin qui le devait mener au souverain
pouvoir n'était pas encore ouvert. La seule route par où il pouvait
aller, lui va encore coûter des peines et des traverses ; et l'amour
las de le persécuter, va l'accabler de ses faveurs.
Timocrate commandait pour lors en Agrigente et ayant répudié Erithie
(c'est le nom d'une Athénienne qu'il avait épousée à cause de sa
grande beauté,) elle se retira de désespoir chez les Magarins pour
tâcher de les soulever contre lui, et pour se venger de sa perfidie
; car rien n'est plus sensible à une femme qui se croit accomplie,
que le mépris; de princesse qu'elle était avant ce changement, elle
se trouve seule abandonnée, sans rang et sans appui, parmi des
Barbares. Elle apprit qu'il y avait un étranger parmi eux, dont la
conduite et le genre de vie lui firent croire qu'il avait peut-être
aussi choisi cette retraite pour y ensevelir ses disgrâces ; une
curiosité naturelle, et l'espérance de trouver de la consolation lui
firent chercher à connaître Phalaris ; un bois fort épais lui en
fournit bientôt l'occasion ; il s'y enfonçait souvent pour
s'entretenir de ses projets de grandeur, et ce fut dans un des
sentiers le plus reculé qu'il aperçut cette belle désolée : un air
négligé et convenable à sa situation, faisait toute sa parure, elle
n'en était que plus belle. Mais quoiqu'il fût surpris de cette
aventure, son ambition le possédait tellement, que sans s'émouvoir,
loin de l'éviter, il alla à sa rencontre ; il n'appréhenda plus que
ce ne fût encore quelque enchanteresse qui vint traverser les
desseins : il ne sentit pas la moindre émotion à sa vue, la
politesse seule et la galanterie la lui firent aborder : elle
répondit à ses civilités et prenant la première la parole, elle lui
dit ; que sans doute il avait lieu d'être surpris de voir dans un
lieu habité seulement par les animaux les plus sauvages, une femme
seule et désolée ; qu'elle n'était pas moins étonnée d'y rencontrer
un homme dont le port et la mine marquaient la haute naissance : que
néanmoins elle s'estimait moins malheureuse, puisqu'elle pourrait
peut-être trouver en lui un protecteur contre ses ennemis.
Ensuite elle lui conta toute son aventure. Phalaris l'écoutait avec
attention ; et faisant réflexion sur sa destinée, il n'en pouvait
trop admirer la bizarrerie.
Il promit à la belle Erithie de lui donner secours en tout ce qui
dépendrait de lui. Ils se séparèrent, de crainte d'être surpris dans
ce lieu écarté, avec promesse de se consoler mutuellement.
Lorsqu'il fut de retour chez lui, il conta ce qui venait de lui
arriver à Epicarme, et lui dit, qu'il était bien content de
lui-même, que tous les charmes de cette inconnue ne l'avaient point
touché, qu'il sentait bien que son coeur méprisait ces faibles
impressions; mais que cette belle fugitive pourrait servir à son
ambition, et qu'il méditait un dessein dont le succès le comblerait
de gloire.
Epicarme le conjura de fuir cette pernicieuse et dangereuse occasion
; qu'il ne connaissait que trop par sa propre expérience combien
l'amour lui avait été funeste, qu'il n'était point encore assez sûr
de lui-même, pour risquer un si grand danger et qu'enfin la fuite
était le seul parti qu'il eût à suivre.
Phalaris, après avoir réfléchi sur ce nouvel incident, ne douta plus
que ce qui avait pensé causer sa perte, n'allât contribuer à son
élévation ; tout flattait son ambition, et cette princesse
abandonnée lui ouvrait un chemin qui le pouvait conduire au trône ;
il souhaitait avec empressement de la revoir ; et dès qu'il crut le
pouvoir faire avec bienséance, il envoya Epicarme qui s'était rendu
à ses raisons, pour savoir s'il pouvait avoir l'honneur de
l'entretenir : elle fut charmée de l'attention de ce cavalier, et
assura Epicarme qu'elle l'attendait, et qu'elle était très sensible
à ses civilités. Elle voulut l'interroger sur le nom, sur le rang de
son maître, et sur le sujet qui lui avait fait choisir cette
retraite ; mais le discret Epicarme répondit modestement, que
c'était à son maître à satisfaire sa curiosité, que pour lui il
n'avait d'autres soins que de. bien remplir son devoir, ensuite il
se retira.
La belle Erithie se promit beaucoup de l'empressement de Phalaris;
elle accusait moins les dieux d'injustice, puisque ayant souffert
impunément la perfidie de Timocrate, ils lui faisaient rencontrer
dans cet inconnu un protecteur et un appui. Comme ces différentes
pensées l'agitaient, Phalaris entra : après les premières civilités,
elle lui reprocha poliment sa discrétion en lui faisant connaître
qu'elle n'avait eu aucune réserve pour lui, qu'elle lui avait confié
les secrets les plus cachés de son coeur, qu'elle se croyait en
droit après tant de sincérité, d'exiger de lui une pareille
confidence.
Phalaris lui répondit, que les actions de sa vie avaient eu si peu
d'éclat, et qu'il avait été exposé à de si étranges revers, qu'il la
conjurait de lui épargner un récit qui lui rappellerait des
disgrâces qu'il cherchait à oublier : qu'au reste, ce qu'il savait
de sa destinée, c'est que la fortune peut-être se lasserait de le
persécuter, qu'il était d'un rang et d'un nom à tout espérer, qu'il
avait assez d'ambition pour tout entreprendre, et qu'une passion
violente et tyrannique l'avait conduit en ces déserts ; mais qu'il
espérait que cette même passion pourrait l'en arracher.
Erithie ne lui en demanda pas davantage ; c'en était assez pour
exécuter les projets qu'elle avait formés ; elle ne songea plus
qu'aux moyens de les faire réussir ; il fallait se déclarer et
prévenir Phalaris, qu'elle ne connaissait point : sa fierté et la
bienséance la retenaient ; mais la vengeance et l'ambition plus
fortes, surmontèrent tout; l'offense venait d'être faite ;
l'offenseur était puissant ; l'inconstance avait fait son crime, et
par conséquent l'amour voulait être vengé ; et comme les passions
sont beaucoup plus vives dans les femmes que dans les hommes, les
moments que la belle Erithie perdait en plaintes, étaient des
moments qu'elle dérobait à sa jalousie et à la vengeance, il fallait
périr ou détruire sa rivale, et le seul moyen digne d'elle, était de
susciter à son perfide un rival capable du moins de balancer sa
gloire et sa réputation:
Elle avait assez fait connaître à Phalaris que c'était lui qu'elle
choisissait, et ce choix flattait trop son ambition pour qu'il ne
lui fît pas paraître par ses sentiments qu'il en était digne ;
l'entreprise était hardie et difficile; l'ambition avait produit le
projet, mais il fallait des troupes pour l'exécution. C'est une
princesse abandonnée, et un général disgracié qui forment ces vastes
desseins; mais que ne peuvent point l'ardeur de s'élever, et la
fureur de se venger ? et lorsque l'amour veut se mettre de la
partie, ne peut-il pas seul fournir les moyens de tout entreprendre
?
La charmante Erithie avait trouvé dans Phalaris une si grande
sympathie d'humeur et tant d'égalité dans ses sentiments, qu'elle
résolut de se l'assurer, tant pour ne point donner lieu à des bruits
qui auraient pu flétrir sa réputation, et qui par conséquent
auraient autorisé le changement de Timocrate, que pour l'animer à la
mieux défendre, et oublier entièrement son
infidèle. D'ailleurs, tout parlait en sa faveur, sa bonne mine, son
rang et les grands sentiments avaient inspiré à' Erithie une estime
particulière pour lui.
Phalaris trouvait en cette princesse une couronne à acquérir et
assez de charmes pour remplir son coeur : il parut fort
reconnaissant des bontés qu'elle avait pour lui, quoique sa
délicatesse fût un peu offensée de se voir réduit à profiter, et de
la disgrâce d'Erithie, et de l'inconstance de Timocrate. Il sentait
bien qu'il ne devait qu'à la vengeance et au désespoir, le bonheur
qui lui était préparé ; mais la possession d'un sceptre doit
s'acheter à quelque prix que ce soit : d'ailleurs, ce n'était que
par les armes qu'il prétendait y parvenir ; il avait des droits
légitimes pour entreprendre cette guerre : car Erithie lui ayant
fait entendre ses volontés, ils avaient pris jour entre eux pour
l'accomplissement.
Phalaris dont l'âme était grande, et que le penchant naturel
entraînait vers l'amour, ne voulut plus regarder Erithie comme une
princesse dont le rang et les prétentions pouvaient toucher le coeur
le plus ambitieux ; il l'envisage dès lors comme une simple grecque,
mais en même temps comme la plus accomplie de son siècle. En effet
Vénus même que la fable nous donne pour la déesse de la beauté, n'a
jamais été plus belle; une douceur engageante jointe à un esprit vif
et un discernement juste, étaient ses moindres qualités.
L'ambition va faire place à l'amour, Phalaris voudrait mériter par
lui-même un retour sincère ; il met toute sa gloire à venger Erithie
; mais il voudrait qu'elle ne regardât plus Timocrate que comme un
inconstant et que ce fut comme un usurpateur ; il n'eut point de
peine à lui inspirer ces sentiments de délicatesse : l'estime
s'était tellement fortifiée dans son coeur et son perfide l'avait si
cruellement outragée qu'elle travailla à s'attacher sincèrement à
Phalaris ; si elle ne trouvait pas en lui une couronne, sa vertu le
rendait digne de la porter, en lui en ouvrant le chemin ; la
reconnaissance l'assurait plus de sa fidélité que ses charmes.
Elle voulut joindre le devoir à la parfaite estime, afin de ne
jamais rompre de si beaux noeuds.
Lorsque l'amour eut exigé d'eux tous ses droits et que le flambeau
de l'hymen eut allumé leurs chastes feux, il fallut penser à
contenter l'ambition.
Les seuls Gamariens pouvaient leur prêter secours : mais ces peuples
qui ne faisaient pour lors la guerre qu'aux animaux, jouissaient de
la tranquillité d'une paix qu'ils avaient achetée bien cher.
Phalaris néanmoins alla visiter les principaux et leur insinua que
les Agrigentins faisaient bien paraître qu'ils les méprisaient ;
puisque, contre les lois, ils avaient usurpé des terres qui leur
appartenaient ; il leur fit valoir ensuite l'importance de se faire
craindre de ses voisins : il n'oublia pas à leur exagérer l'ambition
de Timocrate, qu'ils avaient tout à craindre de lui et de ses
peuples, et que l'occasion était belle de le prévenir ; que
d'ailleurs la princesse Erithie qu'il venait de répudier, leur
demandait secours, qu'il y allait de leur intérêt de ne la pas
abandonner, et qu'il les assisterait de ses conseils et de son bras.
Il eut beaucoup de peine à les persuader ; la crainte de trop
risquer et la mollesse les empêchait de rien entreprendre ; et il
est même certain qu'ils n'auraient pas pris les armes si dans ce
temps les Himériens ne leur avaient déclaré la guerre ; ils furent
contraints d'armer : mais Phalaris qui s'était offensé du peu
d'envie qu'ils avaient paru avoir de lever des troupes pour secourir
Erithie, s'était retiré et ne paraissait plus parmi eux ; c'était un
trait de sa politique : il savait bien que ces peuples dans leur
situation présente, lui proposeraient le commandement, leur chef
étant accablé de vieillesse et hors d'état de commander : mais comme
il avait son but, il voulait mépriser ce rang ; le commandement lui
fut bientôt présenté, il affecta d'abord de ne vouloir pas
l'accepter, ne connaissant point, disait-il, ni les moeurs, ni la
manière de combattre de ces peuples. Néanmoins après de fortes
instances, il se mit à leur tête. Avant de se mettre en campagne il
exerça les troupes et leur apprit de nouvelles manoeuvres ; sa
douceur et sa bonté lui attirèrent leur amitié ; il retrancha leur
manière de combattre : et comme il était en usage parmi eux de se
poster par pelotons, il les rangea en lignes ; il leur fit connaître
aussi combien il était avantageux d'attaquer les premiers et que
c'était le plus sûr moyen d'intimider les ennemis et d'encourager
les troupes.
En effet, le soldat est presque certain de la victoire, lorsqu'il
peut prévenir son ennemi. Ces nouveautés furent fort bien reçues de
ces barbares , qui accoutumés à une discipline grossière, étaient
souvent battus plutôt faute d'une bonne disposition que par manque
de valeur.
Phalaris ne voulut point faire la revue générale de son armée qu'en
présence d'Erithie, qu'il avait déjà assurée qu'il périrait plutôt
lui et toutes ses troupes, qu'elle ne fût pas vengée ; qu'elle seule
savait ses projets ; que ces peuples ne sauraient à présent empêcher
les irruptions des Himériens en leur pays ; mais que, la défaite de
ces derniers le mettrait en état d'exécuter leurs grands desseins.
Ce discours la combla de joie ; le sort paraissait déjà leur être
favorable ; elle lui dit qu'elle croyait qu'il était à propos de
cacher leur hymen jusqu'à son retour, ce qu'il approuva, en
l'assurant qu'il ne voulait le publier qu'en lui rendant sa couronne
: ils se firent plusieurs autres assurances d'amitié, et Phalaris
alla joindre l'armée : la belle Erithie fut présente à la revue ;
elle se promit beaucoup et de la valeur des troupes et de la
prudence du général ; tout allait combattre pour elle, l'amour et la
gloire escortaient Phalaris.
Laissons-le donc marcher aux ennemis avec cette puissante escorte et
ramenons la charmante Erithie dans sa solitude. Le présent flattait
tous ses désirs, mais l'avenir était douteux; l'incertitude est
cruelle lorsqu'il s'agit ou de monter au plus haut degré de gloire
ou de tomber dans l'abîme le plus affreux : la victoire lui rendait
une couronne que l'inconstance lui avait ravie, et la défaite de
Phalaris la réduisait dans la plus cruelle disgrâce. Abandonnons
cette princesse à ses différents mouvements et ne perdons point de
vue notre général, qui après trois jours de marche se vit en
présence des ennemis. Il rangea d'abord son armée en bataille et
alla reconnaître lui-même le camp et la situation ; et après avoir
invoqué les dieux qu'ils adoraient, il harangua ses soldats en ces
termes : O vous, Gamariens, que le soin de votre propre liberté et
de votre gloire amènent ici, secondez la noble ardeur qui m'anime ;
la victoire s'offre à nous ; les dieux sont de notre parti ; ils
autorisent cette guerre ; la cause en est trop juste pour qu'ils
nous abandonnent ; il est beau d'être la terreur de ses voisins et
de leur imposer des lois, et on ne saurait trop loin pousser la
gloire; si la justice et les lois humaines défendent de s'agrandir
sur les débris de ses ennemis, l'honneur de la patrie et la
véritable valeur ordonnent d'augmenter sa réputation et de s'élever
; l'occasion s'en présente, c'est à nous d'en profiter et de montrer
qui nous sommes.
Ce discours éloquent anima tellement ses troupes que l'on
n'entendait plus dans le camp que le mot de, combattons. Phalaris en
habile général profita de cette chaleur ; il fit donner le signal du
combat ; il ne fut pas plutôt donné, que ses troupes chargèrent les
ennemis avec tant de fureur, qu'ils les enfoncèrent et les
culbutèrent ; ils ne purent soutenir ce premier mouvement et se
retirèrent en désordre derrière un bois qui les favorisait et qui
leur donna le temps de se rallier.
Phalaris fit battre la retraite, ne voulant rien hasarder ; il eut
peine à modérer l'ardeur des soldats qui voulaient percer le bois ;
mais ce coup était trop téméraire.
Notre général fit faire halte à ses troupes pour leur donner le
temps de se reposer, et envoya un détachement pour s'emparer des
équipages que les Himériens avaient abandonnés, et il alla lui-même
observer le bois et la manoeuvre des ennemis ; il reconnut qu'ils
faisaient un grand abatis d'arbres pour se retrancher : s'il n'avait
écouté que sa valeur, il aurait été les forcer ; mais c'était
sacrifier ses soldats ; il résolut avec prudence de faire une fausse
marche pour les attirer ; il laissa reposer le reste du jour son
armée ; et afin que ce faux mouvement ne ralentît point l'ardeur de
ses troupes, il leur dit :
Enfants, la victoire est à nous ; elle aurait pu être plus grande,
si nous avions voulu forcer. les
ennemis dans leurs retranchements ; mais mon dessein est de devoir
le gain de cette grande bataille à votre intrépidité et non à
l'effusion de votre sang ; il est trop beau pour le répandre ; votre
valeur m'est à présent connue : j'ai donc résolu pour nous assurer
d'une entière victoire, de me servir d'une ruse de guerre; nous
allons feindre de nous en retourner, et il faut même que notre
retraite paraisse un peu précipitée pour mieux attirer les ennemis
et lorsqu'ils seront sortis de leurs retranchements et qu'ils en
seront assez éloignés pour que nous les puissions joindre avant
qu’ils soient à la portée de s'y rejeter ; nous ferons volte face et
nous les chargerons comme nous avons fait.
Ce projet eut un applaudissement général et il fut en même temps
exécuté. Les ennemis d'abord crurent que c'était une feinte ; mais
ayant su par leurs espions que l'armée ennemie s'éloignait et
qu'elle marchait même avec précipitation, ils résolurent de la
suivre et de tâcher de réparer la perte qu'ils venaient de faire,
ils pressèrent leur marche pour joindre Phalaris et pour pouvoir
charger son arrière-garde : mais d'abord que ce rusé général connut
qu'il était temps de découvrir son artifice, il fit faire tout d'un
coup volte face à son armée ; et sans lui donner le temps de la
réflexion, il la mena à la charge. Les ennemis furent surpris de ce
mouvement qu'il voulurent se retirer ; mais ils étaient trop avancés
pour reculer, ainsi leur seul parti fut de se défendre : le combat
d'abord fort opiniâtre ; les Himériens se battirent en désespérés ;
mais leur première défaite n'avait pas laissé de jeter la terreur
parmi eux; et les Gamariens en firent un tel carnage, que ne pouvant
plus soutenir leurs efforts et leur ardeur ils se débandèrent et
s'enfuirent avec tant de désordre que leur défaite fut entière.
Phalaris reçut deux blessures en cette action, s'étant exposé
partout, dont l'une ne laissait pas d'être dangereuse par la grande
quantité de sang qu'il perdit, n'ayant pas voulu se retirer qu'il ne
fût certain du gain de la bataille.
Après la déroute des ennemis il ne voulut point les poursuivre, plus
à cause de la fatigue de ses troupes, qu'à cause de sa blessure :
car pour ne point intimider ses soldats il se fit panser à la tête
du camp et leur donna des louanges sur l'action qui venait de se
faire, avec autant de fermeté que s'il avait été en pleine santé ;
il donna ses ordres à l'ordinaire pour que le butin fût partagé
également ; et surtout il pria les officiers de faire observer le
même ordre dans le camp, leur disant, que la victoire devait
augmenter l'attention des soldats pour remplir leurs devoirs, et que
c'était par une plus grande exactitude qu'ils devaient se montrer
dignes de ses faveurs, que la grande discipline rendait une armée
plus formidable, que la quantité de troupes; il commanda aussi que
l'on fit des sacrifices aux dieux pour les remercier de cet heureux
succès : ensuite il écrivit à Erithie le détail de cette grande
action ; il lui dépêcha un exprès pour la tirer d'inquiétude. Voici
les termes de sa lettre.
Les dieux, mon Erithie, ont secondé la justice de nos armes ; ils
viennent de nous faire remporter une victoire complète. Les
Gamariens ont fait paraître en cette action tant d'intrépidité et de
valeur, qu'avec de pareilles troupes un général peut s'assurer de la
conquête de l'univers ; et ce qui doit les immortaliser, c'est que
leurs ennemis se sont défendus avec tant vigueur, qu'ils ne doivent
qu'à leur fermeté le gain de cette bataille. Pour moi, je ne saurai
vous exprimer la joie que j'aurai de pouvoir vous faire connaître
que Phalaris sait du moins disputer une couronne, s'il n'est pas
digne de la porter.
Adieu ; les ordres que j'ai à donner m'empêchent de vous en écrire
davantage ; n'oublie pas que la gloire et l'amour me guident, et que
pour contenter ces deux passions, il ne faut pas moins que la
victoire ; il ordonna de cacher à Erithie ses blessures, de crainte
de l'alarmer
Mais elle s'intéressait trop à sa destinée pour n'avoir pas commis
des personnes pour l'informer de tout ce qui se passerait ; la
blessure de Phalaris avait fait trop de bruit pour qu'elle fût
ignorée de celle qui y prenait le plus de part ; elle en fut si
alarmée, qu'elle partit dès l'instant pour le joindre.
Phalaris ne fut pas peu surpris de la voir; un si tendre
empressement marquait assez la bonté de son coeur ; mais comme ses
blessures étaient en fort mauvais état, il craignait que cela ne lui
coûtât trop d'inquiétudes.
Le premier soin d'Erithie fut de s'informer des chirurgiens, si ses
blessures n'étaient point dangereuses ; ils lui cachèrent la vérité,
et la prièrent seulement d'obtenir de lui qu'il permît qu'on le
transportât dans la plus prochaine ville, parce que ce n'était que
par là qu'il pouvait se rétablir.
Erithie eut bien de la peine à faire consentir Phalaris à quitter le
camp ; il connaissait bien qu'il y était nécessaire, parce que son
dessein était de marcher jusqu'aux portes d'Himère où les ennemis
s'étaient retirés : mais les Himériens voulant prévenir l'orage qui
les allait accabler, envoyèrent dans ce temps des députés à Phalaris
pour demander la paix.
Il les reçut en vainqueur et leur dit qu'ils sauraient sa résolution
aux portes de leur ville.
Une réponse si fière les étonna ; ils avaient ordre de tout accorder
pour l'obtenir. Ainsi, ils lui firent des propositions très
avantageuses. La paix était contraire à ses projets, et donnait des
bornes à son ambition ; néanmoins il n'était pas le maître absolu
pour refuser des conditions si favorables et si honorables pour les
Gamariens ; il fallait assembler un conseil général pour en décider,
ce qu'il fit.
Il se plaignit fort de sa destinée à Erithie. Quoi ! disait-il, la
victoire, qui ordinairement ouvre le chemin qui mène au trône, m'en
ferme l'entrée; je n'entreprends de faire la guerre que pour amener
la paix : la défaite entière de mes ennemis, qui devait me promettre
un fort digne d'envie, ne servira qu'à détruire mes desseins. Ces
tristes réflexions l'agitaient avec tant de violence, qu'il eut
besoin du secours d'Erithie, qui n'ayant d'autre soin que celui de
lui conserver la vie, tâchait à le rassurer, en lui faisant
connaître que sa valeur lui avait acquis une trop haute réputation
chez les Gamariens, pour qu'ils voulussent l'abandonner dans une
entreprise où leur honneur et leur intérêt particulier se trouvaient
engagés. D'ailleurs, que cette victoire était un puissant aiguillon
pour les animer à la gloire ; que cette première conquête les
assurait de bien d'autres, qu'ainsi sa seule attention devait être
de se rétablir, et que ses jours lui étaient plus précieux que
l'empire du monde.
Ces sentiments si généreux, et des raisons si puissantes, calmèrent
un peu l'esprit de Phalaris : il fit assembler le conseil pour ne se
point rendre suspect à ces peuples et afin de cacher toute son
ambition ; son opinion fut qu'il fallait accorder une trêve aux
Himériens pour avoir le temps de régler une paix durable : son avis
fut généralement approuvé et la trêve fut signée de part et d'autre
pour trois mois.
Phalaris donna ses ordres pour faire séparer son armée, et fit
transporter, accompagné de sa chère Erithie, dans sa première
solitude ; il ne voulut accepter les honneurs du triomphe et empêcha
qu'on lui fît élever une statue en mémoire de la fameuse bataille
qu'il venait de remporter; il refusa même un superbe édifice que ces
peuples lui avaient préparé.
Tant de grandeur et de noblesse le firent regarder du peuple comme
un dieu : ils voulurent l'adorer, disant qu'il en était plus digne
que leurs dieux, puisqu'ils lui devaient leur liberté. Tant
d'honneurs et d'élévation lui rendirent la tranquillité que cette
paix lui avait ôtée ; il ne songea plus qu'à se mettre en état
d'exécuter ses grandes idées ; l'attention extrême, et les
complaisances de la belle Erithie, jointes à un bon tempérament et à
l'expérience de ses chirurgiens, le mirent bientôt hors de danger.
Le peuple impatient de le voir, offrait chaque jour des sacrifices
aux dieux pour le recouvrement de sa santé ; et enfin, pour répondre
à leurs empressements, il se montra à la populace et aux soldats sur
une galerie de sa maison. La joie fut universelle, chacun à l'envi
s'empressait de le voir et de chanter ses louanges ; il fit des
présents aux peuples, et il y eut pendant trois jours des
réjouissances publiques. Le temps de la trêve expirait ; ainsi il
fallait penser ou, à la rompre, ou à conduire la paix.
Il consulta avant que de paraître au conseil, la prudente Erithie ;
et après avoir examiné toutes choses, il fut résolu qu'il opinerait
pour la paix parce qu'il devait à présent être assez sûr de ces
peuples pour les conduire où il le jugerait à. propos ; et
d'ailleurs, cette guerre aurait pu traîner en longueur, et par
conséquent elle aurait été un obstacle à leurs projets. Il se rendit
sur cette confiance au conseil ; il fut contraint d'y aller sur la
fin du jour, pour éviter l'embarras d'une populace qui l'aurait
accablé de louanges et d'acclamations.
Il y fut reçu, non comme un général , mais comme un souverain : il
conjura tous les officiers et les premiers de la république de le
regarder comme leur camarade et leur ami ; assura que leur gloire et
le bien public commun lui étaient chers, et qu'il voulait leur en
donner une preuve sensible, en les exhortant à faire la paix avec
les Himériens ; que la trêve étant expirée, il était temps de se
déclarer ; et que puisque leurs ennemis se soumettaient à recevoir
la loi du vainqueur, il croyait qu'il était et de leur intérêt et de
leur gloire d'accepter les conditions qui leur étaient proposées ;
qu'après cela ils trouveraient d'autres occasions de contenter leur
ardeur guerrière, que pour lors la victoire les pourrait conduire
plus loin ; qu'à l'égard de la présente guerre, quand bien même ils
seraient maîtres de la ville d'Himère, ces peuples implorant leur
clémence, l'honneur les aurait obligé de les recevoir à composition;
parce que, disait-il, une nation qui veut se rendre recommandable à
la postérité doit chercher à acquérir de la gloire par des actions
héroïques et approuvées des dieux. Les conquêtes ne doivent pas se
mesurer à l'ambition, il suffit de chasser ses ennemis et de les
repousser jusque dans leur pays lorsqu'ils ont eu la témérité de
vouloir pénétrer dans le vôtre ; leur fuite et leur défaite est un
assez grand triomphe pour les vainqueurs, c'est une tyrannie et une
fausse ambition que de vouloir les subjuguer ; vous les avez déjà
vaincus par la force des armes, il faut achever leur entière défaite
par la clémence et par la générosité.
Ce discours fut un oracle pour cette assemblée ; on dressa les
articles de paix, et tous prièrent Phalaris de les examiner et de
les régler comme il le souhaiterait ; il en retrancha quelques-uns,
et augmenta les autres ; mais il réduisit lés Himériens par cette
paix à la nécessité de la conserver fidèlement. Les plus
expérimentés ne pouvaient trop admirer le désintéressement et la
simplicité de ce général, qui loin d'éterniser une guerre pour se
rendre nécessaire, et pour entasser lauriers sur lauriers, cherchait
à la finir, lorsque à peine elle était commencée ; cette paix était
pour eux un si grand gage de sa vertu, qu'elle le rendait aussi
fameux que sa dernière victoire.
Phalaris, rendit un compte exact de tout ce qui s'était passé au
conseil à sa chère Erithie qui en était d'autant plus charmée, que
l'amitié lui avait fait en partie oublier sa vengeance, toute son
ambition se bornait à plaire à son héros ; ses vertus avaient
entièrement effacé de son coeur Tilmocrate ; il était même des
moments qu'elle lui voulait du bien d'avoir été perfide. La
possession de Phalaris lui semblait plus douce que celle d'une
couronne. La passion qu'elle avait pour lui, remplissait tellement
son coeur, qu'il était fermée pour tout autre. Enfin, ils
jouissaient du plus parfait bonheur, du moins Erithie : à l'égard de
Phalaris, son âme était partagée entre l'amour et la gloire ; l'une
de ces passions était satisfaite, mais il manquait à l'autre une
couronne : ce qui fait bien voir que l'homme ne peut jamais parvenir
à ce point de félicité, qui ne laisse plus rien à souhaiter. Il
faudrait pour cela qu'il n'eût qu'une passion à combattre ou à
contenter ; mais comme il est susceptible et capable de toutes
sortes d'impressions, rien ne le peut fixer, ni l'arrêter. Triste
condition que la sienne, puisqu'il est la victime de ce qui devrait
faire son souverain bien !
Les députés des Himériens étaient déjà arrivés ; ils demandèrent
audience à Phalaris, elle leur fut accordée, ils lui présentèrent
des présents, qu'il accepta ; il les reçut très favorablement et les
renvoya après aux principaux officiers, et le jour marqué la paix
fut signée de part et d'autre avec beaucoup de joie. Tout était
tranquille, hors le seul Phalaris, qui sans cesse était dévoré par
l'ardeur de régner : il se voyait contraint de ralentir son ambition
; il n'était pas encore temps d'éclater : mais comme la fortune se
joue et méprise les projets des hommes, elle fraya le chemin qui
devait le conduire en Agrigente par la mort de Timocrate qui fut
causée par une chute qu'il fit.
Le bruit de cette mort se répandit bientôt par tous ; Phalaris en
fut instruit des premiers ; l'occasion s'offrait et il fallait en
profiter : les Agrigentins ayant déjà élu leur capitaine général
pour remplir la place de Timocrate.
Erithie rendait mille grâce aux dieux de ce qu'ils paraissaient lui
être si favorables : elle ne prévoyait pas tous ses malheurs, tout
pour le présent parlait pour elle ; elle allait bientôt recueillir
les fruits d'une heureuse hyménée; elle touchait au moment de se
voir rétablie sur le trône. Ne la détournons point de ses pensées
flatteuses, tandis que Phalaris fait assembler les Gamariens et leur
tient ce discours :
La guerre que les Himériens vous avaient suscitée, m'a été très
avantageuse, puisqu'elle m'a donné l'occasion de vous marquer
combien je m'intéressais à votre gloire ; je n'ai pas lieu de me
plaindre de votre reconnaissance, puisque vous vouliez la pousser si
loin, qu'elle aurait offensé les dieux. Je ne suis qu'un faible
mortel qui ne cherche à s'élever que pour me rendre digne des
faveurs de ces mêmes dieux, en tâchant de les imiter. La fortune,
par la mort de Timocrate, me présente les moyens de rendre une
couronne à une princesse qui mérite plus de la porter encore par sa
vertu, que par sa naissance, elle a eu la bonté de vouloir bien la
partager avec moi ; me refuseriez-vous l'honneur de la devoir à
votre valeur ? Je ne prétends point vous engager dans une guerre
préjudiciable et contraire au bien public : votre intrépidité
m'assure de la victoire, et il suffira que vous paraissiez pour
contraindre les Agrigentins à reconnaître leur véritable souverain.
Je ne vous demande que l'honneur de recevoir le sceptre de vos
mains, mon autorité, la justice et les dieux feront le reste.
Tous les officiers et les autres répondirent qu'ils étaient tous
prêts de le suivre partout, et qu'ils ne regretteraient que la perte
d'un héros qui les avait comblé de gloire.
Les officiers prirent le soin de faire assembler les troupes ; tous
les soldats étaient ravis qu'on les arrachât à la mollesse ; la
dernière victoire les avait rendus belliqueux. D'ailleurs, Phalaris
et les officiers et les premiers du peuple étaient charmés de
trouver une si belle occasion de reconnaître les signalés services
qu'il leur avait rendus. C'était un sûr appui qu'ils se faisaient,
en mettant Phalaris sur le trône d'Agrigente ; ainsi l'armée fut
bientôt en état de marcher.
Phalaris certain du succès, se formait une idée bien glorieuse,
lorsqu'il pensait qu'il allait être en état de rendre à Erithie tout
ce qu'il lui devait : mais cette princesse plus agitée par la
crainte du succès, qu'animée par l'ambition qui lui faisait tout
espérer, aurait souhaité que l'amour seul eût donné les couronnes et
non l'impitoyable avidité de régner, la folle présomption et
l'insatiable vanité de l'homme.
Phalaris risquait beaucoup ; il était étranger, connu; il est vrai,
par ses grandes actions de toute la Grèce : mais les Agrigentins
étaient des peuples séditieux, changeants et toujours prêts à la
révolte. C'était une princesse répudiée qu'il voulait rétablir, qui
était le prétexte de cette entreprise ; ils pouvaient regarder
Phalaris comme un tyran et un usurpateur. Enfin, il y avait tout à
appréhender d'un peuple qui se voit forcé à recevoir des lois d'un
prince qu'il n'a pas élu.
Toutes ces réflexions l'embarrassaient cruellement ; le seul
Phalaris occupé de sa nouvelle grandeur, était insensible à toutes
autres pensées. Il consola le mieux qu'il put Erithie l'assurant
qu'il ne tarderait pas à la venir chercher lui-même accompagné des
principaux Agrigentins; que l'état où elle était ne lui permettait
pas de l'accompagner ; que d'ailleurs il voulait apaiser tous les
troubles avant que de l'exposer. Erithie ne le vit partir qu'avec
des regrets les plus touchants ; un mauvais augure et un triste
présage de l'avenir la tourmentaient sans cesse mais toutes ces
inquiétudes n'empêchèrent point Phalaris de joindre l'armée.
Les Agrigentins qui ne savaient point son dessein, furent fort
surpris lorsqu'on les vint avertir qu'il paraissait une armée
formidable qui semblait menacer Agrigente; ils envoyèrent la
reconnaître, et s'informèrent du sujet qui l'a mettait en campagne ;
ils ne furent pas peu étonnés d'apprendre le projet de Phalaris. Ils
résolurent de lui opposer du moins toutes les troupes en état de
défense ; ils regardaient cette surprise comme une usurpation ; leur
nouveau prince prit le parti de périr ou de vaincre son ennemi ;
ainsi peu après il se mit à la tête d'un corps de troupes inférieur,
à la vérité, à ses ennemis ; mais du moins assez fort pour rester
sur la défensive.
Phalaris était trop animé pour ne pas chercher à décider; il ne
balança point de marcher aux Agrigentins ; et avant que de le faire,
il leur envoya un manifeste contenant toutes ses prétentions ; ils
ne voulurent pas seulement le lire. Ce procédé ne fit qu'irriter
l'ardeur qu'il avait de s'assurer de cette couronne par la victoire,
il alla droit à eux : l'affaire fut sanglante ; mais la supériorité
des troupes de Phalaris et leur intrépidité décidèrent du gain de la
bataille. Les Agrigentins furent repoussés jusque dans leur ville,
et les Gamariens les suivirent de si près qu'ils y entrèrent avec
eux en si grand nombre qu'ils s'emparèrent des principaux postes.
Phalaris fit occuper le palais par ses troues et fit entourer la
ville par le reste de son armée. Après s'être fait voir aux peuples
et leur avoir donné des marques de sa libéralité, ses troupes le
proclamèrent roi. Les Agrigentins furent obligés de le reconnaître,
leur nouveau prince ayant été fait prisonnier. Phalaris fit observer
aux Gamariens le même ordre qu'ils observaient chez eux. Les peuples
d'Agrigente ne s'aperçurent point que les vainqueurs étaient maîtres
de leurs biens et de leurs vies; on ne les distinguait point d'avec
les vaincus ; il ne se commit pas le moindre désordre ; les
officiers des Gamariens y tenaient la main, en sorte que cette
grande discipline et cette clémence lui rendirent le peuple
favorable.
Le sénat seul et les officiers paraissaient mécontents de ce
changement ; néanmoins la force des armes les avait contraints à
reconnaître Phalaris pour leur souverain mais ils le craignaient
beaucoup plus qu'ils ne l'aimaient. Cependant il mit tout en usage
pour se rendre maître des coeurs. Il harangua le peuple et le sénat
; il leur fit connaître que son dessein était de maintenir leur
liberté, de les rendre redoutables à tous les autres peuples et de
faire envier leur sort à toute la Sicile ; qu'il prétendait plutôt
être leur père que leur souverain ; que la justice et le bon droit
venaient de donner une couronne qu'il soutiendrait mieux par la
vertu et par la douceur que par les armes. Si ce discours éloquent
ne fit pas une forte impression dans le coeur des Agrigentins, du
moins il leur donna une grande idée de Phalaris.
La première marque qu'il voulut leur donner de la confiance qu'il
avait en eux, fut de renvoyer les Gamariens après les avoir comblés
de présents et de louanges; les principaux officiers lui
remontrèrent qu'il hasardait trop dans un si prompt avènement à la
couronne, de se défaire d'eux, et que ces peuples subjugués, outrés
de leur défaite, pourraient bien avoir la témérité d'attenter à sa
vie. Phalaris leur répondit qu'il leur tiendrait compte d'un zèle
aussi généreux ; mais que sa vie était entre les mains des dieux,
que les hommes n'en pouvaient disposer que par leur ordre; qu'ainsi,
si c'était l'arrêt des destinées qu'il pérît, toutes les nations
assemblées pour le défendre, ne pourraient le dérober à la mort :
que du moins ce qui pourrait le consoler en périssant, c'est que sa
fin serait honorable puisque la recherche de la vertu et de la
gloire avaient fait tous les soins de sa vie ; qu'après cela il
mourrait dans le lit d'honneur et le sceptre à la main.
Après les avoir remerciés, et du trône qu'il devait à leur courage,
et de leur nobles empressements à l'y vouloir maintenir, il les
conjura de s'en retourner; et avant que de partir ils l'assurèrent
qu'il n'aurait pas de voisins plus propres à le secourir et qu'ils
mettraient toute leur gloire à le soutenir sur un trône qui était la
juste récompense de sa vertu.
Les Gamariens se retirèrent et s'en retournèrent chez eux fort
glorieux de ce succès ; et par ordre de Phalaris, et selon les lois,
ils firent mourir le capitaine général des Himériens qui avait été
fait prisonnier.
Phalaris écrivit à Erithie tous ces événements et se donna tout
entier à la connaissance de toutes les affaires: publiques, il
chercha aussi à se faire des créatures, et par ses présents il tâcha
de ranger de son parti les chefs de la noblesse et les premiers du
peuple: il paraissait souvent en public; il décidait lui-même des
différends particuliers ; la seule équité dictait ses ordonnances;
il s'appliqua à faire fleurir les arts et les sciences, en
récompensant ceux qui excellaient dans les uns ou dans les autres ;
il établit des lois pour réprimer le vice et le libertinage ; afin
de pouvoir mieux élever la vertu ; enfin il semblait que le siècle
d'or allait renaître.
Néanmoins il découvrit une conspiration qu'une troupe de scélérats
et gens sans aveu qui craignaient sa justice, avaient formée contre
lui. Il en fit faire un exemple public, en les faisant expirer dans
les tourments proportionnés à leur attentat.
Ces genres de supplices firent horreur au peuple qui ne juge que des
apparences et qui déteste les rigueurs de la justice parce qu'il est
naturellement porté à la vie licencieuse et criminelle ; la clémence
les rend insolents et la sévérité les révolte et les rend séditieux.
Car il est certain que Phalaris régnait en véritable souverain ; on
ne lui peut reprocher que trop de sévérité ; il avait en horreur le
vice et le faisait punir rigoureusement, ce qui l'a fait passer dans
l'antiquité pour un si cruel tyran, que Pline et les autres ne
parlent que de sa tyrannie et ne disent rien de ses vertus.
Le grand nombre de conspirateurs, que son autorité et sa justice lui
suscitèrent, le contraignirent d'avoir recours aux plus terribles
supplices : il pardonna à beaucoup, afin de faire rentrer dans le
devoir les autres : sa clémence ne fit qu'irriter ces malheureux.
Ainsi, pour se conserver la vie, il fut réduit à la faire perdre à
bien d'autres.
Au reste, jamais prince ne s'est acquis tant de gloire : c'était un
héros pendant la guerre et un philosophe pendant la paix ;
l'élévation de son génie lui avait fait reconnaître un être
supérieur, et l'on peut dire qu'il a poussé l'amour de la vertu et
des sciences, et de la délicatesse de la politique au plus haut
degré.
L'infortunée Erithie ne put pas jouir du bonheur qui semblait
l'attendre. Comme elle se disposait à venir à Agrigente avec son
fils Paurolas, Pithon en devint si éperdument amoureux, que sa vertu
étant un obstacle invincible à ses infâmes désirs, il se vengea de
ses chastes rigueurs par le poison.
La mort d'Erithie pensa causer celle de Phalaris ; sa seule fermeté
lui fit soutenir ce rude assaut; il chercha, mais en vain, à se
venger de cet attentat. Il avouait qu'il était né le plus malheureux
des hommes, et que son seul courage l'avait empêché de succomber et
d'être accablé sous le poids de ses infortunes. Sa confiance l'avait
conduit au trône, qui devait mettre le comble à sa gloire ; et c'est
ce haut degré d'honneur qui l'a flétri et qui l'obscurcit. Tous les
autres peuples ont admiré et sa bonté, et la douceur de son
gouvernement; les seuls Agrigentins le font passer pour un cruel
tyran. Les épîtres qu'il a laissées, peuvent seules le justifier.
Une âme abandonnée à toutes les passions les plus outrées, n'est pas
capable de sentiments si vertueux et si élevés. Ainsi j'ai cru que
les hommes de ce siècle et des autres à venir, moins prévenus, lui
rendraient la justice que toute l'Antiquité lui a refusée, en
examinant ses écrits et en admirant leur beauté et leur justesse.
Les Siciliens ne peuvent lui pardonner le taureau d'airain inventé
par Pérille sculpteur d'Athènes; et qui en fit le premier la funeste
épreuve.
Ce genre de supplice était terrible, puisque l'on enfermait le
criminel vif dans ce taureau, et que l'on allumait du feu autour, ce
qui produisait des mugissements affreux par les cris des patients.
Il était destiné pour punir les parricides, les assassinats et les
plus énormes crimes.
Pourquoi tant se déchaîner contre ce taureau? est-il de trop grands
supplices pour punir de si grands crimes ? Et les autres princes ne
se sont-ils point servis des tortures et des tourments les plus
rigoureux, en sont-ils moins grands dans l'Histoire?
Comme la France a toujours eu des partisans du vrai mérite, et que
la vertu y a toujours paru dans tout son éclat, j'espère qu'elle
rendra plus de justice à Phalaris que la Grèce et la Sicile; et que
ne faisant attention qu'a ses grandes actions, elle le regardera
comme un des plus grands princes de son siècle.
Comme tous les historiens sont fort incertains sur son genre de
mort, et que je ne veux rien avancer de moi-même, j'en laisse au
lecteur le choix ; persuadé que quand il aura lu sa vie, et qu'il
sera pénétré des sentiments d'honneur et de vertu dont toutes ses
lettres sont remplies, il ne refusera pas une fin honorable et
glorieuse à un prince dont la vie n'a été qu'un tissu de grandes
actions.
FIN |
![]()