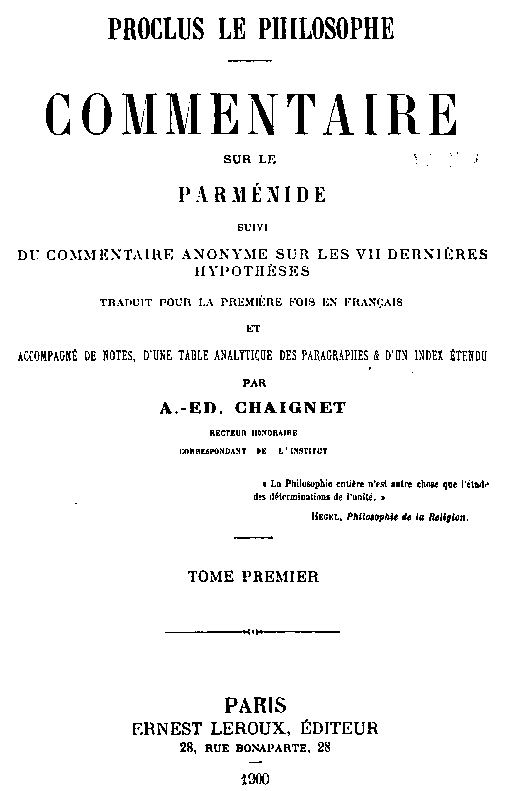|
MARINUS DE NEAPOLIS.
VIE DE PROCLUS
VIE DE PROCLUS PAR MARINUS DE NEAPOLIS.
PROCLUS OU DU BONHEUR 1. Si j'avais considéré le grand esprit et tout ce qui fait la haute valeur du philosophe Proclus, notre contemporain, les documents que doivent avoir préparés et les qualités oratoires que doivent posséder ceux qui se proposent d'écrire la vie d'un tel homme, et si j'avais ensuite regardé ma propre insuffisance dans la pratique de l'éloquence, j'aurais, je crois, eu raison de me tenir tranquille, de ne pas, comme dit le proverbe, sauter le fossé et de ne pas me lancer dans cette œuvre périlleuse. Mais ce n'est pas sur ces exigences que je me suis mesuré : et j'ai réfléchi que, même dans les sacrifices, ceux qui se présentent aux autels ne font pas tous des offrandes d'un prix égal, mais que les uns par le sacrifice de taureaux, ou de chèvres ou d'autres victimes semblables s'efforcent de se montrer digne de participer aux dieux dont ils abordent les autels, et même leur composent avec art des hymnes tantôt en vers, tantôt en prose, tandis que les autres n'ayant rien de semblable à offrir, ne présentent en sacrifice qu'un gâteau, ou quelques grains d'encens et, n'adressant aux dieux qu'une courte invocation, n'en sont pas moins favorablement entendus : mû par ces réflexions et de plus craignant, selon le mot d'Ibycus, non pas de manquer aux Dieux car ce sont ses propres termes, — mais de manquer à ce grand sage, pour m'assurer, par mon attitude, les éloges du monde (j'ai craint en effet que ce ne soit pas un acte de piété de me taire, moi seul, parmi ses amis, et d'omettre de raconter sur lui la vérité, dans la mesure de mes forces, quand c'est a moi sans doute surtout qu'incombe le devoir de parler) ; et peut-être même auprès des hommes, je n'obtiendrais pas cet honneur (car ils ne croiraient probablement: pas que c'est pour éviter l'ostentation, mais par une certaine paresse d'esprit, ou même par quelque défaut d'âme plus grave encore que je me suis dérobé à celte entreprise); — par toutes ces raisons, j'ai estimé que c'était pour moi une obligation île rapporter par écrit quelques-unes des hautes et si nombreuses qualités dont le philosophe a fait preuve dans sa vie, et de les rapporter dans toute leur vérité. 2. Je ne commencerai pas comme le l'ont la plupart des écrivains, qui divisent méthodiquement leur matière en chapitres se succédant en ordre régulier: je prendrai pour le fondement le plus convenable de ce discours, le bonheur dont a joui cet homme véritablement bienheureux. Car je crois qu'il a été le plus heureux de tous les hommes dont on ait célébré, dans une longue suite de siècles, la félicité, je ne dis pas seulement le plus heureux du bonheur qui est le partage des sages, quoi que celui-là aussi, il l'ait possédé pleinement, ni parce qu'il a eu tous les avantages physiques qui permettent de jouir de la vie, ni non plus sous le rapport de la fortune, où la plupart mettent leur bonheur, quoique sous ce rapport le hasard l'eût très favorisé, et plus qu'aucun autre (car tous les biens qu'on appelle extérieurs lui furent prodigués avec largesse), je veux parler d'un bonheur complet et parfait, auquel rien absolument ne manqua, et qui réunit les doux conditions de la félicité. 3. D'abord si nous divisions par genres les vertus, en vertus physiques, morales et politiques, et au-dessus de celles-ci les vertus purificatives et théorétiques, et celle qu'on appelle du nom de théurgiques, sans parler de celles qui sont d'un ordre encore plus élevé et qui dépassent, la condition de l'humanité, nous commencerons par celles qui ont un caractère plutôt physique, et que nous possédons dès la naissance et qui naissent avec nous. Cet homme que nous appelons heureux, les a eues toutes naturellement dès son origine : ce qui se voyait manifestement dans cette enveloppe extérieure que nous portons comme l'huître sa coquille -: d'abord une extrême délicatesse des sens, qu'on peul appeler la prudence corporelle, surtout des plus nobles de nos sens, la vue et l'ouïe, qui ont été données par les dieux aux hommes pour qu'il puissent se livrer à la philosophie, et goûter les douceurs du bien être : notre philosophe les a conservés intacts pendant toute sa vie; — ensuite une constitution corporelle très robuste, qui résistait aux grandes chaleurs comme aux grands froids, et n'était altérée ni par un mauvais régime de vie. ni par la négligence de l'alimentation, ni par les excès de travail auxquels il se livrait la nuit comme le jour, tantôt plongé dans les prières, tantôt compulsant les livres de science, tantôt écrivant, tantôt s'entretenant familièrement avec ses amis, et tout cela avec une application aussi soutenue, que s'il n'était occupé que d'une seule chose. Une telle puissance pourrait être justement appelée vaillance de corps. La troisième qualité corporelle qu'il possédait, est celle qu'on peut comparer à la tempérance, il laquelle on rapporte avec raison la beauté corporelle : car de même que la première consiste dans l'accord et la convenance entre elles des facultés de l'âme, de même l'autre, la beauté du corps. se laisse voir dans une certaine symétrie de ses parties organiques. Il était d'un aspect extrêmement agréable; car non seulement il avait la beauté des justes proportions, mais il émanait de son âme je ne sais quelle lumière vivante, une sorte de fleur merveilleuse qui rayonnait sur son corps et qu'il est absolument impossible de décrire par la parole. Il était tellement beau qu'aucun peintre n'a pu saisir sa ressemblance, et que, à tous les portraits qui circulent de lui, quoique eux mêmes très beaux, il manque encore beaucoup de traits pour représenter sa personne dans toute la vérité. La quatrième vertu corporelle dont il était doué est la santé, qu'on compare habituellement à la justice dans l'âme ; car elle est dans le corps une sorte de justice, analogue à celle qui est dans l'âme ; la justice n'est pas autre chose, en effet, qu'une sorte d'habitude, ἕξις, qui empêche les bouleversements des parties de l'âme, et ce qui opère l'ordre et le concert mutuel entre les éléments δésordonnés du corps: c'est là ce que les Asclépiades nomment la santé : elle était des son berceau si profondément enracinée en lui. qu'il put dire lui-même combien de fois il était tombé malade, c'est à dire seulement deux ou trois fois dans le cours d'une longue vie d'une durée de soixante quinze ans accomplis ; et une preuve éclatante de ce fait et dont je peux moi-même porter témoignage c'est que dans sa dernière maladie, il ne distinguait pas quelle était la nature de ses souffrances, parce qu'il ne les avait pas de longtemps éprouvées, 4. Et quoique ce soient là des avantages purement corporels, on pourrait dire qu'ils étaient les prodromes des espèces particulières dans lesquelles nous divisons la vertu. Les premiers biens de l'âme qui étaient comme nés avec lui et qu'il n'avait pas eu besoin d'apprendre, et ce sont pourtant là ces parties de la vertu qui, d'après Platon, sont les éléments d'une nature philosophique; on est étonné de voir à quel haut degré il les possédait. Car il était doué d'une grande mémoire, d'une intelligence ouverte à toutes les études; il était libéral, d'un abord plein de grâce, amant et pour ainsi dire frère de la vérité, de la justice, du courage et de la tempérance. Jamais volontairement il ne dit un mensonge : il en avait une extrême horreur, et ne chérissait rien tant que la sincérité et la véracité. Et en effet, il fallait bien que celui qui devait atteindre à l'être vrai, fût, dès sa jeunesse, passionné pour la vérité; « car la vérité est le principe de tous les biens, chez les dieux comme chez les hommes ». Qu'il avait un profond mépris pour les plaisirs des sens, et qu'il était ami surtout de la tempérance, il suffit d'en apporter une seule preuve, c'est son ardeur extrême et son penchant tout puissant pour les sciences et pour tous les genres de sciences, qui ne permettent pas même de commencer a naître aux plaisirs de la vie grossière et animale, et souvent ont, au contraire, la force d'imprimer en nous les joies pures et sans mélange de l'âme. On ne saurait dire combien il était éloigné de l'amour du gain, à ce point que dès son enfance, il négligea le soin de la fortune que lui avaient laissée ses parents, qui étaient fort riches, par suite de son amour passionné pour la philosophie. Aussi était il absolument étranger à la ladrerie et à tous les sentiments de bas étage, son âme étant toujours portée vers l'universel et le tout, soit dans Tordre divin, soit dans l'ordre humain. De cet état d'esprit était née une hauteur d'âme qui lui faisait voir le néant de la vie humaine, et l'empêchait de considérer, comme les autres, la mort avec effroi. Il n'éprouvait aucune crainte de toutes les choses qui paraissent aux hommes si terribles, et cela par une disposition naturelle, à laquelle on ne peut donner le nom d'aucune autre vertu que la vertu du courage. De tout cela, il résulte évidemment, même pour ceux qui n'ont pas connu par expérience la noblesse de cette nature, combien dès sa jeunesse il aima la justice : il fut juste et doux ; jamais chagrin dans les relations ni difficile dans le commerce do la vie, en un mot jamais injuste : puisqu'un contraire son caractère s'est montré à nous plein de bonne grâce, étranger à l'avarice, à la ladrerie, à l'arrogance comme à la timidité. 5. Il n'est pas hors de propos de rappeler à ceux surtout qui ne l'ont pas vu et entendu, combien son esprit était ouvert, et son intelligence féconde, combien de connaissances et des plus nobles il possédait à fond, combien d'idées nouvelles il a produites et mises au grand jour, et que seul il semblait n'avoir jamais bu la boisson de l'oubli. Sa puissante mémoire n'éprouvait jamais de trouble ; il n'était pas sujet à ses défaillances, était toujours en possession de lui-même et de sa pensée, et n'avait pas d'autre affaire que la science. Son naturel était très opposé à la rudesse et à l'humeur discourtoise: son goût le portait naturellement vers le meilleur en toutes choses, et par sa politesse et son affabilité dans les réunions mondaines comme dans les banquets religieux et dans tous les actes de sa vie, sans rien perdre de sa dignité, il captivait toujours les assistants, toujours en meilleure disposition d'âme quand ils le quittaient. 6. Voilà les qualités physiques et d'autres encore de même nature qu'apporta, en naissant, celui que Marcella, sa mère, épouse légitime de Patricius, donna à son mari. Ils étaient tous deux de Lycie, de noble origine et de grande vertu. Il fut reçu à sa naissance par la Déesse Poliouchos de Byzance, qui assista pour ainsi dire sa mère dans ses couches : c'est elle qui, à ce moment-là fut cause qu'il vécut, puisqu'il naquit dans la ville qu'elle protège et sauve, et qui, plus tard, lorsqu'il parvint à l'enfance et à la jeunesse, fut cause qu'il vécut bien : car elle lui apparut en songe pour l'exhorter à la philosophie. C'est de là, je pense, qu'il contracta une si grande intimité avec la Déesse, que c'est à elle surtout qu'il sacrifiait et que ce sont ses préceptes qu'il pratiquait avec le plus grand enthousiasme. Quelque temps après sa naissance, ses parents remmènent dans leur propre patrie, à Xanthus, ville consacrée a Apollon, et qui devint la sienne à lui même, par un effet, pour ainsi dire divin, du sort. Car j'imagine qu'il fallait que l'homme qui devait être le prince de toutes les sciences, fut élevé et nourri sous les yeux du Dieu Musagète. L'éducation excellente qu'il reçut là, lui permit, d'acquérir les vertus morales, de s'habituer à aimer ce que le devoir commande de faire, et à se détourner de ce qui n'est pas tel. 7. A ce moment là, la grande faveur des Dieux dont il jouissait dès sa naissance, se manifesta clairement. Car un jour qu'il souffrait d'une maladie grave et qu'on le croyait perdu, un enfant apparut au dessus de son lit, qui semblait être un jeune garçon et d'une parfaite beauté, en qui il était facile de reconnaître Télesphoros, avant même qu'il eût dit son nom. Cependant après avoir dit qui il était, et quel était son nom, ayant touché la tête du jeune malade (car il se tenait auprès de lui et s'appuyait sur son oreiller) il le guérit subitement de sa maladie, et en même temps disparut à ses yeux. Ce miracle divin témoigna ainsi déjà delà faveur des dieux peur le jeune homme. 8. Après avoir, très peu de temps, fréquenté en Lycie une école de grammaire, il se rendit à Alexandrie d'Égypte, imbu déjà très profondément de ces qualités morales qui charmèrent les maures qu'il y fréquenta. Léonas le sophiste, Isaurien d'origine, si je ne me trompe, le plus célèbre parmi les nombreux savants qui pratiquaient le même art, non seulement l'admit à ses cours, mais voulut le faire l'hôte de sa maison, le lit vivre de la vie commune avec sa femme et ses enfants, comme s'il était son fils véritable. Il le fit connaître aux magistrats qui gouvernaient l'Égypte, lesquels de la vivacité naturelle d'esprit du jeune homme et de la distinction comme de In dignité de ses mœurs, le reçurent parmi leurs meilleurs amis. Il fréquenta l'école du grammairien Orion descendant d'une caste sacerdotale égyptienne et qui était tellement versé dans la connaissance de son art, qu'il composa lui-même des ouvrages très utiles à la postérité à laquelle il les a laissés. Il assista aux leçons des maîtres romains et fit rapidement de grands progrès dans les matières de leur enseignement : car au commencement, il se destinait a la profession paternelle, où son père s'était rendu célèbre dans la ville royale, par ses connaissances en droit. A ce moment où il était encore jeune, il se plaisait beaucoup à la rhétorique : car il n'avait pas encore fait connaissance avec les études philosophiques: il s'y rendit même célèbre, et se faisait admirer de ses condisciples comme de ses professeurs mêmes, par son beau talent de parole, par sa facilité à s'assimiler cet. art, et par le fait qu il semblait, par son aptitude et son savoir faire, plutôt un maître qu'un disciple. 9. Il était encore dans le cours de ses éludes, lorsque Léonas se rendant à Byzance, en fit son compagnon de route, voyage que Léonas lui-même n'avait entrepris que pour être agréable à Théodore, gouverneur d'Alexandrie, personnage très distingué, très libéral, et ami de la philosophie. Le jeune homme accompagna de grand cœur son maître, pour ne pas interrompre ses études. Mais pour dire la vérité, ce fut un coup de la Bonne Fortune, qui le ramenait auprès de la Déesse qui avait été comme l'auteur de sa naissance. Car à son retour, la Déesse lui conseilla de s'adonner à la philosophie et de visiter les écoles d'Athènes: mais il revint auparavant à Alexandrie, et disant adieu à la rhétorique et aux autres études auxquelles il s'était livré jusque là. il ne suivit plus que les cours de philosophie qui s'y faisaient. Pour s'initier à la philosophie d'Aristote, il entendit les leçons d'Olympiodore le philosophe, dont la réputation était très répandue ; pour les mathématiques, il se confia à Héron, personnage très pieux, et qui possédait et pratiquait les meilleures méthodes d'enseignement de cette science. Ces maîtres furent si charmés des vertus du jeune homme, qu'Olympiodlore qui avait une fille, élevée elle-même dans la philosophie, voulut la lui fiancer, et qu'Héron n'hésita pas à l'initier à toutes ses idées sur la religion et à en faire son commensal assidu. Après avoir entendu Olympiodore, qui possédait un vrai talent de parole, mais qui, par suite d'une trop rapide élocution et d'une trop grande subtilité, était intelligible à un très petit nombre de ses auditeurs, Proclus, en sortant, immédiatement après la conférence, répéta de mémoire et mot à mot à ses camarades, la leçon qui avait été fort longue, comme me l'a dit un de ceux qui y avaient assisté, Ulpien de Gaza, qui lui aussi avait consacré toute sa vie à la philosophie. Il comprit facilement les traités de logique d'Aristote et à la simple lecture, quoi qu'ils soient difficiles à ceux qui les abordent. 10. Après avoir étudié à Alexandrie sous ces maîtres, et profité. dans la mesure de leur talent et de leur science, de leurs leçons, il lui sembla, en lisant un certain auteur en commun, que. le professeur, dans son explication, n'avait pas vraiment entendu la pensée du philosophe. Il prit alors en un certain mépris ces écoles, et en même temps se rappelant la vision divine qu'il avait eue à Byzance, et l'ordre qui lui avait été donné, il s'embarqua pour Athènes, sous l'escorte pour ainsi dire de tous les Dieux et des bons démons qui veillent à la conservation desOracles et de la philosophie. Car c'était afin que l'École de Platon fût conservée dans sa vérité et sa pureté que les Dieux, protecteurs de la philosophie, l'envoyaient là, comme le prouvent manifestement les débuts de son arrivée, et les symboles vraiment divins qui lui présagèrent clairement la fonction qu'il devait tenir de son père, et l'élection qui devait un jour l'appeler à lui succéder dans la direction et l'administration de l'école. Car aussitôt qu'il eut abordé au Pirée, et que son arrivée fut connue dans la ville, Nicolaos, qui l'ut plus tard si célèbre dans la sophistique et à ce moment faisait ses études auprès des maîtres d Athènes, descendit au port pour le recevoir et lui offrir l'hospitalité, car il le connaissait et était son compatriote: Nicolaos en effet était de Lycie. Il le mena donc à la ville. Chemin faisant et arrivé au monument de Socrate, Proclus se sentit fatigué et las de marcher, et quoi qu'il ne sut pas et qu'il n'eut jamais entendu dire, qu'il y avait, là un culte rendu à Socrate, il pria Nicolaos de s'arrêter la même un instant et de s'asseoir pour se reposer, et en même temps de lui procurer un peu d'eau, s'il pouvait en trouver n'importe où ; car, dit-il, je meurs de soif. Celui-ci très empressé, lui en fit apporter, non pas d'un endroit quelconque, mais du lieu consacré même : car la source de la stèle de Socrate n'était pas loin. Après qu'il eu bu, Nicolaos, pour la première fois à ce moment vit là un symbole, et lui dit qu'il venait de se reposer dans le lieu consacré à Socrate, et que c'était de ce terrain que venait l'eau qu'il venait de boire, la première eau de l'Attique qu'il but. Celui-ci se levant et ayant fait une prière, continua son chemin vers la ville. Comme il arrivait à la citadelle, il rencontra, à l'entrée, le portier, qui se préparait déjà à mettre les clés dans les portes de sorte qu'il lui dit : (Je répète les termes mêmes de ce brave homme) : Vraiment, si tu n'étais pas arrivé, je fermais. « Quel symbole plus clair peut-on demander, et qui n'a pas besoin, pour être interprété, ni de Pollès, ni de Mélampous, ni de semblables devins. 11. Tenant alors en mépris les théories et la pratique oratoires, quoiqu'il fût vivement sollicité par les professeurs d'éloquence, comme s'il fut venu dans ce but même, le premier des philosophes que le hasard lui lit entendre, fut Syrianus. fils de Philoxène, à la leçon de qui assistait Lacharès, profondément versé dans les doctrines de la philosophie, et qui était alors un auditeur assidu du philosophe, bien que son art dans la sophistique excitai autant d'admiration, qu'Homère dans la poésie. Ce dernier, comme je le disais, assistait donc à ce cours : c'était à l'heure du crépuscule, sur le tard. Pendant qu'ils s'entretenaient ensemble, le soleil se couchait, et la lune, pour la première fois, sortant de la conjonction, apparaissait. Ils cherchèrent donc à congédier le jeune homme, qui était pour eux un étranger, après l'avoir salué, afin de pouvoir seuls et à loisir adorer la Déesse. Mais celui-ci, après avoir fait quelques pas, et ayant vu, lui aussi, la lune apparaître, au sortir même de la maison, défit, à la place même où il était, ses chaussures, et, à leur vue, adora la déesse. Alors Lacharès frappé de l'acte libre et hardi du jeune homme, dit au philosophe Syrianus ce mot admirable qu'a prononcé Platon concernant les grands génies : « Voilà, dit-il, un homme qui sera un grand bien ou tout le contraire. » Tels sont les présages, pour n'en citer qu'un petit nombre parmi beaucoup d'autres, que les Dieux envoyèrent à notre philosophe, à peine arrivé à Athènes. 12. Syrianus l'ayant pris avec lui, le présenta au grand Piutarque, fils de Nestorius. Celui-ci ayant vu le jeune homme, qui n'avait pas encore sa vingtième année accomplie, et ayant appris sa résolution et son vif désir de consacrer sa vie à la philosophie, fui charmé de lui, au point de l'admettre avec le plus grand empressement à ses leçons de philosophie, quoi qu'il fût souvent empoché par l'âge : car il était déjà très vieux. Il lut donc avec lui, d'Aristote, le traité de l'Âme, de Platon le Phédon. Le grand maître lui conseilla de mettre par écrit le texte de leurs entretiens, et pour mettre en branle son zèle, chercha à exciter en lui l'ambition, en lui disant, que s'il terminait et complétait ces scholies, on dirait un jour : « C'est Proclus qui est l'auteur de ces commentaires sur le Phédon » D'ailleurs, à mesure qu'il connaissait mieux, après l'avoir éprouvée, son aptitude pour les belles choses, il avait plus de goût pour lui, l'appelait continuellement son enfant et le recevait dans sa maison. Comme il le voyait s'abstenir très rigoureusement de viandes, dans sa nourriture, il lui conseilla de ne pas pousser à l'excès cette abstinence, afin de garder un corps assez vigoureux pour suffire aux travaux et aux fatigues de l'esprit. Il invita même le philosophe Syrianus de lui donner les mêmes conseils au sujet de son régime ; mais celui-ci répondit, au vieillard, - comme nous l'a rapporté cette tête si chère, -- « laisse-le apprendre ce que je veux, en suivant ce régime austère, et après, s'il le veut, qu'il meure! » Voilà de quelle sollicitude, il était l'objet de la part de ses maîtres. Le vieillard ne survécut que deux ans, après l'arrivée de Proclus, et en mourant, il le recommanda à Syrianus, son successeur avec les mêmes instances que son propre petit-fils, Archiadas. Celui-ci le prit avec lui, et non seulement le fit encore davantage profiter de ses leçons, mais l'admit dorénavant dans sa maison, le fit participer à la vie d'un philosophe, parce qu'il avait enfin trouvé le disciple et le successeur qu'il cherchait depuis longtemps, c'est à dire, qui fût capable de comprendre les sciences dans leur multiplicité et leur diversité, et en même temps de concevoir les vérités divines. 13. Pendant cet espace de moins de deux années, il lut avec son maître tous les traités d'Aristote sur la Logique, l'Éthique, la Politique, la Physique, et sur la science qui s'élève au-dessus de toutes celles-là, la Théologie. Solidement muni par cette étude, qui est pour ainsi dire une sorte d'initiation préparatoire et de petits mystères, il l'amène à la mystagogie de Platon a, en procédant par ordre, et « non en sautant par-dessus le seuil », comme dit l'Oracle; il lui fait voir d'une vue directe et immédiate, les mystères réellement divins contenus dans ce philosophe, « lorsque les yeux de l'âme ne sont plus voilés comme d'un brouillard, et que la raison, pure de sensation, peut jeter au loin des regards fermes. » Pour lui, par un travail intense et toujours en éveil, la nuit comme le jour, il mit par écrit, en y ajoutant ses remarques critiques, les doctrines qu'il entendait professer, et dont il constitua un ensemble synoptique, et fit de tels progrès qu'à l'âge de 28 ans, il eut composé beaucoup de mémoires, et entre autres un commentaire sur le Timée, œuvre écrite avec un art très élégant, et, remplie de science. Par ces fortes et hautes études, la beauté morale de sa nature ne lil que s'accroître, en ajoutant à la science, la vertu. 14. Il acquit en outre les vertus politiques, qu'il puisa dans les écrits politiques d'Aristote, dans les Lois et la République de Platon. Mais pour ne pas laisser croire que ces connaissances n'étaient pour lui que verbales, et qu'il n'en faisait aucune application réelle, comme il ne lui était pas possible de se mêler de politique, parce que ses pensées le portaient plus haut, il engagea Archiadas à s'y consacrer, lui donnant des leçons, lui expliquant les vertus et les méthodes politiques, et, faisant la fonction de ceux qui excitent les coureurs, l'exhorta à diriger les affaires communes de toute sa ville, et en même temps à rendre des services aux particuliers, dans toutes les espèces de vertus, mais particulièrement dans la justice. Et en fait il engendra chez lui une noble émulation, lui enseigna la libéralité à l'endroit de l'argent, et la munificence, en faisant lui-même des dons tantôt à ses amis, tantôt à ses parents, tantôt aux étrangers clases concitoyens, enfin en se montrant en toutes circonstances supérieur à la vanité de la richesse. Et en réalité il fit de grandes largesses publiques, et à sa mort, il légua aux deux cités, son pays natal et Athènes, sa fortune, pour en jouir après Archiadas. Quant a Archiadas il se montra, par sa propre nature, et par suite de l'affection qu'il portait à Proclus, un ami si sincère de la vérité, que les hommes de notre temps même, quand ils parlaient de lui, l'appelaient de ce nom vénéré : le très pieux Archiadas. 15. Cependant quelquefois lui-même se mêla de donner des conseils politiques; il assistait parfois aux réunions publiques où l'on délibérait sur les intérêts de la ville, proposait des résolutions d'une grande sagesse pratique, conférait avec les magistrats sur les cas qui intéressaient la justice, non seulement leur donnait des conseils, mais les contraignait en quelque sorte, avec la hardiesse d'un philosophe, à faire à chacun son droit. Il veillait à l'honorabilité de ceux qui donnaient un enseignement public, les obligeait à pratiquer, dans leur conduite publique, la tempérance, la leur enseignant non seulement par des discours, mais encore par les actes et les occupations de toute sa vie, en un mot, se faisant pour ainsi dire, pour les autres, un type exemplaire de tempérance. Il déploya même cette espèce de courage politique qu'on peut nommer d'Hercule. Car ayant à traverser un état de choses, où il eut à subir tant et de si terribles tempêtes, quand tous les vents de Typhon déchaînés secouaient sa vie si réglée, sans se laisser abattre ni effrayer, au milieu des plus grands périls il sut sauver sa vie. Un jour cependant, en butte aux soupçons et aux vexations d'une sorte de vautours acharnés a à leur proie, qui l'entouraient, quand il se vit dans celle situation il partit d'Athènes, obéissant à la puissance qui mène les révolutions du monde, et fit un voyage en Asie, où son séjour lui fut extrêmement profitable. Car c'était afin que les antiques institutions religieuses, qui s'étaient conservées là, ne fussent pas ignorées de lui, que la divinité lui fournit l'occasion de ce départ. En effet, de son côté il put prendre une claire connaissance, chez les Lydiens, de ces doctrines, et eux, qui avaient, par suite du long cours des temps, omis ou négligé certaines opérations liturgiques, reçurent de lui une doctrine plus complète, parce que le philosophe concevait plus parfaitement ce qui a rapport aux Dieux. Par cette conduite, et en gouvernant ainsi sa vie, il sut se faire ignorer, mieux encore que les Pythagoriciens n'observent le précepte inviolé de leur maître : Cache, ta, vie. Après un séjour d'un au seulement en Lydie, il revint à Athènes, conduit par la providence de la déesse amie de la sagesse. Voilà comment la vertu du courage s'établit fermement en lui, tout d'abord par la nature, puis par l'habitude, ensuite par la science et par cette prudence pratique qui raisonne de la cause à l'effet. Il montra encore, sous un autre point de vue, qu'il savait mettre en pratique son art politique, en écrivant aux magistrats des villes, et par ses recommandations rendant des services à des cités entières. Peuvent témoigner de la vérité de ce que j'avance, les peuples qui ont éprouvé ses bienfaits, d'abord les Athéniens, puis les habitants d'Andros, et beaucoup d'autres de nations diverses. 16. Par suite de ces sentiments il favorisa le développement de l'activité littéraire, venant en aide à ceux qui se livraient a ces travaux, réclamant des magistrats qu'ils leur distribuassent des pensions alimentaires et d'autres avantages proportionnés à leur mérite; mais il n'agissait pas en cela sans connaissance de cause, ni par faveur, mais il obligeait ceux auxquels il s'intéressait si sérieusement, de remplir avec zèle leurs occupations propres, les interrogeant et examinant leurs travaux dans tous leurs détails : car il était en toutes choses un juge excellent. S'il en trouvait quelqu'un qui ne se conformait qu'avec négligence à ses conseils, il le réprimandait sévèrement, en sorte qu'il a pu paraître fort irascible et en même temps 1res susceptible à l'endroit des respects qui lui étaient dus, parce qu'il voulait et qu'il pouvait porter sur toutes choses un jugement vrai et sur. Il aimait en effet les honneurs, mais cet amour delà réputation ne dégénérait pas chez lui, comme chez d'autres, en passion. Il n'était ambitieux de gloire que pour la vertu et pour le bien, fit peut-être ne se ferait-il rien de grand en ce monde, sans l'énergie qu'inspiré ce sentiment. Il était irascible, je ne le cacherai pas, mais en même temps, doux : il s'apaisait facilement, et, le temps de retourner une coquille, il montrait que sa colère avait fondu comme de la cire. Car au même moment, pour ainsi dire, qu'il réprimandait, son naturel sympathique et tendre le portait à obliger ceux-là même et à appeler sur eux la bienveillance du gouvernement. 17. C'est bien à propos qu'il me soit venu à l'esprit de mentionner ce trait particulier de sa nature, la sympathie, sentiment plus puissant chez lui, que chez aucun autre homme qu'on ait connu. Car n'ayant jamais goûté la joie du mariage ni de la famille, parce qu'il ne l'avait pas voulu, car beaucoup de propositions lui avaient été faites, très avantageuses sous le rapport de la naissance comme de la fortune, mais, comme je l'ai dit, demeuré libre de ces liens, il avait une telle sollicitude pour ses élèves, pour tous ses amis, même pour leurs femmes et leurs enfants qu'il était pour eux comme un père commun et l'auteur de leur propre existence: car il veillait, à tous les points de vue, à leur vie. Si quelqu'un parmi ses connaissances tombait malade, d'abord il implorait les Dieux avec une ardente piété pour lui, par des sacrifices et des hymnes, puis visitait le patient avec un dévouement empressé, convoquait les médecins et les pressait d'appliquer sans retard les ressources de leur art, et lui-même leur suggérait certain remède plus efficace, et par là il sauva beaucoup de malades des crises les plus périlleuses, pour son humanité envers ses serviteurs les plus familiers, on apprendra à la connaître, si on le veut, par le testament de ce parfait honnête homme. De tous les gens qu'il connaissait, celui qu'il aimait le mieux était Arcilladas et après lui ceux qui appartenaient à cette famille, surtout parce qu'il descendait de la famille du philosophe Plutarque, ensuite parce qu'il avait contracté avec Archiadas une amitié pythagoricienne, enfin parce qu'il avait été son condisciple et aussi son maître : car de ces deux formes de l'amitié qu'on trouve si rarement rapportées chez les anciens, celle qui les liait semble avoir été la plus profonde. Il n'y avait rien que voulait Archiadas que ne voulût pas également Proclus, et réciproquement rien que voulait Proclus que ne voulût aussi Archiadas. 18. Après avoir terminé d'exposer avec les développements convenables, les espèces principales des vertus politiques de notre philosophe, que scelle l'amitié, et qui sont de beaucoup inférieures aux espèces des vertus véritables, arrivons à ses vertus purificatives, qui sont différentes des vertus politiques. Car quoique celles ci aient également pour fonction de purifier l'âme, de la préparer a pourvoir aux affaires humaines sans en être l'esclave, afin d'acquérir l'assimilation à Dieu, ce qui est la fin la plus parfaite de l'âme, elles n'opèrent pas toutes cette séparation de la même manière, mais chacune, plus ou moins. S'il y a certaines purifications politiques qui donnent l'ordre et la beauté à ceux qui les possèdent et les rendent meilleurs, même pendant leur séjour ici-bas, parce qu'elles mettent des bornes et une mesure aux affections irascibles et aux désirs sensuels, et en général suppriment les passions et les fausses opinions, les vertus purificatives leur sont supérieures, parce qu'elles produisent une séparation complète, nous affranchissent des poids, véritablement de plomb, de la génération, et opèrent notre fuite sans obstacle des choses d'ici-bas. Ce sont là ces vertus que notre philosophe a pratiquées par toute une vie consacrée à la philosophie, enseignant par ses leçons éloquentes, ce qu'elles sont, comment l'homme les acquiert, et surtout leur conformant sa vie et pratiquant les actes par lesquels l'âme arrive a se séparer, continuellement, pendant la nuit comme dans le jour, usant des pratiques purificatives qui nous détournent du mal, des lustrations et de tous les autres procédés de purification, soit Orphiques, soit Chaldéens, se plongeant sans hésitation chaque mois dans la mer, souvent même deux ou trois fois dans le même mois. Non seulement il pratiquait cette rude discipline quand il était dans la force de l'âge, mais même quand il approchait déjà du couchant de la vie, il observa, sans y manquer jamais, ces habitudes austères dont il s'était fait pour ainsi dire une loi. 19. Quant aux plaisirs nécessaires de la nourriture et de la boisson, ils n'étaient pour lui qu'un délassement de ses fatigues, pour ne pas en être troublé et sollicité : car il en usait très sobrement. Il pratiquait surtout l'abstinence de la nourriture animale : si parfois une occasion impérieuse l'obligeait à en user, il ne faisait qu'y goûter, et cela par déférence et respect. Chaque mois il se sanctifiait selon les rites consacrés à la Mère des Dieux par les Romains et avant eux par les Phrygiens, observait les jours néfastes usités chez les Égyptiens plus scrupuleusement qu'eux-mêmes, et spécialement il jeûnait certains jours, très ouvertement. Car pendant tout le premier jour du mois il restait sans nourriture, sans même avoir soupe la veille, de même qu'il célébrait la nouvelle lune, dans une grande solennité et avec une grande sainteté; il observait régulièrement les grandes fêtes de tous les peuples pour ainsi dire, et les cérémonies religieuses particulières à chaque pays, et il n'en faisait pas, comme tant d'autres, le prétexte d'une distraction ou d'une débauche de nourriture, mais au contraire c'était une occasion de réunions qui duraient toute la nuit, sans sommeil, de chants, d'hymnes et autres dévotions semblables. Nous en voyons la preuve dans la composition de ses hymnes, qui contiennent les hommages elles louanges non seulement des dieux adorés chez les Grecs, mais où l'on voit célébrés Marnas de Gaxa, Asklépios Léontouchos, d'Ascalon, Thyandridès, autre dieu fort en honneur chez les Arabes, Isis qui avait un temple à Philie et en un mot tous les autres dieux. C'était une sentence chez lui familière et que cet homme si religieux avait sans cesse à la bouche, qu'il faut que le philosophe veille au salut non pas seulement d'une cité, ni des coutumes nationales de quelques peuples, mais qu'il devait être l'hiérophante commun du monde entier. Voilà, en ce qui concerne l'austérité de la manière de vivre, les exercices purificateurs et saints qu'il pratiquait. 20. Il évitait ainsi les douleurs physiques, et si parfois il en était atteint, il les supportait avec douceur, el en diminuait la vivacité, parce que la partie la plus parfaite de lui-même, ne s'attendrissait pas sur lui-même. La force d'âme, en face de la souffrance, il la montra clairement dans sa dernière maladie : abattu par elle, en proie à des douleurs atroces, il essayait encore de conjurer le mal : il nous ordonnait tour à tour de lire des hymnes ; pendant ces lectures, les souffrances semblaient apaisées et remplacées par une sorte d'impassibilité (d'ataraxie) et ce qui est encore plus étonnant, il se rappelait tout ce qu'il avait entendu lire, quoique la faiblesse qui s'était emparée de lui, lui eut fait perdre, pour ainsi dire complètement, la mémoire des personnes. Quand nous disions le commencement d'un hymne, il en récitait la suite et la fin, surtout quand c'était des vers Orphiques : car lorsque nous étions auprès de lui, nous lui en récitions. Et ce n'est pas seulement contre les souffrances physiques qu'il se montrait insensible, mais plutôt encore quand c'étaient des événements extérieurs qui le frappaient à l'improviste, et qui paraissaient contraires au cours ordinaire des choses: quand de tels accidents survenaient : « Eh bien, disait-il, ce sont-là les accidents coutumiers de la vie ». Cette maxime m'a paru digne d'être rapportée, parce qu'elle témoigne hautement de la force d'âme de notre philosophe. Il contenait, autant que cela est possible, la colore, et, ou bien il ne la laissait pas éclater du tout, ou bien ce n'était pas la partie de l'âme douée de raison, qui en était troublée : ces mouvements involontaires touchaient l'autre partie, et encore faiblement et passagèrement. Quand aux plaisirs physiques de Vénus, il ne se les permettait, je pense, que dans la mesure où l'imagination seule y participe et encore très superficiellement.
21. Et ainsi l'âme de cet
homme bienheureux se ramassant et se concentrant en elle-même se séparait pour
ainsi dire de 22. Pourvu de ce genre de vertus, faisant sans effort et d'un pas tranquille, des progrès constants en suivant l'ordre des degrés de l'initiation mystique, il s'éleva à des vertus plus grandes et plus hautes : mené comme par la main, d'abord par son heureuse nature, puis par une éducation fondée sur une science profonde : car déjà purifié et élevé au-dessus des choses de la génération, méprisant les Narthécophores qui s'y trouvent, il s'enivrait d'amour pour les choses premières, était arrivé à voir directement lui même les visions vraiment béatifiques de l'au-delà, et établissant sa science certaine, non sur des syllogismes discursifs et apodictiques, mais sur ce qu'il contemplait de ses yeux, sur les intuitions de l'activité intellectuelle, les paradigmes contenus dans la raison divine, il acquérait celte vertu dont le nom propre et véritable n'est pas la science, mais qu'on doit plutôt nommer la sagesse, Σοφία, ou d'un autre nom, s'il en est un plus auguste. Conformant tous ses actes à celte vertu, le philosophe n'eut pas de peine à comprendre toute la théologie hellénique et étrangère, même celles que des fictions mythiques avaient obscurcies et il les mit au jour pour ceux qui veulent cl peuvent en atteindre la hauteur, donnant à toutes des interprétations profondément religieuses, et les ramenant à une parfaite concordance. Il étudia à fond les écrits des plus anciens auteurs, et tout ce qu'il y trouva de pensées utiles et fécondes, il le recueillit, après l'avoir soumis à la critique; mais ce qu'il trouvait, sans force et sans valeur, il le mit de côté, comme puérilités ridicules; tout ce qui était contraire aux vrais principes, il le discutait très énergiquement el le soumettait à une critique approfondie, traitant chacune de ces théories avec autant de clarté que de vigueur dans ses conférences, et consignant toutes ses observations dans des livres. Car il se livrait sans mesure à son amour pour le travail, faisant chaque jour cinq leçons, parfois davantage, et écrivant beaucoup, à peu près 700 lignes. Ce qui ne l'empêchait pas d'aller lui-même faire visite aux autres philosophes, de faire le soir des conférences purement orales, et tout cela en pratiquant pendant la nuit, en se privant de sommeil, ses dévotions, et adorant le soleil et à son lever, et à l'heure du midi, el à son coucher. 23. Il est l'auteur de beaucoup de théories qui n'étaient pas connues auparavant, soit physiques, soit intellectuelles, soit d'un ordre encore plus divin. Car c'est lui qui le premier affirma qu'il y a un genre d'âmes capables de voir à la fois plusieurs idées, faculté qu'il posait par là même, avec raison, comme intermédiaire entre la raison qui d'avance embrasse par la pensée toutes choses ensemble el d'une seule intuition, et les âmes, dont les pensées discursives passent et ne conçoivent qu'une seule notion à la fois. Il serait facile, si on le voulait, de rencontrer d'autres doctrines imaginées par lui : on n'a qu'à entreprendre la lecture de ses ouvrages, (ce que pour le moment je me suis abstenu de faire, dans la crainte en exposant ces détails, de trop allonger cet écrit). Celui qui se livrera à ce travail, reconnaîtra que tout ce que nous avons plus haut l'apporté de lui est vrai; et on le saurait mieux encore, si on l'avait vu, si on s'était trouvé en sa présence, si on l'avait entendu faire ses leçons, et prononcer de si nobles discours, lorsque tous les ans il célébrait les anniversaires de la naissance de Socrate et de Platon. Il était visible qu'une inspiration divine le portait quand il parlait, et que de cette bouche si sage tombaient à flots les paroles semblables à des flocons pressés de neige. Il semblait alors que ses yeux étaient remplis d'une éclatante lumière, et que sur tout son visage se répandaient les rayons d'une illumination divine. Un jour un personnage politique de haute distinction, très véridique et d'une grande honorabilité, (il se nommait Rufin) venant assister à une de ses leçons, vit une lumière qui entourait sa tète. Le cours fini, Rufin se leva et le salua respectueusement, proclamant avec serment l'apparition divine dont il avait été témoin. Ce Rufin, après les circonstances fâcheuses auxquelles il avait été exposé et après son retour d'Asie, lui offrit une grosse somme d'argent que celui-ci dédaigna et refusa absolument d'accepter. 24. Mais revenons au sujet que nous avions commencé. Après avoir, quoique insuffisamment, relaté ce qui concerne sa sagesse théorétique. il nous reste a parler de cette forme de la justice qui est au même rang de dignité que ce genre de vertus. Elle ne consiste pas. comme celles dont nous avons parlé plus haut, en une pluralité de parties, ni dans l'accord de ces parties les unes avec les autres, mais dans un acte absolument propre, qui n'appartient qu'à l'âme pensante et qui, par suite, doit être défini par lui-même et à part. Ce qu'il y a de propre à cette vertu, c'est que son acte se conforme absolument à la raison et à Dieu : et c'était le caractère éminent de l'activité intellectuelle de notre philosophe. Car à peine reposé des fatigues de ses travaux de la journée, livrant alors son corps au sommeil, même pendant ces moments, sa pensée ne cessait d'être en activité. Aussi, après avoir de bonne heure secoué le sommeil, comme une sorte de paresse de l'âme, lorsque l'heure de ses prières n'était pas encore arrivée parce que la nuit était loin d'être écoulée, seul, dans son lit, il composait des hymnes, examinait certaines théories, cherchait des idées, qu'il mettait par écrit quand, le jour venu, il se levait. 25. Quant à la tempérance qui accompagne cet ordre de vertus, il la posséda ; car elle était la conséquence des premières. C'est la conversion interne de l'âme vers la raison, et la disposition morale qui ne se laisse pas toucher ni ébranler par un penchant pour tout le reste. Le courage qui l'accompagne, il le montra dans toute sa perfection, cherchant à imiter l'état d'impassibilité de ce principe sur lequel étaient tendus ses regards, qu'il voulait imiter et qui est par essence réellement impassible. En un mot il vivait, comme dit Plotin, non lias de la vie de l'homme de bien que la vertu politique rend digne et capable de vivre; mais méprisant cette vie môme, il prit en échange une autre, la vie des Dieux : car c'est à eux et non aux hommes de bien qu'il voulait ressembler. 26. Il possédait déjà et pratiquait ces vertus quand il étudiait encore avec le philosophe Syrianus et en lisant les traités des anciens philosophes; il avait recueilli de la bouche de son maître les premiers éléments et pour ainsi dire les germes de la théologie orphique et de la théologie chaldaïque. Mais celui-ci n'eut pas le temps de lui expliquer les poèmes (orphiques) - (Il avait bien formé le projet d'expliquer à lui et à Domninus de Syrie, philosophe qui fut aussi diadoque, l'un ou l'autre de ces ouvrages, soit ceux d'Orphée, soit les Oracles, et leur avait laissé à choisir l'un des deux ; mais ils ne s'accordèrent pas : ils ne choisirent pas tous deux le même, celui-ci préférant le livre d'Orphée, notre maître, les Oracles. Ce qui l'empêcha de réaliser son projet, et aussi parce que le grand Syrianus ne vécut pas longtemps après). Il n'avait donc encore reçu de son maître que les premiers principes; mais après sa mort, il étudia avec une grande ardeur les mémoires qu'il avait laissés sur Orphée, en même temps que les très nombreux travaux de Porphyre et de Jamblique sur les Oracles et les écrits des Chaldéens qui appartiennent au même ordre d'idées, et ainsi nourri des divins Oracles, il s'éleva aux plus hautes des vertus que le divin Jamblique a si magnifiquement appelées les Vertus Théurgiques. Il réunit aussi les interprétations des philosophes qui l'avaient précédé, dans un recueil qui lui coûta beaucoup de travail, et qu'il soumit à une cri-tique sérieuse et il y fit entrer les hypothèses Chaldaïques et les plus considérables des commentaires écrits sur Ies Oracles communiqués par les Dieux. C'est à l'occasion de cet ouvrage, qu'il ne put terminer qu'au bout de cinq années entières qu'il eut, dans un songe, une vision divine. Il lui sembla que le grand Plutarque lui prédisait qu'il vivrait un nombre d'années égal au nombre des tétrades qu'il avait composées sur les Oracles. Les ayant comptées, il trouva qu'il y en avait soixante dix, et ce qui prouve que le songe était divin, c'est l'événement, c'est a dire la fin de sa vie. Car il vécut, comme nous l'avons dit plus haut, cinq ans au delà de soixante dix: mais dans les cinq dernières il était très affaibli. L'austérité trop sévère, excessive même de son régime, ses ablutions fréquentes, et d'autres habitudes ascétiques de celte nature, avaient épuisé cette constitution physique que la nature avait faite si robuste : il commença à décliner après sa 70e année de sorte qu'il ne pouvait plus suffire à toutes ses occupations. Dans cet état, il se bornait a prier, à composer des hymnes, à écrire quelques lignes, à converser avec ses amis, tout cela l'affaiblissait encore. Aussi se rappelant le songe qu'il avait eu, il en était émerveillé et disait fréquemment qu'il n'avait vécu que 70 ans Malgré ce grand état de faiblesse, Hégias lui rendit le courage de reprendre ses leçons : ce jeune homme montrait déjà dès son enfance, des indices manifestes des vertus de ses aïeux, qui prouvaient qu'il était de la famille de la vraie Chaîne d'Or, qui commençait à Solon : il étudia avec ardeur avec lui les écrits de Platon, et les autres théologies. Le vieillard lui confia ses manuscrits et éprouva une grande joie de voir quels pas de géant il faisait dans l'avancement de toutes les sciences. Quant à ses travaux sur les écrits des Chaldéens, il me suffit de les avoir indiqués d'un mot. 27. Un jour lisant avec lui les poèmes d'Orphée, et l'entendant citer dans ses commentaires, non seulement les interprétations de Jamblique et de Syrianus. mais de beaucoup d'autres encore, qui pénétraient au fond de la théologie, je priai le philosophe de ne pas laisser, sans l'avoir interprétée, cette divine poésie, et de lui consacrer des commentaires complets. Il me répondit qu'il avait eu souvent le projet d'en écrire, mais qu'il en avait été empêché par certains songes : car il disait qu'il avait vu apparaître son maître qui l'en avait détourné avec des menaces. Ne concevant pas d'autre expédient, je le conjurai du moins de paraphraser les remarques qu'il approuverait dans les livres de son maître. Par bonté, il se laissa persuader, et écrivit en tète de ces commentaires un certain nombre de notes. C'est ainsi que nous possédons un recueil de tous les écrits qui ont rapport à ce même auteur, des scholies et des commentaires fort étendus sur Orphée, bien qu'il n'ait pas consenti à faire ce travail sur toute la théomythie et sur toutes les Rhapsodies. 28. Mais puisque, comme je l'ai dit, par ses études sur ce sujet, il avait acquis une vertu encore plus grande et plus parfaite, la vertu théurgique, et ne s'était pas arrêté au degré de la vertu théorétique. il ne conforma pas sa vie exclusivement à l'un des deux caractères propres aux êtres divins; il ne se renferma pas exclusivement dans la méditation, tendant sa pensée toujours vers le divin ; mais il appliqua aux choses inférieures sa faculté de prévoyance et sa sollicitude, selon un mode politique plus divin et qui ne ressemble pas à la vertu politique dont nous avons parlé plus haut ; car il pratiquait les réunions et les conversations des Chaldéens, et employait même l'art de faire mouvoir, sans prononcer des paroles, les toupies divines. Car il croyait à ces pratiques, aux oraisons jaculatoires et à d'autres dont il avait appris l'usage d'Asklépigénie, fille de Plutarque ; car les rites mystiques (ὄργια) conservés par Nestorius et toute la procédure théurgique lui avaient été confiés et enseignés à elle seule par son père. Avant cela, et selon l'ordre prescrit, purifié par les lustrations chaldaïques, le philosophe avait assisté en qualité d'épopte, aux apparitions d'Hécate, sous forme lumineuse, comme il l'a mentionné lui même dans un écrit spécial. Il avait la puissance de provoquer les pluies, en mettant en mouvement, en temps utile, une yunx déterminée, et put délivrer l'Attique d'une sécheresse terrible. Il connaissait le moyen de prévoir les tremblements de terre, avait expérimenté la puissance divinatoire du trépied, et prononcé lui même, sur son propre sort, des vers prophétiques. A l'âge de 40 ans, il lui sembla qu'en songe il avait prononcé ces vers: « Ici plane une splendeur immortelle, hypercéleste, qui a jailli de la source sanctifiée et d'où rayonne une lumière de feu ». Au commencement de sa 42e année, il lui sembla encore qu'il criait à grande voix ces vers : « Un esprit est entré en moi, qui me souffle la force du feu, qui, déployant et ravissant ma raison dans un tourbillon de flamme, s'envole vers l'éther, et fait retentir de ses frémissements immortels les voûtes étoilées. » Outre ce que nous venons de dire, il avait vu clairement en songe qu il appartenait à la chaîne Hermaïque et sur la foi d'un songe, il était convaincu qu'il avait l'Âme du pythagoricien Nicomaque. 29. On pourrait, si on le voulait, s'étendre beaucoup sur ce point et raconter les œuvres théurgiques de ce Bienheureux. J'en veux citer seulement une entre mille, qui est vraiment miraculeuse. Un jour Asklépigénie, fille d'Archiadas et de Plutarcha, épouse de Théagène, mon bienfaiteur, étant encore petite fille et élevée chez ses parents, tomba gravement malade, et d'une maladie que les médecins déclarèrent incurable. Archiadas, car c'était sur elle seule que se fondait l'espoir de sa maison, était dans la désolation, et poussait, comme il est naturel, des gémissements douloureux. La voyant abandonnée des médecins, le père, comme il arrive dans les circonstances les plus graves de la vie, en vint à jeter sa dernière ancre, ou plutôt courut chez le philosophe, comme celui qui pouvait, seul la sauver, et le pria avec force instances de venir en toute hâte prier pour sa lille. Celui-ci, emmenant avec lui le grand Périclès de Lydie, qui était lui aussi un vrai philosophe, courut au temple d'Asclépios pour prier le Dieu en faveur de la malade. Car Athènes encore alors avait le bonheur de le posséder et le temple du Sauveur n'avait pas été encore ravagé. Pendant qu'il priait selon le rite antique, un changement se manifesta tout d un coup dans l'état de la jeune fille, et une amélioration subite eut lieu. Car le Sauveur, en tant que Dieu, lui rendit vite la santé. Les cérémonies religieuses accomplies, il se rendit auprès d'Asklépigénie qui justement venait d'être délivrée des souffrances qui l'avaient assaillie, et qui se trouvait dans une parfaite santé. Il avait eu bien soin d'accomplir ses vœux et ses prières à l'insu de tous, pour ne fournir aucun prétexte à la malveillance ; car toute la maison où il habitait avait pris part à cet acte : ce fut en effet un des bonheurs de Proclus, d'habiter la maison qui lui convenait le mieux, qu'avaient habitée Syrianus, son père, et son grande père, comme il appelait Plutarque. voisine du temple d'Asklèpios, célébré par Sophocle, du temple de Dionysos près du théâtre, et qui était vue, ou du moins apparente, de l'Acropole d'Athéna. 30. Combien il fut cher à la Déesse amie de la sagesse, le choix qu'il lit de la vie philosophique, qui fut celle que nous venons de décrire, le prouve amplement. Mais la Déesse le témoigna elle-même, lorsque la statue de la Déesse qui était érigée dans le Parthenon, fut changée de place par des gens qui ébranlent ce qui est inébranlable. Le philosophe , dans un songe, crut voir venir à lui une femme d'une grande beauté, qui lui annonça qu'il fallait le plus promptement possible préparer sa maison: « car la Reine Alhenaïs, dit-elle veut demeurer auprès de toi. » La faveur dont il jouissait auprès d'Asclépios, s'est montrée dans le fait que j'ai raconté tout à l'heure, et nous en avons été convaincu dans sa dernière maladie par l'apparition de la Déesse. Car, étant dans un état entre le sommeil et le réveil, il vit un serpent ramper autour de sa tête : à partir de ce moment, il commença à se sentir soulagé de son mal, et il eut le sentiment que cette apparition allait le guérir de sa maladie, s'il n'avait été retenu par un violent et ardent désir de la mort ; je suis en effet certain qu'il aurait recouvré complètement la santé, s'il eût voulu recevoir les soins que demandait son état. 31. Voici encore un fait qui est digne d'être rappelé, et que je ne rappelle pas sans attendrissement et sans larmes. Il avait toujours craint qu'une arthrite dont avait souffert son père,— c'est une maladie qui, fréquemment el habituellement est transmise des parents aux enfants,— ne vint à l'atteindre lui-même, et ses craintes, à mon avis, n'étaient pas sans fondement : car avant le fait que je dois rapporter, il avait ressenti des douleurs de celte nature, lorsque eut lieu un autre incident vraiment surprenant. Sur les conseils de quelques personnes, il se mit sur le pied malade ce qu on appelle un emplâtre. Pendant qu'il était étendu sur son lit, soudain un passereau s'abattit en volant et l'emporta. C'était un symbole divin, réellement paeonique et de nature à lui inspirer confiance pour l'avenir ; mais cependant, comme je le disais, il n'en éprouvait pas moins des craintes d'être atteint plus tard de cette maladie Ayant donc imploré le dieu à ce sujet, et lui ayant demandé de lui dire clairement la chose, en donnant il vit (c'est une chose bien téméraire, et cependant il faut avoir le courage, il ne faut pas craindre de proclamer ouvertement vérité) en dormant il lui sembla voir quelqu'un qui venait d'Épidaure, se pencher sur ses jambes et dans un mouvement de tendre affection, sans hésiter, embrasser ses genoux. A partir de ce jour, il vécut toute sa vie sans inquiétude à ce sujet, et il arriva à une extrême vieillesse, sans ressentir aucune atteinte de ce mal. 32. Le Dieu des Adrottoï montra aussi et manifestement les liens d'affinité de ce saint homme avec lui. Car lorsqu'il visita son temple, il lui témoigna sa faveur par des apparitions. Comme il était dans le doute et qu'il désirait savoir de source certaine quel Dieu ou quels dieux habitaient ce lieu et y étaient honorés, parce que les indigènes n'étaient pas d'accord sur ce point dans leurs récits; quelques uns, conjecturant que c'était le temple d'Asclépios, se fondaient sur de nombreux témoignages; car ils disent que réellement des voix se font entendre dans ce lieu, qu'une table y est consacrée au Dieu, quo des réponses oraculaires sur des questions relatives à la santé, y sont données, et que ceux qui viennent le consulter sont guéris, contre toute espérance les maladies les plus dangereuses; mais d'autres croient que ce sont les Dioscures qui fréquentent ce temple : car quelques personnes ont cru voir, en songe, sur la route qui conduit à Adrotta, deux jeunes hommes, d'une extrême beauté, montés sur des chevaux de grande vitesse, et disant qu'ils allaient en toute hâte au temple, de sorte qu'au premier abord ils avaient cru voir des hommes ; mais bientôt après, ils avaient été convaincus que c'était une apparition vraiment divine; car lorsqu ils furent eux mêmes arrivés au temple et qu'ils s'informèrent, il leur fut répondu par le personnel attaché aux fonctions du temple qu'on n'avait rien vu, tandis que ces cavaliers s'étaient dérobés soudain à leur vue à eux-mêmes). Par ces raisons donc, comme je le disais, le philosophe incertain et ne sachant que croire des faits qui étaient rapportés, pria les dieux de ce lieu de lui faire connaître par certains signes, quel était leur vrai et propre caractère : et alors il lui sembla en songe qu'un Dieu venait à lui et lui adressait ces claires paroles : « Eh! quoi ! n'as tu pas entendu Jamblique dire quels sont ces deux personnages, et prononcer les noms de Machaon et de Podalirios » Là dessus le Dieu donna à ce saint homme un témoignage de sa haute bienveillance. Comme les orateurs qui prononcent dans un théâtre l'éloge de certains personnages, le Dieu se tenant debout, avec un geste de la main et un accent dramatique, prononça avec une grande force ces mots : — (car je répéterai les paroles mêmes divines) : « Proclus est la gloire de la Patrie. » — Quelle plus grande preuve pourrait-on apporter de l'affection des Dieux pour cet homme si parfaitement heureux? A la suite de ces témoignages sympathiques qu'il recevait de la divinité, il se mettait, malgré lui, à fondre en larmes, toutes les fois qu'il nous rappelait ce qu'il avait vu, et l'éloge divin qui avait été prononcé sur lui. 33. Mais si je voulais énumérer tous les faits de cette espèce et rapporter la dévotion particulière qu'il avait pour Pan, fils d'Hermès, les grandes faveurs et les nombreux cas où il a été sauvé à Athènes par la bienveillance du Dieu, et raconter par le détail les protections et. les avantages qu'il a reçus de la Mère des Dieux, dont il était si particulier fier et heureux, je paraîtrais à ceux qui par hasard rencontreront cet ouvrage me laisser aller à un vain bavardage, et même à quelques-uns dire des choses peu dignes d'être crues. Car il y a un grand nombre de faits considérables et pour ainsi dire journaliers où la déesse agit ou parla en sa faveur, et dont le nombre est tel, en même temps qu'ils sont si inouïs, que je n'en ai pas maintenant le souvenir exact et précis Si quelqu'un désire connaître avec quelle faveur il s'attachait à la Déesse, qu'il prenne de ses mains son livre sur la Mère des Dieux, et il verra que ce n'est pas sans une inspiration et un secours d'en haut, qu'il a pu exposer toute la théologie relative à la déesse et expliquer philosophiquement tout ce que les actes liturgiques et les enseignements de vive voix nous apprennent mythiquement de la Déesse et d'Attis, en sorte qu'ils ne seront plus troublés par ces gémissements lamentables, dont le sens se dérobe, et par toutes les traditions pleines de mystères qu'on leur raconte dans ces cérémonies. 34. Après avoir rapidement et en courant fait connaître et les actes et les résultats heureux de sa vertu théurgique, après l'avoir montré en tout au niveau de toutes les vertus, et à un degré que les hommes n'ont pas vu depuis de longs siècles, mettons maintenant fin à tout ce discours. Le commencement n'en a pas été pour nous seulement le commencement ni même, comme dit le proverbe, la moitié du tout, mais c'est le tout tout entier1. Car nous avons commencé par le bonheur ; le bonheur a formé le milieu, et nous voilà encore ramenés au bonheur : nous avons, dans cette exposition, mis sous les yeux les biens que les dieux et en général la Providence ont procurés à cet. homme de bien ; nous avons montré leur disposition à l'écouter favorablement, leurs apparitions, leur sollicitude, et tous les autres secours qu'ils lui ont prêtés, toutes les faveurs qu'il a reçues en partage du destin et de la Bonne Fortune, patrie, parents, force et beauté naturelles du corps, maîtres et amis, tous les autres avantages, qui, par leur grandeur et leur éclat, sont bien supérieurs à ceux qu'on voit chez les autres hommes, tout cela nous l'avons fait ressortir dans cet écrit. Nous avons de plus énuméré ces supériorités qu'il devait à sa volonté propre, et qui ne lui venaient pas d'une cause étrangère et extérieure (car telles sont ces grandeurs murales de l'âme, issues de l'ensemble de toutes ses vertus). En un mot, nous avons mis en pleine lumière que l'activité de son âme en toutes ses démarches, se conformait à la vertu parfaite, et que pendant une vie parfaite il a été comblée de tous les autres biens humains et divins 35. Mais afin que les personnes curieuses des choses des sciences nobles, puissent, par la disposition des astres sous laquelle il est venu au monde, conclure que la vie que le sort lui réservait en partage, n'était rangée ni dans les plus basses conditions ni dans les conditions moyennes, mais dans les plus limites, nous avons dressé le tableau de la configuration des astres, telle qu'elle se trouvait au moment de sa naissance :
L'Horoscope a été pris
dans le Bélier 36. Proclus quitta ce monde la 124e année à partir de l'avènement de Julien à l'empire1, sous l'Archontat de Nicagoras le jeune, à Athènes, le 17e jour du mois de Munychion, selon les Athéniens, le 17e du mois d'Avril selon les Romains. Son corps reçut les honneurs de la sépulture suivant les coutumes nationales des Athéniens, et comme lui même de son vivant l'avait prescrit : car cet homme bienheureux avait, plus que tout autre, la connaissance et la pratique des honneurs funèbres dus aux morts. Il ne négligeait, dans aucune circonstance, de leur rendre les hommages accoutumés, et chaque année, à jours fixes, il allait visiter les tombeaux des héros de l'Attique, ceux des philosophes, de ses amis et de ceux qu'il avait particulièrement connus, accomplissait les actes prescrits par la religion, et cela non par un intermédiaire, mais personnellement. Après avoir rempli ce pieux devoir envers chacun d'eux, il allait à l'Académie, et dans un certain lieu particulier, sollicitait par ses vœux et ses prières, les âmes de ses ancêtres et de ses parents, a part et séparément, et, dans une autre partie de l'édifice, faisait en commun des libations en l'honneur de tous ceux qui avaient pratiqué la philosophie. Après tout cela, ce saint personnage, traçant un troisième espace distinct, faisait un sacrifice à toutes les âmes des morts qui reposaient dans cette enceinte. Son corps revêtu et disposé, comme je l'ai dit, suivant ses propres recommandations et porté par ses amis, fut enterré dans la partie la plus orientale des faubourgs de la ville, près du Lycabettos, où repose aussi le corps de son maître, Syrianus. Car c'était une volonté que celui-ci, de son vivant, avait exprimée à son élève, et en vue de laquelle il avait fait faire un double monument funèbre; et, comme après sa mort, notre pieux maître se demandait en lui même si cela n'était pas contraire au respect et aux convenances, il lui sembla le voir en songe qui lui adressait des reproches et des menaces, et le blâmait vivement même d'avoir eu cette pensée. On grava sur son tombeau une inscription en quatre vers, qu'il avait composée pour lui même, et que voici : « Moi, Proclus, je suis Lycien d'origine ; Syrianus m'a nourri ici de ses leçons, pour lui succéder dans son enseignement. Ce même tombeau a reçu nos deux corps : Puisse un même séjour être réservé à nos deux âmes! » 37. Il y eut un an avant sa mort des prodiges célestes, comme une éclipse du soleil tellement complète que la nuit se fit pendant le jour : on tomba dans une obscurité profonde et les astres apparurent ; elle se produisit au moment où le soleil était dans le Capricorne, au centre oriental. Les savants qui s'occupent de déterminer par écrit le temps qu'il fera chaque jour, en ont signalé une deuxième qui, elle, devait se produire une année pleine, écoulée après sa mort. Ces états désordonnés que paraît subir le ciel, sont, dit-on, des indices des événements qui arrivent sur la terre ; en tout cas. ils nous ont montré à nous, la disparition et pour ainsi dire l'éclipsé de lumière que subissait la philosophie. 38. Les faits que je viens de raconter de notre philosophe sont suffisants pour moi ; mais il est permis à celui qui le voudra, d'entreprendre un récit sincère touchant ceux qui ont été ses disciples ou ses amis. Car beaucoup de personnes, et venues de beaucoup de pays différents, ont fréquenté ses cours, les uns uniquement pour l'entendre, les autres pour devenir ses émules, et se sont liés à lui par amour de la philosophie. Un écrivain plus laborieux que moi pourra faire la liste générale de ses ouvrages (car pour moi j'ai été amené à écrire ce livre pour satisfaire à un devoir de conscience, et pour acquitter ma dette de pieux hommage envers cette tête divine et le bon Démon qui l'avait reçu dans son partage). En ce qui concerne ses écrits, je me borne a dire que de tous, il préférait toujours les commentaires sur le Timée, quoi qu'il eût une grande prédilection pour ceux du Théétète. Il avait aussi souvent à la bouche, ces mots : « Si j'étais le maître, je ne laisserais dans la circulation, de tous les anciens livres, que les Oracles et le Timée; tous les autres, je les ferais disparaître des yeux des hommes de notre temps, car ils ne peuvent que nuire à certains de ceux qui, témérairement et sans précaution, en abordent la lecture. »
|