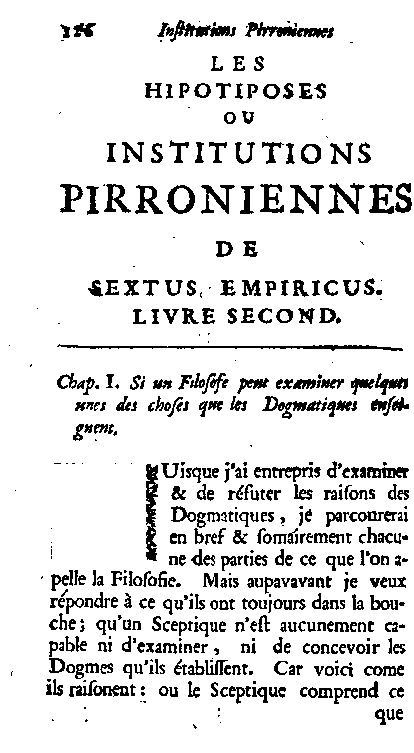
LES
HYPOTYPOSES ou INSTITUTIONS PYRRHONIENNES DE SEXTUS EMPIRICUS.
LIVRE SECOND.
Chap. I. Si un philosophe
peut examiner quelques unes des choses que les dogmatiques
enseignent.
Puisque j'ai
entrepris d'examiner et de réfuter les raisons des dogmatiques, je
parcourrai en bref et sommairement chacune des parties de ce que
l'on appelle la philosophie. Mais auparavant je veux répondre à ce
qu'ils ont toujours dans la bouche; qu'un sceptique n'est aucunement
capable ni d'examiner, ni de concevoir les dogmes qu'ils
établissent. Car voici comme ils raisonnent : ou le sceptique
comprend ce que disent les dogmatiques, ou il ne le comprend pas.
S'il le comprend, comment peut-il douter de ce qu'il dit avoir
compris ? Et s'il ne le comprend pas, il ne peut pas parler ni
raisonner de ce qu'il ne comprend pas. Car comme celui qui ignore,
par exemple, ce que c'est que l'argument de la soustraction par
partie, ou ce que c'est que l'argument à deux conséquences, ne peut
parler de ces arguments là : ainsi celui qui ne connaît aucune chose
des dogmatiques, ne peut point examiner contre eux, ou réfuter des
choses qu'il ne connaît pas : et par conséquent un sceptique ne peut
examiner ou réfuter ce que disent les dogmatiques.
Que ceux qui
raisonnent ainsi, nous répondent dans quel sens ils prennent ce mot,
comprendre. Entendent-ils par là avoir simplement une
perception, une idée d'une chose ; en avoir une simple connaissance,
sans rien affirmer touchant ï'existence de ce dont nous discourons?
Ou bien entendent-ils par ce mot, connaître une chose, et en même
temps, établir l'existence de cette chose dont nous disputons? Car,
si par ce mot, comprendre, ils entendent accorder son
assentiment à leur fantaisie compréhensive, à l'existence de ce que
cette faculté compréhensive représente; en sorte que la faculté
compréhensive de l'âme soit imprimée, marquée, ou imbue par une
chose vraie et existante réellement, et qu'elle ne puisse recevoir
aucune impression d'une chose fausse et non existante : il faudra
peut-être aussi qu'ils nient, qu'ils puissent examiner ou réfuter ce
qu'ils ne comprennent pas.
Par exemple,
quand un stoïcien raisonne contre un épicurien, qui dit que Dieu est
d'une substance séparée du monde; ou que Dieu ne prend aucun soin
des choses qui sont dans le monde ; ou que la volupté est le
souverain bien : comprend-il ce qu'il veut réfuter, ou ne le
comprend-il pas? S'il le comprend, il faudra qu'il dise que les
sentiments de l'épicurien sont véritables; mais par là il renversera
absolument toute la philosophie stoïcienne: et, s'il ne le comprend
pas, il ne peut point disputer contre l'épicurien.
Il faut
répondre à peu près de même aux philosophes des autres sectes, quand
ils veulent disputer sur des sentiments opposés de quelques uns de
leurs adversaires. Car si comprendre une chose, c'est la croire
véritable, i!s ne pourront jamais s'entendre, ni par conséquent
disputer de quoi que ce soit les uns contre les autres.
Mais pour
dire quelque chose de plus fort, et cesser de badiner, je dis que
toute leur philosophie dogmatique sera renversée; et qu'au contraire
la philosophie sceptique sera fermement établie; si on leur accorde
qu'on ne peut pas disputer touchant ce que l'on ne comprend pas, en
prenant le mot comprendre dans le sens qu'ils le prennent.
Car celui qui
prononce dogmatiquement sur une chose obscure, doit dire qu'il
prononce ou après avoir compris la chose, ou avant que de l'avoir
comprise. S'il prononce avant que de l'avoir comprise, il ne
méritera aucune croyance. Que s'il prononce après l'avoir comprise,
ou bien il dira qu'il l'a comprise par elle même et qu'elle s'est
présentée à lui évidemment ; ou bien, il dira qu'il l'a comprise par
quelque examen et par quelque recherche. S'il dit que cette chose
obscure s'est présentée à lui évidemment, et qu'il l'a comprise par
elle même ; il faudra qu'elle ne soit pas obscure, et qu'elle soit
également évidente et visible à tout le monde, il faudra que chacun
la reconnaisse pour vraie et que personne n'en dispute. Mais il y a
toujours eu des disputes insolubles sur chaque chose obscure parmi
les dogmatiques. Il faut donc dire que ce dogmatique qui prononce
affirmativement sur l'existence d'une chose obscure, ne l'a point
comprise, comme une chose qui se soit présentée à lui évidemment.
Que s'il dit
qu'il a compris cette chose par quelque examen ; comment pouvait-il
l'examiner avant que de l'avoir comprise exactement, comme nous
avons supposé,par concession pour les stoïciens? Car si, pour
examiner, il est nécessaire (selon les stoïciens) que l'on comprenne
exactement ce que l'on veut examiner ; et si réciproquement, pour
comprendre une chose qui est en question, il faut que l'examen ait
précédé, comme nous l'avons démontré ; il faudra que les stoïciens
avouent qu'ils ne peuvent ni disputer, ni prononcer dogmatiquement
sur des choses obscures; à moins qu'ils ne veuillent tomber dans le
Diallèle, ou dans le cercle vicieux ; qui prouve deux choses
concertées réciproquement l'une par l'autre.
Ajoutez que,
s'ils veulent commencer par la compréhension, nous les réduirons à
la nécessité d'avouer qu'ils doivent avoir examiné avant que d'avoir
compris, et que, s'ils aiment mieux commencer par l'examen, nous les
réduirons à la nécessité de dire, qu'avant que d'examiner, ils
doivent avoir compris ce qu'ils doivent examiner. Tellement qu'ils
ne peuvent ni comprendre aucune chose obscure, ni prononcer
affirmativement touchant cette chose : ce qui est capable de ruiner
le babil subtil des dogmatiques, et d'introduire, à ce que je crois,
la philosophie éphectique.
Maintenant,
s'ils veulent dire qu'il n'est pas nécessaire qu'une compréhension
semblable à celle, dont nous avons parlé, précède l'examen, mais
qu'une simple perception, ou qu'une simple connaissance ou idée de
la chose suffit ; il sera vrai de dire que ceux aussi qui
s'abstiennent de juger de l'existence des choses obscures, pourront
examiner, et faire des difficultés sur ce qu'ils voudront. Car un
sceptique n'est pas privé d'intelligence; je veux dire de celle, qui
vient du fond de sa raison, et qui naît des choses qui se présentent
à lui ; en agissant sur lui et lui paraissant actuellement d'une
certaine manière. Or cette forte d'intelligence n'emporte point
nécessairement avec elle l'existence des choses que le sceptique
aperçoit par son entendement. Car nous n'apercevons pas seulement
par l'entendement les choses qui existent, mais encore celles qui
n'existent pas. Par conséquent, soit qu'un philosophe éphectique
examine, soit qu'il ait des idées, ou qu'il aperçoive par son
entendement ; il persévère toujours dans son institut de philosophe
sceptique : et nous avons déjà dit qu'il accorde son assentiment aux
choses qui se présentent à son imagination, suivant ce qu'elles lui
paraissent.
Mais voyez,
je vous prie, si les dogmatiques ne sont pas plutôt exclus du
pouvoir d'examiner que les sceptiques. Car il n'y a point
d'inconvénient à dire que des personnes, qui avouent qu'elles
ignorent ce que les choses sont par leur nature, continuent à les
examiner. Mais l'examen ne convient point à des personnes qui
s'imaginent de connaître les choses exactement ; puisqu'à l'égard de
ces deniers, leur examen doit être fini suivant leur pensée : au
lieu que les premiers conservent encore toute la raison qu'ils ont
d'examiner, laquelle consiste à croire qu'ils n'ont pas encore
trouvé ce qu'ils cherchent.
Il nous faut
donc examiner en peu de mots à présent chacune des parties de ce
qu'on appelle philosophie. Mais comme il y a eu une grande
controverse parmi les dogmatiques touchant les parties de la
philosophie, les uns ne la distinguant point par parties, d'autres
la divisant en deux parties, et d'autres en trois ; (controverse sur
laquelle il n'est pas besoin de nous étendre : ) nous suivrons dans
notre discours l'opinion de ceux qui passent pour les plus habiles
dans cette dispute, quand nous aurons exposé leur sentiment autant
qu'il sera nécessaire.
Chap. II. Par où doit
commencer l'examen de la philosophie contre les dogmatiques.
Les stoïciens
et quelques autres distinguent trois parties dans la philosophie ;
la Logique, la Physique, et la Morale : et ils commencent par la
Logique. Quoiqu'il y ait eu de grandes disputes entre eux, pour
savoir, par laquelle de ces parties il fallait commencer; nous les
suivrons, sans nous assujettir à aucun sentiment : et parce que
toutes les choses qui se disent dans ces trois parties, ont besoin
de Critérium ou de régie des jugements, et que la question
de cette régie des jugements, semble appartenir à la partie
rationnelle de la philosophie, ou à la Logique; nous commencerons
par l'examen de cette régie des jugement, et par la Logique.
Chap. III. Du Critérium,
c'est-à-dire, de la règle du vrai et du faux.
Il faut
savoir avant toutes choses que l'on appelle Critérium, ou bien ce
par quoi quelques uns prétendent que l'on juge si une chose est, ou
n'est pas ; ou bien ce qui est la règle de notre conduite dans la
vie. Mon dessein est pour le présent de traiter de ce qu'on appelle
la règle du vrai et du faux : car à l'égard du Critérium pris
dans la seconde signification, j'en ai parlé assez dans le premier
livre, où j'ai traité de la sceptique en général.
Le
Critérium, dont il s'agit ici, se peut entendre de trois
manières. D'une manière commune, d'une manière particulière, et
d'une manière très particulière. Il se prend communément pour toute
mesure de compréhension ; et suivant cette signification les
facultés naturelles sont des régies, ou des mesures de
compréhension, ou de perception, Il se prend particulièrement, pour
toute mesure artificielle de compréhension ; comme sont une règle,
un compas. Il se prend très particulièrement pour toute mesure
artificielle qui sert à comprendre une chose obscure ; suivant
laquelle signification l'on n'appelle point règles de vérité, les
choses qui appartiennent à la conduite de la vie commune, mais
seulement celles qui appartiennent à la raison ou à la Logique, et
que les dogmatiques nous donnent comme des règles pour discerner la
vérité.
J'entreprends
donc de discourir ici principalement de cette règle logique ou
rationnelle du vrai et du faux. Or à l'égard de cette règle des
jugements, on peut considérer trois choses : le juge, l'instrument
dont on prétend se servir pour juger; et l'exemplaire sur lequel on
veut juger. Le juge, qui est l'homme; l'instrument, qui est
l'entendement ou les sens ; et l'exemplaire, qui est l'idée,
l'imagination, ou la faculté compréhensive de l'âme, sur le modèle
de laquelle Idée, l'homme entreprend de juger par l'entendement ou
par les sens, comme nous avons dit.
Voilà ce que
nous avons jugé à propos d'expliquer avant toutes choses, afin que
l'on connaisse de quoi il est question. Il nous reste maintenant de
passer à la réfutation de ceux qui disent témérairement qu'ils
possèdent une règle de vérité. Commençons par la vérité.
Chap. IV. S'il y a quelque
règle de vérité.
Entre les
philosophes qui ont traité de la règle du vrai et du faux, quelques
uns ont décidé qu'il y en a une, comme les stoïciens ; et quelques
uns ont dit qu'il n'y a point, comme, entre autres, Xéniade de
Corinthe, Xénophane de Colophon, qui dit qu'il n'y a qu'opinion en
toutes choses. Pour nous, nous nous abstenons de juger s'il y a une
règle de vérité ; ou s'il n'y en a pas.
Dira-t-on
qu'il est possible de décider cette controverse ; ou dira-t-on que
cela est impossible ? Si on dit que cela est impossible, par là on
nous accordera qu'il faut s'abstenir de juger. Que si cette
controverse est telle qu'on puisse la décider, que l'on nous dise
par où on pourra la décider ; puisque nous n'avons point encore de
règle de vérité, qui sait reconnue et avouée, et que nous ne savons
pas même s'il y en a une, mais que nous la cherchons.
Outre cela,
afin que nous puissions décider la controverse qui est entre nous
sur la règle du vrai, il faut que nous ayons une règle avouée et
reconnue, par laquelle nous puissions juger de la bonté de cette
autre règle : et afin que nous ayons cette seconde règle avouée et
reconnue, il faut auparavant décider la controverse que nous avons
entre nous sur la règle de vérité. Ainsi la dispute tombant dans le
moyen que nous avons appelé le Diallèle, (le cercle vicieux)
on ne fait plus comment trouver une règle de vérité : d'autant plus
que nous ne permettons pas aux dogmatiques, d'établir une règle de
vérité par supposition; et que, s'ils veulent juger d'une règle de
vérité par une autre règle, et ainsi de suite, nous les réduirons au
moyen que nous avons appelé le progrès à l'infini.
De plus comme
la démonstration a besoin d'une règle du vrai et du faux qui soit
démontrée, et que la règle du vrai et du faux a besoin d'une
démonstration jugée telle : les voilà encore réduits au Diallèle.
Mais quoique ces choses puissent suffire, selon nous, pour faire
voir la témérité des dogmatiques, à l'égard de ce qu'ils disent de
la règle de vérité; néanmoins, afin que nous puissions les réfuter
en diverses manières, il ne sera pas hors de propos de nous arrêter
sur cette matière.
Notre
intention n'est pas de reporter en détail toutes les opinions des
dogmatiques touchant la règle du vrai et du faux. (Car il y a eu là
dessus des différences de sentiments infinies ; et ainsi il faudrait
nous écarter de la juste méthode de la dispute pour les examiner
tous.) Mais, comme on peut considérer trois choses par rapport à
cette règle; celui qui juge, l'instrument par lequel il juge, et
l'exemplaire sur lequel il juge : nous examinerons, toutes ces
choses en particulier, et nous montrerons par là que cette règle de
vérité est incompréhensible. De cette manière nous traiterons la
chose avec méthode, et notre réfutation sera plus parfaite et plus
accomplie.
Commençons
par le juge du vrai et du faux. En réfutant ce que les dogmatiques
disent sur cet article, nous rendrons fort douteux ce qu'ils disent
sur les deux autres.
Chap. V. Du Critérium à quo,
c'est-à-dire, de celui qui doit juger de la vérité.
Quand je
considère ce que les dogmatiques disent de l'homme, non seulement il
me semble que l'homme est une chose incompréhensible, mais je crois
encore que l'on ne saurait en avoir une connaissance même légère et
superficielle qui fait juste. Nous voyons dans Platon, Socrate qui
dit qu'il ne sait s'il est plutôt homme que quelque autre chose. Et
quand les dogmatiques veulent donner une notion de l'homme,
premièrement ils ne s'entendent point entre eux; et ensuite, ils ne
disent quelquefois que des choses ridicules. Démocrite dit que
l'homme est ce que nous connaissons tous. Selon quoi nous ne
connaîtrons donc point l'homme, parce que nous connaissons aussi le
chien ; ou il s'ensuivra de là qu'un chien, que nous connaissons,
est aussi un homme. Il y a de plus quelques hommes que nous ne
connaissons pas ; et par conséquent ils ne seront pas hommes. Bien
plus, suivant cette notion on pourra dire qu'il n'y a aucun homme.
Car si Démocrite veut dire qu'il faut qu'un homme sait connu de
tous, comme aucun homme n'est connu de tous, il n'y aura aucun homme
selon sa pensée. Il est évident que ce ne sont point ici des
subtilités de sophiste, et la doctrine de ce philosophe n'est
point éloignée de ce que je dis. Car il prétend qu'il n'y a rien
autre chose, à parler véritablement, que du vide et des atomes,
lesquels deux principes sont, à ce qu'il dit, non seulement dans les
animaux, mais encore dans tous les composés. Mais par ces principes
là nous ne pourrons pas connaître ce qui est propre à l'homme, parce
qu'ils sont communs à toutes choses, et que rien autre chose que ces
principes, ne se présente à nous. Nous n'avons donc rien par où nous
puissions distinguer l'homme d'avec les autres animaux, et en avoir
une connaissance intellectuelle qui sait claire et évidente.
Épicure dit
que l'homme a une certaine forme et est animé : et suivant ce
philosophe encore, il ne faut que montrer un homme pour le faire
connaître, et celui qu'on ne montre pas n'est pas homme. Et si un
homme montre une femme, l'homme ne sera pas homme; et si c'est une
femme qui montre un homme, la femme ne sera pas de l'espèce humaine.
Nous inférerons encore la même chose de la diversité des
circonstances, que l'on peut connaître par le quatrième des dix
moyens de l'Époque.
D'autres
philosophes disent que l'homme est un animal raisonnable, mortel,
capable d'intelligence et de science. Or comme dans le premier moyen
de l'Époque nous avons fait voir, qu'aucun animal n'est privé
de raison, et que tous les animaux sont capables d'intelligence et
de science, selon ce que les dogmatiques disent eux-mêmes ; nous ne
saurons pas ce qu'ils veulent dire par leur définition de l'homme.
De plus: ou bien ils diront que ces accidents qu'ils ajoutent dans
la définition, sont dans l'homme actuellement ; ou bien ils diront
qu'ils y sont seulement en puissance. S'ils y sont actuellement,
celui-là ne sera pas homme qui n'aura pas encore une science
parfaite, ni une parfaite raison, et qui n'est pas dans l'état de
mort; car c'est là être actuellement mortel. Que s'ils disent que
ces accidents sont dans l'homme seulement en puissance, celui-là ne
sera donc point homme qui a une parfaite raison, et qui a acquis une
grande science et une grande intelligence, ce qui est encore plus
absurde, que ce que nous disions auparavant. Il paraît donc que nous
ne pouvons avoir aucune notion de l'homme.
Aussi, quand
Platon veut que l'homme soit un animal sans plumes, à deux pieds, à
larges ongles, capable de science, ou de conduite politique; il ne
prétend pas dire cela affirmativement : car homme étant selon lui du
nombre des choses qui naissent ou qui se forment toujours, et qui ne
sont pas encore véritablement ; comme on ne peut rien prononcer
affirmativement touchant ce qui n'est pas encore, comme il le dit
lui même, il s'ensuit qu'il n'aurait pas voulu passer pour avoir
donné cette définition précédente d'un ton affirmatif, et qu'il ne
prétendait, en la donnant, autre chose que d'approprier, selon sa
coutume, ses expressions à ce qui lui paraissait vraisemblable.
Mais
accordons leur que l'on peut avoir quelque légère idée de l'homme,
nous trouverons toujours que l'homme est une chose incompréhensible.
Il est composé d'âme et de corps; mais le corps et l'âme sont deux
choses incompréhensibles : donc le tout, qui est l'homme, l'est
aussi.
Prouvons que
le corps est incompréhensible. Les accidents d'une chose sont
différents de la chose dont ils sont les accidents: ainsi quand une
couleur, ou quelque chose de semblable se présente ou se fait sentir
à nous, la raison veut que nous disions qu'il n'y a que les
accidents, qui se font sentir à nous, et non pas le corps même.
D'ailleurs on dit que le corps a trois dimensions: nous devons donc
comprendre la longueur, la largeur, et la profondeur. Mais si la
profondeur se présentait à nos sens, nous connaîtrions quand de l'or
serait argenté : ainsi le corps est incompréhensible.
Maintenant
laissant là le corps, nous trouverons que l'homme est
incompréhensible par ce que son âme l'est. Voici comme nous nous en
convaincrons. Pour passer sous silence les disputes infinies et
inexplicables des philosophes, qui ont disputé touchant l'âme ; les
uns ont dit que l'âme n'est rien, qu'elle n'existe pas, comme entre
autres Dicéarque de Messénie; d'autres ont dit qu'elle existe; et
d'autres se sont abstenus de juger de cette controverse. si les
dogmatiques disent que la décision de cette dispute est impossible ;
il faudra qu'ils accordent que l'âme est une chose incompréhensible.
S'ils disent qu'elle peut être décidée, qu'ils disent par quel moyen
ils la décideront. Ils ne le peuvent pas par les sens, puisqu'ils
prétendent qu'elle doit être conçue et connue par l'entendement, et
par la raison. S'ils disent que cette question sera décidée par
l'entendement ; nous répondrons qu'il n'y a rien dans l'âme dont on
sait moins certain que de l'existence et de la nature de
l'entendement, comme on le peut voir par ceux, qui conviennent bien
entre eux de l'existence de l'âme, mais qui sont en grande dispute
les uns avec les autres à l'égard de l'entendement. Si donc ils
veulent comprendre ce que c'est que l'âme par l'entendement et
décider par ce moyen la controverse de l'âme; ils prétendront juger
et éclaircir une chose contestée par une autre chose, qui l'est
encore plus, ce qui est absurde. Ainsi on ne pourra pas décider, non
pas même par le raisonnement, la controverse de l'âme : et par
conséquent il n'y aura rien où on la puisse décider. Ce qui étant
ainsi, il faut avouer que l'âme est une chose incompréhensible :
d'où il suit que l'homme aussi est une chose incompréhensible.
Mais
accordons encore que l'on comprenne ce que c'est que l'homme. Je dis
qu'après tout on ne pourra peut-être prouver en aucune manière que
l'homme doive être le juge de la vérité des choses ; le
Critérium a quo. Car si quelqu'un veut dire que les choses
doivent être décidées par l'homme, ou il avancera cela sans
démonstration, ou il le prouvera par une démonstration. Mais il ne
peut pas dire cela avec démonstration ; car il faut que sa
démonstration sait jugée et reconnue pour vraie: mais, comme nous
n'avons point encore de juge reconnu et avoué, par qui cette
démonstration puisse être jugée, puisque nous le cherchons; nous ne
pouvons point juger de la démonstration, ni par conséquent démontrer
que l'homme fait le juge, ou le Critérium a quo, dont il
s'agît maintenant. Que si on dit sans démonstration que les choses
doivent être jugées par l'homme; on ne méritera pas d'être cru.
Ainsi nous ne pourrons point assurer que l'homme fait le juge du
vrai et du faux, ou le Critérium a quo.
Mais encore,
qui est-ce qui pourra juger que l'homme soit le juge, du vrai et du
faux? Si on dit que l'homme est le juge, sans que cela ait été jugé
comme vrai, on ne méritera pas d'être cru ; et si on prouve qu'il
est le juge, parce que cela a été jugé ainsi par l'homme, on prendra
pour preuve cela même qui est en controverse. Que si on dit que
cela a été jugé par quelque autre animal, comment pourra-t-on
admettre cet animal, pour juger que l'homme est le juge de la
vérité? Car si cet animal juge, sans que son jugement ait été
reconnu et jugé comme vrai, on ne le croira pas : que si son
jugement est approuvé, on demandera par qui. S'il est approuvé par
l'animal lui-même, c'est la même absurdité que ci-dessus ; et s'il
est approuvé par un homme, voilà le Diallèle, ou le cercle vicieux.
Que si le jugement de cet animal est approuvé par quelque autre
que par lui même, et que par l'homme, il faudra chercher un juge qui
décide de la validité de ce jugement, et ainsi de suite à l'infini.
Ainsi nous ne pourrons jamais dire, que les choses doivent être
jugées par l'homme.
Accordons
néanmoins que l'on dise et que l'on croie que les choses doivent
être jugées par l'homme. Comme il y a une grande diversité entre les
hommes, nous demanderons d'abord que les dogmatiques conviennent
entre eux, s'il faut suivre le sentiment de cet homme-ci, ou de
celui-là, avant que d'exiger que nous suivions aussi le sentiment de
cet homme. Mais s'il est vrai, que tant que l'eau coulera, tant que
les arbres porteront des feuilles, ils disputeront pour savoir qui
d'entre eux doit être le juge des choses; comment peuvent-ils nous
presser avec tant de hardiesse de suivre le sentiment de qui que ce
soit?
S'ils disent
qu'il faut ajouter foi au sage. A quel Sage leur demanderons-nous?
Est-ce à celui, qui est sage selon Épicure ; ou à celui qui est sage
selon les Stoïciens ; ou à celui qui fera de la secte de philosophes
Cyniques? jamais ils ne s'accorderont pour nous donner une réponse.
si quelqu'un nous demande que nous laissions là la question du sage,
et que nous ajoutions foi à celui qui est plus prudent que tous les
autres; d'abord les dogmatiques se diviseront entre eux pour savoir,
lequel est le plus prudent : mais ensuite quand on voudrait
accorder, que du commun consentement de tous les dogmatiques, on en
peut trouver quelqu'un qui surpassé en prudence tous ceux qui sont
et qui ont été, ce quelqu'un là ne sera pas encore pour cela digne
de foi. Car comme il y a des degrés presque infinis de perfection,
ou d'imperfection dans la prudence, nous répondrons que cet homme,
si l'on veut, est plus prudent que ceux qui ont été et qui sont à
présent, mais qu'il se peut faire qu'il vienne quelqu'un dans la
suite qui sera plus prudent que lui. Comme donc on exige de nous,
que nous ajoutions foi à celui qui passe aujourd'hui pour plus
prudent que ceux qui sont et qui ont été, à cause de sa prudence ;
ainsi il faut attendre d'ajouter foi plutôt à celui qui viendra, et
qui sera plus prudent que celui à qui on veut que nous ajoutions foi
aujourd'hui. Et quand cet homme là sera venu, on pourra encore
espérer qu'il y en aura un autre après lui plus prudent que lui, et
encore un autre plus prudent que celui que l'on attend, et ainsi
jusqu'à l'infini.
De plus on ne
peut pas savoir si ces hommes prudents que l'on attend,
s'accorderont avec celui d'à présent ; ou s'ils débiteront des
choses contraires et opposées: ainsi encore que l'on avouerait qu'il
y a quelque homme plus prudent que ceux qui sont, et qui ont été,
comme nous ne pourrons pas assurer qu'il n'y en aura aucun plus
prudent que cet homme, (car cela est obscur) il faudra toujours
attendre le jugement d'un homme plus prudent qui pourra venir, et ne
jamais acquiescer à celui qui est actuellement le plus habile homme.
Accordons
encore qu'il n'y a eu, et qu'il n'y aura jamais aucun homme plus
prudent que celui que l'on suppose être le plus prudent de tous; je
dis que, quand cela serait, il n'est point à propos de le croire.
Car comme ceux qui ont de la prudence, ont de coutume plus que les
autres, en établissant leurs sentiments, de faire en sorte que les
opinions défectueuses dont ils entreprennent la défense, paraissent
vraies et exemptes de défauts; quand cet habile homme, que l'on
suppose, nous affirmera quelque chose, nous ne saurons pas s'il nous
l'expose telle qu'elle est de sa nature, ou s'il n'avance pas comme
vrai, ce qu'il fait être faux : nous ne saurons pas s'il ne nous
veut pas faire croire, comme vraie, une chose fausse : vu qu'étant
plus habile homme que tous les autres, nous ne saurions le réfuter.
C'est pourquoi, quoiqu'il passe pour le vrai juge des choses, nous
ne l'en croirons pas davantage, parce que nous penserons qu'à la
vérité il se vante de dire vrai dans tout ce qu'il dit, mais que
peut-être il a intention de nous faire croire des choses fausses
comme vraies, ce qui lui est facile à cause qu'il a beaucoup
d'esprit et de subtilité.
Voilà les
raisons pour lesquelles on ne doit point ajouter foi à celui là même
qui serait le plus habile et le plus subtil de tous les hommes,
lorsqu'il s'agit de juger des choses. Si maintenant quelqu'un
prétendait qu'il faut s'en rapporter au consentement de plusieurs,
nous répondrons que c'est là une prétention vaine. Car premièrement
le vrai, est peut-être rare, et il se peut faire qu'un seul homme
sait plus prudent que plusieurs. Ensuite il y a plus de personnes
qui soient discordantes entre elles sur la question de la règle du
vrai, qu'il n'y en a qui s'accordent sur ce point : car ceux qui
nous ont donné quelque règle que ce fait de vérité, différente de
celle dont il semble que les autres conviennent, contredisent à
cette règle reçue, et ils sont tous ensemble en plus grand nombre
que ceux qui reçoivent celle là d'un commun consentement.
De plus ceux
qui s'accordent ensemble recevoir une règle de vérité, sont ou
affectés diversement, ou affectés d'une même manière. On ne peut pas
dire qu'ils soient affectés diversement, au moins par rapport au
consentement qui est entre eux sur cette règle: car comment
pourraient-ils dire en ce cas là la même chose touchant une même
chose ? Que s'ils sont affectés d'une seule et même manière, tout de
même aussi, et celui qui est d'un sentiment différent, est affecté
d'une seule manière, et ceux qui s'accordent avec lui sont tous
affectés d'une seule et même manière : d'où il suit qu'eu égard aux
manières dont nous sommes affectés ou aux dispositions que nous
suivons, il n'y a point de différence entre la manière dont une
multitude est affectée, et entre celle dont un seul homme est
affecté. Ainsi il ne faut pas suivre plusieurs plutôt qu'une seule
personne.
Je ne dis
rien de la différence incompréhensible des jugements, qui se trouve
dans une aussi grande multitude qu'est celle des hommes, comme je
l'ai dit dans le quatrième moyen de l'Époque ; y ayant une
quantité innombrable d'hommes, si on les prend chacun en
particulier, et n'étant pas possible de parcourir tous leurs
jugements, et de prononcer ensuite quels jugements sont appuyés sur
plus ou sur moins de voix parmi tous les hommes. D'où il suit
encore, qu'il est absurde de préférer quelques juges à d'autres sous
prétexte qu'ils sont en plus grand nombre.
Concluons de
tout ce que si nous avons dit, que le Critérium a quo, ou le
juge du vrai et du faux, est une chose incompréhensible. Or comme ce
Critérium renferme les deux autres, un chacun d'eux étant ou une
partie, ou une disposition passive, ou une action de l'homme que
l'on suppose être le Critérium a quo, il aurait peut-être été
à propos de les omettre pour passer à d'autres choses ; ce que nous
avons dit sur le premier, paraissant suffire pour les deux autres.
Mais afin que l'on ne croie pas que nous voulons éviter de réfuter
en particulier ce que les dogmatiques disent du Critérium per
quod et du Critérium secundum quod, nous en dirons
quelque chose par surabondance de droit, en commençant par le
Critérium per quod.
Chap. VI. Du Critérium
per quod, c'est-à-dire, de l'instrument par lequel en prétend
juger de la vérité.
Il y a eu
parmi les dogmatiques une grande controverse et presque infinie, sur
cette question de l'instrument par lequel on doit juger des choses.
Mais pour observer ici une méthode juste, nous dirons que, supposé,
comme ils le prétendent, que l'homme fait le juge des choses, il n'y
a en lui que son entendement et ses sens, dont il puisse se servir
pour en juger, comme eux-mêmes l'avouent. si donc nous montrons
qu'il ne peur pas juger des choses par ses sens seulement, ni par
son entendement seul, ni par tous deux ensemble, nous renverserons
toutes leurs opinions particulières tout à la fois; car elles
peuvent être toutes réduites à ces trois.
Commençons
par les sens. Quelques-uns assurent que les perceptions passives des
sens sont vaines, que rien de tout ce qu'ils semblent apercevoir
n'est l'objet de leurs perceptions : quelques autres disent, que
toutes les choses par lesquelles ils croient être mas, sont
réellement à eux : et il y en a encore d'autres qui croient que
quelques-unes de ces choses là sont aperçues par les sens réellement
telles qu'elles sont, et non pas quelques autres. Dans une si
grande diversité de sentiments nous ne saurions savoir qui sont ceux
à qui nous devons ajouter foi : car nous ne déciderons pas cette
controverse par les sens, puisque nous disputons si leurs
perceptions sont vaines ou si elles sont fondées sur la vérité et
sur la nature: mais nous la déciderons pas non plus par un autre
moyen, puisque selon la supposition que les sens seuls sont les
instruments par lesquels nous jugeons des choses, il n'y a aucun
autre instrument de jugement dont nous puissions nous servir. Ce
fera donc une chose que l'on ne pourra décider, et qui fera
incompréhensible, de savoir si nos sens sont affectés d'une
perception vaine, ou si cette perception est causée par quelque
chose de réel. Ce qui étant ainsi, il s'enfuit que pour juger des
choses nous ne devons pas employer les sens seuls, puisque nous ne
pouvons pas dire qu'ils aperçoivent quoi que ce soit de réel.
Accordons néanmoins que les sens ont la faculté d'apercevoir : on ne
pourra point encore s'y fier, s'il s'agit de juger des objets
extérieurs des sens ; car les sens sont mus d'une manière contraire
par de mêmes objets sensibles et extérieurs. Par exemple, le goût à
la présence du miel, a tantôt un sentiment d'amertume, et tantôt une
sensation de douceur : la vue aperçoit quelquefois un même corps
comme s'il était de couleur de sang, et quelquefois comme s'il était
blanc : l'odorat n'est pas toujours d'accord avec lui même ; car un
homme qui est sujet aux maux de tête, trouve désagréable le parfum
liquidé ; qu'il trouve agréable s'il est autrement affecté : les
inspirés et les frénétiques s'imaginent entendre des gens qui leur
parlent, gens que nous n'entendons pas ; et une même eau peu chaude
paraît incommode à ceux qui ont quelque inflammation, étant
appliquée sur la partie enflammée, qui ne paraît que tiède aux
autres.
Dira-t-on que
toutes les apparences des sens, ou que toutes les imaginations sont
vraies ; ou dira-t-on qu'elles sont en partie, vraies et en partie
fausses ? Car de dire qu'elles sont toutes fausses, nous ne le
pouvons pas, n'ayant aucune règle du vrai approuvée sans
contestation, par laquelle nous puissions juger quel sentiment nous
devons préférer aux autres; outre que nous n'avons aucune
démonstration vraie et jugée telle, puisque nous cherchons encore
une règle de vérité, par laquelle nous devons juger de la vérité de
la démonstration.
Ainsi si
quelqu'un prétend qu'il faut ajouter foi aux sens, quand ils sont
dans leur état naturel, et non quand ils n'y sont pas, il dira une
absurdité. Car s'il dit cela sans rien démontrer, on ne le croira
pas, et s'il le veut démontrer, il ne le pourra pas, à cause de ce
que nous avons dit, qu'on ne peut pas avoir à cet égard une
démonstration vraie qui fait reconnue et jugée telle. Mais de plus,
quand on accorderait que les perceptions de ceux qui sont dans leur
état naturel, sont dignes de foi, mais non pas de ceux qui n'y sont
pas ; on trouvera encore après cette concession, qu'il est
impossible de juger par les sens seuls des objets extérieurs. Car la
vue, lors même qu'elle est dans son état naturel, nous représente
une même tour quelquefois ronde et quelquefois carrée: et le goût
représente les mêmes viandes comme désagréables à ceux qui sont
rassasiés, qu'il représente comme agréables à ceux qui ont bon
appétit: et l'ouïe aperçoit de nuit comme forte une voix qui paraît
faible et sourde en plein jour : une odeur qui paraît désagréable à
la plupart du monde, ne paraît point cela aux couroyeurs : et à
l'égard du toucher, avant que d'entrer dans l'appartement chaud du
bain, on a chaud dans l'appartement tiède qui y joint, et on a froid
dans ce même appartement tiède, au sortir de l'appartement chaud.
Puis donc que les sens mêmes qui sont dans leur état naturel, sont
sujets à avoir des perceptions contraires des mêmes objets, et qu'il
n'est pas possible de décider cette controverse, parce que l'on n'a
point un juge avoué et reconnu indubitablement pour juger des
apparences des sens; c'est une conséquence qu'il faut toujours
rester dans les mêmes doutes. On pourrait, pour confirmer ce que je
dis, rapporter ici plusieurs choses que nous avons dites en parlant
des moyens de l'Époque ; mais ceci suffit pour faire voir,
que peut-être n'est-il pas vrai que les sens seuls puissent juger
des objets extérieurs. Ainsi passons à l'entendement.
Ceux qui
veulent que l'on suive l'entendement seul pour juger des choses,
doivent prouver d'abord qu'il y a un entendement. Mais ils ne
pourront jamais faire comprendre que cela puisse être démontre.
Gorgias dit que rien n'existe, non pas même l'entendement; et
d'autres disent que l'entendement est une chose existante. Comment
décideront-ils cette controverse? Ce ne fera pas par l'entendement,
autrement ils usurperont, comme déjà prouvé, ce qui est en question.
Ce ne sera pas non plus par autre chose, puisqu'ils supposent ici
qu'on doit se servir de l'entendement seul pour juger des choses.
C'est donc une chose que l'on ne peut décider, et qui est
incompréhensible, de savoir si l'entendement existe ou non. D'où on
peut conclure qu'il ne faut pas suivre l'entendement seul dans le
jugement des choses, puisqu'on ne l'a pas encore compris, et qu'on
ne peut pas prouver s'il existe.
Mais
accordons que l'on conçoive ce que c'est que l'entendement, et que
son existence fait une chose avouée : je dis qu'il ne peut pas juger
des choses. Car s'il ne connaît pas exactement lui-même, s'il est
douteux et discordant avec lui même lors qu'il s'agit de définir
quelle est sa nature, son origine, le lieu où il est ; comment
pourra-t-il comprendre exactement quoi que ce soit des autres
choses.
Ensuite quand
on accorderait que l'entendement a la faculté de discerner et de
juger; comment pourrons nous trouver le moyen de nous en servir pour
bien juger ? Il y a une diversité d'entendements : autre est celui
de Gorgias, suivant lequel il dit que rien n'existe : autre est
celui d'Héraclite, selon lequel il dit que toutes choses existent:
(qu'il n'y a point de fausses apparences :) autre est celui de ceux
qui disent qu'il y a quelques choses qui existent, et quelques
autres qui n'existent pas. Nous ne saurions trouver aucun moyen de
choisir avec discernement entre ces différences des entendements, et
nous ne pourrons point dire s'il nous faut suivre l'entendement de
celui-ci plutôt que l'entendement de celui-là. Car si nous
entreprenons de juger par quelqu'un de ces entendements
particuliers, alors en nous joignant à un parti opposé aux autres,
nous usurperons, comme déjà prouvé, ce qui est en dispute entre tous
: et si nous voulons juger par quelque autre chose que par
l'entendement, nous nous écarterons de la thèse, qui dit qu'il faut
juger des choses par l'entendement seul.
Outre cela,
on peut démontrer, suivant ce que nous avons dit en parlant du
Critérium a quo, que nous ne pouvons pas savoir quel est
l'entendement qui est le plus pénétrant de tous,et que, quand nous
aurions trouvé un entendement plus pénétrant que tous ceux qui sont
et qui ont été, nous ne devrions pas pour cela suivre son jugement ;
parce qu'il est incertain, s'il n'en viendra point encore quelque
autre plus pénétrant que celui là. Enfin quand on supposerait un
entendement qui surpasserait tous les autres par sa pénétration et
par son discernement, cependant nous n'accorderons point notre
assentiment à celui qui jugera par cet entendement là, dans la
crainte que nous aurons, que cet homme ayant un entendement fort
subtil, ne nous veuille persuader comme vraie, une fausse raison
qu'il nous débitera. Concluons et disons que l'entendement seul ne
peur pas juger des choses.
Il reste à
dire que nous devons juger des choses par les sens et par
l'entendement ensemble. Mais cela ne se peut encore ; tant s'en faut
que les sens dirigent l'entendement, comme de sûrs guides pour
parvenir à la connaissance des choses, qu'au contraire ils lui sont
souvent opposés. parce que le miel est amer aux uns et doux aux
autres, Démocrite dit qu'il n'est ni doux ni amer ; et Héraclite dit
qu'il est l'un et l'autre. Il faudra raisonner de même des autres
sens, et des choses qui s'aperçoivent par les sens. Si donc
l'entendement se règle sur les rapports des sens, il faudra qu'il
dise des choses toutes contraires et opposées les unes aux autres:
or cela ne convient pas à une règle de vérité qui aurait la faculté
de faire comprendre la vérité et de la distinguer d'avec la
fausseté.
Mais encore,
faudra-t-il que nous jugions des choses par les sens et par les
entendements de tous les hommes, ou seulement par ceux de quelques
uns. La première de ces choses est impossible, vu les discordances
infinies qui se rencontrent dans les sens et dans les entendements
de tous ; outre que dans cette universalité, l'entendement de
Gorgias y est compris, lequel entendement prononce qu'il ne faut
suivre ni le jugement des sens, ni celui de l'entendement: ce qui
fait que l'on s'exposerait à une fâcheuse rétorsion, si on soutenait
qu'il faut suivre les entendements et les sens de tous.
Que si on dit
que nous devons juger des choses seulement par les entendements et
par les sens de quelques uns; comment pourra-t-on juger qu'il faut
s'attacher à ces sens et à ces entendements en particulier et non
pas à d'autres ; vu que ceux qui voudraient dire cela, n'ont point
de règle certaine et démontrée, par laquelle ils puissent juger de
la diversité des sens et des entendements ? S'ils disent que nous
devons juger des sens et des entendements par les sens et par les
entendements ; ils usurperont, comme prouvé et comme reçu pour règle
de jugement, cela même dont on dispute.
Ajoutons
encore ceci. Faudra-t-il juger des sens et des entendements par les
sens, ou des sens et des entendements par les entendements ; ou des
sens par les sens, et des entendements par les entendements; ou des
entendements par les sens, et des sens par les entendements.? Si on
veut juger des sens et des entendements, ou par les sens seuls ou
par l'entendement seul, on sortira de la thèse qui dit qu'on doit
juger par les sens et par l'entendement joints; et choisissant ou
les sens seuls ou l'entendement seul, on s'exposera aux difficultés
que nous avons marquées ci dessus. Si on juge des sens par les sens
et des entendements par les entendements; comme les sens sont
opposés aux sens et les entendements aux entendements, si l'on
choisit quelque chose dans cette discordance des rapports des sens
pour juger des autres rapports des sens, on usurpera, comme prouvé,
ce qui fait une partie de la dispute, et qui est une raison de
douter: on l'usurpera, dis-je, pour juger des choses qui ne sont pas
plus controversées, que ce que l'on prendra pour en juger. Appliquez
ceci aux entendements qui sont aussi contraires les uns aux autres.
Que si on veut juger des entendements par les sens, et des sens par
l'entendement, on prouvera réciproquement l'une par l'autre deux
choses également contestées et obscures ; on tombera dans le
Diallèle, suivant lequel il faudra pour juger des sens, avoir
auparavant jugé des entendements, comme il fera nécessaire pour
examiner les entendements, d'avoir auparavant examiné les sens.
Puis donc que
l'on ne peut juger d'aucune de ces deux régλes prétendues de vérité
par aucune règle de même genre, ni de toutes deux ensemble par une
seule des deux, ni, en permutant, de la première par la seconde, et
de la seconde par la première; nous ne pourrons point préférer un
entendement à un autre, ni un sens à un autre semblable sens : et
par conséquent nous n'aurons point de règle pour juger de quoi que
ce fait. Car si nous ne pouvons juger par les sens et par les
entendements de tous, et si nous ignorons par quels entendements et
par quels sens nous devons juger ; il ne nous restera plus rien dont
nous puissions nous servir pour juger; et par conséquent il ne
pourra point y avoir de Critérium per quod, ou d'instrument
pour parvenir à la connaissance de la vérité.
Chap. VII. Du Critérium
secundum quod, c'est-à-dire, de l'exemplaire suivant lequel on
doit juger des choses.
Examinons
maintenant l'exemplaire suivant lequel on prétend que l'on juge des
choses. Voici d'abord ce que nous en pouvons dire: c'est que nous ne
pouvons pas avoir une connaissance même légère et imparfaite de
l'évidence, que quelques dogmatiques disent être cet exemplaire. Les
stoïciens disent que l'évidence est une impression dans la partie
principale de l'âme. Comme donc l'âme et la principale partie de
l'âme sont, selon eux, une espèce de souffle ou de respiration
légère, ou quelque chose de plus subtil que ce souffle ou que cette
espèce d'air, on ne saurait s'imaginer qu'elle puisse être capable
de recevoir aucune impression fait par l'enfoncement, fait par
l'élévation des parties, ou par une certaine vertu altératrice
qu'ils ont monstrueusement inventée. Car, si cela était, l'âme ne
pourrait pas conserver la mémoire de tant de préceptes qui composent
une science ou un art, lorsque de nouvelles altérations survenant,
les premières seraient effacées par les secondes.
Mais, encore
que l'on pût avoir quelque notion de l'évidence, elle ferait
néanmoins incompréhensible. Car l'évidence étant une passion ou une
impression passive dans la principale partie de l'âme, et cette
principauté de l'âme étant incompréhensible, comme nous l'avons fait
voir, nous ne comprendrons pas non plus cet état passif. Ensuite
quand nous accorderions que l'évidence est compréhensible, il ne
s'ensuit pas que nous puissions juger des choses par son moyen. Car
l'âme ne s'applique pas par elle même aux objets de dehors, et elle
ne conçoit pas les images des choses, par elle même, mais par les
sens; et les sens ne conçoivent peut-être pas les objets extérieurs,
mais seulement leurs propres perceptions passives. Ainsi
l'imagination sera seulement conforme à la perception passive des
sens, laquelle passion est différente de l'objet extérieur. Car le
miel n'est pas la même chose que la perception de douceur que j'ai
en mangeant du miel : et l'absinthe est toute différente de la
perception d'amertume que ce breuvage me cause. Or si la perception
passive est différente de l'objet extérieur, l'imagination frappée
ne sera pas une représentation de cet objet, mais de quelque chose
qui en sera toute différente. Si donc l'entendement juge sur cette
représentation, il jugera mal, et non conformément à l'objet réel
qui est présent aux sens. C'est pourquoi il est absurde de dire que
l'on puisse juger des objets de dehors, sur le rapport de l'évidence
qui est l'impression de l'âme. Car d'où est-ce que l'entendement
saura si les perceptions passives des sens sont semblables aux
choses qui s'aperçoivent par les sens, n'ayant par lui-même aucun
commerce avec les choses de dehors, et les sens ne lui représentant
point la nature de ces choses, mais seulement leurs propres
perceptions à eux-mêmes, comme on le peut voir par ce que nous avons
dit en parlant des moyens de l'Époque, au quatrième moyen ?
Car comme celui qui ne connaît point Socrate, mais qui a vu son
portrait, ne sait pas si cette image ressemble à Socrate ; ainsi
l'entendement considérant les perceptions des sens, mais ne voyant
pas les objets de dehors, ne pourra pas savoir si les passions des
sens sont semblables à ces objets ; et par conséquent il ne pourra
pas juger de ces objets sur le rapport de la faculté compréhensive
de l'âme, non pas même par voie de ressemblance.
Donnons
néanmoins par concession non seulement, que nous puissions nous
imaginer et comprendre ce que c'est que l'imagination convaincue par
l'évidence, mais encore, quelle est capable de juger des choses;
(quoique nous ayons fait voir le contraire:) il s'ensuivra de là
qu'il faudra ajouter foi à quelque imagination que ce fait, et aussi
par conséquent à celle, suivant laquelle quelqu'un assurera que
toutes les imaginations sont indignes que l'on y ajoute foi. Mais
par là on s'exposera à cette rétorsion, qui consistera à dire, que
toutes les imaginations, évidentes tant qu'il vous plaira, ne
méritent pas tellement d'être crues, que l'on puisse juger des
choses suivant leur rapport.
Que si l'on
doit ajouter foi seulement à quelques imaginations évidentes,
comment connaîtrons nous que l'on doit ajouter foi à celles ci, et
non pas à celles là ? Car si on juge de cette difficulté sans le
secours de l'imagination, on accordera tacitement, que cette faculté
compréhensive est superflue pour juger des choses ; puisque l'on
avouera que l'on peut juger de quelques choses sans son aide. Mais
si on doit juger des choies avec le secours de la faculté
compréhensive, comment prendrons nous une faculté compréhensive
particulière, qui n'est ni jugée, ni prouvée, pour nous servir à
juger des autres facultés compréhensives ? Il faudra que ceux qui en
agiront ainsi, se servent d'une imagination pour juger des autres,
et puis d'une seconde imagination pour juger de cette première, et
ainsi de fuite jusqu'à l'infini. Mais on ne peut pas juger de cette
enchaînure infinie de preuves. On ne peut donc trouver en aucune
manière quelles sont les facilités compréhensives, que l'on doit
employer comme des règles de vérité, et quelles sont celles dont on
ne doit point se servir.
En un mot, si
nous accordons que l'on doit juger des choses selon le rapport des
fantaisies ou des imaginations, nous rétorquerons toujours ; et soit
que l'on veuille que l'on ajoute foi à toutes, du bien à quelques
unes seulement, et non pas à d'autres, nous en conclurons toujours
que l'on ne doit pas prendre les imaginations compréhensives comme
règles de vérité pour juger des choses.
En voilà
allez pour ce court traité sur le Critérium secundum quod, ou
sur la règle du vrai et du faux, suivant laquelle on prétend que
l'on doit juger des choses. Au reste il faut savoir que nous ne
prétendons pas prouver qu'il n'y a aucune règle de vérité, (car ce
serait là une assertion dogmatique) mais, parce que les dogmatiques
assurent sur des raisons qui ne sont que probables, qu'il y a
quelque règle de vérité, nous leur avons opposé des raisons
probables. Nous ne voulons pas assurer néanmoins que nos raisons
soient vraies, ou plus probables que celles qui leur sont contraires
; mais à cause de leur probabilité, qui nous paraît être égale à
celle des raisons que les dogmatiques établissent, nous concluons
que nous devons nous abstenir de prendre parti, et de juger.
Chap. VIII. Du Vrai et de la
Vérité.
Quand nous
accorderions par supposition qu'il y a quelque règle de vérité, il
se trouvera qu'elle sera inutile et vaine, si nous montrons par les
dogmatiques eux-mêmes, que la Vérité n'existe point, et que le Vrai
ne peut subsister. Voici comme nous montrons cela.
On dit que le
Vrai est différent de la Vérité en trois manières, par sa substance,
par sa constitution et par sa puissance. Par sa substance parce que
le vrai est incorporel, le Vrai n'étant ou qu'une énonciation
proprement dite, ou que quelque dit en général ; mais la
Vérité est un corps, étant une science par laquelle on prononce ou
on énonce tout ce qui est vrai. Car la science est l'âme elle même
disposée d'une certaine manière, comme le poing est une certaine
disposition de la main : mais l'âme est un corps, ou un souffle
léger et subtil selon les dogmatiques.
On dit que le
Vrai est différent de la Vérité par sa constitution, parce que le
Vrai est quelque chose de simple; comme, je dispute: mais la
Vérité consiste dans la connaissance de plusieurs choses vraies. On
dit que le Vrai est différent de la Vérité en puissance ou en vertu,
parce que la Vérité est accompagnée nécessairement de science, ce
qui n'est pas nécessaire pour le Vrai. D'où vient que les
dogmatiques disent que la Vérité ne se trouve que dans le sage, et
que le Vrai se trouve dans le fou : car il peut arriver qu'un fou
dise quelque chose de vrai.
Voilà ce que
disent les dogmatiques. Mais nous, eu égard au dessein que nous nous
sommes proposé d'être courts, nous ne parlerons que du Vrai : parce
que le Vrai renferme ou suppose la Vérité, qui est un amas de
connaissances ou de choses vraies. Derechef, comme il y a des
raisons générales par lesquelles nous attaquons l'existence du Vrai,
et des raisons particulières, par lesquelles nous prouvons que le
Vrai n'existe pas dans le discours extérieur, ni dans l'idée ou la
notion de l'entendement, nous nous contenterons d'expliquer pour le
présent les raisons les plus générales. Car, comme le fondement d'un
mur étant ruiné, tout ce qui était appuyé dessus est renversé ; de
même aussi en renversant l'opinion de l'existence du Vrai, toutes
les subtiles inventions des dogmatiques se trouveront enveloppées
dans cette réfutation.
Chap. IX. S'il y a quelque
chose qui soit naturellement vraie.
Les
dogmatiques disputent entre eux sur le Vrai : quelques uns disent
qu'il y a quelque chose de Vrai ; et d'autres qu'il n'y a rien de
vrai. Cela étant on ne peut point décider cette controverse, parce
que si celui qui dit qu'il y a quelque chose de vrai, le dit sans
démonstration, on ne le croira pas, à cause que cela est contesté :
et s'il veut apporter une démonstration et qu'il avoue qu'elle est
fausse, il se réfutera lui-même : mais s'il dit que sa démonstration
est vraie, il tombera dans le Diallèle. (Car il prouvera qu'il y a
quelque chose de vrai par une démonstration qu'il dit être vraie
mais qu'il ne peut prouver être vraie à moins qu'il n'ait prouvé
qu'il y a quelque chose de vrai.) De plus on lui demandera une
démonstration pour prouver que sa première démonstration est vraie,
et encore une démonstration de cette seconde, et ainsi à l'infini.
Mais on ne peut point démontrer ainsi à l'infini ; et par conséquent
il faut dire qu'on ne peut connaître en aucune manière qu'il y ait
quelque chose de vrai.
Bien plus. Ce
quelque chose, qu'ils disent être le genre généralissime de
toutes choses, est ou vrai ou faux ; ou bien, il n'est ni vrai ni
faux ; ou bien il est vrai et faux tout ensemble. S'ils disent qu'il
est faux, ils avoueront que toutes choses sont fausses: car comme,
de ce que cette chose, qui est animal, est animée, il s'enfuit que
tous les animaux en particulier sont animés; de même, si le
quelque chose qui est le genre généralissime de toutes choses
est faux, toutes les choses particulières seront fausses aussi, et
il n'y aura rien de vrai ; mais de là on conclura aussi qu'il n'y a
rien de faux. Car cette proportion, toutes choses sont fausses, sera
fausse aussi parce qu'elle est quelque chose : et comme cette
proposition particulière, il y a quelque chose de faux, est
comprise dans la générale qui est fausse, elle fera fausse aussi, et
par conséquent|étant faux que toutes choses soient fausses, et qu'il
y ait quelque chose de faux, il n'y aura rien de faux.
Que si le
quelque chose généralissime est vrai:, toutes choses seront
vraies ; mais on inférera de là, qu'il n'y a rien de vrai, parce que
cette proposition, il n'y a rien de vrai, étant quelque
chose, sera vraie aussi.
Si ce
quelque chose est vrai et faux tout ensemble, toutes les choses
particulières qui sont fous ce genre feront aussi vraies et fausses
en même temps : d'où on conclura qu'il n'y a rien qui soit vrai de
sa nature, parce que ce qui est vrai par sa nature, ne peut en
aucune manière être faux.
Enfin si
ce quelque chose n'est ni vrai ni faux, il faudra avouer que
toutes les choses particulières, qui sont sous ce genre n'étant ni
vraies ni fausses, ne feront rien et n'existeront point. Voilà donc
des raisons qui nous empêchent de savoir évidemment si le Vrai
existe.
Ajoutons
encore ceci. Ou bien il n'y a que les choses évidentes qui soient
vraies, ou bien il n'y a que les choses obscures qui le soient,.ou
bien entre les choses vraies il y en a quelques unes qui sont
obscures, et quelques unes qui sont évidentes : mais rien de tout
cela n'est vrai ; comme nous le démontrerons: donc il n'y a rien de
vrai.
Si les
dogmatiques disent que les choses évidentes seulement sont vraies,
ou bien ils diront qu'elles le sont toutes, ou bien ils diront qu'il
n'y en a que quelques unes qui le soient. S'ils, disent qu'elles
sont toutes vraies, ils s'exposeront à une rétorsion : car on leur
dira qu'il paraît évident à quelques-uns qu'il n'y a rien de vrai.
S'ils disent qu'il n'y a que quelques choses évidentes qui soient
vraies, personne ne pourra dire sans quelque preuve de sa
distinction, que celles-ci soient véritables, et celles là fausses,
quoiqu'elles soient toutes évidentes. Mais en se servant de sa
preuve de distinction, ou il dira que cette preuve est évidente,ou
il dira qu'elle est obscure: or il ne peut pas dire qu'elle fait
obscure ; car on suppose ici que les choses vraies sont évidentes :
(il se réfuterait donc lui même. ) Que s'il dit que sa preuve de
distinction est évidente, comme on ne fait encore quelles choses
évidentes sont vraies et quelles choses évidentes sont fausses, sa
preuve prétendue évidente, qu'il aura prise pour la distinction des
choses vraies qui sont évidentes, aura besoin d'une autre preuve
distinctive d'évidence vraie; et celle ci d'une autre, et ainsi de
suite à l'infini : or il est impossible de juger ainsi des choses à
l'infini. On ne peut donc comprendre en aucune manière s'il n'y a
que les choses évidentes qui soient vraies.
Si quelqu'un
dit que les choses obscures seules sont vraies, il ne dira pas
qu'elles le soient toutes: car il ne dira pas, par exemple, qu'il
soit également vrai que le nombre des étoiles est pair, ou qu'il est
impair. S'il dit donc qu'il n'y a que quelques choses obscures qui
soient vraies, comment jugerons-nous que ces choses obscures-ci sont
vraies, et que ces obscures là sont fausses? On ne pourra pas en
juger par quelque chose d'évident: (car on suppose à présent que les
seules choses obscures sont vraies:) mais, si nous voulons examiner
par une chose obscure quelles sont les choses obscures qui sont
vraies et qu'elles sont les obscures qui sont fausses, cette chose
obscure aura besoin encore d'une autre chose obscure pour
l'examiner, et celle-ci d'une autre, et ainsi jusqu'à l'infini. Ce
ne sont donc pas les choses obscures seules qui sont vraies.
Nous voilà
donc réduits à dire que les choses sont en partie évidentes, et en
partie obscures ; mais c'est encore là une absurdité. Car, ou toutes
les choses tant évidentes qu'obscures sont vraies ; ou quelques
choses évidentes sont vraies, et quelques choses obscures sont
vraies. Si on dit que toutes choses, tant les évidentes que les
obscures, sont vraies, on s'exposera à une rétorsion, parce qu'il
faudra que l'on avoue aussi, qu'il est vrai qu'il n'y a rien de vrai
; et il faudra dire qu'il est vrai que le nombre des étoiles est
pair, et qu'il est vrai qu'il est impair. Que si nous disons que
quelques choses qui nous paraissent évidentes sont vraies, et que
quelques choses obscures sont vraies aussi ; comment jugerons-nous
que ces choses évidentes-ci sont vraies et que ces choses
évidentes-la sont fausses? Si nous voulons juger de cela par une
chose évidente, nous donnerons dans le progrès à l'infini : et si
nous en voulons juger par une chose obscure, comme les choses
obscures ont besoin aussi d'être examinées, comment jugerons-nous de
cette chose obscure? Sera-ce par une chose évidente? Nous tomberons
dans le Diallèle. Sera-ce par une chose obscure ? Nous tomberons
dans le progrès à l'infini.
Il faudra
dire le même à l'égard des choses obscures. Car celui qui voudra
juger de ces choses obscures, par quelque chose d'obscur, tombera
dans le progrès à l'infini, et celui qui en voudra juger par quelque
chose d'évident, tombera encore dans le progrès à l'infini, s'il
veut prouver ce qu'il a pris pour évident, par ce qui lui paraît
évident. Et s'il va de l'évident à l'obscur, pour juger de l'obscur,
il tombera dans le Diallèle. Il est donc faux que quelques choses
vraies soient évidentes, et que quelques-unes soient obscures, comme
on le prétend.
Si donc ni
les choses évidentes seules ni les choses obscures seules, ni
quelques choses évidentes, ni quelques choses obscures ne sont point
vraies, il n'y a rien de vrai. Mais s'il n'y a rien de vrai, et que
le Critérium fait une règle qui nous doive faire juger et
distinguer ce qui est vrai, ce Critérium est une chose vaine et
inutile, quand même nous dirions par concession qu'il y en a un.
Que si nous
devons nous abstenir de prononcer s'il y a quelque chose de vrai, il
en faut conclure, que ceux-là parlent témérairement qui disent que
la dialectique de la connaissance des choses vraies et fausses, et
de celles qui ne sont ni vraies ni fausses. Au reste, comme nous
avons fait voir, que l'on se saurait trouver aucune règle de vérité,
il faut dire, que personne ne saurait plus rien établir de certain
sur toutes les choses qui passent pour évidentes suivant les
décidons des dogmatiques, ni touchant celles qui passent pour
obscures. Car si nous sommes obligés de nous abstenir de juger des
choses qui passent pour évidentes, comment oserons-nous décider
touchant les choses obscures, dont les dogmatiques disent qu'ils ne
peuvent les reconnaître que par les choses évidentes ?
Néanmoins par
surcroît de preuves, nous disputerons encore sur les choses obscures
en particulier: et parce qu'il semble qu'on peut les comprendre, et
les connaître avec quelque assurance, par le moyen du signe et de la
démonstration, nous ferons voir que l'on doit s'abstenir d'accorder
son assentiment au signe et à la démonstration. Commençons par le
signe ; aussi bien est-ce un genre, qui semble renfermer dans son
étendue, la démonstration comme une espèce de signe.
Chap. X. Du Signe.
Toutes choses
sont telles (selon les dogmatiques) que les unes sont évidentes, et
les autres obscures. Les choses obscures, selon ces philosophes,
sont ou obscures tout à fait et pour toujours, ou obscures pour
quelque temps, ou obscures de leur nature. Ils disent que les choses
évidentes sont celles qui se font connaître à nous par elles mêmes ;
comme, par exemple, qu'il est jour. Ils ajoutent que les choses tout
à fait obscures sont celles dont la nature ne permet pas que nous
les comprenions ; comme de savoir si le nombre des étoiles est pair.
Que celles; qui sont obscures pour un temps sont celles qui étant
évidentes de leur nature, nous sont néanmoins obscures pour quelque
temps, à cause de certaines circonstances extrinsèques ; comme la
ville d'Athènes, où je n'ai pas encore été m'est obscurément connue
pour un temps. Que les choses obscures de leur nature sont celles
dont la nature ne permet pas qu'elles nous soient évidentes ; comme
les pores du corps que nous nous imaginons par la pensée, car on
n'aperçoit jamais ces pores par eux mêmes, mais on peut croire qu'on
les connaît par d'autres choses, comme par les sueurs ou par quelque
autre chose semblable.
Les
dogmatiques disent donc, que les choses évidentes n'ont pas besoin
de signe, parce qu'on les connaît par elles mêmes, et que les choses
tout à fait obscures n'en ont pas besoin non plus, parce qu'on ne
peut aucunement les connaître. Mais que celles qui sont incertaines
pour quelque temps, et celles qui sont incertaines de leur nature,
se connaissent par des signes, non pas toutes par de mêmes signes,
mais les incertaines, ou obscures pour un temps par des signes
d'avertissement, et celles qui sont obscures de leur nature, par
des signes d'indication ; il y a donc, selon eux, des signes
d'avertissement et des signes d'indication.
Ils appellent
signe d'avertissement, celui qui s'étant présenté quelquefois
évidemment avec la chose signifiée, et ayant été observé clairement
avec cette chose, nous en rappelle le souvenir, dès qu'il tombe sous
nos sens, quoique la chose alors fait cachée; parce qu'il a été
observé autrefois avec elle, et qu'il tombe fous les sens maintenant
avec évidence : comme on peut voir à l'égard de la fumée et du feu.
Mais le signe
d'indication est, selon eux, celui qui n'ayant point été observé
évidemment avec la chose signifiée, signifie néanmoins par sa nature
et par sa constitution, la chose dont il est le signe : comme les
mouvements spontanés, que l'on voit dans un corps sont des signes de
l'âme, que l'on n'a jamais vue par elle même avec ces mouvements.
C'est: pourquoi ils définissent ainsi ce signe. Le signe
(d'indication) est une énonciation démonstrative et convaincante,
qui est l'antécédent d'un bon Connexum, et par laquelle
quelle on découvre la vérité du conséquent du même Connexum.
Or comme il y a deux sortes de signes,, ainsi que nous l'avons dit,
nous ne les rejetons pas tous, et nous n'attaquons que le signe
démonstratif, (que j'ai appelé le signe d'indication ) comme étant
une pure invention des dogmatiques. Car le signe d'avertissement
mérite que l'on y ajoute foi dans la conduite ordinaire et dans la
pratique de la vie. Ainsi quiconque voit de la fumée, conçoit en
lui-même qu'il y a là du feu ; et en voyant une cicatrice, il dit
qu'il y a eu là une plaie. Notre sentiment n'est donc pas opposé à
l'usage commun, mais au contraire il le favorise; car nous
approuvons, sans établir aucun dogme, les choses que l'on croit
conformément à cet usage ; mais nous attaquons les fictions et les
assertions particulières des dogmatiques.
Ce que je
viens de dire était nécessaire, si je ne me trompe, pour exposer
l'état de la question. Venons maintenant à la réfutation des
dogmatiques, non pas en tâchant de montrer absolument qu'il n'y a
aucun signe démonstratif, mais seulement en rapportant les raisons
égales de part et d'autre, soit celles par lesquelles on prétend
qu'il y a un tel signe, soit celles par lesquelles on prouve qu'il
n'y en a point.
Chap. XI. S'il y a quelque
signe démonstratif ou d'indication.
Je dis que
nous ne saurions avoir la moindre idée qui fait juste de ce signe,
si l'on considère ce que les dogmatiques en disent. Les stoïciens
qui semblent avoir discouru sur ce sujet d'une manière exacte,
voulant définir ce qu'ils entendent par ce signe; disent que le
signe (démonstratif ) est l'énonciation antécédente d'un bon
Connexum, par lequel on découvre le conséquent de même
Connexum. Ils entendent par cette énonciation, un dit parfait,
qui a un sens par lui même, ou qui a une signification complète. Et
ils appellent un bon Connexurn, celui qui commençant par le
vrai, ne finit pas par quelque chose de faux. Car ou le Connexum
commence par le vrai et finit par le vrai, comme, s'il est jour,
il fait clair : ou il commence par le faux et finit par le faux,
comme: Si la terre vole, elle a des ailes : ou il commence
par le vrai et finit par le faux, comme, si la terre existe, elle
vole : ou il commence par le faux et finit par le vrai, comme,
si la terre vole, elle existe. Ils disent que de tous ces
Connexum, il n'y en a de vicieux, que celui qui commence par le
vrai et qui finit par le faux ; et que tous les autres sont vrais.
Ils appellent antécédent, la proposition qui précède dans le
Connexum, qui commence par le vrai, et qui finit par le vrai.
Enfin cet antécédent a la vertu de faire découvrir le conséquent ;
parce que, par exemple, dans ce Connexum, si cette femme a
du lait, elle a conçu, ces paroles, cette femme a du lait,
paraissent découvrit et démontrer ces autres, elle a conçu.
Voilà ce que
disent les Stoïciens. Mais à cela nous opposons premièrement, qu'il
est incertain s'il y a un dit tel qu'ils prétendent. Car comme parmi
les dogmatiques, les Épicuriens nient qu'il y ait un tel dit,
ou une telle idée ou énonciation incorporelle, différente de la
pensée déclarée par la parole, et de la chose signifiée, dans
laquelle idée ou énonciation les Stoïciens prétendent que consiste
le vrai et le faux, au contraire des Épicuriens qui font consister
le vrai et le faux dans les paroles et dans les choses ; c'est là
une controverse entre ces sectes.
Lors donc que
les Stoïciens disent que ce dit est quelque chose ; ou ils le
disent seulement par énonciation, ou bien ils le confirment par une
démonstration. S'ils se servent seulement de l'énonciation, les
Épicuriens leur opposeront une énonciation, qui leur niera que ce
dit fait quelque chose. S'ils employant la démonstration ; comme la
démonstration est composée de propositions ou d'énonciations qui
sont aussi des dits, il est évident que ce qui ne consiste
qu'en dits ne peut pas être pris pour prouver que le dit fait
quelque chose. Car comment est-ce que celui qui n'accorde pas qu'il
y ait quelque dit, accordera-t-il qu'il y ait un composé de
dits ? C'est donc prouver ce qui est en question, par ce qui
est en question, que de vouloir prouver, que le dit est quelque
chose, en se servant pour le prouver de l'existence prétendue d'un
assemblage de dits. Mais si on ne peut pas prouver ni par une
simple affirmation, ni avec une démonstration, que le dit
soit quelque chose, il n'est pas évident s'il y a quelque dit.
On dira la même chose de l'énonciation parfaite, qu'ils assurent
aussi être un dit.
Mais
peut-être que, quand on accorderait par supposition qu'il y a
quelque dit, il se trouvera néanmoins qu'il n'y a point ce
qu'ils appellent un Axiome, c'est-à-dire, une énonciation parfaite,
parce qu'elle est composée de dits qui n'existent point
ensemble. Par exemple, dans cette énonciation parfaite, s'il est
jour, il fait clair ; lorsque je dis il est jour, l'autre
partie, il fait clair, n'existe pas encore. Et lorsque je
dis, il fait clair, l'autre partie, il est jour,
n'existe plus. Si donc les composés ne peuvent pas exister, si
toutes leurs parties n'existent ensemble, et si les parties qui
composent l'énonciation parfaite n'existent point ensemble, cette
énonciation n'existera point non plus.
Mais laissant
là ces choses, je dis que l'on ne peut pas comprendre quel doit être
un Connexum pour être bon. Car Philon dit, qu'un Connexum
est bon, lorsqu'il ne commence point par le vrai pour finir par le
faux, d'où il suit que celui ci est bon, s'il est jour, je
dispute, pourvu qu'il soit jour, et que je dispute. Mais Diodore
dit que jamais il n'arrive, ni ne peut arriver qu'un bon Connexum
commence par le vrai et finisse par le faux : suivant quoi le
Connexum ci-dessus paraît être faux; parce que s'il est jour, et
que je cesse de parler, il arrivera que ce Connexum qui
commençait par le vrai et qui finissait par le vrai, commencera
maintenant par le vrai et finira par le faux, ce qui ne peut jamais
arriver à un bon Connexum, suivant Diodore. Au contraire celui-ci
sera vrai, Si les éléments des choses ne sont pas indivisibles,
les éléments des choses sont indivisibles: car commençant
toujours par une chose fausse, (qui est que les éléments des choses
ne sont pas indivisibles,) il conclut par une chose vraie, (selon la
pensée de Diodore) qui est que les éléments des choses sont
indivisibles, ou sont des atomes.
Ceux qui
veulent que l'on considère la connexion et la liaison des parties du
Connexum, disent qu'il est bon lorsque l'opposé de son
conséquent est opposé aussi à son antécédent. Suivant eux les
Connexum précédents sont vicieux: et celui-ci fera vrai :
S'il est jour', il est jour.
Mais ceux qui
jugent de la bonté du Connexum par la force de la
signification de l'antécédent, disent que le Conxexum est
vrai, lorsque son conséquent est renfermé en puissance dans son
antécédent. Selon eux, ce Connexum, s'il est jour, il est
jour, et tout autre Connexum, composé ainsi de dits
redoublés, sera peut-être faux. Car il est impossible qu'une chose
soit comprise en elle même.
C'est donc
une chose qui paraît impossible à décider, que cette controverse ;
et nous ne pouvons pas juger de la bonté des Connexum
précédents, ni simplement par quelque Connexum (car ce serait
prouver ce qui est en question, par ce qui est en question) ni aussi
par quelque démonstration. Car il semble qu'une démonstration ne
peut passer pour bonne, que lorsque sa conclusion est une suite de
la Connexion qui est entre les prémisses et la même
conclusion, (tout comme dans le Connexum, le conséquent doit
être une suite de l'antécédent) telle que pourrait être celle-ci :
S'il est jour, il fait clair : Or il est jour : Donc il fait
clair. Mais comme il est ici question de juger de la conséquence
du conséquent à son antécédent dans le Connexum, il est
évident qu'en voulant prouver cette conséquence par la démonstration
à l'égard du Connexum, on tombe dans le Dialléle. Car
pour démontrer la bonté du Connexum, on se sert d'un
argument, où on suppose que la conclusion est une suite de la
connexion qu'elle a avec ses prémisses ; au lieu que pour prouver
que cette conclusion est juste, il faudrait avoir prouvé auparavant
la bonté du Connexum ou la conséquence du conséquent à
l'antécédent. Il est donc impossible de comprendre ce que c'est
qu'un bon Connexum .
Je dis de
plus que l'on ne peut pas savoir ce que c'est que l'antécédent dans
le Connexum. Cet antécédent, à ce qu'ils disent, est la
proposition qui précède dans un Connexum qui commence par le
vrai, et qui finit par le vrai.
Or si cet
antécédent est un signe démonstratif du conséquent, ou bien ce
conséquent est manifeste, ou bien il est caché. S'il est
manifeste,il n'a pas besoin de Signe qui le démontre, et on le
comprendra tout d'un coup avec l'antécédent, par lequel il ne sera
point signifié; de sorte que l'antécédent n'en sera point le signe.
Que si le conséquent est caché; comme il est impossible de juger à
l'égard des choses cachées quelles sont celles d'entre elles qui
sont vraies, ou qui sont fausses, ou s'il y en a aucune d'elles qui
soit vraies, il sera incertain si ce que dit le Connexum
touchant son conséquent occulte ou obscur, sera vrai. Or de là on
tirera encore cette conséquence ; que c'est une chose obscure, de
savoir si ce qui est mis dans le Connexum comme l'antécédent,
l'est effectivement.
Mais laissons
ces choses. Je dis que l'antécédent ne peut être un signe
démonstratif ou explicatif du conséquent. Car le conséquent est la
chose signifiée par rapport à son signe, et ainsi il est connu et
compris tout ensemble avec son signe ; puisque ce qui se rapporte à
quelque chose est connu avec elle : et comme on ne peut pas
comprendre le côté droit avant le gauche, ni au contraire le gauche
avant le droit, ce qui se doit dire de toutes les choses qui ont
quelque relation à une chose, ainsi on ne peut pas connaître le
signe avant la chose signifiée. Si donc le signe ne peut pas être
compris ou connu avant la chose signifiée, il ne peut pas tenir lieu
de démonstration à l'égard de cette chose qui est comprise et connue
avec lui, et non pas avant lui. Ainsi à ne considérer même que les
sentiments des dogmatiques, le signe est une chose que l'on ne
saurait concevoir. Car ils disent qu'il se rapporte à quelque chose,
et qu'il est démonstratif de ce à quoi ils disent qu'il se rapporte
; d'où il suit que s'il se rapporte à quelque chose, qui est la
chose signifiée, il est nécessaire qu'on ne connaisse avec la chose
qu'il signifie, comme le côté gauche se connaît en même temps que le
droit, et le dessus en même temps que le dessous, et comme tous les
relatifs, en même temps que leurs corrélatifs. Mais s'il est
explicatif de ce qu'il signifie, il faut absolument que l'on le
connaisse avant ce qu'il explique, afin qu'étant connu le premier,
il nous conduise à la connaissance de ce qu'il fait connaître. Or on
ne peut pas concevoir une chose qui soit telle, qu'on ne puisse pas
la connaître avant une autre chose, avant laquelle néanmoins il faut
qu'elle soit connue. On ne peut donc pas concevoir une chose qui se
rapporte à une autre, et qui en même temps fait explicative de ce à
quoi on dit qu'elle se rapporte. Mais les dogmatiques disent que le
signe se rapporte à quelque chose, qui est la chose signifiée et
qu'il est explicatif de cette chose : donc il n'est pas possible que
nous concevions ce que c'est qu'un signe.
Ajoutons à ce
que nous avons dit, qu'autrefois les philosophes ne s'accordaient
pas sur ce sujet ; les uns disant qu'il y avait quelque signe
d'indication et les autres le niant. Celui donc qui dit qu'il y a
quelque signe démonstratif, ou il le dit simplement et sans
démonstration ou avec démonstration. S'il ne se sert que d'une
assertion toute nue, on ne le croira pas ; et s'il veut démontrer ce
qu'il avance, il prendra comme avoué ou comme prouvé ce qui est en
question. Car comme la démonstration passe pour une espèce de signe,
tant que l'on doutera s'il y a ou s'il n'y a pas quelque signe, on
doutera aussi s'il y a ou s'il n'y a pas quelque démonstration :
tout comme, par exemple, en demandant s'il y a quelque animal, on
demande aussi s'il y a quelque homme, puisque l'on fait qu'un homme
est un animal. Or c'est une absurdité de vouloir prouver une chose
qui est en question, par ce qui est en question également, ou par
elle même ; on ne saurait donc affirmer même avec démonstration
qu'il y ait quelque signe. Mais si on ne peut rien affirmer, ni en
affirmant tout simplement, ni avec démonstration touchant le signe,
on n'en peut absolument point parler avec certitude et décisivement,
comme d'une chose que l'on ait comprise. Que si on ne comprend pas
exactement ce que c'est que le signe, on ne pourra pas dire qu'il
signifie aucune chose, puisque l'on n'est pas même certain sur ce
qui concerne le signe ; et par conséquent il ne fera point signe.
Suivant ce
raisonnement le signe ne sera rien de réel, ni rien que nous
puissions concevoir. Disons néanmoins encore ceci. Ou bien les
signes sont évidents, ou bien ils sont obscurs, ou bien les uns sont
évidents, et les autres obscurs : mais rien de tout cela n'est vrai
: donc il n'y a point de signe. Tous les signes ne sont pas obscurs
; en voici la preuve. Ce qui est obscur n'est pas évident par
soi-même, selon les dogmatiques, mais il tombe sous les sens par
quelque autre chose : donc, si le signe est obscur, il aura besoin
d'un autre signe qui fera aussi obscur, (suivant la supposition
présente, qui dit qu'aucun signe n'est évident ) et celui ci d'un
autre obscur, et ainsi jusqu'à l'infini : mais on ne peut pas
trouver ainsi une infinité de signes: donc un signe obscur est une
chose incompréhensible : il ne peut donc point y avoir de tel signe,
puisqu'il ne peut rien signifier, ni être signe étant lui même
incompréhensible.
Que si tous
les signes sont évidents ; comme le signe est du nombre de ces
choses qui se rapportent à quelque autre et à la chose signifiée, et
qu'à l'égard des choses ainsi relatives l'une est conçue en même
temps avec l'autre; il s'ensuivra, que les choses que l'on dit être
signifiées par ces signes, étant comprises avec leurs signes qui
sont supposés tous évident, seront aussi évidentes. Car de même que
quand le droit et le gauche tombent en même temps sous nos sens, on
ne peut pas dire que le droit soit plus évident que le gauche, ou le
gauche plus évidemment aperçu que le droit: de même si le signe et
la chose qu'il signifie sont conçus et compris ensemble, il faut
dire que le signe n'est pas plus évident que la chose qu'il
signifie. Mais si la chose signifiée est évidente, on ne pourra pas
même dire qu'elle fait signifiée, puisqu'elle n'a pas besoin d'autre
chose que d'elle même, par quoi elle fait signifiée et démontrée:
c'est pourquoi comme étant le droit, il n'y a plus de gauche, ainsi
on trouvera qu'il n'y aura plus de signe, si on dit que tous les
signes sont évidents seulement.
Il reste donc
à dire que quelques signes sont évidents, et quelques autres
obscurs. Mais de cette manière encore nous resterons dans les mêmes
doutes. Car à l'égard des signes évidents, les choses signifiées par
ces signes seront évidentes, comme nous l'avons dit; mais comme ces
choses signifiées étant évidentes, n'auront besoin de rien par quoi
elles soient signifiées, elle ne seront donc pas signifiées ; ainsi
les signes prétendus évidents, ne seront point, puisqu'ils ne
signifieront rien. Et à l'égard des signes obscurs, qui ont besoin
d'autres signes qui les démontrent, si on dit qu'ils sont démontrez
par des signes obscurs, et ceux-ci par d'autres obscurs, et ainsi de
suite, on tombe dans le progrès à l'infini, et ces signes obscurs
étant incompréhensibles, par conséquent ils n'existent point, ou ils
ne sont point signes, comme nous l'avons dit ci-dessus. Que si on
dit qu'ils sont démontrés par des signes évidents, ils seront
évidents aussi eux- mêmes, comme étant compris et connus ensemble
avec leurs signes évidents; et par conséquent ces signes obscurs ne
seront rien ; parce qu'il ne se peut pas faire qu'une même chose
soit obscure de sa nature, et soit en même temps évidente. Ces
signes, dont nous parlons, sont supposés obscurs : mais il se trouve
qu'ils sont évidents, s'ils peuvent être signifiés par des autres
signes évident : la supposition se renverse donc elle même.
Si donc les
signes ne sont ni tous évidents, ni tous obscurs, et qu'il n'y ait
point d'autres signes imaginables, comme le disent les dogmatiques
eux mêmes ; il n'y aura point de signes. Il suffit maintenant
d'avoir dit ce peu de choses entre plusieurs que j'aurais pu
ajouter, pour montrer qu'il n'y a point de signe d'indication. A
présent nous rapporterons quelques raisons qui font voir qu'il peut
y avoir quelque signe, afin de démontrer par là l'égalité des
raisons contraires.
Ou les
raisons, que l'on apporte contre l'existence du signe, signifient
quelque chose, ou elles ne signifient rien ; si elles ne signifient
rien, comment peuvent-elles renverser l'existence du signe? Que si
elles signifient ce que c'est que le signe, ou bien ces raisons que
l'on apporte contre le signe sont démonstratives, ou bien elles ne
le sont pas : si elles ne le sont pas, elles ne démontrent pas qu'il
n'y a point de signe; et si elles le sont, comme la démonstration
est une espèce de signe, et qu'elle démontre sa conclusion, elle
sera un signe. C'est pourquoi voici comme quelques-uns raisonnent.
S'il y a quelque signe, il y a un signe, et s'il n'y a point de
signe, il y a un signe: (car on ne peut pas faire voir qu'il n'y a
point de signe, que par une démonstration qui est un signe : ) or ou
il y a un signe, ou il n'y a point de signe : donc il y a quelque
signe.
Contre cet
argument on peut opposer celui-ci: S'il n'y a point de signe, il n'y
a point de signe ; et s'il y a un signe, tel que celui que les
dogmatiques disent être un signe, il n'y a point de Signe: car comme
nous l'avons fait voir, il n'y a point de signe tel que celui dont
il s'agit ici, qui, comme les dogmatiques le prétendent, se rapporte
à quelque chose, et qui en même temps fait démonstratif de la chose
qu'il signifie : or ou il y a un signe, ou il n'y a point de signe :
donc il n'y a point de signe.
Mais que les
dogmatiques répondent eux-mêmes à l'égard des raisons que l'on
apporte touchant le signe. Signifient-elles, ou ne signifient-elles
point ? Si elles ne signifient point, elles ne servent à rien pour
prouver qu'il y ait un signe. Et si elles signifient, il y aura
quelque chose signifiée par elles; et cela prouvera qu'il y a
quelque signe. Mais, comme on apporte des raisons également
probables pour faire voir qu'il y a un signe, et pour faire voir
qu'il n'y en a point, il faut dire qu'il n'est pas plus vrai qu'il y
ait un signe, que non pas qu'il n'y en ait point.
Chap. XII. De la
démonstration.
ΙL est donc
évident, par ce que nous avons dit précédemment, que la
démonstration n'est point une chose dont on puisse dire certainement
qu'elle est. Car si nous nous abstenons de juger du signe, la
démonstration étant elle même un signe, il faut que nous nous
abstenions aussi de juger s'il y en a quelqu'une, puisque nous
trouverons que les arguments qui ont été proposés touchant le signe,
peuvent être appliquez aussi contre la démonstration,en ce qu'elle
se rapporte à quelque chose comme le signe, et que de même elle est
explicative de sa conclusion : d'où il suit que l'on peut dire
contre la démonstration à peu près les mêmes choses que nous avons
dites contre le signe.
Mais pour
traiter séparément de la démonstration, comme je le prétends faire
en peu de mots, je tâcherai d'expliquer succinctement ce que les
dogmatiques entendent par une démonstration. La démonstration,
disent-ils, est un argument qui en concluant par des prémisses
avouées et indubitables, développe et démontre sa conclusion qui
avait été auparavant obscure. Expliquons cette définition.
L'argument
est, selon les dogmatiques, un discours composé de prémisses et
d'une conclusion. Les prémisses ou les somptions de la
démonstration, sont des propositions, que l'on prend d'un commun
consentement, pour établir la conclusion ; et la conclusion est une
proposition, qui est établie par les prémisses. Ainsi dans cet
argument : S'il est jour, il fait clair: Or il est jour ; Donc il
fait clair; cette proposition, Donc il fait clair, est la
conclusion ; et les autres sont les somptions ou les prémisses.
Ensuite, entre les arguments, il y en a qui ont la force de
conclure, et d'autres qui ne l'ont pas. L'argument a la force de
conclure, lorsque le Connexum qui commence par les somptions
ou les prémisses de l'argument, liées ensemble, et qui finit par la
conclusion de l'argument, est vrai. Par exemple, l'argument
ci-dessus a la force de conclure, parce que dans ce Connexum,
s'il est jour, il fait clair, la conclusion, il fait clair,
est une suite de la liaison de cette prémisse, il est jour,
et de cette autre, s'il est jour, il fait clair : mais les
autres arguments, qui ne sont pas ainsi, n'ont pas la force de
conclure. Au reste, entre ces arguments concluants, les uns sont
vrais, et les autres faux. Ils sont vrais, lorsque non seulement le
Connexum est vrai, en vertu de la liaison des prémisses et de
la conclusion ; mais encore lorsque la conclusion est vraie, aussi
bien que les prémisses, et que la liaison qui est entre toutes ces
choses: et par, cette raison là, supposé qu'il soit jour maintenant,
l'argument précédent est vrai : S'il est jour, il fait clair : Or
il est jour : Donc il fait clair. Mais les faux arguments qui
concluent bien, sont ceux qui n'ont pas cela. Car, parce qu'il est
jour maintenant, cette argumentation, S'il est nuit, il ne fait
pas clair: Or il est nuit: Donc il ne fait pas clair, conclut
bien, parce que les prémisses, il est nuit : et, s'il est nuit,
il ne fait pas clair, concluent bien ; mais elle n'est pas
vraie, parce que l'une des prémisses qui est celle-ci, il est
nuit, n'est pas vraie. Les dogmatiques disent donc, qu'une
argumentation est vraie, quand elle tire une conclusion vraie de
prémisses vraies.
De plus ;
entre les argumentations, les unes font démonstratives et les autres
non. Les démonstratives font celles qui de prémisses évidentes en
tirent quelque conclusion qui était auparavant obscure : et les non
démonstratives sont celles qui ne sont point telles. Suivant cela
cet argument, s'il est jour, il fait clair : Or il est jour :
Donc il fait clair, n'est point démonstratif. Car sa conclusion,
il fait clair, est évidente indépendamment de cet argument. Et
cet autre argument, si les sueurs coulent dehors du corps, il y a
des pores, que l'on peut concevoir par l'entendement : Or les sueurs
coulent dehors du corps : Donc il y a des pores que l'on peut
concevoir par l'entendement. Cet argument, dis-je, est
démonstratif.
Enfin entre
les argumentations, qui concluent quelque chose d'obscur, les unes
ne font que nous mener simplement par les prémisses à la conclusion,
et les autres non seulement nous mènent à la conclusion, mais encore
elles nous la démontrent et elles nous l'éclaircissent. Celles qui
ne font simplement que nous conduire à la conclusion, sont celles
qui ne dépendent que de la foi ou de l'autorité, et de la mémoire;
telle qu'est celle-ci; Si quelqu'un des dieux vous a dit que cet
homme deviendra riche, il deviendra riche : Or ce Dieu ( en montrant
Jupiter) vous a dit que cet homme deviendra riche ? Donc cet homme
deviendra riche. Car nous accordons notre assentiment à cette
conclusion, plutôt parce que nous ajoutons foi à la parole d'un
dieu, qu'à cause de l'évidence nécessaire des prémisses. D'autres
argumentations ne nous mènent pas seulement ainsi par direction à la
conclusion, mais elles nous y conduisent encore par explication, et
par démonstration ; comme celle-ci, si les sueurs coulent sur la
peau, il y a des pores que nous pouvons nous représenter : or
l'antécédent est vrai : dont aussi le conséquent l'est. Car ce que
l'on dit que les sueurs coulent, sert à faire concevoir
clairement, ce que l'on ajoute, qu'il y a des pores, parce
que nous avons dans notre esprit ce préjugé, que l'humidité ne peut
pas passer au travers d'un corps qui ne serait point poreux.
Il faut donc
que la démonstration soit un argument, qui ait la force de conclure,
qui soit vrai, qui ait une conclusion obscure par elle- même, mais
laquelle soit manifestée par la force des prémisses. C'est pourquoi
on dit que la démonstration est une argumentation qui par des
propositions accordées, déclare et rend évidente sa conclusion qui
était auparavant obscure. Voilà ce que disent ordinairement les
dogmatiques pour donner une notion de la démonstration.
Chap. XIII. S'il y a
quelque démonstration
Or de ce que
les dogmatiques disent de la démonstration, on peut conclure qu'il
n'y en a point, pourvu que l'on renverse en particulier chacune des
choses qui sont comprises dans la notion qu'ils en donnent.
Par exemple,
l'argument est composé de propositions : mais les choses composées
ne peuvent pas exister, si les choses dont elles font composées,
n'existent toutes ensemble, comme cela est évident à l'égard d'un
lit et d'autres composés semblables : Or les parties de l'argument
n'existent point ensemble; car quand nous disons la première des
prémisses, la seconde, ni la conclusion n'existent pas encore, et
quand nous disons la seconde, la première n'existe plus, et la
conclusion n'existe pas encore, et enfin quand nous prononçons la
conclusion, les prémisses n'existent plus : Donc les parties de
l'argument n'existent point ensemble, et par conséquent il semble
que l'argument n'existe pas non plus.
Outre cela on
ne saurait comprendre quel doit être un argument qui a la force de
conclure; car si on prétend le discerner par la bonté de la
conséquence du Connexum, comme cette conséquence du
Connexum est quelque chose de si controversée qu'on ne peut pas
la connaître, et que peut-être même ne peut-on pas concevoir ce que
c'est que le Connexum, (comme nous l'avons fait voir en
parlant du signe,) il s'ensuit qu'on ne pourra pas comprendre quel
doit être un argument qui a la force de conclure.
De plus les
dialecticiens disent qu'un argument peut devenir malpropre pour
conclure ou faute de liaison et de connexion dans ses parties, ou à
cause de quelque omission, ou parce qu'il n'est pas en forme, ou
pour quelque superfluité. Faute de liaison ; lorsque les prémisses
n'ont pas de liaison l'une avec l'autre, ni avec la conclusion ;
comme celui-ci, s'il est jour, il fait clair : or on vend du blé
au marché : donc Dion se promène. A cause de quelque
superfluité, lorsqu'il se trouva une proposition dans les prémisses
qui ne sert à rien pour la conclusion ; comme, s'il est jour il
fait clair : or il est jour, et même Dion se promène: donc il fait
clair. Lorsque la forme de l'argument n'est pas propre pour
conclure, comme supposant que ces arguments soient concluants
s'il est jour il fait clair : or il est jour : donc il fait clair.
S'il est jour il fait clair : or il ne fait pas clair : donc il
n'est pas jour : alors l'argument suivant n'est pas propre pour
conclure, s'il est jour il fait clair : or il fait clair : donc
il est jour. Car, comme le Connexum suppose et promet que
son conséquent est renfermé dans son antécédent, il s'ensuit que
quand on reçoit l'antécédent, on reçoit aussi le conséquent ; et
quand on ôte le conséquent, on ôte aussi l'antécédent : car si
l'antécédent existait, le conséquent existerait aussi. Mais quand on
pose le conséquent, on ne pose pas nécessairement l'antécédent. Car
le Connexum ne disait pas que l'antécédent fût une fuite du
conséquent, mais seulement que le conséquent était une suite de
l'antécédent. Voilà pour quoi on dit qu'une argumentation conclut
bien, lorsque du Connexum et de l'antécédent du Connexum,
elle conclut le conséquent du même Connexum; ou bien lorsque
du Connexum, et de l'opposé du conséquent, elle conclut
l'opposé de l'antécédent. Mais on dit que celle-là conclut mal, qui
du Connexum et du conséquent conclut l'antécédent, comme
celle que j'ai dite ci-dessus; parce que quoique ses prémisses
soient vraies, elle conclut faux, si étant dite de nuit il y a une
lumière de lampe ou de chandelle. Car cette proposition s'il est
jour, il fait clair, est un Connexum vrai : et cette
prémisse, il fait clair, est vraie aussi, à cause de la
lumière de la chandelle : mais la conclure, Donc il est jour,
est fausse.
Enfin une
argumentation est vicieuse par omission, dans laquelle on omet
quelqu'une des choses qui sont nécessaires pour tirer une conclusion
légitime ; comme supposant que cette argumentation est vraie, ou
les richesses sont bonnes, ou elles sont mauvaises, ou elles sont
indifférentes ; mais elles ne sont ni mauvaises, ni indifférentes :
donc elles sont bonnes ; l'argument suivant sera vicieux par
omission; ou les richesses sont bonnes, ou elles font mauvaises
: or elles ne font pas mauvaises : donc elles font bonnes.
Si donc je
démontre que, suivant les dogmatiques eux-mêmes, on ne saurait fixer
ni connaître distinctement quelle est la différence qui est entre
les arguments concluants, et entre ceux qui ne le sont pas ; j'aurai
fait voir en même temps qu'on ne peut pas comprendre quelle est une
argumentation qui a la force et la vertu de conclure: tellement que
ce verbiage immense des dogmatiques dans leur dialectique se
trouvera tout à fait inutile. Or voici comme je le fais voir.
On dit qu'un
argument n'est point concluant faute de liaison, et que cela se
connaît, en ce que ses prémisses n'ont pas une bonne connexion entre
elles, ni avec la conclusion. Mais comme il faut savoir ce que c'est
qu'un bon Connexum, avant que de savoir distinguer si sa
conséquence est bonne, et que nous ne pouvons pas juger d'un bon
Connexum, comme nous l'avons prouvé ci-dessus, on ne pourra pas
juger non plus quel peut être un argument qui faute de liaison, ou
par son inconséquence n'est point propre pour conclure. Car
quiconque dit qu'il y a quelque argument non concluant à cause de
son inconséquence, s'il affirme seulement cela par une proposition,
sans autre preuve, on lui opposera une autre proposition contraire :
et s'il démontre ce qu'il avance, en se servant de quelque argument,
on lui dira que son argument doit avoir premièrement la vertu de
conclure, et doit ensuite prouver qu'il n'y a point de liaison entre
les prémisses de cet argument que l'on dit être défectueux par
inconséquence. Mais nous ne saurons pas si son argument est
démonstratif, parce que nous n'avons pas une preuve distinctive du
Connexum qui soit approuvée du commun consentement de tous,
par laquelle nous puissions juger si sa conclusion est une suite de
la connexion des prémisses de son argument. Nous ne pouvons donc pas
par cet argument là distinguer,comme il faut, un argument vicieux
par fon inconséquence, d'avec un argument qui a la vertu de
conclure. Nous ferons les mêmes objections à celui qui dira qu'une
argumentation est vicieuse, si elle est proposée dans une forme
défectueuse : car celui qui assure qu'une forme d'argumenter est
vicieuse, n'aura point d'argument indubitable reconnu pour
concluant, par lequel il puisse conclure ce qu'il dit. Et par le
même moyen on peut aussi réfuter ceux qui veulent faire voir qu'un
argument peut être vicieux par omission. Car si on ne peut pas
distinguer quel doit être un argument parfait, et auquel rien ne
manque, celui aussi dans lequel on aura omis quelque chose sera
obscur, et on ne pourra point le distinguer d'un autre, où rien ne
manquerait. Outre cela celui qui veut faire voir par un argument,
qu'il manque quelque chose à une argumentation, ne pourra jamais
assurer par un jugement certain et droit, que cette argumentation a
quelque défaut, à moins qu'il n'ait une règle pour diffamer un bon
Connexum par laquelle il puisse juger de la conséquence de
l'argument qu'il employé contre cette argumentation.
Maintenant à
l'égard de cet argument que l'on dit être vicieux par superfluité,
on ne peut le distinguer d'avec un argument concluant par aucun
argument démonstratif: car eu égard à la superfluité, les
argumentations indémontrables, qui sont si célèbres parmi les
stoïciens, paraîtront elles-mêmes n'être point propres pour conclure
; (argumentations néanmoins d'une si grande conséquence, que si on
les rejette, on renverse en même temps toute la dialectique.) Les
stoïciens disent que ces argumentations indémontrables n'ont pas
besoin d'être confirmées par une démonstration, et qu'elles servent
à démontrer quand les autres arguments concluent bien. Or on verra
clairement qu'il y a de la superfluité dans ces argumentations
indémontrables, quand je les aurai exposées, et quand j'aurai ainsi
prouvé ce que j'avance.
Ils ont
inventé plusieurs argumentations indémontrables, mais ils en
assignent principalement cinq. La première, qui du Connexum
et de son antécédent, en conclut le conséquent: comme, s'il est
jour, il fait clair : or il fait jour: donc il fait clair. La
seconde, qui du Connexum et du contraire du conséquent,
conclut le contraire de l'antécédent: comme, s'il est jour, il
fait clair: or il ne fait pas clair : donc il n'est pas jour. La
troisième, qui d'une proposition négative copulative, et de la
position d'une de ses parties, conclut le contraire du reste :
comme, il n'est pas jour, et nuit ensemble: or il est jour: donc
il n'est pas nuit. La quatrième, qui d'une proposition
disjonctive et d'une de ses parties, conclut le contraire du reste :
comme, Ou il est jour, ou il est nuit : or il est jour : donc il
n'est pas nuit. La cinquième, qui d'une disjonctive et du
contraire d'une des parties, conclut le reste : comme, Ou il est
jour, ou il est nuit : or il n'est pas nuit : donc il est jour.
Voilà leurs
célèbres argumentations indémontrables, lesquelles toutes ne me
paraissent point être propres pour conclure, parce qu'elles ont le
défaut de la superfluité. Pour commencer par la première, voici
comme je raisonne. Ou c'est une chose avouée et indubitable que de
ce dit, s'il est jour, (qui est l'antécédent du Connexum
s'il est jour, il fait clair,) suit cet autre, il fait
clair, qui est le conséquent; ou bien cela est incertain. Si
cela est incertain, nous n'accorderons point le Connexum
comme une chose indubitable. Que s'il est certain que posé ce dit,
il est jour, cet autre, il fait clair, existe
nécessairement, certainement après que nous avons dit, il est
jour, on en conclut tout d'abord, il fait clair :
tellement qu'il suffit de dire, il est jour, donc il fait clair
: et tout ce Connexum, s'il est jour, il fait clair ,
devient superflu.
Nous suivrons
la même méthode pour attaquer la seconde argumentation
indémontrable. Car ou il se peut faire que, le conséquent n'existant
pas, l'antécédent existe, ou cela ne se peut pas. Si cela se peut
faire, le Connexum ne sera pas véritable : mais si cela ne se
peut pas, dès qu'on nie le conséquent, on nie aussi l'antécédent;
tellement que le Connexum devient derechef inutile, puisque
c'est assez de proposer ainsi l'argument, il ne fait pas clair :
donc il n'est pas jour.
Ce sera
encore la même chose dans la troisième indémontrable. Car ou il est
certain qu'il ne se peut pas faire que les choses qui sont jointes
dans la proposition copulative négative existent ensemble, ou cela
est incertain. Si cela est incertain, nous n'accorderons pas la
copulative négative : et si cela est certain, dès que l'on pose
l'un, on ôte l'autre, et la négation de la copulative négative est
inutile, puisque l'on peut réduire l'argument à ceci, il est jour
: donc il n'est pas nuit.
Nous dirons
la même chose à l'égard de la quatrième et de la cinquième
indémontrables. Car ou on connaît certainement que dans la
disjonctive une partie est vraie et l'autre fausse avec une
contrariété parfaite, comme le promet la disjonction, ou cela est
incertain. Si cela est incertain, nous n'accorderons pas la
disjonction : mais si cela est certain, l'une des deux parties
posée, il est évident que l'autre n'est pas, et l'une étant ôtée, il
est évident que l'autre existe; tellement qu'il suffit de proposer
ces arguments ainsi, il est jour : donc il n'est pas nuit. Il
n'est pas jour, donc il est nuit, et la proposition disjonctive
devient superflue.
On peut dire
la même chose des syllogismes que l'on appelle catégoriques, qui
sont fort en usage parmi les péripatéticiens : tel qu'est cet
argument, Ce qui est juste, est honnête: ce qui est honnête est
bon : donc ce qui est juste est bon. Ou bien c'est une chose
avouée, certaine, et évidente, que l'honnête est bon : ou bien cela
est douteux, et n'est point connu avec évidence. Si cela est
incertain, on ne l'accordera pas dans l'argument proposé, et ainsi
ce syllogisme ne sera pas concluant non plus : mais s'il est certain
que tout ce qui est honnête est, bon, dès qu'on dit que ceci ou cela
est honnête, on conclut aussi que ceci ou que cela est bon. Ainsi il
suffit de raisonner ainsi: Ce qui est juste est honnête: donc ce
qui est juste est bon: et l'autre prémisse où on disait que ce
qui est honnête est bon, est superflue. De même dans cet argument,
Socrate est homme : or tout homme est animal : donc Socrate est
animal. Si ce n'est pas une chose certaine par elle même, que
tout ce qui est homme est animal, la proposition universelle de cet
argument ne fera pas avouée, et on ne l'accordera pas à celui qui
argumentera : mais si dès que quelque chose est homme, il s'enfuit
que c'est un animal, et si par conséquent cette proposition, tout
homme est animal, est indubitablement vraie ; aussitôt que l'on a
dit que Socrate est homme, il s'ensuit qu'il est animal : tellement
qu'il suffit d'argumenter ainsi, Socrate est homme : donc Socrate
est animal ; et cette proposition, tout homme est animal,
est superflue.
On peut se
servir de la même méthode dans les autres premiers arguments
catégoriques, sans qu'il soit besoin de nous arrêter plus longtemps
à ces choses. Au reste ces argumentations indémontrables dans
lesquelles les dogmatiques font consister le fondement des
syllogismes, étant vicieuses par superfluité, toute la dialectique
est renversée par cette superfluité: puisque nous ne pouvons pas
discerner les arguments vicieux par superfluité, et par conséquent
malpropres à conclure, d'avec ceux qui font concluants.
Que si
quelques-uns n'approuvent pas que les argumentations n'aient qu'une
seule prémisse, ceux là ne font pas plus croyables qu'Antipater, qui
ne rejette pas ces arguments. Voilà les raisons qui font que l'on ne
peut point juger quelle doit être cette argumentation, que les
dialecticiens disent avoir la vertu de conclure. Mais de plus on ne
peut pas juger quel doit être un argument pour être vrai, soit par
les raisons que nous avons dites, soit parce que le conséquent doit
être vrai nécessairement. Car ou la conclusion que l'on dit être
vraie, est évidente, ou elle est obscure. Mais elle ne peut pas être
évidente, car en ce cas elle n'aurait pas besoin de prémisses pour
la manifester, si elle tombait par elle même sous nos sens, et elle
ne serait pas moins évidente que ses prémisses. Que si elle est
obscure, parce que la controverse des choses obscures nous a paru
jusqu'ici impossible à être jugée (comme nous l'avons dit ci-dessus
) et que par conséquent les choses obscures sont incompréhensibles,
il s'ensuivra que la conclusion obscure de cet argument que l'on dit
être vrai, sera aussi incompréhensible : et si elle est
incompréhensible, jamais nous ne distinguerons si ce que l'on
conclut, est vrai ou faux. Nous ne saurons donc pas, et nous ne
pourrons trouver en aucune manière si l'argumentation est vraie ou
non. Mais, pour ne nous pas arrêter sur ces choses, je dis que l'on
ne saurait trouver quelle doit être une argumentation, afin qu'elle
puisse conclure par des choses évidentes une chose qui était
obscure. Car si la conclusion vient de la liaison et de la connexion
qui est entre les prémisses de l'argument, et si le conséquent, est
du nombre des choses qui se rapportent à quelque autre chose,
c'est-à-dire, s'il se rapporte à l'antécédent ; comme les relatifs
se connaissent ensemble, (ainsi que nous l'avons fait voir, ) il
s'ensuit que la conclusion étant obscure, les prémisses le seront
aussi ; et si les prémisses sont évidentes, la conclusion le sera
aussi, puisqu'on la conçoit avec les prémisses qui font évidentes:
tellement qu'on ne conclura pas une chose obscure, de choses
évidentes. Ce qui étant ainsi, les prémisses ne démontrent pas la
conclusion ; car si elle est obscure, elle est inconcevable et on ne
saurait la connaître, et si elle est évidente, elle n'a pas besoin
d'être rendue telle par des prémisses
Donc si la
démonstration est une argumentation concluante, qui par quelques
prémisses que tout le monde reconnaît pour vraies, manifeste une
conclusion obscure; comme nous avons fait voir qu'il n'y a aucune
argumentation, ni qui ait la vertu de conclure, ni qui soit vraie,
ni qui puisse conclure l'obscur par l'évident, ni qui manifeste et
découvre fa conclusion ; il est clair qu'il ne peut point y avoir de
démonstration.
Voici encore
quelques raisons par lesquelles nous attaquerons les dogmatiques, et
qui nous feront voir qu'il n'y a point de démonstration, et que l'on
n'en peut pas concevoir. Si on dit qu'il y a quelque démonstration,
ou on dira qu'elle est générale, ou on dira qu'elle est
particulière : mais il ne peut y avoir ni démonstration générale,
ni démonstration particulière , comme je vais le montrer: (et on ne
peut pas concevoir d'autre démonstration:) donc on ne peut pas dire
qu'il y ait aucune démonstration.
Qu'il n'y ait
point de démonstration générale, voici comme je le prouve. Ou cette
démonstration a des prémisses et une conclusion, ou elle n'en a
points. Si elle n'en a point, elle n'est pas une démonstration. Que
si elle a quelques prémisses, et quelque conclusion, comme tout ce
qui est démontré, est quelque chose de particulier, aussi bien que
ce qui démontre,elle fera une démonstration particulière . Il n'y a
donc point de démonstration générale. Mais il n'y en a point non
plus de spéciale ou de particulière . Car ou on dira que cette
démonstration est un composé de prémisses et d'une conclusion, ou un
composé de prémisses seulement : mais aucun de ces composés n'est
point une démonstration, (comme je vais le faire voir:) donc il n'y
a point de démonstration particulière.
Je dis donc
qu'un composé de prémisses et d'une conclusion n'est pas une
démonstration. Premièrement parce qu'ayant quelque partie obscure et
incertaine, qui est la conclusion, elle sera obscure et incertaine;
ce qui est absurde à dire d'une démonstration. Car si cette
démonstration est obscure et incertaine, elle aura plutôt besoin de
quelque chose qui la démontre, qu'elle ne fera démonstrative de
quelques autres choses.
Ensuite.
Comme les dogmatiques disent que la démonstration est relative à
quelque chose, c'est-à-dire, à la conclusion, et que les choses
relatives sont conçues comme se rapportant à d'autres choses qu'à
elles-mêmes, comme le disent encore les mêmes philosophes, il faut
que ce qui est démontré soit autre et différent de la
démonstration. Si donc la conclusion est ce qui est démontré, on ne
pourra pas concevoir qu'une démonstration ait une conclusion. Car ou
la conclusion aide en quelque chose à sa propre démonstration, ou
elle n'y sert de rien. Mais, si elle y aide, elle sera explicative
et démonstrative d'elle-même, et si elle n'y sert de rien, elle
est superflue, et elle ne sera pas par conséquent une partie de la
démonstration, parce que nous dirons que cette démonstration est
vicieuse par superfluité.
Mais d'un
autre côté un composé de prémisses seules n'est pas une
démonstration. Car si je dis, s'il est jour il fait clair : Or il
est jour : qui est-ce qui accordera que cela fasse une
argumentation, ou un discours dont le sens soit complet. Donc un
composé de seules prémisses n'est pas une démonstration ; ce qui
fait qu'il ne peut y avoir de démonstration particulière. Or s'il ne
peut y avoir ni démonstration particulière , ni démonstration
générale, et que nous ne puissions pas concevoir quelque autre forte
de démonstration, il faut dire, qu'il ne peut y avoir aucune
démonstration.
Nous
montrerons encore qu'il n'y a point de démonstration, en cette
manière. S'il y a quelque démonstration, ou bien, étant évidente,
elle démontre quelque chose d'évident; ou étant obscure, quelque
chose d'obscur; ou étant obscure, quelque chose d'évident; ou étant
évidente, quelque chose d'obscur : Or on ne peut concevoir aucune
démonstration qui puisse servir à démontrer aucune de ces choses :
Donc on ne peut concevoir ce que c'est qu'une démonstration.
Si la
démonstration, étant évidente, découvre ou démontre ce qui est
évident, ce qu'elle démontre est en même temps évident et obscur,
évident, parce qu'on le suppose tel, et obscur, parce qu'il a besoin
d'être démontré, et qu'il ne tombe point par soi-même évidemment
tous nos sens.
Si, étant
obscure, elle démontre ce qui est obscur, elle aura besoin elle-même
d'être démontrée par quelque autre chose, et ne pourra pas servir à
la démonstration de quelques autres choses: ce qui est contraire à
la notion de la démonstration.
Par la même
raison il ne peut pas y avoir une démonstration obscure d'une chose
évidente, ni une démonstration évidente d'une chose obscure. Car
comme la démonstration est relative à quelque chose, et comme les
choses relatives se connaissent ensemble l'une par l'autre, il est
clair que si ce que l'on dit être démontré, est compris ensemble
avec la démonstration évidente, il sera aussi évident. De manière
qu'on s'exposera à une rétorsion, et qu'on ne pourra pas prouver que
des choses manifestes soient démonstratives de quelque chose
d'obscur. Si donc il n'y a point de démonstration évidente d'une
chose évidente, ni obscure d'une chose obscure, ni obscure, d'une
chose évidente, ni évidente d'une chose obscure, et qu'il n'y ait
rien que ces sortes de démonstrations, suivant les dogmatiques ; il
faut dire que la démonstration n'est rien.
Ajoutez,
qu'il y a des disputes entre les dogmatiques touchant la
démonstration. Les uns disant qu'il n'y en a point, (comme ceux qui
disent qu'il n'y a rien:) et les autres disant qu'il y en a, (comme
la plupart des dogmatiques.) Au lieu que nous disons qu'il n'est pas
plus vrai de dire qu'il y en a, que de dire qu'il n'y en a pas. De
plus il est nécessaire qu'une démonstration contienne un dogme : or
tout dogme est controversé : il faut donc qu'il y ait quelque
controverse touchant quelque démonstration que ce soit. Car si dès
là que l'on regarde comme avouée et indubitable la démonstration,
par exemple, celle par laquelle on démontre qu'il y a du vide, on
regarde en même temps le vide corne un dogme avoue; et si ceux qui
doutent s'il y a du vide, doutent aussi de la démonstration du vide,
(ce qu'il faut dire à l'égard de tous les dogmes dont on prétend
donner des démonstrations il s'enfuit que toute démonstration est
révoquée en doute et controversée.
Donc, parce
que toute démonstration est une chose incertaine et obscure, à cause
qu'elle fait le sujet d'une controverse ; ( les choses controversées
étant obscures et incertaines,en tant qu'elles sont controversées; )
elle n'est pas évidente par elle même, et elle doit nous devenir
telle et nous être démontrée par une démonstration. Mais la
démonstration qui servira de preuve à la première, ne fera pas elle
même indubitable et évidente; (car nous cherchons maintenant s'il y
a quelque démonstration de quelque manière que ce soit:) or si cette
démonstration est contestée et incertaine, elle aura besoin d'une
autre démonstration, et celle-ci d'une autre, et ainsi à l'infini.
Mais on ne peut pas démontrer des choses à l'infini : on ne peut
donc pas démontrer qu'il y ait quelque démonstration.
Cela ne peut
point non plus se découvrir par quelque signe. Car comme c'est une
question, de savoir s'il y a un signe, et qu'un signe a besoin d'une
démonstration qui en prouve l'existence, on ne peut éviter de tomber
dans le Diallèle, parce que la démonstration a besoin de signe qui
la prouve, et le signe a besoin d'une démonstration qui en fasse
voir l'existence : ce qui est absurde. On ne peut donc pas décider
la controverse de la démonstration, parce que la décision que l'on
en ferait a besoin elle même d'une règle de décision ou de jugement
: or, comme on est en dispute pour savoir s'il y a une telle règle,
( comme nous l'avons fait voir, ) et que par conséquent la règle de
jugement a besoin d'une démonstration qui prouve qu'il y a une telle
règle, il se trouve que l'on est obligé de s'embarrasser dans le
Diallèle : moyen d'Epoque qui est pour nous une raison de
douter.
Si donc ni
par la démonstration, ni par le signe, ni par la règle du vrai, on
ne peut point montrer qu'il y ait quelque démonstration ; si de plus
la démonstration ne peut pas se démontrer elle même, (comme nous
l'avons fait voir,) on ne pourra pas savoir s'il y a quelque
démonstration; et il faudra dire par conséquent qu'il n'y en a
point.
En voilà
assez pour ce traité abrégé, contre la démonstration. Examinons les
objections des dogmatiques. Ou les arguments que l'on propose contre
la démonstration (disent-ils ) sont démonstratifs, ou ils ne le sont
pas. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas prouver qu'il n'y a
point de démonstration : et s'ils sont démonstratifs, ceux qui les
sont (pour rétorquer contre eux leurs propres raisonnements,)
prouvent et reconnaissent par là l'existence de la démonstration.
Voici donc quel est l'argument de ces dogmatiques. S'il y a quelque
démonstration, il y en a, et s'il n'y en a pas, il y en a aussi : (puisqu'on
prétend démontrer qu'il n'y en a pas.) or, ou il y a quelque
démonstration, ou il n'y en a pas : donc il y en a. Ils concluent
encore la même chose par un raisonnement de pareille force ; le
voici. Ce qui est également une conséquence de deux choses opposées,
est non seulement vrai, mais encore nécessaire : or ces deux
propositions, Il y a quelque démonstration, II n'y a point de
démonstration, sont choses opposées entre elles, et de l'une des
deux, telle qu'il vous plaira, il s'ensuit qu'il y a quelque
démonstration : donc il y a quelque démonstration.
Mais nous
pouvons opposer quelque chose à ces raisonnements, en disant, par
exemple, que comme nous ne croyons pas qu'il y ait aucun argument
démonstratif, nous ne disons pas que celles là mêmes qui font contre
la démonstration, soient nécessairement démonstratives, mais
qu'elles nous paraissent seulement vraisemblables. Or il n'est pas
nécessaire que des choses vraisemblables, soient démonstratives, et
au contraire si elles étaient aussi démonstratives, ( ce que nous
n'assurons pas, ) elles seraient; aussi nécessairement vraies. Or
est-il que les arguments vrais sont ceux qui concluent du vrai au
vrai ; et ainsi leur conclusion est vraie. Mais la conclusion que
nous avons établie, et que les dogmatiques nous passent, sans nous
l'accorder, était celle-ci, donc il n'y a point de démonstration :
ainsi en rétorquant contre eux leur raisonnement, nous dirons, donc
il n'y a point de démonstration ; puisque nos arguments étaient
vrais.
De plus il se
peut faire que, comme les remèdes purgatifs se chassent eux-mêmes
avec les matières qui font dans le corps, ainsi nos arguments se
réfutent et se condamnent eux-mêmes, avec les autres que l'on dit
être démonstratifs. Cela n'est point absurde : car cette expression,
Il n'y a rien de vrai, non seulement exclut tout, mais elle se
renverse encore elle même avec toutes les autres choses. Au reste on
peut faire voir en plusieurs manières que cet argument, s'il y a
une démonstration, il y a une démonstration ; s'il n'y a point de
démonstration, il y a une démonstration : Or ou il y en a, on il n'y
en a point : Donc il y en a: on peut, dis-je, faire voir que cet
argument n'a aucune vertu pour conclure. Mais pour le présent nous
nous contenterons de ce raisonnement. Si ce Connexum, s'il
y a une démonstration, il y a une démonstration, n'est pas
vicieux, il faut que l'opposé de son conséquent, lequel opposé est,
il n'y a point de démonstration, soit opposé à son antécédent;
Il y a une démonstration: Or il ne se peut pas faire, selon les
dogmatiques, qu'un Connexum ne soit pas vicieux, qui est
composé de propositions contraires; parce que le Connexum
promet, que si son antécédent est vrai, son conséquent le sera
aussi. Mais dans des propositions répugnantes et disjonctives, c'est
tout le contraire; si l'un des deux est, il n'est pas possible que
l'autre soit aussi. Donc si ce Connexum est vrai, s'il y a
une démonstration, il y a une démonstration ; cet autre ne peut
pas l'être, s'il n'y a point de démonstration, il y a une
démonstration.
Mais enfin si
nous voulons accorder et supposer que ce Connexum est vrai ;
s'il n'y a point de démonstration, il y a une démonstration; il
s'ensuivra que ces propositions peuvent coexister ensemble, savoir,
il y a une démonstration, et il n'y a point de démonstration.
et si elles peuvent coexister ensemble, l'une ne répugne pas à
l'autre. Ainsi dans ce Connexum, s'il y a une
démonstration, il y a une démonstration, l'opposé du conséquent
ne répugne point à l'antécédent: donc ce Connexum n'est pas
vrai.
Mais
accordons encore que ce Connexum soit vrai ; mais que ces
propositions, Il n'y a point de démonstration, Il y a quelque
démonstration, ne répugnent pas l'une à l'autre: je dis que la
proposition disjonctive ne fera pas bonne, par exemple celle-ci,
ou il y a une démonstration, ou il n'y a point de démonstration.
Car une bonne disjonctive promet qu'une des propositions qu'elle
contient est vraie, et que le reste est faux et répugnant à ce qui
est vrai. Que si cette disjonctive est bonne, on trouvera derechef
que ce Connexum, s'il n'y a point de démonstration, il y a
une démonstration, qui est composé de propositions répugnantes,
est vicieux. C'est pour quoi les fonctions de cette argumentation
sont discordantes entre elles, et se renversent réciproquement l'une
l'autre: et ainsi elle ne conclut pas bien.
De plus ils
ne peuvent pas faire voir que de deux choses opposées, il suive quoi
que ce soit. Car ils n'ont pas une règle de discernement et de
jugement pour juger de cette conséquence, comme nous avons dit. En
un mot si les choses que l'on dit en faveur de la démonstration sont
vraisemblables, (car nous ne nous y opposons pas, ) et si aussi les
argument que l'on avance contre la démonstration sont vraisemblables
; nous devons nous empêcher de juger ni pour ni contre, et dire
qu'il est également incertain s'il y a, ou s'il n'y a pas une
démonstration.
Chap. XIV. Des syllogismes.
Il pourrait
paraître superflu de discourir dd ces syllogismes, qui sont si
communs dans les disputes des dogmatiques, soit parce qu'est
détruisant l'existence de la démonstration, ils sont aussi
renversés en même temps: (car il est clair que n'y ayant point de
démonstration il ne peut y avoir de syllogisme démonstratif;) soit
parce qu'on peut appliquer à la réfutation; des syllogismes, ce que
nous avons dit en traitant des arguments vicieux par superfluité,
lorsque nous avons donné une méthode pour faire voir que tous les
arguments démonstratifs des stoïciens et des péripatéticiens n'ont
aucune vertu de conclure.
Mais
peut-être qu'il n'y aura pas de mal à ajouter ici comme par surcroît
une dispute particulière touchant les syllogismes; vu surtout le
grand attachement que les dogmatiques ont pour ces arguments.
On pourrait
apporter plusieurs raisons pour faire voir que ces syllogismes ne
peuvent subsister; mais eu égard au dessein de cet ouvrage où nous
voulons être courts, il suffira de les attaquer de la manière que
j'exposerai un peu après.
Je traiterai
encore ici des arguments indémontrables ; parce que ces arguments
étant renversés, tous les autres syllogismes tombent en même temps,
et parce que l'on prétend démontrer par ces arguments, que les
syllogismes sont concluants. Cette proposition, Tout homme est
animal, se prouve par une induction ou par une énumération de
tous les Individus. Car de ce que Socrate qui est homme, est aussi
animal, et tout de même Platon et Dion, et tous les autres hommes
particuliers, il paraît qu'on peut confirmer par là que tout homme
est animal. Et s'il se trouve un seul être particulier qui soit
contraire aux autres, la proposition universelle n'est point vraie.
Par exemple, parce que la plus grande partie des animaux remuent la
mâchoire inférieure, et que le crocodile seul remue celle d'en haut,
cette proposition universelle, Tous les animaux remuent la
mâchoire inférieure, n'est pas vraie.
Quand donc
les dogmatiques raisonnent ainsi, Tout homme est animal : Socrate
est homme : Donc Socrate est animal : il est évident que
lorsqu'ils veulent ainsi, de cette proposition universelle, Tout
homme est animal, conclure cette proposition singulière,
Socrate est animal comme d'ailleurs une proposition universelle
se prouve par une induction des singuliers, il est, dis-je, évident
qu'ils tombent dans le Diallèle, en accordant qu'on doit prouver une
proposition universelle par l'induction de tous les particuliers, et
en voulant néanmoins conclure
par un syllogisme, une proposition particulière d'une proposition
universelle.
Tout de même
dans cet argument, Socrate est homme, or aucun homme n'est un
animal à quatre pieds. : donc Socrate n'est pas un animal à quatre
pieds,: quand ils veulent prouver cette proposition, Aucun
homme n'est un animal à quatre pieds, par une induction des
singuliers, et qu'en même temps ils veulent conclure par un
syllogisme chaque proportion singulière de celle-ci, Aucun homme
n'est un animal à quatre pieds, il est évident qu'ils tombent
dans l'incertitude du Diallèle.
Mais il est à
propos de parcourir de la même manière les autres argumentations,
que l'on appelle Indémontrables chez les péripatéticiens ; comme
aussi celles qui sont fondées sur un Connexum semblable à
celui-ci, s'il est jour, il fait clair.
Ils disent
que de cette proposition, s'il est jour, il fait clair, on
peut en conclure fermement celle-ci, Il fait clair : et derechef
ils disent que ces deux dits, il fait clair : il est jour,
prouvent et confirment le Connexum, s'il est jour, il fait
clair, parce qu'on ne le croirait pas comme vrai, si l'on ne
savait auparavant, qu'être jour et faire clair, sont deux choses qui
coexistent toujours ensemble. Si donc pour composer ce Connexum,
s'il est jour, il fait clair, il faut auparavant avoir
compris que quand il est jour il fait clair; et, si cependant on
conclut de ce Connexum, que quand il est jour il fait clair ;
il est évident que, comme ce Connexum dans cet argument
indémontrable ne peut être prouvé que par la coexistence nécessaire
de ces deux choses qu'il renferme, savoir qu'il est jour et qu'il
fait clair, et que, comme réciproquement la coexistence de ces deux
choses est confirmée et prouvée par le Connexum, il est,
dis-je, évident qu'ici le Diallèle par son incertitude renverse
toute la solidité de cet argument.
Il faut dire
la même chose de celui-ci : S'il est jour, il fait clair : or il
ne fait pas clair : donc il n'est pas jour. Car ce Connexum
ne peut passer pour vrai, que parce que l'on ne peut pas voir le
jour à moins qu'il ne fasse clair; et il passerait pour faux, si
quelquefois on voyait le jour sans qu'il fit clair : mais dans cet
argument indémontrable on conclut de ce Connexum, s'il est
jour, il fait clair ; qu'il n'est pas jour, quand il ne fait pas
clair; tellement que ces deux choses ont besoin l'une de l'autre
pour se prouver mutuellement, et d'être prises chacune pour la
preuve de l'autre, comme si elles étaient prouvées. Voilà un
Diallèle vicieux.
De même
encore, parce qu'il y a des choses, qui ne peuvent pas coexister
ensemble, comme le jour et la nuit, il suit de là que cette
copulative négative, il n'est pas jour et nuit ensemble, et
que cette disjonctive, Ou il est jour, ou il est nuit,
passent pour vraies; et cependant on veut prouver la non-coexistence
de ces choses par la copulative négative, ou par la disjonctive, en
disant, il n'est pas jour et nuit ensemble : or il est nuit :
donc il n'est pas jour; ou bien, donc il n'est pas jour;
ou, or il n'est pas nuit : donc il est jour.
Voici donc
comme nous raisonnons. Si pour prouver la disjonctive, ou la
négative copulative, il faut auparavant avoir prouvé ou conçu que
les propositions dont elles sont composées, ne peuvent coexister
ensemble ; et si cependant on prétend conclure de la disjonctive, ou
de la copulative négative, que ces choses ne coexistent pas
ensemble, on tombe dans le Diallèle. Car il est certain que nous ne
pouvons point ajouter foi aux Connexum précédents, à moins
que nous n'ayons connu auparavant la non-coexistence des
propositions qui y sont contenues, et que nous ne pouvons point
affirmer cette non-coexistence, avant la preuve des syllogismes, qui
sont fondés sur ces Connexum: (c'est là le Diallèle.)
Comme donc
nous ne pouvons trouver aucun premier fondement, sur lequel nous
puissions appuyer une croyance certaine, à cause de ces preuves
réciproques ; nous dirons que ni le quatrième, ni le cinquième des
arguments indémontrables n'ont aucune solidité. Mais en voilà assez
pour le présent sur les syllogismes.
Chap. XV. De l'induction.
Je crois que
l'on peut encore réfuter facilement la manière d'argumenter qui se
fait par induction. Car ceux qui veulent ainsi prouver l'universel
par les singuliers, ou bien ils le feront en examinant tous les
singuliers, ou bien ils le feront en examinant tous les singuliers,
ou bien en en parcourant seulement quelques uns. S'ils n'en suivent
que quelques uns, l'induction ne sera pas solide et certaine, parce
qu'il se pourra faire que quelques uns des singuliers, qui auront
été omis dans l'induction, soient contraires à la proposition
universelle. Que s'ils veulent parcourir tous les singuliers, ils
entreprendront une chose impossible, les singuliers étant infinis,
et n'étant renfermés dans aucunes bornes. Ainsi quelque parti que
l'on prenne, il arrive que l'induction est chancelante et peu
assurée.
Chap. XVI. Des
définitions.
Comme les
dogmatiques s'imaginent d'être fort habiles dans l'art des
définitions, qui appartient à leur logique ou à la partie
rationnelle de leur philosophie, nous dirons maintenant quelque
chose des définitions.
Les
dogmatiques croient que les définitions sont fort utiles pour
plusieurs choses; mais on peut réduire leur utilité et leur
nécessité à deux principaux chefs, si je ne me trompe. Car ils
croient pouvoir démontrer qu'elles font nécessaires partout ; ou
pour comprendre une chose, ou pour l'expliquer et l'enseigner avec
méthode. Si donc nous faisons voir qu'elles ne sont utiles ni pour
l'une ni pour l'autre de ces choses, nous renverserons (à mon avis)
toute la peine inutile que se donnent les dogmatiques à cet égard.
D'abord. Si
celui qui ne connaît pas l'objet d'une définition, ne peut pas
définir ce qui lui est inconnu ; et si celui qui le connaît, et qui
le définit ensuite, comprend sans l'aide de la définition, ce qui
est défini, et ne fait que donner une définition à une chose connue;
la définition n'est donc pas nécessaire pour comprendre une chose.
Car si nous voulons définir toutes choses, nous ne définirons
absolument rien, parce que nous tomberons dans le progrès à l'infini
: et si nous disons que l'on peut connaître quelques choses sans
définitions, nous faisons voir par là, que les définitions ne sont
point nécessaires pour connaître les choses; puisque comprenant des
choses qui n'ont point été définies, nous pourrions de même
comprendre toutes les autres sans définitions. Ainsi ou nous ne
définirons rien, pour éviter le progrès à l'infini, ou nous
avouerons que les définitions ne sont point nécessaires pour
connaître les choses : et par là nous trouverons qu'elles ne le sont
pas non plus pour enseigner. Car comme celui qui a le premier connu
une chose, l'a connue sans définition ; tout de même celui que l'on
enseigne peut être instruit sans définition.
De plus les
dogmatiques prétendent juger des définitions par les choses que l'on
définit, et ils disent que les définitions sont vicieuses, quand
elles renferment des choses qui ne sont dans aucun des définis ou
qui ne sont point dans quelques uns. De manière que si quelqu'un dit
que l'homme est un animal raisonnable, immortel, ou qu'il est un
animal raisonnable, mortel, grammairien, alors, parce qu'il n'y a
aucun homme immortel, ou bien parce qu'il y a quelques hommes qui ne
sont pas grammairiens, ils disent que ces définitions-là sont
vicieuses. Mais peut-être que l'on ne saurait juger des définitions,
a cause de la multitude infinie des singuliers par lesquels il
faudrait en juger : et ensuite les définitions ne peuvent pas faire
comprendre ni rendre faciles à enseigner les choses par lesquelles
on juge de ces mêmes définitions; puisque ces choses là doivent être
connues et comprises avant que de juger par elles des définitions.
Mais enfin
peut-on nier qu'il ne soit ridicule de dire que les définitions
servent ou à comprendre, ou à enseigner, ou seulement à éclaircir
quoi que ce soit, quand elles ne servent qu'à nous embarrasser par
des obscurités. Par exemple, (pour badiner un peu) si quelqu'un,
voulant demander à un homme s'il n'en a point rencontré un autre à
cheval, et menant avec lui un chien, lui faisait cette
interrogation; animal raisonnable, mortel, capable de science et
d'intelligence, n'as-tu pas rencontré un animal risible, à larges
ongles, capable de science politique, ayant les hémisphères de ses
fesses appuyés sur un animal mortel, qui a la faculté de hennir,
menant avec soi un animal à quatre pieds aboyant? Ne faudrait-il pas
se moquer de celui qui voudrait qu'un homme demeurât muet sur une
chose aussi connue que celle-là, à cause qu'il ignorerait les
définitions? Il faut donc dire que la définition est inutile, si on
la considère selon les différentes notions que les dogmatiques en
donnent : soit que l'on dise qu'elle est une oraison qui par une
courte réminiscence, nous conduit à la connaissance des choses
signifiées par les paroles ; (Définition ou notion dont nous n'avons
point parlé;) soit que l'on dise qu'elle est une oraison qui marque
ce que la chois est, ou que l'on en donc quelque autre notion. Car
les dogmatiques en voulant nous apprendre ce que c'est que la
définition, tombent dans une controverse, dont ils ne sauraient
jamais se débarrasser, laquelle j'omets, parce que je veux être
court, quoique cette controverse paraisse renverser toutes leurs
définitions. Mais je ne crois pas en devoir dire davantage sur les
définitions.
Chap. XVII. De la
division.
Comme
quelques dogmatiques disent que la dialectique est l'art de faire
des syllogismes, et des inductions, de définir et de diviser ; cela
fait qu'après avoir disputé sur le Critérium ou sur la règle
des jugements, sur le signe et la démonstration, sur les
syllogismes, sur l'induction, et sur les définitions, nous croyons
qu'il convient au dessein que nous avons dans ce traité, de disputer
aussi en peu de mots sur la division. On dit donc que la division se
fait en quatre manières, c'est-à-dire, que l'on peut diviser ou le
nom en ses différentes significations; ou le tout en ses parties, ou
le genre en ses espèces, ou l'espèce en ses individus. Or je crois
qu'en examinant chacune de ces choses à part, il n'est pas difficile
de faire voir qu'il n'y a point de science qui apprenne à diviser en
aucune de ces manières.
Chap. XVIII. De la division du nom
en ses différentes significations
Les
dogmatiques mettent les sciences au rang des choses naturelles et
non pas au rang des choses positives ou d'institution ; et cela avec
raison, Car la science doit être une chose stable et fixe : mais les
choses positives ou d'institution font sujettes à changer aisément,
comme étant variables et dépendantes de différents établissements
qui sont en notre pouvoir. Or les noms signifiant par institution et
non de leur nature, (car autrement tous les hommes, grecs et
étrangers, entendraient toutes les significations des mêmes mots,
outre que nous avons le pouvoir de déclarer les significations que
nous devons donner aux mots, et de désigner les choses par tels
autres noms que nous voulons :) comment, je vous prie, peut-il y
avoir un art ou une science de diviser le nom en ses significations
? Et comment peut-on dire, (comme quelques-uns le prétendent,) que
la dialectique est la science des choses significatives et des
choses signifiées ?
Chap. XIX. Du Tout et de la Partie.
Nous
parlerons du Tout et de la Partie, dan s nos objections contre les
physiciens. Mais voici ce que nous avons à dire pour le présent,de
ce que l'on appelle la division du Tout en ses Parties. Quand on dit
que l'on divise, par exemple, dix par un, par deux, par trois, par
quatre, le nombre dix n'est pas partagé en ces parties là. Car
aussitôt que la première partie de dix est ôtée, comme, par exemple,
l'unité, (pour ne pas contester maintenant là dessus) ce n'est plus
dix, mais neuf, c'est tout autre chose que dix. Ainsi alors la
soustraction des autres nombres n'est plus un retranchement ou une
division du nombre dix, mais de quelques autres, qui varient à
chaque division ou soustraction qui se fait. Peut-être donc ne
peut-on pas diviser aussi un Tout en ce que l'on appelle ses
Parties. Car si on divise le Tout en ses Parties, les Parties, sont
donc contenues dans le Tout avant la division. Mais elles n'y sont
pas contenues : je le prouve. Par exemple, pour nous arrêter au
nombre dix, en un et en neuf; huit est aussi une partie de dix, car
on peut le partager en huit et en deux ; sept de même, et six, et
cinq, et quatre, et trois, et deux, et un, sont des parties de dix.
Si donc toutes ces parties sont comprises en dix, et si, étant
ajoutée avec dix, elles font cinquante cinq, il s'ensuivra que
cinquante cinq seront contenus dans dix, ce qui est absurde : donc
ce que l'on dit être les parties de dix, n'est point compris dans
dix, et dix ne peut point être partagé en ces choses là, (que l'on
n'y aperçoit point,) comme un Tout serait partagé ou divisé en ses
parties.
On peut faire
les mêmes objections à l'égard des grandeurs, comme, par exemple, si
on voulait diviser une grandeur de dix coudées. Mais il suffit de
conclure que peut-être ne saurait-on partager ou diviser un Tout en
Parties.
Chap. XX. Des genres et des espèces.
IL reste à
parler des genres et des espèces, ce que nous ferons plus amplement
ailleurs: maintenant que nous voulons être courts, nous nous
contenterons d'en dire peu de choses. Comme les dogmatiques mettent
au rang des notions de l'esprit, les genres et les espèces, les
arguments que nous avons rapportés contre l'entendement et contre
l'imagination ou la fantaisie, suffisent pour renverser aussi ces
notions là. Mais si nos objections précédentes les laissent
subsister, que répondra-t-on à ceci?
S'il y a des
genres, ou bien il y en a tout autant que d'espèces, ou bien, il y a
une espèce commune à toutes les autres, que l'on dit être les
espèces de celle là, laquelle on appellera genre, S'il y a autant de
genres que d'espèces, il n'y aura point de genre commun qui puisse
être divisé en ces espèces-là. Mais si on dit qu'il y a un seul
genre dans toutes les espèces qui lui appartiennent, ou bien chacune
de ses espèces participera à tout le genre, ou bien seulement à une
partie du genre. Mais l'espèce n'est pas participante de tout le
genre ; car il ne se peut pas faire que le genre étant quelque chose
d'unique, il soit contenu en même temps dans de différentes choses,
en sorte qu'on le puisse apercevoir tout entier dans chacune des
choses où on dit qu'il est. Que si l'espèce reçoit seulement une
partie du genre, premièrement le genre ne sera pas communiqué tout
entier à l'espèce, comme on le croit, et l'homme ne sera pas animal,
mais une partie d'animal, c'est-à-dire, qu'il sera, par exemple, une
substance qui ne sera ni animée ni sensitive. En second lieu il
faudra dire que toutes les espèces qui appartiennent à un genre, ou
sont participantes d'une même partie de leur genre, ou les unes
participantes d'une partie et les autres d'une autre. Elles ne
peuvent pas être participantes toutes d'une même partie, à cause de
ce qui a déjà été dit. Que si une espèce participe à une partie du
genre, et une autre à une autre partie, les espèces ne seront point
semblables entre elles en genre, ce que les dogmatiques n'admettront
pas, et chaque genre fera infini, étant partagé non seulement en une
infinité d'espèces, mais encore en une infinité de singuliers, dans
lesquels on remarque le genre avec ses espèces. Car on dit et que
Dion est homme, et qu'il est animal. Que si ces conséquences là font
absurdes, il faut dire que les espèces ne participent point à leur
genre (qui est unique, ) non pas même en quelque partie.
Or si quelque
espèce que ce soit ne participe ni à tout le genre, ni à quelque
partie du genre, comment peut-on dire que le genre est unique, ou
qu'il y a un seul genre dans toutes ses espèces, de manière qu'il se
divise en ces espèces là ? Certainement on ne peut point dire cela à
moins que l'on ne se forge certaines images, certaines ombres, qu'il
fera aisé de renverser, en suivant la méthode des sceptiques, à
cause des controverses et des disputes des dogmatiques, qu'il fera
impossible de décider, et à cause desquelles on ne pourra se
déterminer à rien.
Ajoutons
encore ceci. Les espèces sont ou telles, ou telles, (d'une
certaine manière ou d'une autre,) et leurs genres sont ou tels
et tels : ou bien ils sont tels seulement et non pas d'une autre
manière : ou enfin ils ne sont ni tels ni tels : (ni d'une
manière ni d'une autre.) Par exemple, parce que de ces
choses-ci, ou de celles-là quelles qu'elles soient, les unes sont
corporelles et les autres incorporelles, les unes vraies et les
autres fausses, quelques-unes fort grandes, et quelques autres fort
petites, et ainsi des autres: ce quelque chose, cet
Aliquid, par exemple, que l'on dit être au genre généralissime,
sera ou toutes choses, ou quelques-unes de toutes, ou rien. Que si
ce Quelque chose n'est rien du tout, il ne sera pas même
genre, et la dispute sera finie. Si on dit que cet Aliquid
est toutes choses, outre que ce que l'on dira là, sera impossible,
il faudra qu'il soit toutes les choses qui appartiennent aux espèces
et aux individus, où il se rencontre. Car comme de ce que l'animal
est (à ce que l'on dit) une substance animée, sensitive, chacune de
ses espèces est dite aussi être, et une substance, et animée, et
sensitive; tout de même, si le genre est corps et non corps, et faux
et vrai, et noir et blanc, (ce qui soit dit seulement par
supposition,) et très petit et très grand, et toutes autres telles
choses, chacune des espèces, et chaque singulier sera toutes choses,
ce qui n'est point évident. Il est donc faux aussi que cet
Aliquid, que ce Quelque chose généralissime soit toutes
choses. Que s'il est seulement quelques-unes de toutes choses, s'il
est les unes ou les autres, parce qu'il fera le genre de ces
choses-ci, il ne sera pas le genre des autres. Comme, par exemple,
si cet Allquid généralissime est corps, il ne fera pas genre
à l'égard des choses incorporelles; et si cet Aliquid est
animal, il ne sera pas genre à l'égard des animaux privés de raison
: de manière qu'il n'y aura rien qui soit incorporel, et rien qui
soit animal privé de raison ; et ainsi du reste, ce qui est absurde.
Donc le genre n'est point tel et tel; il n'est point non plus tel,
et non d'une autre manière ; et enfin il n'est point ni tel ni tel ;
(il n'est ni toutes choses, ni quelque chose, ni rien:) Ce
qui étant ainsi, il n'y a point de genre en aucune manière.
Maintenant,
si on dit que le genre est toutes choses en puissance , nous
répondrons que ce qui est quelque chose en puissance , doit être
quelque chose en acte, ou actuellement : Par exemple, quelqu'un ne
peut pas être grammairien, s'il n'existe actuellement. Si donc on
nous dit que le genre est toutes choses en puissance , nous
demanderons ce qu'il est en acte, et alors nos doutes demeureront
toujours les mêmes. Car le genre ne peut pas être en acte toutes
choses contraires. Il ne peut pas être non plus de certaines choses
en acte, et d'autres choses en puissance ; comme, par exemple, il
ne peut pas être corporel en acte, et incorporel en puissance. Car
être en puissance , c'est pouvoir être en acte: mais ce qui est
corps en acte, ne peut pas être incorporel en acte. Ainsi, par
exemple, si une chose est corps en acte, elle n'est point
incorporelle en puissance, et ainsi réciproquement. Nous ne pouvons
donc pas dire que le genre soit d'autres choses en acte, et d'autres
choses seulement en puissance . Mais si le genre n'est rien en
acte, et s'il n'existe point, ce genre, que les dogmatiques
prétendent diviser en ses espèces, n'est rien.
Il est à
propos de considérer ici une chose. Comme de ce qu' Alexandre et
Paris sont une même personne, il ne se peut pas faire, que cette
proposition : Alexandre se promène, étant vraie, cette autre,
Paris se promène, soit fausse. De même si c'est une même
chose, d'être homme, et d'être Téon, ou Dion, il est évident que si
on se sert du mot d'homme dans une proposition qui regardera
également Téon et Dion, cette proposition devra être vraie ou fausse
par rapport à Téon et à Dion tout ensemble. Mais cela n'est point
ainsi. Car si Dion est assis, et que Téon se promène, cette
proposition, Un homme se promène, est vraie étant dite du
second, et fausse étant dite du premier. Donc le nom d'homme n'est
pas une appellation commune, ni une seule et même chose à l'égard de
tous les deux, mais elle est toute différente, et particulière à
chacun.
Chap. XXI. Des accidents
communs.
On peut
raisonner à peu près de même sur les accidents communs, ou sur les
propriétés communes. Car si Dion et Téon ont, par exemple, une seule
et même propriété commune, comme serait celle de voir ; si nous
supposons que Dion vienne à mourir, et que Téon lui survive, et
qu'il voie, ou bien il faudra dire que la vue de Dion qui est mort,
demeure entière, ce qui répugne à l'évidence de la chose, ou bien il
faudra dire que sa vue est périe et n'est pas périe, ce qui est
absurde. Donc la faculté de voir de Téon n'est pas la même que celle
de Dion. Donc ce font deux facultés différentes et particulières
chacune à un chacun. Si, par exemple, la respiration est une même
propriété dans Dion et dans Téon, il ne se peut pas faire que cette
respiration soit encore dans Téon, et qu'elle ait cessé dans Dion.
Or il se peut faire que celui-ci soit mort, et que l'autre soit
encore vivant. Donc elle n'est pas une même chose dans l'un et dans
l'autre. Mais il suffit pour le présent d'avoir dit en peu de mots
quelque chose sur ce sujet.
Chap. XXII. Des sophismes.
Il ne sera
pas hors de propos de nous arrêter un peu sur la dispute des
sophismes, parce que ceux qui estiment la dialectique, disent
qu'elle est nécessaire pour les résoudre. Car, disent-ils, si l'on
distingue par le moyen de la dialectique, les arguments vrais et
faux, et si les sophismes sont des arguments faux, elle peut les
discerner et juger de ces mauvais raisonnements qui nuisent à la
vérité, par quelque apparence de vraisemblance. C'est pourquoi les
dialecticiens, zélés à donner des secours aux hommes pour la
conduite ordinaire de la vie, qui serait en danger sans eux,
s'appliquent avec un grand soin à nous donner la notion, les
différences, et les solutions des sophismes. Ils disent qu'un
sophisme est une argumentation vraisemblable et trompeuse, qui admet
une conclusion où fausse, ou semblable à une fausse, ou obscure, et
qui ne doit point être admise pour quelque autre raison.
Cette
conclusion est fausse, comme dans ce sophisme. Personne ne donne
à boire un Catégorème : or boire de l'absinthe, c'est un catégorème
: donc personne ne donne à boire de l'absinthe.
La conclusion
paraît fausse dans celui-ci. Ce qui n'a pu, ni ne peut se faire,
n'est point absurde : or il n'a pu ni ne peut se faire, qu'un
médecin tue, en tant que médecin.
La conclusion
est obscure, comme dans celui-ci. Il n'est pas vrai et que je
vous aie interrogé premièrement sur quelque chose, et qu'en même
temps les étoiles soient en nombre impair : or je vous ai interrogé
premièrement, si les étoiles sont en nombre pair.
La conclusion
ne doit pas être admise pour quelque autre raison dans tous les
sophismes ; tels que font ceux, par exemple, qui jettent dans un
solécisme, comme : Ouod vides, est : Atqui vides Phreneticum :
Ergo est Phreneticum. Ou bien. Ouod cernis, est : Atqui
cernis inflammatum locum : Ergo est inflammatum locum.
Après cela
les dogmatiques entreprennent de faire comprendre les solutions de
ces sophismes, et ils disent, que dans le premier des précédents, on
a accordé autre chose par les prémisses, que ce qui a été inféré
dans la conclusion. Car on avait accordé que l'on ne boit pas un
Catégorème, et que boire de l'absinthe est un Catégorème,
mais non pas que de l'absinthe est un Catégorème. Ainsi au
lieu que l'on devait conclure: Donc personne ne boit ce
Catégorème : Boire de l'absinthe, ce qui est vrai, on a conclu :
Donc personne ne boit de l'absinthe, ce qui est faux, et
n'est point une conséquence des prémisses que l'on a accordées.
Au second
sophisme ils disent qu'à la vérité il paraît conduire à quelque
chose de faux, (en sorte que ceux qui n'y prennent pas bien garde,
doutent s'ils doivent l'approuver.) mais qu'il conclut vrai
néanmoins, savoir : Donc cette proportion, un médecin en tant que
médecin tue, n'est point absurde. Car aucune proposition
parfaite n'est absurde ; Or cette proposition, un médecin tue
entant que médecin, est une proposition parfaite; donc elle
n'est point absurde.
A l'égard du
troisième argument qui paraît conduire dans l'obscurité, ils disent
que cette induction à l'obscurité, est du genre des choses qui
varient. Car si aucune interrogation n'a précédé, il suivra que l'on
aura cru que les étoiles sont en nombre impair, et que la seconde
proposition sera fausse, dans laquelle on dit, que l'on a demandé si
les étoiles sont en nombre pair, et l'on ne pourra rien conclure.
Mais si on a fait l'interrogation qui est spécifiée dans la seconde
proposition, on n'aura pas cru que les étoiles sont en nombre
impair, et alors on pourra conclure que l'on ne regardait pas comme
une chose certaine, que les étoiles fussent en nombre impair; (le
traducteur essaye de deviner la pensée de Sextus) puisque
l'on avait demandé si elles sont en nombre pair.
Pour ce qui
est des autres arguments à solécismes, qui sont les derniers, les
dogmatiques prétendent que les conclusions en sont absurdes, parce
qu'elles concluent contre l'usage et les règles de parler.
Voilà ce que
disent quelques dialecticiens touchant les sophismes : (car il y en
a d'autres qui raisonnent diversement sur cette matière.) Au reste
ces petites subtilités pourront plaire aux oreilles des simples,
mais dans le fond ce ne sont là que des inutilités et des inventions
où les philosophes ont pris bien de la peine en vain : comme on peut
le remarquer seulement par ce que j'ai déjà. Car j'ai fait voir que
l'on ne peut connaître ni le vrai ni le faux, selon les
dialecticiens, et je l'ai prouvé en plusieurs manières différentes,
et principalement en ruinant leurs arguments indémontrables, et leur
démonstration, qui sont les preuves de leur art syllogistique.
Néanmoins
entre plusieurs choses que l'on pourrait ici rapporter de
particulier au sujet présent, nous dirons seulement ceci, parce que
nous tâchons d'être courts. Tous les sophismes qui paraissent
pouvoir être résolus par la dialectique, la solution en est inutile;
et ceux dont la solution est utile, jamais un dialecticien ne
saurait les résoudre, et il n'y a que ceux qui sont habiles dans
chaque art, et qui ont acquis la connaissance des choses par leur
application, qui en puissent trouver la solution.
Donnons en un
ou deux exemples. Que l'on propose ce sophisme à un médecin. Dans
les relâchements des maladies, il faut user d'un différent régime de
vivre, et boire du vin: or quand quelque maladie que ce soit se
forme, il se fait ordinairement quelque relâchement avant les trois
premiers jours : donc il faut changer de régime et boire du vin à
l'ordinaire avant les trois premiers jours du mal. Un
dialecticien ne saurait rien fournir qui puisse servir à résoudre
cet argument, quoique cette solution soit fort utile. Mais un
médecin résoudra ce sophisme parce qu'il sait que le relâchement
d'une maladie s'entend de deux manières, savoir pour une
disposition en mieux de toute la maladie, et pour une disposition en
mieux de chaque degré particulier de force et de violence, depuis le
plus haut période du mal.
Or nous
voyons qu'avant les trois premiers jours il arrive ordinairement un
relâchement de quelque degré particulier de force et de violence
dans une maladie : mais nous n'approuvons point un changement de
régime dans ce relâchement là, mais dans le déclin de toute la
maladie. Ainsi un médecin dira que les prémisses de l'argument,
parlent de choses toutes différentes ; que dans la première on
entend parler de la première sorte de relâchement] de] tout le mal,
et que dans la dernière il s'agit de la seconde sorte de relâchement
d'un degré particulier du mal.
De même si on
propose cette difficulté touchant une personne malade d'une fièvre
ardente, causée par une violente obstruction; et que l'on raisonne
ainsi: Les maladies se guérissent par des remèdes contraires aux
maux : or l'eau froide est contraire à cette inflammation proposée :
donc l'eau froide est un remède conconvenable à cette inflammation,
Un dialecticien demeurera muet à cet argument : mais un médecin, qui
saura ce que c'est que les maladies dont la cause n'est point
accidentelle et passagère, et qui en connaît les symptômes, répondra
qu'il n'est pas ici question des symptômes, (n'étant pas rare que la
chaleur s'augmente et s'irrite par l'usage de l'eau froide;) mais
qu'il s'agit de maladies qui sont permanentes et non passagères, et
que l'obstruction est du nombre de ces maladies là, (laquelle ne
demande pas des remèdes astringents, mais quelque moyen de résoudre
l'obstruction par des remèdes laxatifs:) que l'ardeur de cette
fièvre qui vient en conséquence de l'obstruction, n'est pas une
maladie permanente par sa propre nature et principalement ; et
qu'ainsi l'eau froide ne convient point à ce mal, (qui vient
d'obstruction originairement.)
Un
dialecticien n'a donc rien à dire quand il s'agit de répondre à des
sophismes, dont la solution qui y convient, est utile. Cependant ce
dialecticien est tout fier quand il nous propose quelques mauvais
sophismes, comme ceux-ci : Si non et pulchra cornua habes, et
cornua habes.
At non pulchra cornua habes, et cornua habes.
Ergo cornua habes.
Si quelque chose se meut, elle se meut ou dans le lieu ou elle est,
ou dans celui ou elle n'est pas : mais ce n'est pas dans le lieu ou
elle est, car elle y demeurerait en repos ; ni dans le lieu ou elle
n'est pas, car comment pourrait-elle être en action, ou en
mouvement, là ou elle n'est point du tout . Donc rien ne se meut.
Ce qui se fait; ou est, ou n'est pas: or ce qui est, ne se fait pas
; car il est : et ce qui n'est pas, ne se fait pas non plus ; car ce
qui se fait est le sujet passif de quelque action, et ce qui n'est
pas ne peut pas être un tel sujet passif: donc rien ne se fait.
La neige est de l'eau gelée ou durcie : or l'eau est noire : donc la
neige est noire.
Un philosophe
en accumulant ainsi de pareilles sottises, fronce les sourcils,
vante sa dialectique, et entreprend avec faste de nous prouver par
ses démonstrations syllogistiques, que quelque chose se fait; que
quelque chose se meut ; que la neige est blanche; que nous n'avons
pas des cornes; pendant qu'il suffirait d'opposer à tout cela
l'évidence de la chose, pour réfuter tous ces sophismes qu'ils
proposent avec tant de hauteur, et qui certainement n'ont pas plus
de force, que le témoignage contraire, qui se tire tout
naturellement de ce qui se voit avec évidence.
C'est pour
cette raison qu'un philosophe à qui on proposait un sophisme contre
l'existence du mouvement, se mit à marcher sans rien dire : et dans
l'usage de la vie, les hommes parcourent les terres et les mers,
bâtissent des vaisseaux et des maisons, et font des enfants, sans se
mettre en peine des subtilités que l'on propose contre le mouvement
et la génération.
On rapporte
un bon mot du médecin Hérophilus. (Il était contemporain de ce
Diodore, qui a donné dans sa dialectique ridicule, des arguments
sophistiques sur plusieurs choses, et surtout contre le mouvement.)
Diodore ayant l'épaule démise, et étant allé trouver Hérophilus pour
lui demander de le guérir, ce médecin le railla plaisamment. Ou
votre épaule, dit-il, s'est démise dans le lieu où elle
était, ou elle s'est démise dans le lien où elle n'était pas : mais
ce n'est ni où elle était, ni où elle n'était pas : donc elle ne
s'est pas démise. De manière que le sophiste le pria de laisser
là ces subtilités, et de lui appliquer quelque remède convenable
suivant sont art.
Il suffit
donc, à ce que je crois, de se conduire dans la vie, suivant les
observances communes, et les préjugés établis parmi les hommes, en
se servant de l'expérience que l'on acquiert par l'usage, sans
néanmoins établir aucun dogme; et au reste on doit s'abstenir de
juger de tout ce qui se dit parmi les dogmatiques par pure
curiosité, et qui n'est d'aucune utilité pour l'usage ou pour la
conduite ordinaire de la vie.
Or puisque la
dialectique ne saurait résoudre les sophismes quels qu'ils soient,
dont la solution pourrait être de quelque avantage; et qu'à l'égard
de ceux, dont on accorderait qu'elle peut donner la solution, cette
solution est inutile ; il faut dire que la dialectique est inutile
pour résoudre les sophismes.
De plus une
personne qui, après avoir examiné ce que disent les dialectciens sur
ce sujet, voudra les attaquer, pourra faire voir en peu de mots que
tout leur art de résoudre les sophismes est absolument superflu : et
voici comment. Les dialecticiens disent qu'ils se sont appliqués
avec force à la dialectique, non seulement pour apprendre quelles
doivent être les prémisses et la conclusion d'un bon raisonnement,
mais encore et principalement dans la vue, de savoir distinguer le
vrai et le faux, par des arguments démonstratifs : d'où vient qu'ils
appellent la dialectique, la science des choses vraies, des fausses,
et de celles qui ne sont ni vraies ni fausses. Or puisqu'ils disent
eux-mêmes, qu'une argumentation est véritable, qui de prémisses
vraies, tire une conclusion vraie, dès qu'on nous proposera un
argument qui aura une fausse conclusion, nous saurons qu'il est
faux, et nous ne le recevrons pas, parce qu'il faudra
nécessairement, ou que cet argument là n'ait pas la vertu de
conclure, ou que ses prémisses ne soient pas vraies : comme on peut
le voir évidemment par le raisonnement suivant.
Une fausse
conclusion dans un argument ou est une suite naturelle de la liaison
des prémisses, ou n'en est pas une suite: si elle n'en est pas une
suite, l'argument n'aura point la vertu de conclure ; car les
dialecticiens disent qu'un argument a cette vertu, dans lequel la
conclusion suit la liaison des prémisses. Que si cette conclusion
fausse suit naturellement des prémisses, il faut aussi que la
liaison des prémisses soit fausse, selon les préceptes de l'art des
dialecticiens; car ils disent que du faux suit le faux, mais que le
vrai ne suit point du faux. Or il est évident, par ce que nous avons
dit ci-dessus, qu'un argument qui n'a point la vertu de conclure, et
qui n'est point vrai, n'est pas même démontrable, selon eux : donc,
si un argument nous étant proposé, dont la conclusion soit fausse,
nous connaissons qu'il n'est point vrai et qu'il n'a point la vertu
de conclure, par cela seul qu'il a une fausse conclusion, nous ne
l'approuverons pas, encore que nous ne reconnaissions pas par quel
endroit il est trompeur. Car comme nous ne consentons pas, que ce
que font les joueurs de gobelets soit vrai, et que nous savons
qu'ils nous trompent, quoique nous ne sachions pas comment; de même
nous n'ajoutons pas foi à des arguments faux, qui paraissent
vraisemblables, quoique nous ne connaissions pas en quoi ils font
captieux.
Comme les
sophismes n'ont pas seulement le vice de nous conduire à quelque
chose de faux, mais qu'ils ont encore ceci de particulier, qu'ils
nous jettent dans d'autres absurdités ; on pourrait peut-être
raisonner ici d'une manière plus générale en cette sorte. Ou le
sophisme que l'on nous propose, nous conduit à quelque chose que
l'on ne doit pas admettre, ou il nous conduit à quelque chose qui
doit être admise : si c'est le second, il n'est point absurde d'y
ajouter foi ; et s'il nous conduit à quelque chose que l'on ne doit
point admettre, il ne nous faudra pas ajouter foi à une absurdité à
cause d'une vraisemblance : mais il faudra aussi que ceux qui nous
proposent cet argument, s'en désistent, puisqu'il engage à ajouter
foi à des absurdités ; s'il est vrai que leur dessein soit de
rechercher la vérité, comme ils le promettent, et non de débiter des
chicanes puériles.
Comme nous
n'allons pas nous jeter dans un précipice, parce qu'il y a un chemin
qui y conduit, et qu'au contraire nous nous, écartons de ce chemin à
cause du précipice ; tout de même s'il y a quelque argument qui nous
conduise à une choie évidemment absurde, nous ne croirons pas cette
absurdité, à cause de l'argument, mais nous laisserons là
l'argument, à cause de l'absurdité.
Quand donc on
nous proposera ainsi un argument, nous ne dirons ni oui ni non à
aucune proposition ; mais quand on nous aura proposé tout
l'argument, nous objecterons ce que nous trouverons à propos. Car si
les sectateurs dogmatiques de Chrysippe disent que quand on leur
propose le Sorite, ils doivent s'arrêter, et ne dire ni oui
ni non, pour s'empêcher de donner dans quelque absurdité ; à plus
forte raison, nous qui faisons profession de la sceptique, et qui
craignons les absurdités, devons-nous prendre garde de ne pas donner
dans le piége en accordant des prémisses : à plus forte raison
devons-nous nous abstenir de dire oui ou non à chacune des
prémisses, jusqu'à ce qu'on nous ait proposé tout l'argument.
Voilà comme
quoi, munis de ce que nous avons observé dans l'usage ordinaire de
la vie, sans établir néanmoins aucun dogme, nous évitons les
tromperies des sophismes. Mais les dogmatiques ne pourront jamais
distinguer un sophisme d'avec un bon argument, étant obligés de
juger si l'argument est en forme et concluant, et si les prémisses
sont véritables, ou s'il n'y a rien de tout cela. Car nous avons
fait voir ci-dessus, qu'ils peuvent pas connaître quelles sont les
marques et les caractères des arguments qui ont la vertu de
conclure, et qu'ils ne peuvent point juger si une chose est vraie,
n'ayant ni règle de jugement, ni démonstration, dont on convienne
certainement, comme nous l'avons fait voir par leurs propres
paroles. Ainsi eu égard à toutes ces choses, on doit conclure que
cet art tant vanté chez les dialecticiens, de résoudre les
sophismes, est tout à fait inutile.
Chap. XXIII. Des
amphibologies.
Nous
raisonnons sur la distinction des amphibologies, comme nous avons
fait des sophismes. Si l'ambiguïté consiste dans un mot qui ait deux
ou plusieurs significations, et si les mots signifient par
institution; ceux qui sont exercés dans quelque art que ce soit,
distingueront les significations qu'il est important de distinguer,
(savoir celles qui dépendent de l'expérience, parce qu'ils ont la
pratique et un usage positif et d'institution des mots qui sont
établis pour signifier les choses. Au lieu que les dialecticiens ne
les distingueront pas, comme par exemple, dans cette proposition à
double sens, Il ne faut pas désapprouver un changement de régime
dans les relâchements des maladies.
Nous voyons
de plus que dans les choses d'usage, les enfants même distinguent
fort bien les ambiguïtés, dont la distinction leur paraît être
utile. Car si quelqu'un, ayant deux esclaves nommés tous deux Manès,
dit à un enfant de faire venir Manès, l'enfant lui demandera lequel
des deux il doit appeler. Et si quelqu'un ayant des vins de
différentes sortes, dit à un enfant, verse moi à boire ; l'enfant
lui demandera duquel il veut. Ainsi l'expérience que l'on a de ce
qui est utile dans toutes les choses de la vie, fait trouver les
distinctions nécessaires. Mais à l'égard des ambiguïtés, sur
lesquelles on n'a point une expérience qui appartienne à l'usage
ordinaire de la vie, et qui ne consistent que dans les sentiments
des dogmatiques, et dont la distinction est peut-être inutile pour
vivre, si on veut se passer d'établir aucune opinion, à l'égard,
dis-je, de ces ambiguïtés, un dialecticien même qui aura quelque
sentiment particulier, sera obligé de s'abstenir d'en juger, en
suivant la méthode des sceptiques, parce qu'elles se trouveront
avoir quelque liaison avec des choses obscures, incompréhensibles et
qui n'existent peut-être point. Mais nous parlerons de cela
ailleurs.
Au reste si
quelque dogmatique prétend réfuter quelque chose de ce que nous
avons dit, il fortifiera par là, les raisons des sceptiques ; car
par les efforts qu'il sera pour nous réfuter, et par la controverse
qui fera entre lui et nous, et dans laquelle il fera impossible de
juger qui aura tort ou raison, il nous confirmera toujours davantage
dans la pensée que nous devons nous abstenir de décider sur les
choses en question.
Après avoir
parlé des amphibologies en dernier lieu, nous finissons ici le
second livre de nos institutions.
Fin du Second
Livre.