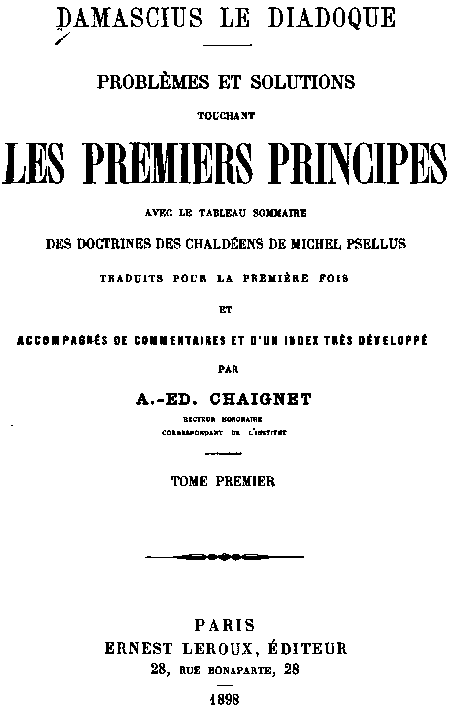|
de damascius
DAMASCIUS LE DIADOQUE
PROBLÈMES ET SOLUTIONS TOUCHANT LES PREMIERS PRINCIPES § 1 - § 10 Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer et PhIlippe Remacle
§ 1. Ce qu'on appelle le Principe unique et suprême (01) du Tout est-il au-delà (02) du Tout, ou bien une certaine chose particulière du Tout, par exemple, le sommet des choses qui procèdent de lui ; de plus, devons-nous dire que le Tout est avec le Principe, ou qu'il est après lui et procédant de lui ? Car, si l'on admet cette alternative, il y aura quelque chose en dehors du Tout, et comment cela serait-il possible ? En effet, ce à quoi rien ne fait défaut, c'est là le Tout absolu (03) ; or le Principe fait défaut : donc ce qui est après le Principe, mais en dehors du Principe, n'est pas absolument Tout (04). En outre, le Tout, qui est plusieurs, veut (05) être fini ; car l'infini ne saurait être absolument Tout. Donc il ne se manifestera rien en dehors du Tout ; car la totalité, ἡ παντότης, est une limite, et, par sa nature propre, une circonscription, où le Principe sera la limite d'en haut, et où la dernière des choses procédant du Principe est la limite d'en bas. Donc le Tout sera avec ses limites (06). En outre, le Principe est coordonné (07) aux choses qui procèdent du Principe ; car c'est de ces choses qu'il est dit et qu'il est le Principe. En effet, le causant est coordonné aux choses causées, le premier aux choses qui suivent le premier ; or, le composé de ces choses qui sont plusieurs, c'est ce que nous appelons Tout, de sorte que dans le Tout est compris le Principe ; car, en général, nous appelons Tout absolu tout ce que nous concevons, de quelque manière que ce soit (08). Or, nous avons une notion du Principe (09), et nous avons, par suite, l'habitude d'appeler Toute la ville, le prince et les sujets, Toute la race, l'auteur de la race et ses descendants. Mais si Tout est avec le Principe (10), il ne saurait y avoir quelque chose qui soit (11) le principe de Tout, puisque le principe est compris et contenu dans le Tout. Donc le composé un et unique de toutes les choses, que nous appelons Tout, est sans principe et sans cause, si nous ne voulons pas aller à l'ifini. Or, nécessairement, toute chose est ou principe ou vient d'un principe ; donc le Tout aussi ou est principe ou vient d'un principe. Mais s'il vient d'un principe, le principe ne sera pas avec le Tout, mais en dehors du Tout, en tant que principe des choses qui viennent de lui. Si le Tout est principe, qu'est-ce qui pourra procéder du Tout, comme venant d'un principe et en dehors du Tout, dans les choses inférieures, comme pour compléter et réaliser le Tout (12) : car cela même (ce complément) fait partie du Tout, car la notion du Tout absolu n'exclut rien. Donc le Tout n'est pas principe et ne vient pas d'un principe (13). En outre, le Tout, dans son ensemble, est conçu, sous un certain rapport (14), dans la pluralité et par une certaine distinction, car nous ne concevons pas le Tout sans ces caractères. Comment donc s'est-il immédiatement (15) manifesté une certaine distinction et la pluralité (16)? C'est que (17) il ne faut pas considérer partout le Tout comme consistant dans la distinction et la pluralité, mais l'Un est le sommet des plusieurs, et l'Unifié est la monade des choses distinguées, et l'Un est encore plus simple que la monade. Mais d'abord la monade est tout nombre, quoique encore replié sur lui-même. Donc Tout, en ce sens, est aussi monade. Ensuite, l'Un n'est pas une chose particulière et déterminée d'entre les plusieurs ; car il servirait à compléter les plusieurs, comme le fait, dans tout le reste, chaque chose individuelle; mais aussi nombreux que sont les plusieurs selon une certaine division, autant de plusieurs est cet Un avant la division, selon son indivisibilité absolue ; car il n'est pas Un, en tant que minimum, comme Speusippe (18) semble le croire; mais il est un, comme ayant absorbé tout (19) ; car, par sa propre simplicité, il a réuni tout (20) et a fait le tout, un. C'est pourquoi Tout vient de lui, parce qu'il est Tout, et qu'il est avant Tout; comme l'Unifié avant les choses distinguées, de même l'Un avant les plusieurs est le Tout. Mais lorsque nous répandons toute notre pensée sur le Tout, nous donnons au Tout des attributs différents, et pour le moins trois, en le concevant sous le mode uni,, sous le mode unifié et sous le mode plurifié (21). Tout vient donc bien, comme on a coutume de dire, d'Un et va à l'un (22). Si donc nous appelions Tout, selon l'habitude générale, les choses qui ont leur hypostase dans la distinction et la pluralité, nous devrons poser comme leur principe, l'Unifié, et encore plus l'Un (23). Mais si nous concevons ceux-ci aussi comme Tout, si nous les enveloppons dans les autres tous, par suite de leur rapport à eux, et du composé qu'ils forment avec eux, comme nous l'avons déjà dit plus haut, alors la logique exigera un autre principe avant le Tout, que nous n'aurons plus le droit de concevoir Tout, ni de coordonner avec les choses qui viennent de lui (24). Car si l'on disait que l'Un, quoi qu'il soit Tout, sous quelque rapport, est cependant Un avant cette espèce de Tout, et plutôt Un que Tout, — car il est Un par soi, et Tout comme causant de Tout et selon sa composition avec le Tout, et pour nous exprimer simplement, Tout secondairement, tandis que l'Un est Un éminemment, principalement, — même en s'exprimant ainsi, d'abord on mettra la dualité dans l'Un même; mais c'est nous qui le divisons, qui nous dédoublons, et, mieux encore, qui nous plurifions en face de sa simplicité; car c'est parce qu'il est Un, qu'il est Tout, dans le sens le plus simple. Mais même en disant cela, il faut que le principe du Tout soit détaché et élevé hors du Tout lui-même, hors de la totalité la plus simple et de celle qui a absorbé Tout, telle que celle de l'Un (25). § 2. Ainsi donc notre âme, par un instinct de divination prophétique, voit qu'il y a un principe du Tout, de quelque manière qu'on conçoive ce Tout, que ce principe est au-delà de Tout et ne se compose pas en un même système avec le Tout (26). Il ne faut donc pas l'appeler Principe (27) ni causant, ni premier, ni antérieur à tout, ni au-delà de Tout, encore moins (28) faut-il lui donner le nom de Tout. En un mot (29), il ne faut lui donner aucun nom ; il n'est possible ni de le concevoir ni de le (30) penser ; car, tout ce que nous concevons, soit par intuition, soit par réflexion ou est une chose déterminée du Tout — et c'est là la notion la plus véritable qu'on s'en puisse former, — ou si on en purifie l'idée (31), c'est le Tout, même si nous nous élevons, par l'analyse des choses et de nous-même, à la chose la plus simple qui est la plus compréhensive de toutes et, pour ainsi dire, la circonférence dernière non seulement des êtres, mais même des non êtres (32) ; car des êtres l'unifié et l'absolument indistinct est le dernier, car tout être est un mélange d'éléments, et des plusieurs, purement plusieurs, le dernier est l'Un. Nous ne pouvons, en effet, rien concevoir qui soit plus simple que l'Un, que l'absolument Un, qui n'est que Un. Si nous le nommons principe, cause, premier, le parfaitement simple, il n'est tout cela et le reste, là-haut, que selon l'Un (33). Mais nous, incapables de l'embrasser dans son ensemble, nous nous divisons en présence de lui, quand nous lui attribuons ces prédicats que nous trouvons en nous divisés ; mais en cela, nous le rabaissons, parce que la pluralité ne convient pas à l'Un. Ainsi il n'est pas connaissable, ni même nommable, car il serait par là plusieurs ; mais ces attributs peuvent lui appartenir selon l'Un (34); car la nature de l'Un reçoit tout, ou mieux, est une nature universelle, παντοφυής. Il n'y a rien qui ne soit pas Un ; c'est pourquoi toutes choses se déroulent pour ainsi dire de l'Un ; il est ce qui est proprement causant, premier, la fin en soi, le dernier en soi, le sommet dernier et absolu de tout, la nature une des plusieurs (35), non pas la nature qui est en eux et procède de lui, mais la nature antérieure aux plusieurs, qui engendre la nature qui est dans les plusieurs, le sommet le plus indivisible des choses qui sont, sous quelque rapport que ce soit, des touts, le plus immense enveloppement, περιοχή, de tout ce qu'on appelle, sous quelque rapport que ce soit, des touts (36). Mais si l'Un est causant de tout et embrasse tout, quel moyen qu'on puisse remonter encore au-delà de lui? Ne risquons-nous pas (37) de marcher dans le vide et d'arriver au rien en soi; car ce qui n'est pas même Un n'est véritablement rien (38). Et d'où viendrait-il qu'il y eût quelque chose au-delà de l'Un? Car les plusieurs n'ont besoin de rien autre que l'Un ; c'est pourquoi l'Un seul est causant des plusieurs, et c'est pour cela que l'Un est certainement causant, parce que le causant des plusieurs ne peut être que l'Un, car ce causant ne peut être le Rien : οὐδέν — (le rien n'étant causant de rien) — et les plusieurs non plus ne sont pas cause ; car en tant que plusieurs, ils ne peuvent constituer un ensemble coordonné ; et comment d'ailleurs les plusieurs seraient-ils un causant (39) ? Si les plusieurs étaient causants, ils ne seraient pas causants les uns des autres, parce qu'ils ne sont pas coordonnés entre eux et que cela formerait un cercle. Donc chacun en soi sera causant de lui-même ; donc aucun (40) ne sera causant des plusieurs ; donc, nécessairement, c'est l'Un qui est causant des plusieurs, c'est-à-dire causant de la composition ordonnée qu'on voit en eux; car cette composition, l'union des plusieurs les uns avec les autres, est une sorte de conspiration, ὁμόπνοια (41). § 3 (42). Si l'on objectait que cela est suffisant au principe de l'Un (43) et si l'on ajoutait, comme argument décisif, que nous n'avons aucune notion, aucune idée plus simple que l'Un, comment se ferait-il que nous pouvons pressentir quelque chose au-delà de ce dernier concept, de cette dernière notion? Et si l'on persistait dans cette affirmation, nous pardonnerions à son auteur la difficulté qu'il nous oppose ; car c'est en effet une pensée inaccessible, que nous sommes incapables de formuler. Mais cependant en nous appuyant sur les choses à nous plus connues, il faut habituer notre esprit à cet enfantement mystérieux, l'habituer à prendre cette conscience, je ne sais d'autre nom à lui donner, à la conscience ineffable (44) de cette vérité sublime. Car puisque, même dans les choses d'ici-bas, ce qui est affranchi de toute relation est plus noble que ce qui est soumis à la relativité, puisque ce qui n'entre dans aucune série est plus haut placé que ce qui fait partie d'un ordre donné, comme, par exemple, l'homme qui se voue à la science est plus noble que le politique (45), comme Cronus est supérieur au Démiurge, comme l'être est supérieur aux espèces, l'Un aux plusieurs dont l'Un est le principe, de même ce qui dépasse tout cela, qui n'est posé dans aucun système composé ni dans aucune relation, pour ainsi parler, est d'une dignité supérieure aux causants purement causants et aux causés, à tous les principes et à tout ce qui est conditionné par les principes, puisque même l'Un, par essence, est placé avant les plusieurs, le plus simple avant les plus composés, quel que soit le mode de composition, et ce qui a la plus grande compréhension avant les choses qu'il comprend au-dedans de lui-même. Et cet Un, si on veut en dire quelque chose, il faut dire qu'il est au-delà de ces oppositions et de toute opposition, non pas seulement de cette opposition contraire qui a lieu entre les choses de même rang, mais de celle qui est entre le Premier et ce qui vient après le Premier. § 4. En outre, l'Un et l'Unifié et les plusieurs et les choses distinctes qui procèdent d'eux sont donc Tout. Autant il y a de choses qui se distinguent, autant de fois est l'Unifié, d'où elles se distinguent; autant il y a de plusieurs, autant de fois est l'Un, d'où elles se déroulent (46) par évolution. L'Un n'en est pas moins un : il l'est même encore plus, puisque les plusieurs sont après lui et non en lui ; et l'Unifié n'en est pas moins unifié, puisqu'il est le coagrégat (47) des choses qui se distinguent et est antérieur à la distinction. L'un et l'autre sont Tout, soit selon la composition, soit selon leur propre nature (48). Mais le Tout ne peut pas être premier ni principe : d'un côté, parce que s'il est Tout par composition les derniers termes sont avec lui ; de l'autre, s'il est une seule des choses du Tout, parce qu'il est un et Tout à la fois selon l'absolument Un (et nous n'avons pas encore trouvé cet absolument au-delà de Tout), et parce que l'Un est le couronnement des plusieurs, comme causant de ceux qui viennent après lui. Outre cela, nous nous faisons une idée de l'Un par un concept épuré qui le ramène au plus simple et au plus compréhensif. Mais le principe le plus auguste se doit dérober à la prise de toutes nos pensées et de toutes nos conceptions, puisque, même dans les choses d'ici-bas, ce qui, en s'élevant en haut, échappe toujours à nos pensées est plus digne de notre vénération que ce qui est plus à notre portée, de sorte que ce qui est le plus parfaitement digne de notre vénération doit être ce qui échappe à toutes nos conceptions, et cela, c'est Rien ; il y a deux espèces de Rien : le Rien supérieur à l'Un, et le Rien au dessous. Si en nous exprimant ainsi, nous marchons dans le vide, il y a aussi deux manières de marcher dans le vide : l'une qui mène à l'Ineffable, το άρρητον, l'autre qui mène au néant absolu. Car celui-ci aussi, comme le dit Platon (49), est ineffable, mais dans le sens de l'imperfection, tandis que l'autre l'est dans le sens de la perfection. Maintenant si nous cherchons l'utilité et le besoin d'un tel principe, répondons : c'est le principe de tous le plus utile et le plus nécessaire, puisque, comme d'un abîme, tout procède de lui, de l'Ineffable, et selon un mode ineffable. Car ce n'est pas comme Un qu'il produit les plusieurs, ni comme Unifié qu'il produit les choses distinctes ; c'est comme ineffable qu'il produit tout, et de la même manière, ineffablement. Et si, en disant cela même qu'il est ineffable, qu'il n'est aucune des choses du Tout, qu'il est incompréhensible, notre raisonnement semble pris de vertige, il faut savoir que ces noms et ces verbes s'appliquent aux enfantements de notre esprit (50) qui s'efforcent témérairement de le sonder curieusement, mais qui se tiennent et s'arrêtent au bord de l'abîme et ne nous apprennent rien de lui. Ils ne nous révèlent que nos propres états d'esprit (51) à son égard, les doutes qu'il fait naître, l'impossibilité de les résoudre, et cela même sans clarté évidente, mais par des raisonnements qui encore ne s'adressent qu'à des gens capables de les entendre. § 5. Car nous voyons que, même au sujet de l'Un, ces enfantements de notre esprit sont également impuissants et tournent sur eux-mêmes. Car, comme le dit Platon (52), l'Un, s'il est, n'est pas même un, et s'il n'est pas, aucun terme du langage (53), ne pourra s'appliquer convenablement à lui, de sorte qu'on ne pourra ni le nier ni le désigner par un nom. Car ce sont là des choses qui ne sont pas simples. Il n'y aura de lui ni opinion ni science, qui, elles aussi, ne sont pas simples, de sorte que l'Un est totalement inconnaissable et ineffable. Quoi donc, alors ! chercherons-nous encore quelque chose au-delà de l'lneffable? Non, Platon s'est servi de l'Un comme d'un moyen terme pour nous amener ineffablement à l'ineffable, dont nous traitons maintenant, à l'ineffable au-delà de l'Un ; car, par la suppression de l'Un comme par la suppression des autres, il nous ramène à l'Un; car c'est l'Un qu'il nous montre dans le Sophiste, parce qu'il l'a vu dans une certaine position, purifié, en démontrant que l'Un en soi préexiste à l'être (54), et si, après s'être élevé jusqu'à l'Un, il reste muet, c'est qu'il a paru convenable à Platon, par respect et vénération, de garder un silence religieux, suivant l'antique usage (55) sur des sujets qu'il est absolument impossible d'exprimer par la parole ; — car c'est en réalité un sujet des plus dangereux, quand le discours tombe dans des oreilles simples. C'est pourquoi, après avoir soulevé la question du non être absolu, il l'a écartée, parce qu'il risquait de tomber dans la mer de la dissemblance, ou plutôt dans la mer du vide sans substance. Et si les démonstrations ne s'adaptent pas (56) à l'Un (57), cela n'a rien d'étonnant ; car c'est un procédé de connaissance tout humain, qui opère par division et est plus composé qu'il ne convient : en effet, les démonstrations ne conviennent même pas à l'être, parce qu'elles sont spécifiées (58), et, mieux encore, elles ne conviennent même pas aux espèces (Idées), parce qu'elles sont d'ordre logique. N'est-ce donc pas lui-même, qui, dans ses Lettres, nous a fait voir que nous ne possédons aucun signe pour exprimer l'espèce, que nous n'en avons ni vague ébauche, ni (59) nom, ni définition, ni opinion, ni science ? La Raison seule a l'intuition des espèces ; et nous ne la possédons pas encore, puisque nous nous plaisons à l'argumentation dialectique. Si donc nous émettons une pensée fondée sur les espèces, nous n'atteindrons ni l'Unifié, ni l'être, et si, par hasard, nous parvenons à former une notion composée, cette notion est impuissante à enlacer l'Un et arriver jusqu'à lui. Si nous formons une conception uniée (60), qui, pour ainsi dire, ferme les yeux pour voir l'Un en soi, et si elle s'est simplifiée jusqu'à être Un, — si toutefois il y en a une telle — c'est elle qui est la connaissance de l'Un. S'il y en a une telle, dis-je, car nous ne pouvons guère l'espérer, car l'objet en est complètement ineffable et inconnaissable, puisque l'Un est tel. Mais cependant, dans la condition intellectuelle où nous sommes maintenant, nous faisons des efforts pour distinguer ces hautes idées, au moyen de démonstrations et de représentations que nous épurons (61) ; nous cherchons à nous élever à ces pensées extraordinaires, au moyen de l'analogie et de formules négatives, rejetant comme vides toutes les choses humaines comparées à celles-là et à Celui-là, grimpant pas à pas et montant des choses d'ici-bas, qui ne sont d'aucune valeur ni d'aucun prix, à celles qui ont plus de prix et plus de valeur : et c'est précisément ce que nous sommes en train de faire ici. Il est certain que de l'absolument ineffable nous ne pouvons même pas affirmer qu'il est ineffable, et de l'Un même nous devons dire qu'il se dérobe à toute composition et de discours et de nom, comme à toute distinction, telle que la distinction du connaissable et du connaissant, et il faut le concevoir comme une sorte de surface plane et lisse (62), où aucun point ne se laisse distinguer d'un autre, comme la chose la plus simple et la plus compréhensive ; il faut le concevoir, non pas seulement Un, — comme propriété caractéristique de l'Un, — mais Tout-Un, πάντα ἕv, et Un avant Tout, et non pas Une (63) déterminée et particulière des choses du Tout. Ce sont là les pensées qu'enfante notre esprit ; voilà comment nous les purifions pour arriver à l'absolument Un, au principe véritablement un de Tout. Il est certain que le Un qui est en nous, et que nous concevons ainsi, en tant que plus uni, plus semblable par sa nature à nous-mêmes, mais inférieur, presque du tout au tout, à l'Un véritable, l'Un en nous, dis-je, se prête le mieux à une telle conception (64). De l'individuel, posé n'importe comment, le passage à l'universel et à l'absolu est facile, et même si nous ne pouvions pas du tout le saisir, du moins portés pour ainsi dire par l'Un purement Un qui est en nous, nous parvenons à nous faire une notion de l'Un avant Tout. Voilà comment l'Un est exprimable, et comment il est inexprimable; mais Celui-là (65), il faut l'adorer par un silence absolu, et plutôt encore par une ignorance absolue qui rend méprisable toute connaissance (66). § 6 (67). Voyons donc, en second lieu, comment ce principe même peut être dit absolument inconnaissable ; car, si cela est vrai, comment écrivons-nous ici toutes ces choses sur lui et en si bel ordre ? N'est-ce pas pure logomachie que ces bavardages sur des choses que nous ne connaissons pas ? S'il ne peut réellement faire partie du système du Tout, s'il n'a pas de relation au Tout, s'il n'est rien du Tout, pas même l'Un, tout cela constitue sa nature, nature que nous nous posons comme connaissant et que nous avons le désir de mettre les autres en état de connaître. De plus, cette propriété d'être inconnaissable, savons-nous qu'elle est inconnaissable ou l'ignorons-nous ? Si nous l'ignorons, comment disons-nous qu'il est absolument inconnaissable? Si nous le savons, il est certainement connaissable qu'il est inconnaissable : il est connu qu'il est inconnaissable. Outre cela, il n'est pas possible de nier une chose d'une autre, si l'on ne connaît pas la chose dont on nie l'autre : il n'est pas possible d'affirmer que ceci n'est pas cela, si on ne saisit pas complètement cela. Car ce qu'on sait qu'on ne sait pas, on n'en saurait dire qu'il est ou qu'il n'est pas, comme le dit Socrate dans le Théétète (68). Comment donc ce que nous connaissons d'une certaine manière, le nions-nous de ce que nous ignorons absolument ? Car c'est comme si un aveugle de naissance niait que la chaleur existe dans les couleurs. Sans doute il aura raison de dire que la couleur n'est pas chaude, car la chaleur est sensible au toucher et cela il le sait par le toucher ; mais la couleur, il ne la connaît pas du tout ; il n'en connaît que ceci : c'est qu'elle n'est pas sensible au toucher; il sait ainsi qu'il ne la sait pas. Mais cette connaissance n'est pas une connaissance de la couleur, mais de sa propre ignorance (69). Eh ! bien, nous aussi, en disant de Celui-là qu'il est inconnaissable, nous n'affirmons rien de lui ; nous constatons l'état de notre esprit à son égard ; car ce n'est pas dans la couleur qu'existe l'incapacité de sentir ni la cécité de l'aveugle : c'est en lui-même. C'est donc en nous aussi que réside l'inconnaissance de ce que nous ne connaissons pas ; car la connaissance du connaissable est dans le sujet connaissant et non dans l'objet connu. Mais si de même que la connaissance est dans l'objet connu et en est comme l'apparence visible, φανότης, on venait dire de même que l'inconnaissance sera dans l'objet non connu, et est pour ainsi dire son obscurité et sa non apparence qui. font qu'il est ignoré et est invisible à tous, celui qui soutient cela, ignore que toute ignorance est, comme la cécité, privation, et que l'incompréhensible (70) et l'inconnaissance sont comme l'invisible. Dans les autres choses, la privation d'une propriété en laisse subsister quelque autre. Ainsi l'incorporel, s'il est invisible, demeure intelligible, et de même le non-intelligible n'en demeure pas moins quelque autre chose ; par exemple, si une quelconque des choses n'est pas perceptible par quelque pensée de la raison (71). Mais si nous supprimons toute connaissance (72), même la plus vague, si nous disons que c'est là ce qui constitue notre complète ignorance, si nous disons que ce vis-à-vis de quoi se ferme tout œil et se ferme absolument, c'est ce que nous nommons l'inconnaissable, non pour en dire quelque chose, comme que c'est une chose, qui, par nature, n'est pas susceptible d'être perçue par la vue, comme il en est de l'intelligible, et que c'est ce qui, par nature, ne peut être pensé par une pensée substantielle même intense (73), comme il en est de l'Un, et que c'est ce qui ne laisse absolument aucune prise de lui-même, pas même un vague pressentiment — car nous ne le disons pas uniquement inconnaissable, puisque étant quelque autre chose, il a une nature, à savoir, l'inconnaissable; mais nous jugeons ne devoir lui attribuer ni l'Être, ni l'Un, ni le Tout, ni le principe de Tout, ni l'au-delà de Tout, ni absolument quoi que ce soit. Donc sa nature n'est pas non plus ceci : le Rien, l'au-delà de Tout, le supra-causant, l'incombinable avec Tout ; ce n'est pas là sa nature et ces prédicats sont uniquement les suppressions des choses qui sont après lui (74) : — si donc il en est ainsi, comment (75) disons-nous quelque chose de lui? C'est que, en connaissant les choses qui viennent après lui, par ce connaître même, quelle qu'en soit la nature, nous les jugeons indignes, de poser, pour m'exprimer ainsi, l'absolument ineffable. Car, de même que ce qui est au-delà de la connaissance particulière et déterminée est d'une valeur supérieure à ce qui est embrassé et saisi par elle, de même nécessairement ce qui est au-delà de toute ombre de connaissance est d'un ordre de dignité encore plus haut. Mais nous connaissons ce qui a cette dignité supérieure comme étant en nous, et en tant que notre propre état d'esprit, et c'est ce prodige merveilleux (76) que nous exprimons en disant qu'il est l' absolument inaccessible à nos pensées ; car nous raisonnons seulement par analogie : Si ce qui est, dans une certaine mesure, inconnaissable selon la perfection, est supérieur à ce qui est absolument connaissable, il faut nécessairement accorder que ce qui est totalement inconnaissable, selon la perfection, est ce qu'il y a de plus haut, quoiqu'il n'ait ni la suprême élévation, ni la puissance suprême, ni la dignité suprême ; car ce sont là des attributs que nous, nous lui accordons (77) ; mais lui il se dérobe à toutes nos pensées, à toutes nos conceptions ; car, par le fait même que nous ne le concevons pas, nous reconnaissons qu'il possède une essence digne d'une suprême admiration ; car si nous le concevions, nous rechercherions encore quelque autre chose antérieure et supérieure à cette conception. Il faut donc ou aller à l'infini, ou nous arrêter ici (78) à l'absolument inconnaissable. § 7 (79) Est-ce donc que nous avons quelque chose à démontrer sur Lui, et est-il démontrable, Lui, que nous estimons ne pas être perçu par l'opinion conjecturale? Non : en disant cela, nous démontrons quelque chose à son sujet, mais non pas Lui même, ni le démontrable en Lui; car il n'y a rien autre chose à dire que ceci : Lui n'est pas dans le démontrable, et il n'est pas le démontrable même (80) ; ce que nous démontrons, c'est notre ignorance à son égard, notre incapacité d'en parler (81), c'est cela qui est le démontrable. Quoi donc ! Ce que nous disons de lui, n'en avons-nous pas une opinion? Or, s'il y a une opinion (82) de lui, il est concevable par l'Opinion ; ou bien notre opinion est-elle qu'il n'y a pas d'opinion de lui? Et cette opinion, dit Aristote (83) est vraie. Si donc cette opinion est vraie, il y a un objet réel, πράγμα, auquel correspond cette opinion et par lequel elle devient vraie, car c'est par l'existence réelle de l'objet que l'opinion est vraie. Et cependant comment cela pourrait-il être ? Comment pourrait-il être vrai, ce qui est absolument inconnaissable? Si le vrai à son sujet est qu'il n'est pas même non connaissable, ce vrai est que c'est vraiment faux, car il est vrai que c'est faux. Mais ces conclusions doivent s'appliquer aux privations et au non-être relatif, où il est possible que le défaut soit accompagné d'une jouissance de la forme. C'est ainsi qu'on peut dire que l'absence de la lumière (84) que nous appelons ombre, jouit encore de la lumière; car s'il n'y avait pas de la lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Mais au non-être absolu ne peut s'ajouter aucun être quelconque, comme le dit Platon (85) ; donc non plus ni le non-être ni, par suite, la privation ne peuvent lui être attribués. Car ce qui n'est sous aucun rapport ni d'aucune manière est une expression qui ne le signifie pas véritablement et proprement (86) ; car cela même, à savoir l'expression significative, ἡ σημασία, est un être ; l'objet dont on se fait une opinion existe, quoiqu'on ait l'opinion qu'il n'existe absolument pas (88) : l'Opinable est quelqu'un des êtres. C'est pourquoi il vaut mieux dire, comme Platon, que ce qui n'est sous aucun rapport ni d'aucune manière, τὸ μηδαμῆ μηδαμῶς, dans le sens de l'imparfait, n'est ni exprimable ni opinable, comme nous le disons de Lui (89), dans le sens du Parfait. Car nous opinons qu'il n'est pas opinable, ou le raisonnement, dit-il, se détruit lui-même, et en réalité nous n'avons même pas d'opinion. Quoi donc ! Ne croyons-nous pas, ne sommes-nous pas persuadés qu'il en est ainsi? Oui : ce sont bien là nos impressions à son sujet, comme nous l'avons souvent dit; mais ce que nous avons en nous n'est que l'objet de notre opinion (90); il est donc vide, comme l'objet de notre opinion du vide et de l'infini. De même donc que des choses qui ne sont pas, nous avons des opinions comme si elles étaient, opinions imaginaires et forgées, — car nous nous représentons le soleil comme ayant la grandeur d'un pied, quoique ce ne soit pas sa dimension réelle ; de même, si nous avons quelque représentation du non-être absolu, ou de Celui-là dont nous traitons ici, c'est une représentation à nous, qui est en nous et marche sur le vide. Quand nous saisissons cette représentation, nous croyons le saisir, Lui, tandis que ce n'est rien pour nous (91), tant il dépasse notre puissance de connaître. Comment donc serait-il démontrable, puisque tout ce qui existe en nous à son sujet, c'est l'ignorance (92) ? Car comment le disons-nous inconnaissable? Par une seule raison déjà dite, à savoir que nous trouvons toujours ce qui dépasse la connaissance plus auguste qu'elle, de sorte que ce qui est au-dessus de toute connaissance, s'il était possible de le trouver, serait trouvé le plus auguste ; et il suffit pour la démonstration qu'il ne soit pas possible de le trouver, en d'autres termes, qu'il est au-dessus de Tout. Si nous le connaissions de quelque manière que ce soit, il serait lui aussi dans le Tout ; car ce que nous connaissons, c'est cela que nous appelons Tout (93), et il aurait quelque chose de commun avec le Tout, par exemple, le connaissable même. Mais les choses qui possèdent quelque chose de commun, forment un système un, de sorte que par là encore il serait avec Tout. Par cette raison donc il est nécessairement inconnaissable. Troisième raison, c'est que l'inconnaissable, comme le connaissable, fait partie des êtres, et quoique ce soit relativement, ils en font cependant partie. De même donc que la même chose est dite grande et petite par rapport à quelque autre, de même elle est dite connaissable et inconnaissable par rapport à des choses différentes, et de même qu'une même chose participe des deux idées, du grand et du petit, et est ainsi à la fois grande et petite, de même lui aussi, participant à la fois du connaissable et de l'inconnaissable, est l'un et l'autre. Et de même que le connaissable préexiste (94), de même et nécessairement préexiste, προϋπάρχει, l'inconnaissable, surtout puisqu'il est plus parfait que le connaissable. C'est ainsi que l'intelligible inconnaissable à la sensation est connaissable à la raison ; car le meilleur ne saurait être la privation de la forme réellement existante du pire, surtout quand il a son hyparxis dans l'intelligible. En effet, toute absence, ἀπουσία, et la privation semblable est ou dans la matière ou dans l'âme. Comment serait-elle dans la raison, dans laquelle tout est présent? Elle serait plutôt, en quelque manière (95) dans l'intelligible, si nous n'admettions qu'une seule espèce de privation selon le meilleur, comme nous appelons la non-forme, τὸ μὴ εἶδος, ce qui est au-dessus de la forme, le non-être ce qui est au-dessus de l'être, le rien ce qui est vraiment inconnaissable parce qu'il est supérieur à Tout et plus parfait. Si donc l'Un est le dernier connaissable des choses que nous connaissons de quelque manière que ce soit, ou que nous soupçonnons, ce qui est au-delà de l'Un est l'inconnaissable éminemment, totalement ; il est tellement inconnaissable qu'il n'a pas même l'inconnaissable pour nature, que nous ne pouvons pas l'atteindre (96) en tant qu'inconnaissable et que nous ne connaissons même pas s'il est inconnaissable. Notre ignorance à son égard est absolue; nous ne le connaissons ni comme connaissable ni comme inconnaissable. C'est pourquoi nous tournons de tous côtés autour de lui, sans pouvoir rien toucher de lui, parce qu'il n'est rien, et plus que cela encore, parce qu'il est le Rien. Ainsi donc ce qui n'est absolument pas, est ou bien au-delà de celui-ci, puisque celui-ci est négation de l'être et celui-là négation de l'Un, c'est-à-dire, τ οὒδέν; mais le Rien est vide, c'est le défaut de Tout; et n'est-ce pas là notre conception de l'ineffable? — ou bien le Rien est double : celui-ci au-delà ; l'autre, en deçà. Car l'Un est double : celui-ci est le dernier, par exemple, l'Un de la matière; l'autre, le premier, par exemple, l'Un antérieur à l'être, de sorte que des deux riens, celui-ci n'est même pas le dernier un, celui-là n'est même pas le Premier (97). Par là donc, il y a aussi un double inconnaissable et un double ineffable : celui-ci qui n'est même pas le dernier; l'autre qui n'est même pas le premier. Est-ce donc comme à nous inconnaissable que nous le posons? Cela n'aurait rien de contraire à la raison, et il serait, s'il est permis de le dire, inconnaissable à la plus auguste raison; car toute raison regarde vers l'intelligible et l'intelligible est ou espèce, εἶδος, ou être. Mais peut-être la connaissance divine le connaît, et par là il sera connaissable à la connaissance uniée et supra-substantielle. Mais celle-ci a l'intuition de l'Un, et Lui, celui dont nous parlions, est au-delà de l'Un. Pour nous résumer, s'il était connu, il serait avec les autres choses, et il serait l'Une de toutes. Car il y aurait quelque chose de commun à elles et à Lui, à savoir d'être connu, et, sous ce rapport, il serait coordonné avec le Tout. Bien plus, s'il est connaissable, du moins la connaissance divine l'embrassera; elle le définira donc ; or, toute définition remonte à un dernier terme, l'Un. Mais Lui, il est au-delà de l'Un : il est donc totalement incompréhensible et invisible ; de sorte qu'il est inconnaissable à toute connaissance, même à la connaissance divine. Outre cela, la connaissance connaît les choses connues comme étant ou subsistant (98), ou participant de l'Un. Mais Lui, il est au-delà de tout cela. Le connaissable est relatif à la connaissance et au sujet connaissant : il aurait donc une coordination et un rapport avec ces sortes de choses. En outre, l'Un lui-même risque d'être inconnaissable, puisque autre doit être le sujet connaissant et autre l'objet connu, même si l'un et l'autre se trouvent unis dans le même ; en sorte que l'Un ne saurait se connaître lui-même, du moins le réellement Un. Car cet Un ne contient aucune dualité : il n'y aura donc pas en lui un connaissant et un connu. Donc même Dieu qui existe uniquement selon l'Un et qui est en contact avec l'Un purement Un, serait en contact avec lui selon la dualité (99); mais comment le double pourrait-il toucher le simple? et s'il connaissait l'Un par l'Un, il y aurait d'un côté l'Un connaissant, de l'autre, l'Un connu, et la nature de l'Un recevra l'un et l'autre (100) c'est-à-dire sera grand et Un, de sorte qu'il n'y aura pas contact d'une chose avec une chose différente comme le connaissant touche le connu, puisque cette nature de l'Un est exclusivement cela même, de sorte que, même selon la connaissance, il n'y aura pas contact de deux choses différentes. Comment ce phénomène se produit, nous le verrons plus tard (101). Mais, à plus forte raison, Lui, qui n'est pas même Un, sera inconnaissable. Car Platon a toute raison de soutenir qu'il est impossible d'affirmer qu'on connaît et qu'on ne connaît rien (102) . Le dernier connaissable est l'Un; nous ne connaissons rien au-delà de l'Un. De sorte que tout ce que nous disons ici est une vaine rapsodie, ou bien, puisque nous savons les choses que nous savons, nous savons aussi cela d'elles, à savoir qu'elles sont indignes, s'il est permis de s'exprimer ainsi, de la première hypothèse (103); puisque ne connaissant pas encore les espèces intelligibles, nous déshonorons les images qui existent en nous, parce que la nature de ces espèces est indivisible et éternelle, et que leurs images, qui deviennent en nous et subissent des changements multiples, sont divisibles : nous ignorons donc à plus forte raison le coagrégat (104) des espèces et des genres : nous n'en possédons qu'une image, qui est le coagrégat des espèces et des genres qui sont en nous à l'état distinct et séparé; nous soupçonnons que l'être est quelque chose de tel, τοιοῦτο; mais lui-même, τοῦτο, qui est quelque chose de plus parfait, qui est le parfaitement unifié, nous ne le concevons pas. Maintenant nous concevons (105) aussi l'Un, mais non par une synthèse (106), mais nous y arrivons en simplifiant le Tout en Lui. Et en nous cette simplicité consiste à le ramener à l'Un tout pour nous (107), et elle est bien loin de toucher à cette simplicité parfaite ; car en nous l'Un et le simple ne sont pas ce que disent ces mots : ce n'est qu'un indice de cette nature. Ainsi ayant recueilli dans notre raison tout ce qui est, d'une façon quelconque, connaissable et concevable, nous jugeons être arrivés jusqu'à l'Un, s'il faut exprimer ce qui est inexprimable et se former une idée de ce qui est inconcevable. Nous jugeons cependant (108) qu'il faut poser ce qui est absolument incombinable avec le tout, sans relation de coordination avec lui, et tellement séparé et élevé qu'il ne possède pas même vraiment cette supériorité (109). Car le supérieur est toujours supérieur à quelque chose : il n'y a pas de supériorité absolue, parce que le supérieur a toujours un rapport à ce au-dessus de quoi il s'élève et, malgré sa prééminence, il fait partie d'un système coordonné. Si donc on devait le poser réellement supérieur, il ne faut pas le poser comme supérieur ; car ce mot, dans son sens exact et propre, n'exprime pas vraiment le supérieur ; car, par sa propre nature, il est en même temps coordonné, de sorte qu'il faut nier de lui ce prédicat (110). Mais la négation est une sorte de proposition : le nié est une chose ; mais le Rien n'est ni niable ni en un mot exprimable, ni connaissable de quelque façon que ce soit : de sorte qu'il n'est même pas possible de nier la négation. Mais tous ces discours et toutes ces pensées qui tournent dans un cercle, c'est là toute la démonstration que nous imaginons, au sujet de ce cette arlons. Quelle sera donc la fin de ces discours, sinon le silence complet, l'aveu que nous ne connaissons rien des choses qu'il ne nous est pas permis de connaître, parce qu'il nous est impossible de les connaître ? § 8. Mais est-ce donc qu'on ne pourrait pas poursuivre la recherche de ce sujet, en raisonnant par comparaisons? Non ! Car si c'est en nous appuyant sur les choses d'ici-bas que nous parlerons de Lui, qu'en (111) pourrons-nous dire puisque, dans ces sortes de choses et partout en elles, la monade est à la tète de son nombre propre (car il y a Une Ame, et il y a une pluralité d'âmes ; il y a Une Raison, et il y a une pluralité de raisons ; il y a Un Être et il y a une pluralité d'êtres ; il y a Une Hénade et il y a une pluralité d'hénades). La logique nous obligera donc de dire aussi : il y a Un Ineffable (112) et il y a plusieurs ineffables, et il faudra dire alors que l'ineffable engendre ineffablement l'ineffable (113). Engendrera-t-il donc une pluralité qui lui soit propre ? Ces difficultés et les difficultés semblables sont le fait de gens qui ont oublié ce que nous avons dit plus haut, à savoir que Lui (114) n'a rien de commun avec les choses d'ici-bas ; que rien n'est en lui des choses qu'on dit, qu'on pense, qu'on conjecture, pas même l'Un ni les plusieurs, qu'il n'est ni cause génératrice (115) ni aucune cause que ce soit ; qu'il ne comporte ni analogie ni assimilation ; que Lui et Eux (116) ne sont donc pas comme les choses d'ici-bas, qu'il ne faut même pas l'appeler Lui ni Eux, ἐκεῖνα; qu'il ne faut pas dire qu'il est Un, ni qu'il est plusieurs. Ce qu'il y a de mieux à faire pour nous, c'est de rester en repos, de demeurer dans les profondeurs ineffables de l'âme, sans en vouloir sortir. Et s'il est nécessaire d'en montrer quelque chose, il faut nous servir des négations, c'est-à-dire ni un ni plusieurs, ni générateur ni non générateur, ni causant, ni non causant, et pousser jusqu'à l'infini ces négations, qui, je ne sais comment, tournent absolument sur elles-mêmes. Appelons-le donc : ce qui n'est absolument pas ni nulle part, μηδαμῆ μηδαμῶς, quoique ce soit là un pur bavardage. Toutes ces appellations, en effet, lui conviennent, et plus que toutes les autres, la propriété (117) d'anéantir pour ainsi dire notre raison, comme nous l'apprend le philosophe d'Élée. C'est là sans doute une difficulté, mais facile à résoudre, car nous avons déjà dit que celui-ci (118) est pris dans le sens de l'imperfection et que Lui est posé dans le sens de la perfection, et les choses ne sont pas niées de la même manière de chacun des deux; mais en haut, l'imparfait est nié du parfait, s'il est permis de s'exprimer ainsi, en bas, le parfait est nié de l'imparfait, si l'on peut parler ainsi. Car on peut nier ces attributs de la matière comme de l'Un, mais dans les deux sens différents qui viennent d'être indiqués. Ainsi donc, comme je viens de le dire, cette difficulté est facilement levée ; mais l'autre est plus embarrassante, à savoir, si le non-être absolu est un évanouissement et un évanouissement complet de l'être, et si l'Un et, encore mieux, l'ineffable est au-delà de l'être. Le non-être complet et absolu sera donc enveloppé par l'Un qui s'étend et se prolonge (119) jusque vers l'en deçà, et il sera Un et en outre ineffable parce que l'ineffable est en deçà comme au-delà de l'Un. Mais si c'est seulement une privation de l'être, celui-ci que nous appelons le non-être absolu, recevra ces attributs (120), et cela n'a rien d'étonnant, car la matière est non-être absolument, quand on la considère selon l'Un ; car là-haut, l'Un est ce qui est au-dessus de l'être ; mais ici-bas, c'est ce qui est après l'être, et il n'est pas étonnant s'il participe aussi de l'ineffable; mais si absolument le non-être absolu n'est posé ni être, ni Un, ni ineffable, ni par affirmation, ni par négation, ni par un raisonnement réfutatif (121), ni par un raisonnement contradictoire, ni d'aucune manière que ce soit (car c'est d'un tel principe que parle l'étranger d'Élée (122)), — alors celui-là seulement est l'évanouissement de toutes les notions qu'on peut concevoir n'importe comment ; c'est celui-là même qui n'est absolument quoi que ce soit. Donc le véritablement ineffable est comme une sorte de créneau qui entoure tout ce qui est exprimable, par en haut dépasse tout et par en bas sert de fondement et d'assiette (123) à tout. Mais ce que nous disons là ne lui conviendra pas à Lui, car il n'est ni en haut ni en bas ; il n'y a rien de Lui qui soit premier, rien qui soit dernier; car il n'a pas de procession. Par conséquent, il n'est pas non plus une sorte de corniche qui entoure et couronne tout l'exprimable, il n'enveloppe pas tout; l'exprimable n'est pas au dedans de lui, ni même l'Un en soi. Est-ce donc que rien ne vient de lui dans les choses d'ici-bas? Car c'est une question qu'il faut examiner après celles-là (124). Et comment rien n'en viendrait-il, puisque le Tout vient de lui de quelque manière que ce soit ? Car ce dont chaque chose procède, elle en participe aussi, puisque cela même qu'elle est, n'est rien]autre chose (que Lui), tenant de lui et comme aspirant de lui son propre principe, se retournant vers lui, dans la mesure où elle le peut. Car qu'est-ce qui l'empêcherait, Lui, de donner quelque chose de lui-même aux choses qui procèdent de lui? Quelle autre chose serait au milieu entre elles et lui ? Comment ne serait-il pas nécessaire que toujours le deuxième soit toujours plus près que le troisième (125) du Principe suprême, et le troisième que le quatrième, et s'il en est ainsi qu'il s'en éloigne moins, et s'il en est ainsi qu'il demeure davantage dans l'essence de cette grande nature, et s'il en est ainsi, qu'il soit plus semblable à elle, de manière à être apte à en participer, de manière même à en participer ? Et comment aurions-nous de ce principe ces représentations, de quelque nature qu'elles soient, s'il n'y avait pas aussi en nous quelque trace de Lui, quelque chose qui, pour ainsi dire, s'élance vers Lui? Il faut donc certainement dire qu'étant ineffable, il communique à tout une participation de l'ineffable, selon laquelle il y a en chaque chose aussi quelque ineffable (126) ; c'est ainsi que nous reconnaissons qu'il y a des choses qui, par nature, sont plus ineffables les unes que les autres : l'Un plus que l'être, l'être plus que la vie, la vie plus que la raison, et ainsi de suite en suivant la même proportion ou mieux, dans le rapport inverse, en remontant de la matière jusqu'à la substance pensante, celles-ci selon l'imparfait, celles-là selon le parfait, s'il est permis de le dire (127). Si nous admettons cela, nous admettrons qu'il y a une procession de Lui et un certain ordre ineffable entre les choses qui procèdent de Lui, et nous reporterons dans l'ineffable tous les exprimables, puisqu'il sera réparti par fraction partout dans l'exprimable; donc nous lui donnerons trois monades et trois nombres, et non plus seulement deux, mais le nombre substantiel, l'unie, l'ineffable; et ainsi nous poserons dans l'ineffable, d'où nous les avions précédemment exclus, l'Un et les plusieurs; nous y établirons un ordre entre les premiers, les deuxièmes, troisièmes ou derniers degrés ; en outre, la persistance, μονή, la procession, la conversion, et par conséquent nous confondrons et mêlerons complètement l'exprimable avec l'ineffable. Mais non (128); il ne faut pas, comme nous l'avons dit, transporter à l'ineffable ni cette détermination (l'Un) ni les autres (les plusieurs), du moins à l'ineffable que nous voulons placer au-dessus de l'Un et des plusieurs. Donc, il ne faut pas poser ce qui est antérieur aux plusieurs comme une chose, et ce qui est, par participation, réparti par fraction dans les plusieurs, comme une autre différente. Il n'est donc pas participé et il ne transmet rien de lui-même aux choses qui viennent de lui (129) ; il ne faut pas dire que tout Dieu ineffable est antérieur à l'Un, comme l'Un est antérieur à la substance. Mais ainsi encore ici le raisonnement, se détruisant lui-même (130) nous montre cet ineffable dans tous les modes des choses (131) et posera les contradictoires, s'il part des choses (132) qui viennent après lui. Mais qu'y a-t-il d'étonnant que nous nous heurtions à ces difficultés et à d'autres semblables, même quand il s'agit de l'Un, de l'absolument unifié, de l'être ? Mais réservons ces questions. Maintenant il s'agit de savoir si on peut s'élever du principe posé le premier (133) à Lui et de quelle manière en général on peut opérer ce raisonnement remontant en partant du dernier degré des choses. Appliquons la méthode logique générale qu'on emploie, lorsqu'il s'agit des autres principes et des choses qui en procèdent jusqu'aux dernières d'entre elles. Car, de même que Parménide, en poursuivant l'Un, est arrivé à tout ce qui, de quelque manière que ce soit, est suspendu à l'Un, de même nous nous laisserons guider par ce premier posé, ou plutôt, commençant par les choses tout à fait susceptibles d'être exprimées et d'être connues par la sensation, nous monterons à Eux (134) et nous amènerons, comme dans un port, à cet état de silence qu'on doit observer à son égard, l'enfantement de la vérité. Comment donc, en prenant pour principe du raisonnement les choses évidentes, accomplirons-nous cette marche ascendante toute entière? Il faudra poser d'abord l'axiome suivant ; portés sur lui, nous nous élèverons d'ici bas là-haut, dans la mesure de nos forces et avec autant de sûreté qu'il est possible. § 9. Disons donc (135) : Ce qui n'a, par essence, besoin de rien est absolument supérieur à ce à quoi il manque quelque chose. Car ce qui a besoin d'un autre est, par nature et nécessairement, asservi à ce dont il a besoin. Si deux choses ont besoin l’une de l’autre, l’une de ceci, l'autre de cela, ni l’une ni l'autre ne saurait être principe ; car ce qu'il y a de plus propre au vrai principe, c'est de n'avoir besoin de rien. Il faut que le principe soit uniquement cela même, c'est-à-dire Principe. Le fait de n'avoir besoin de rien est sa marque distinctive, et de ne rien reconnaître qui existe avant lui : or, le principe qui a quelque manque ou besoin que ce soit, reconnaît par là même quelque chose qui existerait avant lui ; mais il ne faudrait pas s'étonner qu'une chose qui aurait besoin de quelque autre chose qui lui serait antérieure et supérieure, soit un principe, puisqu'elle pourrait être principe par rapport aux choses qui viennent après elles (136), puisqu'elle n'en a pas besoin; car si elle avait aussi besoin de ces dernières, elle ne garderait pas même vis-à-vis d'elles la valeur d'un principe. Soit, par exemple, le corps pourvu de qualités, car c'est là la première chose pour nous exprimable (137), c'est-à-dire le sensible. Mais est-il donc premier? car il y a là deux choses : le corps et la qualité qui est dans le corps, son substrat. Laquelle donc des deux natures est antérieure à l'autre? car le composé a besoin de ses parties propres ; ce qui est dans un substrat a besoin de ce substrat : dirons-nous que le corps est principe et la première substance ? Cela est impossible. D'abord parce que le principe ne saurait s'adjoindre et s'annexer rien de ce qui vient après lui et de ce qui procède de lui ; or, nous disons que le corps est qualifié : cette qualité déterminée, qui s'ajoute à lui, comme à un être autre, ne vient donc pas de lui. En second lieu, le corps est essentiellement divisible ; chacune de ses parties a besoin des autres ; le tout a besoin de toutes. Ayant des besoins, composé de parties qui ont des besoins, il ne saurait être véritablement sans besoin, ἀνενδεές. En outre, s'il n'est pas un, mais unifié, il a besoin de l'Un pour le ramasser en un tout, comme dit Platon (138) : mais il (139) est quelque chose de général, d'informe absolument, comme une espèce de matière. Donc il a besoin de recevoir l’ordre et la forme, afin de n'être pas seulement corps, mais tel ou tel corps, par exemple, corps igné, corps terrestre, et, pour tout dire d'un mot : corps ordonné et qualifié. Ainsi ce sont les choses qui s'ajoutent à lui qui le réalisent, lui donnent son essence régulière, constituent son second substrat, sa matière seconde (140). Est-ce donc la chose ajoutée qui est le principe ? Cela n'est pas possible ; car elle ne demeure pas par elle-même, ni même ne subsiste pas par elle-même. Elle est dans le substrat et a besoin de lui. Si on fait principe non le substrat même, mais un des éléments qui sont dans chaque chose individuelle, comme l'animal est dans le cheval et dans l'homme, alors même ainsi chacun des deux éléments, le substrat et ce qui est dans le substrat, et plus encore l'élément universel, comme l'animal, et les éléments propres, comme le raisonnable et l'irraisonnable, ont besoin l'un de l'autre. Les éléments ont besoin les uns des autres, et la chose composée d'éléments a besoin des éléments mêmes. En un mot, cet objet sensible, qui s'offre si évident à nos yeux, n'est ni le corps, car le corps ne meut pas lui-même la sensation, ni la qualité, car la qualité n'a pas une extension (141) commensurée à la sensation, et elle n'a pas d'appareil sensoriel corporel. Ainsi ce qui met la vision en état de distinguer ou de composer, ce n'est ni le corps ni la couleur, mais le corps coloré ou la couleur incorporée; c'est là ce qui est capable de mouvoir la vue et, en général, c'est le sensible, c'est-à-dire tel corps déterminé, qui est capable de mouvoir la sensation.
Ceci prouve évidemment une chose, à savoir que
cette qualité, qui s'ajoute au corps, est incorporelle; car s'il y a déjà corps,
il n'est pas encore sensible ; donc le corps a besoin de l'incorporel et
l'incorporel a besoin du corps ; car il n'est pas lui-même sensible. Enfin, en troisième lieu, le composé des deux n'est pas principe ; car lui-même n'est pas sans besoin : il a besoin de ses éléments propres et d'une force qui les ramasse, pour engendrer la forme une sensible. Car ce n'est pas le corps qui opère ce rapprochement, puisqu'il est étendu ; ce n'est pas la qualité qui n'existe pas à part du corps dans lequel elle est, ou avec lequel elle se trouve être ; mais c'est la forme, qui est composée. Donc, ou bien le composé se produit lui-même; mais c'est impossible, car il n'a pas la faculté de se replier sur lui-même, et surtout se divise en parties multiples, séparées ; ou bien, il n'est pas produit par lui-même, et alors il y aura un autre principe avant lui.
§ 10 (143).
Supposons que ce qu'on appelle la nature soit le principe du mouvement et du
repos, qu'il existe par soi-même et non par accident dans la chose mue et en
repos (144) ; car la nature est quelque chose de
plus simple que les formes composées qu'elle a la puissance de créer; mais si
elle est dans les choses créées par elle, et même à part d'elles, elle ne
subsiste pas avant elles, car elle a besoin d'elles pour être ce qu'elle est.
Quoiqu'elle ait quelque chose de supérieur et de distinct par rapport à elles,
cela même de les façonner et de les créer (145),
comme nous le disons, cependant elle n'est pas sans besoin, car elle a l'être
avec elles, en elles ; elle en est inséparable ; elle est du genre des êtres et
non pas des non-êtres, puisqu'elle se plonge complètement en eux et qu'elle ne
peut pas en extraire l'élément qui lui est propre. Car la propriété de faire
croître, de nourrir, d'engendrer des êtres semblables, et le principe un, qui
est antérieur à ces trois facultés, la nature, ne sera pas incorporelle dans son
Tout; mais c'est presque quelque chose du corps, une qualité, et elle n'en
diffère qu'en tant que ce qui paraît être mû et en repos du dedans, est fourni
au composé (146). Car la qualité du sensible
fournit l'apparence de la surface et ce qui tombe sous la sensation; le corps
transmet l'étendue dans tous les sens, la nature transmet l'acte naturel qui se
développe extérieurement, soit selon le lieu seulement, soit selon la fonction
de faire croître, de nourrir, d'engendrer des êtres semblables. Car par
elle-même cette nature, telle qu'est celle des végétaux, a une valeur plus
précieuse ; mais elle n'est pas, par elle-même au moins, capable de pouvoir
s'arracher des choses qu'elle administre ; car elle s'est donnée à elles tout
entière, selon sa substance même. Car c'est une espèce de vie, elle diffère du
corps naturel, dans sa signification précise, qui se manifeste plus évidemment
que la nature qui est en lui, et est pour ainsi dire mue par lui, nature qui a
bien une sorte d'activité interne, mais qui ni ne nourrit, ni ne fait croître,
ni n'engendre des êtres semblables. Car cette nature même (147)
est inséparable de son substrat et a besoin de lui, de sorte qu'ayant besoin
d'une chose plus imparfaite qu'elle-même, elle ne saurait être véritablement
principe. Car il ne faudrait pas s'étonner qu'une chose qui est une sorte de
principe ait besoin d'un principe placé au-dessus d'elle-même, mais qu'elle ait
besoin des choses qui sont après elle et dont elle est supposée être le
principe. |
|
(01) 1. Μία. Bien que ce mot soit pris souvent dans le sens de Premier, je préfère ici le traduire par Unique, parce que Premier, comme le dit Damascius lui-même, indique une relation à un second, qu'exclut l'idée de l'Unité et de l'Unicité absolue du Principe Suprême. (02) Ἐπέκεινα. (03) Πάντα ἁπλῶς. Le sens d'ἁπλῶς est fixé par Aristote, Top., II, 11, p. 115, b 33 : « ὃ ἂν μηδενός προστιθεμένου δοκῇ, εἶναι καλὸν ἢ αἴσχρον ἢ ἄλλοτι τῶν τοιούτων ἁπλῶς ῥηθήσεται... » Il signifie donc : Sine exceptione, utique, omnino. (04) Notes marginales : « Si le Principe unique du Tout est au-delà de ce Tout, ou s'il est coordonné avec lui. » — Premier raisonnement : « Si le Principe unique du Tout est au-delà du Tout, ou une certaine chose particulière du Tout. » Le commencement de ce Traité, c'est-à-dire les trente premières lignes de l'édition Ruelle, avait été déjà publié par J. Ch. Wolf, dans ses Anecdota Grœc, t. III, p. 195. Conf. Kopp. (05) Βούλεται. L'expression est caractéristique du système, qui est un système d'abstractions transformées en forces vivantes et pensantes. Cependant Aristote s'en sert pour exprimer la nature de la chose. Anal. ΙΩ., II, 27, p. 70.a. 3 : σημεῖον δὲ βούλεται εἶναι πρέτασις... ici., Met., XII, 10, 1076. a. 3 : τά δὲ ὄντα οὐ βούλεται πολιτεύεσθαι κακῶς. Conf. id., Eth. Nic., III, 2. éd. IV. II. (06) 2. Qui renfermeront le principe : car, comme dit Sénèque (de Benef., VII, 3) : « Nihil est extra Omnia », « hors du Grand Tout, il n'y a rien ». D'Holbach, Syst. d. la nat. I,1, p. i. C'est le second raisonnement. (07) Il a sa place dans le système ordonné des choses ; il fait partie de cet ordre et de ce système, dans l'hypothèse où le Tout est avec le Principe : hypothèse à laquelle est passé brusquement Damascius. Note marginale : « Troisième raisonnement. » (08) Le Tout embrasse donc le monde du réel et le monde des possibles, le système des choses et le système de nos idées. (09) Note marginale. « Deuxième raisonnement pour prouver le contraire, à savoir, qu'il est au-delà du Tout. » (10) Note marginale. « Le premier argument est réduit à l'absurde. » (11) Kopp semble avoir lu οὐκ ἂν εἴη τις ἀρχή au lieu de τί, « ne sera pas quelque chose à part, de subsistant par soi ». (12) Il n'y a plus de procession possible, par là même plus de Principe, puisque le Principe est ce dont les choses procèdent, et le Tout ne procède de rien. La création ne s'explique plus, et il n'y a plus d'auteur des choses. (13) Car s'il procédait d'un Principe, ce principe serait hors de lui, et lui ne serait plus Tout. (14) Πῶς. Κορρ fait observer que, dans les manuscrits, les enclitiques mêmes ont l'accent. (15) Εὐθύς, suapte natura. (16) La pluralité et la distinction seront-elles primitives et sans cause ? cela n'est pas possible. Les plusieurs, dont la notion semble impliquée dans la notion du Tout, y sont effacés, absorbés par l'un qui en est le couronnement. De même, dans les choses distinctes, leur unification en fait une monade. Or, l'un comme la monade excluent la pluralité. Ils sont Tout, cependant ; car l'un qui n'est pas un certain un d'entre les plusieurs, par sa simplicité parfaitement indivisible, contient Tout, avant toute division. Donc le Tout ramené à l'Unité n'enferme pas primitivement de pluralité. Il est un Tout. La conclusion, c'est que, de quelque façon qu'on entende le Tout, et il y en a trois, comme on le verra, il ne saurait être Principe. (17) Il annonce la réponse à une objection proposée. (18) Zeller (t. II, p. 656) ne croit pas que telle ait été l'opinion de Speusippe à qui Damascius l'attribue par une fausse interprétation du passage suivant de la Métaphysique d'Aristote (XIV, 1,1087, b. 30) : « Ce sont surtout ceux qui opposent l'un à la pluralité qui s'attachent à cette doctrine : car l'un sera alors le peu nombreux, ὀλίγον : car la pluralité a pour contraire la petite quantité, et le nombreux est contraire au peu nombreux, tandis qu'il est évident que l'Un exprime la mesure. » Les Platoniciens opposaient à l'Un la matière qu'ils désignaient sous les noms de grand et petit, nombreux et peu nombreux» τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον. (19) Les manuscrits donnent la leçon inintelligible κατὰ τῶν. Κορρ, très heureusement, lit : κατάπιαν, restitution confirmée par les mots ; τῆς πάντα καταπιούσης ἀπλάτητος de la fin de ce paragraphe. (20) συνανέλυσιν. Ce mot, qui ne se trouve pas dans nos lexiques, désigne la réunion en un tout de choses antérieurement divisées. (21) Note marginale. « Nous le nommons : 1. Tout. — Selon sa forme, ἰδέαν une et unique, indistincte, sous le mode unité. 2.. Tout. — Selon le rapport et la composition ordonnée de ses parties les unes avec les autres. C'est le mode unifié. 3. Tout. — Selon la distinction, signifie toutes et chacune de ses parties individuelles. C'est le mode plurifié. » Cette note émane du premier copiste du ms. A. (22) Cette formule : ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἕv, se retrouve au § 40. « Si donc nous disions que la vérité est la lumière de ce Principe Suprême, nous dirons que cette vérité qui vient de Lui est la procession des Hénades divines. — Est-ce donc que ces Hénades n'ont pas entre elles quelque chose de commun, selon quoi tous les Dieux sont dits et sont Un seul Dieu ? — Si vraiment, dirai-je, mais cependant elles procèdent comme d'Un et à Un, ὡς ἀφ' ἐνὸς καὶ πρὸς ἕν — de sorte que cet Élément commun est plusieurs πολλά. » Nous la rencontrons encore § 97 bis : « Toutes les Aphrodités et toutes les Athéna demeurent dans les limites de la nature de la première Athéna, même si elles permutent selon chaque espèce, plus particulière que la propriété (du genre) qui reste la même. C'est donc selon le caractère commun et persistant, que demeure aussi la communauté du nom et la communauté de la division (du genre créé par elle). C'est pourquoi toutes les Héros ont un commun (et le nom et le caractère) parce qu'elles procèdent d'Un et dans Un. » On voit donc se dégager le sens de la formule, qui peut s'appliquer à la logique mais surtout à la physique. — L'Un a fait tout Un : Ce Tout maintenant est conçu sous trois rapports ; il n'a pas pour cela perdu son essence; car ces trois modes ne sont qu'Un, comme lui-même : il procède donc d'Un dans Un. Aristote s'était servi de cette formule en exposant la doctrine des Platoniciens sur la science (de Anim., I, 2, 404, b. 23) (ἐπιστήμην δὲ τὰ δύο· μοναχῶς γὰρ ἐφ' ἕv. Tout mouvement logique comme physique a deux termes : ce qu'il y a de commun entre eux, c'est que ces deux termes soient d'un seul et même genre — ἕν(γένει) — et contenus l'un dans l'autre : le conséquent dans l'antécédent, l'espèce dans le genre, le petit terme dans le grand, ou le grand dans le petit selon qu'on considère l'extension ou la compréhension des termes. Mais on va toujours, dans la génération homogène, comme dans la déduction légitime, d'Un à Un : Ad idem referuntur et ab eodem pendent. — Les êtres sont synonymes, lorsqu'ils ont le même nom et la même essence. — C'est à cette catégorie des πρὸς ἓν καὶ ἀφ' ἑνός λεγόμενα qu'Aristote, Met., III. 2. 1003, b. 15 rapporte les êtres, τὰ ὄντα. qu'il ne veut pourtant pas appeler synonymes ni καθ' ἓν λεγόμενα, parce que chacun de ces termes signifie l'unité et la communauté du genre, et que les êtres n'ont de commun que l'Être universel, l'Être en soi, qui n'est pas un genre. Cependant, ils ne sont pas pour lui simplement homonymes, parce qu'ils sont plus près de l'Unité du genre que de la pure homonymie, puisqu'ils peuvent être l'objet d'une certaine science Une. Ils tiennent le milieu entre les synonymes et les homonymes. Conf. Εthic. Nic, I. 4. 1096, b. 25. « Le Bien est une chose commune par l'unité de son idée... il ne ressemble pas aux choses produites par le hasard, aux homonymes; il est commun τῷ ἀφ' ἕνος εἶναι ἢ πρὸς ἓν ἅπαντα συντετελεῖν, et il y a plusieurs sortes d'Un(met.V. 6.1016, b. 31) : « l'Un en nombre, l'Un en espèce, l'Un en genre, l'Un selon l'analogie ; — mais tous ces derniers sont ἄλλα πρὸς ἄλλο ». Les commentateurs d'Aristote ne se sont guère occupés d'interpréter la formule que par rapport à la distinction des choses appelées synonymes, homonymes et paronymes (ou dérivés). Ammonius (in Categ. I, p. 21, éd. Busse). « Voici la division des homonymes : « Les uns sont homonymes par hasard ou par accident; comme si on trouvait par hasard à Byzance et à Athènes un individu nommé Socrate. Ces homonymes sont des indivisibles, ἀδιαίρετα, ou individus. — Les autres sont homonymes par l'idée, ἀπὸ διανοίας. — Ils se divisent eux-mêmes en homonymes les uns aux autres et en paronymes. Des paronymes, les uns tirent leur nom de la cause efficiente, ἀπὸ τοῦ ποιητικού αἰτίου comme le bistouri médical et le livre médical, car ce sont des τὰ ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν — ἀφ' ἑνός, comme tirés de la cause efficiente, et πρὸς ἕν en tant que tirés de la fin, comme ὑγιεῖνον, φάρμακον. » Alexandre d'Aphrodisée (in Met. III, 1, pp. 238 et 241, éd. Mich. Hayduck) : « L'être se dit en plusieurs sens comme les ἀφ' ἑνός τε καὶ πρὸς ἓν λεγόμενα. — Aristote divise les choses qui sont ordonnées sous quelque chose de commun ὑπό τι κοινὸν τεταγμένα, en homonymes — synonymes et τὰ ἀφ' ἐνός τινος ἣ πρὸς ἓν λεγόμενα. — L'être (en soi, universel) n'est ni le genre des choses dont il est affirmé ni leur homonyme ; il est entre les homonymes et les synonymes, entre lesquels se trouvent les ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἓν λεγόμενα... id., Κ (XI, c. 3, p. 641). » L'être n'est affirmé ni homonymement des choses dont il est dit, καθ' ὧν λέγεται, ni non plus synonymement, mais comme les ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν. Les homonymes n'ont de commun que le nom ; les synonymes, le nom et la chose. Les άφ' ενός χαΐ προς Εν ne sont ni identiques aux synonymes (car alors ils participeraient de la nature en même temps que du nom) ni aux homonymes, car ils ne participeraient que du nom... ils participent du nom, mais aussi de l'essence de la chose, de l'entité, ὀντότητος, mais non éminemment, πρώτως ; ils sont en hyparxis, et ne sont pas absolument privés de la nature de la chose... Ce qui fait qu'il peut y avoir des ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἕv une seule et unique science, et qu'ils sont intermédiaires entre les homonymes et les synonymes, » comme le dit encore Philopon, de Gêner, et Corr. 1, 6, p. 132 Vitel. Les scolastiques ont repris la question et distingué la generatio sponianea ou aequivoca, ὁμωνύμως, qui ne produit que des êtres qui n'ont avec le producteur qu'une simple identité de nom, sans accord dans l'essence : une production hétérogène, à laquelle s'oppose la génération univoca, ἐκ συνωνύμων, dans laquelle le germe forme de nouveaux êtres de même nom et de même essence : (ἀφ' ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν). (23) Et le Tout aura un principe distinct de lui. (24) Note marginale: « Σημείωσαι. Remarquez bien qu'il ne faut pas le coordonner avec les choses qui procèdent d'eux ἀπ' αὐτῶν (sic, au lieu de ἀπ' αὐτῆς) à cause de leur dualité (διπλόην). » (25) Le Principe est transcendant et même au-delà de l'Un. (26) Note marginale : « ὅτι ἐπέκεινα τῶν πάντων ἡ πρώτη ἀρχή. » (27) Car le Principe est principe de quelque chose, ce qui implique une relation. (28) Σχολῇ. (29) Je lis ὅλως, au lieu d'ὅμως. (30) Note marginale : « ἡ ἀρχὴ ἐπέχεινα τῶν πάντων, ἀνεννόητον, ἀνεπίνοητον, οὐδ ἀρχὴ κυρίως λεγομένη. » Descartes, Réponse à Gassendi : Des choses qui ont été objectées contre la IIIe Méditation, § VII : « Je vous avertirai, dis-je, qu'il répugne que je comprenne quelque chose et que ce que je comprends soit infini ; car, pour avoir une idée vraie de l'infini, il ne doit en aucune façon être compris, d'autant que l'incompréhensibilité même est contenue dans la raison formelle de l'Infini. » — Le texte de Ruelle donne ὑπονοητέον. Je crois qu'il faut lire ἐπινοητέον, comme l'indique la note marginale, et comme on lit deux lignes plus bas : οὔτε νοήσαμεν ἢ ἐπινοήσαμεν. (31) Διακαθαιρόμενον, si on purifie la notion de la pluralité, on obtient, comme dit Kopp : mera et sincera forma conceptum ; — ou une notion individuelle ou une notion générale, où la forme pure apparaît seule. (32) Tel que le τί des Stoïciens, le genre suprême, l'Etwas de Hegel. (33) Ἐκεῖ. Kopp : « Ibi (in inaccessa, impenetrabili et inexpugnabili naturœ suœ arce). » J'entends plus simplement « dans la région de l'intelligible ». On pourrait encore traduire : « Ici tous ces attributs et tous les autres ne sont entendus que selon l'Un. » (34). Ἢ καὶ ταύτα. Kopp fait la proposition interrogative : « An hœc quoque in eo secundum suam naturam insunt ? » (35) Kopp supplée ici : multorum genitrix. (36) Ὅλων. Le mot ὅλον enferme, outre ridée de la totalité, l'idée d'un ordre des parties constituées de l'essence. Ici il ne semble pas différer de πάντων. Kopp le traduit par : « Solida ». (37) Μήποτε signifie non pas précisément « peut-être », mais une affirmation atténuée, comme ἴσως, σχεδόν : non dubitantis, sed modeste asseverantis est. N'est-ce pas vrai que? n'est-il pas vrai que? (38) Ruelle lit : οὐδέν ; Kopp, οὐδέ « n'est véritablement pas ». (39) Αἴτιον que je distingue de αἰτία. (40) Au lieu de rapporter οὐδέν à τῶν πολλῶν Kopp l'entend absolument : les plusieurs n'auraient pas de causant. (41) Ce paragraphe a été traduit en latin. par Kopp. (42) Y a-t-il ou n'y a-t-il pas quelque chose de plus simple que l'Un ? On ne peut pas s'arrêter, dans la recherche des principes, à l'Un : un instinct obscur mais puissant nous pousse à nous élever plus haut, et à pénétrer jusqu'à ce qui est absolument parfait, et ne dépend que de lui-même. (43) C'est-à-dire pour faire de l'Un le principe premier, comme l'a fait Plotin. (44) τὴν ἀρρητον, à laquelle on ne peut donner de nom, que la parole humaine est impuissante à rendre. Il faut restituer ici au mot, comme souvent, sa valeur étymologique, pour le bien comprendre. (45) C'est la maxime même d'Aristote, Εthic, I, 3. (46) Ἐξελίττεται, l'évolution. (47) Συναίρεμα. (48) Note marginale : « πάντα, ἒν κατὰ φύσιν, πολλὰ — πάντα ἡνωμένον κατὰ συνταξιν, διακεκριμένα. Cette note obscure signifie, je crois : il y a un Tout, Un par essence, — c'est : les Plusieurs ; — il y a un Tout unifié, qui existe par composition et qui comprend les choses distinctes. » (49) Soph., 238, C. : Οὔτε φθέγξασθαι δυνατόν... τὰ μὴ ὂ, ἀλλ' ἐστιν ἀδιανόητόν τε καὶ ἀρρητον καὶ ἄφθεκτον καὶ ἄλογον. (50) Ἡμετέρων ὠδίνων. (51) Οἰκεῖα πάθη. (52) Plat.. Parm, 141 e.: οὐδ' ἄρα οὔτως ἔστιν . ὥστε ἓν εἶναι... ἀλλ' ὡς ἔοικε, τὸ ἓν οὔτε ἓν ἐστιν, οὔτε ἐστίν. Ruelle renvoie à 160 b. Mais c'est la VIe hypothèse qui pose que si l'Un n'est pas, il est tout et enveloppe l'être et le non être. (53).ΟὐδεΙς λόγος. (54) Soph 243, d. sqq. Platon ne démontre pas ici que l'Un est antérieur à l'être : il se borne à exposer les difficultés qui s'élèvent, d'une part, contre l'hypothèse qui identifie l'Un à l'être et, d'autre part, contre celle qui les sépare, c'est-à-dire contre l'hypothèse qui explique la nature des choses par un principe unique et celle qui pose plusieurs principes des choses. La note marginale : παράγει (sont produisant) : l'Ineffable, l'Un, l'Unifié ; παράγεται ἀπορρήτως (sont produits ineffablement): Tout—les plusieurs—les choses distinctes. (55) Πάντη σιωπᾶν ἀρχαιοτρόπως. Κορρ voulait lire ἀρχαιόπρεπως. L'auteur du traité de Mysteriiis, parlant des Dieux Suprêmes, dit comme Porphyre et Apollonius : διὰ σιγῆς μόνης θεραπεύεται. Sans aller jusque-là, saint Augustin reconnaît que Dieu est mieux connu par l'ignorance que par la science, et que ce que l'âme connaît de lui, c'est qu'elle connaît qu'elle ne le connaît pas (de Ord., II. 44. et id., 47) : « Scitur melius nesciendo quam sciendo... Cujus nulla scientia est in anima, nisi scire, quomodo eum nesciat. » L'auteur des écrits attribués à saint Denys l'Aréopagite dit aussi que Dieu est au-dessus de toute pensée, puisque la pensée va à l'Être et que Dieu est au-dessus de l'Être. On ne doit le nommer ni parfait ni supra-parfait, ni ineffable ni inintelligible : il est le Dieu caché, supra-ineffable, supra-incompréhensible. Pour arriver à lui, il faut nous ensevelir dans l'obscurité du non être, dans le silenee de Dieu. De Myst. Theol., 5, 1, 1; de divin, nomin., 4, 2; 92; 2, 10; 13, 3. Porphyr., de Abstin., 11, 34; ad Marc, 12. Apollonius (Ritter et Preller, Hist. Phil. Gr. Rom. § 519), « μονῳ δὲ χρῷτο πρὸς αὐτόν (Dieu) ἀεὶ τῷ κρειττονὶ λόγῳ, λέγω δὲ τῷ μή διὰ στόματος ἰόν. » (56) 1. Οὐχ ἁρμόζουσι. (57) C'est-à-dire le mode démonstratif, dialectique, logique, ne convient pas pour faire connaître ni l'Un ni l'être. (58) Εἰδητικαί : elles reposent sur la division des choses en genres et en espèces. (59) Τύπος, l'ébauche première, modelée en argile ou en cire par le sculpteur, avant de s'attaquer au marbre. (60) Voici trois modes de connaissance : Γεἰδητική, la συντηρημένη, la ἐνιαία. (61) En éliminant le particulier et l'accident. (62) Ἁλώνης τρόπον. Le mot ne se trouve pas dans nos lexiques ; il est sans doute identique à άλωνία, l'aire où l'on bat le blé. La comparaison est si bizarre que Ropp lit ἁλύσεως qu'il traduit : Spatii instar, entendant l'uniformité de l'espace vide. Ruelle lit ἅλωνος, qui a aussi le sens d'aire. (63) Οὐ μὴν ἓν τὸ τί τῶν πάντων. Comme dans Aristote, où ὁ τΙς ἄνθρωπος signifie l'individu déterminé (Catag. 1. a 22) τὸ τί, τὰ τινά, est équivalent à τα καθ' ἕκαστα. — Note marginale : « 1. — ἓν τι πάντων. — 2. — ἓν τὰ πάντα ὁμοῦ. — 3. — ἓν πρὸ πάντων. » (64) 1. C'est-à-dire que c'est dans l'analyse de notre propre esprit que nous trouvons une image, quoique à peine ressemblante, de l'Un en soi. (65) Ἐκεῖνο. Le principe qui est au-delà de Γϋη. On pourrait traduire : Lui. (66) Ἀτιμαζούσι, auprès de laquelle toute connaissance est sans prix et sans dignité. (67) Pour éclaircir ce paragraphe, Ropp cite un passage, alors inédit, tiré de Ἑρεννίου φιλοσόφου ἐξηγήσει εἰς τὰ μετὰ τὰ φυσικά, mais qui a été publié par A. Mai, t. IX, Auctor. Classicor., pp. 513-593. Ce passage, qui forme le chapitre 5 de l'ouvrage, commence ainsi : ὑπὲρ τοῦ ὑπερουσίου ἑνὸς λέγειν ἀρχόμενοι. Il est doublement inutile de le reproduire ; car il n'éclaircit pas les obscurités de notre philosophe, et de plus, il est prouvé que l'ouvrage n'est pas d'Hérennius, mais n'est qu'une compilation de Damascius lui-même et d'Alexandre d'Aphrodisée et de Philon d'Alexandrie. On ne sait rien, d'ailleurs, d'un philosophe nommé Hérennius qui aurait vécu vers ces temps, car il ne peut être confondu avec le disciple de Plotin. Em. Heitz suppose que c'est un centon fabriqué à l'époque de la Renaissance par un faussaire. (68) Théét., pp. 188 a. 191 b. 192 a. Platon ne dit pas expressément cela; il se borne à exposer les sophismes de ceux qui nient la possibilité de l'erreur. (69) Nicolas de Cusa, dans le livre : De docta ignorantia, écrit en 1440, admet aussi que la sagesse n'est que l'aveu de sa propre ignorance, et comme les Néoplatoniciens, dans son ouvrage : De conjecturis, il voit dans l'intuitio intellectualis. une comprehensio incomprehensibilis, fondée sur l'extase et qui dépasse et franchit toutes les limitations de l'intelligence finie. Dans cette intuition intellectuelle, ainsi définie, le principe de contradiction n'a plus d'application, et les contraires s'y confondent (coincidentia contradictorum). (70) Je lis ἀνόητον au lieu ά'ἀγνόητον. (71) Complétez : elle peut être perçue par la sensation. (72) Ici commence un raisonnement des plus compliqués, coupé d'incidences, qui en rompent la suite, et dont l'ἀπόδοσις ne se trouve que onze lignes plus loin, aux mots πῶς οὖν. (73) πολλῇ νοήσει. Κορρ traduit par crassa iniellectione. On pourrait entendre ; multiple, divisée. (74) C'est-à-dire des caractères empiriques. (75) C'est ici que vient l'apodose, ou la conclusion de l'argument hypothétique commençant à εἰ δέ. (76) Ce qu'il y a de merveilleux, en effet, c'est que cet objet est en nous, en tant que pensé n'importe comment; il est un état de conscience et nous n'en avons pas conscience. (77) Et qui en réalité sont indignes de lui. (78) ἀνμαγκη στῆναι. C'est la maxime bien connue et la formule même d'Aristote. (79) La nature de l'Ineffable peut-elle être démontrée, ou perçue par l'opinion? Le Rien est double; l'Un est double; l'Inconnaissable est double. (80) Les leçons des manuscrits sont fort diverses : le texte de Ruelle (ms. Α.), que je suis, donne : οὐδέ αὐτὸ, ἀλλὰ τὴν ἡμετέραν κ. τ. λ. D'autres parmi lesquels les deux de Kopp, lisent : οὐδέ αὐτὸ, ἀλλὰ οὐ κατὰ τὴν.., oὐ Kopp voudrait changer οὐ en ὅ, de sorte que Damascius voudrait dire : « Neque aliud quidquam neque illud (Demonstrabile) ipsi Recondito et abstruso inest, neque hoc ipsum quod (ἀλλὰ ὃ) quod per nostram ejus ignorationem... » Kopp entend dans cette proposition par ἐκεῖνο le démontrable : or, deux lignes plus haut, il signifie manifestement Yineffable, et on ne saurait lui donner deux significations si opposées, à si peu de distance. De plus Kopp ne rend pas le vrai sens de αὐτό, qui signifie la chose en soi, distincte et séparée des autres. Le sens me paraît donc : Le démontrable n'est pas dans l'ineffable ; l'Ineffable non plus, οὐδὲ ἐκεῖνο, n'est pas dans le démontrable, et encore moins le démontrable en soi, οὐδέ αὐτό. Voici la note de Kopp : « Uterque liber (Scil. e. f.) où quod fortasse in ὅ mutandum... Ceterum monac. (e) οὐδέ αὐτό in exteriore margine adpinxit, et οὐ κατὰ in interiore marg. adjunxit : quœ verba si quis delere velis, legere possit : « οὐδὲ ἐκεῖινο (τὸ ἀποδεικτόν) ἐστιν ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἀποδεικνυμένην... (au lieu άποδείκνυμεν). (81) ἀφασία. (82) δόξα. Une des facultés de la connaissance. (83) Où Aristote a-t-il dit cela ? (84) C'est-à-dire une privation. (85) Soph., 238, c. : « A l'être peut s'ajouter quelque autre des êtres; mais dirons-nous qu'il soit possible qu'au-non être s'ajoute jamais quelqu'un des êtres? » (86) Ἄκυρον τῆς αὐτοῦ σημασίας. On ne peut pas le définir par cette formule. (88) Il peut avoir une existence relative, sans avoir une existence réelle. (89) Ἐκεῖνο. Soph., 258, c. : Συννοεῖς οὖν ὡς οὔτε φθέγξασθαι δυνατὸν ὀρθῶς, οὔτ' εἰπεῖν, οὔτε διανοηθῆναι, τὰ μὴ ὂν αὐτὸ χαθ' αὑτὸ, ἀλλ' ἔστιν ἀδιανόητόν τι καὶ ἄρρητον καὶ ἄφθεγκτον καὶ ἄλογον. (90) Δόξασμα. (91) Οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. Elle ne nous enseigne rien de lui, il n'a aucun rapport à nous. Kopp. « Opinio nobis insinuata et in inane vacuumque descendens : quam vanam opinionem quum concepimus, ea illud ipsum (abstrusum) concipere arbitramur, quod nulla qualibetcunque ratione ad nos refertur, quia omnem nostram excessit notitiam. » (92) Ἀγνόημα : le grec a des nuances si subtiles qu'elles sont intraduisibles à toute autre langue ; ἀγνόημα n'est pas l'ignorance même, mais l'objet qu'aurait l'esprit quand il ignore, comme s'il pouvait en avoir un dans ce cas. (93) Tout ce que peut atteindre notre pensée. (94) Au connaissant. (95) Πῶς. J'en fais une enclitique, malgré l'accent que laissent souvent les manuscrits sur ces particules. Ruelle a souvent changé la ponctuation de Kopp; j'ai souvent été tenté de changer celle de Ruelle. (96) Προσβάλλειν αὐτῷ. (97) Damascius lui refuse ici ce nom, parce que le Premier implique une série ; on n'est jamais le premier que par rapport à un second. (98) Ὄντων ἢ ὑπαρχόντων, ayant l'être ou l'hyparxis. (99) C'est-à-dire en se dédoublant en sujet et objet. (100) Μέγα οὖσα καὶ ἕv. (101) § 22. (102) Théét., 199. a. οὐδέποτε συμβαίνει ὅ τις οἶδε μὴ εἰδέναι. (103) Si l'Un est, il n'est rien. — Cette hypothèse ne traite que des intelligibles. (104) 1. Tὸ συναίρεμα, le système un et entier des genres intelligibles. (105) ἐννοοῦμεν. Deux manuscrits donnent ἀγνοοῦντες. (106) Comme nous concevons l'unifié ou l'être. (107) Le texte est inintelligible : συνίσταται πρὸς ἓν ἡμῖν πάντα. M. Ruelle propose de lire πρὸς τὰ ἐν ἡμῖν πάντα. Κοpp traduit : in nobis hœc simplicitas constat ad unum nobis omnia diluens. (108) Ὅμως; je lirais volontiers ὅλως, annonçant les conclusions d'une induction précédente. (109) Tὸ ἐξηρημένον, qui serait un prédicat de lui. (110) Supérieur : ἐξηρημένον. (111) Kopp au lieu de τί λέγομεν propose de lire τὶ λέγομεν ; le sens serait alors : car si nous partons des choses d'ici-bas pour traiter de Lui, nous aurons à en dire quelque chose. (112) Le texte donne ὅ que Kopp change avec raison en ἕν qu'exige la suite et le lien logique des idées. (113) Je lis avec Ruelle, τοῦ ἀπορρήτου au lieu de τὸ ἀπόρρητον, qui pourrait se comprendre : il faut dire alors que l'ineffable est ineffablement générateur. (114).Ἐκεῖνο. (115) Παράγωγον. (116) 1. Ἐκεῖνο καὶ ἐκεῖνα, parce que Lui n'est pas seulement singulier, mais pluriel. La formule hébraïque du nom de Dieu, Elohim, qui est un pluriel, exprime cette idée. (117) Περιτροπή. Le sens est fixé par Platon, Phœdon., 95 b : μή τις ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ; τὸν λόγον — profliget, convertat, evertat, renverse sens dessus dessous. C'est l'usage que le Sophiste fait de la dialectique et du langage. v. le Soph. 259 à 263. (118) Le τὸ μηδημῆ μηδαμῶς. (119) Au lieu (Γὑπερεκτεινομένου, deux manuscrits dont Kopp adopte la leçon, donnent ὑπεχτεινομένου, avec le sens : « qui s'allonge en s'abaissant jusque dans », je conserve ὑπέρ qui, en composition, peut signifier extrêmement : « qui s'allonge dans son extension extrême jusque dans... » Kopp traduit : utpote quod ad citeriorem oram subter extendatur (ὑπεκτεινομένου) et permeet. (120) Dont nous avons dit qu'ils conviennent à Lui. (121) Κατὰ περιτροπήν. Kopp traduit par retrorsum. Le sens précis m'échappe : Platon dans le Phédon (95 b.) emploie le verbe περιτρέπειν dans la phrase : μή τις ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον où Stallbaum dit : « περιτρέπειν est verbum militare quod signiflcat in fugam convertere, facere ut milites terga sertant. Sensus igitur hic est : ne disputatio nostra irrita reddatur et parum efficax. » — Ast traduit par : Zu nichte machen. (122) Soph., 238, e (123) Ἕδρα. C'est l'ineffable de la matière. (124) Note marginale : « Vient-il quelque chose du Premier dans les choses d'en bas? » (125) Ὅτι ἀγγυτέρω. Κορρ : « expletiva conjunctio mihi esse videtur, nisi forte eam delere malis. » (126) Le divin, tout transcendant qu'il est, se communique aux choses qu'il crée, et ce qu'il leur communique, c'est le divin qu'elles portent dans leur essence. Ce n'est pas là le Panthéisme. Le Tout n'est pas Dieu, ni un mode de Dieu; mais il y a en toute chose quelque chose de Dieu, de divin. Tout être est un mystère. (127) 1. Le monde intelligible lui-même renferme des ordres de perfection et en contient, comme nous le verrons, exactement trois. §§ 139 et 173 : περὶ τῆς δευτέρας τάξεως τῶν νοητῶν — περὶ τῆς τρίτης ; et il y a entre eux des communications et comme des échanges. (128) Je lis ἣ δὲ — dans le sens adversatif — Bonitz (ad Arist. Aie/., Vil, 4, 1029. b. 29 : « ἢ τὸ oὐ καθ' αὐτό — usurpatur particula ἢ ad afferendam objectionem quam scriptor sibi ipse facit. — Il s'emploie aussi pour signifier la réponse a l'objection qu'on s'est faite. (129) Au lieu d' ἐφ' ἑαυτοῦ, je lis avec Kopp ἀφ' ἑαυτοῦ. (130) Περιτρεπόμενος ὁ λόγος. Κοpp : « trépida revolutaque disputatio reconditur, illud utique contraria pro rebus ipsi subsequentibus meditatione, concipi debere aperit. » — Il lit ἐναντίᾳ ἐπινοήσει au lieu ά'ἐνάντια ἐπινοήσειεν.
(131)
Κατὰ πάντα τρόπον, ou affectant toutes sortes de propriétés différentes
et même contradictoires. (132) Je lirais volontiers : ἐπὶ τῶν μετ' αὐτόν au lieu de ἀπό. (133) C'est le corps qualifié, comme on va le voir au § 9 : τὸ πρῶτον ἡμῖν ῥητόν, qu'il appelle ici τέθεν. (134) Ἐκεῖνα s'échange parfois avec ἐκεῖνο. L'Ineffable est aussi bien pluriel que singulier. (135) Axiome de la raison, d'où il est conclu que le corps n'est pas le Principe cherché. Note marginale : Ἀρχὴ ἀναλύσεως καὶ τὸ πρῶτον. Peut-être faudrait-il lire ἀναβάσεως, comme dans une autre note marginale : ἄλλος τρόπος τῆς ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀναβάσεως. (136) Il y a des principes relatifs. (137) Tὸ πρῶτον ἡμῖν ῥητόν, qu'il a appelé plus haut τὸ πρῶτον τεθέν. (138) Parm., 142, c. : Platon ne dit pas tout à fait cela; il dit que l'Un ne peut faire défaut à l'être ni l'être à l'Un, et que tous deux se conditionnent mutuellement. (139) Le corps. (140) Aristote, auquel fait allusion Damascius, ne dit pas « sa matière seconde », mais sa dernière matière, identique à la forme, Met., H, 6, 1045 b, 18 : ἡ ἐσχάτη ὕλη καὶ ἡ μορφὴ ταὐτὸ καὶ ἓν τὸ μὲν δυνάμει, τὸ δὲ ἐνεργίᾳ, d'après la restitution de Bonitz. La différence des deux formules, c'est que la dernière matière dernière est en puissance et la forme est en acte, et que par la puissance motrice la matière est amenée à la forme. Le mot ἔσχατος, comme celui de πρῶτος, appliqué à la matière, a deux sens : l'un absolu, l'autre relatif. (141) Διάστασις. .... (142) Se surpassent l'un l'autre, sont supérieurs l'un à l'autre. (143) Note marginale : « que la nature n'est pas le Premier. » Aristote, Phys., II, c. 1, p. 192, b. 21. (144) C'est la paraphrase de la définition d'Aristote : conf. Met., V, 4, 1015, a. 15; Phys., lI, 1. (145) Τὸ συαπλάττειν καὶ δημιουργεῖν. (146) Note marginale : τίνι διαφέρουν σώμα, ποιάτης, φύσις. (147) Des corps inanimés. |
|
|