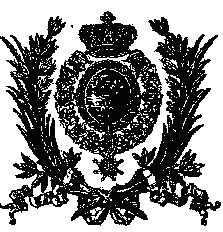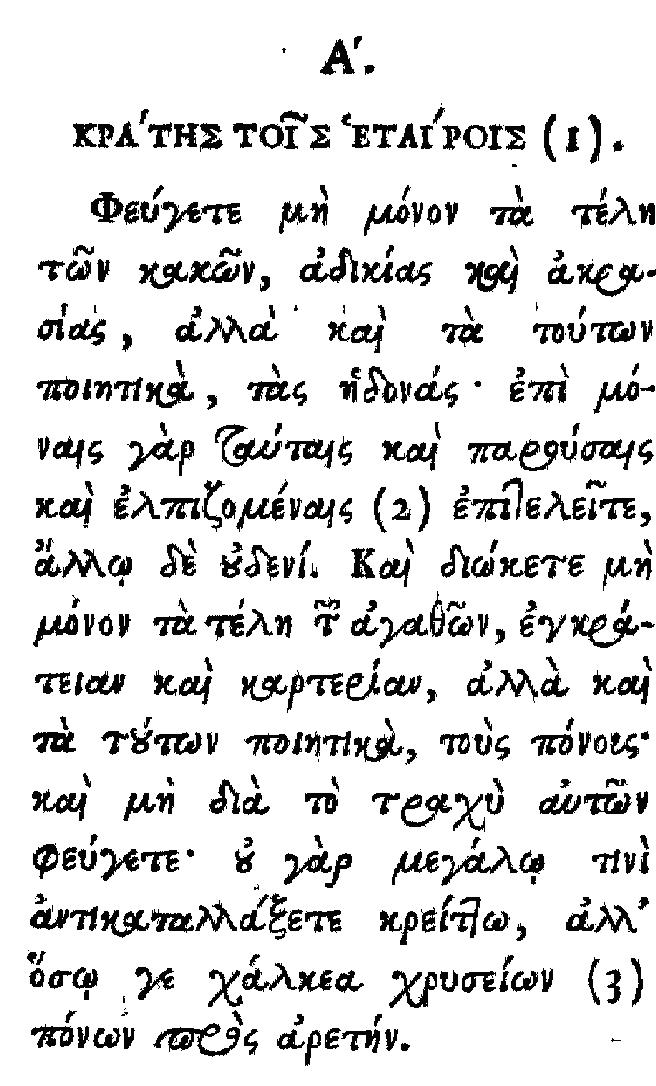|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE CRATES
CRATÈS LE CYNIQUE (pseudo)
LETTRES
NOTICES ET EXTRAITS DES MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES;, PAR L’INSTITUT ROYAL DE FRANCE; faisant suite AUX NOTICES ET EXTRAITS LUS AU COMITE ÉTABLI DANS L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. TOME ONZIEME.
PARIS, ******* IMPRIMERIE ROYALE; 1827. NOTICE DES LETTRESDE CRATÈS LE CYNIQUE;CONTENUES DANS LE MANUSCRIT 483 DU VATICAN. Par M. BOISSONADE. (EXTRAIT)
Je me propose d'examiner dans cette notice l’authenticité des lettres de-Cratès le Cynique. J'ai prouvé précédemment que les lettres de Diogène étaient pseudonymes. J’essaierai maintenant de faire voir que la correspondance du disciple n'est pas moins supposée que celle du maître. Les lettres de Cratès sont du nombre de celles dont Bentley croyait la supposition facile à démontrer, et il promettait sur cette matière une dissertation qui n'a point paru. Ménage, a prononcé très affirmativement que les lettres qui portent le nom de Cratès n’étaient pas de ce philosophe; mais il ne l'a pas prouvé. Ruhnkenius, dans ses notes sur Xénophon, donne à l'auteur le nom de Pseudo-Cratès ; mais il n'a pas expliqué les motifs qu'il avait pour s'exprimer de la sorte. Brucker, dans son Histoire de la· philosophie, prétend que les lettres de Cratès sont aussi fausses que toutes celles qui nous sont parvenues sous le nom de différents philosophes; mais il se contente de le dire. Stoll, cité par Brucker, est du même avis, et s'est pareillement dispensé des preuves. Feu M. Clavier, dans l'article Cratès de la Biographie universelle, dit que « l'on trouve quelques lettres, sous le nom de ce philosophe, dans le recueil intitulé Epistolae Graecanicœ; mais qu'elles sont évidemment supposées. » Il le dit, et se borne à le dire. Comme les simples assertions des hommes, même les plus savants, ne peuvent, en saine critique, être admises comme des preuves, le sujet que je traite pourra encore paraître un peu neuf. En effet, quoique l'opinion que je professe sur la supposition des lettres de Cratès ne me soit point particulière, je puis dire, en quelque façon, que je me la suis rendue propre, puisque j'ai le premier, je croîs, songé à en donner les motifs et les preuves. La découverte de vingt-quatre lettres inédites pourra d'ailleurs rendre cette notice un peu intéressante pour les vrais amateurs de la littérature savante, auxquels les moindres restes de l'antiquité paraissent toujours précieux. Dans les Epistolaires Grecs, donnés par Alde, et dans la réimpression de Genève, on trouve quatorze lettres sous le nom de Cratès. L'éditeur Genevois y a joint une traduction Latine dont l’auteur m'est inconnu. Commelin, qui les a réimprimées, en a changé l'ordre en quelques endroits, je ne sais trop pourquoi : la version Latine qui accompagne son texte, est d'Eilhard Lubin. Mais; il nous reste, un bien plus grand nombre de lettres sous le nom de Cratès. Le manuscrit 483 du Vatican m'en a offert vingt-quatre dont le texte.est encore inédit. Je dis le texte ; en effet, de ces vingt-quatre lettres, il y en a quinze, dont il existe une ancienne traduction Latine par Athanasius de Constantinople. Cette traduction est fort rare et à peu près inconnue. Elle a été imprimée à Paris, en Sorbonne, vers l'année 1471 et réimprimée dans la même ville vers 1486. Il y en a aussi une troisième édition, que je n'ai pu me procurer, et dont je dois l'indication à M. l'abbé Morelli, dont je transcrirai les paroles : Interpretationis Latina ab Athanasio factœ editionem habeo ego a nemine, quantum vidi, relatam. Libellus typis prodiit initio sœculi XVI, absque loci (fortasseViennae Avstriae), typographi et anni indiciis ; in-4°, inscnptus : « Diogenis, Cynici philosophi secta, auctore Bartholomaeo Coloniense, latine. Insignia Diogenis » (carmine omnia expressa ). « Cratis philosophi Cynici Epistolae (sunt XXIV una Socratis Platoni adjecta), « interprete Athanasio Constantinopolitano ; Archiense abbate.) » In fine accedunt, Epistola Joannis Stabii·Austriaci philos, et mathem. Joanni Graeco Pierio Corographo Austriae, data ex Ingelstadio, sine nota, et ejusdem carmen phaleucium pragmatice, nec non insignia typographi, quae scrutari pretium operae non est. Outre les vingt-quatre lettres de Cratès, et celle de Socrate à Platon, dont je publierai à la suite de cette notice le texte encore inédit, Athanase a traduit, au moins dans l'exemplaire de l’édition de 1471 dont je me sers, trois lettres d'Anacharsis. La première commence par ces mots : Anacharsis Medico S. P. D, invidia et poesis, &c. C'est la quatrième d'Alde. Athanasius avait, dans son manuscrit, la mauvaise leçon que j'ai trouvée dans le manuscrit 483 du Vatican. La seconde lettre, dont voici le début, Anacharsis Annoni S. P. D, Indumentum Scytharum pellis est, &c, répond à la cinquième d'Alde…... La troisième lettre de cette traduction, Anacharsis Atheniensibus F. Ridetis uel quia graece recte non loquor, &c, répond à la, première des éditions…. c'est aussi la leçon qu'Athanase avait sous les yeux» L'examen de cette traduction des lettres d'Anacharsis pourrait donner lieu à. beaucoup d'autres remarques mais elles m'écarteraient trop longtemps des lettres de Cratès et de la version qu'Athanasius nous en a donnée. J'ai observé qu'elle était très rare et à peu près inconnue. En effet, Sinner, qui en avait trouvé un manuscrit dans la bibliothèque de Berne, ne savait pas qu'elle eût été imprimée; ignorance assez répréhensible dans un bibliographe de profession, qui pouvait, qui devait même consulter la Bibliothèque Grecque de Fabricius, où il aurait appris que ces lettres n'étaient pas inédites. Mais Fabricius lui-même n'est pas ici à l'abri de la critique. Il possédait l'.édition de 1486, et il cite même le commencement de la première lettre, Fugite non solum fines malorum : pourtant il ne s'est pas aperçu que le recueil d'Athanasius était plus considérable que celui d'Alde et des autres éditeurs, ni que cette lettre même dont il rapportait les premiers mots manquait aux textes Grecs imprimés. Cette facile observation a échappé pareillement au continuateur de Fabricius, « On a, dit Diogène; de Laërte dans la vie d'Hipparchia, on a de Cratès un livre de lettres ; il s'y montre excellent philosophe, et quelquefois écrivain égal à Platon. » Cette phrase suffit seule pour prouver que nous n'avons pas les lettres de Cratès lues par Diogène de Laërte. Il n'y a rien de moins semblable au style de Platon que le style des quatorze lettres déjà connues et des vingt-quatre lettres nouvelles. Diogène de Laërte n'est pas un écrivain d'une critique bien judicieuse ni d'un goût bien sûr ; pourtant il est presque impossible qu'il ait pris de petites phrases courtes et maniérées, des antithèses et des jeux de mots, des répétitions et des négligences excessives, pour le style de Platon. Mais comme les raisons tirées du langage sont toujours un peu vagues ; comme il peut arriver (les goûts sont si bizarres !) que certains lecteurs trouvent très spirituel et très platonique ce qui à d'autres semblera ridicule et sophistique, j'abandonnerai cette face de la question, et je chercherai des arguments plus solides, sur lesquels la raison et le bon sens seront appelés à prononcer, et non le goût, juge toujours inconstant et capricieux. Selon le plus grand nombre des manuscrits et la version d'Athanasius, la septième lettre des éditions est adressée aux riches : « Allez-vous pendre! leur dit-il. Quoi ! vous avez à votre disposition des lupins, des figues, de l'eau, des exomis de Mégare, et, quand il faudrait vous tenir en repos, vous naviguez, vous labourez de grandes terres, vous trahissez, vous vous faites tyrans, vous assassinez, et le reste! Mais nous, que Diogène de Sinope a délivrés de tout mal, nous vivons dans une paix entière. Sans avoir rien, nous avons tout, tandis que vous qui avez tout, vous n'avez rien : triste effet de votre esprit contentieux, de votre jalousie, de vos craintes, de votre vanité. » A qui persuadera-t-on qu'une lettre écrite aux riches, à tous les riches en général, ne soit pas un jeu d'esprit, un badinage, ou, si l'on veut, un exercice scolastique! Il n'est pas plus aisé de croire que Cratès ait écrit aux jeunes gens pour leur conseiller de manger le gâteau cynique et de boire de l'eau. Je ne puis non plus m'imaginer que Cratès, ou qui que ce soit, ait pu écrire aux Thessaliens, à tous les Thessaliens, une lettre de trois lignes, pour leur dire que les hommes ne sont pas faits pour les chevaux, mais les chevaux pour les hommes; qu'ils songent donc à prendre soin d'eux-mêmes plus que de leurs chevaux; qu'autrement, ils ne vaudront pas même autant que leurs chevaux. Jamais un tel billet n'a pu être adressé à toute une nation. Cratès avait peut-être reproché à quelque Thessalien son goût excessif, ou celui de ses compatriotes, pour les chevaux; et un sophiste aura de ce mot fait une lettre. C'est ainsi qu'un mot connu a donné occasion à une autre lettre que ce pseudo-Cratès écrit aux Athéniens. « J'apprends, leur dit-il entre autres choses, que vous manquez d'argent ; vendez vos chevaux, et l'argent ne vous manquera pas; puis, quand vous aurez besoin de chevaux, décrétez que les ânes sont des chevaux ; » et le reste. C'est un mot, non de Cratès mais d'Antisthène. « Antisthène, dit Diogène de Laërte conseillait aux Athéniens de décréter que les ânes étaient.des chevaux. Comme ce conseil paraissait absurde : Mais vos généraux, dit-il, se font sans études; il n'y faut qu'un décret. » Cette boutade d'Antisthène, mise ici sous le nom de Cratès, rend déjà suspecte l'authenticité de la lettre; et l'on voit de plus qu'assurément Diogène de Laërte avait d'autres lettres de Cratès que les nôtres, puisqu'il ne fait aucune remarque sur cette variété de noms. Une lettre adressée par notre Cratès à ses disciples, commence en ces termes : « Exercez-vous à avoir peu de besoins ; c'est le moyen d'approcher de Dieu : le contraire en éloigne. » Cette pensée est de Socrate, dans les Mémorables de Xénophon. « Je crois, dit le philosophe au jeune Antiphon, que n'avoir point de besoins est un privilège divin ; qu'en avoir très peu, c'est être très près de la divinité. » Diogène de Laërte attribue le même sentiment à Diogène le Cynique. Je pourrais bien tirer de ces variétés un argument contre la lettre de Cratès ; mais j'aurais peur d'être ici plus rigoureux que vrai : en effet, l'idée qui fait la base de cette lettre a été fréquemment répétée ; et Cratès, disciple de Diogène, admirateur de Socrate, a pu employer, les maximes de leur philosophie. Je ne crois pas devoir abandonner si facilement l'argument que me fournit la lettre huitième des inédites. Cratès écrit à Métroclès de ne pas demander à tout le monde, de demander trois oboles aux sages, une mine aux libertins, parce que les dissipateurs dépensent trop pour pouvoir donner deux fois. C'est un mot de Diogène rapporté par Diogène de Laërte et par Stobée. « Le Cynique, dit le biographe, demandait une mine à un dissipateur. Mais pourquoi, lui dit-il, demandes-tu aux autres une obole, et à moi une mine! C'est, répondit Diogène, parce que j'espère que les autres me donneront encore ; mais recevrai-je encore quelque chose de toi ? les dieux le savent. » Cratès pouvait bien s'approprier une pensée de Socrate, devenue, en quelque sorte, une maxime générale et une espèce d'axiome de morale ; mais je ne m'imaginerai jamais qu'il ait pu placer dans une de ses lettres un mot de Diogène, un mot spirituel et piquant, sans en nommer l'auteur. Il est de plus à remarquer que c'est à Métroclès qu'il écrit, à Métroclès, disciple comme lui de Diogène, et qui devait parfaitement connaître les mots de leur maître; qui même, à ce qu'il paraît, en avait fait un recueil. Les anciens sophistes écrivaient fréquemment sous des noms supposés. Souvent ils voulurent surprendre, à leur profit, la bonne foi des princes et des particuliers, et se faire acheter chèrement les productions de leur faible plume, en y mettant un nom fameux. Mais plus d'une fois il arriva que le public voulut se tromper lui-même, et que ces ouvrages pseudonymes reçurent de la confiance trop crédule des lecteurs un caractère d'antiquité que les auteurs n'avoient pas songé à leur donner. En effet, beaucoup de ces compositions n'étaient que des exercices de style et des thèmes scolastiques·. Pour s'exercer, par exemple, au style épistolaire et en donner des modèles à ceux qui suivaient leurs écoles, les sophistes faisaient des lettres sous des noms feints, ou, pour rendre la difficulté plus grande, sous des noms historiques. Les lettres d'Aristénète, presque toutes celles d'Alciphron et de Théophylacte Simocatta, sont dans la première classe; à la seconde appartiennent celles des philosophes, celles de Diogène, de Cratès et de tant d'autres. Un mot célèbre, un fait connu servait de sujet; on l'amplifiait; on l'ornait avec plus ou moins de talent. La ressemblance des lettres dix-sept et dix-neuf de notre faux Cratès, me semble une preuve manifeste de ce que je viens d'avancer. Elles roulent toutes deux sur le même sujet. Hipparchia avait filé et fait de ses propres mains une exomis, qu'elle envoie à Cratès. Le philosophe, la lui renvoie, et lui dit qu'elle ne doit pas s'occuper de pareilles misères; qu'il les faut abandonner aux autres femmes ; que ce n'est pas, dans de pareilles vues qu'il l'a épousée. Il paraît que l'histoire philosophique, écrite ou traditionnelle, avait conservé la mémoire d'un fait de ce genre. On savait sans doute que Cratès avait refusé un manteau travaillé de la main d'Hipparchia; peut-être savait-on aussi de quelles paroles il s'était servi en le lui renvoyant ; et ces données de vinrent le sujet d'une espèce de thème, d'un exercice de style épistolaire. Deux de ces petites compositions nous seront parvenues; et le temps, qui nous a enlevé tant de tragédies, tant de poèmes et d'histoires, aura, par un caprice bizarre, respecté deux lettres sur un sujet qui eut paru plus que suffisamment traité, s'il ne l’avait été qu'une fois ; car, dire que Cratès a pu avoir deux manteaux à renvoyer à Hipparchia, qu'Hipparchia a pu n'être pas découragée par un premier refus, c'est une supposition sans vraisemblance : le ton des deux lettres est trop uniforme, pour qu'elle puisse être admise ; on s'en convaincra, en prenant la peine de les lire. Le même argument se peut tirer des lettres, douze et treize des inédites. Elles sont toutes deux adressées aux Athéniens. Cratès leur fait sentir qu'ils ne doivent pas se fâcher quand le sage leur demande l'aumône, parce qu'il ne fait que leur redemander son bien. En effet, tout est à Dieu, et les sages sont amis de Dieu ; or, entré amis tout est commun ; donc, tout ce qui appartient aux Athéniens, appartient aux sages, ainsi qu'aux dieux; donc, le sage qui demande, trois oboles, ne fait que redemander trois oboles qui sont à lui. Ce raisonnement, qui est de la façon de Socrate ou de Diogène, sert de thème à ces deux lettres. Si Cratès a pu écrire une fois aux Athéniens une pareille lettre, ce qui est déjà bien peu vraisemblable, est-il croyable qu’il ait répété cette plaisanterie assez mauvaise? La lettre seconde des éditions d'Aide et de Genève, ou la troisième de Commelin, est ainsi conçue. « A ses disciples. » —« Ne demandez point à tous les choses qui vous sont nécessaires, et n'acceptez point de dons ; car il n'est pas dans l'ordre que la vertu soit nourrie par le vice. Ne demandez qu'à ceux qui sont initiés à la philosophie; ne recevez que d'eux seuls; et vous pourrez alors redemander votre bien, et ne paraître pas demander celui des autres. » La lettre huit des inédites commence par une pensée toute pareille. « Ne demande pas à tous; dit le philosophe à Métroclès, mais à ceux qui en valent la peine, et ne prends pas également de tous. » La lettre vingt-quatre roule aussi sur la même idée. De telles lettres me semblent si maladroitement forgées, qu'on a peine à concevoir comment elles ont pu faire des dupes. La critique aujourd'hui est plus éclairée, plus soupçonneuse ; et je ne m'imagine pas qu'un faussaire pseudonyme persuadât un seul lecteur avec si peu d'art et si peu d'esprit: En est-il un, par exemple, qui, en lisant la lettre huit des éditions, ne criât aussitôt à l'imposture ? « Nous sommes enfin, dit Cratès à Diogène, libres des richesses; mais l'opinion nous tient encore esclaves; et pourtant, j'en jure, par Hercule, il n'est rien que nous ne fassions pour secouer son joug. Mais je saurai bien me racheter des mains de cette maîtresse, et je ferai voile vers Athènes, pour te faire, en retour de la liberté que.tes discours m'ont procurée, don de Cratès et de Cratès, supérieur désormais à toutes les choses de la vie. » On a vu, si l'on n'a pas négligé de lire ma note sur le texte de ce passage, que la leçon des éditions est fort inexacte; et qu'il m'a fallu suivre le sens plus régulier et plus facile qu'offre le manuscrit du Vatican ; mais les imprimés et les copies s'accordent dans cette étrange bévue de notre, philosophe, qui, écrivant de Thèbes, parle de s'embarquer, pour se rendre à Athènes. On demeurera d'accord avec moi, que la lettre· est· écrite de Thèbes, si l'on remarque qu'elle a dû être composée, par Cratès, après qu'il eut abandonné son bien aux Thébains. En faisant cet acte d'abnégation cynique, il dit au milieu de la place publique : « Cratès met Cratès en liberté. » Ce mot est rapporté par plusieurs auteurs anciens, avec quelques variétés de forme que j'ai discutées dans ma précédente Notice sur Diogène; mais les idées d'affranchissement et de liberté s'y retrouvent presque toujours, et ce sont celles qui dominent aussi dans notre lettre. Simplicius, sur Epictète, dit que. Cratès ne se cru libre, qu'après avoir renoncé à ses biens, et qu'il se couronna, comme ayant enfin recouvré sa liberté. Le pseudo-Diogène, dans la neuvième, lettre des éditions, a suivi une tradition pareille: « J'ai appris? écrit-il à Cratès, que tu.as apporté toute ta fortune, dans l'assemblée, que tu l’as cédée à la patrie, et que, debout au milieu de la place, tu as fait cette proclamation : Cratès, fils de Cratès met Cratès en liberté. » Ces mêmes idées reparaissent dans la lettre de Cratès : « Nous sommes libres des richesses, mais encore esclaves de l'opinion. Pourtant il n'est rien que nous ne fassions pour secouer son joug. Je saurai me racheter de cette maîtresse et je me donnerai à toi en retour de la liberté que je dois à tes discours. » Ces rapprochements prouvent complètement que la lettre a été écrite par Cratès après la cession de son bien, et, comme il le disait par une métaphore philosophique, après son affranchissement; ils prouvent qu'elle a été écrite de Thèbes; et; très probablement, c'est une réponse fictive à cette lettre du pseudo-Diogène que je viens de citer : « Je t'admire, dit le pseudo-Diogène : tu as su, plutôt que je ne l'espérais, vaincre l'opinion. C'est à cette phrase que Cratès répond, quand il dit qu'il n'est pas encore affranchi de l'esclavage de l'opinion. Diogène finit par lui dire de venir bien vite à Athènes, parce qu'il a encore besoin de fortifier par l'exercice sa philosophie naissante, et qu'il n'y a pas pour son cynisme récent de sûreté à rester longtemps dans une ville où personne ne lui ressemble.[1] C'est cette invitation qui fait dire à notre maladroit Cratès qu'il s'embarquera pour Athènes : absurdité palpable, puisque à moins d'avoir perdu la raison, on ne doit aller de Thèbes à Athènes que par terre ! Je suis tenté de croire que cette lettre a été composée par quelque littérateur d'Egypte ou d'Asie, qui ne connaissait même pas les localités du pays où il plaçait son héros. A ces preuves, qui me semblent assez solides, j’ajouterai l'argument que m'offre le nom de Ganymède donné à un jeune débauché dont Cratès réprimande la mollesse, dans la lettre neuvième des inédites. Un pareil nom ne semble-t-il pas imaginé d'après les mœurs de ce jeune homme, et n'indique-t-il pas jusqu'à un certain point que la lettre n'est pas une composition sérieuse, et a été écrite à un personnage en l'air! Les mœurs du Ganymède mythologique avaient rendu ce nom odieux, au moins ridicule; et il était employé fréquemment comme une injure ou comme un reproche ironique. Laudo Ganynedem, s'écrie Eumolpe, en voyant Giton empressé autour d'Encolpius. L’allusion du satirique n'est pas moins claire .......................... Tu Gaetulum Ganymedem Respice quum sities. Comme nom propre, le nom de Ganymède n'était guère donné qu'à de jeunes esclaves, et compromettait passablement leurs mœurs et celles de leur patron. Le Ganymède qui bavarde si ridiculement à la table de Trimalcion, ne peut être qu'un affranchi, parvenu. Gruter rapporte l'épitaphe d'un Flavius Ganymède, affranchi de l'empereur et pédagogue de ses enfants ; mais sûrement ce ne fut pas quand on le fit pédagogue, que ce nom lui fut donné, mais lorsque adolescent il était deliciae domini. Au besoin, ne pourrait-en pas encore argumenter d'une importante variété qu'offre le manuscrit 3047 de la Bibliothèque du Roi ? Les lettres trois, cinq et neuf de l'édition d'Alde, y sont mises sous le nom d'Apollonius de Tyane ; cette même lettre neuf, dans un manuscrit de Vienne et un manuscrit de Florence, est placée parmi celles d'Alciphron, et Wagner l'ajointe à son édition d'Alciphron, comme, un morceau inédit. Le commencement de la lettre onzième d'Aide, qui est la quatorzième de Commelin, est aussi, parmi celles d'Alciphron; dans le même manuscrit de Florence, et Wagner l'a placé parmi les fragments inédits de son auteur. Ces variétés seules suffiraient pour jeter de l'incertitude sur l'authenticité des lettres de Cratès ; ajoutées aux raisons que j'ai développées, elles les confirment et les fortifient. Par qui et à quelle époque ces lettres ont-elles été écrites ? Ce sont des questions fort embarrassantes. Je ne connais point de moyen d'y faire de réponse satisfaisante; et, dans l'état actuel des lettres, grecques, je ne croîs même pas qu'aucun critique puisse donner la solution de ce problème littéraire. Tout ce que je puis conjecturer, c'est que la lettre de Cratès sur son affranchissement pourrait bien être de la même plume que celle de Diogène à laquelle elle sert de réponse. Plusieurs des lettres attribuées à ces deux philosophes sont probablement du même écrivain. J'ai été trop loin, autrefois, en les donnant toutes à un seul auteur. Il est fort possible et même assez probable qu'Alciphron a composé les deux lettres qui, dans le manuscrit Florentin, font partie de ses opuscules épistolaires. En effet, Alciphron, qui a forgé des lettres de Ménandre, de Glycère, de Léontium, de Lamia, a pu forger aussi quelques lettres sous le nom de Cratès ! Peut-être serai-je contredit par un savant académicien, qui a paru croire que Ménandre et Glycère avaient réellement écrit les lettres qui se trouvent sous leur nom dans le second livre d'Alciphron. Mais je vais même jusqu'à me flatter de voir cet habile homme de mon avis, s'il consent à s'éloigner pour quelques moments des grands classiques qui ont jusqu'ici été l'objet de ses travaux, et à jeter un coup d'œil attentif sur le recueil du rhéteur Alciphron. S'il ne dédaigne pas de s'occuper un peu d'un si pauvre auteur, il verra bien que le Ménandre d'Alciphron est un personnage tout aussi imaginaire que son parasite Stemphylochaeron et son pécheur Philoscaphus. Je crois donc qu'Alciphron aura voulu s'exercer sous le nom de Cratès, comme sous celui de Ménandre et ces deux lettres auront ensuite été réunies par quelque éditeur on quelque copiste, à d'autres lettres composées, sous le même nom, par d'autres rhéteurs. Il pourrait, au reste, se faire qu'il y eût dans cette collection plus de deux lettres à restituer à Alciphron; mais on peut bien assurer du plus grand nombre qu'elles ne sont pas plus d'Alciphron que de Cratès. Il est impossible qu'il ait voulu plusieurs fois traiter le même sujet, et il y a beaucoup de ces épîtres qui sont trop mauvaises même pour lui. Alciphron est assurément un écrivain d'une excessive médiocrité ; pourtant, il faut lui rendre cette justice, qu’il y a dans les lettres qui lui appartiennent mille fois plus d'esprit, plus de talent, plus de style, plus de littérature et d'intelligence de l'art de composer, que dans la plupart de celles du pseudo-Cratès. Il me reste à présenter le texte des vingt-quatre lettres inédites du manuscrit du Vatican. Elles sont fréquemment altérées; et bien des passages ne pourront être corrigés qu'avec le secours d'un meilleur exemplaire. Le manuscrit quatre-vingt-un de la Bibliothèque de Saint-Marc, dont M. l'abbé Morelli a bien voulu m'envoyer les leçons pour quelques endroits, sur lesquels je l'avais consulté, ne m'a pas été d'un grand secours. Ainsi, je ne puis répondre partout de l'exactitude de ma traduction, ne pouvant répondre de celle du texte. On désirerait sans doute que je commençasse par décrire le manuscrit dont je donne ici la copie; mais il fut rendu aux commissaires de S. S. avant que j'eusse pu l'examiner avec l'attention et le soin que demande le travail d'une description. Je me rappelle simplement qu'il n'est pas fort ancien. Je suis aussi fort disposé à croire que Léon Allatius, qui fut assez longtemps garde de la Vaticane, & qui avait eu le projet de publier les lettres de Cratès, dans le septième tome de la seconde édition de ses Symmicta, les avait prises dans ce même manuscrit. Au reste, on trouvera sans doute sur ce volume les détails les plus satisfaisants et les plus amples dans un catalogue raisonné que M. Hase a fait des manuscrits Grecs et Latins qui, par les chances de la guerre, nous étaient venus des Bibliothèques étrangères, et qui, depuis, ont été restitués aux anciens et légitimes possesseurs. Ce catalogue n'est pas encore imprimé ; mais il faut espérer qu'il pourra enfin paraître. Ce sera, je pense, une belle acquisition pour la critique et l’histoire littéraire. I
I.SOCRATE A PLATON.Criton m'engage à chercher mon salut dans la fuite : il insiste, il me presse. L'estime qu'il fait de la vie est telle, qu'il veut que, pour vivre, je vive déshonoré. Puis il s'afflige dénie voir dans les fers ; comme si j'y étais par mon fait, et non par l'injustice de ceux qui m'y ont mis. J'aime bien mieux que les autres soient coupables de ma mort, que d'être, moi, coupable de m'être sauvé.II.ARISTOPHANE A THÉOPHRASTE.Un tort de vivacité vaut bien mieux qu'un tort d'habitude ; il nous nuit peu, et nous n'y pensons guère. Mais un tort qui vieillit, amène la malveillance, et une haine sans fin. Dans un tort de premier mouvement, un mot d'explication peut sou vent rétablir le calme : dans l'autre supposition, que d'orages, que d'ennuis à traverser pour arriver à un raccommodement ! Aussi mon avis est qu'il faut éviter, par dessus tout, d'offenser l’amitié : on n'y saurait trouver un prétexte plausible. Toutefois, si involontairement on a eu ce malheur, on doit au plus vite se réconcilier. Il est peut-être au-dessus des forces de l'homme de n'avoir jamais de tort; mais il y a quelque chose de noble à revenir d'une erreur : Un tel retour est tout à fait le propre d'un caractère solide.III.MÉNIPPEAUX VRAIS PORTE-BESACES.C’est fort bien fait à vous de souffrir la faim, la soif, le froid, de coucher sur la dure : ainsi l'ordonne la loi de Diogène, écrite dans l'esprit de Lycurgue, le législateur des Lacédémoniens. Si quelqu'un d'entre vous ne s'y conforme pas, il sera livré à la maladie, à l'envie, au chagrin, et à tous les maux de la même famille, Violateurs impies de l'équitable et divine loi de Sinope, leurs pieds seront tourmentés par la goutte, et leurs entrailles par le tonnerre des vents bruyants.[1] C'est la pensée de Sénèque : Subducendus populo est tener animus et parum tenax recti. Socrati et Catoni et Laelio excutere morem suum dissimilis multitude potuisset, &c.[2] Diogène dit de même, dans une de ses lettres, que le manteau cynique et la mendicité sont comme des armes, contre les sottes opinions du monde. Dans sa lettre vingt-un, il dit que le manteau, la besace et le bâton sont plus propres que les épées à protéger les hommes. Qui ne se souvient du Damasippe de la satire (Horace, II, 3), parlant des préceptes qu'il a reçus de Stertinius.Haec mihi Stertinius, sapientum octavus, amico Arma dedit.L'auteur de la vie de S. Euthymius dit que l'humilité, la sagesse, la méditation, la discrétion, l'obéissance, sont les armes des moines.[3] Icésius: dit chez Athénée, que les têtes de pourpre que l'on a fait bouillir seules sont bonnes dans les indispositions de l'estomac.[4] Le Protésilas des Héroïques de Philostrate appelle Ulysse le jouet d'Homère. En effet c'est pendant son sommeil que ses compagnons délient l'outre qui contenait les vents, et qu'ils immolent les bœufs du soleil. Ulysse dort dans l'antre des Phéaciens; il dort encore quand on le débarque sur les côtes d'Ithaque. Plusieurs Anciens se sont moqués de ce sommeil d'Ulysse, et en ont fait un reproche à Homère. On peut voir dans le traité de Plutarque, de la Manière de lire les poètes, et dans les notes de ses interprètes, comment il est possible de justifier le héros et le poète. J'ai déjà parlé de cette grande disposition d'Ulysse au sommeil, dans une note sur les Lettres de Diogène.[5] Il fait allusion à l'épreuve de l'arc, au xxie livre de l'Odyssée ; et pour bien sentir l'intention de l'auteur, il faut se rappeler que tous les anciens n'estimaient pas le talent des archers. Le vigneron des Héroïques de Philostrate dit que Protésilas pratique tous les exercices militaires, excepté celui de tirer de l'arc, qu'il regarde comme le fait des lâches! où l'on peut voir ce que j'ai autrefois remarqué. Le scholiaste de Platon dit aussi que l'usage de l'arc était déshonorant, parce que les archers frappent de loin. Lycus, dans Euripide, reproche a Hercule de ne se point tenir à la portée de la lance, et de ne jamais porter qu'un arc, la plus lâche des armes. Il faut lire sur ce passage les notes de Brodeau et de Barnès, et ajouter une bonne remarque de Spanheim sur les Césars de Julien. Safry-eddin, poète Arabe, loue le sultan Al-mélic-Alsaleh, de ce qu'il dédaigne de se servir de l'arc, et ne veut devoir son salut qu'au glaive acéré : « L'arc, ajoute-t-il, n'est à ses yeux, quand il s'agit de combats, qu'une faible femme, dont il dédaigne de prendre conseil à son conseiller, c'est le glaive tranchant, le glaive mâle. » (Journal des savants, juin 1817).6] En effet, les cyniques croyaient les femmes moralement égales aux hommes: c'était un des principes d'Antisthène selon Dioclès dans Diogène de Laërte. Antisthène tenait peut-être cette doctrine de Socrate son maître, et les stoïciens la reçurent de l'école des cyniques. Stoïci, dit Lactance, et servis et mulieribus philosophandum esse dixerunt. Le stoïcien Cléanthe avait traité le sujet dans un livre aujourd'hui perdu; mais nous avons encore sur la même question deux dissertations du stoïcien Musonius, publiées par M. Wyttenbach dans le premier livre de sa Philomathie, La première contient l'examen de ce problème : « Faut-il donner aux filles la même éducation qu'aux garçons! » Musonius est pour l'affirmative. C'était aussi l'avis de Plutarque, dans un traité dont Stobée nous a conservé quelque chose. Musonius dit que les femmes n'ont point d'autres vertus que les hommes, et que, pour arriver à des vertus pareilles, il faut des institutions pareilles. Suivant cette thèse dans ses différents détails, il se sert, pour montrer que la valeur même n'est pas étrangère aux femmes, de l'exemple des Amazones, employé aussi par notre Cratès. Musonius, dans la seconde dissertation, soutient que les femmes doivent, aussi bien que les hommes, se livrer à la philosophie. Ce qui prouve encore la nécessité d’ajouter la négation, c'est que, dans la lettre XVI, Cratès dit à Hipparchia de persister dans le cynisme, parce qu'elle n'est en rien inférieure à lui.[7] Cette lettre, qui n'est pas dans Athanasius, est un fragment de la dix-neuvième, et en a été séparée par quelque erreur de copiste.[8] C'est un vers de l'Iliade. Athanasius a omis tout cet endroit, sans doute parce que son manuscrit était incorrect ; et, ne se rappelant pas apparemment le Vers de l'Iliade que cite Diogène, il a passé ce qu'il ne pouvait traduire. Philon, qui a raconté Cette aventure de Diogène, et avec des circonstances à peu près pareilles, met aussi ce passage d'Homère dans la bouche du Cynique. Philon et notre auteur ont puisé à la même source.[9] Mais Cratès avait abandonné toutes ses propriétés de Thèbes. Comptait-il donc sur ses parents ? il aurait eu tort. Ses parents devaient le croire un peu fou. — On pourrait aussi peut-être attribuer ces paroles au prisonnier.[10] Ceci s'expliquera par la comparaison d'un beau passage d'Épictète, dans Arrien : « Les tragédies ne se font, dit le philosophe, qu'avec les riches, les rois, les tyrans. Jamais le pauvre ne fut héros de tragédie ; il n'y paraît» dans les chœurs : les rois ouvrent la pièce par des paroles de joie : Couronnez les palais. Mais au troisième ou au quatrième acte : Oh ! Cithéron, pourquoi m'as-tu reçu ? Esclave, où sont ces couronnes ? Le diadème, où est-il ! Tes satellites ne te servent à rien. —Quand donc tu abordes quelqu'un de ces hommes puissants, souviens-toi que tu abordes un personnage tragique, non pas l'acteur, mais Œdipe lui-même. »[11] Cette dernière phrase ne paraît pas se lier avec le reste. Il doit y avoir là quelque lacune.
|