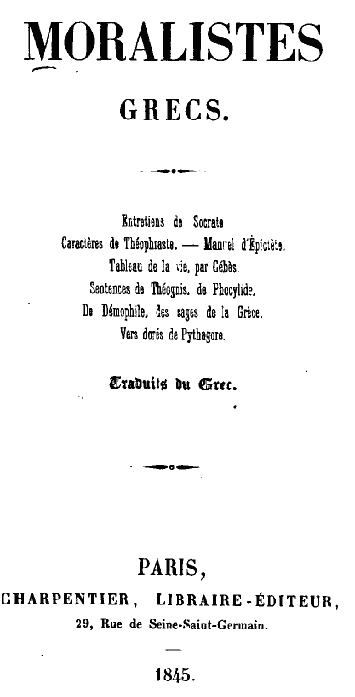|
CÉBÈS.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
TABLEAUDE LA VIE HUMAINE,PAR CÉBÈS.
En nous promenant dans le temple de Saturne, nous vîmes, entre autres offrandes faites au dieu, un tableau placé devant le sanctuaire. Le sujet en était étranger, et contenait des allégories particulières. Mais nous ne pouvions conjecturer quel en était l'auteur et le sens : car ce tableau ne représentait ni une ville, ni un Camp ; mais plutôt une enceinte qui en renfermait deux autres, l'une plus grande, l'autre plus resserrée. Devant la porte on apercevait une foule nombreuse, et dans l'enceinte une multitude de femmes. A l'entrée du vestibule de la première, se tenait un vieillard qui avait l'air de donner quelques avis à la foule qui entrait. Comme nous étions longtemps à nous tourmenter sur le sens de ces allégories : — Rien d'étonnant, étrangers, nous dit un vieillard qui se trouvait à côté de nous, si vous avez de la peine à saisir ce que signifie ce tableau ; car bien peu d'habitants le savent, et ce n'est pas une offrande faite par un citoyen. Mais il y a déjà du temps qu'il vint ici un homme plein de sens, d’une haute sagesse, et qui, dans ses discours et sa conduite, cherchait à retracer Parménide et Pythagore. — Avez-vous vu et connu cet homme? — Oui ; et comme j'étais dans ma première jeunesse, j'eus tout le temps de l'admirer. Il agitait mille questions intéressantes, et très souvent je l'ai entendu expliquer cette peinture. — Au nom des dieux, si vous n'avez des occupations trop pressantes, satisfaites notre curiosité, car nous désirons ardemment d'être initiés dans ces mystères. — On peut vous contenter, étrangers. Mais il est bon de vous avertir que ce récit a ses dangers. — Quels peuvent-ils être ? — Si vous écoutez avec fruit, et si vous comprenez bien ce que j'ai à vous dire, vous deviendrez heureux et sages : sinon, devenus insensés, malheureux, grossiers, ignorants, vous mènerez une vie déplorable. En effet, cette explication ressemble à l'énigme que proposait le sphinx aux passants ; celui qui en trouvait le mot était sauvé ; celui qui ne la comprenait pas était mis à mort par le monstre. Il en est de même de ce récit. La folie est un sphinx à l'égard des hommes. Elle ne montre qu'à travers un voile énigmatique ce qu'il y a dans la vie de bon ou de mauvais, et d'indifférent par sa nature. Celui qui ne perce pas le voile, elle ne le fait pas périr d'un seul coup, comme le malheureux que le sphinx tuait et dévorait ; mais elle le mine peu à peu, comme un criminel qui sèche dans un cachot en attendant le supplice. Si, au contraire, on entend l'énigme, la folie périt à son tour : on est à l'abri de ses atteintes, et l'on jouit pendant toute sa vie d'un bonheur inaltérable. Écoutez-moi donc sérieusement, et prêtez-moi la plus grande attention. —Dieu ! que vous excitez vivement notre curiosité ! commencez donc votre récit au plus vite. L'alternative de peines et de récompenses que vous nous annoncez vous assure de l'attention la plus soutenue. Alors le vieillard lève sa baguette, et l'étendant sur le tableau : — Sachez, dit-il, que cette enceinte qui s'offre à vos regards s'appelle la Vie, et que cette multitude nombreuse qui se tient à la porte sont ceux qui doivent y entrer. Ce vieillard, plus élevé, qui, d'une main, tient un papier, et de l'autre, semble montrer quelque chose, se nomme le Génie. Il instruit ceux qui entrent de la conduite qu'ils doivent tenir, après être venus à la vie, et de la route qu'ils doivent suivre, s'ils veulent n'y pas périr. — Quelle route leur prescrit-il, et comment? — Voyez-vous auprès de la porte par laquelle entre la multitude un trône sur lequel est assise une femme, au visage composé, à l'air persuasif, et qui tient une coupe dans sa main ? — Je la vois; mais quel est son nom? — C'est l'Imposture, qui séduit tous les hommes, et enivre de son breuvage magique ceux qui entrent dans la vie. — Quelle est cette liqueur? — L'Erreur et l’Ignorance. Après en avoir bu, ils entrent dans l'enceinte. —Tous boivent-ils de ce breuvage d'erreur? —Tous en prennent; mais les uns plus et les autres moins. Voyez-vous ensuite à l'entrée de la porte une multitude de femmes, qui, quoique différentes entre elles, ressemblent toutes à des courtisanes? — Oui, je les aperçois. — On les nomme Opinions, Passions, Voluptés. A mesure que la foule entre, elles s'élancent sur chaque passant, l'embrassent et l'emmènent. — Où les conduisent-elles? — Les unes au salut, les autres à la perte, enivrés qu'ils sont du breuvage de l’Imposture. — Dieu ! quelle funeste liqueur! — Chacune leur promet de les conduire à la source de tous les biens, et de les faire arriver au bonheur et à la fortune. Ces malheureux, par une suite de l'erreur et de l'ignorance qu'ils ont bue dans la coupe de l’Imposture, ne peuvent trouver les véritables routes à suivre dans la vie, mais errent à l'aventure. Voyez-vous encore comme les premiers entrés conforment leurs démarches irrégulières aux caprices de ces femmes? — Je le vois ; mais quelle est cette autre, qui paraît aveugle, dans le délire, et placée sur un globe de pierre? — On la nomme Fortune. Elle n'est pas seulement aveugle, mais sourde et insensée. —Quelle est son occupation? — D'errer de tous côtés, et de dépouiller les uns de ce qu'ils ont pour en enrichir d'autres, et bientôt après de retirer ses dons à ces derniers pour en favoriser de nouveaux avec aussi peu de discernement et de solidité. Aussi le symbole qui l'accompagne caractérise-t-il parfaitement sa nature. — Quel est ce symbole? — Ce globe sur lequel elle est placée. — Eh bien ! quel en est le sens? — Que ses dons ne sont ni stables ni assurés. Car, lorsqu'on met en elle sa confiance, les chutes sont considérables et dangereuses. — Mais que veut cette foule innombrable qui l'environne, et comment l'appelle-t-on ? — On l'appelle la troupe des Inconsidérés. Chacun d'eux demande les biens qu'elle jette au hasard. —Pourquoi donc n'ont-ils pas tous le même visage? pourquoi les uns paraissent-ils livrés aux transports de la joie, tandis que les autres tiennent leurs mains étendues dans l'excès de leur désespoir? — Ceux dont l'air est joyeux et riant sont ceux qui ont reçu quelques dons. Aussi l'appellent-ils Bonne Fortune. Ces autres qui versent des larmes et lui tendent des mains suppliantes sont ceux à qui elle a ravi ses premières faveurs. Ceux-là l'appellent Mauvaise Fortune. — De quelle nature sont donc ces largesses, puisqu'elles causent tant de joie à ceux qui les reçoivent et font verser des pleurs à ceux qui les perdent? —C'est ce que le commun des hommes regarde comme des biens. — Qui sont-ils ? — Les richesses, la gloire, la noblesse, les enfants, les commandements, les couronnes et les autres possessions semblables. —Ces choses ne méritent-elles pas le nom de biens? — C'est une question que nous pourrons agiter dans toute autre circonstance. Pour le présent, soyons attentifs à l'explication de l'allégorie. — J'y consens. — Après avoir passé cette porte, voyez-vous une autre enceinte, et dehors des femmes parées comme des courtisanes? — Oui. — Elles se nomment, l'une l’Intempérance, l'autre la Débauche; les deux dernières, l’Avarice et la Flatterie. —Pourquoi se tiennent-elles en cet endroit? — Elles observent ceux qui ont reçu quelque chose de la Fortune. —Ensuite, que font-elles? — Alors elles sautent de joie, les embrassent, les flattent, les pressent de demeurer avec elles, leur promettent une vie douce, exempte de peine et d'affliction. Si quelqu'un, séduit par ces enchanteresses, se déclare pour le plaisir, ce genre de vie lui paraît délicieux tout le temps que durent les sensations voluptueuses causées par leurs caresses. Mais ces délices n'ont point de réalité. Au contraire, dès qu'il sort de son ivresse, il s'aperçoit qu'il a cru faire bonne chère, mais que ses biens et sa personne ont été en proie aux déprédations et aux outrages. Ainsi, après avoir dissipé tout ce qu'il avait reçu de la Fortune, il est obligé d'obéir en esclave à ces femmes, de tout endurer, de mener la conduite la plus indécente, et de se livrer, pour leur complaire, aux plus grands excès; par exemple, de devenir frauduleux, sacrilège, parjure, traître, brigand, et de réunir tous les vices. Et lorsqu'une fois il a épuisé tous les crimes, on le livre à la Peine. — Quelle est-elle? — Voyez-vous, derrière ces sortes de gens, une espèce de soupirail, et un cachot étroit et ténébreux ? Celle qui tient un fouet se nomme la Peine. Celle qui baisse la tête sur les genoux est la Tristesse. Celle qui s'arrache les cheveux est la Douleur. — Quels sont ces deux autres qu'on voit auprès d'elles, nus, hideux, difformes et décharnés? — L'un s'appelle le Deuil, et son frère, le Désespoir. C'est donc à ces bourreaux que le malheureux est livré, pour vivre auprès d'eux dans de continuels tourments ! Ensuite on le jette dans un autre cachot, celui du Malheur, où il passe le reste de sa vie, en proie à toutes sortes de maux, à moins qu'il n'ait le bonheur de rencontrer le Repentir. — Alors, qu'arrive-t-il? — Si le Repentir vient à le rencontrer, il le délivre de ce cruel esclavage, et, lui inspirant de nouveaux désirs, de nouvelles opinions, il lui donne le choix de deux routes, dont l'une doit le conduire à la Véritable Instruction, et l'autre à la fausse. S'il choisit la meilleure, au terme de son voyage il est purifié, arraché aux dangers qui le menaçaient, et il passe le reste de sa vie dans le sein du bonheur, à l'abri de toute disgrâce, sinon la Fausse Instruction l'engage dans des routes d'erreur. — Grand Jupiter, que ce danger est terrible ! Et la Fausse Instruction, où est-elle? — Voyez-vous cette autre enceinte, et à l'entrée du vestibule cette femme parée avec tant d'art et de propreté? La multitude et les hommes légers l'appellent Instruction, mais c'est un nom qu'elle ne mérite pas. Tous ceux qui doivent être préservés sont obligés de passer ici avant de parvenir au séjour de la véritable Instruction. — Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin qui y conduise? — Oui, il y en a d'autres. — Qui sont ceux que l'on voit se promener dans l'intérieur de l'enceinte? — Ce sont les adorateurs de la Fausse Instruction, qui, séduits par elle, croient vivre avec la véritable. — Comment les appelez-vous? — Poètes, orateurs, dialecticiens, musiciens, arithméticiens, géomètres, astrologues, épicuriens, péripatéticiens, critiques, et autres qui leur ressemblent. — Et ces femmes qui paraissent courir de côté et d'autre et ressemblent aux premières du nombre desquelles étaient l’Intempérance et ses compagnes, quelles sont-elles? — Ce sont les mêmes. — Comment ! entrent-elles aussi dans cette enceinte ! — Oui certes, mais plus rarement que dans la première. — Les Opinions aussi? — Assurément. L’ignorance et la Folie font aussi partie de cette troupe. Ceux que je vous ai nommés ressentent encore les effets du breuvage funeste que leur a présenté l’imposture. Ils ne peuvent être délivrés du joug de l’Opinion et des autres vices, qu'ils n'aient abandonné leur fausse déesse, suivi la véritable route, pris une liqueur salutaire capable de les purifier, et banni l'Opinion, l’Ignorance et tous les vices qui les assiègent. C'est alors que leur délivrance est assurée. Mais tant qu'ils demeureront auprès de la Fausse Instruction, leur esclavage durera toujours, et leurs connaissances seront pour eux la source de mille maux. — Quelle route mène donc à la véritable Instruction ? — Voyez-vous cet endroit élevé qui parait inhabité, désert, cette porte étroite, et devant la porte un sentier peu fréquenté, qui semble escarpé, raboteux, impraticable? Là s'élève une hauteur d'un accès difficile, et environnée de tous côtés d'affreux précipices. Voilà le chemin qui y conduit. — Il semble en effet bien rude au seul aspect. — Auprès de la hauteur est un rocher élevé, escarpé de tous côtés, duquel deux femmes robustes et vigoureuses tendent les bras d'un air d'empressement. — Je les aperçois, mais quel est leur nom? — L'une s'appelle la Modération, et l'autre la Patience. Ce sont deux sœurs. — Pourquoi tendent-elles les mains avec cet air d'empressement? — Pour exhorter les voyageurs, parvenus jusque là, à s'armer de courage, à ne pas s'abandonner à un lâche désespoir. Elles leur disent qu'après quelques efforts ils vont trouver une route agréable. — Mais, quand ils sont arrivés au pied du rocher, comment peuvent-ils y monter? car je ne vois pas de sentier qui conduise au sommet. — Les deux nymphes en descendent, et les tirent à elles. Ensuite elles leur disent de respirer, et bientôt après leur donnent la force et la confiance, leur promettent de les conduire à la véritable Instruction, et leur montrent combien la route est belle, aplanie, sans obstacles et sans dangers. Voyez-vous encore devant ce bois une prairie charmante, éclairée par un jour pur et brillant? puis, au milieu de cette prairie, une autre enceinte et une autre porte? — Oui; mais comment nomme-t-on ces lieux? — Le séjour des Bienheureux : car c'est là qu'habitent toutes les Vertus et le Bonheur. — Que ce séjour est digne d'envie ! — Auprès de la porte vous apercevez une belle femme, pleine d'une modeste assurance, sur le déclin de l'âge mûr, simple dans son extérieur et sans aucune parure empruntée. Elle est placée, non pas sur un globe, mais sur une pierre carrée et immobile. A côté d'elle sont deux autres qui paraissent être ses deux filles. Cette déesse est l'Instruction, et ses deux compagnes la Vérité et la Persuasion. — Pourquoi est-elle placée sur une base carrée? —C'est pour montrer aux voyageurs que la route qui conduit à elle est sûre et solide, et que la possession de ses dons est assurée. — Quels sont ces dons? — La confiance et une sécurité inaltérable. — Quelle est leur utilité? — La persuasion intime et fondée, qu'on n'éprouvera plus aucun mal dans le cours de sa vie. — Dieux ! quels dons magnifiques ! Mais pourquoi se tient-elle hors de l'enceinte? — Pour guérir ses hôtes, et leur présenter un Breuvage salutaire. Dès qu'ils sont purifiés par cette liqueur, elle les conduit aux Vertus. — Quoi ! je ne vous entends pas. — Je vais me faire comprendre. Je suppose qu'un homme, attaqué d'une maladie dangereuse, soit conduit au médecin. Celui-ci commence à écarter, par des purgatifs, toutes les causes de la maladie ; ensuite il s'attache à rétablir ses forces et à lui rendre la santé. Mais si le malade refusait de se conformer aux ordonnances du médecin, n'aurait-on pas raison de le renvoyer et ne mériterait-il pas d'être emporté par la maladie? — Je vous entends. — De même lorsqu'un voyageur est parvenu jusqu'à l’Instruction, elle le guérit, et lui présente la liqueur qui doit le purifier de tous les vices qu'il a amenés avec lui. — Quels sont ces vices? — L'ignorance et l'erreur bues dans la coupe de l’Imposture, l'orgueil, la cupidité, l'intempérance, la colère, l'avarice et tous les autres auxquels il s'est livré dans la première enceinte. — Lorsqu'il est purifié, où l'envoie-t-on ? — On l'introduit dans le séjour de la Science et des autres vertus. Voyez-vous sur la porte cette troupe de femmes belles, modestes, sans parure et sans art? — La première s'appelle la Science, les autres, qui sont ses sœurs, la Force, la Justice, l’Intégrité, la Tempérance, la Modération, la Liberté, la Continence et la Douceur. — Qu'elles sont belles ! que nos espérances sont brillantes ! — Oui, si vous comprenez et mettez en pratique ce que vous aurez entendu. — Comptez que nous y donnerons tous nos soins. —Votre bonheur en dépend. —Après que les Vertus ont pris notre voyageur, où le conduisent-elles? — A la Félicité, leur mère. Voyez-vous cette route, qui conduit à une élévation qui commande toutes les enceintes? A l'entrée du vestibule est une femme d'un âge fait, d'une beauté touchante, sans luxe, parée des mains de la décence, assise sur un trône élevé, et couronnée d'une guirlande de fleurs. C'est elle qu'on nomme la Félicité. — Mais que fait-elle à celui qui parvient à son trône? — Elle et toutes les Vertus ses compagnes, le couronnent de leurs dons comme un généreux athlète sorti vainqueur des plus grands combats. — Et quels ennemis a-t-il donc vaincus? — Les plus dangereux de tous, je veux dire des monstres cruels qui le dévoraient, le tourmentaient et le faisaient gémir dans le plus rude esclavage ; voilà les ennemis dont il a triomphé, qu'il a terrassés. Il s'est rendu à la liberté, et maintenant ces monstres, de ses tyrans sont devenus ses esclaves. —De quels monstres parlez-vous? Je brûle d'envie de les connaître. — D'abord l’Ignorance et l’Erreur. Ne les regardez-vous pas comme des monstres? —Et comme des monstres cruels. —Ensuite la Douleur, le Deuil, l’Avarice, l'Intempérance, et tous les vices. Il leur commande en maître, et n'est plus leur esclave. — Quels brillants exploits ! quelle belle victoire ! Mais, dites-moi, quelle est la vertu de la guirlande dont le vainqueur est couronné? — D'assurer le bonheur. En effet, celui qui porte cette couronne jouit d'une félicité pure et solide ; il ne l'attend pas des autres, il la trouve dans son propre cœur. — Triomphe éclatant et bien digne d'envie ! Mais, après avoir été couronné, que fait-il? où va-t-il? — Les Vertus le ramènent au point d'où il était parti, et de là lui montrent les autres mortels, leurs écarts, leurs vices et le malheur de leur vie, leurs naufrages, et comment ils sont menés en triomphe par leurs ennemis, les uns par l'Intempérance, les autres par la Vanité, ceux-ci par l’Avarice, ceux-là par la vaine Gloire, tous par quelque vice semblable. Ils ne peuvent briser les chaînes pesantes qui les accablent pour se réfugier dans cet heureux séjour, mais toute leur vie est en proie au trouble et à l'agitation. Ces malheurs leur sont arrivés parce qu'ils ont perdu de vue les instructions du Génie, et ne peuvent plus trouver la route qui conduit au bonheur. — Vous avez raison ; mais je voudrais savoir pourquoi les Vertus montrent à notre voyageur les lieux par où il a passé d'abord. — Il ne comprenait, il ne voyait clairement rien de ce qui s'y passait. Dans un état de doute et d'incertitude, aveuglé par les vapeurs de l’Ignorance et de l’Erreur, il prenait pour bon ce qui ne l'était pas, et pour mauvais ce qui était bon. Aussi vivait-il mal, comme le reste de ceux qui habitent ces lieux. Maintenant qu'il possède la science des choses utiles, il mène une vie sage, et contemple d'un œil de compassion les erreurs des autres mortels. — Après avoir contemplé tous ces objets, que fait-il? où dirige-t-il ses pas? — Partout où bon lui semble : partout il est en sûreté, comme Jupiter dans l'antre; du mont Dictys. De quelque côté qu'il aille, il sera vertueux et à l'abri de tout danger ; partout il se verra fêté, accueilli, comme un médecin par ses malades. — N'a-t-il plus rien à craindre de ces femmes, que vous traitiez de monstres cruels? — Non, il ne craint rien de leur part. Il ne sera plus tourmenté par la Douleur, par la Tristesse, par l’Intempérance, par l'Avarice, par la Pauvreté, enfin par quelques maux que ce soient. Autrefois leur esclave, il est devenu leur maître ; elles respectent aujourd'hui sa supériorité. Ainsi les serpents obéissent aux Psylles. Acharnés contre tous les autres, jusqu'à ce qu'ils leur aient ôté la vie, ils ne blessent pas ces peuples, parce qu'ils portent avec eux un remède contre le venin du serpent. De même celui-ci, muni d'un antidote, ne reçoit aucun mal. — Fort bien : mais dites-moi qui sont ceux que l'on voit descendre de la hauteur? Les uns la tête ceinte de guirlandes, l'air riant et serein ; les autres, sans couronne, ont tous les traits du désespoir : leur tête courbée et leurs genoux qui fléchissent annoncent leur épuisement, et ils semblent tenus par des femmes. —Ceux qui portent des couronnes sont arrivés heureusement jusqu'à l’Instruction ; ils témoignent leur joie d'avoir reçu d'elle un favorable accueil. Des autres que vous voyez sans couronnes, les uns ont été durement conduits par la déesse, et se retirent toujours soumis à l'empire du Vice et du Malheur ; les autres, à qui la lâcheté a fait perdre courage, après être parvenus jusqu'à la Patience, retournent sur leurs pas, puis errent à l'aventure, sans tenir de route certaine. Les femmes qui les suivent sont la Douleur, la Tristesse, l’Ignominie et l’Ignorance. — C'est donc de tous les maux que vous formez leur cortège? —Assurément. Pour ces derniers, après être rentrés dans la première enceinte, auprès de la Volupté et de l’Intempérance, ils ne s'en prennent pas à eux-mêmes, mais dès le moment se répandent en invectives contre l’Instruction, et ceux qui dirigent leurs pas vers elle. Ils les regardent comme des malheureux, des infortunés qui abandonnent une vie douce, pour en choisir une dure et pénible, et se, priver des biens dont ils jouissent eux-mêmes. — Quels sont ces biens? — Pour abréger, ce sont lai débauche et l'intempérance. En effet, être, comme les brutes, l'esclave de ses appétits déréglés, voilà ce qu'ils regardent comme le souverain bien. — Comment nommez-vous ces autres femmes qui, d'un air de gaieté, viennent du séjour de l'Instruction ? — On les nomme Opinions. Elles viennent d'y conduire ceux qui sont entrés dans le sanctuaire des Vertus, et reviennent en prendre d'autres pour leur annoncer que les premiers jouissent déjà du bonheur. — Sont-elles introduites aussi auprès des Vertus ? — Non ; il n'est pas permis à l'Opinion de pénétrer dans le séjour de la Science. Elle se contente de remettre les voyageurs à l’Instruction, et quand celle-ci les a reçus, elle retourne sur ses pas pour en amener d'autres, comme les vaisseaux déchargés de leurs marchandises repartent pour en aller chercher de nouvelles. — Rien de plus intéressant que ce récit. Mais vous ne nous avez pas encore dit ce que le Génie recommande à ceux qui entrent dans la vie. — D'avoir son courage : prenez aussi courage vous-mêmes ; car j'entrerai dans tous les détails, et je n'omettrai rien, voyez-vous, dit-il en étendant le bras, cette femme qui paraît aveugle et placée sur un globe, que je vous l’ai dit s'appeler la Fortune ? Il défend de mettre sa confiance en elle, de regarder ses dons comme stalles et solides, et d'y compter comme sur une possession assurée. Rien n'empêche qu'elle ne retire ses faveurs pour les prodiguer à d'autres, et même rien n'est plus ordinaire, Ainsi, il faut être au dessus de ses présents, ne point se livrer à la joie, quand elle donne, ni au désespoir, quand elle ôte. En effet, jamais elle n'agit qu'inconsidérément et sans réflexion. En conséquence, rien de tout ce qu'elle fait ne doit surprendre. N'imitez pas, ajoute-t-il, les hommes de mauvaise foi, qui se réjouissent quand ils reçoivent des fonds, et les regardent comme leurs biens propres, puis sont indignés quand on leur redemande ce dépôt, et croient qu'on leur fait une injustice, oubliant sans doute qu'on ne les leur a confiés qu'à condition qu'on pourrait les reprendre sans opposition. Voilà les sentiments où vous devez être à l'égard des faveurs de la Fortune. Ne perdez jamais de vue qu'il est dans son caractère d'enlever ce qu'elle a donné pour en rendre un moment après beaucoup plus, et l'ôter encore ce qu'elle vient de donner et même ce qu'on ne tient pas d'elle. Recevez donc ses faveurs, et aussitôt courez en chercher de plus stables et de plus solides. — Quelles sont ces faveurs ? — Celles qu'ils doivent recevoir de l’Instruction, s'ils ont le bonheur d'y parvenir, savoir la vraie science des choses utiles, dons assurés dans leur possession, et constants dans leur durée. Aussi le Génie leur recommande de se réfugier au plus tôt auprès d'elle, et lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à ces femmes, que j'ai déjà nommées, la Volupté et l’Intempérance, de les quitter au plus vite, et de n'avoir en elles aucune confiance, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la Fausse Instruction. Il leur ordonne d'y faire quelque séjour, d'emprunter d'elle des secours pour leur voyage, et ensuite d'accélérer leur marche, pour arriver à la véritable Instruction. Voilà les avis qu'ils reçoivent du Génie. Quiconque ne les suit pas, ou les entend mal, périt misérablement. Voilà, étrangers, le sens de l'allégorie représentée dans ce tableau. Maintenant vous pouvez me faire des questions sur chaque article, j'y satisferai avec plaisir, — Eh bien, je vais profiter de votre complaisance. Quels secours le Génie recommande-t-il d'emprunter de la Fausse Instruction? — Ce qui peut être de quelque utilité ; je veux dire les lettres et les autres connaissances, que Platon appelle un frein salutaire, qui empêche la jeunesse de s'occuper d'objets plus pernicieux. — Ces connaissances sont-elles donc absolument nécessaires pour arriver à la véritable Instruction. —Sans être nécessaires, elles sont utiles. — Mais elles ne contribuent en rien à rendre meilleurs. — Elles ne servent en rien à nous rendre meilleurs, dites-vous ? — Non, certes : car sans leur secours on peut devenir plus vertueux ; cependant elles ne sont pas sans utilité. Quelquefois nous entendons un étranger par le moyen d'un interprète ; cependant, quoique nous l'ayons parfaitement compris, il ne serait pas inutile pour nous d'avoir une connaissance plus exacte de sa langue ; de même rien ne nous oblige d'avoir ces connaissances, comme aussi rien ne nous les interdit. — Les savants n'ont donc aucun avantage sur le reste des hommes pour la pratique de la vertu ? — Comment en auraient-ils, puisqu'ils se trompent comme les autres sur la nature du bien et du mal ? En effet, rien n'empêche d'avoir toutes les connaissances, et d'aimer le vin, les excès, d'être avare, injuste, traître, insensé. —Sans doute, on en voit beaucoup tels que vous les dépeignez. — Eh bien, ces sciences leur donnent-elles plus de facilité à devenir meilleurs ? — Non certes, d'après ce que vous dites. Mais pourquoi donc sont-ils dans la seconde enceinte, comme voisins de la Véritable Instruction ? — Et quels fruits en retirent-ils tandis qu'on voit souvent quelques-uns des habitants de la première enceinte qui gémissaient sous la tyrannie de l’Intempérance et des autres vices, briser leurs chaînes, laisser derrière eux ces savants, et pénétrer dans la troisième enceinte auprès de la Véritable Instruction. Maintenant, qui donnera l'avantage aux premiers sur les autres, qui les surpassent en zèle ou en docilité? — Expliquez-vous. — Je vais le faire. D'abord ils ont au moins le tort de s'afficher pour savoir ce qu'ils ignorent. Tant qu'ils sont enivrés de cette idée flatteuse, il est impossible qu'ils aient beaucoup d'empressement à chercher la véritable instruction. Ne voyez-vous pas aussi les Opinions, sortir de la première enceinte, et s'arrêter avec eux? En conséquence, ils ne sont pas meilleurs que les autres, à moins qu'ils ne rencontrent le Repentir, qui les persuade qu'ils suivent la Fraude, et non pas la Véritable Instruction, qu'elle les induit en erreur, et que dans cet état déplorable ils ne peuvent prétendre au bonheur. Pour vous, étrangers, si vous n'embrassez ce parti, et si vous ne méditez longtemps et profondément sur ce que nous venons de dire, jusqu'à vous en rendre la pratique familière, si vous n'y réfléchissez constamment et sans relâche, si même vous ne comptez le reste pour rien, vous ne tirerez aucun fruit de ce que vous venez d'entendre. — Comptez que nous nous en occuperons. Mais dites-nous pourquoi vous ne regardez pas comme des biens ce qu'on reçoit de la Fortune, la santé, les richesses, la gloire, les enfants, les victoires, et comme des maux ce qui leur est opposé ; car votre discours nous a paru paradoxal et incroyable. —Eh bien, tâchez de faire à mes demandes les réponses que vous jugerez convenables. — J'y consens. — Regardez-vous la vie comme un bien pour un homme qui vit mal? — Non ; mais plutôt comme un mal. —Comment donc la vie peut-elle être un bien, si elle est un mal pour lui? — Elle est un bien pour l'homme vertueux, comme pour le vicieux elle est un mal. — Ainsi la vie sera en même temps l'un et l'autre. — C'est mon avis. — Ce que vous dites n'est guère probable. — Comment est-il possible qu'une même chose soit en même temps bonne et mauvaise, utile et nuisible, à désirer et à fuir? cela paraît hors de vraisemblance. — Mais si la mauvaise vie est un mal pour le vicieux, la vie prise en elle-même en serait-elle un? — Il y a de la différence entre vivre et vivre mal. Que vous en semble? — Je suis de votre avis. — C'est donc la mauvaise vie qui est un mal? — La vie prise en elle-même n'en est point un : car, si le contraire avait lieu, elle serait aussi un mal pour ceux qui vivent bien. — Vos réflexions me paraissent justes. — Puis donc que les uns et les autres jouissent de la vie, elle n'est ni un bien ni un mal. Il en est d'elle comme des traitements par le fer et le feu ; salutaires aux malades, ils seraient funestes à ceux qui sont en santé. Considérez-la donc sous ce point de vue. Préféreriez-vous une vie honteuse à une belle et courageuse mort? — Non, certes. — La mort n'est donc pas un mal, puisqu'elle est souvent préférable à la vie? — On ne peut en disconvenir. — On peut donc établir le même rapport de la maladie à la santé ; car, dans bien des circonstances, l'une est plus nuisible que l'autre. —Vos conséquences sont justes. — Eh bien, considérons les richesses dans le même esprit, ou plutôt sans examen : ne voyons-nous pas du premier coup d'œil des riches malheureux et coupables? — Le nombre n'en est que trop grand. — Leurs richesses ne leur sont donc d'aucune utilité pour vivre heureux et sages ? — Leurs vices le prouvent. — Ce ne sont donc pas les richesses, mais l'instruction qui fait l'homme de bien? — Cela paraît probable. —En conséquence, comment les richesses seraient-elles un bien, si elles ne contribuent en rien à rendre meilleurs ceux qui les possèdent ? — Vous avez raison. — Bien des gens ne tirent donc aucun fruit de leurs richesses, puisqu'ils n'en savent pas faire usage? — C'est mon avis. — Comment donc peut-on regarder comme un bien ce qui souvent n'est pas utile? On ne peut donc bien vivre qu'en faisant de ses richesses un usage légitime et bien entendu. — Ce que vous dites est de toute vérité. — En général, ce qui trouble les hommes, ce qui les induit en erreur, c'est le double rapport d'estime et de mépris que méritent ces objets à titre de bien ou de mal. Mais comme ils y attachent le plus haut prix, qu'ils les regardent comme la seule route du bonheur, pour en jouir, ils se permettent tout, même les actions les plus impies. Cette conduite vient de ce qu'ils ne connaissent pas ce qui est bien. Ils ignorent que jamais le bien ne peut naître du mal. Combien voit-on de riches qui ne doivent leur opulence qu'aux excès les plus honteux, aux trahisons, aux déprédations, aux homicides, aux calomnies, aux rapines, enfin à tous les crimes! Si donc, comme il est vraisemblable, le mal ne peut produire aucun bien, et que les richesses soient le fruit des mauvaises actions, il est impossible qu'elles en soient un. — La conséquence est nécessaire. — Le vice ne conduit point à la justice et à la sagesse, ni la vertu à l'injustice et à la folie. Ce sont des choses incompatibles. Au contraire, rien n'empêche de réunir avec tous les vices la gloire, les victoires et les autres objets semblables. On ne doit donc les regarder, ni comme des biens, ni comme des maux. Le seul bien, c'est la sagesse; et le seul mal, c'est la folie. — Vous m'éclairez, et vos réflexions me paraissent justes et raisonnables.
FIN.
|