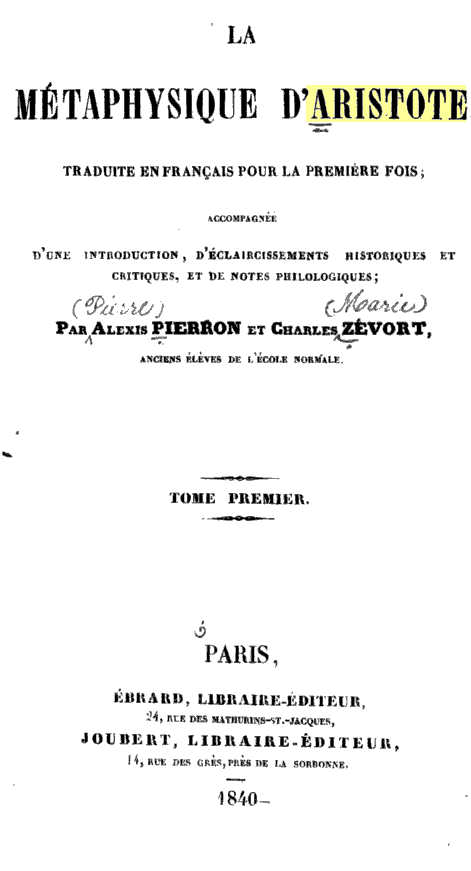
ARISTOTE
MÉTAPHYSIQUE
INTRODUCTION
Traduction : Alexis PIERRON et Charles ZEVORT.
LA MÉTAPHYSIQUE D’ARISTOTE.
INTRODUCTION
La Scolastique, c’est-à-dire la philosophie d’Aristote telle que se l’était faite le moyen-âge, fut, dès le quinzième siècle, l’objet d’attaques assez vives, mais au fond peu dangereuses. Ce dont il s’agissait avant tout pour les beaux esprits du temps, pour ces Grecs chassés par la conquête, c’était d’enseigner leur langue et leur littérature, d’en répandre le goût parmi les Occidentaux. Ils traduisaient, ils commentaient Aristote ou Platon, ils se passionnaient dans cette étude; et l’interprète de Platon se croyait tenu, pour louer dignement son modèle, d’établir la prééminence de Platon sur Aristote. Les choses n’allaient pas beaucoup plus loin. L’Académie platonicienne de Florence suivit à peu près les mêmes errements ; d’ailleurs elle se montra peu exclusive : à Florence, comme jadis à Alexandrie, on admirait à la fois Aristote et Platon.
Durant la première moitié du seizième siècle, le débat grandit et prit un caractère sérieux ; bientôt la Scolastique put commencer à craindre pour son existence. L’esprit de liberté et d’examen pénétrait partout, et s’essayait à remuer, à changer le monde. L’antiquité, retirée de sa poussière, fournit les premiers instruments. On étudia avec une ardeur que la science n’a guère connue depuis, tous ces systèmes de philosophie, enfants sans joug de la pensée antique. La foi naissait de l’enthousiasme, le prosélytisme, de la foi; dans cette fièvre de rénovation, les plus audacieuses hypothèses trouvèrent de dévoués partisans, des martyrs même. Toutes les doctrines et tous les noms se levèrent à la voix du siècle, et s’avancèrent, pour ainsi dire en armes, contre ce grand nom et cette grande doctrine depuis si longtemps en possession d’une absolument universelle autorité. La Scolastique succomba, mais après une lutte longue et acharnée; elle défendit pied à pied la victoire, elle employa tous les moyens pour prolonger son existence. Ses efforts furent inutiles. Censures théologiques, destruction des ouvrages ennemis par la main de l’autorité séculière, condamnations infamantes portées contre les partisans d’autres doctrines, enfin une loi de sang [01], tout ce que la Scolastique imagina pour se perpétuer dans l’empire, n’aboutit, comme c’est l’inévitable cours des choses, qu’à accélérer sa ruine. L’arrêt du Parlement, qui condamne les dissidents à mort, cet arrêt plus extravagant et plus ridicule encore qu’il n’est horrible, est le symp tome manifeste de l’agonie du système; Pourtant ce n’est pas un système qui eut les honneurs du triomphe; ce ne fut ni Platon, ni Parménide, encore moine Épicure. C’est au nom des progrès de l’empire humain que Bacon prononça la condamnation du passé : Descartes confirma la sentence au nom de la pensée rétablie dans ses droits imprescriptibles.
On sait jusqu’à quel excès le dix-septième siècle poussa, en philosophie, son mépris pour la tradition. Aristote surtout, qui avait été l’âme de la Scolastique, fut en butte à tous les outrages. On le chassa même de la Logique qu’il avait créée, même de l’Art oratoire. Si la Poétique d’Aristote conserva son autorité, si cette autorité s’accrut encore durant la grande époque littéraire, ce n’est pas, comme on l’a tant répété, par la vertu singulière du nom d’Aristote: Boileau lui-même s’est égayé aux dépens d’Aristote et des Aristotéliciens. Ce miracle eut une autre cause. La vérité absolue n’est pas encore dans ce monde, mais du premier bond, pour ainsi dire, l’humanité a atteint les limites du beau; et la Poétique d’Aristote, tableau fidèle, quoi qu’on en ait dit, de la pratique des éternels maîtres, pourrait bien n’être pas autre chose que l’énumération des conditions éternelles de l’absolue beauté.
Le dix-huitième siècle se tourna vers une face nouvelle des choses. Il vit dans une portion de la réalité, la réalité tout entière, dans une vérité, la vérité même. Comme le dix-septième siècle avant lui, plus encore peut-être, plein d’une admiration sincère pour ses propres découvertes, convaincu que l’âge de la raison datait de lui seulement, il condamna, avec une assurance impitoyable, tout ce qui l’avait précédé, même le grand siècle. Il s’agissait bien, alors que Malebranche passait pour insensé, alors que Descartes n’était guère plus doucement traité que Malebranche, il s’agissait bien d’Aristote, de Platon, de la philosophie antique! Hormis quelques érudits paisibles, ou quelques hommes assez forts pour s’arracher aux vives préoccupations du moment, combien y en avait-il, non pas seulement en France, mais en Europe, qui connussent de Platon et d’Aristote autre chose que leur nom, et que ne satisfit pas le jugement traditionnel sur les rêveries mystiques de Platon, et les abstractions vides de sens de son pédantesque rival? On continuait à médire d’Aristote et de Platon, mais sans se donner la peine de motiver la critique, par habitude, par imitation, plutôt que par animosité véritable, et l’on riait, sans trop savoir pourquoi, des plaisanteries de Voltaire sur les grands mots de catégories et d’ entéléchie.
Leibnitz s’était proclamé, et à bon droit, le disciple d’Aristote. Leibnitz jouit pendant le dix-huitième siècle d’une renommée immense et d’une grande autorité. Aristote n’y gagna rien. On s’obstina à rapporter à Leibnitz toute la gloire de son grand système. L’idée de la Scolastique effrayait encore les esprits; on eût cru, en adressant quelques hommages à l’antique idole de la Scolastique, reculer vers le moyen âge, c’est-à-dire, dans l’opinion du temps, vers la barbarie. Leibnitz protesta du moins. Mais en France, l’anathème fut maintenu, sans adoucissement, sans réclamation, avec une persévérance inouïe. Pas une seule voix, durant deux cents années, ne s’éleva de notre pays, en faveur de ces doctrines qu’on y avait autrefois défendues avec la hache et le glaive, et les dédains de nos pères firent longuement expier au roi déchu le despotisme de son génie.
Il était réservé à notre siècle, qui a déjà déraciné tant de préjugés, réparé tant d’injustices, réhabilité tant de gloires, de rappeler enfin à la lumière cet Aristote si profondément oublié. Ce ne fut point une vaine fantaisie d’érudit, la curiosité d’exhumer un cadavre, et de mesurer le néant. Il ne s’agissait pas non plus, à l’exemple du seizième siècle, d’enchâsser richement une vieille relique dédaignée, pour la proposer aux adorations du monde. La critique moderne avait un but plus élevé ; elle essayait de renouer la tradition brisée, de rattacher le présent et l’avenir au passé, de faire l’éducation du genre humain, par l’expérience du genre humain lui-même. C’est en Allemagne qu’on vit se manifester les premiers symptômes de cette révolution favorable. Les deux grands systèmes dogmatiques qui passionnaient les esprits, devaient naturellement appeler l’attention sur l’aïeul de Spinosa et de Leibnitz, de Schelling et de Hegel. Il y a vingt ans, un philologue du premier ordre, Chrétien-Auguste Brandis, commentait à ses disciples la Métaphysique d’Aristote, non pas pour faire puérilement parade devant eux d’un beau talent et d’une érudition immense, mais pour les initier à la philosophie de leur temps [02]. L’exemple de Brandis trouva des émules dans cette noble contrée où rien de ce qui regarde l’antiquité n’excite un médiocre intérêt : des travaux précieux attestent la fécondité d’un mouvement qui dure toujours et qui grandit encore.
La réhabilitation d’Aristote ne date, en France, que de quelques années. C’est à M. Cousin qu’appartient l’honneur d’avoir appelé enfin sur Aristote, sinon une faveur passionnée, au moins l’universelle bienveillance. On sait le but que se proposa de tout temps ce philosophe illustre. Il tenta de retrouver, au travers de tous les systèmes, les éléments épars, et latents, pour ainsi dire, de la vérité philosophique. Entreprise gigantesque poursuivie pendant vingt ans avec une infatigable persévérance, et qui eut bientôt remué dans tous les sens le champ mal cultivé de l’histoire des idées !
Platon, le premier, reconquit parmi nous cette estime si injustement déniée au passé. La beauté des sentiments, la grandeur des conceptions, cette imagination si audacieuse et si bien réglée, les merveilles de ce style qui est la perfection même, en un mot Platon tout entier reproduit pour tous dans une fidèle et vivante image, et aussi la grande renommée du traducteur, tout conspirait à réconcilier dès l’abord avec ces nobles doctrines, même les esprits les plus hostiles. Le jour d’Aristote vint plus tard ; mais il vint, et l’on s’enquit de ce que c’était en réalité que cette Métaphysique d’Aristote, qui était depuis deux siècles comme une sorte d’épouvantail philosophique avec lequel on faisait peur de l’abstraction, et dont le nom était devenu synonyme d’erreur, de ténèbres, et même de folie, puisqu’on lit partout que le style d’Aristote est d’une clarté parfaite, excepté là où il ne se comprenait pas lui-même ; et que le comble de la folie, c’est d’exposer avec un calme et une assurance imperturbable des idées dont on ne saurait dire ni la valeur, ni la raison, ni les conséquences.
Sans négliger les autres parties de l’œuvre immense d’Aristote [03], M. Cousin s’attacha de préférence à la Métaphysique, qu’il considérait comme le point culminant et le résumé le plus vaste et le plus complet de la doctrine péripatéticienne. Presque en même temps qu’il attirait sur ce vieux monument l’attention d’une société savante, et qu’il provoquait un concours d’où sont sortis deux livres qui resteront, et ce rapport si plein et si lumineux, qui est un admirable écrit ; en même temps qu’il proposait la Métaphysique comme objet principal d’étude aux candidats de la philosophie, il prenait pour texte de ses leçons à l’Ecole normale les points les plus épineux du système, et publiait la traduction des premier et douzième livres, les seuls fragments de la Métaphysique qui aient jamais été reproduits en français.
À ce mouvement se rattachent immédiatement, outre les beaux ouvrages de MM. Ravaisson et Michelet de Berlin, d’autres travaux moins connus (leur destination même les condamnait à cette obscurité), mais non sans mérite, tant s’en faut, ni sans portée : nous voulons parler de quelques thèses universitaires soutenues dans ces dernières années sur divers points importants du système d’Aristote, par quelques-uns des jeunes philosophes sortis de l’Ecole normalen[04].
Le travail que nous publions aujourd’hui appartient, par sa naissance (que n’est-ce encore par quelque autre titre !), à cette noble lignée. Elèves de l’Ecole normale, l’enseignement et les exemples du philosophe qui a régénéré cette grande et libérale institution nous ont inspiré de bonne heure le goût des choses philosophiques et de l’histoire des systèmes. C’est dans le rapport sur le concours de 1835, que nous avons puisé l’idée de cet ouvrage ; c’est dans la traduction du premier et du douzième livre que nous avons trouvé le modèle, et en quelque sorte l’initiation ; les travaux du maître et des disciples, ainsi que ceux des deux philosophes couronnés dans le concours, ont été les bases sur lesquelles nous avons essayé de construire. Ajoutons que la bienveillance et les avis du seul homme qui eût pu dignement interpréter la Métaphysique, ne nous ont pas manqué ; renonçant pour sa part à continuer l’œuvre qu’il avait si bien commencée, M. Cousin a légitimé, pour ainsi dire, par sa haute et généreuse approbation, notre invasion dans les domaines qu’il avait conquis autrefois, et notre entrée en possession du vaste terrain non encore occupé. Que ce soit là notre réponse à ceux qui seraient tentés de porter contre nous l’accusation de témérité ingrate et d’entreprise sur des droits sacrés.
Nous avons rencontré dans le cours de ce travail, comme l’imaginent aisément ceux qui connaissent le texte de la Métaphysique, d’assez grandes difficultés, et de plus d’une sorte. Pour l’interprétation des détails particulièrement, c’est-à-dire pour ce qui importait le plus à des traducteurs, rien, ou peu s’en faut, n’avait été fait encore. Les difficultés du sens étaient restées perpétuelles, souvent impossibles à franchir, sinon à tourner, toujours scabreuses et pleines de périls. La critique philosophique a seule à peu près, jusqu’ici, passé sur le vieux monument : la philologie moderne nous a donné, mais voilà tout, un texte mieux constitué de la Métaphysique. Sauf quelques notes, malheureusement trop rares, de M. Cousin, sur les deux livres traduits en français, sauf quelques indications éparses dans diverses monographies, la plus grande œuvre, sans contredit, de la philosophie antique, a été moins bien traitée que telle rapsodie misérable qu’on aurait dû peut-être, pour l’honneur de l’antiquité, laisser à jamais enfouie dans son obscurité native. Il y a certainement plus d’un grammairien, plus d’un rhéteur, plus d’un poète, il en est même un grand nombre, qui ne méritaient pas d’occuper un seul des instants que leur a si libéralement prodigués l’érudition contemporaine ; et la centième partie du temps perdu dans ces labeurs ingrats et inutiles eût suffi pour lever tous les obstacles qui encombrent le lecteur dans presque tous les écrits d’Aristote.
Quoi qu’il en soit, nous essayons de venir, pour notre part, et dans la mesure de nos forces, à l’aide de ces laborieux amis de la philosophie, que n’effraie pas la lecture des textes originaux, mais qui, chercheurs d’idées avant tout, n’ont pas un long temps à dépenser dans de fastidieux détails, dans des comparaisons de variantes, dans d’arides discussions de mots. Il en est plus d’un, nous en sommes sûrs, qui, rebuté dès les premiers pas faits sans guide, s’est élancé brusquement du premier livre dans le douzième, et s’arrête avec regret en face des deux autres. C’est à ceux-là surtout que s’adresse cette traduction ; c’est leur intérêt que nous avons eu sans cesse en vue. Ce que nous devons au lecteur d’Aristote, c’est donc, non pas seulement la reproduction plus ou moins fidèle du texte nu de la Métaphysique, c’est aussi tout ce qui nous a paru de quelque utilité pour une intelligence plus complète du livre, tout ce que nous avons pu faire pour ne pas laisser le lecteur trop en-deçà du but. Forts de nos intentions, nous oserons même, dés cet instant, expliquer ce que c’est que la Métaphysique, déterminer l’objet que se propose Aristote, indiquer sa méthode, dégager les solutions qu’il a trouvées, en un mot présenter l’analyse, ou plutôt (qu’on nous passe cette expression ambitieuse), l’esprit de ce grand ouvrage ; car nous ne pouvons pas songer à donner une suite d’ex- traits : autant vaudrait renvoyer à la traduction ou à nos sommaires. Il n’en est pas de la Métaphysique comme des traités modernes, où nous sommes toujours de plain-pied, pour ainsi dire ; où nous voyons toujours et partout d’où vient l’auteur et ce qu’il fait, où il se dirige et quel chemin il doit prendre. Aristote sait parfaitement où il est et ce qu’il veut, mais souvent il ne juge pas à propos de nous le dire ; c’est-là son secret, et ce secret, il faut sans cesse le lui arracher. Pour lire avec fruit la Métaphysique, il faut avoir lu la Métaphysique ; c’est cette première et fatigante épellation que nous voudrions d’abord épargner au lecteur.
En dehors et au-dessus des données des sens et de la conscience, il y a tout un monde, que l’homme ne connaîtra jamais parfaitement sans doute, mais au sein duquel il lui est cependant donné de pénétrer. L’expérience nous fait connaître des qualités, des phénomènes, des changements de tout genre ; mais tout cela est contingent, variable, accidentel ; de pareilles connaissances ne peuvent constituer une science véritable : n’y a-t-il donc dans la nature que des qualités, des mouvements, sans soutien, sans principe ? La raison ne saurait l’admettre : elle nous conduit nécessairement à rattacher ces qualités à un être, à une substance, comme on l’appelle. Elle rapporte le mouvement à une cause, et, à travers tous les changements, à travers le flux perpétuel de la nature, elle découvre des principes immuables, nécessaires.
Mais quelle est cette substance conçue par la raison ? Est-elle spirituelle ou matérielle ? Quels sont ses attributs ? À quel titre peut-on la considérer comme principe ? N’y a-t-il dans le monde qu’une seule substance, un seul être ? Et, d’un autre côté, la cause de toute production, de toute destruction est-elle une ou multiple, est-elle inhérente à chaque être ou bien en est-elle indépendante ; n’y a-t-il pas un moteur unique ; quel est le but du mouvement qu’il communique aux êtres ; quels rapports unissent le monde à ce moteur unique, éternel, s’il existe réellement ? Telles sont les principales questions que se pose Aristote, et dont il donne successivement la solution. La tâche est immense et difficile ; il ne l’ignore pas, il n’aspire pas même à résoudre complètement tous les problèmes que peut soulever la question des principes : selon lui, ce serait entreprendre sur Dieu même. Mais, sans prétendre pénétrer tous les secrets de l’univers comme celui qui tient dans sa main les lois et les mouvements, qui, principe et fin de toutes choses, sait le principe, le but et la portée de ce qui est, l’homme cependant peut aspirer à connaître la vérité, dans les limites du pouvoir départi à son intelligence. Le monde lui a été donné pour l’objet de ses méditations; et il est indigne de lui, comme dit Aristote, de ne pas chercher la science à laquelle il peut atteindre. Il pourra se tromper dans ses recherches ; mais il n’aura point, même alors, tout à fait perdu sa peine ; son intelligence se sera élevée dans cette étude, la vérité aura soulevé pour lui quelque coin de son voile : il est impossible, dit Aristote, qu’on manque jamais complétement la vérité.
Cette tâche si noble et si digne de l’homme, Aristote l’a donc entreprise, et le résultat de ses recherches prouve, au moins en partie, qu’il ne s’était point exagéré la puissance du génie humain.
On a dit, on répète encore que ce qui a manqué surtout à l’antiquité, c’est la méthode. Si, par là on prétend seulement que les ouvrages des anciens ne présentent point cette régularité dans la forme, cet enchaînement des parties qui distingue les œuvres modernes, et particulièrement les productions de l’esprit français, on est dans le vrai assurément. Mais si Aristote, car c’est à lui plus encore qu’à tout autre qu’on adresse le reproche, ne procède pas toujours en apparence avec un ordre, une symétrie parfaite ; si des questions se trouvent soit plusieurs fois reproduites, soit scindées contre notre attente , et interrompues dans leur développement pour n’être reprises que longtemps après, soit seulement indiquées ou même entièrement omises, quand la suite des idées semblerait les appeler et en exiger le développement ; si la méthode enfin se montre peu à la surface, cependant elle n’est point absente : c’est elle qui dirige, qui inspire sans cesse la pensée, qui lui donné cette unité qu’on ne saurait méconnaître, pour peu qu’on veuille percer l’enveloppe extérieure, et pénétrer au fond des choses. Aristote n’a nulle part expressément formulé sa méthode ; il ne trace point, au début de son ouvrage, les lignes où sa pensée viendra s’encadrer, mais, dirigé : par ce bon sens profond qui est le caractère propre de son génie, il suit une méthode dont il ne dévie jamais. Cette méthode n’est ni étroite ni exclusive ; elle se prête à toutes les formes de la pensée ; ce n’est ni l’expérience seule, ni la dialectique, ni la méthode historique, c’est mieux encore ; ce sont à la fois et tour à tour toutes ces méthodes. Aristote n’est pas le théoricien de la méthode ; il est méthodique comme on était éloquent dans les premiers âges : l’Ulysse d’Homère n’avait pas même besoin de connaître comment et pourquoi il savait persuader les hommes.
Une chose qui a souvent frappé, et qui a pu influer beaucoup sur le jugement général que l’on porte de la philosophie d’Aristote, c’est que, dans un traité qui a pour objet la recherche des principes les plus élevés de la science, dans un traité sur la philosophie première, sur l’être, sur Dieu, il prenne pour point de départ l’expérience sensible. À chaque instant Aristote s’appuie sur les données expérimentales, il nous y ramène sans cesse, il formule même les lois de l’expérience. Qu’on ne s’y trompe pas cependant ; si l’expérience des sens est au point de départ, elle n’est pas partout, elle n’est pas tout en un mot ; elle n’est qu’un degré nécessaire sur lequel il faut s appuyer pour arriver plus haut. Elle donne la vérité, mais seulement une partie de la vérité ; l’expérience ne constitue pas la science. Elle en est essentiellement distincte ; elle en est, si l’on veut, la condition, mais elle en diffère autant que le manœuvre de l’architecte.
Tout portait Aristote à négliger le témoignage des sens : l’autorité de son maître, les préjugés philosophiques contre la certitude du monde sensible répandus de son temps ; mais son génie l’a mieux servi que les circonstances, et l’un des principaux caractères de sa doctrine, c’est le retour à la réalité, et le rétablissement des sens dansleurs droits légitimes. Toutefois il neleur demande que ce qu’ils peuvent donner, il fait leur part, et les abandonne au moment où, au lieu de le servir, ils ne pourraient que l’égarer. Il ne s’arrête pas, comme on l’a supposé, à cet empirisme grossier qui voudrait tout ramener à des notions sensibles : bien loin delà, il s’adresse aussi à ce sens intime, à ce génie de la conscience révélé par Socrate, et qui avait si bien inspiré Platon : il lui demande compte des principes que les sens ne sauraient expliquer.
Et en effet, à côté de l’expérience de sens, il nous faut admettre une expérience intérieure, celle de la pensée se saisissant elle-même, expérience qui. seule nous élève à ces principes, à ces lois du monde que les sens ne peuvent apercevoir. Nulle part, il est vrai, Aristote n’a distingué expressément ces deux manières de connaître ; mais il les met en œuvre l’une et l’autre.
Ce n’est que quand il se verra fermement debout sur cette base, qu’Aristote se donnera l’essor, et s’élancera dans ces régions de la pensée si hardiment parcourues avant lui par Platon. S’il n’emprunte pas à son maître ces ailes divines qui l’emportaient dans le monde des idées, son vol, pour être plus régulier, n’est ni moins audacieux ni moins sublime. Arrivé à ces hauteurs, il pourra bien nous crier que Platon a mal vu, que ses yeux ont été éblouis par la lumière ; mais il n’entre pas dans son dessein de détruire ce monde de l’intelligence. Pour lui, comme pour Platon, la science repose dans la connaissance du général ; celui-là seul, selon Aristote, a véritablement la science, qui connaît le général, bien qu’il puisse se montrer moins habile dans tel cas particulier. L’architecte construirait plus difficilement le palais que le dernier des manœuvres ; mais il donne les plans, il les fait exécuter.
Expérience de la conscience, expérience interne, quelque nom qu’on lui donne, tel est, avec l’expérience sensible, le premier degré de la méthode d’Aristote ; mais cette méthode est encore expérimentale à d’autres titres. — Ce n’est pas assez pour le philosophe de consulter ses sens et sa raison : autour de lui on observe ; de tout temps l’humanité a observé ; et le résultat de ces observations successives, consigné dans le langage, constitue le sens commun. Expression juste ordinairement, quoique vague, de la vérité, le sens commun n’est pas à dédaigner pour le philosophe : Aristote ne repousse point ses lumières, il les invoque au contraire ; ce qu’il veut avant tout, c’est la science, et il la cherche partout où il espère en rencontrer quelque parcelle : il demande à la langue, à la pensée vulgaire, la définition de la philosophie ; il retrouve la vérité jusque dans les vers des poètes, jusque dans les proverbes populaires, la dégage des voiles épais dont elle se couvre, et la fait rentrer dans le domaine de la science.
Au-dessus des poèmes et des proverbes, expression spontanée de la pensée humaine, se rencontrent les méditations des philosophes. La philosophie n’était pas née de la veille à l’époque d’Aristote ; déjà bien des hommes avaient consacré leurs loisirs à l’étude des grandes questions de la nature ; ils avaient travaillé à la science et préparé ses progrés. Aristote ne peut se résigner à croire que tant de systèmes n’aient été que de stériles produits de l’imagination ; il espère y découvrir la vérité, au moins une partie de la vérité. Il se met à l’œuvre, il les analyse, les retourne dans tous les sens pour leur arracher cette vérité tant désirée. Eclectique dans la bonne acception du terme, il ne pense pas que la vérité puisse être le résultat des travaux d’un seul homme, mais il ne pense pas non plus, nous l’avons déjà dit, qu’on la manque jamais complétement.
La méthode d’Aristote, on le voit, c’est la méthode même de l’école moderne. La gloire de l’école moderne c’est, non pas de l’avoir inventée : les plus grands génies se trompent quand ils veulent inventer ; sa gloire, c’est de l’avoir mise en lumière, d’en avoir fait la théorie. Et cette méthode, Aristote l’a pratiquée avec une sagacité, une rectitude de vues, et, en général, une impartialité admirable. Il rapproche les opinions les plus opposées, montre leurs rapports, les complète, les développe, l’une par l’autre : il oppose l’école d’Élée à Pythagore, Pythagore à Platon, montre l’élément de vérité qui se trouve dans chacun d’eux, puis, jugeant la doctrine d’un point de vue plus élevé, la dominant du haut de son propre système, il repousse tout ce qui est exclusif, et ne garde que le vrai. Reconnaissant, comme il le dit lui-même, pour ceux qui lui ont préparé la voie, fortifiant son système de leur assentiment, il sait se passer d’eux, et les renverser quand ils l’entravent. Il ne fait point de la science avec des lambeaux pris çà et là ; il a un système arrêté, il joint aux matériaux qu’il a préparés lui-même, quelques débris des anciens monuments ; il en forme un tout durable, et qui puisse résister à l’assaut des siècles. Justesse d’appréciation, hauteur de vues, respect pour le talent, même lorsqu’il échoue dans ses efforts, rien ne manque à cet examen des anciens systèmes, et cette portion de l’ouvrage est sans contredit un des plus beaux morceaux historiques que nous ait laissés l’antiquité.
La méthode d’Aristote est donc expérimentale, et c’est-là, à nos yeux, un grand titre de gloire. Nous ne partageons pas à cet égard les préjugés de l’Allemagne philosophique, qui ferait presque un crime à Aristote d’avoir proclamé l’autorité de l’expérience. Il est généralement reçu en Allemagne de ne considérer l’observation que comme un pis-aller ; on l’admet bien comme moyen de contrôle, mais on ne lui accorde pas le pouvoir de conduire par elle-même à la vérité ; on fait la science a priori, et, avec un dédain superbe, qui ressemble fort à celui de Platon pour le monde sensible, on rejette bien loin l’expérience. C’est de ce point de vue systématique qu’on a reproché à Aristote de n’avoir pas de prime-assaut abordé ces régions supérieures que ne peut explorer l’expérience, de s’être appuyé sur les connaissances expérimentales pour arriver aux notions supra-sensibles.
Nous ne dirons pas, avec Bacon, qu’il faut couper les ailes au génie : mais que le génie du moins ne présume pas trop de ses forces ; qu’il parte de la terre s’il veut s’élever vers les cieux ; que la terre soit toujours présente à ses regards, s’il craint de se perdre dans les espaces imaginaires. S’il est vrai de dire que l’homme, que le monde ne sont que des êtres rela- tifs, comparés à l’Être, à la substance éternelle, il n’est pas moins vrai que ce n’est que par l’homme et le monde sensible que nous pouvons nous élever jusqu’à Dieu ; avant d’arriver au sommet de la science, il faut passer par les degrés intermédiaires; et si les systèmes qui se prétendent issus de cette intuition spontanée, supérieure à l’expérience, sont arrivés à quelque vérité, c’est encore à l’expérience qu’ils ont dû leurs découvertes. Peut-être nous dissimulent-ils les moyens qu’ils ont mis en œuvre, semblables au maçon qui détruit l’échafaudage sur lequel il s’est appuyé pour élever un temple, et qui ne nous laisse admirer que le monument ; peut-être même ont-ils oublié par quelle marche pénible, par quelle suite d’observations, ils sont arrivés à ces grandes vérités, qui dépassent de si loin l’expérience : et pourtant, qu’ils le sachent ou non, c’est l’expérience qui les a conduits. Aristote, plus que tout autre, eût été en droit de négliger les petites précautions, les observations qui peuvent paraître minutieuses à l’homme de génie; il ne l’a pas fait cependant : personne n’a jamais observé, personne n’a décrit avec un soin plus scrupuleux.
La dialectique est encore une partie importante de la méthode d’Aristote. De nos jours, on n’a voulu voir dans la dialectique qu’une arme dangereuse, bonne tout au plus pour les sophistes, principe de tous les égarements du moyen-âge et des subtilités de la Grèce. On n’a vu dans les systèmes anciens, dans celui qui nous occupe en particulier, qu’une vaine production de cette futile méthode. Nous n’avons pas la prétention de rendre à la dialectique son autorité souveraine à jamais perdue : elle ne peut, seule, donner la vérité ; on l’a dit à bon droit. Poser un principe, en faire ressortir habilement toutes les conséquences, ce n’est point établir une science ; reste encore à montrer ensuite la légitimité du principe, et la dialectique n’a pas ce pouvoir. Mais, pour refuser à la dialectique l’autorité d’une méthode exclusive, ce n’est pas à dire que nous la proscrivions tout à fait. La vérité, sans doute, brille par elle-même ; mais elle est souvent offusquée : elle a besoin de combattre, de se mesurer avec l’erreur; il lui faut, en philosophie surtout, où les faux systèmes sont si nombreux, s’établir au milieu des ruines, déblayer le terrain, si elle ne veut être obscurcie ou périr même. Les systèmes s’étaient produits en foule dans la Grèce disputeuse, puis la lassitude était arrivée ; fatigués de toutes ces spéculations qui se détruisaient l’une l’autre, un grand nombre d’hommes s’étaient jetés dans le scepticisme. Quel devait être le rôle du philosophe qui prétendait régénérer la science, l’établir sur de nouvelles et inébranlables bases ? Devait-il simplement produire son système, le présenter nu aux attaques des doctrines contemporaines et du scepticisme ? Il eût bientôt succomhé. Quiconque innove ne doit point redouter la lutte ; il doit la provoquer au contraire. Aristote venait faire une révolution ; il avait à renverser des systèmes ; avant d’édifier il lui fallait détruire : aussi, toujours chez lui le dogme se présente escorté de la critique. Tantôt il se jette au milieu des systèmes opposés, et, s’appuyant sur leurs propres principes, il les renverse au moyen d’une argumentation vigoureuse et serrée : les Sophistes surtout sont attaqués sans relâche, et il sait habilement tourner leurs propres armes contre eux-mêmes. Tantôt il confronte les principes de ses prédécesseurs à ceux qu’il a lui-même établis, et s’attache à les convaincre d’impuissance et d’erreur. Mais ce n’est pas tout encore : il s’attaque à son propre système ; il le soumet à son analyse impitoyable ; il en expose les difficultés, les contradictions ; il le réduit en poudre, en quelque sorte ; et, lorsqu’il nous voit épuisés, hors d’haleine, lorsque nous désespérons presque de la vérité, au milieu des contradictions qui surgissent de toutes parts, il fait peu à peu apparaître la lumière ; tout se concilie ; l’ordre règne là où tout à l’heure nous ne voyions que désordre et chaos, et l’esprit se repose au sein d’une admirable harmonie.
Mais à quoi bon tant de peine? pourquoi chercher la science à travers des chemins si tortueux ? C’est que rien ne peut mieux faire briller un système que cette confrontation perpétuelle avec les difficultés qu’il est appelé à résoudre. C’est beaucoup pour un principe d’être appuyé sur l’observation, en rapport avec l’expérience et la raison universelle ; mais c’est plus encore de rendre compte de toutes les difficultés. Il est, comme le dit Aristote, des méthodes diverses pour les esprits différents. Pour quelques-uns il suffira que les principes soient énoncés pour être admis ; d’autres, au contraire, demandent que tout soit rigoureusement démontré [05]; ils ne se rendent aux principes, que si vous les mettez dans l’impossibilité de refuser leur adhésion. À ceux-là il n’est pas inutile de montrer la vérité armée, pour ainsi dire, de toutes pièces.
Le préambule de la Métaphysique est d’une étendue immense, et, au premier aspect, démesurée. Ce ne sont pas moins que les six premiers livres ; et l’ouvrage entier en a quatorze ! Mais l’étonnement cesse bientôt, dés qu’on songe à la marche habituelle du philosophe et à cette large méthode que nous venons d’esquisser; dès que l’on réfléchit aux innombrables questions de toute sorte qui obstruent les abords du problème ontologique. D’ailleurs, l’ontologie, la science de l’être en tant qu’être, comme l’appelle Aristote, était, quand la Métaphysique parut, à peu près à ses premiers bégaiements. Il s’agissait de lui donner de la force et de la vie : on ne devait donc rien précipiter ; on ne pouvait s’entourer de trop minutieuses précautions.
Il était impossible, comme on l’imagine bien, qu’Aristote résolût toutes les questions préliminaires sans exposer, en partie du moins, son propre système ; mais il ne le fait qu’accidentellement, et le plus brièvement qu’il peut. Tout ce qui précède le VIIe livre n’est réellement qu’un préambule, même le VIe, où Aristote traite, comme il dit, de l’être qui n’appartient pas à la science. Ce n’est qu’au VIIe livre qu’Aristote aborde enfin son sujet véritable, l’étude de l’être en lui-même, de l’être en tant qu’être. Les bornes étroites de notre travail ne nous permettent pas de donner une analyse détaillée de cette partie ; nous nous contenterons de mettre en lumière les vérités sur lesquelles Aristote lui-même a cru devoir insister, celles qui peuvent servir surtout à l’intelligenre de son système. Les points que nous avons à examiner sont :
1° Objet de la science en général, et de la philosophie en particulier (Liv. I, II) ;
2° Opinions des philosophes sur les premiers principes de la philosophie (Liv. I) ;
3° Limites de la science de l’être (Liv. III, IV, VI) ;
4° Valeur et autorité du principe de contradiction (Liv. IV).
Quant aux difficultés qui sont posées dans le troisième livre, nous en examinerons quelques-unes à propos des deux dernières questions ; les autres trouveront place dans la seconde partie, l’étude de l’être, l’ontologie proprement dite. Le livre des Définitions (liv. V), περὶ τῶν ποσαχῶς, ne sera pas non plus l’objet d’une longue étude ; nous aurons soin d’y recourir, lorsque cela sera nécessaire pour l’intelligence des termes.
I. Il y a, selon Aristote, deux manières de connaître, l’expérience et la science, l’expérience qui nous révèle les faits, la science qui démontre et enseigne la raison des faits, leur cause, leur principe. La science a elle-même ses degrés. Au premier rang se place, même dans l’opinion commune, la spéculation pure. La science à laquelle on doit s’appliquer uniquement pour elle-même, indépendamment de tout résultat pratique, qui n’a pour but ni l’utilité, ni le plaisir, a certainement une valeur propre, que n’ont ni les métiers ni les arts. Enfin, si aux degrés de l’existence correspondent toujours ceux de la connaissance, la science spéculative par excellence, c’est la science des premières causes, des premiers principes. Or, c’est-là la Philosophie elle-même, la Science de la vérité, la Science de l’être, la Théologie, car tels sont les noms qu’Aristote donne successivement à ce que nous appelons la Métaphysique.
Après avoir magnifiquement développé cette idée de la suprématie absolue de la philosophie, après avoir montré qu’elle sort même de l’opinion qu’on se forme communément de la philosophie et des philosophes, Aristote se demande quels sont ces premiers principes, ces premières causes, objet de la science qu’il se propose de traiter. Il y a, selon lui, quatre causes premières, quatre principes premiers :
La substance,
La forme,
Le principe du mouvement,
La cause finale.
En effet, sous les diverses modifications dont nous sommes témoins, nous concevons quelque chose qui persiste ; il y a, par exemple, une substance une, invariable, sous la variabilité des phénomènes de l’âme. Mais cette substance n’existe pas à l’état de substance pure, sans forme, sans qualités; elle ne serait qu’une abstraction ; la pensée peut seule séparer la forme de la substance. À la substance il faut donc joindre la forme comme second principe, et par forme Aristote n’entend pas seulement le rond ou le carré ; c’est l’essence même des êtres; c’est ce qui les fait être ce qu’ils sont. La forme de l’homme ne consiste pas dans des bras, des jambes, une tête disposée de telle manière; elle consiste dans l’âme, dans ce qui en fait un être raisonnable, dans ce qui le distingue des animaux, il existe ainsi des êtres, des substances, non pas des substances abstraites, sans attributs ni qualités, mais des substances réalisées, des substances soit pensantes soit matérielles, avec telle forme, avec telle qualité ; mais l’univers n’est point encore expliqué quand on l’a ramené à ces deux principes : s’il n’y avait que la forme et la substance, le monde serait un théâtre sans vie ; tout resterait dans une perpétuelle immobilité. Chaque être y serait avec sa forme et sa substance ; mais inerte, sans action sur lui-même, sans pouvoir changer sa manière d’être, restant éternellement ce qu’il était d’abord. Tel n’est point le monde qui est sous nos yeux, tel n’est point l’homme partie de ce monde. Tout change, une forme succède à une autre : l’homme succède à l’homme, la plante à la plante, un éternel mouvement anime tout l’univers. Le mouvement, la nature ne se l’est point donné à elle-même ; on ne peut point dire, pour nous servir de l’exemple que donne quelque part Aristote, que l’homme a été mis en mouvement par l’air, l’air par le soleil, le soleil par la Discorde, et ainsi à l’infini [06] ; il faut de toute nécessité s’élever à la conception d’un premier moteur, immobile lui-même, et cause éternelle de tout mouvement, et ce moteur unique, c’est Dieu. Enfin, si nous étudions la nature, nous verrons que rien ne se fait au hasard, que tout a un but ; la raison noua, dit. que tout mouvement doit avoir une direction, une fin. Cette fin est un quatrième principe, La cause finale, comme on l’appelle, c’est le bien, le bien de chaque être, le bien de l’univers, le bien absolu ; c’est Dieu sous un autre point de vue.
Tels sont les principes fondamentaux de la science ; et il est évident qu’il n’existe ni une série infinie de causes, ni une infinité d’espèces de causes. Il faut nécessairement s’arrêter à des causes premières, qui n’ont d’autre raison qu’elles-mêmes. La pensée a besoin de point d’arrêt [07] ; la science n’est possible qu’à cette condition.
Nous devons remarquer ici, que s’il est vrai de dire que l’intelligence s’élève à la notion de ces quatre causes, qu’elles suffisent à l’explication de l’univers, qu’il est inutile d’avoir recours à un plus grand nombre ; là cependant ne s’arrête pas la science : ce n’est point assez d’avoir établi d’un côté l’existence de la matière et de la forme, l’existence des individus, de l’autre le principe éternel, cause de tout mouvement et de tout bien ; il faut chercher à concilier ces principes, généraliser encore, et s’élever à cette unité à laquelle aspire la science, et en dehors de laquelle on ne saurait rencontrer cette harmonie qui seule peut satisfaire la raison. Dans la pensée d’Aristote, la matière, la forme sont éternelles ; ce sont des principes indépendants, et, à ce titre, la matière est Dieu tout aussi bien que l’éternel moteur. Si, comme il le dit, la plante produit la plante, si l’homme engendre l’homme, quel est donc le rapport de ces existences individuelles avec la cause première de tout mouvement ; car la chaîne des productions ne peut aller à l’infini ? Dieu n’est-il que l’organisateur d’une matière éternelle indépendante de sa propre substance ? C’est-là ce qui sort de l’étude de la Métaphysique d’Aristote. Il restait donc à identifier la forme avec la pensée éternelle, la matière avec la forme ; restait à s’élever à l’idée d’un dieu créateur, cause et substance de tout ce qui est. Là seulement était l’unité, là était la véritable conciliation de toutes les contradictions. Ce progrès, on pourrait croire qu’Aristote l’a entrevu ; quelques passages du XIIe livre le laisseraient supposer; cependant il n’a point clairement exprimé cette idée, et, il faut l’avouer, il y a là un abîme que l’antiquité ne devait point franchir.
Si Aristote n’a point assez généralisé, du moins il ne supprime aucun des faits de la science : en admettant un trop grand nombre de causes, il aura répandu quelques nuages sur des questions importantes; mais ces questions subsisteront, la route n’est pas fermée aux siècles futurs. Ceci, du reste, ne peut l’embarrasser dans la critique des systèmes. Les philosophes antérieurs n’avaient pas cherché davantage la conciliation ; ils étaient beaucoup moins complets d’un autre côté. Platon avait admis l’existence éternelle de la matière ; bien plus, il avait omis (telle est du moins l’opinion d’Aristote), deux des quatre principes, la cause du mouvement, et le bien, la cause finale. Le système d’Aristote est donc une mesure assez large pour rendre possible une appréciation exacte de tout ce passé philosophique.
II. C’est un spectacle grand et curieux, de voir comment l’antiquité s’est jugée elle-même, comment, revenant sur ses pas, elle a apprécié la route qu’elle avait déjà parcourue, de quel œil enfin la raison mûrie, fortifiée déjà par l’expérience des siècles, a envisagé alors son enfance et ses débuts.
L’examen auquel se livre Aristote n’est pas une histoire sans vie des systèmes, c’est la représentation fidèle de la marche de l’esprit humain ; c’est un drame véritable qui prend l’homme au moment où, faible encore, ébloui par le spectacle qui s’offre à ses regards, il ne voit dans la nature que la partie la plus grossière ; qui nous le montre ensuite faisant chaque jour un nouveau pas, écartant peu à peu les voiles qui couvrent la vérité, s’élevant enfin jusqu’à l’idée de Dieu, et établissant l’intelligence dans ses droits les plus sacrés. Le but d’Aristote n’est nullement de confondre ses prédécesseurs. Il n’est pas, tant s’en faut, ce tyran que nous dépeint Bacon, qui, pour régner paisiblement, commence par égorger tous ses frères. Aristote sait ce que coûte la science, et il tient compte à ses devanciers des difficultés des temps. Indulgent pour les hommes qui ont consacré leurs veilles à l’étude, il n’est sévère que pour les doctrines : la vérité même y est intéressée.
Cependant, il est triste de le dire, cette impartialité si haute semble se démentir au sujet du philosophe auquel il devait le plus de reconnaissance ; il va jusqu’à l’injustice envers Platon, son ancien maître. On a diversement apprécié les motifs d’une telle conduite; et malgré les efforts des criliques anciens et modernes, tous les doutes qu’a soulevés cette question sont loin d’être éclaircis. La théorie des idées, par exemple, n’est point dans Aristote ce qu’elle est dans Platon. Aristote d’ailleurs ne la renverse qu’en l’isolant au milieu du système, en la séparant de tout ce qui pouvait la rendre plausible ; il est peu de doctrines qui puissent résister à une pareille mutilation.
Les premières spéculations philosophiques furent nécessairement vagues et incomplètes , les principes ne furent considérés d’abord que sous le point de vue dela matière. C’est dans ce sens que furent dirigées toutes les recherches de l’école Ionienne ; les spéculations de cette école ne vont pas au-delà du principe matériel. Thalès et Hippon admettent un seul élément, l’eau ou l’humide ; Hippase de Mélaponte et Héraclite font naître l’univers des transformations successives du feu, principe plus subtil : c’est le feu qui produit l’ordre ou les bouleversements du monde. Empédocle porte le nombre des éléments jusqu’à quatre. Anaxagore l’étend à l’infini ; mais toujours ces éléments sont considérés comme matériels. Le principe de tous les êtres, c’est la matière, la substance, une ou multiple, persistant la même sous toutes les modifications, c’est ce dont provient toute chose, ce à quoi loute chose aboutit. Le tort de ces philosophes c’est, selon Aristote, ne donner que les principes des êtres corporels, quoiqu’il y ait aussi des êtres incorporels ; ou plutôt c’est d’expliquer les êtres incorporels au moyen des principes de la matière.
Ces philosophes suppriment aussi, ou pour mieux dire, oublient la cause du mouvement, et cependant toute production, toute destruction provient d’un principe, et ce principe n’est pas inhérent à la matière : ce n’est pas le bois qui fait le lit, ni l’airain la statue [08]. La cause du mouvement supprimée, le monde reste sans explication ; toute production , toute destruction est impossible. Quant à l’essence, au principe du bien, ces philosophes n’en parlent pas davantage. Des quatre principes posés par Aristote, un seul a été admis par cette école, la substance, et encore la substance considérée sous le point de vue exclusif de la matière.
Les Éléates vont plus loin ; ils n’oublient pas la cause du mouvement, comme les philosophes antérieurs, ils la suppriment à dessein. Ce qui les frappe surtout, c’est l’unité du monde, et ils absorbent dans cette unité la pluralité des phénomènes. La grande question à résoudre, celle que toute philosophie un peu élevée doit nécessairement rencontrer sur son chemin, c’est l’explication de l’unité dans la pluralité [09] ; au lieu de rien expliquer, les Éléates tranchent la question, en niant, du point de vue de la raison, l’existence de la pluralité attestée par les sens ; le changement, la production leur semblent chose impossible. L’univers est un, il est dans une immobilité perpétuelle. Parménide admet bien deux autres principes, le chaud et le froid, le feu et la terre, pour rendre compte des apparences sensibles ; mais il n’en maintient pas moins l’unité du tout. Le principe du mouvement, la cause finale, ne peuvent guère trouver place dans un pareil système. L’idée d’un dieu se rencontre bien chez ces philosophes. Xénophane lui-même, quoique nourri dans les opinions des Ioniens, s’en forme déjà une idée assez élevée, sans distinguer cependant Dieu de la matière [10]. Mais la divinité pour eux n’est pas une cause de mouvement; tout est immobile.
Les Atomistes renversent la question : ce qu’ils voient dans la nature, c’est surtout le côté sensible, que les Éléates avaient négligé ; mais ils ne pénètrent guère plus avant qu’eux dans la question ontologique. Leucippe et Démocrite admettent pour principes le plein et le vide, l’être et le non-être ; puis, ces principes ne leur suffisant pas, ils introduisent la cause du mouvement ; mais bien loin d’en faire un principe séparé, ils l’identifient avec la matière. Les atomes jouissent d’un mouvement éternel ; les diverses transformations du monde ne sont que le résultat de ce mouvement inhérent à la matière. Considérer ainsi la cause du mouvement, c’est la supprimer, ou du moins, ce n’est pas en traiter d’une manière scientifique. Ces spéculations ressemblent à celles des philosophes mathématiciens du XVIIIe siècle, qui expliquaient tous les phénomènes par des lois générales, sans rapporter ces lois à un principe qui pût les expliquer.
La cause essentielle semble avoir été entrevue aussi par les Atomistes. Les corps, selon eux, différent soit par la position des parties, soit par l’ordre et la configuration, et ces différences sont des principes ; mais leurs idées à ce sujet sont tellement vagues qu’on peut douter qu’ils s’en soient bien rendu compte eux-mêmes, et qu’ils se soient élevés à la conception scientifique du principe formel.
Tous ces systèmes, on le voit, ont abordé la vérité par quelque point; ils ont admis quelques-unes des causes énoncées par Aristote ; mais il en ont parlé généralement d’une manière si obscure, si incomplète, qu’on est en droit de dire avec Aristote qu’ils ont vu et n’ont pas vu la vérité. Le mouvement surtout semble avoir embarrassé les premiers philosophes. Ils ont bien aperçu que le mouvement doit, avoir un principe ; mais préoccupés, comme ils l’étaient pour la plupart, du point de vue la matière, ils ne savaient quelle idée se former de ce principe. Parménide et Empédocle lui donnent bien une existence indépendante, supérieurs en cela à leurs contemporains et à leurs prédécesseurs, qui ne le séparaient pas de la matière; mais qu’est-ce que l’Amour [11] pour Parménide? qu’est-ce que l’Amitié et la Discorde [12] pour Empédocle ? en quoi consiste l’action de ces principes ? ils ne nous le disent pas. Contents d’avoir trouvé une explication telle quelle, ils se tiennent dans de vagues généralités, ils ne songent point à pousser plus loin leurs recherche
Anaxagore est peut-être le seul de tous ces philosophes qui se soit formé une idée nette de la cause motrice. Au lieu de rapporter au hasard l’ordre et la beauté du monde, il proclama qu’il y avait dans la nature une Intelligence ( νοῦς) cause de l’arrangement et de l’ordre universel ; il établit que la cause de l’ordre était en même temps et le principe des êtres, et la cause que leur imprime le mouvement. C’était-là une idée féconde pour la science ; c’était, comme le dit Aristote, l’apparition de la raison même. Mais Anaxagore n’en dira point tout le parti possible. Il admettait deux éléments : d’un côté, l’Intelligence, l’unité, de l’autre, l’indéterminé, une substance sans forme, sans qualité aucune, organisée par l’Intelligence ; mais il se servait peu de l’Intelligence. C’était une sorte de machine qu’il ne produisait sur la scène que quand il ne pouvait avoir recours à une autre cause [13].
Ce n’est que chez les Pythagoriciens [14] que nous pouvons rencontrer le germe d’un système plus com plet ; et encore leur opinion se ressent-elle de cette incertitude qui est toujours le caractère des premiers développements de la raison. Les Pythagoriciens négligent les indications des sens auxquelles s’étaient arrêtés les Ioniens, et s’élèvent tout d’abord aux notions rationnelles d’ordre, d’harmonie ; ils prennent pour point de départ les idées les plus exacte auxquelles l’homme puisse arriver, les idées de nombre, qui leur paraissent la règle la plus sûre de la connaissance [15], et, portant ensuite leurs regards sur l’univers, us expliquent tous les phénomènes au moyen de ces idées. Cette méthode n’est pas la meilleure : il est dangereux de se placer de prime-abord au sommet de la science, pour descendre ensuite aux degrés inférieurs ; cependant on ne peut nier qu’il n’y ait là un progrès remarquable. L’esprit humain était définitivement affranchi des liens de la matière, et l’ontologie entrait dans sa véritable voie. Bien des obscurités enveloppaient cette théorie des nombres, mais elle portait en elle un germe fécond que devait développer l’avenir, et Platon ne fit que continuer l’œuvre des Pythagoriciens, en l’agrandissant.
Les Pythagoriciens, nourris dans l’étude des mathématiques, frappés d’un autre côté par les rapports qui existent entre les nombres et l’harmonie du monde, firent du nombre le principe de tous les êtres. Pour eux le nombre est principe à un double titre ; il est d’abord la matière, l’élément intégrant des objets, il en est encore l’exemplaire, la forme, il est enfin la cause de leurs modifications, de leurs états divers. Toutefois les nombres ne sont pas comme les idées de Platon en dehors des êtres ; il en sont la substance même et ne s’en séparent pas. L’unité est pour eux le principe de toutes choses ; mais ce n’est pas le point de vue de l’unité qui paraît avoir dominé chez les Pythagoriciens. Dans l’unité sont contenus deux autres principes, le pair ou l’infini, l’indéterminé, l’impair ou le fini. L’infini est considéré comme la cause substantielle des êtres ; le fini est la forme, la cause dela détermination. Sous ce point de vue les contraires seraient les principes des êtres. Telle est aussi l’opinion avouée des Pythagoriciens. Ils varient sur le nombre de ces principes, mais tous ils s’accordent à construire le monde au moyen des contraires. Leur doctrine cependant ne s’arrête pas là ; ils s’élèvent, comme nous l’avons dit, à la conception d’une unité qui est à la fois finie et infinie, et dans laquelle toute contrariété vient se concilier et disparaître.
On peut, à la rigueur, trouver dans ce système les quatre principes d’Aristote, mais mal définis, mal déterminés. La substance y est représentée par le nombre, élément constitutif des êtres, et re principe a, sur celui des Physiciens, l’avantage de pouvoir s’appliquer aux objets supra-sensibles ; il suffit, comme dit Aristote, pour s’élever à la conception des êtres hors de la portée des sens. Mais il s’applique moins bien aux êtres sensibles, les seuls cependant dont s’occupent les Pythagoriciens ; des principes abstraits ne peuvent rendre raison de ce monde concret qui est sous nos yeux. Admettons un instant qu’on puisse avec les nombres construire l’étendue, comment expliquer la pesanteur et les autres qualités des objets ? Les Pythagoriciens n’en disent rien, et en effet ils ne pouvaient pas en parler. Le principe formel commence aussi à se dégager. Les Pythagoriciens donnent les premiers exemples de la définition, ils font des rapports numériques l’essence des êtres ; ils peuvent à cet égard être regardés comme les précurseurs de Platon et d’Aristote.
Quant à la cause motrice, ils ne la suppriment point tout à fait, comme le prétend Aristote ; seulement ils concilient mal son existence avec celle des nombres, ils admettent que le monde est un, qu’il est de toute éternité gouverné par un seul être, et cet être, cette unité, c’est Dieu. Ils ne font point cependant de la cause motrice un principe à part. De même que les nombres ne sont point séparés des objets dont ils sont la substance, de même aussi l’unité divine n’est point séparée de l’univers qu’elle organise et gouverne, elle en est l’essence et l’âme. Dieu, en tant qu’unité, est le bien ; et comme les Pythagoriciens admettent l’existence du mal, comme ils le rapportent à l’infini ou à l’indéterminé, au principe matériel, et que d’un autre côté l’indéterminé est un des éléments de l’unité, il leur est difficile d’échapper à cette conclusion que Dieu est aussi la cause du mal. Sur ce point comme sur beaucoup d’autres, ils ne se sont pas nettement expliqués ; leur système, quelle qu’en soit du reste la valeur, n’était encore qu’une ébauche ; c’était au génie de Platon qu’il était réservé de lui donner un caractère vraiment scientifique.
Ce qui avait frappé Platon comme les Pythagoriciens, c’était l’unité et l’harmonie de l’univers, les rapports et les différences des êtres qui le composent. Il n’absorbait pas, comme on le lui a reproché, l’individu dans le genre ; il ne niait point la pluralité des êtres : bien loin de là, il la défendait contre les Sophistes [16] ; mais il n’admettait pas que cette pluralité fût l’objet de la science. Elle était l’objet de l’opinion (δόξα), c’est-à-dire d’une demi-connaissance, intermédiaire entre la science et l’ignorance. Les êtres sensibles sont sujets à une multitude de transformations, ils sont dans un flux perpétuel ; ils ne peuvent renfermer qu’une ombre affaiblie de cette vérité immuable à laquelle aspire la science, et qu’elle ne rencontrera que dans l’étude du général. D’un autre côté, la plupart des mois que renferment les langues, les mots homme, arbre, sont des noms communs, ils expriment une notion commune au genre, embrassant plusieurs individus. Connaître ce genre, connaître les faits généraux qui dominent et expliquent les faits particuliers, tel doit être le but de la science, de la philosophie ; il faut s’élever des individus aux espèces, des espèces aux genres, c’est-à-dire aux idées, aux choses universelles [17] : les Idées , en tant qu’elles s’appliquent à plusieurs êtres, sont des universaux ; elles sont l’unité dans la pluralité. Il faut enfin, pour compléter la science, remonter jusqu’à l’unité dans laquelle tous les genres viennent se réunir. C’est dans ce sens que Platon dit que les idées, essence de tous les êtres, ont elles-mêmes l’unité pour essence. Partant de ces données, Platon reconnaît comme principes des êtres, ces idées générales, ces formes immatérielles, qui ne périssent point avec l’individu, qui se reproduisent sans cesse dans chacun des membres de l’espèce. En dehors des êtres sensibles existent les idées, types éternels d’après lesquels Dieu a créé le monde, et, dans ce sens, causes de l’existence des êtres contingents, lesquels n’existent que par leur participation avec elles. Les idées sont les éléments de tous les êtres; elles ont elles-mêmes pour principe, sous le point de vue de la matière, le grand et le petit, ou, comme dit Aristote, la dyade, et l’unité sous le point de vue de l’essence ; et sous ce double rapport les idées sont les nombres.
Platon semble avoir considéré les idées comme l’essence des êtres sensibles ; la dyade, composée de grand et de petit, en est la matière. Mais cette substance est périssable, tandis que la substance des idées est une dyade éternelle.
Un des vices de la théorie des idées, dans l’opinion d’Aristote, c’est de doubler inutilement le nombre des êtres au lieu de les expliquer. Dire qu’il y a un type commun, une idée, avec laquelle les individus sont en participation, ce n’est point avoir expliqué leur existence. Un autre défaut non moins grave c’est d’admettre à la légère qu’il existe des idées, sans établir cette hypothèse sur aucun argument solide, sans expliquer les contradictions qui résultent nécessairement d’un pareil système. À quel titre les idées existeraient- elles ? Est-ce comme essence des êtres ? cela est impossible, puisqu’elles en sont séparées : elles ne se trouvent pas dans les objets qhi en participent. Sont-elles des causes de mouvement ? pas davantage ; car on ne nous dit pas quel rapport unit les idées et les êtres sensibles. Prétendre que ees derniers participent des idées, c’est employer une expression vague qui n’explique rien, c’est faire, dit Aristote, des métaphores poétiques. Platon lui-même semble passer condamnation sur ce point, puisqu’il admet que pour un grand nombre de choses qui existent, les objets de l’art par exemple, il n’y a pas d’idées. L’idée est inutile pour la production, elle est dans l’impuissance de jamais l’expliquer. Enfin les idées ne peuvent pas prétendre non plus au titre de cause finale, quoique Platon ait admis que l’un des éléments de la dyade était le bien.
Sans accepter ni rejeter entièrement ces accusations, essayons de pénétrer plus avant dans le système de Platon, et de parcourir dans ses détours cet édifice dont nous ne voyons ici qu’une face.
La théorie des idées n’était point isolée dans l’enseignement de Platon, elle était intimement liée à sa théologie ; pour la bien comprendre il ne faut point l’en séparer. On sait quelle était la méthode platonicienne : s’élever graduellement du particulier au général, du général à l’unité[18]. Toutes les fois qu’il s’agit de l’idée, Platon ne s’inquiète point d’abord de la ramener à quelque chose de supérieur; il l’étudié en elle-même, il constate son existence ; mais une fois ce point bien examiné, bien développé, bien connu, il passe à une généralité supérieure, il arrive à l’idée de Dieu, et toutes les contradictions qui pouvaient subsister encore, s’effacentcomplétement du haut de ce point de vue. L’idée ne peut rien produire ; Aristote l’a dit avec raison, et Platon le reconnaît avec lui ; mais il y a loin de là à supprimer la cause du mouvement. La forme ne produit rien non plus dans le système d’Aristote; et cependant Aristote admet le mouvement, la cause de la production et de la destruction, il en fait un principe à part. Au-dessus de l’idée il y a Dieu, qui forme, qui organise; la divinité est pour Platon le véritable principe du mouvement. Sans doute, il semble donner aux idées une trop grande autorité ; il prête le flanc aux fausses interprétations, quand il dit que la divinité a formé le monde, les yeux fixés sur les idées[ 19] ; ces conséquences ont même été admises : des Platoniciens ont pensé que Dieu n’avait pas pu créer le monde sans un modèle indépendant de lui, et les Epicuriens tiraient de là un de leurs arguments contre la création [20]. Mais il n’en est pas moins vrai que Platon reconnaît l’action d’une cause motrice [21], qu’il explique par ce principe les phénomènes de l’univers. C’est Dieu qui a employé la matière, principe passif et inerte, qui lui a donné sa forme, c’est-à-dire qui a reproduit en elle les exemplaires éternels; autant du moins que l’imperfection de la matière pouvait se prêter à cette reproduction. « Le monde est matériel, sensible ; il a été formé par conséquent, il a un auteur, et si nous ne pouvons pas arriver à une notion claire de cet auteur, nous pouvons du moins nous demander d’après quels modèles il a formé le monde 22]. »
Élevons-nous plus haut encore ; au lieu de faire des idées des types spéciaux, indépendants de la divinité, disons que l’idée n’est que la pensée de Dieu, que Dieu réalise dans l’univers cette pensée éternelle ; au lieu d’anéantir l’idée comme le fait Aristote, rapportons-la à un principe supérieur, et alors elle devient réellement productrice ; elle est le principe des êtres sensibles, et il est vrai de dire, dans ce sens, qu’ils en participent, qu’ils en sont une représentation, une ombre affaiblie.
Ce qu’Aristote a vu surtout, c’est le caractère propre de chaque être, c’est la forme particulière de chaque individu; le point de vue de Platon était différent, sans être moins vrai pour cela : Platon s’est attaché aux caractères communs des individus, il est parti de là pour expliquer l’univers. Et en effet, il n’y a pas dans la nature, seulement des objets particuliers, tel arbre, puis tel autre, Socrate et Callias ; il y a l’arbre, l’homme en général. Nous sommes forcés par une nécessité rationnelle d’admettre que nos idées générales ne sont pas de pures conceptions ; qu’il y a une correspondance parfaite entre la pensée de l’homme et les lois de l’univers, la pensée éternelle. Nos idées n’ont point seulement une réalité subjective, elles répondent à quelque chose au dehors de nous ; dans ce sens les idées sont elles-mêmes des réalités. Et cela est si vrai, qu’Aristote n’anéantira pas l’idée, quoi qu’il fasse; il la reproduira sous un autre nom. Telle n’est point tout à fait, cependant, la portée du système de Platon. Il a eu le tort de faire de ces idées des êtres indépendants ; de ne point les identifier avec la pensée de Dieu, ou du moins de ne pas le faire assez nettement pour que ses successeurs ne pussent pas se méprendre sur sa pensée [23]. À part ce défaut, il échappe, autant que nous pouvons en juger aujourd’hui, aux reproches que lui adresse son disciple.
Platon n'a point négligé non plus le principe de l'essence ; mais il ne l'a pas pris au même point de vue qu'Aristote ; la forme essentielle d'Aristote est plutôt le caractère propre de l'individu, que le caractère général de l'espèce ou du genre. Platon avait trop négligé l'individu ; sa doctrine tendait à absorber l'individu dans la généralité, qui seule lui semblait digne de ses regards. Aristote, par une réaction naturelle, place l'essence dans l'individu, il ne l'en sépare point; pour lui, ce n'est plus l'idée qui produit l'homme, en se réalisant en lui; c'est un homme, dit-il, qui produit un homme. Le général est, ici, sacrifié au particulier. Ni Aristote n'est absolument dans l'erreur, ni Platon; ils ont pris chacun un côté de la vérité ; ils ont l'un et l'autre raison pour ce qu'ils adoptent, tort pour ce qu'ils nient. La même différence se retrouve dans leur cosmogonie avec les mêmes caractères. Le dieu d'Aristote ne se reproduit pas à chaque instant dans son œuvre ; il a de toute éternité organisé l'univers, réalisé la forme ; il a donné l'impulsion, et les mondes suivent la route qui leur a été tracée ; dans le mouvement primitif étaient contenues toutes les transformations futures : elles se produisent peu à peu, elles naissent sans interruption l'une de l'autre. On reconnaît là le germe de l'harmonie préétablie de Leibriitz. Le dieu de Platon est un ouvrier plus actif ; il a formé le monde, il le renouvelle sans cesse; sans cesse il produit de nouveaux individus, mais toujours en se conformant au type qu'il a adopté d'abord comme le plus parfait.
Il eût été difficile que Platon, après avoir pénétré si avant dans la science, omît un des principes les plus importants, celui qui d'ailleurs se manifeste avec le plus d'évidence, le principe du bien, la cause finale. Ici encore les accusations d'Aristote sontau moins exagérées. Platon dit expressément [24] que le bien est la notion suprême, le principe de toutes choses, et que le bien c'est Dieu ; Dieu est le principe de tout bien et dans le monde sensible et dans le monde intelligible ; l'ordre et l'harmonie de l'univers sont le résultat de son action incessante. On ne peut s'empêcher, à ces caractères, de reconnaître la cause finale.
Mais tout en réclamant contre la sévérité de la critique d'Aristote, il faut avouer que ces divers principes ne sont pas toujours bien définis par Platon, qu'il les emploie souvent d'une manière peu scientifique. Platon n'est pas toujours d'accord avec lui-même ; il accumule d'immenses matériaux pour la science, mais avec lui la science n'a pas dit son dernier mot.
Tous les principes des êtres ont donc élé étudiés soit par Platon, soit par les philosophes antérieurs, mais il est difficile encore de se reconnaître au milieu du vague et des. contradictions de leurs systèmes. Aristote va s'emparer de leurs découvertes, les coordonner, les éclaircir l'une par l'autre, et y joignant ses propres recherches, il constituera enfin la philosophie première ; il l'appuiera sur des bases tellement solides, que vingt siècles pourront à peine ébranler le monument.
III. Le but de la science a déjà été
déterminé [25] ; elle est la
connaissance des principes et des causes de l'être ; Aristote sur ce
point est d'accord avec Platon. Mais cette définition est encore
vague, elle donne lieu à un grand nombre de questions qu'il faut
éclaircir, si l'on ne veut se trouver à chaque instant arrêté par
d’insurmontables difficultés [26]. Par
exemple appartient-il à une seule science d’étudier toutes les
espèces de causes, ou bien chaque cause est-elle l’objet d’une
science particulière ? Parmi ces causes, quelle est celle qui
appartient plus spécialement à la philosophie ? Est-ce la cause
finale, est-ce la substance ? Cette dernière supposition admise,
toutes les substances sont-elles l’objet d’une seule science, ou de
plusieurs ? La philosophie première embrasse-t-elle seulement les
substances, ou bien s’applique-t-elle aussi à leurs propriétés ?
Est-ce à elle qu’il appartient d’étudier l’être sous ses divers
rapports, similitude, dissemblance, etc. ; n’est-ce pas là au
contraire l’objet propre de la dialectique ? Les principes de la
démonstration sont-ils aussi de son domaine ? Enfin quelle
différence y a-t-il entre la philosophie première et les autres
sciences, les mathématiques et la physique par exemple ? Toutes
questions que doit se poser le philosophe. Avant d’aborder l’étude
d’une science, il est indispensable de s’être formé une idée exacte
de sa portée, des objets qu’elle embrasse. Tant qu’on n’a pas
déterminé la carrière à parcourir, la science n’est réellement pas
possible ; elle reste flottante, incertaine, elle ne peut se définir
elle-même. Ç’a été là en général le vice de la philosophie, dans les
temps modernes ; faute d’avoir bien établi où elle commence, où elle
doit s’arrêter, on a philosophé au hasard ; on a fait de la
philosophie, bonne ou mauvaise, mais on n’a point constitué la
philosophie ; on n’en a pas fait une science dans la vraie
acception du mot. Sous ce rapport comme sous tant d’autres, Aristote
avait donné un exemple utile à suivre , il avait tracé la route à
laquelle on devait revenir tôt ou tard.
Pour lui la philosophie est la science de l’être en général et de
ses principes, non point de l’être dans telle circonstance donnée,
de l’être physique ou de l’être mathématique, mais de l’être en tant
qu’être. Les sciences particulières, la physique, les mathématiques,
et en général toutes les sciences intellectuelles ont des principes
plus ou moins rigoureux ; mais elles n’embrassent qu’un objet, qu’un
genre déterminé ; elles n’entrent dans aucune considération sur
l’être proprement dit, ni sur l’essence. Les unes partent de l’être
sans l’étudier en lui-même ; les autres admettent tout d’abord la
forme déterminée comme une propriété du genre dont elles s’occupent,
mais elles ne disent rien de l’existence ou de la non-existence de
ce genre. La physique est la science des êtres matériels en tant
qu’ils sont en mouvement ou peuvent recevoir le mouvement ; elle
serait la science première, s’il n’y avait d’autres êtres que
ceux-là ; mais il y a des êtres immobiles, et la science qui les
étudie a nécessairement la priorité. La science la plus élevée à
tous les titres, est celle qui porte sur des objets immobiles et
éternels. Les mathématiques ne peuvent pas prétendre à ce titre ;
les êtres quelles embrassent sont immobiles à la vérité, mais ils ne
sont point séparés de la matière, ils sont dans la matière ; l’être
premier, l’être absolu, est non-seulement immobile, il est
indépendant, et la seule science vraiment libre, vraiment
indépendante, doit être de toute nécessité celle qui porte sur
l’être indépendant, l’être en soi. Cette science est la philosophie
première. Elle est l’étude des axiomes que toute science doit poser
à son point de départ ; et par là elle domine toutes les
spéculations particulières , elle leur fournit une base et des
principes. Science universelle, dans toute l’acception du mot, elle
ne porte point sur une nature particulière, elle embrasse l’étude,
sans exception, de toutes les natures. L’être en tant qu’être, la
forme de l’être, les attributs universels de l’être en tant qu’être,
voilà son domaine : il comprend toutes les existences.
L’être s’entend de plusieurs manières [27] ; il est ou la substance, ou seulement une modification, une qualité, une privation de la substance ; mais ces diverses acceptions se rapportent à une seule chose, l’être en tant qu’être. De sorte qu’une seule science devra s’occuper de toutes les espèces de l’être, de toutes les modifications de la substance. Elle embrassera aussi l’étude de l’unité dans toutes ses acceptions; car l’unité ne peut se séparer de l’être ; enfin, une même science devant s’occuper des contraires, la philosophie sera la science de tous les contraires, elle étudiera e» même temps l’unité et la pluralité, dans lesquelles vient se résumer toute contradiction [28].
Si tel est, et on ne peut le contester à Aristote, le but de la philosophie première, aucune science ne s’est jamais proposé une aussi vaste carrière à parcourir. Elle] comprend l’étude du monde dans toute son étendue, du monde intelligible comme du monde sensible ; en elle viennent se résumer l’unité et l’infinie variété des êtres ; elle ne connaît d’autres limites que les bornes de la pensée humaine.
En sa qualité de science universelle, la philosophie est aussi appelée à vérifier les principes logiques du raisonnement. Toutes les sciences particulières les adoptent, aucune ne les soumet à l’examen, aucune n’en a le droit. Les axiomes embrassent tout ce qui est, et non pas tel ou tel genre d’êtres ; celui-là seul pourra prononcer sur l’autorité de ces principes, qui aura la science de l’être en tant qu’être. Toutes les sciences prennent l’être pour point de départ, et doivent par conséquent s’appuyer sur les axiomes ; mais, n’étudiant pas l’être sous tous ses rapports, elles ne peuvent contrôler des principes universels. Pour donner les principes les plus certains de ce qui est, il faut avoir la connaissance de l’être en tant qu’être, et, selon Aristote,le seul qui possède cette connaissance, c’est le philosophe [29]. L’examen des axiomes est donc un des principaux objets de la philosophie.
Quelle que soit cependant l’étendue de la philosophie première, elle a des bornes qu’il faut indiquer. Science de l’être en lui-même, et des propriétés, des modifications essentielles de l’être, elle ne peut embrasser l’étude de l’être accidentel, ni examiner ses causes ; l’accident n’a pas de cause proprement dite. Aucune science ne tient compte de l’accident, l’accident n’a guère même qu’une existence nominale [30]. Il suffit d’étudier la nature de l’accident, le mode de son existence, pour se convaincre qu’il ne peut être l’objet d’une science. L’accidentel est opposé au nécessaire ; c’est ce qui n’est ni toujours, ni ordinairement ; c’est par exemple le froid dans la canicule, c’est la la guérison opérée par le cuisinier. L’accident ne peut être le résultat d’une force, d’une puissance proprement dite ; il n’a qu’une cause accidentelle ; et cette cause, c’est la matière, en tant que susceptible d’être autre qu’elle n’est ordinairement. C’est une cause vague, incertaine, qui ne saurait être scientifiquement déterminée. Elle est par conséquent en. dehors de la science.
Il y a de la vérité dans ces assertions ; cependant elles demandent à être précisées davantage. Il est incontestable que l’accident, en tant qu’accident, ne peut être l’objet d’une science ; qu’il appartient, moins qu’à toute autre science, à la philosophie, à la science des êtres immuables. Mais l’être accidentel existe-t-il réellement dans le sens où le prend Aristote ; est-il vrai qu’il ne peut être rapporté à une cause nécessaire et rentrer dans le domaine de la science ? Cela paraît évident à l’homme qui ne fait que débuter dans l’observation de la nature ; une multitude de faits apparaissent, qui ne semblent se ramener à aucune loi, à aucun principe ; le désordre se montre de toutes parts. Mais à mesure que l’intelligence grandit, que l’observation vient compléter nos connaissances, nous supprimons peu à peu dans l’univers, cet inexplicable hasard, cette obscure propriété de la matière produisant les êtres accidentels ; chaque chose a sa loi nécessaire, et tous les faits qui s’accomplissent dans la nature, qu’ils se présentent chaque jour ou qu’ils ne se reproduisent qu’à de rares intervalles, suivent inévitablement cette loi : le hasard ne peut trouver de place dans l’harmonie de l’univers. Nous ne connaissons véritablement qu’une seule cause d’accident, et cette cause, elle ne réside pas dans la matière ; c’est une force, une puissance active, c’est la volonté humaine. Il n’y a d’accidentel que ce qui est le résultat de cette volonté. Tout le reste est nécessaire et immuable.
Quoi qu’il en soit, Aristote est dans le vrai en affirmant que l’être accidentel, ne peut être l’objet de la philosophie. On doit seulement regretter qu’il ait un peu restreint, par ces idées d’accident, de hasard, la notion de cette harmonie universelle qui dérivait si naturellement de son système.
Le vrai et le faux ne doivent point non plus être L’objet de la philosophie ; elle étudie les êtres en euxmêmes, et l’être soi est toujours le vrai ; ce n’est point la pensée qui constitue l’essence des êtres, c’est la pensée au contraire qui constitue le vrai et le faux, car le vrai et le faux ne sont que la convenance et la disconvenance du sujet et de l’attribut, et cette convenance ou cette discotivenance résident dans la pensée. L’ontologie ne s’occupe point de l’examen des êtres qui doivent leur existence à la pensée, elle n’a pour objet que l’essence et les lois de l’être considéré en lui-même.
IV. L’étendue et les limites de la science déterminées, il ne reste plus qu’à montrer sa possibilité, à lui donner une base solide, c’est-à-dire à poser un principe incontestable, qui puisse, a priori, légitimer tous ses résultats ; ce principe, c’est, selon Aristote, le principe de contradiction.
Une des choses les plus incontestables aux yeux du sens commun, c’est que l’homme, dans l’exercice de ses facultés intellectuelles, peut arriver à des connaissances réelles, absolues, qui ne sont point uniquement relatives à lui-même, à sa manière de voir, mais qui répondent à quelque point de la vérité. Il y a une correspondance intime entre l’homme et la nature; l’intelligence humaine est un miroir où vient se peindre, Confusément quelquefois, mais souvent aussi dans son plus vif éclat, la vérité éternelle. Telle a été du moins dans tous les temps l’opinion de l’humanité. Les philosophes cependant nese sont point toujours rendus à l’évidence de ce principe. Il en est qui, de bonne foi, ou par esprit de sophisme, ont révoqué en doute le témoignage de nos facultés; ils ont subjectivé, si l’on nous passe l’expression, la connaissance humaine, et, confondant la vérité et l’erreur, ils ont prétendu condamner l’homme à l’absolue ignorance, ou du moins, lui fermant tout accès à la vérité absolue, ils l’ont réduit à une connaissance passagère, changeante, périssable comme l’humanité. Dans une sphère étroite, lorsqu’il ne s’agit que des données des sens, de pareils systèmes ne sauraient être dangereux ; peu importe que vous prétendiez que telle saveur est à la fois douce et amère, que le miel n’a en lui-même aucune saveur agréable ni désagréable ; chacun n’en continuera pas moins à consulter son goût, et à vivre selon sa coutume. Mais si, passant des notions sensibles aux notions ontologiques et aux notions morales, vous résolvez les problèmes dans le même sens ; si, comme les sophistes de la Grèce, comme Hume dans les temps modernes, vous affirmez que tout est bien ou que tout est mal, ou ce qui revient au même qu’il n’y a ni bien ni mal, si vous subjectivez en un mot les notions de la raison, alors la question prend un caractère tout autrement sérieux. Le moindre doute que vous laisseriez planer sur la vérité porterait, malgré tous vos efforts, ses fruits dans la science ; il faut avoir foi dans la vérité pour la rechercher avec ardeur et pour la découvrir. Il est donc indispensable de se demander, au début de la philosophie, s’il existe ou non une vérité absolue saisissable pour l’homme, ou bien si tout est confondu, s’il n’y a aucune différence entre le vrai et le faux, si la même chose est à la fois et n’est pas.
Les deux grands législateurs de la science dans l’antiquité et dans les temps modernes, Aristote et Kant ont abordé cette question ; mais ils lui ont donné une solution bien différente. Kant, tout en reconnaissant l'universalité des jugements de la raison, conteste cependant à cette faculté le droit de s’élever à l’absolu ; il subjective nos connaissances, et les réduit à des proportions purement humaines ; il commence par élever un doute sur ses propres découvertes, et s’interdit ainsi d’avancer, sinon en se mettant en contradiction avec lui-même. Aristote, au contraire, marche avec assurance ; il ne croit pas seulement à l’existence d’une vérité relative, humaine et périssable, il aspire à quelque chose de plus, il veut la vérité elle-même, et il établit tout d’abord qu’elle existe, que l’homme peut la saisir et la posséder.
Ce n’est point par voie de démonstration qu’Aristote prétend établir le principe de toute vérité ; ce serait tenter l’impossible, l’ignorance seule oserait entreprendre une pareille tâche. Mais toute vérité ne veut pas être démontrée ; on remonterait sans cela à l’infini, on verrait fuir éternellement devant soi la certitude et la démonstration même. Pour que la démonstration soit possible, il faut qu’il y ait des vérités premières, incontestables, évidentes par elles-mêmes, principes de toute démonstration. C’est à ces vérités qu’il faut s’arrêter, c’est sur elles qu’il faut faire reposer la science. Le plus sûr de tous les principes, celui sur lequel s’appuient tous les autres, c’est le principe de contradiction, qui peut se formuler ainsi :
Il est impossible que, sous le même rapport, le même attribut appartienne et n’appartienne en même temps au même sujet.
Le quatrième livre est presque tout entier consacré à l’examen de ce principe. Le scepticisme, avant l’apparition de la Métaphysique, s’était déjà présenté sous bien des formes ; plus d’un système avait abouti à nier la possibilité de la science. Malgré tous les efforts de Platon, il restait dans les abords de la philosophie une multitude d’obstacles qu’il importait de détruire, des doutes qui s’autorisaient de faits réels, qui s’entouraient d’arguments spécieux, propres à séduire même parce qu’ils avaient de paradoxal, et qui appe laient une critique approfondie, une sévère appréciation.
À ceux qui contestent la certitude du principe de contradiction, Aristote ne demande qu’une seule chose, désigner, déterminer un objet, quel que soit le mot qu’ils emploient, quelque sens qu’ils attribuent à ce mot. Soit par exemple le mot homme ; il désigne un objet, un être déterminé; il n’en désigne qu’un seul, au moins pour la pensée actuelle, car il faudrait avoir perdu le sens pour attribuer au même mot une multitude de significations. Du moment que vous avez désigné un objet unique, vous avez déterminé quelque chose, vous avez admis implicitement le Principe. Prétendre le contraire, dire que l’homme et ce qui n’est pas l’homme sont la même chose, c’est dire qu’il n’y a rien de déterminé, c’est anéantir le langage, c’est rendre la pensée impossible ; car toute pensée, exprimée ou non , doit porter sur quelque chose de déterminé ; l’existence seule de la pensée dément les assertions des Sophistes.
D’un autre côté on ne peut pas prétendre que le même être est et n’est pas, que rien n’est déterminé, sans nier en même temps l’existence de la forme et de l’essence des êtres. Si l’homme et le non-homme, pour parler comme Aristote, sont identiques, il n’existe rien qui constitue l’essence de l’homme, tout est accident dans le monde, il ne peut plus y avoir aucun principe universel. Mais l’accident est toujours l’attribut d’un sujet ; et s’il n’y a pas de sujet déterminé, il faudra prolonger à l’infini la chaîne des accidents, et dire qu’il n’y a que des accidents d’accidents ; or, cela est impossible. Il y a nécessairement une substance déterminée ; et de là un argument invincible contre la possibilité de l’existence simultanée, dans le même individu, des contradictoires et des contraires.
Une autre conséquence de ces systèmes, c’est que tout est toute chose, et qu’il n’existe qu’une seule chose. Car, si toutes les affirmations contradictoires sont vraies, si, comme le dit Protagoras, l’opinion de chaque homme constitue la vérité, l’homme est une galère, la galère est un homme ; et le monde est encore ce chaos, ce mélange des éléments, cette primitive confusion dont parlait Anaxagore. Enfin les sceptiques se sont chargés eux-mêmes de détruire leur système. Ils affirment que tout est vrai ou que tout est faux ; mais alors, de deux choses l’une, ou bien leur assertion n’admet aucune exception, et dans ce cas elle se détruit elle-même, ou bien la seule chose vraie, c’est cette assertion que tout est faux, que tout est vrai ; or, c’est admettre qu’il y a un principe vrai, tout en prétendant qu’il n’y a ni vérité ni fausseté (car si tout est vrai tout est faux, et réciproquement) ; c’est élever d’une main, pour renverser de l’autre. Une chose fort consolante du reste, comme le remarque Aristote, c’est qu’il est beaucoup plus facile de proclamer le scepticisme que de le mettre en pratique. Ceux qui, de son temps, refusaient spéculativement d’admettre la distinction du vrai et du faux, n’en continuaient pas moins de vaquer à leurs affaires ; ils allaient à Mégare, ils évitaient le précipice où ils eussent pu tomber: donnant par là un démenti formel à leurs principes.
Cependant, malgré l’absurdité de toutes ces doctrines, Aristote est obligé de reconnaître qu’elles ont un côté spécieux, qu’elles trouvent jusqu’à un certain point leur justification dans les phénomènes sensibles. Le tort, selon lui, de tous les philosophes qui ont professé le scepticisme à cet égard, c’est de ne s’être arrêtés qu’aux objets sensibles. Ainsi Anaxagore et Démocrite voyant les mêmes choses produire les contraires, et ne s’étant point élevés à l’idée d’un principe autre que la matière, ont pu naturellement en conclure l’existence simultanée des contraires dans les mêmes êtres ; ils n’étaient point encore arrivés à la distinction de la puissance et de l’acte, distinction sans laquelle on ne peut expliquer la production et la destruction. Les contraires existent bien dans le même être, mais il n’y sont pas en acte ; ils faut de toute nécessité que l’un des contraires ne soit qu’en puissance. C’est aussi l’apparence des objets sensibles qui conduisit Démociite, Parménide, Anaxagore, Protagoras, à faire des opinions de chaque homme la mesure de la vérité. Les jugements humains varient à l’infini suivant les divers individus, ils varient dans le même homme suivant les circonstances : au milieu de cette diversité d’opinions, où est la vérité ? A ces considérations, joignez celles qui se tirent des transformations incessantes des êtres, du mouvement de toutes choses, et cette préoccupation pourra vous conduire jusqu’à l’opinion exprimée par Héraclite, et par son disciple Cratyle, à savoir, que, ne pouvant y avoir aucune science de ce qui est essentiellement variable, l'homme ne peut rien affirmer, sous peine de tomber dans l’absolue et perpétuelle erreur.
Aristote répond d’abord à tous ces philosophes, qu’ils n’ont considéré que le monde terrestre, et que leurs conclusions fussent-elles vraies relativement à ce monde, l’homme pourrait encore trouver la certitude dans des régions plus élevées ; qu’en négligeant le témoignage des sens, il pourrait s’en rapporter au témoignage de ses autres facultés :
« Cet espace qui nous environne, dit-il, le lieu des objets sensibles, le seul qui soit soumis aux lois de la production et de la destruction, n’est qu’une portion nulle, pour ainsi dire, de l’univers. De sorte qu’il eût été plus juste d’absoudre ce bas monde en faveur du monde céleste, que de condamner le monde céleste à cause du premier [31]. »
Mais sans attaquer ces philosophes d’un point de vue qui n’est pas le leur, il consent à se renfermer dans le cercle étroit où ils ont circonscrit leurs recherches ; il suppose un instant, avec eux, que la connaissance ne porte que sur les objets sensibles.
Il n’est point vrai, même dans cette hypothèse, de dire que toutes les apparences sont vraies ; une chose est, ou elle n’est pas, elle ne varie point suivant l’opinion qu’on s’en forme. S’il y a dissidence, diversité de jugements ou de goûts, cela tient à l’homme, et non pas aux choses elles-mêmes. On ne conteste point l’existence de la lumière, parce qu’il y a des aveugles ; on n’est pas plus fondé à admettre l’opinion d’un malade et d’un homme dont le goût est perverti, s’il s’agit des qualités de telle ou telle substance : il faut s’en rapporter au jugement de l’homme en santé, et ne point prendre l’exception pour la loi. Que si on demande quel est l’homme en santé, à cela il n’y a pas de réponse ; demandez donc quels sont les fous, quels sont les hommes raisonnables, quand est-ce qu’on dort, ou qu’on est éveillé !
Les objections qui se tirent du désaccord des sens chez le même individu ne sont pas plus difficiles à résoudre ; il suffit de distinguer la donnée du sens, de l'idée qui la suit, ou, comme nous dirions aiijourd hui, la sensation de la perception [32]. L’homme peut se tromper ; mais les erreurs ne viennent jamais des sens, elles viennent toujours du jugement ; et, avec un peu d’attention, il est aisé de se garantir de ces erreurs. Il suffit pour cela de distinguer les données des divers sens. Il ne faut point, comme on l’a dit, opposer aux données de la vue, le témoignage du tact ou de tout autre sens : chaque sens a son domaine, on ne doit point l’en faire sortir ; il faut, mais dans la sphère de son action, lui laisser une pleine et entière autorité. Quant aux arguments tirés des phénomènes des songes, Aristote répond que personne ne s’y trompe ; il n’est aucun homme, et c’est-là l’exemple dont il se sert, qui, se trouvant en Afrique, et ayant rêvé la nuit qu’il était à Athènes, se lève le matin pour se rendre à l’Odéon.
Un pareil système irait à dire qu'il n’y a d’autre réalité que la sensation ; que, sans les êtres sensibles il n’y aurait absolument rien ; que le monde n’existe que dans la pensée de l’homme : à elles seules, ces conclusions suffisent pour le réfuter. « La conséquence qui sort d’un pareil système, dit Aristote, est réellement affligeante. Si telles sont les opinions des hommes qui ont le mieux vu toute la vérité possible, et ces hommes sont ceux qui recherchent la vérité avec ardeur, et qui l’aiment…, comment aborder sans découragement les problèmes philosophiques ? Chercher la vérité, ne serait-ce pas vouloir atteindre des ombres qui s’envolent [33] ? "
Heureusement pour la science, la raison humaine a tellement foi en elle-même, qu’elle ne peut point, quoi qu’elle fasse, mettre en doute sa propre autorité. Il est impossible, on peut le reconnaître sans danger, de démontrer que nos facultés ne nous trompent pas. En vain aurions-nous une faculté supérieure même à la raison ; elle tomberait, elle aussi, sous l’éternelle objection. Mais il n’est pas moins impossible de douter réellement ; on peut bien professer le scepticisme du bout des lèvres, mais tout ce qu’on dit, comme le remarque Aristote, il n’est pas nécessaire qu’on le pense.
Ne pourrait-on pas cependant, sans attaquer directement le principe de contradiction, prétendre qu’entre deux contraires il y a un intermédiaire qui n’est ni l’un ni l’autre, ou bien qui est tout à la fois l’un et l’autre ? Dans l’une comme dans l’autre supposition, suivant Aristote, la production, le changement sont impossibles. Il faudrait d’ailleurs admettre une infinité d’intermédiaires ; enfin on aboutirait à dire, comme dans les systèmes précédents, qu’il n’y a ni vrai ni faux, que tout est indéterminé.
Pour échapper à ces conclusions, il n’y a qu’un seul moyen, c’est de déterminer, de définir, ou en d’autres termes, d’exprimer quelque chose ; car la notion dont les mots sont le signe, est la définition de la chose dont on parle [34]. Partant de ce principe, Aristote définit les différents termes qu’il doit employer dans la suite de son ouvrage [35]. Mais il faut prendre garde de se tromper sur la valeur et le rôle de ces définitions ; il ne faut pas croire, comme on a été souvent tenté de le faire, que les définitions, en philosophie, soient des principes généraux, des axiomes dont la science déduit une multitude de conséquences particulières. La philosophie est une science de faits, et les définitions, dans les sciences de faits, ne peuvent avoir ce caractère. La définition dans les mathématiques joue un double rôle : elle sert à fixer la notion de la chose dont on parle, et de plus elle est la conception même, elle est une véritable hypothèse dont on déduit peu à peu toutes les conséquences. Elle est donc véritablement, à ce titre, le principe, le point de départ de la science. Il n’en est pas ainsi dans les sciences de faits : là, il n’est point possible de poser a priori un principe qui renferme en lui-même toutes les déductions que l’analyse se chargera d’en tirer ultérieurement. Dans les sciences de faits, la définition n’est pas au début, elle est au point d’arrivée, elle est la conséquence, le résultat de la science ; elle ne peut être complète qu’au moment où la science est complète elle-même. Pour définir l’être, la substance, il faut les connaître non point vaguement, mais d’une manière précise ; il faut les avoir étudiés sous tous les rapports, être descendu aux derniers degrés de l’analyse. Si Aristote part de certaines définitions, il n’en fait point cependant des principes a priori, comme les définitions mathématiques ; il ne tire point son ontologie des définitions ; ce serait bien plutôt te contraire. S’il définit, c’est pour nous montrer par avance le but qu’il se propose d’atteindre. Il possède déjà la science pour lui-même, il veut l’enseigner ; il peut donc sans inconvénient nous montrer dés l’abord les résultats qu’il a obtenus ; c’est un moyen de nous guider, de nous encouragera le suivre : ignoti nulla cupido.
C’est une méthode tout autre qui le dirigeait, alors qu’il cherchait la vérité : là, il a dû observer ; mais il ne définissait pas. Un seul exemple suffira pour nous en convaincre. Prenons la définition de la cause [36]. La cause est ou bien la matière constitutive dont est fait un être,… ou bien la forme, la raison d’être,… Elle est encore le premier principe du changement, du repos ;… enfin elle est le but, c'est-à-dire ce en vue de quoi une action s’accomplit. Il est évident que le mot cause ne réveille pas immédiatement en nous toutes Ces idées ; la cause n’a pas toujours été considérée sous tous ces rapports : une pareille définition implique la connaissance de tout le système, elle n’en est pas le principe, elle n’en est que le résumé. En l’entendant ainsi, il est vrai de dire qu’on doit partir de définitions. Le philosophe qui veut enseigner, doit d’abord définir les termes qu’il emploie, dire quel sens il y attache ; c’est le moyen de se faire comprendre. En s'appuyant sur des définitions, Aristote n’a pas d’autre but. Mais, comme il n’avait pas dit expressément quel était le caractère de la définition philosophique, on interpréta mal sa pensée dans le moyen âge : Aristote avait été un observateur scrupuleux et zélé, les Scolastiques observèrent peu, ou même n’observèrent point; ils se contentèrent de poser des principes qu’ils n avaient point trouvés eux mêmes, qu'ils recevaient tout faits des mains d’une autorité regardée comme supérieure, à savoir, l’autorité d’Aristote. La dialectique se substitua à la méthode d’observation, et la science fut, pour longtemps, condamnée à tourner dans le cercle tracé par la pensée antique.
ONTOLOGIE. Jusqu’à présent nous ne sommes point entrés à proprement parler dans l'exposition du système ontologique d’Aristote ; on peut déjà cependant s’en former une idée assez juste. Les limites de la phlosophie première ont été fixées : nous savons qu'elle est l'étude de l'être en lui-même, qu'elle ne se borne pas, comme les autres sciences spéculatives, à l'examen d'êtres sensibles ou mathématiques, mais qu'elle aspire à la connaissance de l'être proprement dit, c'est-à-dire de l'être indépendant et immuable : elle est l'étude de l'absolu. Il nous reste à suivre Aristote sur ce terrain ; à voir la solution qu'il a donnée à cette question si difficile et si controversée de l'être premier ; à comparer son système à ceux de ses devanciers, et à montrer les liens secrets qui, sous l'apparence d'une diversité absolue, rattachent ses doctrines à celles de Platon et de Pythagore. Il est aisé de se convaincre, à la lecture de la Métaphysique, qu Aristote a été continuellement préoccupé des doctrines de Pythagore et surtout de l'ontologie de Platon. Il semble qu'il craigne par-dessus tout de se rencontrer avec son maître ; il oppose continuellement son système au système de Platon ; à chaque instant il revient sur la théorie des idées, il la présente et l'attaque sous diverses faces. Aristote est novateur, et il ne veut pas qu'on l'ignore. Toutefois il n'y a pas aussi loin de Platon à Aristote qu'on pourrait se Ie figurer ; la différence est plutôt dans la forme que dans le fond du système : le soin même que prend Aristote de revenir continuellement sur cette différence est bien fait pour inspirer quelques doutes ; il prouve du moins que la distinction est délicate, qu'elle n'est pas toujours facile à saisir.
L'ontologie est la science de l'être en lui-même ; mais l'être absolu, indépendant, ne tombe point sous nos sens ; nous le concevons, nous ne le percevons pas : les seuls êtres que nous percevions sont relatifs et périssables : ils diffèrent essentiellement de la substance absolue, ils sont avec elle dans le rapport du contigent au nécessaire, du fini à l'infini. Bien plus, il ne peut même pas y avoir science des substances sensibles; elles renferment de la matière, c'est-à-dire un principe d'indétermination [37]. Elles ne peuvent être définies, par conséquent, au moins d'une définition réelle ; elles échappent à la science.
Mais, d'un autre côté, quelque loin qu'il y ait des êtres sensibles à l'être éternel, ce n'est qu'en passant par les premiers que nous pouvons nous élever à l'idée du second ; la substance sensible n'est pas la seule substance, mais elle est la plus apparente : c'est elle qui frappe d'abord tous les regards ; c'est par elle qu'il faut débuter, sauf à s'élever ensuite à de plus hautes spéculations. Telle a été la marche de l'humanité ; ce doit être là aussi la marche du philosophe ; il lui faut s'appuyer sur ce qu'il connaît pour arriver à l'inconnu, sur ses idées personnelles pour arriver aux idées absolues. Ces considérations que nous tirons d'Aristote lui-même [38], nous révèlent tout le plan de ce qui est, à proprement parler, sa philosophie première. Plus prudent et plus méthodique que ne l'avaient été ses prédécesseurs, Aristote n'aborde pas immédiatement la notion de la substance ; il ne nous décrit pas, dés le début,sa nature, ses éléments, comme on avait fait avant lui pour le nombre et l'idée : il part de ce que tous les hommes connaissent, de la substance sensible, il l'analyse, la décompose en ses divers éléments, la ramène à ses principes ; puis il demande compte à ces principes des diverses transformations de la matière, de la production et de la destruction ; et enfin, quand il a reconnu que ces principes ne suffisent pas, quand une étude approfondie des êtres matériels a démontré qu'ils ne peuvent exister seuls, qu'ils n'ont point leur raison dans eux-mêmes, alors, mais alors seulement, il s'élève à la notion d'une autre substance ; il passe du relatif à l'absolu, de la pluralité à l'unité, et cherche à concilier l'un avec l'autre, à rendre raison et de l'unité de l'être et de l'infinie diversité des existences individuelles.
Toutes les questions ontologiques peuvent se ramener à celle-ci :
Qu'est-ce que la substance ? car la substance c'est l'être lui-même,
l'être pris absolument, l'être premier sous le rapport de la notion,
sous le rapport du temps et de la nature [39].
Cette question a été traitée plus ou moins explicitement par tous
les philosophes, et la réponse qu'ils lui ont donnée est le résumé,
la plus haute expression de tout leur système.
Si l'on dit que la substance est la matière, on tombe nécessairement
dans les erreurs des Physiciens ; et alors, ou bien on ne donne à la
matière que ses véritables caractères, on la regarde comme un être
abstrait, indéterminé, et l'on est ainsi dans l'absolue
impossibilité d'expliquer les phénomènes sensibles, lesquels sont
tous déterminés, définis ; ou bien, et ç'a été là l'erreur générale,
on est obligé de donner à la matière des caractéres qui répugnent :
sa notion; ou confond la matière abstraite, indéterminée, avec la
forme, c'est-à-dire le principe de la détermination par excellence.
Si l'on admet que la substance est l'universel ou le genre, on tombe dans le système de Pythagore ou dans celui de Platon, car le nombre et les idées sont des universaux ; et l'on reconnaît alors, ou bien que la substance est dans les objets, dans les individus, mais en tant que genre, en tant qu'attribut universel ; que le nombre, par exemple, ou la proportion numérique qui constitue l'homme, se trouve dans Socrate ou dans Callias, qu'elle n'en est point séparée ; et l'on est réduit à construire l'individu avec le général sans pouvoir dire ce qui constitue en lui l'individualité, ce qui le distingue du général : ou bien que la substance est en dehors de l'individu qu'elle constitue, ce qui n'est guère plus intelligible, cardans ce cas elle n'est plus la substance de l'individu, elle ne peut nullement expliquer l'individu, elle est d'une complète inutilité et dans la production des êtres et dans la science.
Reste une dernière supposition : la vraie substance des êtres, ce sera la forme, c'est-à-dire le caractère propre de chaque objet, ce qui le fait lui-même, ce qui le distingue de tous les autres individus compris dans le genre. Ce système est celui d'Aristote. Il échappe aux inconséquences des opinions précédentes; il ne sépare point la substance de chaque êlre, de l'être lui-même ; il rend compte parfaitement de l'existence propre de chaque objet, en donnant pour essence à l'individu non pas un caractère universel, mais une substance particulière, qui n'est qu'à lui, qui ne peut pas être séparée de lui, qui ne se trouve dans aucun autre être que dans lui-même.
Ici, une grave difficulté se présente : sans doute il y a des individus dans la nature, et il est indispensable de déterminer en quoi ils consistent, quelle est leur forme, leur caractère essentiel ; mais il y a aussi des genres, des espèces, et ces genres ne sont pas de vaines conceptions de notre esprit : nous ne les constituons pas par notre pensée; ils ont une existence qui ne dépend pas de nous. La science doit les expliquer, eux aussi: elle doit nous dire quels sont ces caractères communs qui apparaissent dans les êlres de même genre et de même espèce ; il lui faut, tout en admettant que chaque être a sa substance propre, reconnaître aussi qu'il y a des types premiers, qui se reproduisent dans chacun d'eux : après avoir fait la science de l'individuel, il faut faire la science du général.
Aristote a senti la difficulté, il ne l'a pas complètement résolue. Selon lui, les principes sont différents pour les différents êtres ; et, quand il veut expliquer les caractères généraux que présentent les individus d'un même genre, ou il se contente de dire que les principes sont identiques par analogie, ou bien il regarde la forme non plus comme la cause de l'individualité, mais comme un principe générique ; il rétablit sous un autre nom cette théorie des idées qu'il a si souvent et si vivement combattue.
La matière semble, au premier abord, porter plus que tout le reste le caractère de substance : elle n'a ni forme, ni qualité, ni aucun attribut ; elle est le sujet persistant sous les diverses modifications, elle seule demeure permanente au milieu des changements de tout genre que subissent les objets. Mais, d'un autre côté, elle n'est pas déterminée ; bien loin de là, son essence est l'absence même de toute détermination ; elle n'est rien par elle-même, sinon une possibilité d'être, une simple puissance de devenir [40]. Sous ce rapport, l'ensemble de la forme et de la matière, c'est-à-dire la matière réalisée, a plutôt le caractère de substance que la matière indéterminée qui, pouvant être toute chose, n'est rien à elle seule. Là n'est point encore cependant la véritable substance. L'être réalisé n'est point un premier principe : ce titre n'appartient et ne peut appartenir qu'à la forme pure, à l'essence.
Qu'est-ce donc que la forme, et quelle est la nature de ce principe? Cette question, qui est le point fondamental du système d'Aristote, n'a pas toujours reçu de lui, comme déjà nous l'avons indiqué, une solution précise: est-elle un genre, un exemplaire commun qui se reproduit dans les individus; ou bien est-elle individuelle, inséparable de chaque être ? Elle est l'un ou l'autre selon le besoin, ou plutôt elle est tout à la fois l'un et l'autre : cependant Aristote incline généralement à placer dans la forme le principe de l'individualité [41]. C'est-là ce qui le distingue de Platon. La forme substantielle est, selon lui, l'essence déterminée ; elle est opposée par là à la matière, laquelle n'a, par elle-même, aucune qualité, aucune détermination.
La forme pure, c'est l'être, abstraction faite de tout élément constitutif ; ce n'est point seulement un attribut inhérent au sujet, c'est une qualité essentielle et sans laquelle on ne peut le concevoir : musicien et blanc ne sont pas la forme de Socrate, on peut le concevoir sans ces attributs, ils peuvent en être séparés sans que l'être soit anéanti ; la forme, au contraire, ne saurait être séparée, sans qu'il y ait destruction de l'objet. La forme de Socrate, c'est l'homme, si l'on considère Socrate comme esprit et corps ; c'est l'âme, si l'on envisage Socrate sous un point de vue plus restreint, seulement comme intelligence.
Cette forme, cette essence pure est éternelle ; elle ne se produit point dans un être, elle s'y réalise. Cause de l'existence des objets, la forme ne périt pas avec eux ; la seule chose qui périsse, c'est l'union de telle forme et dételle matière; la forme périt dans un objet, sans périr elle-même : elle n'est sujette ni aux lois de la production, ni à celles de la destruction.
On pourrait se demander ici quelleest donc cetteforme qui, cause de l'existence Individuelle, se reproduit cependant dans une multitude d'êtres. Est-ce bien réellement dans la forme que consiste l'individu ? et, s'il en est ainsi, comment faire de la forme un principe général ? Elle ne peut être admise à ce double titre : ou elle est l'essence même de chaque être, sa nature propre, ou elle est la généralité qui se reproduit dans tous les individus du genre ; elle ne peut être l'un et l'autre à la fois. La forme de Socrate, c'est, ou bien le caractère propre de Socrate, ce qui le distingue de tous les autres hommes, ou bien l'homme en général, c'està-dire le caractère qui lui est commun avec l'espèce. Pour Aristote, la forme n'a que le premier de ces caractères : telle est du moins la signification générale de son système. Pour Platon, au contraire, la forme, l’idée n’est que le type général.
Les deux systèmes sont opposés sans s’exclure ; ou plutôt ils s’appellent l’un l’autre la vérité ne peut se trouver que dans leur conciliation. Oui, la substance de chaque être est véritablement la forme déterminée, le caractère propre, la différence, pourvu qu’on admette aussi, qu'indépendamment de cette détermination propre, chaque individu réalise en lui un type général, que dans chaque être la généralité se montre à côté de la particularité. Socrate est lui-même, il est un être déterminé, mais Socrate est aussi membre de l’humanité ; et l’humanité se manifeste en lui, comme elle se manifeste dans chacun des membres de l’humanité.
Quelque naturelle que soit celle conséquence, Aristote la repousse de toute sa force. Ce qu’il voit surtout, ce qu il voit presque uniquement dans la nature, c’est l’individu ; cela résulte clairement de la théorie de la définition appliquée à la forme. Il admet, comme Platon, que l’essence des êtres c’est ce dont il ya définition ; et par définition, il faut entendre ce qui exprime un objet premier, c’est-à-dire un objet dont la notion ne peut être rapportée à un autre objet. Partant d’une donnée commune, Platon et Aristote se séparent aussitôt : toute définition contient deux termes, le genre et la différence ; Platon regarde!e genre comme l’essence des êtres, Aristote s’attache au contraire à la différence [42]. La définition est, selon l’expression d’Aristote, la notion fournie par la différence ; non pas telle] différence prise à volonté, mais la différence propre, caractéristique, de l’individu dont il s’agit, en un mot, la dernière différence ; or, une telle définition, c’est la notion de l’essence même de l’objet.
Il était difficile de trancher plus nettement la question. Appuyé sur cette vérité incontestable, que la substance propre d’un objet ne peut être que dans cet objet même, Aristote met dans tout son jour le vice des doctrines de Platon et de Pythagore : mais, oubliant d’un autre côté que la forme de l’objet, c’est-à-dire sa notion, sa cause d’existence, n’est pas seulement dans l’objet lui-même; qu’avant d’être dans l’objet, elle a dû être ailleurs, sinon réalisée, du moins comme puissance, comme raison d’être; que la forme de chacun des êtres de la nature a dû être pensée par Dieu comme la forme de la maison a dû être pensée par l’architecte ; que cette pensée de Dieu a dû porter non seulement sur les individus, mais aussi sur les genres qui le comprennent, sur l’universel comme sur le particulier; oubliant, disons-nous, cette vérité, non moins incontestable que la première, il refuse d’admettre, à quelque titre que ce soit, cette substance universelle qui fait le fonds de la doctrine de Platon et de Pythagore. L’universel, répète-t-il souvent, ne peut pas être substance [43]. Il n’y a, selon lui, d’autres substances que celles des individus; et la substance d’un individu, c’est celle qui n’est point commune à plusieurs autres. L’universel, au contraire, est commun à plusieurs êtres ; il désigne la manière d’être, un mode de l’existence, mais non pas l’existence déterminée. « Ni l’unité, ni l’être, ni aucun attribut général ne peuvent être substance… ; la substance n’existe dans aucun autre être que dans elle-même, et dans l’être dont elle est substance [44]. »
Platon s’était montré exclusif; Aristote ne l’est guère moins ; mais il serait injuste de lui en faire un crime. S’il s’est trop préoccupé d’un point de vue des choses, il était difficile qu’il n’en fût pas ainsi. La doctrine platonicienne était dangereuse, au moins par sa tendance; elle renfermait un germe d’erreur qui s’est développé plus tard [45]. Effrayé de la tendance, craignant de voir l’individu s’abimer dans une vague généralité, Aristote lui attribue une importance exagérée; il lui fait don de l’indépendance absolue, il oppose la théorie de la forme à la théorie des idées, et s’il est quelquefois contraint à se rapprocher de Platon c’est toujours à regret.
Ainsi, dès le point de départ, opposition complète entre les systèmes de Platon et d’Aristote: forme au lieu d’idée, c’est-à-dire, particularité au lieu de généralité. Mais, nous l’avons dit, cette opposition se dément quelquefois ; la forme ne peut point rester purement individuelle ; la généralité reparait sans cesse, elle se glisse au milieu de la théorie de la forme : entraîné par la force même des choses, Aristote change plus d’une fois de point de vue, et dévie, malgré qu’il en ait, de la route qu’il s’était tracée. Là est un lien qui réunit nécessairement Aristote et Platon : il n’était pas plus possible à Aristote de supprimer l’universalité qui est dans le monde, qu’il n’avait été possible à Platon de supprimer les individus, quoiqu’il y fût conduit logiquement par son principe.
Si nous comparions Aristoteà Pythagore, nous trouverions la même différence en apparence, et au fond, le même rapport. Les Pythagoriciens ne séparaient pas la substance, des individus, et ils échappaient par là à quelques-unes des inconséquences des Platoniciens; mais ils formaient l’individu avec une substance universelle, sans expliquer ce qui constituait l’individu : sous ce point de vue, leur doctrine est identique à celle de Platon.
Si, pénétrant plus avant dans la théorie de la forme, nous l’étudions sous le rapport de la puissance et de l’acte, de l’unité et de la pluralité, si nous appliquons cette théorie à la production et à la destruction des êtres, nous aurons à signaler encore des différences fomlamentales entre la forme d’un côté, et de l’autre le nombre et l’idée, mais nous trouverons aussi de nouvelles analogies, et bien plusremarquables encore. Mais avant de passer à l’étude de la forme considérée soit comme acte et cause finale, soit comme principe de mouvement et cause d’existence, soit enfin comme unité dans la pluralité, car elle a tous ces caractères, il est indispensable de se former une idée de son contraire, c’est-à-dire du principe matériel, qui, sous tous les rapports, est opposé à la forme.
Dans tous les êtres sensibles, il y a, sous les qualités, les modifications, un élément constitutif, une matière, qui n’a par elle-même ni forme, ni qualité, et qui, par conséquent, peut recevoir toutes les formes.La matière est l’élément préexista ni dans lequel la forme se réalise, c’est sur elle qu’a lieu la production ; c’est elle encore qui persiste après la destruction de la forme. En tant que matière indéterminée, elle est éternelle, et pas plus que la forme substantielle elle n’est sujette à production ou à destruction. La matière proprement dite n’est ni le feu, ni l’air, ni la terre, ni nucun des principes matériels admis par les Physiciens : le feu, l’air et la terre ne sont pas la matière pure, ils sont déjà réalisés, déterminés, ils ont une forme particulière ; la matière au contraire n’a aucune forme ; elle a pour caractère l’indétermination absolue, et tout ce qui n’a point ce caractère ne peut être appelé matière, que relativement. L'airain est la matière de la statue, le bois est la matière du lit ; ils sont indéterminés par rapport aux objets dans lesquels ils entrent comme éléments, mais ils ne sont pas absolument indéterminés, ils sont matériels et non matière : ils sont de cela, comme dit Aristote, et non point cela. La matière n’est point l’infini ou l’indéfini numérique des Pythagoriciens, elle n’est pas non plus la dyade de Platon, ou plutôt elle est tout cela et plus encore, elle est l’indéfini, l’indéterminé, sous tous ses faces, dans toutes ses acceptions. On rencontre même la matière dans la définition: elle en est la partie indéterminée, c’est-à-dire le genre, par opposition à la différence, qui spécifie et détermine l’être dont il s’agit dans la définition [46].
Sous un autre point de vue la matière est la puissance, par opposition à la forme, qui est l’acte, le résultat, le but ; et par puissance il ne faut pas entendre cause productrice, la véritable puissance alors serait la forme : la puissance, dans la matière, n’ost qu’une simple possibilité. Quand on dit que la matière est la puissance des contraires, ceia veut dire simplement qu’elle est susceptible de les recevoir, que, n’étant ni l’un ni l’autre, elle peut par là même devenir l’un et l’autre. Elle n’est donc pas une puissance dans la véritable acception du mot ; elle est essentiellement inerte. Si quelquefois nous disons que la matière a une force propre, une puissance passive ou active, c’est qu’alors il ne s’agit plus de la matière première, mais bien d’une matière réalisée, le feu ou l’airain par exemple. La puissance doit donc être attribuée non point à la matière, mais à la forme. Cependant Aristote donne quelquefois, à l’exemple de Platon, une force propre à la matière. Platon avait admis que la cause de tout mal, c’était la matière; que son imperfection, en la rendant incapable de reproduire parfaitement l’idée qui se réalisait en elle, était la cause de tous les désordres du monde ; qu’elle offusquait la vue de l’intelligence humaine, de même qu’elle voilait l’harmonie de l’univers. La matière avait donc une force propre, une force de résistance au bien, et la divinité n’avait pu qu’imparfaitement triompher de cette puissance.
La même idée se reproduit dans Aristote. Dans le monde il y a, selon lui, une fortune [47], il y a des productions du hasard tout aussi bien que des productions naturelles; et tout cela, fortune, hasard, est le fait de la matière : elle est le principe de tout ce qui est accidentel. Elle est la cause du mal ; et par là, la divinité se trouve déchargée de cette responsabilité que les sceptiques avaient voulu faire peser sur elle, en l’accusant de tous les désordres du monde. Le dieu d’Aristote est uniquement cause du bien; mais c’est aux dépens de la puissance infinie qu’Aristote lui donne cet attribut, aux dépens de la Providence même, laquelle ne peut pas être morcelée et s’exercer à demi : la matière reconnue comme puissance du mal est un dernier reste de ce dualisme qui apparaît plus ou moins clairement au fond de la plupart des systèmes de l’antiquité.
Enfin la matière, en tant qu’elle est opposée à la forme, est la cause de la pluralité des êtres, et, pour les objets sensibles, l’unité dans la pluralité n’est autre chose que la réalisation de la forme dans la matière. Chaque être est à la fois un et multiple, un par la forme, multiple par les éléments.
Nous avons vu que la matière proprement dite n’était pas véritablement une puissance, si ce n’est accidentellement, et comme cause du hasard ; elle peut devenir, mais elle n’a pas en elle-même la cause du devenir et de l’être : il en est de même de la matière réalisée : ce n’est pas en tant que matière qu’elle est une puissance, c’est en tant que possédant la forme, en tant que déterminée. La puissance, le pouvoir du changement dans un autre être en tant qu’autre, comme s’exprime Aristote, peut exister soit dans des êtres inertes, soit dans les êtres animés, dans l’âme, dans l'entendement [48]. De là des puissances irrationnelles, ainsi la force végétative dans les arbres ; et des puissances intellectuelles : les arts, les sciences sont des puissances de ce genre. Mais dans l’un et l’autre cas la véritable puissance est toujours la forme; c’est la notion qui est dans l’esprit, c’est la forme intellectuelle qui constitue l’art et la science ; c’est l’homme et non la semence qui produit l’homme : la matière ne peut à aucun titre être regardée comme puissance productrice. Les puissances irrationnelles ne peuvent produire les contraires ; elles ne produisent chacune qu’un effet : dés que l’être passif et l’être actif sont proche l’un de l’autre, alors, et seulement alors, il y a acte ; et l’acte est toujours le même. Il n’en est pas ainsi des puissances rationnelles, soit naturelles, soit acquises. La science étant une explication rationnelle s’applique et à l’objet et à la privation de l’objet ; elle embrasse les contraires. L’âme a en elle-même le principe du mouvement ; elle est une force active, et, quel que soit l’objet sur lequel elle porte son action, elle peut en faire sortir les contraires, à moins toutefois d’obstacles extérieurs, et pourvu que les effets contraires ne soient point simultanés. La puissance productrice est donc la forme déterminée, soit dans les objets inertes, soit dans l’intelligence. On dit quelquefois que le bois et les tuiles sont la maison en puissance; on dit que la semence est, dans telle circonstance donnée, l’homme en puissance ; mais puissance n’est alors que possibilité, et non point cause productrice ; la véritable puissance c’est l’homme d’un côté, et de l’autre la pensée de l’architecte. Essence de l’objet, la forme est donc encore sous un autre point de vue la cause productrice. Telle forme ne se produit point elle-même, mais la forme produit une forme analogue, l’homme engendre un homme, l’arbre produit un arbre.
La théorie de l’acte vient appuyer encore ces conclusions. L’acte est l’opposé de la puissance ; il se prend ou pour le mouvement par rapport à la force motrice, ou pour l’essence et la forme par opposition à la matière indéterminée [49] ; mais, de ces deux acceptions, la seule qui convienne réellement à l’acte, c’est l'essence et la forme. Le mouvement n’est pas un acte véritable; c’est un acte incomplet, ou plutôt ce n’est que le passage de la possibilité à l’acte [50]. À ce titre qu’elle est l’actualité véritable et complète, la forme est réellement une cause finale ; elle est le but du mouvement ; elle est le bien pour l’objet dont elle est l’essence; elle est antérieure à la puissance même, dans les objets matériels. Elle lui est antérieure et sous le rapport de la substance, et sous le rapport de la notion, et sous le rapport du temps. En effet, la forme de l’homme est antérieure à l’enfant : l’homme est antérieur à la semence, la matière n’est en acte que lorsqu’elle a la formé. L’antériorité sous le rapport de la notion n’est pas moins évidente : le constructeur, comme dit Aristote, est celui qui peut construire, qui a appris par conséquent; la connaissance a dû nécessairement précéder, et c’est en construisant qu’on apprend à construire. Enfin, sous le rapport du temps, le premier rang appartient encore à l’acte. Les membres, en puissance, semblent antérieurs à l’homme ; mais ce n’est-là qu’une apparence; l’homme vient de l’homme, le musicien du musicien, il y a toujours un premier moteur, et ce premier moteur existe déjà en acte [51]. Les trois principes de la forme, de la cause finale et du mouvement, viennent donc s’identifier en un seul et même principe, même pour les objets matériels. L’identification n’est pas complète, il est vrai ; l’homme produit l’homme, mais l’être produit a une forme à lui, et si la cause finale ne diffère point de l’essence, elle diffère de la cause productrice : il n’y a point identité entre ce qui est produit et ce qui a produit. Ce n’est que dans une sphère plus élevée, au point de vue de l’être absolu, que nous trouverons véritablement l’identité absolue. La cause productrice et la cause finale ne seront plus qu’un seul et même principe; Dieu sera tout à la fois la cause et le but de tout mouvement.
THÉOLOGIE. L’esprit conçoit un êlre éternel et infini, et cette conception suffit à elle seule, pour que nous ayons le droit d’affirmer son infinie et éternelle existence. Il est toutefois d’autres preuves, plus visibles, si l’on peut ainsi dire, et mieux à la portée de tous : ce ’sont celles qui se tirent de l’examen du monde sensible ; preuves absolues, elles aussi, car elles reposent sur un principe absolu, l’axiome de causalité. Les arguments par lesquels Aristote établit l’existence de Dieu sont surtout des arguments physiques, comme on les appelle dans la langue de la philosophie moderne. La grande et profonde théorie de l’être sensible dont nous avons essayé dé donner une idée, n’est pour Aristote qu un moyen et itbn un but; le but véritable c’est la connaissance de Dieu, car l’objet de la philosophie première, c’est Dieu même. Toute production vient ou de la nature, ou de l’art, ou du hasard. La science ne s’occupe pas des productions du hasard ; Aristote nous a dit plus haut par quels motifs. Quant aux autres productions, celles de l’art et celles de la nature, elles ne sont pas des productions dans le sens absolu qu’on semble attribuer à ce mot ; elles ne sont que la réalisation de la forme éternelle et incréée dans une matière éternelle, incréée. Ainsi, lorsqu’on dit qu’un homme est produit par un homme, qu’un arbre naît d’une semence, cela signifie qu’une forme préexistante se réalise dans une matière préexistante ; cette forme qui se réalise, elle était déjà dans un autre être, dans l’arbre qui a produit la semence, dans l’homme qui a engendré. L’individu, homme ou arbre, est cause de l’individu, mais non pas cause absolue. Son action est subordonnée à certaines conditions nécessaires, à des causes coopérantes, comme les nomme quelque part Aristote [52]. Il y en a d'immédiates, il y en a de plus éloignées ; elles se rattachent les unes aux autres, mais la série des causes ne se prolonge pas à l’infini. On remonte de cause en cause, de l’homme à ce qui le fait vivre, puis aux lois de son existence, puis aux mouvements généraux du monde, puis aux causes diverses de ces mouvements, enfin à la cause première et absolue, au moteur immobile.
La production, ou si l’on veut la création par la pensée, nous fait toucher, pour ainsi dire, la divinité. Elle est chez nous le résultat d’une puissance naturelle, que l’intelligence peut modifier, que le travail développe et agrandit, qui aurait pu sommeiller éternellement en nous, mais que nous ne nous sommes pas donnée. Elle fait partie de l’homme, et les causes de l’homme sont les causes de cette puissance. D’ailleurs, l’objet véritable du statuaire, du poète, du musicien, c’est, non pas la réalisation de la figure dans la pierre, de la pensée dans le poème, de la mélodie dans le chant lyrique, d’une façon quelconque; c’est le beau ; et le beau, c’est le bien, c’est-à-dire Dieu même.
Une difficulté reste toutefois relativement aux êtres sensibles. Comment peut s’opérer le passage du blanc au noir ? comment ce qui est du vin peut-il devenir du vinaigre ? aucune transformation ne semble possible, si ce qui devient n’était déjà dans l’être qui devient. La question n’est point embarrassante pour l’école de Mégare qui prétend que tout est en acte : car alors rien ne change dans la nature ; chaque chose est éternellement ce qu’elle doit être; il n’y a pas de production. Elle n’est pas plus embarrassante pour ceux qui admettent l’existence simultanée des contraires; le même objet est à la fois blanc et noir, vin et vinaigre ; il ne varie point dans son essence , par la production ; ce qui devient était déjà ; la seule chose qui varie, c’est la sensation, c’est-à-dire l’homme, et non point l'objet. Mais prétendre que les contraires ont une existence simultanée, ou, ce qui revient au même, que tout est en acte, en un mot, nier le mouvement, c’est se mettre en contradiction avec l’évidence, c’est écarter la difficulté par une fin de non-recevoir, et non pas la résoudre.
Aristote résout la question d’une manière bien plus rationelle en disant que les contraires existent, il est vrai, dans les êtres, mais qu’ils y sont en puissance et non en acte. Ainsi il y a dans le vin une matière première, qui, en puissance, est vin et vinaigre ; elle peut devenir successivement l’un et l’autre, elle n’est point l’un et l’autre à la fois. On peut admettre au même titre l’existence d’un milieu entre deux opposés, milieu par lequel s’opère le passage entre les deux extrêmes ; entre le blanc et le noir il y a le rouge, qui n’est pas l’un, et l’autre absolument parlant, mais qui tient de l’un et de l’autre et qu’il faut traverser pour aller du blanc au noir. De même aussi entre le vin et le vinaigre il y a un intermédiaire, participant de l’un et de l’autre, et à travers lequel s’opère le passage. Il n’y a pas transformation immédiate du vin en vinaigre ; il y a d’abord résolution de l’objet dans ses éléments premiers, c’est-à-dire dans une matière qui est le milieu entre les deux extrêmes. C’est dans ce sens qu’Aristote dit que pour aller d’un extrême à un autre il faut passer par un milieu, et que ce milieu n’existe qu’entre les extrêmes ; car le passage ne s’opère que d’un extrême à un autre [53]. Cependant il ne peut pas y avoir transformation de tout en tout. Pour que deux choses se changent l’une dans l’autre, il faut qu’elles aient une matière commune, ou en d’autres termes qu’elles ne différent point de genre.ll n’y a point de matière commune entre le périssable et l’impérissable [54] ; le passage de l’un à l’autre est impossible. Il n’y a changement que du contraire au contraire, et les contraires appartiennent nécessairement au même genre. Il y a donc entre chaque contraire une matière qui est l’un et l’autre en puissance, qui peut par conséquent devenir l’un ou l’autre, selon l’action des circonstances, l’impulsion de la cause motrice, mais qui n’est poinl et ne peut devenir l’un et l’autre à la fois.
Que si l’on demande maintenant pourquoi l’homme devient non-homme, pourquoi il est sujet à destruction, quant au corps du moins, il suffit de répondre qu’il y a en lui une matière, que par elle-même cette matière n’est ni l’homme ni le non-homme, mais qu’elle peut affecter diverses formes ; qu’elle est, en puissance, et l’homme et la privation. La seule cause du changement, non point la cause motrice, mais la puissance, ce qui rend le changement possible, c’est la matière : on peut conclure de là, avec Aristote, que toute substance immatérielle est par cela seul immuable, à l’abri de toute altération.
La démonstration de la nécessité d’un premier moteur tient peu de place dans la Métaphysique : c’était pour Aristote un point déjà traité, une question déjà résolue ailleurs [55]. Aristote ne fait que résumer l’argument en quelques mots. Tout mouvement suppose un moteur ; et comme il ne peut pas y avoir une série infinie de principes, il faut nécessairement s’arrêter à une cause première [56], qui communique le mouvement sans l’avoir reçu, et qui a en elle-même la raison de son existence. C’est, sous une forme synthétique, la démonstration de l’existence de Dieu par l’axiome de causalité ; démonstration qui est devenue vulgaire, comme tout ce qui est vrai ; qui n’était pas nouvelle même du temps d’Aristote, mais qu’il a mise à l’abri de toute contestation, en établissant qu’il ne peut y avoir une série infinie de causes.
L’éternité du moteur se prouve par l’éternité du mouvement dont il est le principe, et par l’éternité du temps. « Il est impossible que le mouvement ait commencé ou qu’il finisse ; il est éternel : de même le temps ; car si le temps n’existait pas, il ne pourrait y avoir ni antériorité ni postériorité. Le mouvement et le temps ont la même continuité ; car ou bien ils sont identiques l’un à l’autre, ou bien le temps est un mode du mouvement » [57]. Dans l’un ou l’autre cas il faut que le mouvement soit éternel comme le temps, et de là on conclut l’éternité du moteur. Cet argument a, au premier aspect, quelque chose de sophistique. Le temps n’est point si intimement lié au mouvement qu’il ne puisse s’en séparer ; il n’est ni le mouvement, ni un de ses modes ; car on peut concevoir un temps où il n’y avait pas encore de mouvement. Le mouvement ne constitue pas le temps ; il peut donc ne point participer à son éternité. Mais la preuve, pour être présentée sous un jour un peu faux, n’en subsiste pas moins. Platon n’admettait pas l’éternité du mouvement. Les astres, pour lui, avaient eu un commencement [58] ; éternels dans l’avenir, ils ne l’étaient point dans le passé ; et cependant Platon croyait aussi à l’éternité du moteur. Et en effet, que le mouvement ait commencé ou qu’il soit éternel peu importe ; il n’en faut pas moins remonter à une cause première, éternelle, qui ne dépend d’aucune autre cause. L’éternité de Dieu peut d’ailleurs, dans le système d’Aristote se déduire directement de la définition de son essence. Si sa forme substantielle est l’acte pur, il ne peut point avoir eu de commencement ; car il aurait été en puissance avant d’être en acte; il ne serait point un premier principe, la cause première étant nécessairement en acte.
L’immobilité du moteur est plutôt admise comme un fait, que démontrée directement dans la Métaphysique [59]. Elle est, du reste, facile à établir. Pour que le mouvement soit possible, il faut qu’il y ait une cause, un moteur. Si ce moteur est lui-même en mouvement, Ce n’est pas eu tant que moteur ; car si l’on suppose un être qui se meut lui-même, on pourra toujours considérer en lui deux choses bien distinctes, le mouvement et sa cause, et, en tant que cause , il sera immobile. Mais il n’est pas même possible de scinder ainsi le premier moteur, de l’admettre d’une part comme immobile, de l’autre comme possédant un mouvement propre, quelle que soit la simplicité de ce mouvement. L’essence de Dieu est l’actualité pure, et, en tant qu’acte, il ne peut être en mouvement. Le mouvement n’est qu’un acte imparfait ; il suppose d’un côté une puissance, de l’autre un but, et rien en Dieu n’est à l’état de puissance ; la puissance et le but se confondent en lui dans une actualité absolue. Il n’est susceptible d’aucun changement, de quelque nature que ce soit, et, sous ce rapport, il est vrai de dire qu’il est nécessaire, mais nécessaire à titre de cause finale et de bien.
On peut établir a priori l’unité de Dieu, en s’appuyant sur les données de la raison, qui ne peut concevoir deux infinis. Elle peut aussi se déduire de l’observation, de l'examen de l’univers et des phénomènes dont il est le théâtre. Aristote néglige la première de ces deux méthodes, qui est certainement la plus sûre, qui seule peut donner une parfaite évidence. La preuve a priori se trouve bien implicitement comprise dans la plupart de ses opinions sur la divinité ; mais elle n’est nulle part formellement exprimée. Il conclut l’unité de Dieu, de l'uniformité du mouvement du ciel, et de l’harmonie du monde. Les astres ont chacun uu mouvement propre, en tant qu’ils sont eux-mêmes des essences éternelles ; mais, indépendamment de ces mouvements particuliers, un mouvement unique emporte tout le ciel, et ce mouvement ne peut être que le résultat de l’action d’un principe unique. L’harmonie du monde estinexplicable si l’on n’admetpas un seul moteur. Cette preuve est bonne assurément, elle se présente d’elle-même à l’observateur le plus inattentif ; mais elle n’est pas la meilleure, elle n’est même point parfaitement rigoureuse, et Aristote ne l’ignorait pas, car il en tire seulement une probabilité, et se contente d’ajouter que ce système est, sans contredit, préférable à celui de tous ses devanciers.
L’essence de Dieu est l’acte même, l’acte pur ; rien en lui n’est à l’état de puissance ; car il n’existerait pas réellement ; il ne serait pas le premier moteur, si son essence était la puissance. Mais en quoi consiste son actualité ? est-il un être sensible, est-il le monde dans son ensemble, est-il intelligence et matière ? Évidemment non ; car alors il ne serait plus l’actualité pure, la matière étant puissance des contraires ; l’acte pur ne peut se rencontrer que dans l'intelligence, dans la pensée absolue ; il est l'identité parfaite de l’intelligence et de l’intelligible. Il n’est point une intelligence oisive et inerte ; « la vie est en lui, car l’action de l’intelligence est une vie, et Dieu est l’actualité même de l’intelligence ; cette actualité prise en soi, telle est sa vie parfaite. » Pour l'homme la pensée diffère de son objet, il n'y a pas identité entre la puissance et le but ; aussi la pensée humaine n'est-elle pas l'actualité absolue. Pour l'intelligence divine il ne peut en être ainsi. Car si sa pensée dépendait d'un autre principe, son essence ne serait pas la pensée, mais une simple puissance; elle ne serait plus alors l'essence la meilleure ; la pensée deviendrait pour elle une fatigue. Penser, voilà l'état habituel de la divinité, et en pensant elle ne pense pas autre chose qu'elle-même ; elle pense une chose indivisible, car c'est elle-même, la pensée absolue, le bien, qu'elle pense de toute éternité. « L'intelligence se pense elle-même, en tant que saisissant l'intelligible; car elle devient intelligible elle-même à ce contact, à ce penser : il y a donc identité entre l'intelligence et l'intelligible… La possession de l'intelligible est l'actualité de l'intelligence. » Dieu est donc l'actualité pure et absolue ; en dehors de la pensée qui est son essence, il n'y a rien pour lui ; il ne pense que lui-même, il est la pensée de la pensée.
Dieu, en tant qu'intelligible, est encore le bien ; et c'est à ce titre qu'il est la cause du mouvement de tous les êtres. En tant que pensée toujours en acte, il jouit d'une félicité éternelle et parfaite. La jouissance, pour l'homme, c'est l'action, mais son action commence et finit, elle est imparfaite, son bonheur ne saurait donc être complet. Le bonheur véritable n'appartient qu'à l'être dont l'existence est en même temps l'actualité absolue ; Dieu seul est parfaitement heureux, seul il jouit de l'absolue félicité.
Au premier rang parmi les substances sensibles se rencontrent les astres, substances éternelles et incréées, véritables dieux intermédiaires, placés entre l’être et les êtres, entre Dieu et le monde. Si l’on considère les astres en eux-mêmes, ils sont des principes, des causes finales ; car ils ont un mouvement propre, au milieu du mouvement uniforme du ciel, et chacun de ces mouvements doit nécessairement être rapporlé à un moteur propre ; mais, d’un autre côté, les astres sont emportés dans le mouvement général du ciel ; ils ont un objet d’aspiration, un but, le moteur immobile, le bien absolu. Ainsi s’expliquent et l’unité et la diversité de l’univers. Aristote admet comme Platon que Dieu n’agit pas directement sur le monde ; il meut les astres comme objet de l’amour, et ce qu’il meut imprime le mouvement à tout le reste ; mais Dieu n’en est pas moins le principe de tout mouvement. La seule différence que l’on puisse signaler entre ces deux philosophes, c’est que, pour Aristote, les astres sont éternels et impérissables de leur nature, tandis que Platon les fait naître de la volonté de Dieu, et fait dépendre leur immortalité de cette volonté même. Pour l’un comme pour l’autre les astres sont des dieux secondaires, ils jouent un double rôle : mis en mouvement par l’être immobile et absolu, moteurs eux-mêmes relativement aux autres êtres.
Quant au mode d’action soit du moteur premier, soit des astres, il ne diffère point. Dieu est principe du mouvement en tant qu’intelligible et désirable ; il est le bien, et c’est en aspirant vers lui que les astres se meuvent. Le bien étant unique et absolu, ils ont tons un même but, une même cause finale, et de là l'unité du monde. Mais d'un autre côté, ils sont eux-mêmes des causes finales dans une sphère inférieure; ils sont le but d'autres mouvements, le bien d'autres êtres, et à leur diversité tient la diversité des mouvements de la nature. Il y a dans l'univers une chaîne continue de mouvements, qui tous s'engendrent les uns les autres, qui tous peuvent se ramener en dernière analyse au moteur unique comme à leur principe suprême.
Ce n'est point par delà les bornes de l'univers, que se pense éternellement la pensée divine ; le dieu d'Aristote, pour nous servir d'une expression célèbre, n'est point un roi solitaire, abîmé dans le néant de l'absolue existence. Il est le Dieu du monde ; le monde tout entier est suspendu au moteur immobile. Le mouvement des êtres est une perpétuelle aspiration vers Dieu, source éternelle de l'amour, seul intelligible et seul désirable. La nature tend de toutes ses puissances au bien suprême ; elle tressaille éternellement, si l'on ose ainsi dire, à la présence de l'être aimé. L'harmonie du monde part de Dieu, et c'est à Dieu qu'elle vient aboutir. Dieu est le principe et la fin de toutes choses. Le monde n'est point un empire mal réglé ; ce n'est pas une sorte de poème tout en épisodes, dit Aristote, ce n'est pas une mauvaise tragédie, dit-il encore, et par là il entend une tragédie sans unité. Il en est du bien dans le monde, suivant Aristote ; comme du bien dans une armée : c'est à la fois et l'ordre qui règne dans l'armée et le général qui la commande. Ainsi le bien est partout dans l'univers ; il en est l'unité, le plan régulier, l'éternelle harmonie. Dieu est lui-même, il eu la pensée qui se pense dans toute l'éternité au sein de la félicité suprême ; mais il est encore le bien qui se réalise sans cesse et sans fin dans l'univers: l'ordre universel, c'est Dieu.
Cette grande conception d'un Dieu qui est la puissance motrice, qui est le bien du monde et sa fin, d'un Dieu qui a conscience de lui-même, puisque ce qu'il pense, c'est lui-même, et qu'il est la pensée de la pensée ; cette organisation de toutes choses et cette progression continue des existences; depuis la matière, c'est-à-dire, la simple possibilité, l'indétermination absolue, et presque le non-être, jusqu'à l'absolue réalité, jusqu'à l'être qui est ; cette conception satisfait-elle complètement à l'idée que nous nous faisons de Dieu et de ses rapports avec le monde ?
Le dieu d'Aristote n'a point la toute-science, puis-qu'il ne connaît que lui-même, et que, connaître autre chose, pour lui, selon Anatole, ce serait déchoir ; il n'a point la toute-puissance, car la matière est de tout temps, et les astres sont éternels comme la matière, et même tout est éternel dans le monde et persiste au milieu d'éternelles vicissitudes, et Dieu, selon Aristote, ne peut rien changer ce qui est ; encore moins-est-il créateur : l'idée de la création proprement dite n'appartient même pas à la philosophie antique. On a dit que ce Dieu était une Providence ; on a nié aussi qu'il fut marqué de ce sacré caractère. Il ne s'agit ici que d'entendre sur les termes. La Providence, suivant l'acception généralement reçue, et dans le sens propre du mot, l'intelligence des besoins des êtres inférieurs, et l'attention perpétuelle aux soins que réclame leur conservation, une telle Providence suppose un Bien créateur, tout-puissant, sachant toutes choses : omniscient pour qu'il puisse prévoir, tout-puissant pour qu'il agisse à son gré, créateur pour que rien ne limite sa puissance. Or, tout ce que dit Aristote sur la nature de l'être suprême est en contradiction manifeste avec cette idée. Le Dieu vraiment providentiel est un Dieu qui travaille, c'est un actif ouvrier sans cesse occupé à la réparation, à la perfection de son œuvre ; tandis que le dieu d'Aristote, s'il a les yeux sans cesse ouverts, et jamais il ne s'endort : où serait sans cela, dit Aristote, son excellence et sa dignité ? c'est sur lui-même, et sur lui uniquement, que porte son éternelle contemplation ; la science de Dieu n'est plus qu'une conscience : à ce point de vue, en tant qu'être qui sait, Dieu, pour Aristote, n'est, et ne peut être que la pensée de la pensée.
Tels sont les éléments fondamentaux de la doctrine développée dans la Métaphysique ; tel est du moins le sens général que nous avons cru saisir dans ce grand ouvrage. Mais cette doctrine, est-on en droit de l'attribuer à Aristote ? Notre esquisse suppose ce qu'on a mis en question, à savoir, l'authenticité de la Métaphysique. Il convient donc d'apprécier les doutes qu'a fait naître l'examen, et de donner une idée d'une controverse à laquelle ont pris part des critiques célèbres, depuis Samuel Petit et Ménage, jusqu'à Brandis et à M. Cousin.
Il y a un passage de Strabon, et deux autres passages, l'un de Plutarque, l'autre de Suidas, dont on a tiré, relativement à l'histoire des œuvres d'Aristote, des conséquences qu'il nous est impossible d'admettre. Malgré le respect profond dont nous faisons profession pour l'antiquité, nous en sommes encore à comprendre comment ces trois récits ont toute l'importance qu'on leur attribue. Ils nous paraissent, dans quelques parties, d'une invraisemblance parfaite, et, disons le mot, d'une véritable puérilité. Pour qu'on ne nous accuse pas de fausser à dessein le sens des termes, nous emprunterons à la savante préface mise par M. Barthélemy Saint-Hilaire en tête de la Politique, la traduction des deux premiers passages, et celle du passage de Suidas au livre de M. Michelet de Berlin.
Strabon, liv. XIII, page 608 : « C'est encore de Scepsis qu'étaient les deux philosophes socratiques Éraste et Coriscus, et le fils de ce dernier, Nélée, qui fut à la fois disciple d'Aristote et de Théophraste. Nélée hérita de la bibliothèque de Théophraste, où se trouvait aussi celle d'Aristote. Aristote l'avait léguée à Théophraste, comme il lui confia la direction de son école ; Aristote, à notre connaissance, est le premier qui ait rassemblé des livres, et il apprit ainsi aux rois d'Égypte à se composer une bibliothèque. Théophraste transmit sa bibliothèque à Nélée, qui la fit porter à Scepsis et la laissa à ses successeurs, gens sans instruction, qui gardèrent les livres renfermés sous clef et n'y donnèrent aucun soin. Plus tard, quand on apprit avec quel empressement les rois « descendants d'Attale et maîtres de Scepsis, faisaient rechercher les livres pour former la bibliothèque de Pergame, les héritiers de Nélée enfouirent les leurs dans un souterrain. L'humidité et les vers les y avaient gâtés, lorsque, longtemps après, la famille de Nélée vendit à un prix fort élevé tous les livres d'Aristote et de Théophraste à Apellicon de Téos ; mais Apellicon, plus bibliomane que philosophe, fit faire des copies nouvelles pour réparer tous les dommages que ces livres avaient souffert. Les restaurations qu'il fit ne furent pas heureuses (τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὖ), et ses éditions furent remplies de fautes. Ainsi les anciens Péripatéticiens, successeurs de Théophraste, n'ayant absolument que quelques-uns de ces ouvrages, et principalement les exotériques, ne purent travailler sérieusement, et se bornèrent à des déclamations philosophiques. Les péripatéticiens postérieurs à la publication de ces ouvrages furent à même d'étudier mieux la philosophie et les idées d'Aristote; mais la multitude des fautes dont les livres étaient remplis les força souvent à s'en tenir à des conjectures. Rome contribua beaucoup encore à multiplier ces erreurs. Aussitôt après la mort d'Apellicon, Sylla, vainqueur d'Athènes, s'empara de sa bibliothèque et la fit transporter à Rome, où le grammairien Tyrannion, admirateur d'Aristote, put, en gagnant le bibliothécaire, en faire usage, ainsi que quelques libraires qui employèrent de mauvais copistes et ne collationnèrent pas les textes, défaut ordinaire de tant d'autres livres qu'on fait transcrire soit à Rome, soit à Alexandrie, pour les vendre. »
Plutarque, vie de Sylla, chap. XXVI : « Sylla, parti d'Éphèse, aborda trois jours après au Pirée, et d'après des renseignements qu'on lui donna, il fit enlever pour son propre usage la bibliothèque d'Apellicon de Téos, où se trouvaient la plupart des livres d'Aristote de Théophraste, qui généralement n'étaient pas encore bien connus. Cette bibliothèque fut transportée à Rome, et là, dit-on, le grammairien Tyraunion mit en ordre presque tous ces livres, et en laissa prendre des copies à Andronicus de Rhodes, qui les publia et composa les tables dont on se sert aujourd hui. Les anciens Péripatéticiens ont été certainement fort éclairés et fort érudits ; mais ils ne semblent avoir étudié les ouvrages d'Aristote et de Théophraste qu'en petit nombre et avec peu d'exactitude, parce que l'héritage de Nélée de Scepsis, à qui Théophraste avait légué ces livres, était tombé dans les mains de gens peu instruits, incapables de l'apprécier. »
Suidas dans son Lexique, au mot Σύλλας : « Le consul Sylla ayant levé l'ancre à Éphèse, et ayant abordé à Athènes, s'y arrêta pendant quelque temps ; il s'empara de la bibliothèque d'Apellicon de Téos qui s'y trouvait, et l'emporta. Elle renfermait la plupart de ceux des livres d'Aristote et de Théophraste qui, comme le dit Plutarque, n'étaient pas encore bien connus par la foule, mais parvinrent depuis à la connaissance des hommes. »
1° Nous n'avons pas besoin de remarquer que ce sont là, non pas trois témoignages, mais un seul, puisque Suidas abrège Plutarque, qui, sauf la mention du travail d'Andronicus qu'il ajoute de son chef, se contente de reproduire le récit de Strabon.
2° Strabon prête aux descendants de Nélée une conduite pour le moins fort bizarre. Ces gens grossiers, qui ne faisaient rien d'une bibliothèque précieuse, la cachent dans un souterrain, alors qu'ils pouvaient la vendre chèrement aux rois de Pergame, ou s'acquérir leur faveur par un présent qui ne leur eût rien coûté! Il semble que les fils d'Attale étaient à même de se montrer aussi généreux que le bibliophile Apellicon.
3° Supposer que tout l'œuvre d'Aristote, ou presque tout, se trouvait uniquement dans la bibliothèque de Nélée, c'est-à-dire que rien n'en avait été publié, ni du vivant d'Aristote, ni par ses disciples immédiats, n'est-ce pas supposer une chose absurde en elle-même et contraire aux plus simples notions du bon sens ? Aristote a enseigné toute sa vie, et ses ouvrages sont la plupart des résumés de cours (ἀκροάσεις), la Métaphysique elle-même ; c'est-à-dire des ouvrages destinés aux disciples ; c'est-à-dire des livres qui devaient paraître, dans ce public domestique au moins, à mesure qu'ils étaient composés, des livres que tous devaient avoir sans cesse sous les yeux.
4° La décadence de l'école d'Aristote après Théophraste s'explique suffisamment par le malheur des temps d'anarchie qui ont suivi la mort d'Alexandre, et par l'esprit de l'Alexandrie des Ptolémées, qui n'était point encore l'Alexandrie des premiers siècles chrétiens, et qui s'occupait beaucoup plus des poètes que de la philosophie ; sans qu'on ait besoin d'enlerrer, pour ainsi dire, l'école péripatéticienne avec les livres du maître, dans le caveau de Scepsis.
5° Cette raison tout extérieure ne suffirait pas, même en supposant qu'Aristote et Théophraste n'eussent jamais rien publié. Si Troie avait pu être sauvée, si l'école péripatéticienne, si une école avant tout spéculative avait pu fleurir, à cette époque où le repos de la Grèce était sans cesse en question, et où toute dignité avait disparu avec la liberté, où l'homme cherchait dans la philosophie un refuge contre le monde extérieur plutôt que la satisfaction de ce noble désir de connaissance dont parle si souvent Aristote, les germes semés pendant tant d'années d'enseignement et par Aristote et par son disciple, n'auraient point été stériles, et il y aurait eu une grande école péripatéticienne.
6° La conclusion de Strabon dépasse infiniment ses prémisses. Il ne dit même pas que ce fussent les autographes d'Aristotequi étaient tombés entre les mains de Nélée. Il semble plutôt dire le contraire, comme le fait remarquer M. Barthélémy. Apellicon fit faire des copies nouvelles. Le mot nouvelles n'indique-t-il pas des copies faites sur d'autres copies ? En tout état de cause l'expression copies nouvelles, (ἀντίγραφα καινά, va directement contre les conclusions de Strabon, et prouve une publication antérieure des écrits d'Aristote ; et, quelque restreinte qu'ait été cette publication, quelque peu répandues qu'aient pu être les anciennes copies, il est contraire à toute raison de supposer qu'il n'en soit rien resté. Strabon ne le prétend même pas ; mais il devait aller, pour être conséquent avec lui-même, jusqu'à nier que les Péripatéticiens eussent entre les mains aucun écrit d'Aristote ou de Théophraste.
7° Athénée, ou, suivant quelques critiques, son abréviateur, contredit formellement, au début du Banquet des Sophistes, l’opinion de Strabon: « Nélée hérita des livres d’Aristote [et deThéophraste] ; Ptolémée Philadelphe les lui acheta tous, et les transporta, avec ceux qui venaient d’Athènes et de Rhodes, dans Alexandrie. » Deipnosoph. I ,2. Nous ne prétendons pas qu’Athénée nie qu’Apellicon n’ait eu en sa possession les livres d’Aristote et de Théophraste, et que Sylla ne les ait fait transporter à Rome : il dit même dans un autre passage, V, 53, qu’Apellicon de Téos avait recueilli avidement les ouvrages de l’école péripatéticienne, et particulièrement ceux d’Aristote ; mais il appuie, par son témoignage, notre opinion sur la publication fort ancienne des livres d’Aristote.
8° Il est certain, d’après l’aveu d’un grand nombre de commentateurs, que les ouvrages d’Aristote se trouvaient, de temps immémorial, dans la bibliothèque d'Alexandrie ; il résulte des travaux des critiques modernes, Schneider, Brandis, Stahr et quelques autres, qu’avant l’époque d’Apellicon de Téos, on avait certainement connu commenté, réfuté, un grand nombre d’écrits d’Aristote. On connaît d’ailleurs la fameuse lettre d’Alexandre à Aristote, où il reproche à son maître d’avoir publié ses livres acroamatiques, c’est-à-dire ces résumés de cours dont nous avons parlé tout à l’heure, et la réponse d’Aristote : authentiques ou non, ces lettres prouvent que dans l’opinion de Simplicius, in Phys. proœm., d’Aulu-Gelle, Noct. att. XX. 5, de Plutarque lui-même, vie d'Alexandre chap. VII, les ouvrages d’Aristote avaient été publiés, même ceux qui n’étaient destinés qu’à un public d’élite, même les livres acroamatiques, ou ésotëriques, parmi lesquels la Métaphysique tient, de l’aveu de tous, le premier rang.
Tout ce qu’on peut conclure du récit de Strabon, et de la circonstance que Plutarque y a ajoutée, c’est qu’avant le temps d’Apellicon et la publication faite par Tyrannion et Andronicus, les ouvrages d’Aristote étaient peu répandus, et que depuis ils le furent davantage. Cela est conforme au témoignage des contemporains, et Cicéron atteste, au début des Topiques, que, de son temps, les écrits d’Aristote sont peu familiers aux philosophes eux-mêmes. Peut-être parmi ces ouvrages dont les deux critiques répandirent des copies, y en avait-il quelques-uns d’inédits ; il ne paraît pas toutefois qu’aucun des grands ouvrages ait été dans ce cas. Les commentateurs qui ont si longuement écrit sur la Métaphysique, sur la Physique, sur les Analytiques, etc., auraient certainement noté des faits aussi dignes de remarque. Or, on ne trouve rien de pareil dans les livres d’Alexandre d’Aphrodisée, d’Ammonius, de Simplicius, de Philopon.
Le travail critique de Tyrannion ne paraît pas avoir été d’une grande importance, puisqu’il n’excita pas même l’attention de Cicéron, son contemporain et son ami. Celui d’Andronicus consista, suivant toute probabilité, dans ces tables dont parle Plutarque (πίνακας), dans une classification plus rigoureuse des écrits d’Aristote, dans quelques dissertations sur l’authenticité de quelques-uns de ces écrits. Il réunit les traités qui se rapportaient aux mêmes matières, il en fit des πραγματεῖαι, des corps de doctrines, d’un côté le système de Logique, de l’autre le système de Physique, etc.
Il est généralement admis que le nom de Métaphysique, Μετὰ τὰ φυσικά, n’est pas celui qu’Aristote avait donné à son ouvrage. On fonde cette probabilité sur ce qu’Aristote ne nomme nulle part Μετὰ τὰ φυσικά la science dont il traite : et en effet, les noms sous lesquels il la désigne n’ont rien de commun avec cette expression ; c’est d’abord le mot Sagesse, puis Philosophie première, puis Science de la vérité, puis Science de l’être en tant qu’être, enfin Théologie. Μετὰ τὰ φυσικά signifie après la Physique ; non pas dans l’ordre de la science, car ce qui vient immédiatement après la Physique, selon Aristote, ce sont les Mathématiques ; mais par la place où le traité de l’Être a été rangé d’abord dans la collection des ouvrages d’Aristote. Après tous les ouvrages sur la nature, après la Physique, après l’histoire des animaux, après les autres traités analogues, c’est encore la place que la Métaphysique occupe aujourd’hui. Alexandre d’Aphrodisée, le plus ancien, le plus savant et le plus sûr des commentateurs de la Métaphysique, dit même formellement que telle est l’origine du mot Métaphysique : Μετὰ τὰ φυσικὰ... τῷ τῇ τάξει μετ' ἐκείνην εἶναι πρὸσ ἡμᾶς [60]. Quant au mot Μεταφυσικά, que l’on trouve chez quelques écrivains des bas siècles, au lieu de Μετὰ τὰ φυσικά, ce n’est qu’une corruption, une crase, comme on en voit un grand nombre dans toutes les langues, et qu’amène naturellement l’usage.
Andronicus passe, dans l’opinion commune, pour l’inventeur du nom que porte aujourd’hui enqpre le livre d’Aristote. La Métaphysique aurait été une de πραγματεῖαι, la collection des écrits d’Aristote sur la philosophie première, et c’est lui qui, ne sachant que faire de cette collection, l’aurait rangée après la Physique. Mais on peut élever contre cette opinion sur l’invention du nom de la Métaphysique par Andronicus, des objections de plus d’une sorte, et qui nous semblent péremptoires.
1° La dénomination Μετὰ τὰ φυσικά, comme le remarque M. Ravaisson, présente un caractère d’antique simplicité qui n’était pas dans les habitudes des commentateurs grecs du temps d’Auguste.
2° On trouve dans une note grecque imprimée à la suite du fragment de la Métaphysique de Théophraste, le titre d’un ouvrage composé par Nicolas de Damas, contemporain d’Hérode et d’Auguste, ainsi conçu : Θεωρία τῶν Ἀριστοτέλους Μετὰ τὰ φυσικά. Si le mot eût été aussi récent qu’on le suppose, Nicolas de Damas n’aurait-il pas choisi de préférence l’ancienne dénomination, et, au lieu d’intituler son livre : Commentaire sur la Métaphysique, ne l’aurait-il pas appelé, pour se faire comprendre : Commentaire sur la Théologie, sur la philosophie première, ou quel qu’eut été le nom primitif de la Métaphysique ?
3° II n’est nulle part fait mention chez les anciens de l’invention du titre de la Métaphysique par Andronicus. Or, il semble que ce fait eût été le premier sujoi de remarque dcscommentaîeurs d’Aristote.
4° Ammonius attribue formellement à Aristote le titre de l’ouvrage : ἅπερ οὕτω τὰ Μετὰ τὰ φυσικὰ προσηγόρευσεν [61].
5° On a contesté la valeur du témoignage d’Ammonius, mais sans pouvoir lui opposer autre chose que des fins de non-recevoir assez arbitraires. On peut l’appuyer aujourd’hui d’une imposante autorité. Alexandre d’Aphrodisée dit absolument la même chose qu'Ammonius : Ἡ μὲν ἐπιζητουμένη νῦν αὐτή ἐστιν ἡ σοφία τε καὶ θεολογικὴ, ἣν καὶ Μετὰ τὰ φυσικὰ ἐπιγράφει [62]…
Il est probable que si l’opinion d’Alexandre eût été connue des critiques, ils se fussent épargné les longues discussions auxquelles ils se sont livrés sur le point en litige. Rien ne saurait prévaloir, quand il s’agit de l'histoire de la Métaphysique, contre le sentiment d’Alexandre d’Aphrodisée. Mais Alexandre n a été connu, jusqu’en 1836, que par la traduction latine de Sepulveda, où ce passage est un peu altéré. Sepulveda exprime seulement le fait : ce livre s’appelle Métaphysique, Metaphysica inscribitur [63], tandis que pour être exact il fallait Metaphysica inscribit. La seule objection qu’on puisse faire, c’est, nous le répétons, qu’Aristote ne nomme pas Métaphysique, la science dont il traite. Cette objection, spécieuse avec le mot français Métaphysique, ou même avec le mot latin Metaphysica, tombe d’elle-même si l’on songe à la signification tout extérieure de Μετὰ τὰ φυσικά.
Ainsi acquiert un nouveau degré de probabilité l’opinion émise à ce sujet par M. Ravaisson : et une grande probabilité c’est, en ces matières, à peu près toute la certitude possible. La Métaphysique, selon ce critique distingué, a reçu son nom d Aristote, ou, tout au moins, c’est parmi ses disciples immédiats qu’il faut aller chercher l’auteur du titre sous lequel l’ouvrage est connu depuis tant de siècles [64].
Voyons maintenant si la Métaphysique est, comme ou l’a tant répété, une collection d’écrits sur la philosophie première, une compilation aristotélique.
Diogène de Laërte qui vécut, à ce qu’il paraît, dans la seconde moitié du troisième siècle de notre ère, donne un catalogue des écrits d’Aristote [65]. Dans ce catalogue la Métaphysique n’est point mentionnée. La conclusion légitime, c’était que ce compilateur l’avait omise par ignorance. On a mieux aimé conclure que la Métaphysique n’existait pas, sinon de son temps, au moins du temps des auteurs d'après lesquels il écrivait ; et, comme dans son catalogue d’autres écrits sont cités, qui n’existent plus parmi les œuvres d’Aristote, on s’est demandé si l’un de ces livres perdus, ou plusieurs de ces livres, n’étaient pas notre Métaphysique.
La Métaphysique, suivant Titze [66], correspond aux Ἄτακτα δεκαδύο mentionnés par Diogène ; suivant Trendelenburg [67] aux Ἐξηγημένα κατὰ γένος τέτταρα καὶ δέκα. Mais, comme le fait observer M. Ravaisson [68], outre que ces titres ne s’appliquent guère à la Métaphysique, ni le nombre XII des livres ἄτακτα ne convient à l’ouvrage d’Aristote, ni le nombre XIV des ἐξηγημένα. La Métaphysique, pour les Grecs, avait XIII livres ; notre livre deuxième n’était pour eux qu’une sorte d’appendice du livre premier : ils l’appellent A τὸ ἔλαττον, et non B ; B est notre troisième livre.
Samuel Petit, dans ses Miscellanées [69], regarde le περὶ φιλοσοφίας cité par Diogéne, comme correspondant aux trois derniers livres de la Métaphysique. Ménage adopta l’opinion de Petit[ 70]. M. Michelet de Berlin la reproduisit dans son mémoire, avec de nouveaux développements [71]. Suivant Petit, Ménage et M. Michelet, les trois livres du περὶ φιλοσοφίας sont les XIIIe, XIVe et XIIIe, dans cet ordre. Mais Buhle [72] retrouve le περὶ φιλ.. dans les livres IV, VI et VII ; XIII et XIV ; et XII ; Titze dans les livres I, XI et XII. Cette diversité d’opinion entre des hommes tels que ceux que nous venons de nommer, suffirait à elle seule pour nous faire conclure qu’il n’y a rien de commun entre le περὶ φιλοσ. et la Métaphysique, au moins pour la forme ; car il est probable que le fond des idées devait avoir un grand rapport avec la doctrine exposée dans la Métaphysique. Mais nous pouvons alléguer d’autres preuves.
Le περὶ φιλοσοφίας est mentionné deux fois par Aristote : dans le traité de l’Ame [73] à propos de la composition de l’animal en soi d’après les Pythagoriciens, et dans la Physique [74] pour la distinction des deux sortes de causes finales. Or, dans toute la Métaphysique il n’est fait aucune mention de l’αὐροζῶον des Pythagoriciens ; et, si l’on trouve dans plusieurs passages quelque chose qui ressemble à une distinction entre les causes finales, cette distinction est si vague, si peu explicite, qu’on ne comprend pas comment Aristote y eût renvoyé le lecteur.
Cicéron, par la bouche d’un des interlocuteurs de ses dialogues sur la Nature des dieux [75] attribue à Aristote, dans le troisième livre du De Philosophia, une opinion sur la divinité qu’on a regardée comme identique à celle qu’Aristote développe dans le XIIe livre de la Métaphysique. Nous ne nions pas qu’une partie de ce que l’épicurien Velleius, c’est le nom du personnage de Cicéron, regarde comme l’opinion d’Aristote, n’ait une grande analogie avec ce qu’on trouve dans le XIIe livre ; mais malgré toute notre bonne volonté, nous ne saurions voir dans ce livre aucune trace de doctrines comme celles-ci : « … mundum ipsum Deum dicit esse,… cœli ardorem Deum esse dicit… »
Diogéne de Laërte dit, dans sa préface, qu’Aristote, au premier livre du περὶ φιλοσοφίας, attribuait aux Mages une antiquité plus grande que celle des Égyptiens, et faisait mention des deux principes des Mages, Jupiter ou Oromaze, Pluton ou Arimane. Or, tout ce qu’on trouve sur les Mages, dans la Métaphysique, c’est qu’ils prenaient pour principe l’être premier et excellent [76].
Alexandre d’Aphrodisée, vers la fin de son commentaire sur le premier livre, renvoie, pour l’explication de la théorie platonicienne des êtres mathématiques, au traité περὶ φιλοσοφίας, comme à un ouvrage différent de celui qu’il commentait : or, Alexandre a écrit sur tous les livres de la Métaphysique. Enfin les commentateurs postérieurs à Alexandre, et Alexandre lui-même citent, à propos du XIIIe livre de la Métaphysique [77], le περὶ φιλοσοφίας, preuve certaine que cet écrit n’était point identique aux trois derniers livres , ni même à aucun autre dans la Métaphysique.
De ces arguments, et de quelques autres, et surtout d’un passage du livre de la philosophie cité textuellement dans le commentaire de Simplicius sur le De Cœlo, et qui contient une démonstration de la nécessité d’un premier principe, fort différente de ce qu’on trouve au XIIe livre de la Métaphysique, et qui semble empruntée au deuxième livre de la République de Platon, suivant la remarque de Simplicius lui-même ; de toutes ces preuves, disons-nous, M. Ravaisson a donc pu conclure, et avec raison, ce semble, que si le περὶ φιλοσοφίας se retrouve dans la Métaphysique, c’est sous une autre forme, et avec une remarquable modification, et qu’on eût, de l’un à l’autre ouvrage, suivi la marche et mesuré le progrés de l’Aristotélisme [78].
Diogène de Laërte fait mention d’un traité περὶ τἀγαθοῦ en trois livres, qui semble identique au περί φιλοσοφίας. Muret [79], Brandis [80], M. Michelet de Berlin [81], ont adopté cette opinion, et lui ont donné une grande probabilité. Simplicius, à propos du passage du De Anima [82], où Aristote renvoie au περὶ φιλ. fait cette remarque : περὶ φιλοσοφίας μὲν νῦν λέγει τὰ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ… C’est bien là une identification véritable, et rien ne s’oppose à ce que le même livre ait porté à la fois les deux noms ainsi : περὶ φιλοσοφίας ἢ περὶ τἀγαθοῦ. Le περὶ τἀγαθοῦ n'est donc pas identique aux trois derniers livres. Outre les arguments que nous avons allégués à propos du περὶ φιλοσοφίας, en voici un autre qui nous paraît péremptoire. Aristote, au livre IV de la Métaphysique, dit, selon les anciens éditeurs τεθεώρηται, et selon Brandis p. 62, et Bekker p. 1004, τεθεωρήσθω δ' ἡμῖν ἐν τῇ ἐκλόγῃ τῶν ἐναντίων, en parlant de la réduction des contraires. Alexandre d’Aphrodisée [83], qui avait sous les yeux la leçon τεθεὼρηται, pense qu’Aristote, par le temps passé du verbe, nous renvoie au deuxième livre du περὶ τἀγαθοῦ, où se trouvait la réduction des contraires à l’unité et à la pluralité. Or, dans l’hypothèse de l’identité, la leçon τεθεώρηται est une absurdité, et la remarque d’Alexandre un non-sens. Du reste le mot περὶ τἀγαθοῦ est si peu identique aux trois derniers livres de la Métaphysique, que dans tout le treizième et dans le quatorzième, excepte au dernier chapitre de tout l'ouvrage, il n'est pas même question du bien, c'est-à-dire de ce qui devait être le véritable, l'unique sujet du traité en question.
Le περὶ εἰδῶν, en deux livres, devait être un traité spécial entièrement distinct par son objet du περὶ φιλοσοφίας. Si l'on en juge par ce qu'en dit Alexandre d'Aphrodisée à la fin de son commentaire, il s'agissait dans ce traité, mais avec plus de développement que dans le premier livre de la Métaphysique, et même que dans les deux derniers, des doctrines de Pythagore et de Platon, qu'Aristote rapproche toujours les unes des autres. On ne peut donc pas l'identifier non plus avec les deux derniers livres de la Métaphysique. Alexandre dit formellement que le περὶ τῶν εἰδῶν est un ouvrage à part, un ouvrage distinct des deux derniers livres, et en dehors de la Métaphysique… τὰ περὶ τῶν εἰδῶν γραφέντα αὐτῷ δύο βιβλία, ἀλλὰ ὄντα παρὰ τὰ Μ καὶ Ν, καὶ ἐκτὸς τῆς Μετὰ τὰ Φυσικὰ συντάξεως [84]. Syrianus, in Métaph. XIV, sub fin,. et Philopon, fol. 67, b., répètent la même chose qu'Alexandre. Tous les efforts de M. Michelet pour maintenir son opinion sur l'identité du XIIIe et du XIVe avec le περὶ εἰδῶν ne sauraient prévaloir contre de pareils témoignages ; et tout ce qu'il dépense de science ingénieuse pour concilier l'opinion des commentateurs avec la sienne [85], témoigne pour nous, de leur radicale incomptabilité. Mais M. Michelet n’a pas connu le passage d’Alexandre ; et M. Ravaisson qui l’a cité, d’après les manuscrits de la Bibliothèque royale, affaiblit considérablement son autorité. Selon lui, la fin du commentaire de la Métaphysique attribué à Alexandre d’Aphrodisée, est de Michel d’Éphèse : opinion que nous sommes loin de partager, car nous maintenons l’authenticité intégrale du commentaire [86].
Diogène de Laërte mentionne encore d’autres traités qu’on a essayé d’identifier avec d’autres parties de la Métaphysique : mais ce ne sont-là que des hypothèses purement gratuites, et qui ne prouveraient pas, fussent-elles fondées, que la Métaphysique soit une collection d’ouvrages aristotéliques. « S’il était vrai, remarque M. Ravaisson, que le περὶ ἀρχῶν dût être identifié avec les Ier et IIIe livres, le περὶ ἐπιστημῶν avec le IIe et le IVe, le περὶ ἐπιστήμης avec le XIe le περὶ ὕλης et le περὶ ἐνεργίας avec le VIIIe et le IXe [87], il ne s’ensuivrait pas que ces titres fussent les titres primitifs ; ce ne seraient, selon nous, que des noms donnés à des parties détachées d’un tout » [88]. Ce qui justifie cette opinion, c’est que plusieurs livres de la Métaphysique, tels que le IIIe et le Ve ont des noms séparés ; Aristote les appelle lui-même, l’un le livre des difficultés, ἀπορήματα, l’autre le livre des acceptions diverses, περὶ τῶν ποσαχῶς, ou π. τ. π. λεγομένων. Ces noms passèrent dans l’usage commun, ainsi qu'on le voit chez les commentateurs ; ce qui n'empêche non plus les livres en question d'être des parties intégrantes et essentielle· de 1a Métaphysique, que les noms mis en tête des livres de l'Iliade par le» Rapsodes, n'empêchent que le Dénombrement, que la Dolonie ne puissent pas être séparés du poème.
Que si nous récapitulons ce qui précède, nous sommes fondés à conclure, ce semble ? 1° Si Andronicus a mis en ordre les différents traités d'Aristote qui avaient rapport à la philosophie première, la Métaphysique n'est point cette collection ; elle n'était qu'une partie de la collection, et formait à elle seule un tout sui generis, un ouvrage original. 2° Si la Métaphysique a quelque chose de commun avec les traités mentionnés par Diogène de Laërte, c'est, ou bien que ces traités y ont été fondus par Aristote, ou bien que ces traités n'avaient qu'une existence nominale, et n'étaient en réalité que des portions de la Métaphysique ayant un nom particulier.
La Métaphysique n'est donc point le résultat d'un travail matériel, pour ainsi dire, de Scoliastes et de commentateurs. « Un pareil ouvrage philosophique, dit M. Cousin [89], ne peut appartenir qu'au grand philosophe; et comme ce n'est ni Lycurgue, ni Pisistrate, qui ont fait l'Iliade avec des rapsodies d'Homère; de même, ce n'est point Andronicus qui a composé l'Iliade de la philosophie, même avec des morceaux d'Aristote. » Nous allons plus loin. Nous ne partageons même pas l’opinion de Michelet sur la manière dont Aristote a composé la Métaphysique. Suivant cet habile critique, Aristote aurait publié d’abord séparément un certain nombre de traités relatifs à la philosophie première, puis il les aurait réunis, aurait rempli les intervalles, mis une introduction ; et ce corps grossissant peu à peu, après quatre publications ou rédactions augmentées, la Métaphysique aurait paru telle que nous la possédons aujourd’hui. La base de l’ouvrage aurait été le περὶ φιλοσοφίας [90]. Ce système, qui peut s’appliquer à l’Organon, est-il vrai relativement à la Métaphysique ? Il nous semble trop ingénieux pour rendre un compte exact de la nature. Surtout, il est difficile de comprendre que telle ait été la manière habituelle de composer d’Aristote ; et c’est ainsi, suivant M. Michelet, qu’il aurait écrit la Physique, la Morale à Nicomaque [91]. Ce n’est pas de cette façon que se passent les choses. La vie dans un livre vient d’une pensée primitive et d’ensemble : le tout est antérieur à la partie disait Aristote ; cela est vrai particulièrement pour les ouvrages de l’esprit. Réunis par Aristote, ou réunis par Andopnicus, les écrits métaphysiques non refaits, non refondus, n’eussent été toujours qu’une collection, un centon, un livre disparate, sans unité de forme ai même de pensée : où serait alors cette belle harmonie que M. Michelet a si bien mise en lumière ?
Il y a, ce semble, une explication plus vraisemblable, parce qu’elle est plus simple, des irrégularités, des répétitions, des dissonances, qu’on ne saurait s’empêcher de reconnaître dans la Métaphysique. La Métaphysique d’Aristote est un traité de doctrine intérieure ; c’est, par excellence, le livre esotérique, comme on parlait dans l’école péripatéticienne, c’està-dire un de ces ouvrages qui supposaient dans le lecteur la connaissance de renseignement plus détaillé du maître. C’est un résumé de cours sur la philosophie première, il n’y a pas à en douter. Si la Métaphysique ne porte pas comme la Physique le titre d’ἀκρόασις, ce n’est pas que ce titre ne lui convienne point. Dans le peu de mots qu’Aristote y consacre à la méthode, on trouve ces expressions caractéristiques : αἱ δ' ἀκροάσεις κατὰ`ἔθη συμβαίνουσι [92], et ailleurs : δεῖ γὰρ περὶ τούτων ἥκειν προεπισταμένους, ἀλλὰ μὴ ἀκούοντας ζητεῖν [93]. C'était donc à des auditeurs que s’adressait Aristote. Or, tout le monde sait comment et pourquoi le professeur, tout eu restant fidèle à sa pensée première, est nécessairement entraîné à des digressions, à des répétitions, à des développements qui sont loin de nuire à la clarté de l’enseignement, comme ils nuiraient à la clarté d’un livre. Et si le livre qui sort de l’enseignement n’est qu’un résumé, quelque soin que l’auteur y mette, le livre se sentira toujours de son origine. On peut admettre du reste que d’un premier enseignement sur la philosophie première ne soit sortie d’abord qu’une ébauche de Métaphysique, le περὶ φιλοσοφίας, si l’on veut. Nouvel enseignement, nouveau livre : et ainsi de suite, nous y consentons, jusqu’aux quatre rédactions succèssives de M. Michelet. Mais M. Michelet fait passer dune rédaction à l'autre le fond avec la forme, et le livre s'accroît par juxtaposition: nous pensons que* le fond seul persiste, et même une partie seulement du fond,car d'un cours à l'autre, un esprit comme celui d'Aristote ne demeurait pas stationnaire. La Métaphysique s'est formée, qu'on nous passe le terme, par intussusception.
Il ne nous reste plus, pour avoir résolu les principales difficultés soulevées à propos de la Métaphysique, qu'à dire quelques mots de l'authenticité et de l'ordre des livres de l'ouvrage. Y a-t-il dans la Métaphysique, telle que nous la possédons aujourd'hui, des interpolations, des parties non authentiques? Y a-t-il dans la disposition actuelle des parties quel- que désordre qu'on puisse réparer ?
Alexandre d'Aphrodisée [94] donnerait à entendre que quelques-uns suspectaient l'authenticité du premier livre, car il la démontre par un passage du IIIe livre, où Aristote renvoie à ce qu'il a dit plus haut sur la doctrine des idées. Syrianus [95] fait la même démonstration, à propos du même passage du IIIe livre. Asclépius nous apprend qu'on attribuait la composition du Ier livre à un certain Pasiclès, fils de Boëthus, le frère d'Eudème qui avait été l'ami d'Aristote [96]. On ne comprend pas qu'il ait jamais pu y avoir aucun doute sur l'authenticité de ce livre. C'est le plus parfait de toute la Métaphysique, c'est le plus bel écrit d'Aristote, c'est un chef-d’œuvre qui n’a rien d’analogue dans l’anûquité : là est Aristote tout entier avec toute sa force, tout son génie, ou il n’est nulle part. Ce serait une faiblesse que de chercher à donner d’autres preuves. Il n’y a pas d’écrits anonymes de cette taille-là dans le monde.
Jean Philopon rapporte à Pasiclés, qu’il appelle fils de Bonœus, le IIe livre, α ἔλαττον. Une note marginale de la plupart des manuscrits de Bekker [97] appuie cette opinion, mais rétablit le véritable nom du père de Pasiclés, Boëthus frère d’Eudème. Il est tout aussi impossible, quelque défaut d’agencement qu’on trouve dans le IIe livre, d’y méconnaître la main d’Aristote, que dans le livre premier. Le premier chapitre et le dernier sont d’une grande beauté de pensée et de forme, et le deuxième est d’une concision, d’une profondeur, et en même temps d’une élégance austère qui n’appartient qu’à l’auteur de la Métaphysique.
Il n’y a pas plus de raison pour enlever à Aristote le Ve livre, qui aurait été attaqué comme apocryphe, à ce que nous apprend Alexandre d’Aphrodisée.
Que les traductions arabes dont se servit Averroès n’aient contenu ni le XIe livre, ni le XIIIe, ni le XIVe, cela ne prouve rien contre l’authenticité de ces livres. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les traducteurs arabes n’aient eu que des manuscrits incomplets [98]. Saint Thomas lui-même ne connaît pas les deux derniers livres de la Métaphysique, tandis qu’Albert-le-Grand, son contemporain, les a commentés ; et, à la même époque où Bessarion donne une traduction complète de la Métaphysique, Argyropule ne traduit que les douze premiers livres.
Mais si, dans la Métaphysique, il est impossible de retrouver la trace d’une autre main que celle d’Aristote, n’y a-t-il pas une autre sorte d’interpolation, l’introduction par exemple, dans la philosophie première, de morceaux appartenant à d’autres traités du philosophe ? Quelques critiques ont répondu affirmativement. M. Ravaisson donne, d’après un manuscrit de la Bibliothèque royale, un passage d’Asclépius qui semble autoriser cette conclusion [99], Aristote, suivant Asclépius, n’aurait pa» achevé »on ouvrage ; surpris par la mort, il l’aurait légué à Eudème, qui serait mort aussi sans l’achever ; et les héritiers d’Eudème auraient comblé les lacunes, en puisant dans d’autres ouvrages d’Aristote, et en raccordant le tout du mieux qu’ils pouvaient. Le commentaire d’Asclépias est aujourd’hui publié[ 100], du moins ce qu’il y a de plus important dans ce commentaire, et on peut voir ce qui a motivé cette opinion, apprécier la valeur des motifs. Le chapitre deuxième du livre cinquième de la Métaphysique est mot à mot la transcription du huitième du livre deuxième de la Physique. Au lieu de se demander si cela n’était pas parfaitement naturel, et si, donnant toutes les acceptions du mot cause, qu’il avait déterminées dans un autre ouvrage, Aristote n’a pas été conduit à se transcrire lui-même, Asclépius y voit une interpolation [101], et répète presque dans les mêmes termes ce qu’il avait dit déjà dans le passage cité par M. Ravaisson, moins affirmativement toutefois, car ce n’est plus lui-même qui prononce, il rapporte l’opinion des autres : Ἔλεγον γὰρ ὅτι τινὰ παραπώλοντο, καὶ μὴ δυνηθέντες μιμήδασθαι ἐκ τῶν αὐτοῦ ἐφήρμοσαν. Si tous les arguments qu’on faisait valoir en faveur de cette opinion, étaient de la force de celui-là, on s’explique aisément pourquoi les autres commentateurs se sont mis peu en peine d’y répondre.
On a cherché à faire rentrer le premier livre dans la classe des livres Physiques. Nous n’essaierons pas plus de démontrer que le premier livre appartient à la Métaphysique, que nous n’avons essayé de démontrer qu’il était l’œuvre d’Aristote.
Nous n’avons pas pu nous rendre aux spécieuses raisons de M. Ravaisson fait valoir pour reléguer, non plus le premier, mais le deuxième livre, dans la πραγματεία φυσική. L’ἄλφα ἔλαττον n’est pas un livre, à proprement parler, c’est un appendice du premier livre ; mais cet appendice, on ne peut l’en séparer sans dommage, et sans mutiler l’œuvre d’Aristote. Aristote vient d’examiner longuement les doctrines de ses devanciers, et il prouve, en général, qu’on doit au passé respect et reconnaissance ; il vient d’énumérer les quatre principes premiers, et il prouve qu’il y a nécessairement des principes premiers ; enfin il vient d’employer une méthode de démonstration qui est propre à la science dont il traite, et il se justifie en entourant d’une vive lumière le grand principe qui domine toutes les recherches scientifiques : connaître avant tout quel mode de démonstration convient à chaque objet particulier. Or, c’est-là tout le deuxième livre de la Métaphysique. Que si, dans l’avant-dernière phrase du livre et dans la dernière, il est question de Physique, qui ne voit que c’est tout simplement un exemple particulier à l’appui de la théorie générale ? Aristote emploie le mot Physique, comme il eut pu, mutatis mutandis, employer le mot Médecine, ou tout autre : « On ne doit pas exiger en tout la rigueur mathématique, mais seulement quand il s’agit d’objets immatériels. Aussi la méthode mathématique n’est-elle pas celle des physiciens, etc. (Voyez p. 65). ,» On ne saurait nier qu’entre les parties de l’α ἔλαττον il n’y a pas une liaison très intime ; mais c’est-là une raison de plus pour le considérer, ainsi que nous faisons, comme un appendice.
Quant à l’argument tiré de ce que le deuxième livre interrompt le passage naturel du premier livre au troisième, il tombe de lui-même devant cette considération. On remarque, il est vrai, qu’Averroès place le IIe livre avant le Ier. C’est que dans les traductions arabes la Métaphysique n’avait pas de commencement : les traductions arabes-latines compulsées par le savant M. Jourdain [102] ne commencent qu’aux deux tiers du cinquième [ cxviii ] chapitre ; les généralités de l'α ἔλαττον ont pu paraître au grand commentateur une sorte de commencement.
Pour en finir avec le deuxième livre, nous demanderons qu'on explique, autrement que par le motif que nous venons d'indiquer, pourquoi l'α ἔλαττον se nomme α ἔλαττον et non B, tandis que le VIe livre, lequel n'a guère plus d'étendue, se nomme E, et non pas δ ἐλαττον : qu'on trouve en un mot la cause rationnelle de la tradition que nous ont léguée les commentateurs grecs.
Il est aussi clair du reste que le premier livre de la Métaphysique est le commencement de la Métaphysique, qu'il est clair que ce livre est d'Aristote et qu'il fait partie de la Métaphysique. Aussi n'est-ce pas à titre de commencement que M. Ravaisson place le Ve livre avant le premier. Le περὶ τῶν ποσαχῶς, suivant M. Ravaisson, est en dehors de la Métaphysique, mais la Métaphysique le suppose ; c'est un traité préliminaire. Cette hypothèse, que n'appuie aucun fait sérieux et précis, et que l'auteur a lui-même considérablement, affaiblie : « Il se pourrait, dit-il, qu'Aristote eût voulu placer l'explication des termes scientifiques immédiatement après l'Introduction, avant d'entrer dans les profondeurs de son sujet [103] ; » cette hypothèse n'est-elle pas en contradiction avec les faite mêmes ? Une trompeuse analogie a seule pu y conduire le savant critique que nous combattons. Dans les livres de Mathématiques on place les définitions en tète. Mais il ne s'agit pas ici de définitions mathématiques. Nous avons expliqué plus haut ce que c'était que les définitions du περὶ τῶν ποσαχῶς, leur rôle dans la Métaphysique, et comment Aristote après avoir dit ; définissez, avait donné l'exemple avec le précepte. La vérité est dans l'autre supposition, que M. Ravaisson ne présente que sous la forme dubitative·
Le XIe livre embarrasse étrangement les critiques. On trouve qu'il rompt l'enchaînement, qu'il est un hors-d'œuvre. On ne le conserve à sa place, que parce qu'il fait certainement partie des livres Métaphysiques et qu'on ne sait où le placer ailleurs. Et c'est l'extrémité où on se trouve réduit, si on le sépare du XIIe, comme ont fait Samuel Petit, Buhle, Titse, M. Ravaisson, et M. Michelet lui-même, l'ingénieux restaurateur de l'unité de la Métaphysique : on ne comprend pas bien comment le ΧI [104] livre pourrait être une introduction aux livres XIII et XIV ; il n'y à en réalité rien de commun entre eux, ou plutôt il y a entre eux un abîme. Du Val l'avait vivement senti, alors que, tout en plaçant le douzième à la fin de l'ouvrage, il ne le séparait pas du XIe, et les transportait à la fois tous les deux [105].
Le XIe livre se compose de deux parties distinctes, mais non séparées, un résumé de la doctrine ontolologique exposée dans les premiers livres de la Métaphysique, et une théorie du mouvement. « Le point auquel sont arrivées les recherches d'Aristote, dit M. Cousin, est la nature de l'être absolu, du principe unique et premier, de la cause unique et première, c'est-à-dire de Dieu. Mais avant d'entrer dans cette recherche difficile et de pénétrer en quelque sorte dans le sanctuaire de l'être, il faut ici faire une station et récapituler les résultats obtenus ; car le rapprochement de tous ces résultats est déjà un progrès, le point de départ et la garantie de progrès nouveaux. Tel est le but du XIe livre, qui peut être regardé comme une introduction à la Théologie [106].» Or, la Théologie est tout entière, est uniquement dans le livre XIIe.
Cette conclusion que M. Cousin tire de l'examen de la première partie du XIe livre, sort avec bien plus d'évidence encore de l'examen de la seconde partie.
La question fondamentale, suivant Aristote, celle qu'on doit avant tout se poser, c'est la question de l'essence. Quelque objet qu'on étudie, il faut se demander d'abord : Quel est cet objet ? Or, de quoi s'agit-il principalement dans le douzième livre ? de la cause du mouvement. De l'essence du mouvement, il n'en est pas dit un seul mot dans tout le cours de ce livre. Aristote serait-il donc infidèle à sa méthode ? aurait-il donc oublié qu'on est en droit de lui demander : Qu'est-ce que le mouvement, τί ἐστιν ἡ κίνησις ? Or, la réponse à la question que suppose tout le XIIe livre,] elle est à la fin du XIe, elle est là uniquement.
Le livre onzième est donc, de tous les livres de la Métaphysique, le seul qui puisse servir d'introduction à la Théologie.
Mais on dit : La seconde partie du livre XIe est un abrégé des IIIe et Ve livres de la Physique [107]. Là n'est pas la question. Nous demanderons si la théorie du mouvement est à sa place. M. Ravaisson remarque en outre que Michel d'Éphése, comme il nomme l'auteur d'une partie du commentaire que nous attribuons à Alexandre d'Aphrodisée, n'a pas commenté la fin du livre XIe. Mais il fallait ajouter que le commentateur s'est abstenu, parce qu'il avait déjà traité ce point à propos de la Physique : c'eût été double emploi. Il renvoie formellement à ce qu'il a dit dans son ouvrage sur la Physique : Ἔως τὸ τέλος τοῦ βιβλίου τὰ αὐτά εἰσιν ἀπαραλλάκτως τοῖς ἐν τῇ Φυσικῇ Ἀκροάσει λεγομένοις, καὶ δεῖ τούτων τὴν σαφηνείαν ἐκ τῶν εἰς ὑπομνημάτων πορίζεσθαι [108]. Que si l'on nie qu'il s'agisse ici de son propre commentaire, toujours est-il qu'il renvoie à ce qui a été écrit sur ce point à propos de la Physique. Or, cela suffit pour expliquer son silence.
Mais si l'intercalation des XIIΙe et XIVe livres entre le livre onzième et le douzième interrompt la suite des idées et détruit complètement l'harmonie de la Métaphysique, faut-il donc nécessairement, comme le veut Du Val, les intercaler entre le Xe et le XΙe. Nous reconnaissons avec Du Val, et avec tous les critiques modernes, que le XIIe livre est le point culminant de la Métaphysique, qu'il est la fin de l'exposition du système, qu'il faut appliquer à la Métaphysique, comme dit M. Michelet, le finis coronat opus, mais l'interversion demandée nous semble radicalement impossible. Deux livres, et deux livres fort longs de pure polémique contre Platon et Pythagore, en travers de l'exposition d'un système, il y avait là de quoi arrêter les critiques dans leurs remaniements. Il suffit du reste, pour se convaincre de l'impossibilité de l'intercalation comme l'entend Du Val, de mettre en regard les têtes de chapitre de la fin du dixième livre avec celles du commencement du treizième, lequel, dans l'hypothèse, devrait suivre immédiatement.
LIVRE X.
VIII. Les êtres différents d'espèce appartiennent au même genre. — IX. En quoi consiste la différence d'espèce ; raison pour laquelle il y a des êtres qui différent, et d'autres qui.ne diffèrent pas d'espèce. — X. Le périssable et l'impérissable sont différents et par l'espèce et par le genre.
LIVRE XIII.
I. Y a-t-il, oui ou non, des êtres mathématiques ? — II. Sont-ils identiques aux êtres sensibles, ou en sont-ils séparés ? — III. Leur mode d'existence. — IV. Il n'y a pas d'idées au sens où l'entend Platon…
Mais comment le XIIIe et le XIVe livre se trouvent-ils les derniers de la Métaphysique ? Ici nous laissons parler M. Ravaisson lui-même, l’un d«s partisans de l’intercalation : « Les XIIIe et XIVe livres sont d’une date postérieure au XIIe, et la tradition conservait en quelque sorte l’ordre chronologique aux dépens de l’ordre méthodique. Le motif principal qui nous« paraît autoriser cette hypothèse, c’est que le XIle livre ne présente aucune allusion véritable aux XIIIe et XIVe livres, où se trouvent cependant des déterminations de la plus haute importance pour la théorie qui se résume à la fois et s’achève dans le XIIe… C’est ce défaut de liaison du XIVe au XIIe qui aura porté les commentateurs anciens à considérer le XIIIe et le XIVe comme un appendice ajouté après coup : ils ont senti qu’un simple déplacement ne suffirait pas pour rétablir entre les trois derniers livres l’enchaînement et l’harmonie [109] ». Il serait inutile, après cet aveu du critique qui a le mieux expliqué pourquoi le XIIe livre était la fin de la Métaphysique, d’insister sur le point dont il s’agit. On peut bien, dans une exposition des doctrines d’Aristote, introduire çà et là et à sa place, ce qui se trouve de cette doctrine au fond de la vaste polémique contre la doctrine des nombres et des idées ; mais là se borne, à ce qu’il nous semble, la possibilité de l’intercalation. Les XIIIe et XIVe livres sont à la Métaphysique, ce que l’α ἐλαττον est au livre premier : seulement il y a, entre les parties de ce long appendice, une liaison parfaite, et une unité que commandait l’unité même du sujet j ajoutons avec le critique que nous venons de citer, que le XIIIe et le XIVe livre sont au nombre des plus riches, des plus achevés, des plus clairs de la Métaphysique.
Nous sommes donc bien loin de partager l’opinion aujourd’hui accréditée, et que quelques-uns regardent comme un résultat définitivement acquis à la science, de la nécessité d’un changement dans l’ordre des derniers livres de la Métaphysique. On a été jusqu’à écrire, de notre temps, qu’il fallait, pour en douter, ou n'avoir pas lu 'ouvrage avec l'attention qu’il mérite, ou supposer Aristote plus qu'absurde : nous sommes presque tentés de retourner la phrase en sens contraire. Du reste, l’anathème ne tombe pas sur nous seulement. Il faut croire qu’Alexandre d’Aphrodisée, Asclépius, Philopon, avaient lu attentivement la Métaphysique ; et pourtant ni Philopon, ni Asclépius, ni Alexandre, ni les autres commentateurs, ni personne dans l’antiquité, quoi qu’on en ait dit [110], ne s’est douté qu’il y eût dans la disposition des livres de la Métaphysique un désordre qu’il était urgent de réparer. M. Cousin pense que c’est là une preuve qui n’est pas sans valeur ; et, pour sa part, il n’est pas éloigné de lui accorder une entière confiance. Il y a bien apparence; en effet, que cette évidence qui n’avait jamais frappé personne, pendant tant de siècles, n’est qu’une pure illusion. On peut attaquer, il est vrai, le récit d’un historien, suspecter l’authenticité d’un fait ; il n’y a jamais prescription, dans le domame dé l’histoire. Mais il n’en est pas de même des choses du sens commun ; et il s’agit .ici d’une chose de sens commun, il s’agit d’un jugement que doit être en état de porter quiconque a lu attentivement la Métaphysique.
Ce serait ici le lieu de chercher quel a été le rôle de la Métaphysique d’Aristote dans l’histoire de la philosophie, d’apprécier son influence sur les systèmes qui se sont succédé depuis Aristote jusqu’à nos jours. Mais la tâche serait au-dessus de nos forces, et d’ailleurs c’est un sujet qui a été traité avec une grande supériorité de talent et de science par des hommes compétents. Nous nous en référons entièrement sur ce point au livre de M. Michelet, et au tome deuxième de M. Ravaisson, qui ne doit pas tarder à paraître, et où cette question a reçu, dit-on, tous les développements que réclamait son importance. Mais nous devons donner un tableau succinct des principaux travaux anciens et modernes, dont le but spécial a été de répandre la connaissance de la Métaphysique, traductions, commentaires, éditions : on verra les ressources que nous offraient le présent et surtout le passé, et comment il était possible, avec la patience seule, et la conscience, de mener jusqu’au bout l’entreprise.
Il ne paraît pas que les Romains aient traduit eux-mêmes Aristote dans leur langue. La connaissance du grec était si répandue dans toute l’étendue de l’empire, que tout Romain, au moins tout Romain de quelque distinction, connaissait, écrivait et parlait également les deux langues. C’est de la séparation des deux parties de l’empire que date la séparation des littératures, et c’est aux derniers siècles de la décadence latine, au commencement des siècles barbares, qu’on commence à sentir le besoin de traduire les livres grecs. Les poètes avaient bien donné une sorte d’exemple, mais si peu à titre de traducteurs, qu’ils se permettaient les plus grandes libertés, et ne voyaient dans l’original qu’un thème tout fait de versification, une occasion de mettre aux prises la littérature nationale avec la littérature victorieuse du peuple qu’on avait vaincu : c'est la pratique de Catulle, d’Horace, des autres poètes. Le premier traducteur connu d’Aristote est Boèce, célèbre surtout comme poète et comme moraliste : or, Boèce vivait au vie siècle ; il était né vers le temps de la destruction de l’empire d’Occident par les barbares. Il traduisit certainement les ouvrages dialectiques, et l’on verra tout à l’heure qu’il avait mis en latin une partie au moins de la Métaphysique, et que son travail, aujourd’hui perdu, était encore entre les mains des savants au temps de saint Thomas.
Outre la cause que nous venons d’indiquer, il y en avait une autre, qui dut nuire pendant longtemps à la propagation des ouvrages d’Aristote ; c’est l’anathème prononcé par les Pères des premiers siècles, presque tous platoniciens purs, contre la doctrine péripatéticienne. On peut lire dans l’ouvrage de Jean de Launoy (De varia Aristolelis fortuna in Academia parisensi) combien la réprobation était unanime. Launoy a réuni dans son deuxième chapitre vingt-neuf condamnations portées contre Aristote dans l’espace de quelques siècles, et signées des plus grands noms de l’Église, depuis saint Justin jusqu’à saint Bernard ; car c’est du XIIe siècle seulement que date la grande fortune d’Aristote, au moyen âge. Il est certain qu’à une époque où les plus grandes lumières étaient dans l’Église, cette disposition des esprits était peu favorable à des entreprises du genre de celle dont Boèce donna l’exemple. C’est dans cette période qui sépare l’antiquité du moyen âge proprement dit, que se place le temps le plus florissant de l’empire des Arabes. Les Arabes connurent de bonne heure Aristote, et, les souverains eux-mêmes aidant, dès le siècle des premiers califes Abbassides, la philosophie péripatéticienne fut, chez eux, en possession d’une autorité absolue. Almanzor, le deuxième Abbasside, favorisa tant qu’il put ces grandes études, et lui-même, si l’on en croit un historien, fut un philosophe, et surtout un astronome distingué. Sous le règne d’Almamon, le Syrien Bochtiechva, ou, comme l’écrit Pococke, Bachiva, traduisait en arabe les principaux ouvrages de médecine et de philosophie de l’antiquité. Les fils de Bochtiechva continuèrent l’œuvre de leur père, d’autres se joignirenl à eux, et les philosophes arabes dont le nom est resté, Avicenne, Alfarabi, Algazel, Averroès enfin, purent lire et commenter tous les livres d’Aristote. Nous ne nous plongerons pas dans les ténèbres de cette partie de l'histoire littéraire, que n'a point complètement dissipées la savante dissertation d'Eusébe Renaudot [111], d'où nous tirons ces détails. Qu'il nous suffise de constater, et c'est-là un résultat qui sort clairement des profondes recherches de cet orientaliste: 1° que la langue grecque n'a jamais été cultivée par les Arabes ; 2° que leurs traductions d'Aristote ne dérivaient point directement du grec, mais d'anciennes versions syriennes, hébraïques, arméniennes, ou même latines, dont il ne reste pas d'autre trace, et que les translateurs, tous étrangers, Syriens la plupart, tel que Bochtiechva ne connaissaient probablement pas les textes originaux ; 3° enfin que les philosophes arabes, Avicenne, Alfarabi et les autres, tous commentateurs d'Aristote, tous de grands commentateurs, Averroès surtout, ne savaient pas le grec, ne voyaient Aristote qu'à travers la version d'une version, et n'avaient, pour ainsi dire, la doctrine que de troisième main. Le fait, pour être singulier, n'en est pas moins authentique ; mais ce qu'il y a de plus étrange encore, c'est qu'on traduisit en d'autres langues ces versions de versions, en hébreu, en arménien peut-être, mais certainement en latin : toutes les grandes bibliothèques de l'Europe renferment des manuscrits de traductions arabes-latines de quelques-uns. des ouvrages d'Aristote. M. Jourdain, dans son mémoire couronné par l'Académie des inscriptions: Recherches critiques sur les anciennes traductions latines d'Aristote, Paris, 1819, in-8°, donne, p. 484-85, un spécimen d'une traduction arabe-latine de la Métaphysique [112]. Cette traduction n'est, et ne pouvait être, après tant de réflexions, de la lumière, pour ainsi dire, qu'une image extrêmement effacée et à peu près méconnaissable de l'original ; un ouvrage sans autre valeur que celle d'une curiosité bibliographique et historique. On en jugera par quelques phrases du livre deuxième, que nous empruntons à M. Jourdain : « Consideratio quidem in veritate difficilis est uno modo, et facilis alio ; et signum ejus est quod nullus hominum pοtuit pervenire in ipsam secundum quod oportet plene. Neque deviavit se ab hominibus omnibus… Et cum difficultas ejus est duobus modis, dignum est ut sit difficilis non propter res, sed propter nos. » : Recherches, etc. p. 484-85.
La vieille traduction qui accompagne toujours le commentaire de saint Thomas, et à laquelle renvoie ce commentaire, est loin d'être entièrement méprisable ; nous l'avons eue constamment sous les yeux, et nous l'avons plus d'une fois mise à profit. Elle a été faite sur le texte, comme il est facile de s'en convaincre en comparant le mode d'expression à celui de l'original, auquel il est parfaitement conforme, ce qu'on ne pourrait pas dire des traductions arabes-latines. Une autre preuve encore plus concluante c'est l'interpolation d'un grand nombre de mots grecs, tels que automata, diathigo, ecmagium, micrologia, sophia, etc. Les Arabes avaient un tout autre procédé ; ils traduisaient tout et donnaient des équivalents même aux noms propres. Hipparque, par exemple, s'est longtemps appelé Abraxis dans le moyen âge, chez Albert, chez Roger Bacon, jusqu'à l'époque où les textes grées ont commencé à se répandre dans l'Occident et où la science s'est affranchie de la tûtèle des Arabes. La traduction dont nous parlons a toujours été imprimée sans nom d'auteur, avec cette simple indication : Antiqua translatio. Elle fait partie de cette collection de versions aristotéliques entreprises, sur l'invitation de saint Thomas, par quelque helléniste du temps, probablement Guillaume de Moërbeka [113]. Elle ne va, de même que le commentaire de saint Thomas, que jusqu'à la fin du XIIe livre. Toutefois les mss. de la Bibliothèque royale, n" 6296, 6297, contiennent les livres XIII et XIV.
Quoi qu'il en soit, cette traduction n'est pas le premier essai, depuis Boèce, d'une version de la Métaphysique d'après le texte même. Saint Thomas semble avoir eu au moins trois traductions de la Métaphysique, dérivées toutes trois du grec. Ainsi il lisait dans la traduction faite par ses ordres, lib. I, lect. 4 : « Supervenientibus igitur erit aliquid præ opere methodo quae nunc. » Il fait cette remarque : « Unde et litera Boetii habet. [Accedentibus igitur ad opus scientiœ prœ operæ viæ, quœ nunc est, aliquid erit.] Alia litera habet. [Supervenientibus igitur quœ nunc [ cxxxi ] est, aliquid erit vitae opus via.] » Et saint Thomas propose une leçon un peu différente des trois leçons qu'il avait sous les yeux. Voyez fol. 6 , a. Dans plusieurs autres passages il cite encore la lettre de Boetius, lequel est sans nul doute le Boèce dont nous avons parlé plus haut. Très souvent aussi on retrouve dans saint Thomas les mots : Alia litera habet ; et, au livre Ve, il relève l'erreur d'un translateur, latin-arabe probablement, qui, au lieu d'écrire : Ut si quis porrigens dicat y, écrivait : dicat naturam, ce qui est absurde, car il s'agit seulement de la quantité de l'υ dans φύσις. Saint Thomas s'appuie de l'autorité d'un traducteur qui avaùeu certainement le grec sous les yeux : « Litera ista corrupta est. Quod ex alia translatione patet quœ sic habet. [Ut si quis producens dicat hypsilon.] Physis enim, quod apud Grœcos naturam significat, si pro generatione viventium accipiatur habet primum y productum : si vero pro principio, sicut communiter utitur, habet primum y breve. » Fol. 60, a. Mais après le VIIe livre on ne rencontre plus aucune trace de ces antiques versions : on est fondé à croire qu'elles n'allaient pas au-delà de ce livre.
Pour revenir à la traduction du XIIIe siècle, elle n'est pas sans utilité, nous le répétons, malgré ses innombrables imperfections, malgré la barbarie du style, et le peu de critique du traducteur, malgré les fantaisies singulières qu'il substitue quelquefois à la pensée d'Aristote. lui sert de guide habituel pour se convaincre du contraire; il lui eût fallu deviner la moitié de la Métaphysique. D'ailleurs les rectifications qu'il fait subir non-seulement à cette version mais à toutes, les versions qu'il semble avoir eues sous les yeux, ses discussuins sur le sens des mots grecs, sont, à notre avis, des arguments péremptoires.
Deux Grecs du quinzième siècle, le cardinal Bessarion et Jean Argyropoulo (en latin Argyropylus), ont traduit la Métaphysique, l'un les XIV livres, l'autre les XII premiers seulement. C'est à cette différence que ces deux traductions ont dû sans doute la diversité de leur fortune : Bessarion est fréquemment cité, sa traduction accompagne toutes les éditions d'Aristote qui renferment des traductions, tandis que le nom d'Argyropule est à peine connu des lecteurs de la Métaphysique. Pourtant la traduction d'Argyropule est fort supérieure à celle de Bessarion. Bessarion calque servilement sa phrase sur la phrase de l'original, se crée une langue en dehors même des habitudes scolastiques, et réussit ordinairement à se rendre beaucoup plus difficile à comprendre qu'Aristote lui-même, C'est un vocabulaire, mais un mauvais vocabulaire. On pourrait presque défier tous les latinismes du monde de traduire raisonnablement des phrases comme celles-ci, que nous prenons au hasard : « Causæ vero quadrupliciter dicuntur, quarum quidem unam causam dicimus esse substantiam et quod quid erat esse : reducitur enim ipsum quare primum ad rationem ultimam, causa autem et principium, ipsum quare primum. » L. I, 31. — « Causa vero uno modo dicitur, ex qua existente aliquid fit, ut aes statuæ, et argentum paterœ, et horum genera. » V, 2. Telle est la manière habituelle de Bessarion.
Argyropule se met un peu plus à distance du modèle ; il fait, non plus un calque, mais une copie. Son latin est plus pur, et sa traduction est fort intelligible d’un bout à l’autre : il y a même dans sa manière une certaine élégance. Sepulveda, qui s’y connaissait, faisait un grand cas de la version d’Argyropule. Il l’a revue lui-même avec un soin attentif, y a corrigé quelques inexactitudes, comblé quelques lacunes ; et c’est cette version, devenue excellente par ce nouveau travail, qui accompagne toujours la traduction latine d’Alexandre d’Aphrodisée.
Nous avons eu constamment sous les yeux et la traduction de Bessarion et celle d’Argyropule , particulièrement celle qui a été revue par Sepulveda.
Il n’existe dans les langues modernes que deux traductions de la Métaphysique, l’une en anglais, l’autre en allemand ; toutes les deux sont de notre siècle. La première fait partie de la traduction complète d’Aristote par Taylor, Londres, 1806-1812, 10 vol. in-4°. Nous ne connaissons pas cet ouvrage, mais si l’on peut lui appliquer le jugement sévère que Creutzer porte, en général, sur le travail de Taylor, ce serait un livre d’assez peu de valeur. Du reste on ne comprend guère qu’un seul homme, quel qu’il soit, ait pu traduire tout Aristote, et surtout qu’il n’ait mis que huit ou dix années pour achever une entreprise pareille : la vie d’un homme, et une vie longue, y suffirait à peine, et encore en supposant au traducteur toutes les connaissances requises, c’est-à-dire le savoir encyclopédique.
Un ami de Brandis, le docteur Ernest Guillaume Hengstenberg, qui l’avait aidé dans la confection des index qui accompagnent son édition de la Métaphysique, entreprit, sur l’invitation de celui-ci, la traduction du livre d’Aristote. Brandis revit cet ouvrage qui parut à Bonn sous ce titre: Aristoteles Metaphysik übersetzt von Dr Ernest Wilh. Hengstenberg ; mit Anmerkungen und erläuternden Abhandlungen von Dr Christian August Brandis, etc. 1824, in-8°.
Brandis n’a point publié, que nous sachions, le volume de notes qui devait suivre la traduction, et peut-être cette publication est-elle indéfiniment ajournée. Sauf une préface de quelques pages, Hengstenberg n’a donné que la reproduction pure et simple du texte, sans un seul éclaircissement, sans arguments, sans rien de ce qui accompagne habituellement les travaux de ce genre. Le mérite et le grand défaut de cette traduction, c’est celui de toutes les traductions allemandes, une excessive fidélité. La prodigieuse élasticité de l’idiome germanique, l’analogie des formes de cette langue avec la langue grecque entraînent naturellement les traducteurs. Hengstenberg est plus clair que Bessarion : mais son. système se rapproche beaucoup de celui du traducteur latin ; d’habiles germanistes nous ont même fait remarquer d’assez nombreuses impropriétés de termes qui avaient été la conséquence forcée de cette tendance exagérée à la littéralité. Quoi qu’il en soit, nous avons consulté religieusement cet ouvrage, et nous, en ayons tiré à peu près tout le parti, qu on en. peut tirer, c’est-à-dire des indications,précieuses pour la détermination du sens propre de quelques mots, de quelques formules philosophiques, choses ou ignorées des faiseurs de lexiques, même les plus savants, ou déplorablement interprétées.
La traduction française du Ier et du XIIe livre par M. Cousin, est entre les mains de tout le monde ; nous n’apprendrons rien à personne en disant qu’elle accompagne le rapport sur le concours de l’Académie des sciences morales et politiques.
Simplicius nous dit, dans son commentaire sur le de Anima, lib, I, text, 26, qu’il avait commenté la Métaphysique ; mais son ouvrage a péri, ainsi que ceux d’autres écrivains antérieurs, Aspasius, Endore, Evharmoste, nommés par Alexandre d’Aphrodisée, ainsi que celui de Nicolas de Damas. Heureusement Alexandre nous est resté [114]. Le philosophe espagnol Jean Ginès Sepulveda [115], sur l’invitation du pape Clément VII, traduisit en latin tout ce qu’on connaissait d’Alexandre au XVIe siècle, c’est-à-dire tout ce qui regarde les douze premiers livres de la Métaphysique. Voici le titre de l’édition de Venise : Alexandri Aphrodisiei commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima philosophia, interprete Joanne Genesio Sepulveda Cordubensi, ad Clementem VII, Pont. Max. ; quœ omnia recenti hac nostra editione ita diligenter ut nihil desideres, expolita surit, atque elaborata. Venetiis 1561, in-fol. Cette édition, très inférieure, sous le rapport typographique, à celle de Paris, est préférable cependant, parce qu'elle lui est postérieure, et contient, comme le fait entendre le titre, quelques rectifications qui ne sont pas sans importance; elle est d'ailleurs la plus répandue : c'est à cette édition que nous renverrons toujours.
Ce n'est que tout récemment, en 1836, que le texte d'Alexandre a été publié pour la première fois ; encore nel'a-t-il pas été intégralement. Il fait partie du premier volume des scolies sur Aristote, qui est le quatrième volume de la grande édition imprimée par ordre de l'Académie de Berlin. Brandis, le savant éditeur des scolies, a comblé en partie la lacune laissée par Sepulveda ; il donne des extraits nombreux et suivis du commentaire du XIIIe et du XIVe livre, que le philosophe espagnol n'avait pas trouvé dans ses manuscrits.
On a contesté qu'Alexandre d'Aphrodisée eût écrit un commentaire sur la Métaphysique. Patrizzi rapporte l'ouvrage en question à un autre Alexandre à peu près inconnu, Alexandre d'Égée. Cette hypothèse n'a point prévalu. Les preuves de toute sorte abondent pour maintenir Alexandre d'Aphrodisée en possession de ses droits. Une attaque plus sérieuse a été dirigée contre l'authenticité de la partie du commentaire qui concerne les livres VI-XIV de la Métaphysique.
On trouvera à la fin de ce volume, Notes, liv. VI, p. 268, l'exposé de cette discussion qui date de loin, et que MM. Ravaisson et Brandis ont reprise de nos jours. Nous ne partageons point l'opinion négative de Brandis, encore moins pouvons-nous adhérer à l'hypothèse de M. Ravaisson. Avec Sepulveda nous admettons l'authenticité de tout le commentaire : on verra pour quels motifs, à l'endroit que nous venons d'indiquer.
Le mérite par excellence d'Alexandre d'Aphrodisée, c'est la clarté, et cette qualité, si précieuse dans un pareil sujet, n'exclut, chez lui, ni l'étendue, ni même la profondeur. Son unique défaut, si l'on peut appeler de ce nom une vertu éminente, c'est peut-être trop d'impartialité. Au milieu des opinions diverses, il reste quelquefois en suspens ; mais s'il n'opte pas toujours , toujours il met le lecteur en mesure de choisir ; et, quand il affirme, il serait difficile d'aller contre ses conclusions. Partout le commentaire nous révèle un grand esprit, un philosophe véritable ; et sans aller, comme Sepulveda, jusqu'à le nommer un ouvrage divin, on peut dire hardiment avec lui que ce commentaire l'emporte infiniment sur tout ce que nous ont laissé dans ce genre les Grecs et les Latins. La langue d'Alexandre se sent déjà, il faut l'avouer, des siècles de décadence, et son livre est loin d'avoir rien perdu en passant dans l'excellent latin scolastique de Sepulveda. L'expression du traducteur, toujours nette et précise, toujours exacte, mais non pas servile, donne à l'original une fermeté qu'il n'a pas toujours, et dans quelques passages, commente utilement le mot du commentaire. Cette traduction, faite sur les manuscrits du Vatican, et qui présentait des difficultés presque insurmontables, est sans contredit un chef-d’œuvre.
Le commentaire attribué à Jean Philopon[ 116] existe manuscrit dans la bibliothèque de Vienne, dans celle de l'Escurial probablement, et un manuscrit anonyme du Vatican, dont Brandis donne deux ou trois extraits, n’est pas autre chose que le commentaire même de Philopon, ou quelque soit le nom quela critique voudra donner à l’auteur de ces scolies [117]. Le texte de Philopon n’a jamais été publié. Patrizzi l’a traduit en latin sous ce titre : Joannis Philoponi breves, sed opprime ductæ et utiles expositiones, in omnnes XIV Arislotelis libros eos qui vocantur Metaphysici, quas Franciscus Patricius de Græcis latinas fecerat, nunc primo typis excussœ (sic) prodeunt. Apud Dominicum Mammarellum, Ferrariæ, 1583, in-fol. Ces scolies présentent un résumé très substantiel d’Alexandre ; elles contiennent en outre un certain nombre de vues particulières qui font honneur à la sagacité du critique ; et elles s'étendent jusqu’à la fin de la Métaphysique, tandis que la traduction de Sepulveda ne va que jusqu’au XIIe livre, et que Brandis ne nous a donné des deux derniers livres d’Alexandre, que des extraits. Malheureusement le latin de Patrizzi est d’une extrême barbarie, et sa ponctuation est détestable ; et, comme il ne put surveiller lui-même l’impression de son ouvrage, les fautes typographiques fourmillent à chaque pas ; le titre même peut en donner un exemple.
Thémistius [118], l'habile rhéteur, avait commenté le XIIe livre ; l'original grec s'est perdu. Nous n'en avons qu'une traduction latine, faite d'après une ancienne version hébraïque, par Moïse Finz : Themistii Paphlagonis paraphrasis in librum duodecimum Metaphysicorum. Aristotelis latine tantum ex hebraico a Mose Finzio, hebræo, conversa. Venet. 1558, in-fol. Brandis donne, dans ses scolies, de nombreux et utiles extraits de ce petit ouvrage devenu extrêmement rare.
Asclépius de Tralles [119] nous a laissé une rédaction des leçons d'Ammonius, fils d'Hermias, sur un certain nombre de livres de la Métaphysique. Ce commentaire inédit, non traduit en latin, a été publié en partie par Brandis dans sa collection. Asclépius est fort inférieur pour la clarté du style, pour l'étendue et la justesse des aperçus, à Alexandre d'Aphrodisée ; mais le choix judicieux fait par Brandis, est d'un grand secours pour l'intelligence de quelques passages un peu rapidement effleurés par Alexandre : on verra combien nous devons à l'auditeur d'Ammonius.
Le commentaire de Syrianus Philoxenus[ 120] sur les livres III, XIII et XIV, a été traduit en latin par Jérôme Bagolini, 1558, in-4°. Syrianus n'est plus comme Alexandre, comme Philopon,comme Asclépius, un commentateur proprement dit : son ouvrage est] ordinairement une réfutation des idées d'Aristote. Sans être aussi sévère que M. Ravaisson, qui n'accorde à Syrianus d'autre mérite que celui d'un collecteur de matériaux pour l'histoire de la philosophie, on doit avouer que Syrianus manque souvent de critique et de discernement, et que son livre ne sert pas autant qu'il le devrait à l'intelligence du texte d'Aristote. Nous ne connaissons point encore l'original de Bagolini [121], il ne paraîtra que dans le cinquième volume de la grande édition allemande d'Aristote, volume que Brandis n'a point encore publié.
Michel d'Éphése, George Pachymère, Herennius Philon, Métochite, une foule d'autres commentateurs plus ou moins connus, avaient écrit en grec des scolies sur la Métaphysique. Tous ces ouvrages sont perdus, ou du moins à peine en reste-t-il quelques traces.
Aristote, comme nous l'avons dit plus haut, fut connu de bonne heure par les Arabes ; et non-seulement Aristote fut traduit dans leur langue, mais ses scoliastes eux-mêmes, lesquels l'avaient été déjà dans quelques-unes des langues de l'Orient [122]. Averroès[ 123] reçut, comme on sait, par excellence, le surnom de commentateur. Son œuvre immense qui embrasse tout Aristote a été traduite en latin. Il a fallu plus de vingt traducteurs pour mettre fin à ce travail formidable. Huet, d'après Scaliger, donne les noms de ces traducteurs, tous à peu près inconnus[124]. Nous n'avons pu que parcourir fort rapidement le commentaire de la Métaphysique [125] ; toutefois ç'a été assez pour nous convaincre du peu d'utilité que nous en eussions tiré. On s'aperçoit dès l'abord, non-seulement qu'Averroès n'avait pas le texte entre les mains[ 126], mais qu'il voyait Aristote à travers un système ; il lui prête souvent ses propres conceptions, lesquelles se rattachent aux idées alexandrines, et particulièrement à la doctrine de l'émanation. Nous ne connaissons pas le commentaire d'Avicenne [127], traduit aussi en latin : Metaphysica, per Bernardum Venetuni, Venet. 1493, in-fol. Il paraît que ce commentaire est dans le même esprit que l'ouvrage postérieur d'Averroès. Les historiens de la philosophie nous disent qu'Avicenne a fait preuve dans son commentaire de la Métaphysique, d'une manière de penser originale. Quant aux autres commentaires arabes, peut-être fort nombreux, ils n'ont point été traduits, que nous sachions, et probablement ne le seront jamais ; on n'est pas même bien certain qu'ils existent encore.
De tous les commentaires du moyen-âge, un seul est resté fameux, c'est celui de saint Thomas d'Aquin. Même après Alexandre, Asclépius et Philopon, saint Thomas sert merveilleusement à l'intelligence de la Métaphysique, dans toutes les discussions subtiles où se complaît quelquefois Aristote, et qui sont le triomphe de la philosophie dû moyen-âge. Mais ce n'est point à des distinctions scolastiqnes que se borne le mérite de ce Commentaire. Quand Aristote aborde face à face le grand problème ontologique, et établit sur les ruines de tous les systèmes la doctrine qui sera son éternel honneur, saint Thomas met, si l'on ose ainsi parler, à notre service, ce génie puissant qui s'est avancé si loin dans les voies ouvertes par Aristote. La forme du livre est rebutante, et ces syllogismes éternels exigent du lecteur moderne une patience à toute épreuve. Mais si l'on pénètre sous cette rude écorce, on sent partout, énergique et vivante, la grande inspiration qui anima tous les travaux du docteur angélique. Nos citations se rapportent à l'édition générale des œuvres de saint Thomas, Anvers, 16-12 : le commentaire fait partie du tome IV de cette édition, sous ce titre : Divi Thomæ Aquinatis, doctoris angelici, in XII libros Metaphysicorum Aristotelis expositio.
Avant saint Thomas, Albert-le-Grand avait commenté, ou plutôt avait exposé et développé à sa manière, la Métaphysique, comme il avait fait des autres ouvrages d'Aristote [128]. Après saint Thomas, on cite Jean Duns Scot, Alexandre de Hales, Buridan, quelques autres encore, au nombre des commentateurs de la Métaphysique. Mais leurs travaux sont restés inédits, et ne sont connus que par quelques vagues indications des écrivains postérieurs.
Le livre le plus original peut-être qu’ait jamais inspiré Aristote, c’est celui de Patrizzi : Discussionum peripat. tom V. Bâle, 1581, in-fol. C’est le résumé passionné de toute la longue dispute des systèmes, et particulièrement du Platonisme, avec le système d’Aristote, et le dernier mot du XVIe siècle sur et contre la scolastique. Mais ce livre n’était guère pour des traducteurs qu’un livre curieux. C’est un immense pamphlet plein de cynisme et de verve, où brille une prodigieuse érudition, et, dès qu’il ne s’agit plus de la personne et du caractère d’Aristote, mais de la doctrine elle-même, un bon sens imperturbable et une étrange sagacité.
Tous les commentaires du XVIe siècle avaient été plus ou moins marqués de ce caractère satirique. Pierre Ramus commente la Métaphysique [129] avec un évident parti pris de trouver Aristote en défaut; et Ramus fut un des penseurs les plus consciencieux du XVIe siècle et de tous les siècles : mais il voyait Aristote avec les yeux d’un platonicien convaincu et, par suite, exclusif et injuste [130]. Charpentier commente aussi la Métaphysique ; mais c’est pour insulter Platon et le Platonisme ; c’est pour exhaler sa colère contre Ramus. Tout lui est arme indifféremment ; en homme qui n’avait pas craint d’attribuer à Aristote ses propres élucubrations [131], il ne se fait pas défaut de falsifier les textes, de les torturer à sa guise. Du reste, la philosophie n’était pour lui qu’un prétexte. La philosophie, ni le système d’Aristote n’ont rien à démêler avec les crimes de cet homme. Il y a dans tous les temps des intrigants qui veulent paraître ce qu’ils ne sont pas, et qui cachent leur turpitude sous le masque du dévouement aux intérêts de la science; de ces misérables qui réussiraient à déshonorer les plus nobles causes. Ce n’est pas un péripatéticien fanatique qui a montré la porte aux assassins de Ramus, c’est un candidat sévèrement apprécié qui se vengeait de son juge.
Les autres commentaires de la même époque et de la première moitié du dix-septième siècle sont assez nombreux ; mais les noms de leurs auteurs sont à peine connus aujourd’hui : Suarez, d’Orbelles, Valable, Dreier, etc. Ceux que nous avons pu compulser nous ont paru dignes d’un profond oubli. Ce sont, pour la plupart, des livres de classe, faits avec les lambeaux des ouvrages des maîtres, de fades et plates copies ou des développements fastidieux d’Alexandre et de saint Thomas, d’Albert et de Philopon, des œuvres sans portée et sans valeur. Nous devons toutefois excepter l’excellente analyse de tous les écrits d’Aristote, livre par livre, chapitre par chapitre, qu’on trouve dans l’édition de Du Val. L’exposition de la Métaphysique a été faite avec un soin particulier ; l’exagération même des termes dont se sert Du Val pour caractériser la philosophie première est le signe de l’importance qu’il attachait à cette partie de sa tâche. Plus d’une fois nous avons eu recours à cette analyse, qui sera toujours utile, même après des expositions plus élégantes ou plus profondes, même après les grands ouvrages de MM. Ravaisson et Michelet de Berlin (Voy. Synopsis analyt. doct. perip. 2e part. p. 83 sqq. T. 2 de l’éd. de 1629).
Voici le résumé des opinions de Gassendi sur Aristote :
1° Quod homines Aristotelei ex germana Philosophia Sophisticam effecerint ;
2° Quod immerito Aristotelei libertatem sibi philosophandi ademerint ;
3° Quod rationes nullæe sint, quibus secta Aristotelis videri potest praeferenda ;
4° Quod maxima sit incertitudo librorum doctrinœque Aristoteleæ ;
5° Quod apud Aristotelem innumera deficiant ;
6° Quod apud Aristotelem innumera superfluant ;
7° Quod apud Aristotelem innumera fallant ;
8° Quod apud Aristotelem innumera contradicant.
Ces huit propositions sont développées dans le premier livre de son ouvrage intitulé : Exercitationum paradoxicarum adversus Aristoteleos libri VII, etc. Grenoble, 1624. Nous donnons aussi le sommaire du VIe livre dans lequel Gassendi parle de la Métaphysique :
« Liber sextus instituitur adversus Metaphysicam. In hoc ubi rejecta est pars maxima elogiorum, quæ Metaphysicæ deferuntur, impetuntur potissimum vulgata illius principia, et celebres proprietates entis, unum, verum, bonum. Deinde vero fidei orthodoxæ asseritur quæcumque cognitio habetur de intelligentiis, deque Deo ter maximo, dum nimirum ostenditur, quam vana sint argumenta, quibus philosophari solent de substantiis illis separatis, exnaturali lumine. »
Il est permis de croire que Gassendi ne fit guère que prendre dans Patrizzi ce qui était à sa convenance, et que la composition de cet ouvrage ne lui coûta pas beaucoup de recherches ; la forme seule lui appartient en propre, avec les arguments contre la possibilité d’une connaissance rationnelle des substances simples et immatérielles. Richard Simon l’a déjà remarqué, il y a longtemps : « Le petit livre que Gassendi a composé Adversus Aristotelicos, dit-il au tome IV, 12, p.100, de la Bibliothèque critique, — pour avoir lieu de donner plus de cours à sa nouvelle philosophie, n’est qu’un très petit abrégé d’un excellent ouvrage composé par un Italien sur les ouvrages et la doctrine d’Aristote. »
À partir du XVIIe siècle, à partir de Du Val et de Gassendi, et des essais de Petit et de Ménage sur la forme de la Métaphysique, on ne trouve plus rien qui ait trait directement à l’ouvrage d’Aristote, jusqu’aux articles insérés par Buhle dans quelques savants recueils, jusqu’aux belles monographies de nos contemporains Brandis, Titze, Trendelenburg, etc., et à ces travaux tout récents qui appartiennent à ce qu’on pourrait appeler le mouvement péripatéticien français. Nous rangeons ici les titres de ces ouvrages que nous avons déjà cités la plupart dans cette introduction :
Brandis, De perditis Aristotelis
libris de ideis et de Bono sive Philosophia. Bonnœ, 1823., in-8.
Titze, De Aristotelis operum serie et distinctione. Lipsiæ, 1826,
in-8.
Trendelenburg, Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotelo illustrata. Lips., 1826, in-8.
Examen critique de l’ouvrage d’Aristote intitulé Métaphysique, etc., par Ch.-L. Michelet, docteur en philosophie, professeur extraordinaire dans la Faculté philosophique, à l’Université de Berlin. Paris, 1836, in-8.
Essai sur la Métaphysique d'Aristote, etc. par Félix Ravaisson. Tome I. Paris, Imprimerie royale, 1837, in-8.
Victor Cousin, De la Métaphysique d’Aristote. Rapport sur le concours, etc., suivi d’un essai de traduction du premier et du douzième livre de la Métaphysique. Paris, 1838, in-8, 2e édit.
E. Vacherot, Théorie des premiers principes, selon Aristote. 1836, in-8.
A. Jacques, Aristote considéré comme historien de la philosophie. 1837, in-8.
J. Simon, De Deo Aristotelis, 1839, in-8.
Les œuvres d’Aristote furent publiées pour la première fois par les Aides, Venise 1495-498, 5 volumes in-folio. Erasme en donna à Bâle, en 1532, une autre édition complète, réimprimée plusieurs fois à Bâle dans l’espace de quelques années. Les héritiers d’Aide Manuce donnèrent la leur en 1551-1552, 6 vol. in-8 : c’est l’Aldina minor. Ces éditions n’ont guère de valeur que comme curiosités bibliographiques, et comme reproduction plus ou moins fidèle des manuscrits, sur lesquels elles ont été faites directement, au moins les deux premières. Le texte d’Aristote, un texte véritablement constitué, ne date que de Sylburg, 1584-1587 : ’Ἀριστοτέλους τὰ εὑρισκόμενα. Aristotelis opera quœ exstant. Addita nonnusquam ob argumenti similitudinem quædam Theophrasti, Alexandri, Cassii, Sotionis, Athenæi, Polemonis, Adamantii, Melampodis. In tomi cujusque fine adjecta varians locorum scriptura, e praecipuis editionibus, nonnunquam etiam e msstis codd. Emendationes quoque non paucæ ex interpretum versionibus, aliorumque doctorum virorum animadversionibus. Præterea capitum index, et duo rerum ac verborum, notatu digniorum inventaria, latinum et græcum, etc. Opera et studio Friderici Sylburgii Veterensis. Francfort, chez les héritiers d’André Wechel, etc. Cette édition est toute grecque, sans traduction.
Nous avons comparé attentivement le texte de la Métaphysique donné par Sylburg, avec celui de la première Aldine et celui de la première Érasmienne, et nous nous sommes convaincus par nous-mêmes de la réalité des améliorations de toute sorte annoncées dans le titre que nous venons de transcrire. Sylburg, qui avait déjà fait ses preuves par sa collaboration au Thesaurus de Henri Estienne, a tiré un excellent parti de toutes les ressources qu’il avait sous la main ; il était difficile de faire, au XVIe siècle, mieux que n’a fait Sylburg; et, depuis lors jusqu’à ces derniers temps, on n’a pas même essayé de faire mieux. Casaubon, dans son édition grecque-latine[ 132], ne change rien au texte de Sylburg, ou du moins ses corrections sont sans importance. Il avoue lui-même que des circonstances fâcheuses ne lui ont pas permis de mettre beaucoup de temps à ce grand travail ; et Juste-Lipse dit quelque part que Casaubon y était allé au pas de course : cursim egisse Casaubonum[133]. Nous n’avons pas trouvé de différence appréciable entre sa Métaphysique et celle de Sylburg. Du Val, médecin, et professeur de philosophie, donna en 1619, 2 volumes in-fol., une belle édition grecque-latine d’Aristote, imprimée avec les caractères de l’Imprimerie royale, édition reproduite plusieurs fois dans le XVIIe siècle, 1629, 1639, 1654, et qui est la plus répandue de toutes les éditions d’Aristote. Du Val s'en tient religieusement au texte de Casaubon, qui s'en était tenu au texte de Sylburg. C'est à ces trois éditions indifféremment que nous renvoyons toujours, quand nous nous servons des mots : anciennes éditions, ancienne leçon, leçon vulgaire.
L'édition de Du Val fut la dernière édition des œuvres d'Aristote, jusqu'à notre temps ; car on ne peut pas considérer commet une édition la tentative avortée de Buhle, lequel ne parcourut qu'une partie de l'immense carrière dans laquelle il s'était engagé, et qui ne s'avança pas jusqu'à la Métaphysique.
Nous arrivons enfin aux deux textes de la Métaphysique sur lesquels a été faite cette traduction, le texte de Brandis et celui de Bekker.
Le travail de Brandis, Aristotelis et Theophrasti Metaphysica ad vet. codd., etc., parut à Berlin en 1823, 1 vol. in-8. C'est la seule édition particulière de la Métaphysique d'Aristote que nous connaissions [134], car celle de Tauchnitz fait partie d'une édition générale. Brandis ne voulait donner qu'un tint pour les écoliers, commode, portatif, et du prix le plus modique ; il fit un livre qui sera pour In Métaphysique, ce qu'a été si longtemps pour Aristote tout entier l'édition de Sylburg. Il ne lui vint pas dans l'idée qu'on pût, dans l'état actuel de la science, se borner à reproduire le texte que s'étaient transmis si fidèlement, comme chose sacrée, Sylburg, Gasauhon et Du Val. Il collationna une foule de manuscrits plus ou moins connus; et deux autres manuscrits fort anciens, non encore explorés, lui fournirent une ample provision de variantes précieuses, au moyen desquelles il corrigea des passages corrompus, et combla d'évidentes lacunes. D'un autre côté, les commentateurs grecs, Alexandre d'Aphrodisée, Syrianus, Asclépius, dont il avait sous les yeux les textes inédits, Jean Philopon, qu'il ne connaissait encore que par la traduction latine, lui servirent à contrôler les manuscrits, et suppléèrent plus d'une fois à leur insuffisance : tantôt il y trouvait des leçons diverses formellement mentionnées, les unes confirmant celles des manuscrits, d'autres non conservées par les copistes ; tantôt il rencontrait au travers de la paraphrase, quelque authentique et précieuse leçon oubliée aussi, et qu'il remettait dans tout son jour. C'est ainsi qu'il a restitué jusqu'à des phrases entières, qui rétablissent la liaison des idées, et aident singulièrement à l'intelligence de ce texte difficile et scabreux. Et encore, après s'être donné tant de peine, l'éditeur s'accusait de n'être pas arrivé assez bien préparé pour la tâche, et d'avoir peut-être trop précipité son travail !
Le texte de Brandis devait naturellement se retrouver dans la grande édition de Berlin, d'abord à cause de son incontestable supériorité, et ensuite parce que les deux philologues nommés, il y a dix ans, sur la proposition de Frédéric Schleiermacher, pour présider à cette grande entreprise, étaient Emmanuel Bekker, le célèbre éditeur de Platon, et Brandis lui-même. Bekker fut chargé de la collation des manuscrits et de la révision du texte, Brandis de la publication des commentaires. L'édition de Berlin est divisée en deux parties : la première qui contient le texte et les traductions, se compose de trois volumes, deux pour le grec, lesquels peuvent n'en faire qu'un seul, à cause de la continuité de la pagination, et un pour le latin ; il n'a paru encore que le premier volume de la partie confiée à Brandis, mais c'est le plus important, pour nous du moins, puisqu'il contient tout ce qu'on a écrit de meilleur dans l'antiquité sur la Métaphysique. Voyez à la fin de ce volume, Notes, liv. I, p. 223. M. Barthélémy St.-Hilaire a reproché avec raison aux savants éditeurs, le choix de leur version pour la Politique : nous regrettons de même qu'ils n'aient pas adopté pour la Métaphysique, la version d'Argyropule revue par Sepulveda, de préférence à celle de Bessarion ; elle eût été facile à compléter, et outre son mérite propre, elle s'écarte fort peu du texte nouveau, ce que nous ne dirions pas toujours de la traduction préférée.
En passant de l'édition particulière à l'édition générale, le texte de la Métaphysique s'est encore amélioré, et il est probable que Brandis n'a pas été étranger à ce progrès.
Nous ne parlerons pas de la Métaphysique soi-disant ad optimorum librorum fidem accurate edita, qui fait partie de la collection stéréotype de Tauchnitz. Elle n'est pas autre chose, nonobstant son titre, que la reproduction littérale du vieux texte traditionnel, sauf une ponctuation déplorable, dont n'avaient donné le modèle ni Du Val, ni Casaubon, ni Sylburg. Et pourtant cette édition est de 1832 ; elle est venue dix ans après le travail de Brandis, et un an après le deuxième volume de Bekker !
Tel est l'inventaire des principaux travaux auxquels a donné lieu la Métaphysique. Quelques mots, en finissant, sur l'usage que nous avons fait de ces divers secours.
Nous nous sommes conformés au texte nouveau, mais non pas aveuglément. Nous avons plus d'une fois cherché dans le texte vulgaire un refuge contre des hardiesses non motivées, ou qui nous semblaient telles. Il nous est même arrivé, mais rarement, et dans des occasions peu décisives, de combattre à la fois et les anciens et les nouveaux éditeurs. Les notes qu'on trouvera à la fin de chacun de ces deux volumes sont destinées à peu près toutes, à expliquer, à justifier nos préférences. Nous avons tâché, dans ces discussions, de ne jamais hasarder notre opinion sans avoir les preuves à l'appui : nouveaux venus dans la science, et sans autorité, il nous fallait devant le public, si l'on peut ainsi dire, des répondants connus et sûrs. Les éclaircissements qui accompagnent la traduction ont été rédigés dans le même esprit. C'est par Aristote que nous éclairons Aristote, par Platon, par les commentateurs, et, lorsqu'il nous arrive de parler en notre nom, c'est toujours sous l'inspiration des hommes qui ont pénétré le plus profondément dans la pensée d'Aristote, ou du moins c'est leur pensée que nous croyons reproduire.
Parlerons-nous du système de traduction que nous avons adopté ? si l'on peut appeler système une pra tique qui n'a rien de résolument systématique ? La traducteurs se vantent habituellement, de nos jours, d'une rigoureuse fidélité à l'original ; et ce qu'on recommande sans cesse aux traducteurs, c'est la fidélité rigoureuse à l'original. Si par là, on entend la reproduction exacte du sens, dans toute son étendue et dans ses plus minutieux détails, rien de mieux ; et il ne faut épargner ni temps, ni efforts, ni recherches, pour rester le moins possible en arrière d'un tel but. Mais la fidélité dont il s'agit, n'est trop souvent, nous le craignons, qu'une fidélité purement matérielle, une assimilation de coupes de phrases, une équivalence de mots et de syllabes, car on compte les syllabes, et même les lettres : comme si c'était là le style, comme si l'habit c'était l'homme, comme si la langue française n'avait pas aussi son génie propre. Chose excellente, si l'on s'arrête à certaines limites, cette fidélité devient, par l'excès, une vraie trahison! un crime de lèse-original. Il y a tel grand écrivain qui serait fort embarrassé peut-être pour se reconnaître lui-même sous le grotesque accoutrement dont on l'a affublé dans notre siècle, sous prétexte d'exactitude et de fidélité.
Un homme dont l'opinion peut faire loi en pareille matière, M. Cousin, s'exprime ainsi à propos d'une analyse arbitraire de la Métaphysique, présentée à l'Académie des Sciences morales avec le titre de traduction : « Traduire, c'est reproduire un auteur, non pas tel que nous aurions voulu qu'il fût, soit pour notre goût particulier, soit pour celui de notre siècle, mais rigoureusement tel qu'il a été dans son pays et dans son siècle, sous ses formes réelles, telles que l'histoire les a conservées. Et plus un auteur est grand, plus il faut le traiter ainsi, d'abord par respect pour la vérité, mais aussi par respect pour le génie qui vaut bien la peine d'être représenté au naturel, par respect même pour notre siècle auquel il faut bien supposer assez d'imagination et d'intelligence pour comprendre et apprécier les hommes et les œuvres des autres siècles[135]. « Il s'agit, dans ce passage, de la reproduction de la pensée ; et tel est l'idéal que nous avons sans cesse poursuivi. Quant à la forme, nous avons aspiré, autant qu'il était en nous, à l'austère concision d'Aristote; mais si nous avons toujours cherché l'expression pour ainsi dire adéquate, nous n'avons jamais, au besoin, reculé devant la paraphrase.
(01) Il est fait défense, par arrêt du Parlement de Paris du 4 septembre 1624, à peine de la vie, de tenir ni enseigner aucunes maximes contre les anciens auteurs et approuvés, ni faire aucunes disputes que celles qui seront approuvées par les docteurs de la Faculté de Théologie. Voyez Jean de Launoy, Devaria Aristotelis fortuna in Academia parisiensi, 1653, in-8°, page 157.
(02) Cum in antiquæe philosophiæ studio id vel maxime spectandum sit, ut… bene præparati ad nostram perveniamus, etc. Arist. et Theophr. Metaph. prœfat. Brand. sub init.
(03) C’est M. Cousin qui proposa pour le concours de 1837 à l’Académie des sciences morales, l’examen de la Logique d’Aristote, et qui écrivit le rapport sur ce concours où fut couronné l’excellent ouvrage de M. Barthélemy St.-Hilaire, aujourd’hui entre les mains du publi
(04) En première ligne, la dissertation de M. E. Vacberot, Théorie des premiers principes, selon Aristote. 1856, in-8°. Nous ne connaissons aucun écrit qui atteste une étude plus consciencieuse et plus approfondie du système d’Aristote. C’est la réduction de la doctrine à ses éléments premiers et vitaux ; c’en est, pour ainsi dire, la quintessence. MM. A. Jacques et J. Simon ont aussi exposé avec beaucoup de talent, l’un la critique des systèmes dans le Ier livre, l’autre l’idée de Dieu dans le XIIe.
(05) Liv. II, ch. 3.
(06) Liv. II, ch. 2.
(07) Liv. II, ch. 2.
(08) Liv. I, 3.
(09) Ἓν ἐπὶ πολλῶν.
(10) Liv. I, 5.
(11) Ἔρως.
(12) Φιλία καὶ νεῖκος
(13) Liv. 1,4.
(14) Aristote ne distingue jamais les doctrines de Pythagore de celles de ses disciples. C’eût été de son temps une tâche à peu près impossible. Pythagore n’avait rien écrit, de l’aveu même des anciens, et il est probable que ses premiers disciples avaient suivi son exemple. La doctrine dut se transmettre d’abord oralement, chacun y ajoutant ses propres idées, jusqu’à l’époque où Philolaüs (né vers 392 av. J.-C.) formula le système. Il n’était point facile de rendre à chacun sa part dans une doctrine qui s’était enrichie des découvertes de cinq ou six générations; aussi Aristote se contente-t-il de l’examiner en général; il emploie habituellement un mot aussi vague que compréhensif : « Ceux qu’on nomme Pythagoriciens. »
(15) Philolaus apud. Stob. Ecl., I, 6, p. 456.
(16) Voyez le Parménide.
(17) Philèbe.
(18) Philèbe.
(19) Timée.
(20) Exemplum porro gignundis
rebus, et ipsa
Notities lhominum, divis unde insita primum ?
Lucr., V, 192.
(21) WW. motice ---> motrice. (coquille).
(22) Timée.
(23) Platon dit cependant dans la
République, que Dieu est le principe des idées. Quelques passages du
Timée sont plus explicites encore ; enfin Alcinoüs (platonicien qui
vivait vers le IIe siècle avant J.-C.) dit formellement que l’idée,
dans l’opinion de Platon, n’était que la pensée de Dieu : « L’idée
est, par rapport à Dieu, son intelligence ; par rapport à nous, le
premier objet de l’entendement ; par rapport à la matière, la mesure
; par rapport au monde sensible, l’exemplaire ; par rapport à
elle-même, l’essence…
… « L’existence des idées, Platon l’établit ainsi : que Dieu soit
esprit, ou qu’il soit intelligence, il a des pensées, et ces pensées
sont éternelles et immuables ; de là suit l’existence des idées…
Introduction à la Phil. de Platon, ch. 6.
(24) Répub., VI.
(25) Métaph., I, II.
(26)Mét. I, III. Περὶ τῶν ἀπορημάτων.
(27 Mét., IV, 1.
(28) Met., IV, 2.
(29) Met., liv. IV.
(30) Mét.,liv. VI.
(31) Mét., IV, 6
(32).Cette distinction indiquée par Aristote est d’une extrême importance. On l’a souvent omise dans les derniers siècles ; et de là une foule de systèmes qui avaient pour résultat de rendre subjectives toutes nos connaissances. Reid la reproduisit, et en fit le point de départ d’un système plus complet et plus rationnel ; il s’en servit avec bonheur pour combattre le scepticisme de Berkeley et de Hume.
(33) Met. IV, 5. — Quelque triste que soit cette doctrine, elle a souvent été professée. Elle est la conséquence nécessaire du système de Locke sur les idées, et Berkeley et Hume l’en ont fait sortir. Elle se retrouve même, en partie du moins, dans la philosophie écossaise. Les qualités secondes, d’après Reid, ne sont pas perçues directement et en elles-mêmes; avant d’avoir été associées aux qualités premières, elles ne sont que des causes inconnues de sensations, elles sont subjectives.
(34) Met. IV, et pass.
(35)Tout le Ve livre : Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων.
(36) Met., V, 2.
(37) Liv. VII, 15.
(38) Liv. VII passim.
(39) Met., VII, 1.
(40) Livres VII et VIII.
(41 Liv. VII.
(42) Met, VII.
(43) Met., VII, et passim.
(44) Met., VII, et passim.
(45) Mysticisme d’Alexandrie.
(46) Met., VIII.
(47) Liv. VI et XI.
(48) Liv. IX.
(49) Met., IX..
(50) Met., IX 9, et Xl sub fin.
(51) Liv. IX.
(52) Met.,V, 5
(53) . Met., X.
(54) Met., XI.
(55) Physic. ausc., VIII.
(56) La légitimité des conclusions de l’effet à la cause n’a jamais été mise en doute dans l’antiquité. Le scepticisme relativement à l’existence de Dieu et à la Providence, s’appuyait uniquement sur le désordre de l’univers. Dans les temps modernes les progrès de la science ne permettant plus d’élever aucun doute sur l’harmonie du monde, on abandonna cette arme devenue impuissante, et Hume donna une nouvelle base au scepticisme en prétendant que le principe de causalité n’avait aucune valeur, que nous n’avions pas même l’idée de cause.
(57) Met., XII, 6
(58) Selon Aristote (Met , XII, 6), Platon admettait l’éternité du mouvement ; mais Platon dit positivement dans le Timée que les astres ont été créés, et que Dieu leur a communiqué le mouvement dont ils jouissent, à un instant donné de la durée. S’il y a eu quelque mouvement antérieur à la création, il tenait à la matière el ne venait pas de Dieu.
(59) Cette démonstration se trouvait déjà dans la Physique
(60). Brandis, Scholia in Aristotelem, εἰς τὸ Β, p. 603.
(61) In Categor., p. 6.
(62) Schol. in Arist., loc laud.
(63) Ed. de Venise, 1561, in-fol., p. 54.
(64) Essai sur la Métaphysique, t.1, p. 40.
(65) Liv. V, 2-27.
(66) De Aristotelis operum serie et distinctione, p. 70 : Lips. 1826, in-8.
(67) Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata, p. 10. Lips., 1826, in-8.
(68) Essai sur la Met., t. 1, p. 43-44.
(69) Liv. IV, 9 : De metaph., libr. Aristot, ordine, p. 34-52.
(70) Ad Diog., V, 22, p. 192-93.
(71) Examen critique de la Met., p. 28 sqq.
(72) De libris Aristot. deperditis in comment. Gotting., t. XV
(73). Liv. I, 2. édit. de Bekker, p. 404.
(74) Liv. II, 2. Bekk., n. 413.
(75) De Nat. Deor. I, 13.
(76) Métaph.,liv. XIV, 4.
(77) Brandis, De perditis Aristot., p. 45.
(78) Essai sur la Met., t.1, p. 68.
(79)Varia, VII, 21.
(80) De perdit. Arist., p. 7.
(81)Examen crit., p. 54.
(82) De anima, I, 2. Bekk., p. 404.
(83)Schol. in Arist., p. 642. Sepulv., p. 87.
(84 Schol. in Aristot., p. 855.
(85). Examen crit., p. 66 sqq.
(86) Voyez à la fin du volume, notes, liv. VI.
(87) Samuel Petit, Miscellan., IV, 9.
(88) Essai, t. I, p. 76.
(89) Rapport sur le concours, etc., p. 71.
(90) Examen, etc., p. 216 sqq.
(91) Page 205 sqq.
(92) Métaph., liv. II, 3. Brand., p. 39.
(93) Id , IV, 3, p. 66.
(94)Schol. in Arist., p. 616. Sepulv., p. 64.
(95) In Metaph., III, fol. 17, a, traduction de Jérôme Bagolini.
(96)Scholia in Aristot., p. 520.
(97) Aristoteles, græce, ex recensione Immanuelis Bekkeri, p. 993
(98). Voyez. plus loin.
(99) Essai, t. I, p. 34.
(100)Le passage cité par M. Raviaisson, et avant lui, mais avec des fautes graves, par Sainte-Croix (Magas. encycl., Ve année, p. 367), fait partie de l’introduction d’Asclépius. Schol. in Aristot., p. 519-520.
(101) Schol. in Arist., p. 589.
(102) Recherches sur les anciennes traductions latines d'Aristote. p. 11. — M. Jourdain attribue ce défaut à un dessein prémédité : « Les Arabes pensaient que la première partie du livre premier de la Métaphysique était l'œuvre de Théophraste, et d'après cette idée ils ne l'ont pas traduits. Cette supposition est inadmissible ; c'eût été une véritable folie chez les traducteurs. Commençant à ces mots : « Voici le résultat de ce que nous avons dit, » le livre premier est un non-sens. Évidemment l'omission a été forcée. Voyez plus bas ce que c'était que les traductions arabes d'Aristote.
(103) Essai, t. 1, p. 89.
(104) Synopsis analytica doctrinæ peripateticœ, part. IIe p· 85-86, dans l'édition de 1629.
(105) Rapport, p. 65.
(106) M. Ravaisson, p. 96.
(107) Schol. in Arist., p. 798, et traduction de Sepulvoda, éd. de Venise, p. 279.
(108) Essai, t. 1, p. 101, 102.
(109) On cite une phrase d’Averroès d’après laquelle Nicolas de Damas se flattait d’avoir disposé la science dans un ordre meilleur que ne l’avait fait Aristote : Se exactius hanc tradidisse scientiam quam Aristoteles in quodam suo volumine prœsumpsit. Arist. et Averr. opera, t. VII. In Met., fol. 136, b. Il s’agit là, évidemment, d’un mode d’exposition plus rationnel de la doctrine, et non de l’arrangement des parties de l’ouvrage ; et ce n’est pas la même chose. Nous savons même par Averroès quelle était la manière de Nicolas. Il plaçait chaque question, chaque ἀπόρημα, en tête de chaque solution, et la définition des termes en tête de la question. Id. ibid., fol. 18, a, et 47, b. Nicolas prétendait faire mieux qu’Aristote : son but n’était pas de restituer l’œuvre d’Aristote dans sa forme primitive, mais de lui donner une autre forme.
(110) De Barbaricis Aristotelis versionibus, insérée dans le tome troisième de la Bibliothèque grecque de Fabricius, édit. de Harles, p.. 294, sqq.
(111) Le manuscrit est à la Bibliothèque royale sous le n° 5300.
(112) Jourdain, p. 62 sqq.
(113) IIe siècle après J.-C.
(114) Historiographe de Charles-Quint et précepteur de Philippe II ; un des plus savants hommes du XVIe siècle, excellent critique, écrivain éloquent, auquel il n’a manqué que de vivre dans une époque moins agitée. On a rapproché le nom de Sepulveda de celui de Charpentier ; malgré son fanatisme et ses cruautés, Sepulveda ne méritait pas cette infamie.
(115) Vers le milieu du VIe siècle.
(116) Notes, liv. I, p. 223 de ce volume.
(117) Vers la fin du IVe siècle après J.-C.
(118) Vers la fin du Ve siècle.
(119) Dans la première moitié du Ve siècle, 384-450.
(120) On trouvera dans nos éclaircissements du IIIe livre sub fin., la traduction d'un passage de Syrianus, faite sur le manuscrit même, par M. Michelet de Berlin.
(121) Eus. Kenaudot, De barbaricis Aristol., etc.
(122) Abul Walid Mohammed Ebn Achmet Ebn Mohammed Ebn Rashid
(123) Huet, De clariss interpp., p. m. 186.
(124) Aristotelis opera omnia cum commentariis Averrois, in-fol., t. VII.
(125 Renaudot, De barbaricis Aristot., etc., XlX. — Jean Vives, De causis corrupt. artium, V.
(126) Abu Ali Al Hosain Ebn Sina Al Scuaüch Al Raüs.
(127) Beati Alberti Magni Metaphysicorum libri XIII. Operum tomus tertius. Lugduni 1651. Nous citons rarement le livre d'Albert ; ce n'est pas à dire qu'il ne nous ait été d'aucun secours pour l'intelligence de la doctrine : mais, philologiquement, son autorité n'est absolument d'aucun poids.
(128) Les attaques vigoureuses de Ramus contre la philosophie péripatéticienne l’exposèrent à de violentes persécutions. qui ne firent que le confirmer davantage dans son aversion pour Aristote. Voyez dans le livre de Jean de Launoy, De varia Aristotelis fortuna. in Academia parisiensi, 1653, in-8, p. 102, sqq., le texte de l’arrêt que François Ier porta, en 1553, contre les livres de Ramus Dialecticœ institutiones, et Aristotelicœ animadversiones, sur l’avis de Pierre Danès, de François a Vicomcecato, et de Jean de Salignac, et au nom de la gloire au Seigneur et du saint des fidèles.
(129) Scholæ Metaphisicæ, Paris, 1666.
(130) Du Val a imprimé à la fin de son édition un ouvrage soi-disant d’Aristote, dont l’original grec aurait péri, et que Charpentier aurait traduit de l’arabe en latin. Or, Charpentier ne savait pas le premier mot de la langue arabe. Voici le litre de cette immense et indigeste compilation péripatéticienne : Aristotelis libri VIV de secretiore parte divinæ sapientiœ secundum Aegyptios. Qui illius Metaphysica vere continent ; cum Platonicis magna ex parte convenientia. Opus ex Arabica lingua in Latinam conversum, per Jacobum Carpentarium, Claromontanum Bellovacum.
(131) Lyon, chez Guillaume Lemaire, 1590,2 vol. in-fol.; réimprimée à Genève 1596, à Lyon 1597.
(132) Syllog. Burmannianæ, t.1, p. 368.
(133) Fabricius cite une édition particulière du XVIe siècle, qui porte le même titre que celle de Brandis: Arist. et Theophrasti Μetaphysica. Graece. Francof., 1585. Voyez Bibl. gr., éd. Had., X, III p. 357.
(134 De la Métaph., p. 17,18
.
NOTES.