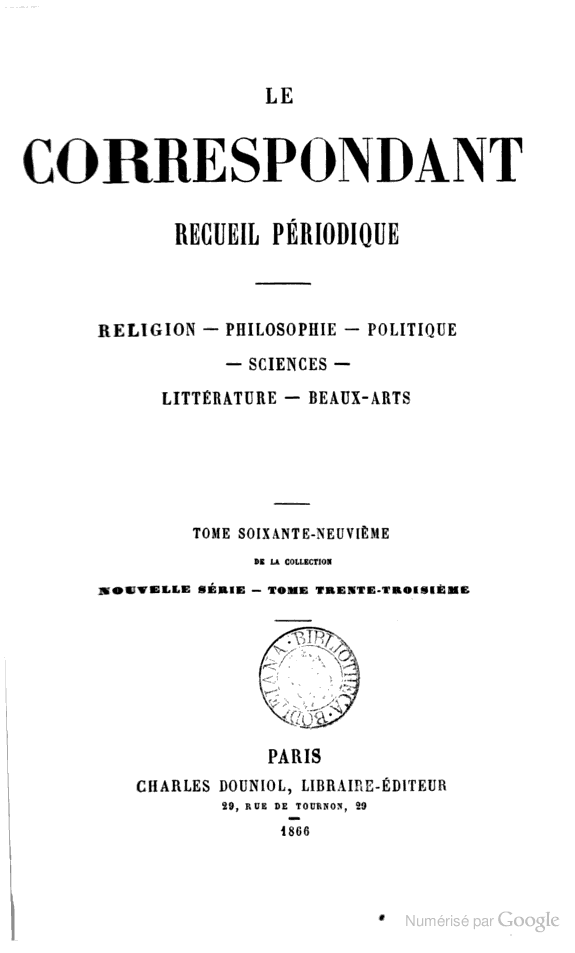
BASILICAS
PREFACE
traduction française de E. Miller.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
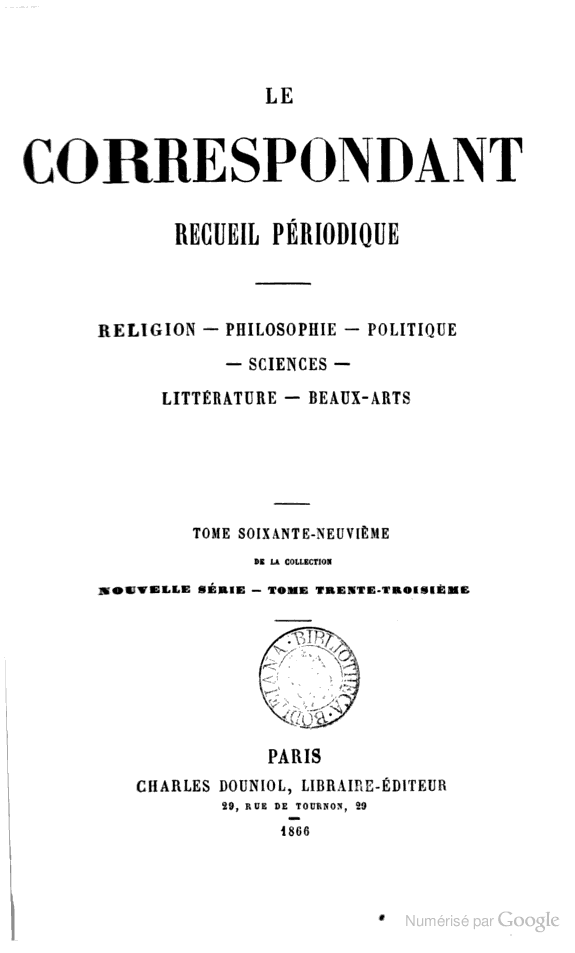
E. Miller.
Extrait du Correspondant (oct. 1866)
Plus je lis, plus je regrette les premières lectures de ma jeunesse, lectures faites trop rapidement et avec une ardeur irréfléchie. Les manuscrits grecs et latins, les premiers surtout, avaient pour moi un charme irrésistible. Rien ne me rebutait : ni les abréviations, ni le sujet, ni l'auteur, ni l'époque, et je dévorais tout ce qui tombait sous ma main. Mais à combien de déceptions n'étais-je pas exposé! La littérature grecque, dans son ensemble, est si étendue, si variée, si inégale ! L'antiquité classique illumine de quelques beaux reflets les œuvres des premiers Pères de l'Église. Saint Basile, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, sont encore les petits-fils de Xénophon et de Démosthène ; c'est ce qu'a si bien prouvé l'illustre auteur du Tableaux de l'éloquence chrétienne au quatrième siècle. Mais après, et plus tard, quel désordre, quelle incohérence, quelle corruption dans les mœurs, dans les esprits, dans le goût, dans la langue ! Tout s'avilit. La dignité humaine disparait. On ne parle plus aux grands qu'avec un encensoir à la main, et l'adulation, revêtant toutes les formes, prend des proportions exagérées. La simplicité est une preuve d'impuissance, et les subtilités sont réputées élégances de style. L'infiltration des idées orientales s'opère peu à peu, et avec elles s'introduit l'abus du langage figuré. Le monde physique envahit le monde moral, et tout devient métaphore. Les mêmes comparaisons, prises dans les grands spectacles de la nature, reviennent à satiété : la mer et l'incessante mobilité de ses ondes, la foudre et ses fureurs, l'aurore et sa rosée bienfaisante, le Nil et la fécondité de ses inondations, le Pactole et son sable d'or. Des mots, des mots et toujours des mots. L'idée est si rare ou tellement noyée qu'elle demeure insaisissable.
Aveuglé par cette vaine fantasmagorie, je passais à côté du fait sans l'apercevoir. Dans mon inexpérience, je négligeais des renseignements qui plus tard eussent trouvé leur application. Quelquefois cependant j'étais récompensé de mes peines, et mes lectures, si rapides qu'elles fussent, n'étaient pas sans profit pour la science. On connaît plusieurs de mes découvertes littéraires ; il en est d'autres sur lesquelles je ne me suis pas encore expliqué. Je les annoncerai en temps et lieu. Ceci prouve tout le parti qu'on peut et qu'on doit tirer d'une élude sérieuse et approfondie des manuscrits. C'est ce qu'avait très bien compris notre célèbre helléniste Boissonade, auquel, à tort suivant moi, on a reproché, je ne dirai pas son goût, mais une espèce de penchant pour les auteurs byzantins. Tout en reconnaissant, tout en déplorant le verbiage et le faux goût qui règnent dans leurs écrits, il savait par expérience qu'ils ne sont pas complètement dépourvus d'intérêt. Un renseignement historique, un trait de mœurs, un détail philologique compense souvent bien des peines et suffit pour justifier l'attention dont ces écrits ont été l'objet.
Et d'ailleurs, avons-nous bien le droit d'être si dédaigneux quand nous nous rappelons ce qu'était l'Occident aux époques dont nous parlons? Pendant que la famille des Comnène et des Ducas cultivait les lettres avec passion et avec plus de succès qu'on ne pouvait en espérer dans des temps si désastreux, nous étions plongés dans l'ignorance et la barbarie. Nos ancêtres, hommes de guerre, allaient, sous prétexte de croisades, ravager les riches provinces de l'Orient et s'emparaient du trône de Byzance. C'est sous le malheureux gouvernement des empereurs latins que les lettres tombèrent dans le plus grand avilissement ; c'est aux troubles qui ont signalé celle époque, qu'on attribue la perle d'un grand nombre d'ouvrages qui existaient encore du temps de Photius. Nicolas Choniatès fait un tableau touchant de la dévastation qu'ont causée à Constantinople les incendies qui accompagnèrent ou suivirent la prise de cette ville par les Francs, et la barbarie des vainqueurs qui, dans leur grossière ignorance, croyaient ne pouvoir mieux exprimer leur mépris pour les Grecs qu'en les appelant des faiseurs de livres et des savants. Les richesses littéraires, accumulées par les Ducas et les Comnène, furent détruites par les soldats de la croix, qui se promenèrent dans les rues portant des manuscrits sur leurs piques.[1]
Soyons donc plus indulgents pour les littérateurs byzantins, quelque faible d'ailleurs que soit leur mérite; car c'est à leur zèle que nous devons la conservation des chefs-d'œuvre de l'antiquité que sans eux nous ne connaîtrions pas. Remercions également les savants modernes qui, à l'exemple de Boissonade, ne craignant pas de consacrer leurs loisirs à l'élude de ces époques dégénérées, nous fournissent des matériaux précieux pour une histoire littéraire de la Grèce pendant le moyen âge.
Cette histoire est encore à faire. Une œuvre de ce genre ne pourra être entreprise avec succès et d'une manière complète que lorsqu'on aura publié tous les ouvrages composés avant la prise de Constantinople, et dont un grand nombre, par suite d'un injuste dédain, dorment encore dans la poussière des bibliothèques, en attendant qu'ils deviennent la proie des vers. L'histoire des décadences, qu'il s'agisse des empires ou des littératures, comporte aussi ses enseignements, et il n'est pas rare de trouver de l'intérêt dans la lecture de certains auteurs qu'un éclectisme trop absolu semble avoir condamnés à un oubli perpétuel.
En voici un par exemple qui nous raconte lui-même sa vie littéraire et qui nous parle des principaux ouvrages qu'il avait composés. A l'en croire, il a abordé tous les genres, et toujours avec le même succès. Éloquence, goût, érudition, il possédait tout à un degré supérieur. On n'est pas plus naïf, plus intrépide dans sa propre glorification. Nous devons sans doute rabattre beaucoup des éloges qu'il se donne avec tant de complaisance. Mais il faut avouer qu'il ne manque pas d'un certain mérite, et que même, sauf de légers défauts tenant à des finesses de langue mal comprises, il écrit d'une manière assez élégante. C'est là un des mérites des rhéteurs de la cour de Constantinople pendant le moyen âge. Ils composaient avec une certaine habileté des pastiches de l'ancienne langue attique, mais ils cachaient mal le vide des idées sous une déclamation de mauvais goût et pleine d'hyperboles.
Notre écrivain se nomme Nicéphore Basilacas. Il est auteur d'un petit nombre de fables et de quelques éthopées ou exercices oratoires écrits avec pureté. Peu connu du reste, il n'a point d'article dans les recueils biographiques; Fabricius et Léon Allatius ne lui ont consacré que quelques lignes.
Ce Basilacas était professeur de rhétorique sous Alexis Comnène, et s'acquit par ses ouvrages une assez grande réputation. Comme tous les savants de l'époque il voulut prendre part aux discussions religieuses; il composa même un Commentaire sur les épîtres de saint Paul, commentaire dont Nicétas Choniatès paraissait faire grand cas. Sur la fin de sa vie plusieurs de ses amis le prièrent de former un recueil de ses écrits. Dans l'intention de leur être agréable, il réunit tout ce qu'il put trouver de ses anciennes compositions, et il plaça en télé une espèce de préface ou d'avant-propos. Cette préface est une pièce curieuse et intéressante, parce qu'elle peut être considérée comme une autobiographie littéraire de l'auteur.
Écoutons son début :
Faites peu de livres, disait Salomon ; c'est un travail incessant ; la continuelle méditation de l'esprit afflige et use le corps. C'est vouloir remplir le tonneau des Danaïdes, ou naviguer sur une mer immense, exposé à tous les orages sans jamais arriver au port. S'épuiser de lassitude pour une chose inutile est la preuve d'une grande sottise. Ce sont les fatigues et les soucis littéraires qui ont occasionné une inflammation du sang à Chéréphon, ce philosophe athénien, ami de Socrate et que les poètes comiques poursuivaient de leurs sarcasmes en l'appelant l'homme à la couleur jaune.
Basilacas continue sur ce ton, puis il fait intervenir l'éloquent Platon, le partisan de Socrate qui n'a rien écrit, et il invoque le témoignage de Marc Aurèle s'écriant :
Évitez la soif des livres, si vous ne voulez pas ressembler à ces jeunes débauchés qui boivent incessamment sans jamais pouvoir se désaltérer. Je savais tout cela, ajoute-t-il. Et comment pouvait-il en être autrement? Moi, qui dès ma plus tendre enfance ai été élevé dans l'élude des belles-lettres, qui ai toujours puisé à la source de l'antiquité comme à une fontaine divine, et qui même n'ai pas dédaigné de sacrifier aux muses modernes. J'admirais ces hommes habiles qui nous ont donné de si bons conseils et qui nous ont dit la vérité sur les choses humaines. Toutefois, je pensais qu'il n'était pas séant de se promener sur l'Hélicon sans cueillir quelques-unes des fleurs suaves qu'on y rencontre, et qu'il fallait, à l'imitation des abeilles, en composer un miel aromatique, je veux dire des ouvrages inspirés par les muses. C'est ce que j'ai fait dans l'intention d'être agréable au public et aux empereurs. Ceux-ci ont accueilli mes productions comme des péans et des odes en l'honneur de leurs victoires; présent modeste, il est vrai, mais digne de ceux auxquels il était offert. Quant au public, par les éloges qu'il m’a donnés, il a encouragé mon ardeur au travail, et j'ai l'espérance d'avoir mérité l'admiration de mes contemporains. Ceux qui aiment les talents et les bons ouvrages ont pu profiter de mes écrits, où on trouve à récolter comme dans un jardin productif et bien cultivé. Chez les autres, épris de l'amour du bien et de la vertu, j'ai fait pénétrer la lumière des Saintes Écritures que j'étudie depuis longtemps, lumière qui dévoile les mystères du Saint-Esprit.
Telles étaient les occupations auxquelles je me livrais de préférence, en ayant soin de meubler ma tête d'une instruction solide et variée.
Après les exercices de la grammaire que je regarde comme un très bon commencement et comme le principe des autres connaissances, je me mis à étudier d'une manière approfondie cette science ordinairement pleine d'attrait pour la jeunesse, je veux dire la rhétorique, l'art des sophistes, ou, pour l'appeler par son nom, l’art dupeur. Les finesses de Mercure charmaient mon âme, et lorsque je parlais au public, j'attirais par mes discours une foule de jeunes gens. Toutefois je ne suivais pas l'ancienne méthode, j'évitais les labyrinthes et les obscurités de langage, comme une mode surannée et entachée d'archaïsme, par conséquent sans grâces et sans charme; c'était à mes yeux comme une langue barbare. J'avais adopté une manière de parler qui, sous le rapport du fond et de la forme, ne laissait rien à désirer. Aussi ai-je acquis une grande réputation d'orateur, malgré les efforts et les intrigues d'une certaine coterie composée d'hommes sans goût, et qui étaient dévorés de jalousie en voyant les effets de mon éloquence et de ma bonne méthode. Peu s'en est fallu que toute la jeunesse, je parle de celle qui est heureusement douée sous le rapport de l'esprit et de l'intelligence, n'adoptât ma manière, de préférence à celle des anciens. Aussi partout aujourd'hui se sert-on du terme βασιλακᾶν, écrire à la manière de Basilacas, comme autrefois on disait γοργιάζειν, dans le sens d'imiter le rhéteur Gorgias.
Ainsi donc grande jalousie contre moi parmi les partisans des anciens, parmi ceux qui, aveuglés par leur sottise, sont ennemis déclarés des grâces. Aussi leurs compositions sont-elles ridicules et pleines de solécismes, bien qu'ils professent la grammaire qui est l'art de parler et d'écrire correctement. Quand ils cherchent l'exactitude, ils font preuve d'ignorance; s'ils sont graves, c'est avec bassesse, et s'ils veulent être sublimes, ils tombent dans la trivialité. Ils ont inventé le terme βασιλακισμος, comme on disait autrefois φιλιππισμός, attachement au parti de Philippe, et cela pour se moquer de mes imitateurs.
Après m'être occupé de la prose, qui est si difficile, j'ai tourné mes regards vers la poésie. Je devins alors très abondant et ma langue coulait comme un fleuve. Et qu'on ne croie pas que je suis ici le jouet de la vanité ou d'un sot orgueil. Le témoignage public est là pour dire que ma réputation n'a pu être flétrie par l'envie, qui cependant s'était tant acharnée après moi. Dans mon ardeur pour la poésie, je ne me suis pas borné à faire des trimètres, genre monotone, qui ne comporte que des vers non rimés et d'un usage si commun aujourd'hui. Composer des ïambes est une bagatelle, aussi ai-je voulu m'exercer à faire des trochées, genre de vers que j'ai perfectionné, indépendamment des autres mètres, dont la variété réjouit en même temps qu'elle élève l'esprit. Ayant remarqué que la jeunesse aime à rire et se laisse facilement entraîner par les plaisanteries et les jeux, j'ai fait aussi des comédies, où je maniais le style comique avec d'autant plus d'à propos que tout ce qui se faisait alors prêtait beaucoup à rire.
Basilacas nous donne ensuite le titre des quatre pièces comiques qu'il avait composées, ce sont :
1° 'Ονοθρίαμβος, Le triomphe de l’âne ;
2° Στύπαξ ῆ Παραδεισοπλάστα, Le marchand d'étoupes ou la formation du paradis;
3° Στεφανῖται, Les vainqueurs couronnés;
4° 'Οταλαντοῦχος 'Ερμῆς, Mercure porte-balance.
Malheureusement, notre poète ne nous donne aucun détail sur ces compositions, dont par conséquent nous ne pouvons avoir aucune idée, puisqu'elles sont perdues aujourd'hui. Perte très regrettable, parce que nous ne possédons rien en ce genre datant de l'époque byzantine. Il est certain toutefois que les pièces en question n'étaient pas de nature à être représentées. Les Grecs du moyen âge transcrivaient Aristophane, Eschyle, Euripide et Sophocle, mais ils n'auraient jamais essayé de faire une comédie ou une tragédie. Une pareille composition eût été blâmée comme une entreprise impie et dangereuse.
J'ai fait encore, dit-il, d'autres poésies, sans observer strictement les règles de la versification; j'en ai composées aussi de légères où je n'ai suivi aucun système de philosophie ou de philologie; presque toutes sont anonymes, comme celle qui est intitulée : Les Sporades célestes.
Ainsi, alors que je n'avais pas encore de poil au menton, je me livrais au genre comique et plaisant, et je cherchais par tous les moyens possibles à noyer dans mon verre la tristesse et les chagrins. Ces poésies sont encore aujourd'hui fixées dans ma mémoire.
Basilacas raconte ensuite comment, ayant bu aux sources de la divine sagesse, il a eu honte de ces frivoles occupations et a livré au feu toutes ces compositions légères, afin de ne pas devenir lui-même la proie des flammes de l'enfer.
Telle est mon histoire, ajoute-t-il, histoire connue de bien des gens qui n'ont pas loué mon zèle et la courageuse résolution que j'avais prise. Et cependant, plusieurs de mes ouvrages, véritables inspirations delà muse attique, étaient remplis de grâce, d'érudition et de pensées sublimes. Des quatre pièces citées plus haut, et qui avaient une grande étendue, il ne reste plus rien aujourd'hui. Il en est de même de mes écrits satiriques, dont quelques fragments seulement ont été conservés dans la mémoire de mes contemporains. Quant à mes autres poésies, elles sont en diverses mains qui ne veulent pas les lâcher. Aussi, dans ce recueil, n'ai-je pu insérer rien ou presque rien en vers ; c'est comme un verre d'eau par rapport à la mer.
Que si je veux parler de mon commerce épistolaire, il a été peu étendu, si ce n'est avec mon oncle maternel. En sa qualité de haut fonctionnaire de l'empire, il avait beaucoup d'amis et de très nombreuses relations. Quant à moi, je n'ai écrit qu'un petit nombre de lettres, peu visité que j'étais par le Mercure de l'opulence et par celui de l'amitié. Je suis un philosophe, je ne fréquente point les palais des grands, et je ne suis pas un courtisan. Jeté jeune dans le tourbillon de la vie et des affaires, j'étais très timide ; je ne m'exagérais pas l'importance de mes ouvrages, et je n'étais pas, comme les singes, aveuglé par les illusions admiratives de la paternité.
Notons ici en passant une certaine allure de modestie, allure à laquelle l'auteur ne nous a pas habitués. Mais reprenant bien vite son ton ordinaire.
J'attendais, continue-t-il, l'arrivée de l'âge mûr et des circonstances meilleures, afin de pouvoir montrer à propos la fécondité de mes talents. Je n'étais pas comme ces auteurs dépourvus de sens qui courent les spectacles et les lieux publics pour lire leurs ouvrages et se faire admirer. Mais, conformément au titre de professeur que je portais, j'étudiais, j'analysais les discours des orateurs anciens, et mes occupations étaient conformes à mes fonctions. Aussi me restait-il peu de temps pour mes travaux particuliers que je négligeais ; je n'en relirais nul honneur. Comme j'avais l'habitude de me servir de papier lin, il arrivait souvent que mes compositions s'effaçaient et devenaient illisibles ; quelques-unes même ont été détruites complètement. D'autres ont été prêtées à des amis qui ne me les ont pas rendues. Autant de raisons qui expliquent pourquoi je n'ai pu réunir qu'une faible partie de mes écrits, celui-ci d'un côté, celui-là d'un autre ; ce n'est qu'avec de très grandes difficultés que je suis parvenu à en former un volume. Et si j'ai pris cette peine, c'était pour répondre au désir de quelques amis qui m'en avaient prié. Mon âge avancé n'était pas à leurs yeux un prétexte suffisant pour me dispenser de ce travail. Les Thersites, diraient-ils, n'oseraient pas se moquer d'Achille, lors même que ce dernier, parvenu à la vieillesse, parlerait comme un enfant sur l'art de la guerre.
Indépendamment du professorat que j'ai exercé pendant assez longtemps, je me suis adonné aux études théologiques. Sans avoir été (je conserve l'expression de l'auteur), sans avoir été un des rossignols de la théologie, j'ai composé quelques ouvrages qui ont rapport à cette science, et qui ne sont pas dépourvus de mérite. Je dois en rendre compte au lecteur tout en lui disant la suite de mon histoire.
Entouré d'envieux et d'ennemis, j'ai été obligé, pour me défendre, de devenir orateur. Je cultivai l'éloquence avec le plus grand succès. Je faisais des discours magnifiques, et la foule se pressait pour m'entendre. Le barreau était plein et le chef de l'Église entrait en courroux contre moi, semblable à Critias ou à Hippias, qui craignaient une insurrection en voyant les Athéniens accourir pour entendre les harangues des orateurs. La longueur de mes discours indignait ce prélat, parce que, malgré son violent appétit, il était obligé d'attendre que j'eusse terminé, pour aller prendre ses repas. Quelquefois aussi je fulminais contre la scélératesse des hommes et je me livrais à des réflexions morales semblables à celles qu'on trouve dans l'Écriture Sainte ; alors cet homme se fâchait parce qu'il croyait voir des allusions dans ce que je disais. Un jour, faisant une conférence sur saint Paul, je discutais celte parole de l'Apôtre à Timothée : « En toute chose apportez une grande attention, quand vous pratiquez les mystères de l'Église. » Je vis alors notre homme s'agiter, froncer les sourcils et contenir mal son indignation. Les louanges que je donnais à saint Paul lui semblaient sa propre condamnation, et il prétendait que les textes sacrés étaient flétris par mes discours. A la fin, il crut devoir me donner un livre contenant un commentaire sur les épîtres de saint Paul, livre tout au plus digne d'être offert à une femme dépourvue d'esprit et d'érudition. Il me rappelait ce philosophe de l'antiquité, Carnéade l'Athénien, qui disait toujours des paroles flatteuses et agréables à une femme galante, à une reine, je veux dire Cléopâtre.
Ainsi, le chef de l'Église n'a pas craint de me traiter comme une femme. Il m'a donné cet abrégé dans l'espérance que j'y trouverais la grande théologie des apôtres. J'avais ordre de m'y conformer, et il ne m'était pas permis de faire le moindre changement aux paroles qui étaient contenues dans ce livre, comme si j'étais un enfant fréquentant encore les bancs de l'école. C'est ainsi que par ses vexations il espérait éteindre mon zèle et affaiblir sensiblement ma puissance de parole. Mais, en véritable orateur que j'étais, je ne me laissais pas décourager : j'aurais craint de passer pour un sot. Je n'ai donc tenu aucun compte de ses recommandations et j'ai adopté une méthode inconnue à la plupart des savants. Je n'écrivis plus que les ébauches de mes discours et je m'abandonnai aux élans de mon éloquence. Mais une ébauche ressemble à un ruisseau qui se perd, et il est difficile de la conserver par l'écriture ou dans la mémoire.
Telle est l'histoire de mes ouvrages. Je dois maintenant parler de leur style et des idées qu'ils renfermaient. En général, mes discours sont éloquents et dignes d'être applaudis, mais ils n'affectent point une trop grande pompe et ne fatiguent point par le fracas des mots. Dans la plupart, la construction est très simple ; les expressions claires et faciles à comprendre. J'ai évité autant que possible le langage trivial qui est le propre des ignorants ; car les mots usités dans les carrefours dénotent une grande inexpérience chez celui qui les emploie. Malgré la clarté qui règne dans mes compositions oratoires, elles ne manquent ni de grandeur ni d'élévation ; on y trouve même des passages qui rappellent la déclamation et la majesté des pièces de théâtre.
On sent aussi dans mes déclamations une odeur suave s'exhalant des fleurs que j'ai cueillies dans les prairies de la littérature. Mon style, nourri de tropes, réunit la force à la douceur. J'ai en horreur les plagiats et les compilations ; car il faut toujours qu'il y ait rapport entre les mots et les choses. Dans les matières que je traite, j'évite les ornements anciens qui me paraissent comporter une vanité superflue et sans aucun rapport avec les affaires actuelles. Souvent la recherche dans les mots et dans le style cache le vide des idées ; ce n'est qu'un vain bruit, plus ou moins agréable et propre à chatouiller l'oreille, mais rendant mal la pensée de l'auteur. Ces expressions, alors, ne sont pas d'accord avec les idées; il y a embarras, lenteur dans la marche de la phrase; c'est, comme dit le proverbe, le char qui traîne le cheval.
Quant aux figures dont je fais usage, elles ont de l'originalité, mais j’évite, comme inutiles, les néologismes et un trop grand atticisme. Ce que je cherche surtout, c'est à être élégant et agréable. J'ai toujours aimé les périodes sonores, pompeuses, les phrases rimées, et en général tout ce qui est un véritable ornement pour le style ; mais j'y ai mis beaucoup de goût et de discernement, m'attachant à dissimuler ces effets et à ne les produire que d'une manière tout à fait naturelle et comme par hasard. J'aurais craint de paraître trop brillant et d'avoir trop travaillé mes discours. Si je cite des histoires et des proverbes, c'est avec mesure et discrétion ; prodiguer ce genre d'ornements, c'est jeter de l'obscurité dans un ouvrage, c'est vouloir renoncer à la réputation d'habile ouvrier et de maître consommé dans son art. Sans doute cette méthode attire le lecteur par le charme de l'érudition, mais elle devient vicieuse si elle tombe dans l'abus.
Tantôt je touche à la philosophie morale et j'émets des idées tellement sublimes, que je parais m'élever jusqu'aux astres. Tantôt je m’adresse du Créateur de l'univers, pour l'admirer et chanter ses louanges. Les passages auxquels je fais ici allusion sont remplis d'éloquence et d’élévation.
Telles sont les richesses que l'on trouve dans mes discours qui sont de différents genres. Celui que j'ai composé pour le nomophylaque, ὁ ἐπὶ τῷ νομοφύλακι, pourrait mieux s'intituler le Sophiste. Il surprend l'imagination et la charme par son chant, comme les oiseaux par leur délicieux gazouillement ; il vole plutôt qu'il ne marche. Le second discours sur le même sujet est plus vigoureux de style et de pensées. Quant au troisième, c'est un coursier noble et fougueux qui court à travers champs et dépasse tous ses rivaux. Métaphore d'une grande justesse, car on y reconnaît la nature et l'étendue du terrain, et on le voit toujours debout et victorieux dans sa marche. Il est aussi très harmonieux et riche d'élocution; il n'emploie que des mots choisis et ne cesse de semer des fleurs sur l'empereur qui, après avoir vaincu les barbares, est rentré en triomphateur.
Le discours suivant est également consacré à l'empereur et aux victoires qu'il a remportées. Mais il est comme un fils par rapport à sa mère, si on le compare au précédent qui est le discours capital, en raison des louanges que je donne à notre monarque. Je l'ai composé pour un homme encore novice dans l'art oratoire, et j'ai dû le proportionner à ses forces.
La déclamation pour Muzalon a été faite pour un jeune homme qui suivait encore les leçons de son maître. Retranchez quelques fictions agréables sous lesquelles se cachent l'art et les ruses du sophiste, fictions que j'y ai semées exprès pour dissimuler les plagiats de ce jeune homme, et afin de faire croire qu'il avait composé lui- même cet ouvrage, en rapport avec son âge et son savoir, faites ces retranchements et vous trouverez que cette composition, qui ressemble à une flûte jouée par un commençant, est très éloquente et écrite avec art.
Le discours pour le grand domestique montre aussi beaucoup de science. Il évite le néologisme et la phraséologie, sans tomber dans la fadeur et sans être dur à l'oreille. J'en dirai autant d'un autre genre d ouvrage, de mes Monades, et surtout du dernier de malheureuse mémoire, car je l'ai composé dans un âge mûr, et le sujet en a été pour moi l'objet d'une longue méditation.
Parmi mes écrits politiques, le meilleur, pour les idées, les paroles et pour l'exactitude, est celui qui est intitulé Déclamation sur Bagoas. En l'écrivant j'ai été débarrassé des maux qui accablaient ma tête.
Quant aux pensées que j'ai exprimées dans la Monade sophistique, elles n'ont pas la même force et ne montrent point autant d'art que celles des autres Monades. Car cet écrit n'est point de la même époque que les discours composés sur les choses sacrées. Ces derniers, plus riches de science et d'érudition doivent être séparés de la Monade sophistique qui leur est inférieure. Je les ai écrits avec un soin tout particulier, dans l'espérance qu'ils resteraient comme des modèles, d'après lesquels on pourrait juger la valeur et la beauté de mes discours intitulés : Epexégématiques.
Un autre de mes livres porte pour titre : Celui qui parle correctement. Moins considérable que le précédent, il est riche d'érudition, d'éloquence et de persuasion. Évitant le mensonge et les sophismes, il puise à la source intarissable de nos ancêtres, les anciens.
Un dernier renseignement. Je suis encore auteur de plusieurs commentaires importants que j'avais également puisés dans les ouvrages des anciens. Mais je crains bien qu'ils ne soient perdus, par suite de la négligence de la personne chez laquelle je les avais déposés.
Comme on le voit, le tableau est complet. Rien n'y manque. C'est au point, si Michel Psellus et Tzetzès ne nous fournissaient des exemples analogues, c'est au point qu'on serait tenté de croire que l'auteur ne parle pas sérieusement et qu'il a voulu faire une plaisanterie, un jeu d'esprit. A toutes les époques, dans tous les pays, l'amour-propre et la vanité de certains écrivains se sont manifestés avec une grande transparence. Quelques-uns même, ayant la conscience de leur génie, ont pu, dans un élan d'enthousiasme poétique, s'écrier comme Horace : Exegi monumentum. Mais on n'en a jamais vu qui, épuisant à leur profit le vocabulaire des formules laudatives, aient poussé plus loin la manie de la glorification personnelle.
Chose singulière ! aucun des ouvrages mentionnés ici par Nicéphore Basilacas n'a été conservé, à l'exception d'un des discours sur l'empereur, et il ne dit pas un mot des opuscules que nous possédons sous son nom. Quoi qu'il en soit, cette petite pièce inédite, dont j'ai essayé de reproduire, sans l'exagérer, l'exacte physionomie, est intéressante à plus d'un point de vue. Elle nous offre un curieux spécimen de la naïveté et, disons le mot, de la sottise byzantine, et on y trouve un nouveau chapitre pour l'histoire littéraire des Grecs au moyen âge. Elle nous fournit de plus l'occasion de regretter que l'antiquité ne nous ait pas laissé un plus grand nombre d'ouvrages de ce genre. Les détails que Xénophon, César, Marc Aurèle, Libanius et Lucien nous donnent sur eux-mêmes ne sont pas de nature à diminuer ces regrets. De quel prix serait pour nous l'autobiographie littéraire d'écrivains tels qu'Aristophane, Ménandre, Platon, Aristote ou Plutarque!