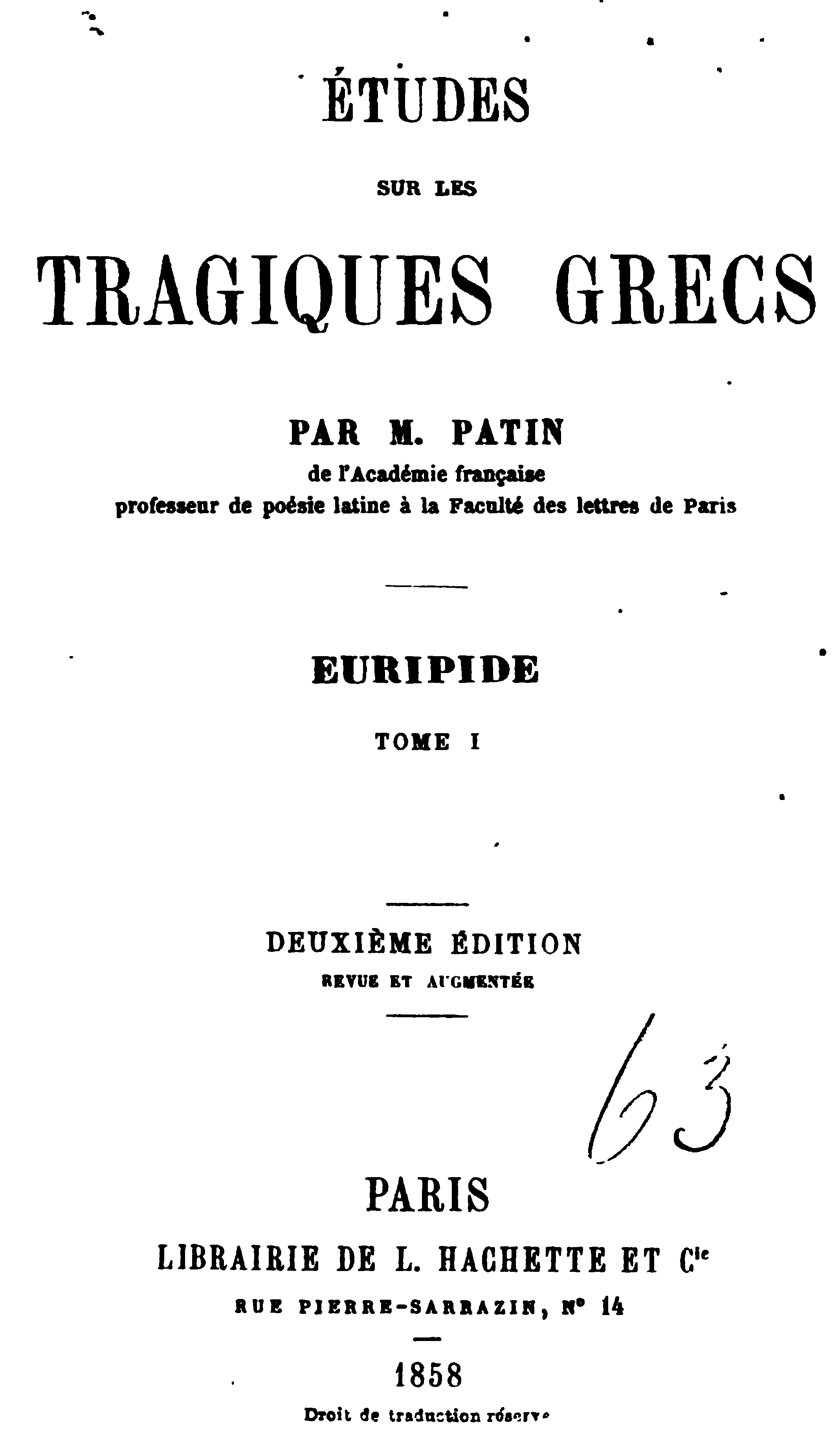
M. PATIN
ÉTUDES SUR LES TRAGIQUES GRECS
EURIPIDE. Tome I
CHAP. VI. ALCESTE
197 CHAPITRE SIXIÈME.
Alceste.
On a dit que Socrate, en ramenant la philosophie des spéculations de la métaphysique aux applications de la morale, l'avait fait descendre sur la terre. Ne pourrait-on pas dire d'Euripide qu'il a, dans le même temps, achevé pour la tragédie une révolution semblable, en dégageant des voiles mythologiques, qui l'enveloppaient, l'expression vivante de l'humanité ? Cette vérité de nature, qui nous a paru se produire en traits si naïfs et si animés, au sein des fables de son Iphigénie en Aulide, de son Hippolyte, de sa Médée, nous paraîtra peut-être plus frappante encore dans le sujet encore plus merveilleux dont il a emprunté son Alceste.
La femme d'Admète, qui meurt en sa place et, le sacrifice accompli, est arrachée par Hercule du séjour infernal et rendue à son époux, voilà ce que le poète a trouvé dans la tradition religieuse (1). La peinture des affections domestiques les plus tendres, les plus vives, voilà ce qu'il a tiré de ce fond fabuleux. Rien de plus étrange que l'évé- 198 nement du drame ; rien de plus naturel que les sentiments et le langage. L'action prête aux mœurs de la dignité et de l'éclat, et en reçoit à son tour de la vraisemblance. Mélange heureux, qui en ravissant l'imagination vers ces temps antiques, dans lesquels on se figure que les hommes avaient commerce avec lés dieux charme le cœur par l'image toujours contemporaine de la passion !
Avant de nous introduire dans la partie pathétique de son sujet, le poète nous en développe la partie merveilleuse par une scène d'une invention originale, d'un effet piquant, où l'on ne peut guère reprendre que quelques-uns de ces vers de prologue, si souvent et si justement reprochés à ses expositions (2).
Nous voyons sortir de la maison d'Admète Apollon > qui autrefois, dans le temps de son exil sur la terre, y a trouvé un asile, qui depuis en est devenu comme l'hôte et l'ami. Il se retire pour ne point être témoin du trépas d'Alceste dont le dernier moment approche. Nous savons déjà par un passage de l'Hippolyte (3) que les dieux du ciel ne pouvaient, sans une sorte de profanation, assister à ses spectacles funèbres.
Sur le seuil du palais, Apollon
rencontre le Génie de la mort (4)
qui vient chercher Alceste et d'abord la consacrer aux
puissances infernales en coupant, avec le glaive dont
199 il est armé, l'extrémité de ses
cheveux. Cette circonstance, non plus, ne paraîtra pas nouvelle
à ceux qui se souviennent 200 que, dans l'Énéide
(5), Iris remplit auprès de Didon mourante le
même ministère.
Un débat s'engage entre les deux divinités. Le Génie de la mort
reproche à Apollon de lui avoir dérobé la vie d'Admète par
l'échange auquel se sont prêtées les Parques. Il craint que ce
dieu ne veuille aussi le frustrer de la nouvelle proie qui lui
est promise. Apollon cherche en vain à lui persuader, ou de
détourner ses coups sur les vieux parents d'Admète, ou de
permettre à Alceste de vieillir. Le ministre des enfers demeure
inflexible : la% jeunesse de la victime ajoutera, dit-il, à sa
gloire. Apollon le quitte indigné et lui annonce, sans en être
cru, qu'Alceste trouvera bientôt un libérateur. Bien qu'il ne
le nomme pas, il le désigne assez clairement pour qu'on puisse
reconnaître Hercule. Ainsi est en partie soulevé par le poète le
voile qui cache le dénouement. Ici, comme partout dans le théâtre
grec, la curiosité, distraite de l'événement lui-même, se porte
sur la manière dont il doit s'accomplir, sur les situations qui
en doivent naître.
La scène, restée vide, est bientôt occupée par une troupe de vieillards de la ville de Phères, en Thessalie, dans laquelle se passe l'action. Ils viennent, pleins d'inquiétude, s'informer du sort de leur reine, dont ils admirent et déplorent le dévouement. La solitude et le silence du palais, où ils ne voient ni n'entendent ce qui d'ordinaire accompagne les funérailles, leur persuadent qu'elle vit encore. Ils adressent pour elle aux dieux, et surtout à Apollon, sauveur d'Admète, les vœux les plus ardents. Les discours d'une foule émue par l'attente d'une grande calamité, ses alternatives d'espérance et de désespoir, ses doutes, ses conjectures, son impatiente et douloureuse curiosité, tout cela est rendu avec infiniment d'art dans des strophes distribuées, selon le scoliaste, entre deux demi-chœurs ; selon d'autres (6), entre les personnages mêmes dont ils se com- 201 posent, et qui à la marche véhémente de l'ode unissent les mouvements confus du dialogue.
Une esclave sort du palais, tout en larmes : on l'interroge avec empressement; elle raconte les tristes apprêts de la mort d'Alceste. Ce récit offre de nombreuses ressemblances avec ceux où Sophocle a raconté la mort de Déjanire (7) et de Jocaste (8), et peut-être est-ce de tous trois que s'est inspiré Virgile, lorsqu'il a retracé les derniers moments de Didon (9). C'est, du reste, un véritable chef-d'œuvre de naturel et de pathétique ; on ne peut le louer qu'en le citant.
« Dès qu'Alceste a senti rapproche du moment fatal, elle a baigné son beau corps dans l'eau pure du fleuve, et, tirant de ses coffres de cèdre ses riches vêtements, elle s'en est parée. Puis se tenant devant son foyer, en présence de Vesta (10) : « Ô a déesse, a-t-elle dit, ô ma souveraine, prête à descendre vers les sombres demeures, je me prosterne pour la dernière fois à tes pieds. Tiens lieu de mère à mes enfants. Donne à l'un une épouse qu'il aime, à l'autre un époux digne d'elle, Qu'ils ne meurent point, comme leur mère, d'une mort prématurée, mais que, plus heureux, au sein de leur terre natale, ils remplissent toute la mesure de leurs jours. » Ensuite elle s'est approchée de chacun des autels qui sont dans le palais d'Admète, et, en priant, elle les couronnait de verdure, elle les parfumait de feuilles de myrte, sans pleurer, sans gémir, sans que la pensée de son malheur altérât en rien le doux éclat de son visage. Mais lorsque, entrée dans sa chambre, elle s'est jetée sur son lit, alors elle a versé des larmes, et s'est écriée : « Ô toi, où fut dénouée ma ceinture virginale par l'homme pour qui je meurs, couche nuptiale, adieu ! je ne puis te haïr, quoique tu m'aies perdue. C'est pour ne point te trahir, pour ne point trahir mon époux, que je meurs. Peut-être une autre femme te possédera-t-elle, non pas plus chaste, mais plus heureuse. » Et elle la tenait embrassée, et elle l'arrosait des torrents qui coulaient de ses yeux. Enfin, lorsqu'elle s'est rassasiée de larmes, elle quitte la chambre et bientôt y rentre, elle en sort et y revient sans cesse, et se pré- 202 cipite cent fois sur sa couche. Cependant ses enfants s'attachaient à ses habits, et pleuraient; elle les prenait dans ses bras, les baisait tour à tour, comme devant bientôt mourir. Tous les esclaves erraient çà et là dans le palais, gémissant sur la destinée de leur maîtresse; elle leur tendait la main à tous, et il n'en est pas de si misérable à qui elle n'ait parlé, dentelle n'ait reçu les adieux (11). »
Cette dernière circonstance doit être remarquée, après tant d'autres, également simples et touchantes, comme un trait de caractère. C'est avec une complaisance bien naturelle que l'esclave chargée de ce récit s'arrête sur la bonté familière qu'a montrée Alceste, en prenant congé de ses serviteurs. Le poète, à l'exemple de l'héroïne, ne néglige aucun des personnages du drame : les plus subalternes, nous aurons d'autres occasions de nous en convaincre, attirent son attention, et reçoivent de son art curieux une forme, irne expression qui tes distinguent.
J'ai loué, dans les deux ouvrages d'Euripide dont j'ai précédemment parlé, l'habile gradation par laquelle il prépare l'entrée de sa Phèdre et de sa Médée. Je retrouve ici, avec d'autres détails et un autre effet, une disposition toute semblable. Nous avons été d'abord intéressés au sort d'Alceste par le débat qu'il suscite entre deux divinités, par l'inquiétude où il jette tout un peuple. Ensuite, nous nous sommes émus au récit des scènes de deuil dont la fin prochaine de cette princesse malheureuse a rempli sa maison. Assez longtemps elle a occupé notre imagination, elle va désormais se montrer elle-même à nos yeux, et sa seule vue, attendue et désirée , portera au comble l'attendrissement.
Qui l'amènera sur la scène, elle qu'on nous a représentée déjà mourante, sans foroe, sans haleine, tout près d'expirer (12) ? le désir de voir une fois encore la lumière du jour, cette lumière vers laquelle tous les héros de la 203 scène grecque tournent avec tant d'amour et de regret leurs derniers regards (13).
Elle paraît, accompagnée de ses enfants éplorés, entre les bras de son époux éperdu, qui la soutient et la guide. Le mètre ordinaire du dialogue, le mètre ïambique, est remplacé, pour quelques moments, par une mesure lyrique qui se prête mieux au désordre de ses premières paroles, et exprime merveilleusement la défaillance du corps et le trouble de l'esprit. Ce sont de touchantes apostrophes à cette nature visible qui déjà fuit et s'efface, à cette maison d'où elle vient de sortir pour n'y plus rentrer , à sa patrie depuis longtemps quittée et présente encore à sa mémoire dans ce dernier moment ; puis, à travers les nuages dont s'obscurcissent par degrés sa vue et sa pensée, les confuses et lointaines images de ce monde inconnu où elle se sent entraîner. C'est là que se rencontrent les beaux vers (14) qu'une ridicule méprise, une impertinente critique de Perrault, donnèrent à Racine l'occasion de traduire (15)..
Je vois déjà la rame et la barque fatale ; J'entends le vieux nocher sur la rive infernale : Impatient, il crie : On t'attend ici-bas ; Tout est prêt, descends, viens, ne me retarde pas.
Cependant Admète serre contre son sein cette épouse qui lui échappe, comme l'a dit l'orateur (16), parmi de si tendres embrassements. Il ne peut croire au malheur qui le menace et qui est déjà à moitié accompli ; s'attachant à une espérance insensée, il conjure Alceste de faire effort pour vivre (17), et semble vouloir lui-même la ranimer à force d'amour.
204 Alceste ne partage point ces illusions de la douleur en délire. Une dernière pensée dont le poète dans cette scène et dans les précédentes l'a plus d'une fois montrée préoccupée, une pensée qui survit à toutes les autres au cœur d'une mère, la soutient encore et seule retarde l'instant fatal. Recueillant ses forces épuisées, rappelant ses esprits qui s'égarent, elle adresse à Admète cette prière d'une expression véritablement ravissante :
« Admète, vous voyez où j'en suis ; laissez-moi vous dire, avant que je meure, ce que je souhaite. Par mon dévouement, par le sacrifice de ma vie, je vous conserve cette lumière du jour; je meurs pour vous; et cependant je pouvais ne pas mourir; je pouvais me choisir un autre époux parmi les Thessaliens, et continuer d'habiter en reine dans cette riche maison. Je n'ai pas voulu vivre, séparée de vous, chargée, après la mort de leur père, de vos tristes enfants. Je ne me suis point laissé toucher par ces dons de la jeunesse, que je possédais, dont je devais jouir. Celui qui vous a engendré, celle qui vous a mis au monde, vous ont abandonné, lorsque, au terme de la vie, il leur convenait sans doute de mourir, et, par un généreux abandon, de sauver leur enfant, leur unique enfant, un fils qu'ils n'avaient pas l'espérance de remplacer. Et j'eusse vécu, et vous-même eussiez achevé les jours qui vous étaient réservés, sans vous voir réduit à pleurer la solitude du veuvage, à élever des orphelins. Un dieu a voulu qu'il en fût ainsi: soumettons-nous : seulement, en retour de ce que je fais? accordez-moi une grâce, non pas égale ; qui pourrait valoir la vie? mais juste, vous en conviendrez, si, comme vous le devez, vous chérissez ces enfants d'un amour égal au mien. Souffrez qu'ils demeurent toujours les maîtres dans ma maison; ne leur donnez point une autre mère, qui ne me vaudrait point peut-être, et dont la haine s'appesantirait sur ceux qui sont à vous non moins qu'à moi. Oh ! ne le faites pas, je vous en supplie. Une marâtre est, pour les enfants d'une première épouse, un ennemi, qui ne pardonne pas plus que la vipère. Au moins mon fils a-t-il, dans son père, un asile, un rempart; il peut lui parler, il peut l'entendre. Mais toi, ma fille, comment te conserver pure et honorée, si, pour ton malheur, ton père se donne une telle compagne? Peut-être t'opprimant du poids d'une injurieuse renommée, elle flétrirait, dans la fleur de ta jeunesse, l'espoir de ton hymen. Car ce n'est point ta mère qui doit te présenter à un époux; ce n'est pas elle qui sera près de toi, lors des douleurs de l'enfantement, pour te soutenir de 205 sa présence, ô ma fille, en ce moment, où rien n'est si doux qu'une mère. Voilà qu'il me faut mourir: et quand? non pas demain; non pas le jour d'après; mais sur l'heure : un instant encore, et l'on me comptera parmi ceux qui ne sont plus. Adieu! vivez heureux ! vantez-vous d'avoir eu, ô mon époux, la meilleure des femmes, et vous, mes enfants, la meilleure des mères (18). »
J'ai traduit, à peu près littéralement, pour le citer, ce morceau célèbre. La paraphrase de Brumoy, l'imitation de La Harpe, en conservent, il est vrai, assez fidèlement le mouvement et les idées; mais, par leurs qualités mêmes, par l'élégance et la pompe du style, elles en altèrent quelque peu l'exquise simplicité. Ce n'est pas assez, pour rendre Euripide, d'être simple à la manière du théâtre, il faut tâcher de l'être comme la nature.
Il n'y a certainement nulle recherche dans ce début de Brumoy :
« Vous voyez, chère Admète, à quel état votre épouse est réduite. Approchez, et recevez de sa bouche les dernières paroles qu'elle vous réservait avant le trépas. »
Il n'y en a pas davantage dans ces premiers vers de La Harpe :
Cher Admète, je touche à mon heure suprême, Voyez ce que j'ai fait pour un époux que j'aime.
Mais n'y sent-on pas cependant une sorte d'apprêt oratoire, un tour de harangue et d'exorde, que n'ont pas les paroles de l'Alceste grecque :
« Admète, vous voyez où j'en suis : laissez-moi vous dire, avant que je meure, ce que je souhaite. »
On pourrait continuer ce parallèle, et partout on trouverait, sous la dignité d'un langage emprunté par les deux traducteurs au souvenir de la scène moderne, une 206 expression familière, qui descend parfois jusqu'à l'allusion proverbiale ; comme lorsque Euripide fait dire à son héroïne qu'une marâtre est, pour les enfants d'une première épouse, un ennemi qui ne pardonne pas plus que la vipère; ou encore, dans un passage que j'ai omis, parce qu'il ne pouvait se passer d'une explication, qu'il lui faut mourir, non pas demain, non pas le troisième jour du mois ; rappelant sans doute par là le délai que l'indulgence de la loi ou l'humanité des créanciers accordait, chez les Grecs, aux débiteurs. Car c'est ainsi que tous les interprètes (19) entendent des mots, obscurs pour nous, et que d'après eux, La Harpe a rendus élégamment dans ces vers :
Il faut nous séparer : la mort qui me menace,
N'admet point, de délai,,n'accorde point de grâce.
On peut appliquer à de tels passages cette observation d'Aristote (20) qu'Euripide a le premier connu et enseigné le secret de cacher l'art dans la poésie, de la ramener au naturel par un mélange habile d'expressions empruntées au langage usuel : artifice savant qu'il ne faut pas confondre avec l'usage plus spontané de cette familiarité noble, commune à tous les tragiques grecs.
A cette vérité, de quelque manière qu'elle soit obtenue, répond celle des sentiments pris dans la nature la plus générale. Quoi de moins rare que ce qu'on voit ici? Une jeune femme mourante, avec le regret de la vie et des joies domestiques, avec une jalouse sollicitude pour les enfants qu'elle laissé orphelins? C'est de la tragédie de tous les jours et de toutes les familles. Mais précisément pour cela, il n'est point de cœur qui n'en soit ému, et 207 lorsque, au milieu de ces aimables, et touchantes faiblesses de l'humanité, nous voyons' se développer l'héroïsme du dévouement, du sacrifice, ce spectacle, tout sublime qu'il est, nous semble vraisemblable ; il ne peut trouver, chez personne, ni incrédulité, ni froideur.
Encore une remarque et qui confirme ce que je viens de dire. Alceste, comme les héros romanesques du théâtre, ne prend point le soin hypocrite de cacher tout ce que lui coûte sa résolution et combien elle l'élève à ses propres yeux. Elle se pare de sa vertu, aux yeux de son époux et de ses enfants, avec une sorte d'orgueil qui est dans la nature, et qui, loin de nuire à l'effet du tableau, l'achève et le complète par un dernier trait de vérité naïve.
La scène se soutient jusqu'au bout aussi vraie, aussi attendrissante ; après qu'Admète, avec les plus vifs transports de reconnaissance, d'amour, de regret, a prononcé la promesse qui lui est demandée (21), elle se termine par ce dialogue où se précipitent, d'un mouvement plus rapide 208 et plus tumultueux, tous les sentiments qui l'ont remplie :
ALCESTE.
Ô mes enfants, vous Payez entendu ; votre père promet de ne point vous donner une marâtre, de ne point profaner ma couche.
ADMÈTE.
Je le promets encore, et je tiendrai ma promesse.
ALCESTE.
Reçois donc de ma main ces enfants.
ADMÈTE.
Don chéri d'une chère main!
ALCESTE.
Prends ma place, sers-leur de mère.
ADMÈTE.
Nécessité cruelle, puisqu'ils ne t'auront plus !
ALCESTE.
Je voudrais vivre pour vous, ô mes enfants, et je meurs !
ADMÈTE.
Malheureux! que deviendrai-je sans toit
ALCESTE.
Le temps adoucira ta peine. Ce n'est plus rien qu'un mort.
ADMÈTE.
Emmène-moi, au nom [des dieux, emmène-moi aux enfers.
ALCESTE.
C'est assez de moi, qui meurs pour te sauver.
ADMÈTE.
Ô Destin, quelle épouse tu me ravis !
ALCESTE.
Mes yeux se couvrent d'un nuage et déjà s'appesantissent.
ADMÈTE.
Je péris, si tu me quittes, ô femme I
209 ALCESTE.
Je ne suis plus; ne me compte plus au nombre des vivants.
ADMÈTE.
Relève ta tête ; ne quitte pas tes enfants.
ALCESTE.
Que ne puis-je! mais adieu, mes enfants, adieu !
ADMÈTE.
Regarde-les ! regarde-les !
ALCESTE.
C'est fait de moi.
ADMÈTE.
Quoi ! tu nous abandonnes?
ALCESTE.
Adieu!
ADMÈTE.
Je suis perdu, infortuné!
LE CHŒUR.
Elle a cessé de vivre; Admète n'a plus d'épouse (22)
Ici, dans le mètre lyrique, qui reparaît, éclate en accents déchirants la douleur du fils d'Alceste; on peut ajouter et de sa fille, car cet enfant qui n'a pas encore de voix pour se plaindre, trouve un interprète dans son frère, moins jeune et plus instruit de son malheur.
Le chœur exhorte Admète à la constance, et cet époux désolé, imposant silence à ses regrets, ordonne en roi les cérémonies des funérailles, et commande aux Thessaliens ses sujets un deuil universel. Ce deuil commence aussitôt par des chants où est magnifiquement célébré l'héroïque dévouement d'Alceste.
Toute cette première moitié de la pièce me paraît d'une beauté achevée, et j'y admire surtout, comme dans la plupart des tragédies grecques, cette étonnante fécondité 210 d'imagination qui trouve pour l'expression d'une situation toujours la mèrn», d'un sentiment unique, des formes si variées. La lyre du poète antique a peu de cordes, mais que d'accords sa main sait en tirer !
Une tragédie, qui, dès le début, atteint à ce degré de pathétique, ne peut guère s'y maintenir ; il lui faut ou déchoir ou changer de ton, comme fait celle-ci, qui, commencée au milieu des larmes, s'achève par de la joie et presque de la gaieté. Ce mélange d'impressions contraires, réprouvé sur notre scène, applaudi sur d'autres, et aujourd'hui l'un des sujets favoris de la 'controverse littéraire, n'est pas, comme l'on voit, si entièrement moderne qu'on le croit communément. Sa première introduction dans l'art tragique remonte a»moins à Euripide, et, quoi qu'il en faille penser, c'est certainement une des singularités les plus piquantes que puisse offrir l'étude de son théâtre.
On en a fait, je le sais bien, contre la tragédie d'Alceste, un sujet de reproche, même chez les anciens. Aristote la condamne implicitement au chapitre de sa Poétique (23) dans lequel il refuse d'admettre comme des fables tragiques celles où le changement a lieu du malheur au bonheur. Un scoliaste, dont l'argument se lit en tête du texte grec de cette pièce (24), la renvoie presque au drame satyrique et à la comédie, à cause de sa termination heureuse. Mais je ne puis, pour mon compte, bien que je sache (j'ai eu occasion de le dire ailleurs (25)) que l'Alceste a été donnée en place de drame satyrique à la fin d'une tétralogie, lui refuser, avec ce scoliaste et les critiques assez nombreux qui l'ont suivi, le caractère tragique, le titre de tragédie. Ce qui constitue la tragédie, c'est, à ce qu'il me semble, la nature des sentiments qui y dominent, et non celle du dénouement, qui peut, de l'aveu d'Aristote, et du bon sens, tourner selon le dessein du poète, et le besoin du sujet, 211 à l'infortune ou au bonheur. Que l'un soit plus tragique que l'autre, tout le monde en convient et je suis loin d'y contredire. Mais que cette manière, préférable en général, soit la seule permise, c'est ce qu'on ne me persuadera pas. Quoi ! les critiques vanteront sans cesse dans Homère ce sourire involontaire qui se mêle un moment aux larmes d'Andromaque ; et ils blâmeront Euripide, lorsqu'il se permet d'éclaircir le front chargé d'ennuis de sa Melpomène ! Il faut être bien ennemi de son plaisir pour sacrifier ainsi, à la rigueur des classifications, une émotion nouvelle, et, on ne peut le nier, pleine de char» me, quelque nom que lui refuse ou que lui donne la poétique.
Du reste, si, dans son tableau, Euripide introduit la lumière au milieu des ombres, ce n'est pas par une opposition heurtée, mais par un insensible et harmonieux passage. Je souhaite qu'on en puisse juger d'après l'analyse qu'il me reste à présenter de la seconde moitié de l'Alceste: analyse que quelques pages pleines du sentiment passionné de la beauté antique (26), où cette partie précisément de l'œuvre d'Euripide a été, il n'y a pas bien longtemps, admirablement reproduite et appréciée, me rendront à la fois plus facile et plus dangereuse.
Tandis que les vieillards thessaliens sont occupés à chanter les louanges de leur reine, paraît Hercule, qui, se rendant en Thrace, pour y ravir, selon l'ordre d'Eurysthée, les chevaux de Diomède, et ayant pris son chemin par la ville de Phères, vient demander l'hospitalité au palais d'Admète. Il s'établit entre le chœur et ce héros, au sujet de l'expédition qu'il médite, une conversation assez froide, mais qui, je pense, dans le dessein d'Euripide, a pour but d'empêcher qu'il ne soit question entre 212 eux de la mort d'Alceste. Admète arrive à temps pour prévenir cette explication inévitable, mais que le poète veut à tout prix éviter. Si Hercule apprend le malheur qui vient de frapper son ami, il refusera d'entrer dans sa maison. Admète qui le comprend, et qui ne veut pas, malgré sa profonde affliction, manquer au devoir, si sacré chez les anciens, de l'hospitalité, parvient, par des paroles équivoques, à lui cacher la vérité que quelques indices lui faisaient déjà soupçonner.
On a trouvé invraisemblable l'erreur d'Hercule, et en effet l'auteur ne l'a obtenue que par des moyens dont l'artifice est trop visible. Cette espèce d'escamotage, qui substitue, avec dextérité, au cours naturel et nécessaire des idées et des discours, un ordre d'entretien arbitraire et factice, était en général fort étranger à la simplicité et à la franchise du génie dramatique des Grecs : c'est un raffinement de l'art qui ne se montre guère que chez Euripide, et encore assez rarement. Voltaire, qui le lui reproche avec quelque dureté (27), n'avait peut-être pas le droit d'être sévère, car il se l'est souvent permis, et ses exemples ont beaucoup contribué à en rendre l'usage aussi général et aussi approuvé qu'il l'est aujourd'hui sur notre scène. Si, par exemple, Tancrède persiste à croire Aménaïde infidèle, n'est-ce pas parce que le poète, avec une adresse subtile, que La Harpe a eu la bonhomie de louer, ne permet pas aux deux amants de se dire, lorsqu'ils se rencontrent, ce qu'il était impossible qu'ils ne se dissent pas ?
De ce défaut résulte, au reste, chez Euripide, une grande beauté. C'est certainement un noble spectacle que celui d'Admète renfermant sa douleur pour la dérober aux regards de son hôte. Le chœur rappelle, à cette occasion, que la maison d'Admète fut toujours hospitalière, et retrace, dans des strophes d'une riche et gracieuse poésie, le séjour qu'y fit jadis Apollon. Ce souvenir n'est point un hors-d'œuvre descriptif. Il nous montre la 213 piété d'Admète comme l'objet constant de l'amour et de la protection des dieux ; il nous fait pressentir qu'elle sera récompensée par Hercule, comme elle l'a déjà été par Apollon; il prépare le merveilleux du dénoûment, en nous reportant dans cette région fabuleuse, dont nous ont fait descendre tant de scènes d'une vérité domestique et familière.
Une des choses qu'Euripide s'est le plus attaché à faire ressortir dans sa pièce, c'est le contraste du dévouement d'Alceste avec l'insensibilité des parents d'Admète, qui, si près de la mort (28),.n'ont pas voulu mourir pour leur fils. Non content de le rappeler sans cesse, il lui a encore consacré une scène entière presque unanimement condamnée comme révoltante par les modernes (29), et dont il ne paraît pas cependant que les anciens aient été blessés : Aristophane ne le dit pas, dans celles de ses pièces du moins qui nous sont parvenues, et où ne manquent pas des parodies de détail de l'Alceste et même de cet endroit de l'Alceste (30) ; or on sait qu'il ne passait rien à Euripide. Ajoutons que, dans des bas-reliefs antiques (31) où sont reproduites les principales situations de la tragédie, cette scène n'a point été omise.
Brumoy, dans une justification ingénieuse, mais forcée, que je ne discuterai point, abuse, en faveur du poète grec, de ce dissentiment présumé, et qui, fût-il d'ailleurs plus évidemment établi, resterait inexplicable. Il ne porte pas en effet sur un point de goût, mais sur un 214 point de morale, peu susceptible de varier au gré des temps et des lieux, l'universelle, l'inviolable obligation du respect filial (32).
Hercule a été conduit dans l'appartement destiné aux étrangers. Le cortège funèbre d'Alceste commence à sortir du palais. En ce moment se présente le vieux père d'Admète, Phérès, apportant, pour en décorer le cercueil, de riches présents, et exprimant sa reconnaissance envers celle qui lui a sauvé un fils. Il est durement repoussé par Admète, qui ne craint pas de lui reprocher, à lui et à sa mère, d'avoir causé la mort de son épouse, en refusant de mourir eux-mêmes en sa place. Phérès, indigné, réplique qu'Admète a eu la lâcheté de sacrifier cette épouse, qu'il regrette, à la conservation de ses jours. Cette odieuse contestation, que le chœur tâche en vain, mais peut-être aussi trop faiblement, d'interrompre, se prolonge entre le père et le fils, avec un acharnement trop peu justifié, chez l'un par l'égarement de la douleur, chez l'autre par l'emportement de la colère : elle décèle, dans tous deux, un amour égoïste de la vie, qui les dégrade également; elle fait ressortir dans la pièce un défaut de vraisemblance, que le pathétique admirable du poète n'avait pas laissé jusqu'ici le loisir d'apercevoir, l'impossibilité qu'Admète ait pu jamais consentir au sacrifice d'Alceste.
C'est là le vice, vraiment grave et fondamental, de cette composition ou,, du moins, du sujet (33); Euripide l'a trahi involontairement par ce penchant de sophiste et de rhéteur, qui lui fit trop souvent débattre dans des plaidoyers 215 contradictoires des thèses de momie subtile, 'des questions de casuiste, et produire au dehors, au moyen du dialogue, ces sentiments honteux qui me sont peut-être pas étrangers à la nature, mais qu'on ne s'avoue pas à soi-même, loin d'en faire confidence à autrui.
A cela se bornent, et c'est bien assez, les reproches que la critique est en droit d'adresser à la tragédie d1Alceste : car je ne pense pas qu'on ait eu raison de blâmer la scène suivante, prise dans cette nature familière, qui n'était point dédaignée des poètes grecs.
On y voit paraître l'esclave chargé par Admète de recevoir Hercule ; il s'est échappé un moment pour venir se plaindre en liberté de l'importune arrivée et de l'indécente joie de cet étranger, qui se livre au plaisir d'un festin dans une maison remplie de deuil. Il regrette de n'avoir pu accompagner jusqu'à sa dernière demeure sa bonne maîtresse , qui fut toujours, pour lui et ses compagnons d'esclavage, comme une mère; qui si souvent, auprès d'Admète, a plaidé leur cause et obtenu leur grâce (34). Je ne puis comprendre, en vérité, comment cette naïveté touchante n'a pas désarmé les censeurs.
On croirait, à les entendre, qu'Euripide a exposé aux yeux le repas d'Hercule ; il l'a retracé seulement à l'imagination par quelques vers qu'on a pu (35) sans doute rapprocher des scènes ou la comédie s'égayait (36) dans le même temps, sur la voracité du héros, mais qui certes s'en distinguent assez par le ton pour que de bons juges (37) y aient encore retrouvé son caractère divin. Une telle scène, dit Voltaire (38), ne serait pas soufferte chez, nous à la foire. Et pour, le prouver, après avoir accusé Brumoy d'une fidé- 216 lité peu scrupuleuse, il la traduit lui-même en style de parade. C'est, ajoute La Harpe, qui lui sert de second dans cette parodie, une disparate choquante (39). Un critique dont on ne peut contester l'autorité en matière de goût (40), y a vu plus justement un contraste assez semblable à celui qu'il avait ailleurs loué éloquemment dans le Roméo et Juliette de Shakspeare (41). On me saura gré de citer les deux passages, apologie réciproque de deux beaux génies.
« Les froides plaisanteries des musiciens, dans une salle voisine du lit de mort de Juliette, ces spectacles d'indifférence et de désespoir rapprochés l'un de l'autre, en disent plus sur le néant de la vie, que la pompe uniforme de nos douleurs théâtrales. »
« .... Cette belle Juliette qui a brillé au milieu du bal, deux jours après, elle est morte. Voilà des musiciens qu'on a fait venir pour sa noce ; il n'y a plus de noce à faire ; ces musiciens vont servir à autre chose, à l'enterrement. A côté de cette salle où est étendue Juliette morte, où sa famille pleure, ils sont là qui causent et font des plaisanteries. Voilà Shakspeare éminemment classique; il se rencontre avec Euripide. »
Je reviens au poète grec : il amène bientôt sur la scène, à la suite de l'esclave mécontent, Hercule, qui a remarqué sa mauvaise humeur et son absence désobligeante. Le héros ne tarde pas à tirer de lui le secret qu'on lui a caché et dont l'honnête serviteur le croyait instruit. Il s'informe rapidement du lieu où l'on a dû transporter Alceste, et il s'y rend aussitôt, après avoir annoncé que, par reconnaissance pour la magnanime hospitalité d'Admète, il ravira son épouse aux mains du Génie de la mort, et la redemandera, s'il le faut, à Pluton lui-même.
On ne conçoit pas trop comment il ne rencontre point 217 en route Admète, que nous allons voir arriver de la cérémonie des funérailles. Une autre circonstance, que les usages ordinaires du théâtre grec rendent singulière, c'est que le chœur, abandonnant la scène qu'il ne quitte jamais (42), a servi de cortège au roi et reparaît avec lui.
Après les plaintes qui ont rempli la plus grande partie de cette tragédie, la verve pathétique d'Euripide n'est point encore épuisée ; il trouve avec une facilité merveilleuse de nouveaux accents pour le désespoir d'Admète, lorsque l'époux désolé revoit cette maison désormais déserte pour lui, et pleine de l'absence d'Alceste. Le passé et l'avenir se retracent alors douloureusement à sa pensée :
« O mon palais! Pourrai-je en passer le seuil? Pourrai-je y demeurer, lorsque ma fortune est ainsi détruite ? Hélas ! Quelle différence ! Ce fut à la lueur des flambeaux, au bruit des hymnes de fête, que j'y entrai autrefois, tenant la main de ma compagne bien-aimée. une troupe joyeuse nous suivait, qui, dans ses chants, nous disait heureux, celle qui n'est plus et moi, de ce que, sortis tous deux d'une noble origine, nous unissions nos destinées. Et maintenant, à la place des concerts d'hyménée c'est le cri des funérailles, au lieu de cette pompe éclatante c'est le noir appareil du deuil, qui me ramènent vers ma couche solitaire (43).... »
« Que deviendrai-je, lorsque je verrai ce lit où elle ne sera plus, ces sièges où elle se tenait, ma maison dans un lugubre abandon, sur mes genoux mes enfants appelant leur mère, et autour de moi mes serviteurs pleurant la maîtresse qu'ils ont perdue (44)? »
Il se représente ensuite tout ce qui l'attend au dehors ; la vue importune du bonheur ou les discours injurieux qui lui rendront amère cette vie qu'une héroïque épouse lui a conservée.
218 Parmi ces plaintes sent jetées, avec un naturel parfait, les consolations du chœur, consolations sincères, mais, comme il arrive,, impuissantes pour une douleur inconsolable. Dans le nombre set remarque une allusion assez évidente à la fermeté avec laquelle le maître d'Euripide, Anaxagoire, avait récemment supporté, à quatre-vingt-quinze ans, la mort d'un fils unique, se contentant de dire : « Je savais que j'avais mis au monde un mortel (45). »
« J'avais dans ma famille un homme à qui fut enlevé un fils digne de ses larmes, l'unique espoir de sa maison. Et cependant il supportait ce malheur avec constance, bien qu'il n'eût pas d'autre enfant, et que, sous ses cheveux blancs, il penchât déjà vers le terme de sa vie (46). »
Dans cette scène je retrouve l'accord, déjà remarqué ailleurs, d'un entretien en apparence désordonné et de la savante progression de l'ode. Le.tout se termine par l'image de l'invincible nécessité, et par l'annonce de l'éternelle gloire d'Alceste.
Tout à coup survient Hercule avec une femme voilée. Après de tendres reproches sur l'erreur où son ami l'a laissé, il lui présente cette femme, qui, dit-il, a été le prix d'une victoire difficile, et dont il le presse d'accepter la garde jusqu'à ce qu'il revienne de son expédition. Admète s'y refuse ; il ne peut, répond-il, la recevoir dans sa maison, ni avec convenance pour elle, ni avec honneur pour lui. Une telle compagnie, d'ailleurs, ne le rappelle- 219 rait-elle pas sans cesse au, sentiment de son malheur ? Et, en effet, quand il la regarde, il croit lui trouver quelque ressemblance avec sa chère Alceste. Il conjure qu'on l'éloigné, qu'on lui épargne un aspect qui le tue. Hercule change d'entretien, et, tantôt regrettant de ne pouvoir lui rendre ce qu'il a perdu, tantôt blâmant l'excès de sa douleur et combattant ses projets d'éternel veuvage, il cherche à le préparer au bonheur inespéré qui l'attend. Puis il revient à sa première demande et, à force d'importunités, arrache le consentement si longtemps refusé. Mais ce n'est pas assez qu'Admète accueille cette captive, il faut qu'il l'introduise lui-même, qu'il lui présente la main. Il résiste, puis se rend encore, et Hercule, enlevant le voile, lui fait reconnaître, dans cette femme dont il détourne les yeux avec une sorte d'horreur, Alceste ravie au trépas. Admète doute, interroge avec anxiété ; il s'assure par ses regards, par ses caresses que c'est bien Alceste qui lui est rendue (47). Mais pourquoi donc garde-t-elle le silence? C'est, répond Hercule, qu'elle appartient encore aux divinités infernales, et que trois jours doivent s'écouler avant que la consécration qui l'a dévouée à leur empire soit effacée. Cette invention. me semble très heureuse, non pas, comme le prétend W. Schlegel, assez subtilement, parce que le poète respecte ainsi le voile qui cache aux vivants le séjour des morts, sorte de réserve pieuse qu'Euripide n'eut jamais, bien au contraire ; mais parce qu'il nous reporte par là, de la joie de son dénouement, aux émotions terribles et touchantes qui ont précédé, et nous retient pour un moment encore dans la tragédie. Nous sommes à ce spectacle, on me pardonnera de revenir sur cette comparai- 220 son (48), comme le voyageur que Delille a peint égaré dans les catacombes, et qui, après avoir retrouvé le fil qu'il avait perdu, s'y arrête avec quelque charme :
A l'abri du danger? son âme encor tremblante
Veut jouir de ces
lieux et de son épouvante ;
A leur aspect lugubre, il éprouve en
son cœur
Un plaisir agité d'un reste de terreur (49).
Telle est cette tragédie singulière, l'une des plus pathétiques du théâtre grec assurément, et qui toutefois, par la peinture satirique des vieux parents d'Admète, par les traits familiers dont est marqué en grande partie le rôle d'Hercule, par la nature non pas seulement heureuse, mais presque enjouée du dénouement, s'approche, plus qu'aucune autre du même théâtre, des limites de la comédie. J'ai déjà dit (50), mais il convient de le répéter ici, qu'on l'avait quelquefois, à raison de ce caractère, chez les anciens et chez les modernes (51), assimilée au drame satyrique, et qu'en effet, dans l'ensemble de pièces dont elle faisait partie, elle remplaçait cette conclusion ordinaire des tétralogies.
C'est pour ne l'avoir point considérée sous ce point de vue, que plusieurs critiques, traitant de fautes ses étrangetés, en ont parlé avec si peu d'estime. Un historien de la littérature grecque (52) a été jusqu'à dire qu'on la regarde, malgré ses beautés de détail, comme une des plus faibles productions d'Euripide. Je proposerais de mettre, par amendement, que c'est, malgré quelques défauts, un de ses chefs-d'œuvre.
Ce chef-d'œuvre est comme isolé dans l'histoire de 221 la tragédie grecque, qui n'a guère conservé le souvenir d'aucune autre Alceste; car, je l'ai dit ailleurs (53), c'est gratuitement, à ce qu'il semble, qu'on a prêté une tragédie de ce titre à l'antique Thespis, et l'on ne sait rien de celle qui le porte (54) dans le catalogue, assez contestable aussi, de Phrynichus.
On croit (55) que l'Alceste d'Euripide a été parodiée par le plus illustre, avec Alexis, des poètes de la moyenne comédie, par Antiphane, dans une pièce également intitulée Alceste (56) et donnée probablement (57) la deuxième année de la cvie olympiade.
Ce titre d'Alceste se retrouve dans les listes plus ou moins exactes qu'on a dressées, d'après les témoignages anciens, des ouvrages dramatiques de Névius (58) , d'Ennius (59) , d'Attius (60) : mais, pour les deux premiers, il y a des raisons de douter s'il ne faut pas choisir entre eux, ou même reconnaître dans un écrivain qui leur est très postérieur, Lévius (61) l'auteur de l'Alceste qu'on leur attribue, et de plus si cette Alceste était une tragédie ou une comédie, une imitation d'Euripide ou d'Antiphane.
La fable d'Alceste a bien souvent tenté les modernes. Le pathétique de la situation, le merveilleux de l'aventure la leur ont fait reproduire, alternativement, sur leurs scènes tragiques et lyriques.
De 1540 à 1543, l'un des plus heureux disciples de la muse latine, Buchanan, donna de l'Alceste d'Euripide, , aussi bien que de sa Médée (62), d'élégantes traductions.
222. C'était à la même époque qu'il imitait les fermes tragiques des anciens dans deux compositions originales, son Saint Jean-Baptiste, son Jephté. Lui-même nous a appris(63) que ces quatre ouvrages, successivement» représentés sur une scène scolatique, celle du collège de Bordeaux, où il eut, dit-on, pour écolier, sinon pour acteur, Montaigne, étaient surtout destinés par lui à détourner la jeunesse du goût, alors dominant en France, des drames allégoriques.
Dès 1606, le poète de cette première troupe française à laquelle, en 1588 , les Confrères de la Passion avaient loué leur privilège, le si fécond et si médiocre Hardy, donna sa tragi-comédie d'Alceste ou la Fidélité. La pièce s'ouvrait par un long monologue assez semblable aux prologues sans fin de Sénèque ; mais du reste elle n'avait rien des unités antiques, latines ou grecques : elle semblait plutôt se rattacher à l'irrégularité barbare des anciens mystères, aux libertés du drame espagnol, alors en vogue. Hercule allant ravir Cerbère aux sombres bords et, par la même occasion (64), ramenant Alceste à Admète, y tenait autant de place que les époux thessaliens eux-mêmes. Une action complexe et lâche s'y distribuait, sans art, entre diverses époques et aussi entre diverses scènes, le palais d'Eurysthée, celui d'Admète, celui de Pluton. Quelques situations, les unes à peine indiquées, les autres poussées au contraire fort au delà des convenances, y étaient comme noyées dans une multitude de vers in- 223 corrects, plats, languissants, parmi lesquels cependant 0a distingue quelques traits naturels., et d'une élégance fortuite ; ce dialogue par exemple :
................
ALCESTE.
Hé! que pourrois-je mieux, qu'ay-je à délibérer,
Toy mort, que
de te suivre, et ton sort espérer?
ADMÈTE.
Tu me suivras, ton heure à son tour arrivée.
ALCESTE.
Ta trame s'achevant, la mienne est achevée (65) „
L'une des premières tragédies-opéras (66) que Quinault composa pour Lully fut, en 1674, Alceste ou le triomphe d'Alcide. On a loué avec raison dans cet ouvrage ce qui manque à d'autres, et semblait refusé par le sujet, le rôle intéressant d'Admète. Blessé mortellement en arrachant sa jeune épouse à un ravisseur, il n'apprend le sacrifice sublime par lequel elle l'a dérobé au trépas, que lorsque ce sacrifice est accompli, et que déjà, sur l'ordre d'Apollon, les arts élèvent le monument qui doit en consacrer la mémoire ; s'immolant à son tour pour sauver ce qu'il aime, il accepte, sans hésiter, l'offre que lui fait Hercule d'aller chercher Alceste dans les enfers, à cette cruelle condition qu'elle deviendra le prix de son libérateur. Le rôle d'Hercule qui, content d'avoir mis à l'épreuve la générosité de son rival, renonce lui-même généreusement au bien qu'on lui a cédé, n'offre pas moins d'intérêt. Toute la composition est animée par cet héroïsme délicat qui procède bien plus, il faut le dire, et sur cette scène galante ce n'était pas un grave défaut, des traditions 224 de la chevalerie, que de celles de la fable antique. Les sentiments développés par Euripide s'aperçoivent à peine ici : ceux qu'y a substitués le poète moderne, s'expriment seulement en quelques vers, thèmes rapides de l'expression musicale , et de plus à tout instant interrompus par le retour importun d'une contrepartie comique ; ils disparaissent presque parmi les merveilles sans nombre d'un spectacle qui fait intervenir dans l'action les puissances surnaturelles du ciel, de la mer, des enfers, et par des tableaux ingénieusement variés, amuse, enchante les sens et l'imagination, un peu aux dépens des émotions du cœur. A cette partie accessoire de l'œuvre appartiennent quelques vers qui en sont la principale beauté. Marmontel (67) les a loués comme une parodie inimitable d'un air de Lully ; Voltaire (68), dont La Harpe (69) trouve l'expression bien forte, a dit que rien n'est plus beau, ni même plus sublime. Les suivants de Pluton y fêtaient ainsi la venue d'Alceste (70) :
Tout mortel doit ici paraître ;
On ne peut naître
Que pour
mourir.
De cent maux le trépas délivre ;
Qui cherche à vivre
Cherche à souffrir.
Venez tous sur nos sombres bords;
Le repos
qu'on désire
Ne tient son empire
Que dans le séjour des morts.
Chacun vient ici-bas prendre place :
Sans cesse on y passe ;
Jamais on n'en sort.
C'est pour tous une loi nécessaire,
L'effort qu'on peut faire
N'est qu'un vain effort.
Est-on sage
225
De fuir ce passage?
C'est un orage
Qui mène au port.
..........
C'est en cette même année 1674, où se jouait F Alceste de Quinault, c'est très peu de temps après la première représentation de cet opéra, que Racine, comme il a été dit plus haut (71), dans la préface de son Iphigénie en Aulide, défendit contre Ch. Perrault l'Alceste d'Euripide,et en traduisit quelques vers. Lui-même, depuis quelques années, avait été fréquemment tenté de transporter une œuvre si éloignée des mœurs et des habitudes littéraires des modernes sur notre scène tragique, et cette tâche difficile, il finit par s'en charger et la pousser même assez loin, si l'on doit ajouter foi au témoignage d'un écrivain qui se crut appelé à la reprendre après lui. Un de ces collatéraux qui se disputèrent, à titres douteux, la succession dramatique du grand poète, en attendant que se fussent déclarés des héritiers plus directs, les Crébillon, les Voltaire, Lagrange-Chancel, s'exprime ainsi dans la préface de son Alceste, donnée, avec grand succès, en 1703 :
« J'avais souvent entendu dire à M. Racine que, de tous les sujets de l'antiquité, il n'y en avait pas de plus touchant que celui d'Alceste, et qu'il n'avait point mis de pièce au théâtre depuis son Andromaque, qu'il ne se proposât de la faire suivre par celle d'Alceste. Sa préface d'Iphigénie fait voir combien il était rempli de ce sujet. J'ai connu de ses amis particuliers qui m'ont assuré qu'il avait exécuté son dessein, et qu'il leur en avait souvent récité des morceaux admirables ; mais que, peu de temps avant sa mort, il eut la cruauté de priver le public d'un si bel ouvrage et de le jeter dans le feu. La lecture d'Euripide, jointe à ce que j'avais pu recueillir des idées de M. Racine, me fit naître l'envie de traiter ce sujet.... »
226 Quelles étaient ces idées d'après lesquelles Racine aurait modifié, pour l'accommoder à notre système tragique, l'antique sujet traité par Euripide ? Les mêmes peut-être, et à cet égard un témoignage allégué par Brumoy (72) confirme celui de Lagrange-Chancel, les mêmes qui avaient présidé à la composition lyrique de Quinault, celle de remplacer le trop facile consentement d'Admète au sacrifice d'Alceste par la connaissance tardivement, douloureusement acquise de ce sacrifice ; celle de faire intervenir Hercule moins accidentellement dans l'action,, en supposant qu'il aime Alceste et qu'il la sauve pour un rival Quant au dénouement lui-même, Racine n'aurait pu, comme il l'avait fait si adroitement dans son Iphigénie, en changer le caractère merveilleux, et l'on a pensé (73),non sans vraisemblance, que cette raison plus que toute autre l'avait à la fin détourné du projet de nous donner une Alceste,
Nous ne pouvons accepter comme un dédommagement l'Alceste de Lagrange-Chancel ; il s'y trouve bien quelque chose du plan qu'on peut soupçonner Racine d'avoir voulu suivre, mais rien certes de cet art par lequel il eût su fondre, comme dans son Andromaque, son Iphigénie, sa Phèdre,, les éléments antiques et les éléments modernes de son œuvre ; rien de la vérité humaine dont il eût animé ce qui aurait pu y manquer de vérité locale. Hercule a sauvé Alceste de la fureur d'Acaste son frère, qui voulait, bien qu'elle n'eût point participé au crime involontaire des autres filles de Pélias, la comprendre dans leur châtiment. Obligé ensuite de partir pour une expédition lointaine contre le Troyen Laomédon, il a confié la jeune princesse, sa conquête au roi de Thessalie Phérès, lui faisant confidence de l'amour qu'il avait conçu pour elle et du dessein où il était de l'épouser à son retour : confidence inutile ; Phérès, enhardi par la longue absence du héros, qu'il pensait ne jamais revoir, a donné Alceste pour 227 épouse à sou fils Admète. Cependant une contagion envoyée par les dieux vengeurs n'a pas tardé à désoler la Thessalie ; il faut, pour la conjurer, l'offrande d'une victime humaine que désigne annuellement le sort ; et de l'urne fatale est sorti, après plusieurs autres moins illustres, le nom du roi lui-même, qui n'est plus Phérès, volontairement descendu du trône, mais Admète. Pour comble de malheur, Hercule, qu'on croyait avoir péri dans les flots, revient, toujours épris d'Alceste, la croyant libre encore, et réclamant sa main. Tels sont dans la tragédie de Lagrange-Chancel les faits de l'avant-scène ; il en résulte deux intérêts trop distincts et auxquels le poète a attribué des parts vraiment trop inégales, insistant outre mesure sur la rivalité épisodique d'Hercule et d'Admète, tandis qu'il ne faisait presque qu'un épisode de ce qui était proprement le sujet, je veux dire le danger du roi de Thessalie et le dévouement de sa femme. La pièce, à laquelle d'ailleurs ne manquent ni la tempête, ni le songe, ni le sacrifice consacrés par l'usage, n'offre que le lieu commun amoureux reproduit alors, sous des noms divers, par toutes les tragédies, et cela dans un style dont quelques lambeaux maladroitement dérobés à Racine (74) font ressortir la faiblesse. Quant aux sentiments desquels Euripide a tiré toute sa tragédie, à peine s'il en est ici question, et avec quelle froideur, quelle impuissance !
Il y a quelque chose de touchant dans ces mots d'Al- 228 ceste par lesquels Admète est progressivement amené à la découverte du cruel secret qu'il ignore :
Vous ne savez donc pas le nom de cet ami?
......................
Qu'on cherche mes enfants, qu'on les fasse venir.
...........................
. . . Mes enfants ne viennent point encore !
.........................
Pour la dernière fois je les veux embrasser (75).
Mais ces enfants si désirés d'Alceste, si attendus parle spectateur, comment Lagrange-Chancel, élève, à ce qu'il croyait, du peintre de Joas, contemporain de l'interprète des douleurs maternelles d'Inès, ne les a-t-il pas fait paraître auprès de leur mère mourante, les a-t-il relégués, triste expédient dont il se félicite, dans un insignifiant récit !
Ainsi n'avait point fait Euripide, dont Lagrange-Chancel évite ici bien timidement la trace, pour la suivre ailleurs avec une audace bien indiscrète. Il s'est complu à développer ce qu'Euripide n'avait que trop exprimé, le lâche amour du vieux Phérès pour la vie; il le lui a fait sophistiquement déguiser sous la joie dénaturée et révoltante de ressaisir, au prix de la vie d'une belle-fille et d'un fils, l'autorité royale (76). Ces aveux honteux, d'une franchise invraisemblable, mauvaise imitation de ceux que Corneille a fait sortir de la bouche de son Félix, eussent suffi pour glacer un meilleur ouvrage.
Tel qu'il est, c'est véritablement un chef-d'œuvre et de conception et de style, comparé à la pièce absurde et 229 plate que, vingt-quatre ans après, composa sur ce beau sujet, chose étrange ! l'auteur ingénieux des Dehors trompeurs , Boissy. Un grand prêtre y provoque par de faux oracles Admète et Alceste à se dévouer, l'un pour le salut de son peuple, l'autre pour la vie de son époux; et pourquoi ces fraudes impies et scélérates, avouées dans l'abandon d'une confidence intime avec une étrange impudeur? C'est que ce grand prêtre, frère aîné d'Admète, mais relégué par la volonté de leur père, malgré le droit de sa naissance, dans les honneurs du sacerdoce, veut à tout prix se replacer au rang dont on l'a exclu. Heureusement Hercule, amant d'Alceste et ami d'Admète, arrive à temps pour les sauver du traître qui se fait justice en s'immolant. Voilà ce qu'après Racine, après Voltaire, qui assez récemment, en 1718, avait donné son Œdipe, Boissy osa faire de la charmante fable d'Alceste et du beau drame d'Euripide. Un tel mépris de la tradition antique, des exemples grecs et en même temps du bon sens et du goût, a vraiment de quoi confondre. Ce qui ne confond pas moins, c'est de voir sous quel style misérable ne craignaient pas de se produire, à une époque pourtant de culture littéraire si avancée, ces misérables inventions. Boissy, du reste, en porta la juste peine. Sa pièce, jouée le 25 janvier 1727, avait été défendue après la seconde représentation, sans doute à cause du rôle odieux qu'y remplissait un grand prêtre et des allusions qu'il pouvait fournir à la malignité du public. Reproduite avec changements dans le mois de novembre de la même année, elle dut être retirée par l'auteur, également après la seconde représentation. Elle s'appela d'abord Admète, puis La mort d'Alceste, et c'est sous le troisième titre d'Admète et Alceste qu'elle est restée à jamais consignée dans le recueil très peu visité des œuvres de Boissy.
Les nombreuses pièces de théâtre par lesquelles le dernier et faible héritier des Coypel se consola des disgrâces de son pinceau, étant restées inédites, nous ne pouvons savoir si son Alceste, représentée en 1739 au collège Ma- 230 zarin, se rapprochait, comme cela eût convenu stir uite scène savante, de la vérité antique, ou, oomihe il est plus vraisemblable, des affectations académiques qui la faussent dans ses tableaux, dans ceux de son père et de son aïeul.
Dans le recueil bien futile des pièces de Saint-Foix se trouve un petit acte en prose, intitule Alceste, et représenté sur le Théâtre-Italien en 1752, à l'occasion delà convalescence du Dauphin. Le dévouement conjugal qui avait retenu la Dauphine près de son époux attaqué d'une maladie contagieuse, y était célébré par une allégorie d'un choix heureux, mais d'une exécution faible, où l'on ne peut guère louer que ce qu'y applaudit le public, l'intention.
Une lettre de Ducis, publiée il y a quelques années (77), nous fait connaître qu'il s'occupait en 1773 d'un Admète et Alceste et que, prenant sur lui l'avance, Dorât se hâtait de s'inscrire pour lire aux comédiens une tragédie du même titre commencée d'ailleurs et même en partie imprimée depuis quelques années (78). Nous aurons à dire, un peu plus loin, ce que devint l'œuvre de Ducis. Quant à celle de Dorât, compromise témérairement dans une concurrence inégale, elle n'arriva pas à être représentée; elle dut se contenter, pour tout théâtre, d'un de ces élégants volumes où l'auteur ensevelissait somptueusement ses trop nombreuses et trop faciles productions.
(C'est en 1776 que Gluck ramena, et pour longtemps, sur notre scène lyrique, le sujet d*Alceste. Écrit en 1762 et 1764 sur les paroles italiennes de Galzabigi, et d'abord exécuté non pas en Italie, mais seulement en Allemagne, son opéra y avait excité un grand, un durable enthousiasme, et sans doute suscité l'Alceste allemande que donnèrent en 1773, sur le théâtre de Weimar, également avec un grand succès, mais non sans réclamation con- 231 tre le caractère trop moderne des paroles (79), le célèbre poète Wieland, l'habile compositeur Schweitzer. Chez nous, la musique de Gluck, bien que fort admirée, ne put triompher entièrement des vices d'un livret, à la coupe régulière sans doute, mais sec, mais monotone (80), plus triste que touchant, «t que le style du traducteur de Calzabigi, Duirollet (81), n'avait certainement pas contribué à réchauffer.
On voit dans les recueils dû temps que le dénouement de œt opéra, mis en action selon les lois et les habitudes du genre., fut plus d'une fois changé et toujours sans succès. D'abord, c'était Apollon qui rappelait Alceste à la vie ; ensuite, ce fut Hercule qui vint, .comme autrefois, l'arracher aux divinités infernales;un troisième remaniement, je crois, concilia, tant bien .que mal, l'intervention finale, toujours assez mal venue, du dieu et du demi-dieu. Ce n'est pas cette recherche impuissante d'un dénouement pour l'Opéra d'Alceste qui a suggéré à Ducis, comme il serait naturel de le croire, l'idée première de la tragédie qu'il donna, deux ans après, en 1778, sous le titre d'Œdipe chez Admète. Elle était écrite et reçue, il en faisait des lectures dès 1775 (82). Mais il dut être encouragé par là à bien augurer d'une conception depuis si généralement et si «justement blâmée. On n'avait pas voulu d'Apollon; on n'avait pas voulu d'Hercule : il pouvait espérer qu'Œdipe, venant se substituer au sacrifice d'Alceste, et montrant à sa place et à celle de son époux, serait mieux reçu. S'il a ainsi raisonné, il s'est bien trompé; l'intrusion forcée de ce .nouveau libérateur dans 232 une action à laquelle il était complètement étranger, ne contribua en rien à l'éclatant succès de l'ouvrage; elle l'aurait bien plutôt compromis. « Que pensez-vous de la tragédie nouvelle? demandait-on à Mme d'Houdetot. - J'en ai vu deux, répondit-elle; j'aime beaucoup l'une fort mais peu l'autre (83). » Il était difficile de mieux saisir, de mieux exprimer ce qui est en effet le défaut capital d'une production d'ailleurs si remarquable et, par intervalles, si belle (84), le mélange incohérent de deux sujets qui se nuisent mutuellement, ou plutôt dont l'un nuit à l'autre. Cette pièce qui plaisait tant à Mme d'Houdetot, c'était celle que, plus tard, Ducis détacha de son œuvre, en lui donnant le nom qu'elle avait porté chez Sophocle, et dont elle n'était point indigne, le nom d'Œdipe à Colone. Celle qui ne lui plaisait pas, le poète n'eût pu aussi facilement insoler, la décorer aussi justement du nom d'un des chefs-d'œuvre d'Euripide, du nom d'Alceste. En effet, dans ce combat, où sont engagés mal à propos Sophocle et Euripide, le premier a tout l'avantage ; son Œdipe, son Antigone, son Polynice, une fois arrivés sur la scène, l'envahissent tout entière et laissent bien peu de place l'Admète, à l'Alceste de l'autre ; et ce peu de place, Ducis le réduit encore par ces développements parasites de déclamations morales ou de descriptions, de narrations épisodiques, qu'admettait trop facilement la contexture riche et vide de ses plans. Les sujets les plus simples suffisent aux Grecs, qui s'y renferment sévèrement. Il n'en est pas toujours de même des modernes, qui vont chercher aux environs les lieux communs dont se sont abstenus leurs devanciers. Euripide, par exemple, semble avoir évité de se souvenir qu'Alceste était sœur de ces malheureuses filles que les perfides suggestions de Médée poussèrent au parricide ; il n'a pas troublé les touchantes et pures émotions que devait faire naître sa tragédie, par le terrible et odieux souvenir du meurtre de Pélias. 233 Ducis, au contraire, après Lagrange-Chancel, et probablement à son exemple, s'est complu à le retracer sous la forme d'un songe, très inutilement, et, il est juste aussi de le dire, très énergiquement (85). Sans doute, en peignant 234 l'amour mutuel des deux époux, leurs efforts, l'un pour cacher le secret de sa mort prochaine, l'autre pour faire accepter son sacrifice, leurs combats de générosité, leurs adieux, Ducis, dont le génie était si bien inspiré par les affections domestiques, a rencontré quelques beaux accents de passion (86). Il n'a toutefois qu'effleuré un sujet qui, après lui, restait encore à traiter.
Un tragique illustre, dont le nom est revenu déjà plus d'une fois (87), et reviendra encore dans ces Études, Alfieri, en 1798, l'aborda plus franchement, sinon beaucoup plus heureusement. Depuis dix ans déjà il avait mis fin à ses tragédies, avec le dessein bien arrêté de n'en point accroître le nombre. Il ne s'occupait plus que de suppléer au défaut de son éducation première en apprenant laborieusement, opiniâtrement, le latin, dont il lui était resté bien peu de chose, le grec qu'il n'avait jamais su. Une curiosité naturelle lui fit chercher de préférence dans cette littérature grecque, dont l'accès lui était si tardivement ouvert, les ouvrages qu'avaient tirés les grands tragiques d'Athènes de ces sujets sur lesquels lui-même s'était exercé, après tant d'autres, en ne suivant guère que son propre génie. Arrivé, dans le recueil d'Euripide, à Alceste, dont il n'avait eu jusque-là aucune connaissance, il en fut, lui-même l'a raconté (88), si ému, si transporté, qu'il ne put se défendre non seulement de la 235 traduire, comme il avait traduit auparavant les Perses d'Eschyle, le Philoctète de Sophocle, mais encore, au mépris de ses serments, serments de poète à la vérité, de composer à sa manière une Seconde Alceste. C'est le titre qu'il donna à sa pièce, supposant qu'il l'avait traduite d'Euripide lui-même, d'après une seconde édition, bien différente de la première, édition restée inconnue à tout le monde, excepté au traducteur, et dont lui-même, aa traduction faite, avait égaré le manuscrit. Ce petit roman littéraire, usé et inutile, pouvait, il est vrai, nous l'avons vu (89) s'autoriser de l'usage où étaient les tragiques athéniens, et Euripide en particulier, de reproduire, avec les changements indiqués par la critique, leurs compositions ; toutefois il n'était guère justifié par l'ouvrage même, qui tient sans doute un rang honorable dans les œuvres posthumes du tragique italien, mais dont les beautés De sont rien moins qu'antiques, rien moins que grecques.
Alfieri ne pouvait comprendre que le vieux père d'Admète ne donnât .pas, pour le salut de son fils, le reste de ses jours. Il l'a fait seulement prévenir par Alceste, empressée de savoir la première l'oracle rendu, de l'accomplir avant tous. IL ne comprenait pas davantage qu'Admète se prêtât au sacrifice d'Alceste, où, s'il le savait trop tard pour l'empêcher, qu'il se résignât à .en profiter. Il l'a peint qui, malgré les prières, les •exhortations de «a femme et de ses amis, s'obstine, avec désespoir, à le rendre inutile. Par cette combinaison qui renouvelait le sujet, il a donné à son Alceste, à son Admète, des proportions plus grandes, mais aussi moins humaines, moins favorables à l'émotion. Si l'Alceste antique se dévoue, c'est à défaut de ceux que les relations étroites du sang, qu'un âge déjà voisin du tombeau semblaient appeler avant «elle, à ma. semblable dévouement. L'Admète antique coassent à vivre par Alceste et sans elle ; il ne rejette pas une vie si chèrement payée, tout incomplète, toute 236 flétrie qu'elle doive être désormais. L'un et l'autre sont plus dans la mesure ordinaire, plus près de nous. Je ne pense pas que les Grecs l'aient trouvé mauvais ; qu'Euripide, comme le veut Alfieri, s'en soit fait un reproche : c'eût été se reprocher sa vérité et son pathétique.
Le pathétique était moins le mérite d'Alfieri que l'élévation et la force. Il me paraît manquer à son Alceste, bien qu'écrite, a-t-il dit (90), dans le délire et dans les larmes. Cela tient non seulement à cette hauteur de sentiments qui n'appelle guère la pitié, mais encore à la forme sous laquelle se produisent surtout ces sentiments, celle d'une controverse, sans issue possible, et dont la continuité gratuite a quelque chose de pénible. Rien, on l'a dit, ne sèche plus vite que les larmes. Ce qui surtout en tarit la source au théâtre, c'est la durée trop prolongée d'une situation, même de la plus douloureuse. Celle dans laquelle Alfieri a placé ses personnages, intéresse d'abord et finit par lasser. Admète est revenu à la vie, à la santé, mais non pas à la joie; le souvenir d'une vision menaçante le trouble, et lorsqu'il revoit Alceste, longtemps demandée et attendue, sa pâleur, sa faiblesse, les éclats involontaires de douleur qu'elle mêle à ses félicitations, lui font pressentir le fatal secret qu'elle doit lui révéler. Comment lui fera-t-elle connaître et accepter son sacrifice? C'est pour le spectateur l'objet d'une vive attente (91). Mais une fois la lutte engagée, quand se prolongent sans fin les efforts d'Alceste, continués par d'autres personnages, pour vaincre le désespoir obstiné d'Admète (92), la répétition surabondante, bien que graduée, des mêmes raisons d'une part, des mêmes transports de l'autre, devient une fatigue, un tourment.
Les pièces d'Alfieri ont de l'unité, mais avec une progression lente, un développement uniforme, de la langueur, de la monotonie. Ce qui contribue au défaut de mouvement et de variété qu'on peut remarquer dans son Alceste, c'est la place qu'il y a donnée à un rôle nulle- 237 ment nécessaire, inutile même, et dont je ne puis comprendre qu'il ne se soit pas débarrassé, lui ordinairement si enclin à réduire, autant que possible, le nombre de ses personnages. Phérès servait au dessein d'Euripide, qui voulait faire ressortir, par le contraste de l'égoïste et lâche amour que la vieillesse garde pour la vie, l'héroïque sacrifice qu'en peut faire au besoin la jeunesse. Mais ce même Phérès, avec toutes les vertus que lui avait rendues Alfieri, à quoi pouvait-il lui servir, sinon à redoubler sans fruit, pour ne rien dire de plus, l'expression des sentiments affectueux, tendres, dévoués, des douleurs, des plaintes déjà prodigués dans l'ouvrage, à en combler les vides par des remplissages trop évidents?
La suppression de ce rôle superflu, que tout conseillait à Alfieri, l'eût préservé d'un grave défaut dans lequel on s'est étonné (93), avec raison, qu'il ait pu tomber. Si l'on est choqué d'entendre, chez Euripide, Admète reprocher à son père de n'avoir point voulu mourir pour lui, combien ce reproche ne semble-t-il pas plus révoltant, quand il s'adresse, comme chez Alfieri (94), à un homme qui eût certainement racheté de sa vie la vie de son fils, si le zèle empressé d'une épouse ne lui en eût ravi l'honneur ?
Alfieri, qui suit ici trop religieusement la trace d'Euripide, s'en écarte ailleurs sans nécessité; il faut ajouter sans utilité.
On se rappelle les dernières instances de l'Alceste grecque à son époux, pour qu'après elle il ne prenne pas une nouvelle épouse. Alfieri fait dire à son Alceste qu'une telle demande serait indigne de tous deux; qu'elle ne craint qu'une chose, c'est qu'il ne puisse pas lui survivre (95). Gela est certes plus digne, mais moins naturel, moins touchant.
On peut encore se rappeler par quels détours l'Hercule d'Euripide amène Admète à recevoir en dépôt, à conduire dans sa maison, et de sa propre main, la femme voilée 238 qu'il lui présente et dans laquelle il doit bientôt lui faute reconnaître Alceste rendue à la vie. L'Hercule, d'Alfieri (96) débute brusquement par la lui proposer pour épouse. Ici l'avantage de la dignité, de la délicatesse, n'est pas du côté du poète moderne.
J'ai loué avec d'autres le silence heureux que fait garder Euripide à Alceste revoyant le jour et son époux, mais encore pour quelque temps sous la puissance des divinités infernales. Alfieri le lui a fait rompre (97), imprudemment, je crois, Quelles paroles trouver, pour une situation si vive, qui ne paraissent impuissantes ?
Il est permis de juger difficile à comprendre la victoire d'Hercule sur le Génie de la mort; mais c'est là une obscurité donnée par le sujet, nécessaire, inévitable, qu'Alfieri n'a certainement pas évitée (98) en faisant dire à Hercule qu'il dois garder le silence sur un tel mystère.
Somme toute, l'Alceste d'Alfieri, malgré quelques situation frappantes, quelques traits éloquents, dignes du bon temps de l'auteur, ne répond pas à l'orgueil de son titre; c« n'est pas la Seconde Alceste; il n'y a encore eu, comme il n'y aura probablement jamais qu'une Aceslte.
C'est elle qu'en 1847 nous nous attendions à voir reparaître, tout simplement traduite, sur la même scène, où Ton avait accueilli, en 1844, avec curiosité et intérêt, une traduction de l'Antigone (99). M. Hippolyte Lucas en a bien conserva dans son imitation (100), particulièrement au second acte, les traits les plus touchants :
............
Ô couche nuptiale! ô couche sainte et pure !
Où vierge j'ai laissé dénouer ma ceinture,
C'est par toi que je meurs, mourant pour mon époux :
Cependant contre toi je n'ai point de courroux.
239
Une autre épouse, ô ciel! doit-elle te connaître,
Non plus chaste que moi, plus heureuse peut-être (101)?
mais il y a fait d'ailleurs des changements, qui n'ont pas paru tous des améliorations. Admète déjà compromis, dans la pièce grecque, par le consentement qu'il donne au sacrifice de sa femme, par le reproche qu'il adresse à son père-, pour ne s'être pas lui-même sacrifié, n'avait rien à gagner à ce qu'on le montrât, pendant tout un acte, occupé du soin de se trouver, dans une telle conjoncture, un remplaçant. Alceste elle-même ne pouvait que perdre à ce qu'on la vît prendre part à cette recherche. Lorsque, l'oracle rendu, leurs courtisans, leurs serviteurs, leurs parents, a'esquivant, les uns après les autres, sous divers prétextes, les laissaient à leur embarrassante situation, cela rappelait trop la conclusion du Dissipateur de Destouches, et rapprochait la tragédie, plus que ne l'avait fait Euripide, de la comédie.
Était-ce en outre un bien sûr moyen de sauver la bizarrerie du dénouement que de le mettre hardiment en action?
Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi (102).
Euripide, plus réservé, n'avait donné place au Génie de la mort que dans un prologue ; il ne l'avait pas ramené dans la pièce elle-même ; la lutte de cette puissance infernale' contre Hercule n'avait pats même été, pour le poète, selon les habitudes de son théâtre, le sujet d'un récit ; il avait passé rapidement sur une si étrange merveille, se hâtant de l'envelopper, par la discrétion d'Hercule et le silence d'Alceste, comme d'un voile mystérieux; s'appliquant à en distraire la pensée, à la retenir dans le monde des réalités, par l'expression des affections domestiques, par les émotions confuses de la douleur et de la 240 joie. Il était bien difficile aux modernes de remplacer heureusement l'artifice habile de ces combinaisons.
L'œuvre d'Euripide ne paraît pas devoir cesser jamais d'exciter l'émulation des modernes. L'année 1860 nous l'a fait voir encore, et doublement; dans une traduction en vers, où un de nos professeurs, M. Romtain s'est appliqué à en reproduire fidèlement les simples et pathétiques beautés; dans une tragédie d'Alceste, où un jeune magistrat, M. L. de Vauzelles, qui a dû au modèle grec ou à son esprit plus d'un touchant passage, a tenté, à son tour, de le corriger par un remaniement du sujet, dont cette nouvelle expérience achève d^e démontrer la difficulté (103).
(1) 1. Plat., Sympos.; Appollod., Bibl., l, ix, 15; II, vi, 2; Hyg., Fab. LI. Cf. Palaephat., de Incred. hist, XLI. Citons, comme un argument et aussi un éloge indirect de la tragédie d'Euripide, le passage de Platon. Voici en quels termes Ta rendu Racine dans sa traduction du Banquet :
« .... Non seulement des hommes, mais des femmes même ont donné leur vie pour sauver ce quelles aimaient. La Grèce parlera éternellement d'Alceste, fille de Pélias; elle donna sa vie pour son époux qu'elle aimait, et il ne se trouva qu'elle qui osât mourir pour lui, quoiqu'il eût son père et sa mère. L'amour de l'amante surpassa de si loin leur amitié, qu'elle les déclara, pour ainsi dire, des étrangers, à l'égard de leur fils; il semblait qu'ils ne lui fussent proches que de nom. Aussi, quoiqu'il se soit fait dans le monde un grand nombre de belles actions, celle d'Alceste a paru si belle aux dieux et aux hommes, qu'elle a mérité une récompense gui n'a été accordée qu'à un très petit nombre de personnes. Les dieux, charmés de son courage, l'ont rappelée à la vie; tant il est vrai qu'un amour noble et généreux se fait estimer des dieux mêmes.... »
(2) Il s'y trouve des traits familiers qui l'ont fait quelquefois traiter bien sévèrement. Métastase, dans ses Observations, va jusqu'à l'appeler une scène comique. M. E. Roux, du Merveilleux dans la tragédie grecque, 1846, p. 143, cf. 87, n*en parle pas beaucoup plus favorablement.
(3) V. 1428. Voyez plus haut, p. 67.
(4) En grec Θάνατος,
mot que Macrobe (Saturn. V, 19) traduit par Orcus. Ajax, chez Sophocle, Aj. v.
853 sq., l'invoque à ses derniers moments. On le trouve représenté sur un grand
nombre de monuments antiques reproduits et décrits dans les recueils: voyez,
entre autres, le t. IV des Religions de l'antiquité de M. Gaigniaut,
planches et explications, numéros indiqués dans la table au mot Thanatos.
Il semble que la tradition de ce personnage et même du rôle qu'il joue au début
de l'Alceste, se soit perpétuée en Grèce, jusqu'à nos
jours. Voici ce que raconte, d'après un témoin de la scène, Faufiel, p. cxxxvii du Discours préliminaire de ses Chants
populaires de la Grèce moderne, 1824 :
«.... Une femme de Metsovon, sur le Pinde, avait perdu son mari qui la laissait avec deux enfants en bas âge. C'était une pauvre paysanne, d'un caractère très simple, et qui ne s'était jamais fait remarquer par son esprit. Menant ses deux enfants par la main, elle arriva en présence du corps de son mari, et commença son myriologue par le récit d'un rêve qu'elle avait fait quelques jours auparavant, récit qu'elle adressait au défunt. « Je vis, lui dit-elle, l'autre jour, à la porte de notre maison, un jeune homme de haute taille, d'un air menaçant, ayant à ses épaules des ailes blanches déployées : il était debout sur le seuil de la porte, une épée nue à la main. Femme, me demanda-t-il, ton mari est-il à la maison? Il y est,lui répondis-je; il est là qui peigne notre petit NikoIos; le caressant pour l'empêcher « de pleurer. Mais n'entre pas, terrible jeune homme, n'entre pas; tu ferais peur à notre enfant. Et le jeune homme aux ailes blanches «persistait à vouloir entrer. Je voulus le repousser dehors ; mais je ne fus pas assez forte. Il s'élança dans la maison ; il s'élança sur toi, ô mon bien-aimé, et te frappa de son épée; il te frappa malheureux; et voici, voici ton fils, ton petit Nikolos, qu'il voulait tuer aussi.... » Après ce début, dont l'accent, autant que les paroles, avait fait frissonner les assistants, qui regardaient, les uns vers la porte, comme pour voir si le jeune homme aux ailes blanches y était encore, et les autres, le petit enfant collé aux genoux de sa mère, elle se jeta en sanglotant sur le corps de son mari.... »
Dans un épisode célèbre du Mâha-Bhârata, Sâvitri, l'Alceste indienne, arrache par l'héroïsme de ses sacrifices, par ses courageuses et habiles obsessions, des mains du dieu des morts, Tama, l'âme de son époux Satyavân. M. A. Drtandy a comparé ingénieusement ces deux modèles, si semblables à la fois, et si divers, de l'amour conjugal, dans son Parallèle, déjà cité plus haut, p. 32, d'un épisode de l'ancienne poésie indienne avec des poèmes de l'antiquité classique, 1856. Empruntons à la page 32 de cette dissertation la traduction du passage, où, près de Sâvitri, tenant entre ses bras le corps déjà inanimé de Satyavân, apparaît tout à coup le dieu des morts.
« .... En ce moment elle aperçut un homme vêtu de rouge, les cheveux nattés (et roulés en forme de tiare), homme par le corps, soleil parla splendeur, au teint d'un jaune sombre et aux yeux rouges, tenant une corde à la main, (et) inspirant la terreur. Il était debout aux côtés de Satyavân et le regardait. A la vue de cet homme, elle se leva soudain, et déposa doucement (sur le sol) la tête de son mari. (Puis) les mains jointes, le cœur serré et toute palpitante, elle dit : « Tu es une divinité; je le reconnais, car cette forme n'est point celle d'un mortel. Daigne me dire, ô dieu, qui tu es et ce que tu désires faire ? » — « Tu es dévouée à ton mari, Sâvitri, tu es aussi adonnée à la pénitence; voilà pourquoi je te réponds. Sache, ô belle ! que je suis Yama. Ton mari que voici, Satyavân, à la vie éteinte, fils de roi, c'est lui que j'emmènerai, moi, après l'avoir lié... »
(5) IV, 698 sqq. Cf. Horat., Carm., I, xxviii, 19. etc. Voyez le passage précédemment cité de Macrobe.
(6) Bœckh. Graec. trag. princip., c. vii : « Ita ut ab alterius Hemicbori persona ad alterius personam vicissim oratio transeat obliqua via, veluti lyra in Graecorum conviviis. »
(7) Trach. v. 901 sq. Voyez t. II, p. 77 sq.
(8) Oedip. rex, v. 1226 sqq. Voy. t. II, p. 188 sq.
(9) Aeneid. IV. 648, sqq.
(10) Voyez Cicéron, de Nat. Deor., II, 27.
(11) V. 158-195.
(12) V. 201 sqq.
(13) Voyez t. II, p. 24, 268.
(14) V. 262 sqq. Cf. Virg. Georg., IV, 494 sqq.
(15) Préface a'Iphigénie en Aulide.
(16) Bossuet, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.
(17) On a vu plus haut, p. 68, que dans l'Hippolyte, v. 1447, Thésée disait de même à son fils expirant : « Ne m'abandonne point encore; fais quelque effort, mon enfant »
(18) .V. 293-338.
(19) Sauf toutefois le dernier traducteur d'Euripide; M. Artaud, auquel il paraît plus probable qu'il y avait ici une « allusion à l'usage établi, dans les condamnations capitales, de laisser au condamné un délai de trois jours pour l'exécution de la sentence. »
(20) Rhet. III, 2, §1.
(21) Nouveau, rapport avec l'Hippolyte, v. 852 sqq., où, comme on l'a vu plus haut, p. 57, Thésée suppose que des tablettes qu'il retire des mains glacées de sa femme contiennent une pareille demande, et se hâte, par avance, d'y souscrire.
C'est dans cette scène aussi, v. 370 sqq., que se trouve ce passage précédemment cité, p. 33, à l'occasion d'un passage analogue de l'Iphigénie en Aulide, v. 1200 sqq. : « Si j'avais la langue, la lyre d'Orphée, et que je pusse, fléchissant la fille de Cérès ou son époux, te ramener des enfers, j'y descendrais. Ni le chien de Pluton, ni Charon, le conducteur des âmes, ne pourraient m'empêcher de te rendre à la lumière. »
Il semble que M. Legouvé qui, dans sa Médée, a introduit quelque chose de l'Hippolyte (voyez plus haut, p. 51), se soit souvenu de l'Alceste, aussi bien que du IVe livre des, Géorgiques, lorsqu'il a fait dirait Orphée, acte III, scène 1, en vers charmants:
Et si la mort venait ravir celle que j'aime...
— Tu mourrais! — Non! j'irais affronter la mort même !
Oui ! sans guide, sans arme, une lyre à la main,
J'irais du Phlégéthon tenter le noir chemin!
La douleur donne à l'âme une force divine !
Et parmi les sanglots sortis de ma poitrine,
Ma bouche exhalerait de tels vers, et mes chants
La redemanderaient en accords si touchants, ^
Que Pluton même aurait pitié de mon supplice,
Et les enfers émus me rendraient Eurydice !
(22) V. 384-405.
(23) Poét. XIII. Voyez, à ce sujet, Marmontel, Éléments de littérature, art. Catastrophe.
(24) Édition de Boissonade, t. II, p. 156; cf. Notul, ibid., p. 345.
(25) Voyez t. I, p. 28 et 31
(26) M. Villemaîn, Cours de littérature française, Tableau de la littérature au dix-huitième siècle, XLIIIe leçon, A cette leçon, faite et publiée en 1819, a souvent renvoyé M. Maignien, auteur d'une estimable traduction & Alceste et de judicieuses réflexions sur cette tragédie et le théâtre grec, insérées par lui, en 1837, dans un volume d'Études littéraires. J'ai cité ailleurs d'autres Études qu'il a fait paraître depuis, en 1841, et où il s'est occupé de l'Œdipe Roi et du Prométhée.
(27) Dictionnaire philosophique, art. Anciens et modernes.
(28) L'attachement des vieillards à la vie a été énergiquement exprimé par le même poète dans un autre de ses ouvrages, son Méléagre (voy. le fragment xviii, Stob. cxix, 9, et ce qu'en ont dit Valckenaer, Diatr. xin, et Matthias, Eurip. fragm.) ; et par Sophocle dans son Acrisius (voyez fragments vii, vin, Stob. LXXIV, 28; cxix, 7.)
(29) Wakefield a loué l'exécution de cette scène en des termes bien vifs que reproduit et approuve J. A. Hartung, Euripid.restitut., 1843, t.1, p. 225..
(30) Par exemple les vers 380, 182, 710, 694 de l'Alceste sont parodiés dans les passages suivants d'Aristophane : Acharn. 893: Equit, 1252: Nuib.1415; Av. 1244. ,
(31) Voyez celui que donne, d'après Zoëga, M. Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. IV, n° CLXXIII des planches, et 651 de l'explication.
(32) Voyez Voltaire, Dictionnaire philosophique, art. Anciens et modernes,
(33) On le trouve signalé chez les anciens eux-mêmes. Valère Maxime, liv. IV. c. vr, § 1, racontant comment Tiberius Gracchus avait tourné contre sa propre vie un présage qui pouvait menacer celle de sa femme Cornélie, en prend occasion pour adresser à Admète cette véhémente apostrophe : « O te, Thessaliae rex, Admete, crudelis et diri facti crimine sub magno judice damnatam ! qui conjugis tuae fata pro tuis permutari passus es, ea que. ne tu exstinguereris, voluntario obitu consumpta, lucem intueri potuisti! Et certe prius parentum indulgentiam tentaveras, femineo anlmo imparinventus. »
(34) V. 789 sqq.
(35) Boettiger, Arisiophanes impunitus deorum gentilium irrisor, Leips., 1790; Opuscula, 1837,.p. 82.
(36) Aristoph., Ran. 549 sqq. ; Av. 1578 sqq.; Vesp. 60.
(37) God. Hermann, de Compositione tetralogiarum tragicarum, Opusc.t. II, p. 318 : « .... Hercule illo vis quidquam divinius ab Euripide factum est.... » Voyez encore, à ce sujet, J. A. Hartung, ibid., p. 220 sqq
(38) Dictionnaire philosophique, art. Anciens et moderne*.
(39) Lycée.
(40). M. Villemain, Cours de Littérature française, passage précédemment cité.
(41) Nouveaux mélanges historiques et littéraires; Essai littéraire sur Shakspeare.
(42) Les exemples du contraire sont très rares ; on n'en peut guère citer avec celui-ci que deux, l'un dans les Euménides, v. 229, l'autre dans l'Ajax,v. 814. Voyez t. 1, p. 372; t II, p. 21.
(43). V. 933-946.
(44) V. 963-967. Je ne puis me défendre de rapprocher de cette scène celle où Bernardin de Saint-Pierre a exprimé si pathétiquement la douleur de Paul revoyant, après le départ de Virginie, l'habitation qu'elle a quittée.
(45) Cic. Tusc. III 14 ; Val. Max. V. 10 ; Plutarch., Consol. ad Apollon. 33, etc. M. Th. Fix. qui ne doute pas de la réalité de cette allusion, s'en sert pour confirmer la date donnée à l'Alceste par la didascalie, assez récemment découverte, que nous avons rapportée, t. I, p. 31,Olymp. LXXXV, 2. Voyez dans l'Euripide de la Bibliothèque grecque de F. Didot. 1843, sa Chronologia faoularum, p. v. Une autre confirmation de cette date, à certains égards, résulte des parodies de l'Alceste, dans quelques pièces d'Aristophane, dont il a été question plus haut, p. 213, note 3. dans les Acharniens, les Chevaliers, les Nuées, les Oiseaux, pièces données seulement à partir de la quatrième année de la LXXXVIIIe olympiade.
(46) V.927 sqq.
(47) Un commentateur anglais rapproche cette situation de celle qui termine le Conte d'hiver de Shakspeare (acte V, se. 8). Cette image, par degrés animée, dans laquelle le roi de Sicile finit par reconnaître une épouse autrefois condamnée par lui, quoique innocente, et dont depuis longtemps il pleurait la perte, n'est pas, en effet, sans analogie avec la femme voilée dans laquelle Admète retrouve, après tant de surprise et de joie, son Alceste perdue.
(48) Voyez t. II, p. 111.
(49) L'Imagination, chant IV.
(50) Voyez t I, p. 28, 31, et plus haut, p. 210.
(51) Le premier, je crois, qui ait renouvelé cette assimilation, c'est l'abbé d'Aubignac dans sa Pratique du théâtre. Elle a été présentée assez récemment, avec des développements dignes d'attention, par M. Hartung, ibid., p. 229 et suiv,
(52) Schoell., t. III, ch. xi ; t. II; p. 56.
(53) T. I, p. 19 sq.
(54) Hésych., v. ἄθαμβες.
(55) Voyez Meineke, Fragm. comic, grœc, t.1, p. 324 ; t. III, 15.
(56) Athen., Deipn. III; XII.
(57) Bœckh, Corpus inscript, graec, I, n° 231. Cf Meineke, ibid.
(58) A. Gell., XIX, 7 ; Non., v. Obesum.
(59) Fulgent,, Exposit. Serm. ant., v. Friguttire. Cf. Bothe, Poet. scen. lat. ; Fragm. trag., p. 31 ; comic., p. 7.
(60) Priscian. IX, X.
(61) Voyez Lange, Vindic. trag. rom., p. 9,10; Bothe, ibid. ; Weichert, Poet. lat. reliq.; de Laevio, p. 19 sqq. M. O. Ribbeck. dans ses Tragic. latin, reliq.. 1842, ne fait mention que de l'Alceste d'Attius
(62) Voyez plus haut, p. 169.
(63). Buchanani vita ab ipso scripta biennio ante mortem.
(64). Cet à-propos pourrait bien être une réminiscence de Sénèque, qui fait dire à Thésée, Hippol, 841 sq. :
Qui, quum revulsum Tartaro extraheret canam,
Me quoque supernas
pariter ad sedes tulit;
et ailleurs, Herc. fur., 802 sqq. :
Ingeminat ictus, domitus infregit minas ;
Et cuncta lassus capita submisit canis,
Anttroque toto cessît. Extimuit sedens
Uterque solio dominus; et duci jubet :
Me quoque petenti munus Alcidae dedit.
(65) 1. Acte II.
(66) Voyez plus haut, p. 193
(67) Éléments de Littérature, art. Canevas.
(68) Dictionnaire philosophique, art. Art dramatique.
(69) Lycée
(70) Acte IV, sc. 3.
(71). Page 203. Voy. H. Rigault, Querelle des anciens et des modernes, 1856, p. 132.
(72) Théâtre des Grecs; Réflexions sur Alceste.
(73) Histoire du Théâtre français, t. XIV, p. 319 ; La Harpe, Lycée.
(74) Les festons magnifiques dont Racine, au début d'Athalie, orne dans ses solennités le temple de Jérusalem sont, par exemple, bien hors de propos transportés par le servile copiste aux autels domestiques dont Alceste prend congé :
Là ses brûlantes mains de festons magnifiques
Entourent les
autels de ses dieux domestiques.
(Acte V, sc. 1.)
Campistron avait donné à Lagrange-Chancel l'exemple de ce genre d'imitation. On a souvent cité, d'après Voltaire {Aux auteurs du Nouvelliste du Parnasse), ce passage de son Alcibiade, qui rappelait si maladroitement deux vers célèbres du Britannicus de Racine :
Je parlerai du moins avec la liberté
D'un Grec qui ne doit point cacher la vérité
(75) Acte IV, sc. iv.
(76) Voyez acte IV, sc. i, ii. Dans la première de ces deux scènes se trouvent des vers imités quelques années après par Voltaire, dans son Œdipe :
... Ah ! que le sort des rois est digne de pitié !
Tandis qu'ils sont heureux, ils ont votre amitié ;
Mais le moindre revers écarte votre foule,
Et, comme leur bonheur, votre amitié s'écoule.
(77) Voyez Revue de Paris, 16 mai 1844, n° 7, p. 83.
(78) Amilka, ou Pierre le Grand, tragédie.... suivie d'un extrait de la tragédie Alceste; Paris, 1767.
(79) Voyez le dialogue satirique publié en 1774 par Gœthe, sous ce titre : les dieux, les héros et Wieland; voyez aussi ce qu'il ait de cet opuscule au livre quinzième de ses Mémoires.
(80) Voyez les Fragments d'Observations de J. J. Rousseau sur l'Alceste italienne de M. le chevalier Gluck.
(81) Auteur également des paroles de l'Iphigénie en Aulide de Gluck. Voyez plus haut, p. 6.
(82) Voyez les lettres de Ducis rapportées par M. Campenon, p. 208 et suivantes de ses Essais de mémoires sur la vie, le caractère et les écrits de J . F. Ducis, 1844.
(83) Correspondance de Grimm.
(84 Voyez t. II, p. 208 sqq.
(85) Je rapporterai ici les deux morceaux de Lagrange-Chancel et de Ducis, comme complément de ce que j'ai dit plus haut,p. 188 sqq., du terrible sujet traité par Euripide dans ses Péliades. Voici le premier, ou du moins en voici les premiers vers :
Mon père Pélias, je frémis d'y
penser,
A mes sens cette nuit s'est venu retracer,
Tel qu'autrefois, chargé de vieillesse et de gloire,
Je le vis des fureurs éprouver la plus noire.
J'ai cru le voir encor dans les bras du sommeil,
Attendant sans effroi le retour du soleil.
Mes sœurs, entre la crainte et l'espoir balancées,
Autour du bain fatal paraissaient empressées;
L'une du feu trop lent ranimait les ardeurs,
L'autre exprimait le suc des herbes et des fleurs;
Une lampe, éclairant leur démarche timide,
Conduit jusqu'au vieillard la troupe parricide.
Trois fois à cet objet leur courage a frémi ;
Trois fois leur bras levé ne descend qu'à demi.
Il semblé que d'un dieu le regard les arrête,
Ou que de la Gorgone il leur montre la tête.
Chacune à son forfait voulant se dérober,
Le coup demeure en l'air, et n'ose retomber.
Alors, comme autrefois, je n'ai rien vu de suite.
(Acte I, se. 2.)
Écoutons maintenant Ducis :
Dans ce temps de la nuit, où des
vapeurs plus sombres
Redoublent le sommeil, épaississent les ombres.
Le trépas de mon père (ô ciel! puis-je y penser?)
A mes esprits tremblants s'est venu retracer.
De son pouvoir Médée étalant les merveilles,
De mes crédules sœurs enchantait les oreilles;
Et, pour les mieux tromper, leur rappelait Aeson
Rendu par un prodige à sa jeune saison.
Par un prodige égal, déjà chacune espère
Remplir d'un sang nouveau les veines de son père.
Le bain fatal est prêt, les feux sont allumés;
Des rayons de l'espoir leurs yeux sont animés ;
On s'arme de poignards ; incertaine et timide,
Leur main semble un moment prévoir le parricide :
Médée exhorte; on marche, on s'avance sans bruit;
On rend grâce au silence, aux horreurs de la nuit ;
On entre dans la chambre, où de ses traits funèbres
Un jour pâle et mourant éclairait les ténèbres,
Et, découvrant à peine un vieillard endormi,
Ne laissait entrevoir le forfait qu'à demi.
On dirait qu'à l'aspect de l'auguste victime
La nature à leurs cœurs a révélé leur crime :
La piété l'emporte, et leurs couteaux pressés
S'entre-choquent soudain dans son cœur enfoncés ;
Leur parricide zèle, innocemment Impie,
En déchirant son sein, croit lui donner la vie.
Sa mort lui montre enfin leur détestable erreur.
Médée, en s*échappant, insulte à leur douleur.
Leurs pleura, leurs bras tendus couvrent le lit funeste :
Le crime est consommé, le désespoir leur reste.
Ce bain, ce sang, ces cris, ces poignards odieux,
Ce vieillard palpitant est encor sous mes yeux.
(Acte I, sc. 3)
(86) On voit dans la lettre dont il a été question plus haut, p. 230, que, lorsqu'il abordait ce sujet, en 1773, une circonstance douloureuse le lui rendait propre. 11 venait de perdre une femme tendrement aimée. « J'agis voulu peindre Y Alceste grecque, écrit-il; et j'ai eu bientôt mon Alceste véritable à pleurer. »
(87) Voyez t. I, p. 306 sqq.; p. 346 sq.; II, p. 289 sqq.; 375 sqq.
(88) Mémoires, IVe Époque, ch. xxvi.
(89) T. I, p. 68 sqq.; III, 8 sqq.; 70 sqq.; 184 sqq.
(90) Mémoires, ibid.
(91). Acte II.
(92) Actes III, IV, V
(93) M. Raoul Rochette, Nouvelles Observations sur l'Alceste d'Euripide, Théâtre des Grecs de Brumoy, édition de 1820, t. VII, p. 414
(94) Acte III, se. ii
(95) Acte III, se. i.
(96) Acte V, sc. i.
(97) Ibid.
(98) Ibid.
(99) Voyez notre t. II, p. 262, 272, 293
(100). Alceste, tragédie en trois actes, représentée sur le, second théâtre français, le 16 mars 1847.
(101) Acte n, se. viii.
(102) Horat. Ad Pison., 188.
(103) Nous avons commencé, p. 197, par rappeler l'hommage que Platon a rendu à la vertu d'Alceste. Citons, en finissant, ce qu'en a dit, développant les idées de Platon, notre Fénelon (Divers sentiments et avis chrétiens, etc., III, Sur le pur amour; Œuvres, éd. in 4° de 1792, t. VIII, p. 62, 68). Alceste et son sublime dévouement lui ont servi à faire comprendre, par analogie, cette affection désintéressée qu'il recommande d'avoir pour Dieu :
« .... Platon cite l'exemple d'Alceste, morte pour faire vivre son époux. Voilà, suivant Platon, ce qui fait de l'homme un dieu, c'est de préférer par amour autrui à soi-même, jusqu'à s'oublier, se sacrifier, se compter pour rien. Cet amour est, selon lui, une inspiration divine ; c'est le beau immuable qui ravit l'homme à l'homme même et qui le rend semblable à lui par la vertu.... Alceste est l'admiration des hommes pour avoir voulu mourir et n'être plus qu'une vaine ombre, afin de faire vivre celui qu'elle aime. Cet oubli de soi, ce sacrifice total de son être, cette perte de tout soi-même pour jamais est aux yeux de tous les païens ce qu'il y a de plus divin dans l'homme; c'est ce qui en fait un dieu.... »
Rapprochons aussi de l'allusion touchante rappelée p. 234, note 1, celle qu'une situation pareille a inspirée à Milton. Voici en quels termes, fidèlement et vivement rendus par M. Villemain [Rapports académiques et choix d'études sur la littérature contemporaine, p. 267), ce grand poète commence un pathétique sonnet consacré à une bien chère mémoire, celle de sa seconde femme, morte en couches, après un an de mariage :
« Il m'a semblé crue je voyais la
sainte, ma défunte épouse, conduite à moi du fond de la tombe,
comme Alceste, que le fils héroïque de Jupiter, l'ayant reprise
de force à la mort, rendit à son heureux époux, encore toute
pâle et languissante.... »