LIVRE
I - L'Égypte jusqu’à l’invasion des Pasteurs
Chapitre
I - L'Égypte primitive
Le
Nil et l'Égypte
Le premier des voyageurs qui ait visité l'Égypte, le premier du moins qui nous ait laissé le récit de son voyage, Hérodote d'Halicarnasse, a résumé l'impression que produisit sur lui cette contrée merveilleuse en une seule phrase, souvent citée : « L'Égypte est un don du Nil[1] ». L'Égypte n'est qu'une bande de terre végétale tendue à travers le désert, une oasis allongée aux bords de la rivière et sans cesse approvisionnée par elle de l'humidité nécessaire à la végétation. Il faut l'avoir vue au moment de l'étiage, un mois avant le solstice d'été, pour se figurer ce qu'elle deviendrait Si quelque accident la privait de son fleuve nourricier. « Le Nil s'est resserré entre ses rives au point d'être réduit à la moitié de sa largeur habituelle, et ses eaux troublées, limoneuses, stagnantes, semblent à peine couler dans une direction quelconque. Des bancs plats ou des masses abruptes d'une boue noire, cuite et recuite au soleil, forment les deux berges. Au delà, tout c'est plus que poudre et que stérilité, car c'est à peine si le khamsin, le vent chargé de sable qui dure quarante jours, a cessé de souffler. Le tronc et les branches des arbres apparaissent çà et là à travers l'atmosphère terreuse, aveuglante, enflammée, mais les feuilles sont tellement engluées de poussière, qu'à faible distance on ne peut plus les distinguer du désert qui les environne. C'est seulement à force d'arrosages pénibles et laborieux qu'on parvient à entretenir quelque semblant de verdure dans les jardins du Pacha. Enfin, - et c'est le premier indice qui annonce la fin de cette saison terrible, - le vent du nord, l'Etésien des Grecs, se lève et se met à souffler avec violence, parfois même avec furie, pendant tout le jour. Grâce à lui, le feuillage des bosquets dont la Basse Égypte est parsemée se débarrasse de la poussière et recouvre sa couleur verte. Les ardeurs dévorantes du soleil, alors au plus haut de sa course, sont aussi fort à propos amoindries par le vent qui règne, ce mois-là et les trois suivants, sur tout le pays d'Égypte.
« Bientôt un changement se produit dans le fleuve. On signale au nilomètre du Caire une hausse d'un pouce ou deux ; les eaux perdent le peu de limpidité et de fraîcheur qui en faisaient, hier encore, une boisson délicieuse. Elles prennent la teinte verte, gluante et terne de l'eau saumâtre entre les tropiques, sans que filtre au monde ait réussi jusqu'à ce jour à les débarrasser de la pulpe nauséabonde et malsaine qui cause cette altération. Le phénomène du Nil vert provient, à ce qu'on dit, des vastes nappes dormantes que le débordement annuel abandonne sur les larges plaines sablonneuses du Soudan, au sud de la Nubie. Après avoir croupi six mois et plus sous le soleil des tropiques, elles sont balayées par l'inondation nouvelle et elles rejoignent le lit du fleuve. Il est heureux que ce phénomène dure rarement plus de trois ou quatre jours, car, si court que soit ce temps, les malheureux contraints de s'abreuver au Nil, lorsqu il est dans cet état, éprouvent des douleurs de vessie insupportables. Aussi les habitants des villes ont-ils la prévoyance d'approvisionner d'eau leurs réservoirs et leurs citernes.
« Dés lors la rivière augmente rapidement de volume et elle se trouble par degrés. Il s'écoule pourtant dix ou douze jours avant l'apparition du dernier et du plus extraordinaire phénomène que présente le Nil. J'essayerai de décrire les premières sensations qu'il me fit éprouver. C'était à la fin d'une nuit longue et accablante, à mon juger du moins ; au moment où je me levai du divan sur lequel j'avais tenté vainement de dormir, à bord de notre bateau que le calme avait arrêté au large de Benisohef, ville de la Haute Égypte, le soleil montrait tout juste le bord supérieur de son disque au-dessus de la chaîne Arabique. Je fus étonné de voir qu'à l'instant où ses l'ayons vinrent frapper l'eau, un reflet d'un rouge profond se produisit sur-le-champ. L'intensité du ton ne cessa de s'accroître avec l'intensité de la lumière avant même que le disque se fût dégagé complètement des collines, le Nil offrait l'aspect d'une nappe de sang. Soupçonnant quelque illusion, je me levai à la hâte, et, me penchant par-dessus le bordage, ce que je vis me confirma dans ma première impression. La masse entière des eaux était opaque, d'un rouge sombre, et plus semblable à du sang qu'à toute autre matière avec laquelle j'aurais pu la comparer. En même temps, je m'aperçus que la rivière avait haussé de plusieurs pouces pendant la nuit, et les Arabes vinrent m'expliquer que c'était là le Nil rouge. La rougeur et l'opacité de l'eau sont soumises à des variations constantes, tant qu'elle reste dans cette condition extraordinaire. A de certains jours, quand la crue n'a pas dépassé un pouce ou deux, les eaux redeviennent à demi transparentes, sans perdre toutefois cette teinte d'un rouge sombre dont j'ai parlé. Il n'y a point là de mélange nuisible, comme au temps du Nil vert: l'eau n'est jamais plus saine, plus délicieuse, plus rafraîchissante que pendant l'inondation. Il y a des jours où la crue est plus rapide, et, par suite, où la quantité de limon charrié dépasse, dans la Haute Égypte, la quantité entraînée par toute autre rivière à moi connue : même, en plus d'une occasion, j'ai pu m'apercevoir que cette masse opposait un obstacle sensible à la rapidité du courant. Un verre d'eau, que je puisai alors et que je laissai reposer pour un peu de temps, fournit les résultats suivants la partie supérieure du liquide resta parfaitement opaque et couleur de sang, tandis qu'un précipité de boue noire remplissait environ Je quart du verre. Une portion considérable de ce limon est déposée avant que la crue atteigne la Moyenne et la Basse Égypte, où je n'ai jamais vu l'eau du Nil en cet état.
« Il n'y a peut-être pas, dans tout le domaine de la nature, un spectacle plus gai que le spectacle présenté par la crue du Nil. Jour après jour et nuit après nuit, le courant trou¬blé roule et s'avance majestueusement par delà les sables altérés des immenses solitudes. Presque d'heure en heure, taudis que nous remontions lentement, poussés par le vent du nord, nous entendions le fracas produit par la chute de quelque digue de boue; nous voyions, au mouvement de toute la nature animée vers le lieu où le bruit venait de retentir, que le Nil avait franchi un nouvel obstacle et que ses eaux bondissantes allaient répandre la vie et la joie au milieu d'un autre désert. Des impressions que j'ai reçues, il y en a peu dont le souvenir me laisse autant de plaisir que l'impression causée par la vue du Nil, à la première invasion de son débordement annuel dans l'un des grands canaux. Toute la nature en crie de joie. Hommes, enfants, troupeaux de buffles, gambadent dans ses eaux rafraîchissantes, les larges vagues entraînent des bancs de poissons dont l'écaille lance des éclairs d'argent, tandis que des oiseaux de toute plume s'assemblent en nuées au-dessus. Et cette fête de la nature n'est pas restreinte aux ordres les plus élevés de la création. Au moment où le sable devient humide à l'approche des eaux fécondantes, il s'anime littéralement et grouille de millions d'insectes. L'inondation gagne Memphis ou le Caire quelques jours avant le solstice d'été : elle atteint sa plus grande hauteur et elle commence à décliner aux environs de notre équinoxe d'automne. A peu près au moment de notre solstice d'hiver, le Nil est redescendu entre ses rives et il a endossé sa livrée bleu clair. Les semailles ont été faites durant cet intervalle et elles s'achèvent vers le moment que l'inondation finit. Le printemps est suivi sur-le-champ par la moisson, et la récolte est rentrée d'ordinaire avant le lever du khamsin ou vent de sable. L'Année d'Égypte se partage donc naturellement en trois saisons : quatre mois de semailles et de croissance, qui correspondent approximativement à nos mois de novembre, décembre, janvier et février ; quatre mois de récolte, qu'on peut de même indiquer, d'une manière vague, en les comparant aux mois de notre calendrier qui sont compris entre mars et juin inclusivement ; les quatre mois ou lunes de l'inondation complètent le cycle de l'année égyptienne[2]. »
Les Égyptiens ne connaissaient pas la source de leur fleuve. Vainement leurs armées victorieuses l'avaient longé pendant des semaines et des mois, à la poursuite des tribus noires ou koushites : toujours elles l'avaient trouvé aussi large, aussi plein, aussi puissant d'allures qu'il était dans leur patrie. C'était moins un fleuve qu'une mer, et mer était le nom qu'ils lui donnaient[3]. Les prêtres n'étaient pas en peine d'expliquer son origine. Il descendait du ciel ; il était l'image en cette terre des eaux d'en haut, sur lesquelles flottaient les barques des dieux ; il naissait entre Eléphantine et Philae, parmi les rochers de la cataracte, dans deux gouffres insondables qu'on appelait les Qarati[4]. Ses inondations n'étaient pas un phénomène naturel : elles étaient produites par les larmes d'Isis et elles devaient leur vertu à cette provenance divine. A ces légendes dévotes s'ajoutaient mille histoires merveilleuses qui avaient cours parmi le peuple. On contait que des matelots 'se rendant aux mines de Pharaon avaient fini, à force de remonter le courant, par déboucher dans la mer inconnue qui baignait le pays de Pouanît : de même les marchands arabes du moyen âge croyaient qu'on pouvait aller par eau d'Égypte au pays des Zindjes et dans l'océan Indien[5]. Cette mer était semée d'îles mystérieuses, semblables à ces îles enchantées que les marins portugais et bretons apercevaient parfois dans les lointains de l'horizon et qui s'évanouissaient quand on voulait en approcher. Elles étaient peuplées par des êtres fantastiques, quelquefois cruels aux naufragés, quelquefois bienveillants. Quiconque en sortait n'y pouvait plus rentrer; elles se résolvaient en flots et elles disparaissaient au sein des ondes[6].
Jadis toute la région de l'Égypte aujourd'hui connue sous le nom de Delta était recouverte par la mer : la Méditerranée baignait de ses vagues le pied du plateau sablonneux que dominent les grandes Pyramides, et le Nil se terminait un peu au nord de l'emplacement où la ville de Memphis fleurit plus tard. A la longue, les matières terreuses qu'il amène avec lui des montagnes d'Abyssinie se déposèrent en bancs de boue sur les bas-fonds de la côte et comblèrent une partie du golfe ; elles s'étalèrent en larges plaines marécageuses, entrecoupées d'étangs, à travers lesquelles les eaux durent se frayer passage. Consolidés par les apports marins, ces terrains nouveaux constituèrent un premier Delta, dont la pointe atteignait un peu au-dessous de Memphis et les extrémités prés de quinze lieues plus bas, dans les parages d'Athribis. Puis, le fleuve continuant son travail et les alluvions gagnant toujours, la chaîne des dunes qui bordait au nord ce premier Delta vit la mer se retirer peu à peu vers le Nord et se trouva délaissée dans l'intérieur des terres, où ses restes indiquent encore par endroits la direction du littoral ancien : dés les commencements de la période historique, le Nil avait projeté ses embouchures en avant de la ligne normale des rivages environnants. Près du village antique de Kerkasore, il se divisait en trois branches : la Pélusiaque tournait au N.-E. et se terminait aux confins du désert de Syrie ; la Canopique se dirigeait vers le N.-O. en baignant les derniers versants du désert Libyque ; la Sébennytique, poussant dans le prolongement de la vallée, courait presque droit au Nord et coupait le Delta en son milieu[7]. Ces trois grands bras étaient unis l'un à l'autre par un lacis de canaux naturels et artificiels, dont quelques-uns tombaient directement dans la mer et portaient le nombre des bouches du Nil à sept[8], et même à quatorze[9], selon les époques. La plaine triangulaire qu'ils enfermaient, et dont chaque portion avait été charriée grain à grain du fond de l'Afrique, compte aujourd'hui environ 25 000 kilomètres carrés de superficie et elle croît chaque année.
Les prêtres, qui savaient par tradition l'état primitif de leur patrie, croyaient pouvoir déterminer avec certitude l'espace de temps qui avait suffi au fleuve pour accomplir son travail. Ils racontaient à Hérodote que Ménès, le premier des rois de race humaine, avait trouvé l'Égypte presque entière plongée sous les eaux : la mer pénétrait jusqu'au delà de l'emplacement de Memphis, en pleine Heptanomide, et le reste du pays, moins le nome de Thèbes, n'était qu'un marais malsain[10]. Ils se trompaient étrangement dans leur appréciation. Le Nil, soumis à des débordements annuels, abandonne la plus grande partie des matières qu'il entraîne sur les campagnes riveraines, et s'appauvrit de plus en plus à mesure qu'il avance ; il n'arrive à la mer que dépouillé du gros de ses alluvions. C'est à peine Si les plages basses qui sont en voie de formation au débouché des branches Canopique et Sébennytique s'accroissent, bon an mal an, l'une de quatorze hectares, l'autre de seize; c'est une moyenne d'un mètre de progrès annuel pour tout le front du Delta. Eu s'appuyant sur ces données, on a pu calculer que, dans les conditions actuelles, il aurait fallu environ sept cent quarante siècles au Nil pour combler son estuaire. Sans accepter aucunement ce chiffre dont l'exagération parait évidente, car la marche progressive des boues était plus rapide autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui dans ces contrées, on n'en sera pas moins forcé de conclure que les prêtres ne soupçonnaient guère l'âge réel de la contrée. Le Delta existait depuis longtemps déjà à l'avènement de Ménès ; peut-être même était-il entièrement terminé à l'époque où la race égyptienne posa pour la première fois le pied dans la vallée qui devint sa demeure.
Le Nil n'a pas seulement créé le sol de l'Égypte, il en a déterminé l'aspect général et le genre de ses productions. Une vallée, qui est sortie tout entière du sein des eaux et qui est chaque année envahie de nouveau par elles, ne peut nourrir qu'un nombre assez restreint d'espèces végétales. Le sycomore et plusieurs sortes d'acacias et de mimosas y prospèrent ; le grenadier, le tamarin, l'abricotier, le figuier ornaient les jardins, et la présence du perséa sur les monuments de la douzième dynastie nous prouve que Diodore commit une erreur en attribuant au Perse Cambyse le mérite d'avoir le premier introduit cet arbre[11]. Deux espèces de palmiers, le dattier et le doûm[12], viennent presque sans culture ; mais aucune de nos grandes essences européennes ne s'est acclimatée dans la partie fréquentée par les anciens. D'autre part, les plantes aquatiques s'y développaient avec un luxe de végétation extraordinaire, et lui donnaient un aspect caractéristique. On ne les rencontrait pas, en général, au long des berges, où la profondeur de l'eau et la force du courant ne leur permettraient guère de croître en paix ; mais les canaux, les étangs, les mares que l'inondation laisse derrière elle, en étaient littéralement encombrés. Deux espèces surtout, le papyrus et le lotus, sont célèbres en Europe à cause du rôle qu'elles jouent dans l'histoire, la religion, la littérature sacrée ou profane de l'Égypte. Le papyrus se plaisait dans les eaux paresseuses du Delta et il devint l'emblème mystique de cette région ; le lotus au contraire fut choisi pour symbole de la Thébaïde. Les anciens confondaient sous ce nom des individus appartenant à trois espèces de nymphéas différentes. Deux d'entre elles, le lotus blanc et le lotus bleu, portent des fruits assez semblables pour la forme à ceux du pavot : leurs capsules renferment de petites graines de la taille d'un grain de millet. La troisième espèce, le Nymphæa nelumbo ou nénuphar rose, est décrite fort exactement par Hérodote. « Elle produit un fruit porté sur une tige différente de celle fleur et qui sort de la racine même qui porte la il est semblable pour la forme aux gâteaux de cire des abeilles », ou, plus prosaïquement, à une pomme d'arrosoir. Il est percé, à la partie supérieure, de vingt ou trente cavités dont chacune contient une graine « de la grosseur d'un noyau d'olive, bonne à manger fraîche ou desséchée »[13]. C'est là ce que les anciens appelaient la fève d'Égypte[14]. « On cueille également, ajoute l'historien, les pousses annuelles du papyrus. Après les avoir arrachées dans les marais, on en coupe la tête, qu'on rejette, et ce qui reste est à peu près de la longueur d'une coudée. On s'en nourrit et on le vend publiquement ; cependant les délicats ne le mangent qu'après l'avoir fait cuire au four[15]. » Ce « pain de lis » était une friandise recherchée et figurait sur les tables royales[16] ; mais, quoi qu'en dise Hérodote[17], la nourriture habituelle du peuple était le blé et les différentes espèces de céréales, le froment, l'orge, le sorgho, l'olyra (Triticum spelta) et la zéa (Triticum monococcum), que le sol d'Égypte produit en abondance. La vesce, le lupin, la fève. le pois chiche, la lentille, plusieurs espèces de ricin naissaient naturellement dans les champs. La vigne venait à merveille dans certains cantons du Delta ou de l'Heptanomide ; l'olivier était rare et restreint à quelques districts[18].
Deux au moins des espèces animales qui vivent à présent sur les bords du Nil, le cheval et le chameau[19], ne sont pas figurées sur les monuments des plus anciennes dynasties et paraissent n'avoir été introduites que longtemps après la fondation du royaume. En revanche, les Égyptiens possédaient plusieurs races de boeufs à longues cornes, analogues aux boeufs de Dongolah, plusieurs variétés de moutons, de chèvres et de chiens, le chien-renard à robe fauve, au nez effilé, aux oreilles pointues, à la queue épaisse, le sloughi ou grand lévrier d'Afrique à oreilles longues et droites, le basset, le chien hyénoïde[20]. L'âne, d'origine africaine, garda sous ce climat favorable une beauté de formes et une vigueur de tempérament que n'a point notre baudet d'Europe[21]. A côté des espèces domestiques, les premiers émigrants trouvèrent le lièvre à longues oreilles, l'ichneumon, une quantité innombrable d'oryx, de àubales, de gazelles, algazelles, defassas, antilopes à cornes en lyre qu'ils apprivoisèrent à moitié[22] : puis des animaux plus redoutables, le chat sauvage, le loup, le chacal, le renard, l'hyène striée et mouchetée, le léopard, le guépard, le lion enfin[23], qu'ils combattirent sans relâche et qu'ils refoulèrent vers le désert[24]. Deux monstres amphibies, le crocodile et l'hippopotame, vivaient sur les bords du Nil et ils en rendaient les abords dangereux pour les hommes et pour les bestiaux. Les hippopotames, assez nombreux sous les premiers rois, diminuèrent bientôt, grâce aux poursuites acharnées dont ils furent l'objet, et se retirèrent dans les marais de la Basse Égypte : quelques individus de leur espèce y subsistaient encore vers le milieu du treizième siècle après Jésus-Christ. Le crocodile, adoré et protégé dans certains nomes, exécré et poursuivi dans certains autres, s'est maintenu jusqu'à nos jours. « Quand il passa devant Qénéh, Champollion vit jusqu'à quatorze crocodiles réunis en conciliabule sur un îlot. Si pareille bonne fortune n'échoit jamais maintenant au voyageur, c'est que le crocodile recule de plus en plus vers le sud devant les armes à feu et l'agitation produite par les bateaux à vapeur, et que bientôt le Nil jusqu'à Assouan ne les connaîtra plus que par tradition[25]. »
L'Égypte possède une grande quantité d'oiseaux, l'aigle, le milan, l'épervier, le faucon, le vautour, la corneille à mantelet, la pie, le pigeon, la tourterelle, la perdrix, le moineau. Les ibis blancs et noirs, les pélicans, le cormoran, l'oie, le canard, hantent les bas-fonds et couvrent les îlots du fleuve de leurs variétés infinies. L'oie et le canard, apprivoisés de toute antiquité, remplissaient la basse-cour des sujets de Ménès et tenaient la place du poulet, encore très rare[26]. Les bras et les canaux du Delta fourmillent littéralement de poissons, la plupart bons à manger, « le rouget des marais de Péluse (?), engraissé dans les lotus, le mulet tacheté des étangs artificiels, le mulet ordinaire mêlé aux fahaka,[27] » l'oxyrrhynque au museau pointu, la torpille, la grande tortue d'eau douce. La nature semble avoir inventé le fahaka dans un moment de bonne humeur. C'est un poisson allongé qui a la faculté de se gonfler à volonté ; quand il ballonne outre mesure, et que le poids de son dos l'emporte, il bascule et s'en va à la dérive, le ventre en l'air et tout semé d'épines qui lui donnent l'air d'un hérisson. Au moment de l'inondation, la crue, en se retirant, l'abandonne dans les champs limoneux, où il devient la proie des oiseaux et des hommes, ou sert de jouet aux enfants. Les embouchures du Nil sont fréquentées par un grand nombre de poissons de mer qui remontent pour frayer en eau douce, et de poissons d'eau douce qui descendent déposer leur frai en pleine mer.
Ainsi tout en l’Égypte se règle sur le Nil, le sol, ses productions, l'espèce des animaux qui l'habitent et des oiseaux qu'il nourrit. Les Égyptiens le sentaient mieux que personne et ils s'en montraient reconnaissants : ils tenaient leur fleuve pour un dieu qu'ils appelaient Hapi et dont ils ne se lassaient pas de célébrer la bienfaisance. « Salut à toi, ô Nil, qui sors en cette terre et qui viens pour donner la vie à l'Égypte, - toi dont les lois sont cachées, ténèbres en plein jour, mais dont pourtant on célèbre les lois, - toi qui détrempes les champs que Râ crée - pour donner la vie à tout le bétail, - toi qui arroses la montagne loin de l'eau, - car ce n'est que ta rosée la pluie qui tombe, - qui aimes le dieu Terre Gabou, - qui offres le dieu des grains Napri, et qui fais prospérer l'atelier de Phtah, la terre d'Égypte ! Seigneur des poissons, lui qui ramène au Sud les bandes d'oiseaux, - par qui il n'y a plus d'oiseau qui attaque les récoltes, - fabricant de l'orge, producteur du millet, - qui met les temples en fêtes, - s'il est paresseux, alors les nez se bouchent, - tout le monde est misérable, les pains d'offrandes aux dieux diminuent ; - alors des millions d'individus périssent parmi les hommes. - S'il s'irrite, la Terre Entière souffre, - grands et petits sont misérables, - et toutes les conditions sont confondues, lorsqu'il leur va contre ! - Si, au contraire, Khnoumou d'Eléphantine l'a fait bon, - et qu’il se lève, alors la terre est en allégresse, - tout ce qui a ventre est en joie, - tout dos est secoué de rire grâce à lui, - toute dent déchire. Ô toi qui apportes les provisions et qui es riche de nourritures, créateur de toutes les bonnes choses, - maître des réconforts, qui renouvelles les parfums (à ses venues), - de qui la peine est plaisir pour les autres, - générateur des fourrages pour les bestiaux, - qui pourvois aux sacrifices de tout dieu, - toi qui es dans l'Hadès, au ciel, en la terre, sur le trône de Tataouî, - qui remplis les entrepôts, qui forces à élargir les greniers, - qui pourvois de biens les malheureux ! - Il fait croître tous les bois utiles - sans qu'il en manque - car c'est son fort de faire exister les bateaux ! - On ne sculpte pas dans les pierres pour lui - des statues où poser la double couronne ; - on ne l'aperçoit point, - il n'a ni serviteurs ni maîtres, - on ne l'arrache pas au mystère, - on ignore le lieu où il est, - et on ne trouve point sa retraite par vertu de livres magiques. - Il n'y a pas de maisons pour ses revenus, - il n'y a point qui guide en son cœur ! - Néanmoins ses générations et ses enfants se réjouissent, - on s'informe de son état comme s'il était un roi – aux ordonnances constantes, - qui se montre au Midi comme au Nord, - par qui sont bus les pleurs de tous les yeux, et qui prodigue l'abondance de ses biens »[28]
Origine
des Égyptiens : les nomes
Les Égyptiens paraissent avoir perdu de bonne heure le souvenir de leur origine. Venaient-ils du centre de l'Afrique ou de l'intérieur de l'Asie ? Au témoignage presque unanime des historiens anciens, ils appartenaient à une race africaine qui, d'abord établie en Éthiopie sur le Nil moyen, serait descendue graduellement vers la mer en suivant le cours du fleuve. On s'appuyait pour le démontrer sur les analogies évidentes que les moeurs et la religion du royaume de Méroé présentaient avec les moeurs et la religion des Égyptiens proprement dits[29]. On sait aujourd'hui à n'en pas douter que l'Ethiopie, celle du moins que les Grecs ont connue, loin d'avoir colonisé l'Égypte au début de l'histoire, fut colonisée par elle à partir de la douzième dynastie, et qu'elle a été comprise pendant des siècles dans le royaume des Pharaons. D'autre part, la Bible affirme que Mizraïm, fils de Cham, frère de Koush l'Éthiopien et de Canaan, vint de Mésopotamie pour se fixer sur les bords du Nil avec ses enfants[30]. Loudim, l'aîné d'entre eux, personnifie les Égyptiens proprement dits, les Rotou ou Romîtou des inscriptions hiéroglyphiques. Anamîm représente assez bien la grande tribu des Anou, qui fonda Onou du Nord (Héliopolis) et Onou du Sud (Hermonthis) dans les temps antéhistoriques. Lehabim est le peuple des Libyens qui vivent à l'occident du Nil, Naphtouhim (No-Phtah) s'établit dans le Delta au nord de Memphis ; enfin Pathrousim (Patorisi, la terre du Midi) habita le Saïd actuel entre Memphis et la première cataracte[31]. Cette tradition, qui amène les Égyptiens de l'Asie par l'isthme de Suez, n'était pas ignorée des auteurs classiques, car Pline l'Ancien attribue à des Arabes la fondation d'Héliopolis[32] ; mais elle n'eut jamais la popularité de l'opinion qui les dérivait des hauts plateaux de l'Ethiopie.
De nos jours, la provenance et les affinités ethnographiques de la population ont fourni matière à de longues discussions. Tout d'abord les voyageurs du xviie et du xviiie siècle, trompés à l'apparence de certains Coptes abâtardis, assurèrent que leurs prédécesseurs de l'âge pharaonique avaient le visage bouffi, l'oeil à fleur de tête, le nez écrasé, la lèvre charnue, et qu'ils présentaient plusieurs des traits caractéristiques de la race nègre. Cette erreur, vulgaire encore au commencement du siècle, s'évanouit sans retour dès que la Commission française eut publié son grand ouvrage. En examinant les innombrables reproductions de statues et de bas-reliefs dont il est rempli, on reconnut que le peuple figuré sur les monuments, loin d'offrir les particularités ou l'aspect général du nègre, avait la plus grande analogie avec les belles races blanches de l'Europe et de l'Asie occidentale. Aujourd'hui, après un siècle de recherches et de fouilles, nous n'avons plus de difficulté à évoquer devant nous, je ne dirai pas le contemporain de Psammétique et de Sésostris, mais celui de Kheops, qui contribua pour sa part à la construction des pyramides. Il suffit pour cela d'entrer dans un musée et d'examiner les statues d'ancien style qui y sont réunies. Au premier coup d'oeil, on sent que l'artiste a poursuivi, dans le rendu de la tête et des membres, la ressemblance exacte avec son modèle ; puis, lorsqu'on écarte les nuances propres à chaque individu, on dégage sans peine les caractères généraux et les types principaux de la race. L'un d'eux, trapu et lourd, répond assez bien à l'un de ceux qui prévalent chez les fellahs actuels. L'autre, celui qui distinguait les membres des hautes classes, nous montre son homme grand, maigre, élancé. Il avait les épaules larges et pleines, les pectoraux saillants, le bras nerveux, rond, terminé par une main fine, la hanche assez peu développée, la jambe sèche ; les détails anatomiques du genou et les muscles du mollet sont assez fortement accusés, comme c'est le cas pour la plupart des peuples marcheurs ; les pieds sont longs, milices, aplatis à l'extrémité par l'habitude d'aller sans chaussure. La tête, souvent trop forte pour le corps, revêt d'ordinaire une expression de douceur et même de tristesse instinctive. Le front est carré, peut-être un peu bas, le nez court et charnu ; les yeux sont grands et bien ouverts, les joues arrondies, les lèvres épaisses, mais non renversées ; la bouche, un peu trop fendue, garde un sourire résigné et presque douloureux. Ces traits, communs à la plupart des statues de l'ancien et du moyen empire, se perpétuent à toutes les époques. Les monuments de la dix-huitième dynastie, les sculptures saïtes et grecques, si inférieures en beauté artistique aux monuments des vieilles dynasties, se transmettent sans altération notable le type primitif. Aujourd'hui, bien que les classes supérieures se soient défigurées par des alliances répétées avec l'étranger, les simples paysans ont gardé presque partout l'aspect de leurs ancêtres, et tel fellah contemple avec étonnement les statues de Khephren ou les colosses des Sanouasrît qui promène, à travers le Caire, à plus de quatre mille ans d'existence, la physionomie de ces vieux Pharaons[33].
Si le type de la population est bien défini, l'origine des éléments qui la composent n'en est pas moins obscure. La majorité des philologues contemporains en place le berceau dans l'Asie occidentale[34], mais sans pouvoir se mettre d'accord sur la route qu'ils auraient suivie pour se rendre en Afrique. Quelques-uns pensent qu'ils prirent le chemin le plus court, celui de l'isthme de Suez[35], mais d'autres leur prêtent des voyages plus longs et des itinéraires plus compliqués : les immigrants auraient franchi le détroit de Bab et Mandeb et les montagnes de l'Abyssinie, puis ils auraient descendu le Nil et ils se seraient installés entre la première cataracte et la mer[36]. L'hypothèse d'une origine purement asiatique soulève des difficultés considérables, car, au point de vue anatomique, le gros de la population nous offre tous les caractères des nations blanches qui se sont établies de toute antiquité sur les versants méditerranéens du continent libyque, et qui peut-être vinrent elles-mêmes de l'Europe méridionale elles se seraient glissées dans la vallée par l'Ouest ou par le Sud-Ouest[37]. Plusieurs enfin assignent pour berceau aux Égyptiens le centre de l'Afrique[38]. Ils auraient rencontré dans leur patrie nouvelle une race noire[39], et ils reçurent plus tard, à coup sûr, des accroissements de peuplades asiatiques, qui s'infiltrèrent par le désert jusqu'aux marais du Delta. Quoi qu'il faille penser de ces théories, le certain est que les ancêtres variés des Égyptiens que nous connaissons, à peine parvenus sur les rives du Nil, furent conquis aussitôt par le pays et assimilés, comme ç'a toujours été le cas depuis lors pour tous les étrangers qui l'occupèrent. Au moment où leur histoire commence pour nous, cinq ou six mille ans avant notre ère, ils étaient tous fondus en un seul peuple, qui possédait une civilisation uniforme et qui parlait la même langue d'un bout à l'autre de la contrée.
Cette langue semble appartenir à la même famille que le berbère et ses dialectes ou que les langues mal étudiées dont se servent encore plusieurs tribus du désert égyptien et du Soudan : on y a signalé en effet des analogies sérieuses avec le berbère[40], et aussi avec l'ensemble des langues dites sémitiques. Non seulement un grand nombre de ses racines appartiennent au type hébræo-araméen ; mais sa constitution grammaticale se prête à de nombreux rapprochements avec l'hébreu et le syriaque. L'un des temps de la conjugaison, le plus simple et le plus ancien de tous, est composé avec des pronoms suffixes identiques à ceux des Sémites[41]. Les pronoms, suffixes et absolus, sont exprimés par les mêmes racines et jouent,le même rôle en égyptien et dans les langues sémitiques[42]. Sans nous étendre sur ces rapprochements, dont quelques-uns laissent encore prise au doute, nous pouvons dès à présent affirmer que la plupart des procédés grammaticaux mis en oeuvre par les langues sémitiques se retrouvent en égyptien à l'état rudimentaire. Aussi bien l'égyptien et les langues sémitiques, après avoir fait partie du même groupe, se sont séparés de bonne heure à une époque où leur système grammatical était encore en voie de formation. Désunis et soumis à des influences diverses, ils traitèrent dès lors d'une façon très différente les éléments qu'ils possédaient en commun. Tandis que l'égyptien et les autres idiomes qu'on pourrait intituler protosémitiques s'arrêtaient dans leur développement, les langues sémitiques propres continuaient le leur pendant de longs siècles avant d'arriver à la forme que nous leur voyons aujourd'hui ; « en sorte que, s'il y a un rapport de souche évident entre la langue de l'Égypte et celles de l'Asie, ce rapport est cependant assez éloigné pour laisser au peuple qui nous occupe une physionomie distincte[43] ».
Au moment où les tribus de langue protosémitique y descendirent, le pays devait présenter l'image de la désolation. Le fleuve, abandonné à ses caprices, changeait perpétuellement de lit. Il n'atteignait jamais dans ses débordements certains recoins de la vallée, qui restaient improductifs ; ailleurs, au contraire, il séjournait avec tant de persistance qu'il changeait le sol en bourbiers pestilentiels. Le Delta, à moitié noyé par les eaux douces, à moitié perdu sous les flots de la Méditerranée, était un immense marais semé de quelques îles sablonneuses et couvert de papyrus, de lotus, d'énormes roseaux, à travers lesquels les bras du Nil se frayaient paresseusement un cours sans cesse déplacé. Sur les deux rives, le désert envahissait tout ce qui n'était pas chaque année recouvert par l'inondation : on passait sans transition de la végétation désordonnée des fanges tropicales à l'aridité là plus absolue. Peu à peu les nouveaux venus apprirent à régler leur fleuve, à l'endiguer, à porter par des canaux la fertilité jusque dans les replis les plus reculés du territoire. L'Égypte sortit de la boue et devint dans la main de l'homme une des contrées les mieux appropriées au développement paisible d'une grande civilisation.
La période de formation du sol et de la nation dura longtemps, des myriades d'années au dire des anciens eux-mêmes, entre trois et quatre mille ans d'après les calculs les plus modérés des savants contemporains. Des découvertes récentes nous ont fait connaître les monuments de ces premiers Égyptiens, et nous ont rendu leurs maisons, leurs tombeaux, les outils et les armes dont ils se servaient. Ils habitaient des huttes basses, construites en pisé ou en briques séchées au soleil, qui ne contenaient qu'une seule chambre carrée ou rectangulaire sans autre ouverture que la porte; les riches seuls en possédaient qui étaient assez vastes pour qu'il fût nécessaire d'en soutenir le toit au moyen d'une ou de deux colonnes. Le mobilier ne comportait que de la vaisselle de terre, modelée à la main, des couteaux et des grattoirs de silex, des nattes de roseaux ou de paille tressée, deux pierres plates à moudre le grain, quelques coffres, quelques escabeaux, quelques chevets en bois comme oreillers pendant le sommeil. La poterie ordinaire est lourde et presque toujours non décorée. Souvent elle est de deux couleurs, le corps du vase en une terre d'un rouge brillant polie à la pierre, tandis que le fond et le goulot sont d'un noir plus luisant que le rouge. Plus souvent, la couverte est d'un jaune uniforme sur lequel s'enlèvent en traits rouges des fleurs, des palmiers, des autruches, des gazelles, des bateaux entremêlés de lignes ondées. Les hommes allaient à peu près nus, sauf les nobles, qui portaient une peau de panthère jetée sur l'épaule ou serrée à la taille en guise de pagne. Ils s'enduisaient le corps d'huile ou de graisse, et ils se tatouaient en partie la face et le visage : plus tard ce genre d'ornement ne fut plus conservé que chez les gens de la basse classe, mais l'usage se maintint de farder le visage et de noircir au kohol le bord des paupières et les sourcils. On substitua de bonne heure la perruque noire ou bleue à la chevelure naturelle, et les chefs militaires ou religieux arborèrent sur leur front des plumes d'autruche pour se distinguer de leurs subordonnés. Par la suite, le pagne en toile blanche de lin remplaça la peau de bête, qui ne fut plus que l'insigne des prêtres ou des princes : un long manteau de lin couvrait l'ensemble du costume lorsqu'on sortait de la maison. L'habillement des femmes n'était pas beaucoup plus compliqué que celui des hommes : il consistait surtout en une jupe étroite de toile de lin, maintenue sur les épaules par deux bretelles et qui, prenant sous la gorge, ne descendait pas tout à fait à la cheville. Des bracelets et des colliers en silex, en ivoire, en coquillages, en graines de couleur, en cailloux bizarres complétaient cette toilette. Les hommes étaient armés de casse-tête et de sabres en bois ou en os de formes variées, d'arcs, de flèches et de lances, garnies de pointes en silex et en os ; comme armes de jet, ils employaient la fronde et le boumerang. Longtemps avant les débuts de l'histoire, les métaux s'étaient associés à la pierre pour les armes et pour les outils, et l'on avait vu le cuivre, puis le bronze et enfin le fer se répandre parmi toutes les classes de la société. Les armes de bois et de pierre, masses, flèches, casse-tête, boumerangs, ne servirent plus que pour la chasse, ou ne furent conservées que par la noblesse ou le clergé comme emblèmes de l'autorité ou comme instruments rituels. La pêche et la chasse fournissaient une partie importante de l'alimentation, chasse au lasso ou à la bola des taureaux sauvages et des espèces de gazelles, d'oryx et de chèvres qui vaguaient par le marais ou la montagne : toutefois, le blé, l'orge, le millet étaient cultivés déjà, et l'âne, le mouton, la chèvre, le boeuf, le porc avaient été domestiqués. Les Egyptiens des temps antérieurs à l'histoire possédaient la meilleure partie de l'outillage agricole, industriel et militaire, que nous voyons figuré sur les monuments de l'époque historique[44].
C'est donc à ces générations si mal connues que revient l'honneur d'avoir établi la constitution et la civilisation de l'Égypte. Le souvenir précis de leur condition s'effaça de bonne heure, et les chroniqueurs de l'âge pharaonique, avec cette naïveté instinctive qui incite les peuples à chercher la perfection dans le passé, en étaient venus assez vite à considérer leurs ancêtres demi sauvages comme des hommes pieux, attachés au culte d'Horus et menant une vie heureuse sous l'autorité directe des dieux. D'abord séparés en clans indépendants, ces Serviteurs d'Horus, - Shamsou-Horou[45], - se seraient groupés à plusieurs pour établir, le long du Nil, de petits Etats dont chacun pratiquait ses lois et son culte. Avec le temps, ces Etats se fondirent les uns dans les autres : il ne resta plus en présence que deux grandes principautés, la Basse Égypte (To-mouri) ou pays du Nord (To-mehi) dans le Delta, la Haute Égypte ou pays du Sud (To-rêsi), depuis la pointe du Delta jusqu'à la première cataracte. La réunion sous un même sceptre constitua le patrimoine des Pharaons ou pays de Kîmit, mais elle n'effaça pas la division primitive : les petits Etats devinrent provinces et furent l'origine des circonscriptions administratives que les Grecs ont appelées nomes. Ceux-ci se composaient d'une ou plusieurs villes et d'un territoire assez restreint[46]. Ils comportaient chacun plusieurs subdivisions : 1° la capitale (nouît) et sa banlieue, siége de l'administration civile et militaire, centre de la religion provinciale ; 2° les terres de production (ouou), cultivées en céréales et fécondées chaque année par l'inondation; 3° les terres marécageuses (pah'ou), sur lesquelles les débordements du Nil laissaient des étangs trop profonds pour être desséchés facilement ; on les mettait en pâturages quand on pouvait, on y cultivait le lotus et le papyrus, on s’y livrait en grand à l'élève des oiseaux d'eau ; 4° enfin, les canaux dérivés du Nil pour les besoins de l'agriculture et de la navigation[47]. En tête de l'administration civile, militaire et religieuse, marchaient des princes héréditaires (hak ou haîti), qui à certaines époques formèrent une véritable féodalité, en d'autres temps furent remplacés par des nomarques à la nomination directe du roi[48]. L'autorité religieuse était exercée sous la surveillance du prince ou du nomarque, par le grand prêtre du temple, dont la dignité était tantôt élective, tantôt héréditaire. Les habitants du nome payaient au roi et à ses fonctionnaires un impôt en nature proportionnel à la richesse foncière, et dont la répartition exigeait des recensements et des cadastres fréquents. Ils étaient astreints à une espèce de conscription pour le service militaire, et à la corvée pour l'exécution de tous les travaux d'utilité publique, qu'il s'agît de restaurer un temple, d'édifier une forteresse, de tracer une route, de construire une digue ou de creuser un canal.
Le nombre des nomes varia selon les temps. La plupart des historiens anciens en comptent trente-six[49] ; les listes égyptiennes en donnent parfois quarante-quatre, dont vingt-deux pour la Haute Égypte et vingt-deux pour la Basse[50]. Le plus méridional d'entre eux s’appelait To-Khentît et il confinait à la Nubie. Le chef-lieu était Abou, l'Eléphantine des Grecs, et plus tard, au temps des Romains, Noubît, Ombos. Il comprenait, avec la ville de Senomouït (Syène), les deux îles célèbres de Senomouït (Bîgèh) et de Lak (Aïlak, Pilak, Philae), qui servirent de refuge aux derniers païens d'Égypte contre les persécutions chrétiennes. Venaient ensuite le nome de Tas-Horou (Apollonitès) avec Dobou (Apollinopolis Magna, Edfou) et Khonou (Silsilis) et celui de Ten (Latopolitès). La métropole de ce dernier fut d'abord Nekhabît que Champollion identifia avec la ville grecque d'Eilithyia. Le nom de Nekhabît est mêlé aux faits les plus importants de l'histoire d'Égypte. Sous la dix-septième dynastie, au temps où les pasteurs dominaient le Delta, les princes indépendants du Sud avaient fait de cette ville un de leurs boulevards et quelquefois leur capitale. Le gouvernement en était confié à un prince de la famille royale, qui prenait le titre de Royal fils de NERHABIT. Plus tard, à l'époque gréco-romaine, Nekhabît, déchue de sa splendeur, céda le premier rang à Sanît (Latopolis), la moderne Esnèh[51].
Au sortir du nome de Ten on entrait dans le nome de Ouîsit, le Phathyritès des Grecs, où brillait Apit, Tapit, la Thèbes aux cent portes d'Homère, la demeure d'Amonrâ, roi des dieux et créateur du monde (Pa-Amon, Diospolis Magna). Son origine se perdait dans la nuit des temps : les traditions nationales en faisaient la patrie terrestre d'Osiris[52] et la résidence d'une des dynasties humaines antérieures aux dynasties historiques. A l'époque de sa prospérité, elle s'étalait sur les deux rives du Nil, du pied de la chaîne Libyque au pied de la chaîne Arabique. Capitale de l'Égypte sous neuf dynasties consécutives, de la onzième à la vingtième, puis dépouillée de sa suprématie à partir de la vingt et unième dynastie, prise et pillée successivement par les Ethiopiens, les Assyriens et les Perses, elle fut détruite par Ptolémée Lathyre et à moitié renversée par un tremblement de terre en l'an 27 avant le Christ. Sur ses ruines s'élevèrent un grand nombre de villages de peu de valeur[53], qui subsistent encore aujourd'hui sous des noms arabes : El-Aqsorain (Louqsor) et Karnak, sur la rive droite ; Gournah, Médinét-Habon, Déir-el-Bahari, sur la rive gauche. A partir de cette époque, le chef-lieu du nome fut Onou du Midi ou Hermontou (Hermonthis), dont la fondation remontait jusqu'aux âges antéhistoriques[54].
Au nord de Thèbes, on rencontrait d'affilée : sur la rive droite du fleuve, le nome de Haroui (Coptitès) avec Qoubti (Coptos), l'une des forteresses et l'un des marchés les plus renommés de la Haute Égypte ; sur la rive gauche, le nome Tentyritès avec Taririt (Tentyris, Dendérah); sur les deux rives, le nome de Hasekhokh (Diospolitès) et le Thinitès, dont la métropole, après avoir été Thini, fut plus tard Aboudou (Abydos). Abydos était une des plus illustres parmi les cités égyptiennes. Strabon, qui la visita lorsqu'elle était en décadence complète, rapporte que jadis elle occupait le second rang[55] : et de fait, après Thèbes, je ne connais pas de ville qui soit mentionnée plus souvent sur des monuments de toute sorte. Non qu'elle fût vaste ou bien peuplée : resserrée entre le désert et un canal dérivé du Nil, elle couvrait, entre les villages modernes d'El-Kharbéh et d'Harabat-el-Madfounèli, une bande de terre fort étroite et elle ne put jamais se déployer à son aise. C'est comme ville sainte qu’elle était respectée universellement. Ses sanctuaires étaient célèbres, son dieu Osiris vénéré, ses fêtes suivies par toute l'Égypte ; les gens riches des autres nomes tenaient à honneur de se faire dresser une stèle dans son temple, auprès du tombeau d'Osiris. Sous les Ptolémées, elle perdit son rang et sa primauté, qui furent attribués au bourg de Soul (Syis, Psouï, Psoï). Celui-ci, agrandi et colonisé par Ptolémée Sôter, prit le nom de Ptolémaïs[56].
Les nomes de l'Égypte moyenne, entre Abydos et Memphis, sans jamais avoir obtenu une prépondérance durable, ont pesé d'un grand poids dans les destinées du pays[57]. Remplis d'une population nombreuse, semés de places fortes situées avantageusement sur les différents bras du Nil, ils pouvaient couper à volonté les communications entre Thèbes et Memphis ou entraver longtemps la marche des armées. On s'y heurtait d'abord, sur la rive droite du fleuve, à Apou ou Khmînou (Panopolis ou Khemmis), dans le nome de Khmînou. Minou y était adoré, et les Grecs, trompés par une analogie de son, avaient cru démêler dans l'un des titres de ce dieu, Pehrirou ou Pehrisou, « le coureur», le nom de leur héros Persée[58]. Plus bas, toujours sur la rive droite, venaient Toukaou et Paharnouboul, dans le nome de Douf (Antæopolitès[59]) ; sur la rive gauche, dans le nome de Bâalou (Hypsélitès), la forteresse de Shashotpou (Shôtp)[60], et dans le nome Iotef supérieur (Iotef khont, Lycopolités), la ville importante de Siout (Lycônpolis, Osyout)[61]. On passait de là dans l'Iotef inférieur (Iotef poh'ou), où Kousit (Kousæ) était maîtresse aux temps pharaoniques ; à l'époque gréco-romaine, son territoire fut réparti entre les deux provinces voisines[62].
Les noms antiques d'Hermopolis étaient Khmounou, la ville des huit dieux, et Ounou la ville du dieu Lièvre[63]. Elle commandait au nome d'Ounou (Hermopolitès), à l'écart du Nil et proche le canal appelé aujourd'hui Bahr-Yousout. C'était une des plus anciennes cités de l'Égypte : elle avait été le théâtre d'une des victoires d'Horus sur Sit, et son dieu éponyme Thot avait pris une part glorieuse aux guerres osiriennes. Son territoire confinait au nord et à l'est avec celui du nome de Mihit[64], l'un des plus puissants parmi les nomes de la Thébaïde. La capitale en était Hibonou (Miniéh) ; mais il renfermait plusieurs autres localités célèbres, Nofirous (Etlidem), Monâït-Khoufou, Haouêrît. Monâït-Khoufou avait été fondée ou agrandie par Khoufou (Kheops); elle florissait encore sous la douzième dynastie et elle fut alors le berceau d'une dynastie provinciale. Au nord de Mihit et sur la rive orientale du fleuve s'étendaient les deux nomes de Pa avec Habonou (Hipponon)[65], et de Matonon (Aphroditès) avec l'obscure Pa Nibtepahe (Aphroditopolis, Atfieh) ; sur la rive occidentale, entre le Nil et la chaîne Libyque, le nome de Ouabou (Oxyrrynchités), ville principale Pamazit (Oxyrrynchos, Pemsje), celui du Nouhit supérieur (Héracléopolitès), chef-lieu Hâkhninsou ou Hnès (Héracléopolis Magna), enfin celui du Nouhit inférieur[66], auquel on rattachait le Toshe ou pays du lac Min (le Fayoum). Le Nouhit inférieur renfermait la ville de Miritoum ou Mitoum (Meïdoum), au pied de la chaîne Libyque. A l'époque gréco-romaine il n'existait plus : la portion de son territoire qui courait entre le Nil et la montagne fut annexée au nome Héracléopolitès ; le Fayoum forma un nome nouveau, l'Arsinoïtès, dont Crocodilopolis, l'ancienne Shodon, fut désormais la cité maîtresse.
A quelques kilomètres au nord de Mitoum, on franchissait la frontière de la Basse Égypte et l'on entrait dans le district du Mur-Blanc (Anbou-haït, Memphitès) ; on défilait sous les murs de Titoouï, un des boulevards du Delta contre les invasions du Midi, et l'on débouchait devant Mannofri (Memphis). Memphis, la ville de Phtah, Hakouphtah, dont les Grecs ont tiré le nom d’Égypte[67], était l'une des places les plus fortes du pays. Elle se composait d'une ville vieille, le Mur-Blanc, où s'élevait le grand temple de Phtah, et de plusieurs quartiers dont le principal, Ankhtooui, était devenu à l'époque persane le séjour favori des étrangers, surtout des Phéniciens[68]. Amoindrie par la fortune d'Alexandrie, la fondation du Caire consomma sa perte: sous les sultans Mamelouks, elle n'était plus qu'un triste champ de décombres. « Malgré l'immense étendue de cette ville et la haute antiquité à laquelle elle remonte, ses restes offrent encore aux yeux des spectateurs une réunion de merveilles qui confond l'intelligence, et que l'homme le plus éloquent entreprendrait inutilement de décrire. Les pierres provenues de la démolition des édifices remplissent au loin le site entier : on aperçoit en quelques endroits des pans de murailles encore debout, construits de ces grosses pierres dont je viens de parler ; ailleurs, il ne reste que les fondements ou bien des monceaux de décombres. J'ai vu l'arc d'une porte très haute dont les deux murs latéraux sont formés chacun d'un seul bloc ; et la voûte supérieure, qui était aussi d'un bloc unique, était tombée au-devant de la porte… Les ruines de Memphis occupent une demi-journée de chemin en tous sens[69] ». Abdallatif parlait ainsi au treizième siècle. Depuis sa visite, une partie de ces débris, exploités comme carrière, a servi à construire les maisons du Caire et des bourgs voisins : le limon du fleuve a noyé le reste.
Près de la pointe du Delta, sur la rive gauche du Nil, et confinant au désert Libyque, les anciens plaçaient le nome Létopolitès avec Sokhmit (Létopolis) et Kerkasore[70] ; sur la rive droite, et confinant au désert Arabique, le nome Héliopolitès. Onou du Nord, l'Héliopolis des Grecs, en était la métropole. Située sur une butte artificielle, elle ne couvrait qu'une superficie assez étroite, et elle n'avait pas une population nombreuse ; elle n'en était pas moins une des capitales religieuses de l'Égypte et le siège d'une école de théologie célèbre dans le monde entier. D'après la tradition grecque, Solon, Pythagore, Platon, Eudoxe, y avaient passé plusieurs années de leur vie dans l'étude des sciences et de la philosophie égyptiennes. Deux villages voisins, Ahou et Hâbenhen (Babylone d'Égypte), avaient joué leur rôle pendant les guerres osiriennes, et étaient des sanctuaires renommés. Sur les bords du Nil s'élevait Taroiou. Taroiou était située presque en face de Memphis : ses carrières, ouvertes par les rois des premières dynasties, furent exploitées à peu près sans interruption jusqu'à l'époque arabe. Les Grecs l'appelaient Troja, et ils prétendaient qu'elle avait été bâtie par des prisonniers troyens, comme sa voisine, Babylone d'Égypte, l'avait été par des prisonniers babyloniens[71]. La nomenclature des autres provinces du Delta n'est pas encore déterminée avec assez de certitude pour que je me hasarde à la donner en détail. Il me suffira de citer : sur la branche Canopique du Nil, rive droite, Saï (Saïs), dans le nome Saïtès ; entre la branche Canopique et la branche Sébennytique, Khsôou (Xoïs) et Paouzit (Bouto), cette dernière dans le nome Am inférieur ou Patonouzit (Phthénéotès[72]) ; sur la branche Sébennytique, rive gauche, Thebnoutir (Sébennytos), rive droite, Hatrib (Attiribis) ; cuire la branche Sébennytique et la branche Pélusiaque, Pbinibdidi ou Didou (Mendés) et Tanis. Au delà de la branche Pélusiaque, entre le Nil et le Désert, s'interposait la forteresse de Zarou, sur la frontière de l'Égypte du côté de la Syrie ; elle paraît répondre à la Sellé des géographes classiques[73]. Les villes du Delta, malgré leur antiquité et leur richesse, n'exercèrent longtemps qu'une influence restreinte sur les destinées de l'Égypte. Des vingt premières dynasties, elles n'en fournirent qu'une seule, la quatorzième, originaire de Xois : encore est-elle insignifiante. Vers le onzième siècle, elles n'arrivèrent à la vie politique et à la prépondérance que pour présider à la décadence du pays, et l'accélérer par leurs rivalités perpétuelles. La fondation de Naucratis et celle surtout d'Alexandrie les ruinèrent si complètement, qu'au premier siècle de notre ère la plupart d'entre elles étaient réduites à la condition de simples bourgades.
L'Égypte
avant l'histoire : les dieux et les dynasties divines.
Les monuments nous montrent que, dès le temps des premières dynasties, les nomes avaient chacun leurs dieux spéciaux, qui nous sont encore mal connus pour la plupart : on adorait Khnoumou aux cataractes, Anhouri à Thinis, Râ dans Héliopolis, Osiris à Mendès. Bien ne nous permet de dire ce qu'étaient ces divinités au début, si les Égyptiens les importèrent toutes de leur patrie primitive ou si beaucoup d'entre elles naquirent dans les boues du Nil : au moment où nous les rencontrons pour la première fois, leur forme s'était modifiée profondément par l'action des siècles et elles ne renfermaient plus tous les traits de leur nature première. Autant qu'on peut en juger, elles se répartissaient en trois groupes d'origine différente : les dieux des morts, les dieux des éléments, les dieux solaires. Sokaris, Osiris et Isis, Anubis, Nephthys, sont voués plus spécialement à la protection des morts. Les dieux des éléments représentent la terre Gabou, le ciel Nouït, l'eau primordiale Nou, le Nil Hâpi, et probablement aussi des dieux comme Sovkou, Sit-Typhon, Haroêris, Phtah, dont nous ignorons presque l'histoire. Parmi les dieux solaires, il convient de mentionner, avant tout, Râ, le soleil, Atonou, le disque solaire, Shou, Anhouri, Amon, le journalier. Dans les plus anciens textes religieux qui nous aient été conservés, la plupart de ces êtres ne sont plus déjà, à proprement parler, que des doublures politiques ou géographiques les uns des autres. Sokaris est le seigneur des morts à Memphis, comme Osiris l'était en d'autres endroits, et il ne différait d'Osiris que par des nuances de culte local : où l'on adorait le soleil sous le nom de Bâ, on ne l'adora point d'abord sous le nom de Shou. Les trois groupes possédaient à l'origine des facultés et des attributions bien tranchées : ils se complétaient l'un par l'autre, mais ils ne se confondaient pas l'un dans l'autre. Le même nome pouvait avoir ses dieux solaires, ses dieux élémentaires, ses dieux des morts : il n'avait pas encore de divinités où l'idée du soleil et des éléments fût mêlée à celle de la mort.
Il ne semble pas que le patron principal de chaque nome ait dû nécessairement revêtir la forme masculine. Dans plus d'un endroit, une déesse jouissait du rang suprême : Hathor à Dendérah, Nît à Saïs, Nekhabît à El-Kab. Dans d'autres localités, le dieu n'était pas unique, mais il se divisait en deux personnes jumelles, toutes les deux mâles comme Anhouri-Shon à Thinis, l'une mâle et l'autre femelle, comme Shou-Tafnouît à Héliopolis. Ils ne témoignaient d'ailleurs aucun goût pour la solitude. Ils s'unissaient en familles, à l'imitation de ce qui se passait sur la terre chacun d'eux se mariait à son gré, avait un fils, et la trinité se trouvait constituée. De Phtah et de la déesse Sokhit naissait Nefertoumou, d'Osiris et d'lsis, Harpochrate l'Horus enfant, et les dieux secondaires de la cité se groupaient autour de chaque trinité. Chacune d'elles gardait d'ailleurs le caractère de la divinité qui l'avait créée ; où c'était une déesse qui avait pris mari, la déesse demeurait le personnage principal ; où c'était un dieu qui avait pris femme, le dieu continuait de tenir le premier rôle. A Dendérah, le mari d'Hathor n'était qu'un reflet de sa compagne ; à Thèbes, Mout, femme d'Amon, n'était qu'une contrepartie féminine d'Amon. Par un progrès tout naturel, on en arriva à considérer que le fils, procédant du père et de la mère, était identique à ses deux parents, et que, par suite, le père, la mère, l'enfant, au lieu d'être trois divinités distinctes, pouvaient bien n'être que trois aspects d'une même divinité. Chaque nome se forgea un dieu en trois personnes, dont les monuments les plus anciens constatent l'existence et qu'ils appellent le dieu, le dieu un, le dieu unique. Mais ce dieu un n'était jamais dieu tout court[74]. Le dieu unique est le dieu unique Amon, le dieu unique Phtah, le dieu unique Osiris, c'est-à-dire un être déterminé ayant une personnalité, un nom, des attributs, un costume, des membres, une famille, un homme infiniment plus parfait que les hommes. Il est à l'image des rois de cette terre, et sa puissance, comme celle de tous les rois, est bornée par la puissance des rois voisins. La conception de son unité est donc géographique et politique au mollis autant que religieuse : Râ, dieu unique à Héliopolis, n'est pas le même qu'Amon, dieu unique à Thèbes. L'Egyptien de Thèbes proclamait l'unité d'Amon à l'exclusion de Râ, l'Egyptien d'Héliopolis proclamait l'unité de Râ à l'exclusion d'Amon. Mais l'unité de chacun de ces dieux uniques, pour être absolue dans l'étendue de son domaine, n'empêchait pas la réalité des antres dieux. L'habitant d'Héliopolis se disait qu'après tout Amon était un dieu puissant, bien qu'inférieur à Râ, et il lui réservait une part de respect dans sa conscience. Chaque dieu unique, conçu de la sorte, n'est que Le dieu unique du nome ou de la ville, noutir nouîti, et non pas le dieu unique de la nation reconnu comme tel dans le pays entier[75].
Le plus souvent les dieux sont représentés à l'image de l'homme, vêtus comme lui et portant à la main les emblèmes de leur puissance. Les uns ont en partage la beauté Phtah et Hathor sont proclamés beaux de face. Les autres sont de vrais monstres et ils étalent à nos yeux des difformités naturelles ; Phtah est parfois un enfant rachitique[76], Bisou un nain féroce. A côté de ces dieux à figure humaine, les monuments nous montrent des boeufs, des éperviers, des ibis, des serpents, qu'on prie autant et plus que les autres. En effet, l'Égypte ancienne a rendu un culte aux animaux, et chaque nome nourrissait, à côté de son dieu-homme, un dieu-bête qu'il proposait à la vénération des fidèles[77]. Thot était un cynocéphale ou un ibis, Horus un épervier, Sovkou un crocodile, Harmakhis un sphinx à corps de lion et à tête humaine, Amon une oie de belle venue, Anubis un chacal[78]. Tous ces animaux furent adorés d'abord en tant qu'animaux, les uns comme le lion, le sphinx, le crocodile, parce qu'on les craignait et qu'on leur~reconnaissait une force, un courage, une adresse supérieure à celle de l'homme; les autres, comme le boeuf, l'oie, le bélier, parce qu'ils servaient bien l'homme et qu'ils lui faisaient la vie plus facile. Plus tard l'idée première se modifia, au moins parmi les théologiens, et l'animal cessa d'être le dieu, pour devenir la demeure, le tabernacle vivant, le corps, dans lequel les dieux infusaient pour ainsi dire une parcelle de leur divinité. L'épervier fut l'incarnation d'Horus et non plus Horus lui-même, le chacal et le boeuf furent l'incarnation d'Antibis et de Phtali et non plus Antibis ou Phtali en personne. Dès lors, les dieux furent conçus indifféremment sous leur forme bestiale ou sous leur forme humaine, souvent même sous une forme mixte où les éléments de l'homme et de la bête étaient combinés selon des proportions diverses. Horus, par exemple, est tantôt un homme, tantôt un épervier, tantôt un épervier à tête d'homme, tantôt un homme à tête d'épervier. Sous ces quatre formes, il est Horus et n'est pas plus lui même sous une d'elles qu'il ne l'est sous l'autre. Quelquefois l'absorption du dieu-bête par le dieu-homme n'avait de raison d'être qu'un simple jeu de mots : Sit-Typhon répondait à l'hippopotame, parce qu’en égyptien Typhon se dit Tobhou et l'hippopotame Tobou[79].
Quelques-uns des dieux-bêtes suivirent la fortune des dieux-hommes auxquels ils étaient associés, et on les adora par tout le pays, le scarabée de Phtah, l'ibis et le cynocéphale de Thot, l'épervier d'Horus, le chacal d'Anubis. D'autres, préconisés dans un nome, étaient proscrits ailleurs. Les gens d'Eléphantine tuaient le crocodile. Au contraire, les prêtres de Thèbes et de Shodou « en choisissaient un beau, qu'ils nourrissaient, après lui avoir appris à manger dans la main. Ils lui enfilaient aux oreilles des anneaux d'or ou de terre émaillée et des bracelets aux pattes de devant[80] ». - « Notre hôte prit des gâteaux, du poisson grillé et une boisson préparée avec du miel, puis il alla vers le lac avec nous. La bête était couchée sur le bord : les prêtres vinrent auprès d'elle, deux d'entre eux lui ouvrirent la gueule, un troisième y jeta d'abord les gâteaux, ensuite la friture, et finit par la boisson. Sur quoi le crocodile se mit à l'eau et s'alla poser sur la rive opposée. Un autre étranger étant survenu avec pareille offrande, les prêtres la prirent, firent le tour du lac, et, après avoir atteint le crocodile, lui enfournèrent l'offrande de la même manière[81] ». Le culte des animaux sacrés coûtait aussi cher que celui des dieux à figure humaine. Il n'était pas rare de voir un riche particulier dépenser tout ou partie de son bien à leur faire de splendides funérailles[82]. Leur mort était un deuil public pour le nome, parfois pour l'Égypte entière ; leur meurtre, un crime capital. Lorsqu'un indigène ou un étranger en tuaient un, même par mégarde, les prêtres réussissaient quelquefois à préserver le coupable contre la fureur populaire en lui imposant une pénitence ; mais le plus souvent leur intervention était impuissante à le sauver. Du temps que l'historien Diodore de Sicile voyageait en Égypte vers le milieu du premier siècle avant notre ère, un Italien, établi dans Alexandrie, tua par hasard un chat. Le peuple s'assembla aussitôt, le saisit et le mit en pièces, malgré sa qualité de citoyen romain, malgré les prières du roi, qui dépendait de Rome et qui craignait pour sa couronne[83].
Les plus célèbres des animaux sacrés étaient le boeuf Mnévis, et l'oiseau Bonou, le Phénix, à Héliopolis ; le bouc de Mendès et le boeuf Hapi à Memphis. Le bouc de Mendès était « l'âme d'Osiris », le boeuf Mnévis « l'âme de Râ ». Au dire des Grecs, le Phénix émigrait tous les cinq cents ans de l'Est et il s'abattait dans le temple de Râ. Quelques-uns prétendaient qu'il apportait avec lui le corps de son père enveloppé de myrrhe. D'autres disaient qu'il venait se faire brûler lui-même sur un bûcher de myrrhe et de bois odorants, pour renaître de ses cendres et pour repartir à tire-d'aile vers sa patrie d'Orient[84]. En fait le Bonou était une espèce de vanneau dont la tête était ornée de deux longues plumes flottantes. Il passait pour l'incarnation d'Osiris comme l'ibis pour l'incarnation de Thot, et l'épervier pour celle d'Horus;
Le taureau Hapi avait fini par devenir aux yeux des Égyptiens l'expression la plus complète de la divinité dans un corps d'animal. Il procédait à la fois d'Osiris et de Phtah aussi l'appelle-t-on « la seconde vie de Phtah » et « d'Osiris[85] ». Il n'avait point de père, mais un rayon de lumière tombé du ciel fécondait la génisse qui l'enfantait et qui ne pouvait plus désormais avoir d'autre petit[86]. Il devait être noir, porter au front une tache blanche triangulaire, sur le dos la ligure d'un vautour ou d'un aigle aux ailes éployées, sur la langue l'image d'un scarabée : les poils de sa queue étaient doubles. « Le scarabée, le vautour et toutes celles des autres marques qui tenaient à la présence et à la disposition relative des épis n'existaient pas réellement. Les prêtres, initiés aux mystères d'Apis, les connaissaient sans doute seuls et savaient y voir les symboles exigés de l'animal divin, à peu près comme les astronomes reconnaissent dans certaines dispositions d'étoiles les linéaments d'un dragon, d'une lyre et d'une ourse[87] ». Il vivait à Memphis dans une chapelle attenante au grand temple de Phtah, et il y recevait des prêtres les honneurs divins. Il rendait des oracles aux particuliers qui venaient le consulter et il remplissait d'une fureur prophétique les enfants qui l'approchaient[88].
La durée de sa vie ne devait pas excéder un certain nombre d'années fixé par les lois religieuses : passé vingt-cinq ans, les prêtres le noyaient dans une fontaine consacrée au Soleil. Cette règle, en vigueur à l'époque romaine, n'existait pas encore ou n'était pas rigoureusement appliquée dans les temps pharaoniques, car deux Hapi contemporains de la vingt-deuxième dynastie vécurent plus de vingt-six ans[89]. L'Hapi défunt devenait un Osiris et prenait le nom d'Osor-Hapi, Osiris-Apis, d'où les Grecs ont tiré le nom de leur Sarapis. Au commencement, chaque animal sacré avait sa tombe propre dans cette partie de la nécropole memphite que les Grecs appelaient le Sérapéion. Elle se composait d'un édicule orné de bas-reliefs sous lequel on pratiquait une chambre carrée à plafond bas. Vers le milieu du règne de Ramsès II, on substitua un cimetière commun aux chapelles isolées. On creusa dans la roche vive une galerie d'une centaine de mètres de long, sur chaque côté de laquelle quatorze chambres assez grossières furent percées successivement ; plus tard, le nombre des galeries et des chambres s'accrut à mesure que le besoin s'en faisait sentir. La momie d'Hapi une fois mise en place, les ouvriers muraient l'entrée de son caveau ; mais les visiteurs ou les dévots avaient l'habitude d'encastrer, soit dans le mur même de fermeture, soit dans les parties qui l'avoisinaient du rocher, une ou plusieurs stèles contenant leur nom et une prière à l'Hapi mort. Ce culte, institué d'une manière définitive par le second roi de la deuxième dynastie, dura jusqu'aux derniers jours de l'Égypte[90]. Mais alors, les prêtres se dispersèrent, les tombes furent violées, puis abandonnées, et le désert s'en empara : au bout de quelques années, le sable les avait recouvertes. Il était réservé à Manette de les retrouver en 1851, après quatorze siècles et plus d'un oubli complet[91].
Les trois groupes de dieux ne jouissaient pas d'un crédit égal dans la religion égyptienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les dieux des éléments, Gabou, Nouît, Tonen, prêtaient peu au culte : leur influence, si elle fut jamais considérable en dehors de certaines localités, s'effaça de bonne heure devant celle des dieux solaires. Le Soleil, Râ, était le patron de la ville d'Onou, qui joua un rôle prépondérant aux temps antéhistoriques, et c'est à la prédominance de sa ville d'origine qu'il dut de monter dès le début au premier rang parmi les dieux du pays entier. Ses prêtres, essayant de se représenter la création du inonde, en étaient arrivés à la conclusion qu'elle s'était produite par l'action concertée d'un nombre déterminé de divinités dont chacune avait accompli une fonction nécessaire à l'organisation de l'univers. Ils avaient choisi les dieux des clans voisins et, les subordonnant au leur, ils avaient combiné un système de neuf personnes, une Ennéade toute puissante, dont les membres étaient issus l'un de l'autre. Au début, Râ était sorti des eaux primitives, du Nou, dans lequel il reposait inerte de toute éternité, et, par sa seule énergie, il avait tiré de lui-même un couple divin, Shou et Tafnouît, les maîtres de l'aurore et du crépuscule, de l'atmosphère et de la ploie. Shou et Tafnouît avaient engendré Sibou-Gabou le dieu-terre et Nouît la déesse-ciel, ou plutôt Shou, se glissant entre ces deux êtres qui étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, les avait séparés pour former de Gabou la terre, de Nouït le ciel. Gabou et Nouît avaient eu pour enfants Osiris et Typhon, Isis et Nephthys, qui avaient introduit dans le monde la civilisation, la mort et la résurrection. Cette première Ennéade, la grande, avait été complétée par deux Ennéades moindres, dont la seconde, commençant avec Horus, fils d'lsis, comprenait les dieux civilisateurs et vivificateurs, Thot, Anubis, Hathor, et ainsi de suite, tandis que la troisième se composait des dieux de la mort et des mânes. Les trois Ennéades et l'idée cosmogonique qu'elles exprimaient s'étaient répandues d'autant plus rapidement qu'il y avait par toute l'Égypte l'équivalent exact des êtres qu'elles mettaient en scène. Partout où un dieu Soleil existait, qu'il s'appelât Anhouri, Shon, Khopri, on l'identifia avec le Râ héliopolitain, et l'on vit en lui le chef des Ennéades créatrices et organisatrices de l’Univers. La plupart des sacerdoces locaux se contentèrent de substituer leur dieu à Râ en tête de l'Ennéade principale, et ils ne modifièrent rien aux données de la théologie héliopolitainne. A Hermopolis seulement les prêtres greffèrent sur la théorie courante une conception originale. Leur dieu Thot était un sorcier qui, par la vertu des formules magiques et de la voix, avait suscité le monde du chaos ; ils lui attribuèrent pour assesseurs des dieux au nombre de huit, quatre mâtes et quatre femelles, qui symbolisaient le ciel et ses supports, le jour et la nuit, la durée.
L'Ennéade hermopolitaine, moins répandue que l'héliopolitainne dans la masse de la population, rencontra un accueil favorable auprès des théologiens : elle fournit un thème à leurs spéculations philosophiques ou cosmogoniques jusqu'aux derniers instants de la religion égyptienne.
L'homme avait été créé, comme le reste de l'Univers, au même instant où Râ, le Soleil, avait surgi des profondeurs de l'eau éternelle. La tradition voulait qu'au début il ne connût aucun des arts nécessaires à la vie; il n'avait pas de langage, et il en était réduit à imiter les cris des animaux. Les dieux des diverses Ennéades se chargèrent de faire son éducation et ils vinrent le gouverner l'un après l'autre. Leur séjour sur terre dura des milliers d'aunées, et leur succession forma trois dynasties divines, dont la composition varia selon les temps et les lieux. A Héliopolis, Atoumou prenait naturellement la tête de la liste. Venaient ensuite :
Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Râ, v. s. f.;
Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Shon, fils de Râ, v. s. f.;
Le roi de la Haute et de la Basse Égypte, Gabou, v. s. f.;
Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Osiris-Ounnofri, v. s. f. ;
Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Sit, v. s. f.;
Le roi de la Haute et de la Basse Egypte, Horus, v. s. f.[92].
A Memphis, Phtah était inscrit en tête. A Thèbes,Atoumou et Phtah cédaient la primauté à Amon Râ, le roi des dieux, le dieu de la première fois. Le temps de cette première dynastie divine était regardé par les Egyptiens des siècles postérieurs comme un âge d'or, auquel ils ne songeaient jamais sans envie : pour dire d'une chose qu'elle était supérieure à tout ce qu'on pouvait imaginer, ils affirmaient « ne pas en avoir vu la pareille depuis les jours du dieu Râ ». Le règne des dieux-rois n'était pas moins rempli d'événements que celui des Pharaons réels. L'histoire ne nous en est parvenue que par fragments, mais le peu qu'on en sait fait le plus grand honneur à l'imagination des Égyptiens. Râ eut à lutter sur son déclin contre l'ingratitude des mortels. Il les avait créés et instruits : ils conspirèrent contre lui et il dut rassembler les dieux secrètement, dans le grand temple d'Onou, pour aviser aux moyens de se défendre. « Voyez les hommes qui sont nés de moi-même : ils prononcent des paroles contre moi. Dites-moi donc ce que vous feriez à leur égard, car, voici, j'ai attendu et je n'ai pas voulu les tuer avant d'avoir entendu vos paroles ». Les dieux décidèrent de détruire la race des coupables, et la déesse Tafnouit à mufle de lionne fut chargée d'exécuter la sentence. Elle descendit parmi les hommes, les massacra et « baigna ses pieds dans leur sang, plusieurs nuits durant, jusqu'à la ville de Khninsou ». Le sang, recueilli et mêlé à diverses substances, fut présenté à Râ en sept mille cruches, et le dieu, apaisé par cette offrande, jura que, désormais, il épargnerait le genre humain ; mais, fatigué de vivre sur la terre, il s'envola au ciel et il remit la royauté à son fils Shou[93].
Il courait beaucoup de légendes analogues sur Shou et sur Gabou, mais Osiris était de tous celui dont l'histoire s'était développée le plus. Je n'entreprendrai pas de la raconter ; trop de documents nous font encore défaut, et ceux que nous avons sont trop obscurs pour que nous y démêlions ce qui appartient à chacune des écoles de théologie qui ont fleuri successivement en Égypte[94]. Son mythe n'est qu'une des formes sous lesquelles on se plaisait à retracer la lutte du bien et du mal, du dieu ordonnateur contre le chaos. Osiris, l'être bon par excellence, Ounnofri, est en guerre perpétuelle avec son frère Sit-Typhon, le maudit : assassiné et démembré par lui, il se ranime sous les manoeuvres magiques d’Isis, d'Horus, d'Anubis, de Thot, et il devient le modèle que les dieux eux-mêmes s'efforcent d'imiter. Or, le Soleil après sa disparition à l'Ouest du ciel, « le roi du jour, souverain de la nuit, qui avance sans station, ni relâche », Râ, n'arrêtait jamais sa course. Il allait inlassable, « sur la voie mystérieuse de la région d'Occident », à travers les ténèbres de l'enfer, « d'où nul vivant n'est jamais revenu », et il y voyageait pendant douze heures avant de regagner l'Orient et de reparaître à la lumière. Sa naissance et sa mort journalières, indéfiniment répétées, avaient suggéré aux Égyptiens l'identification d'Osiris avec Râ. Comme tous les dieux, Osiris s'était fait soleil : sous la figure de Râ, il brillait là-haut pendant les douze heures de la journée ; sous la forme d'Osiris Ounnofri, il régissait la terre. De même que Râ est chaque soir attaqué et vaincu par la nuit qui semble l'engloutir à jamais, Osiris est trahi par Sit, qui le met en pièces et disperse ses membres pour l'empêcher de ressusciter. Malgré cette éclipse momentanée, ni Osiris, ni Râ ne sont morts. Osiris Khont-Amentit, Osiris infernal, soleil de nuit, revit, comme le soleil au matin, sous le nom d'Harpechroudi, Horus enfant, l'Harpochrate des Grecs. Harpochrate, qui est Osiris, lutte contre Sit et le bat, comme le soleil levant dissipe les ombres de la nuit ; il venge son père, mais sans anéantir son ennemi. Cette guerre, qui se rallume chaque jour et qui symbolise la vie divine, servait aussi de symbole à la vie humaine. Celle-ci n'était pas, en effet, confinée à notre terre. L'être qui naissait à notre monde avait déjà vécu et devait vivre ailleurs : les moments de son existence terrestre n'étaient qu'un des stages, un des devenirs (khopriou) d'une existence dont il ne connaissait ni le commencement, ni la fin. Chacun des moments de cette existence, et partant la vie humaine, répondait à un jour de la vie du soleil et d'Osiris. La naissance de l'homme était le lever du soleil à l'Orient, et sa mort la disparition du soleil à l'Occident du ciel une fois mort l'homme devenait Osiris comme Râ lui-même, et il s'enfonçait dans la nuit, jusqu'à l'instant où il renaissait à une autre vie comme Horus Osiris à une autre journée.
Chez les Égyptiens, l'homme n'était pas composé de la même manière qu'il l'est chez nous. Il n'avait pas ainsi que nous un corps et une âme : il possédait d'abord un corps, puis un double (ka). Le double était comme un second exemplaire du corps en une matière moins dense que la matière corporelle, une projection colorée, mais aérienne, de l'individu, le reproduisant trait pour trait enfant s'il s'agissait d'un enfant, femme s'il s'agissait d'une femme, homme s'il s'agissait d'un homme. Plus tard, les idées s'élevant, on reconnut dans l'homme un être moins grossier que le double, mais doué toujours des mêmes propriétés que la matière, une substance que l'on considéra comme étant l'essence de la nature humaine et que l'on imagina sous forme d'un oiseau (Bi, Baï), ou bien une parcelle de flamme ou de lumière, qu'on nomma Khou, la lumineuse. Chacune de ces âmes avait des facultés diverses et ne subsistait pas dans le même milieu que les autres. Le double logeait à l'intérieur du tombeau, et ne le quittait point. Le Baï s'envolait vers « l'autre terre », comme une grue huppée ou comme un épervier à tête et à bras d'homme : il pouvait, à son gré, sortir de la tombe ou y rentrer. Le Khou, instruit ici-bas de toute sagesse humaine et muni de tous les talismans nécessaires pour surmonter les périls surnaturels, abandonnait notre monde afin de n'y plus revenir et se joignait au cortège des dieux de lumière. Ces diverses définitions sont contradictoires et elles auraient dû se détruire l'une l'autre ; mais les Égyptiens, à mesure qu'ils modifiaient leur âme, ne surent pas se débarrasser des notions qu'ils avaient entretenues antérieurement. Ils crurent au Baï et au Khou, sans renoncer pour cela à croire au double, et chaque homme, au lieu de n'avoir qu'une seule âme répondant à la dernière conception que ses contemporains entretenaient de l'âme humaine, eut plusieurs âmes répondant à toutes les conceptions que les dévots s'étaient faites depuis le début[95].
L'idée de la vie future changea aussi souvent que changea l'idée de l'âme. Ceux pour qui la partie durable de l'homme était le double se contentèrent de croire que les morts continuaient la vie sous terre, et ils voulurent leur fournir ce qui faisait la joie et la richesse des habitants de notre monde. Livré à ses propres forces, le double avait faim et soif, il était poursuivi par des animaux monstrueux qui le menaçaient d'une seconde mort, c'est-à-dire de l'anéantissement. Les prières des survivants, habilement rédigées, eurent pour effet de lui donner des vivres, une maison, un cortège de domestiques et de gardiens qui le protégeaient contre ses ennemis. Ses actions d'ici-bas n'exerçaient aucune influence sur le sort qui lui accroissait au delà : bon ou méchant, juste ou injuste, du moment que les rites avaient été accomplis et les prières prononcées sur lui, il florissait riche et heureux dans sa tombe. D'autres transportèrent l'âme en un monde nouveau, et ils joignirent à la croyance d'une vie future dans un milieu différent celle d'une rétribution proportionnée au bien ou au mal achevé pendant la durée de l'existence terrestre. Avant de connaître son sort, l'âme désincarnée devait comparaître devant le tribunal où Osiris, maître de l'Occident, siège, entouré des quarante-deux membres du jury infernal[96]. Sa conscience, ou, comme disaient les Égyptiens, son coeur parle pour elle ou contre elle. Le témoignage de sa vie l'accable donc ou l'absout[97] ; ses actions sont pesées dans la balance infaillible de vérité et de justice, et, selon qu'elles sont trouvées lourdes ou légères, la cour divine rend son jugement. L'âme impie tombait dans l'enfer, où elle n'avait pour nourriture et pour boisson que des matières immondes, où les scorpions et les serpents la poursuivaient, où elle subissait, après mille tortures, la mort et l'anéantissement final. L'âme juste, après avoir subi son jugement, n'était pas encore exempte d'épreuves et de dangers. Sa science s'est confirmée, ses pouvoirs se sont agrandis, elle est libre d'assumer toutes les formes qu'il lui plaît revêtir[98] ; mais le mal se dresse contre elle sous mille figures hideuses et tente de la détruire ou du moins de l'arrêter par ses menaces et par ses épouvantements[99]. Pour triompher il faut qu'elle s'identifie avec Osiris[100] et qu'elle reçoive d'Isis, de Nephtys et des dieux bons les secours qu'Osiris en avait reçus. Grâce à leur appui, elle parcourt les demeures célestes[101] et célèbre dans les champs d'Aïlou les rites du labourage mystique, puis elle se mêle à la troupe des dieux et elle marche avec eux dans l'adoration du Soleil[102]. Afin de mériter ces destinées heureuses les Égyptiens avaient rédigé comme un code de morale pratique dont les articles se montrent plus ou moins développés sur les monuments de toutes les époques[103], mais dont la version la plus explicite forme le chapitre cxxv du Livre des Morts.
Le Livre des Morts, dont chaque momie portait un exemplaire plus ou moins complet, était un recueil de prières à l'usage de l'autre monde. On y lit comment l'âme, amenée au tribunal d'Osiris, plaide sa cause par-devant le jury infernal. « Hommage à vous, Seigneur de Vérité et de Justice ! Hommage à toi, Dieu grand, Seigneur de Vérité et de Justice ! Je suis venu vers toi, ô mon maître ; je me présente à toi pour contempler tes perfections ! Car je te connais, je connais ton nom et les noms des quarante-deux divinités qui sont avec toi dans la salle de la Vérité et de la Justice, vivant des débris des pécheurs et se gorgeant de leur sang, le jour où se pèsent les paroles par-devant Osiris à la voix juste : Esprit double, seigneur de la Vérité et de la Justice est ton nom. Moi, certes, je vous connais, seigneurs de la Vérité et de la Justice ; je vous ai apporté la vérité, j'ai détruit pour vous le mensonge. Je n'ai commis aucune fraude contre les hommes ! Je n'ai pas tourmenté la veuve ! Je n'ai pas menti dans le tribunal ! Je ne connais pas la mauvaise Foi ! Je n'ai fait aucune chose défendue ! Je n'ai pas fait exécuter à un chef de travailleurs, chaque jour, plus de travaux qu'il n'en devait faire ! … Je n'ai pas été négligent ! Je n'ai pas été oisif ! Je n'ai pas failli ! Je n'ai pas défailli ! Je n'ai pas fait ce qui était abominable aux dieux ! Je n'ai pas desservi l'esclave auprès de son maître ! Je n'ai pas affamé! Je n'ai pas fait pleurer ! Je n'ai point tué ! Je n'ai pas ordonné le meurtre par trahison ! Je n'ai commis de fraude envers personne ! Je n'ai point détourné les pains des temples ! Je n'ai point distrait les gâteaux d'offrande des dieux ! Je n'ai pas enlevé les provisions ou les bandelettes des morts ! … Je n'ai point fait de gains frauduleux ! Je n'ai pas altéré les mesures de grain ! Je n'ai pas fraudé d'un doigt sur une paume ! Je n'ai pas usurpé dans les champs ! Je n'ai pas fait de gains frauduleux au moyen des poids du plateau de la balance ! Je n'ai pas faussé l'équilibre de la balance ! Je n'ai pas enlevé le lait de la bouche des nourrissons ! Je n'ai point chassé les bestiaux sacrés sur leurs herbages ! Je n'ai pas pris au filet les oiseaux divins ! Je n'ai pas pêché les poissons sacrés dans leurs étangs ! Je n'ai pas repoussé l'eau en sa saison ! Je n'ai pas coupé un bras d'eau sur son passage ! Je n'ai pas éteint le feu sacré en son heure ! Je n'ai pas violé le cycle divin dans ses offrandes choisies ! Je n'ai pas repoussé les boeufs des propriétés divines ! Je n'ai pas repoussé de dieu dans sa procession ! Je suis pur ! Je suis pur ! Je suis pur ! »
Les mêmes formules de confession négative sont répétées presque mot pour mot dans la deuxième section du chapitre, jointes chacune au nom d'un des quarante-deux membres du tribunal. La troisième section se borne à reproduire dans un langage parfois très mystique les idées exposées dans la première : « Salut à vous, dieux qui êtes dans la salle de la Vérité et de la Justice, qui n'avez point le mensonge en votre sein, mais vivez de vérité dans Onom et en nourrissez votre coeur, par-devant le Seigneur Dieu qui habite en son disque solaire. Délivrez-moi de Typhon qui se nourrit d'entrailles, ô magistrats, en ce jour du jugement suprême ; donnez au défunt de venir à vous, lui qui n'a point péché, qui n'a ni menti, ni fait le mal, qui n'a commis nul crime, qui n'a point rendu de faux témoignage, qui n'a rien fait contre lui-même, mais vit de vérité et se nourrit de justice. Il a [semé partout] la joie ; ce qu'il a fait, les hommes en parlent et les dieux s'en réjouissent. Il s'est concilié Dieu par son amour ; il a donné des pains à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements au nu ; il a donné une barque à qui était arrêté dans son voyage ; il a offert des sacrifices aux Dieux, des repas funéraires aux défunts. Délivrez-le de lui-même ! Protégez-le contre lui-même (variante), ne parlez pas contre lui, par-devant le Seigneur des morts, car sa bouche est pure et ses deux mains sont pures ![104] »
La lutte de Sit et d'Osiris se terminait par le triomphe de Sit : pendant quatre cents années au moins[105], Sit régna sur l'Égypte à la place de sa victime. Mais Osiris avait eu, après sa mort, un enfant, Horus, qui devait le venger. Le récit de la guerre d'Horus contre Sit nous a été conservé par les inscriptions du temple d'Edfou avec un luxe de détails que ne comportent pas toujours les inscriptions vraiment historiques[106]. Horus prend ici le nom d'Harmakhis (Harmakhouîti). Il a une cour, des ministres, une armée, une flotte. Son fils aîné, Harhoudîti, héritier présomptif de la couronne, commande les troupes. Le premier ministre, Thot, dieu de son métier et inventeur des lettres connaît sa géographie et sa rhétorique sur le bout du doigt il est d'ailleurs historiographe de la cour et on l'a chargé, par décret royal, du soin d'enregistrer les victoires de son seigneur et d'inventer pour elle des noms sonores. Un souverain si bien servi ne pouvait pas souffrir qu'un usurpateur comme Sit jouît trop longtemps de son pouvoir : aussi, en l'an 565 de son règne, se décide-t-il à la guerre. Il s'ébranle avec sa flotte, ses archers et ses chars, il descend le Nil sur sa barque, il ordonne des marches et des contremarches ; il livre des batailles rangées, il soumet des villes, jusqu'au moment où l'Égypte entière se prosterne devant lui. Son triomphe n'est pas si complet cependant qu'il anéantisse l'adversaire : après diverses vicissitudes, la querelle des deux prétendants est évoquée devant le dieu Gabou, qui juge de leurs titres et qui partage la vallée du Nil en deux royaumes, dont la limite est à Titoouï, un peu au sud de Memphis[107]. Désormais la constitution politique de l'Égypte est un fait accompli : elle se compose de deux moitiés, la moitié d'Horus et la moitié de Sit, la Haute et la Basse Égypte, qui, réunies, formeront le royaume des Pharaons.
Le premier roi qu'on lui connaisse, le premier du moins dont les Égyptiens eussent gardé le souvenir, portait le nom de Mini (Ménès)[108]. Il était originaire de Thini, dans la Haute Égypte[109]. Jusqu'alors Onou et les cantons du nord avaient eu la part principale dans le développement de la civilisation égyptienne. Les prières et les hymnes, qui servirent plus tard de noyau aux livres sacrés, avaient été rédigés à Onou. Le dieu d'Onou, Râ, avait fourni le type sur lequel s'étaient modelés peu à peu les autres dieux locaux. Il semble bien que l'avènement du Thinite détruisit la supériorité que la ville du Soleil avait exercée si longtemps. La monarchie dont il fût officiellement le fondateur dura quatre mille ans au moins, sous trente dynasties consécutives. On divise d'ordinaire cet intervalle de temps, le plus long qu'ait enregistré l'histoire, en trois parties : l'Ancien Empire, de la première à la onzième dynastie ; le Moyen Empire, de la onzième dynastie à l'invasion des Pasteurs ; le Nouvel Empire, de l'invasion des Pasteurs à la conquête persane. Cette division a l'inconvénient de ne pas tenir un compte suffisant de la marche des évènements. Il se produisit en effet quatre grandes révolutions dans la vie politique de l'Égypte. Au début des âges, le centre de gravité du pays reposa sur Thinis : Thinis est la capitale et le tombeau des rois. Bientôt, toutefois, avec la troisième dynastie, Memphis impose ses souverains à tous et elle est l'entrepôt du commerce et de l'industrie. C'est la seconde période, celle qui marque l'apogée de l'Égypte archaïque ; mais, vers la sixième dynastie, le centre de gravité se déplace et tend à s'abaisser vers le sud. Il s'arrête d'abord à Héracléopolis dans la Moyenne Égypte (neuvième et dixième dynasties), puis il descend encore et se fixe à Thèbes sous la onzième dynastie. Dès ce moment, Thèbes reste la capitale réelle et elle fournit les rois : à l'exception de la quatorzième dynastie, xoïte, toutes les dynasties, de la onzième à la vingt et unième, sont thébaines de naissance. Quand les Pasteurs envahissent la vallée, la Thébaïde s'ouvre comme un refuge à la nationalité égyptienne, et ses princes, après avoir lutté pendant des siècles contre les conquérants, finissent par affranchir le royaume entier au profit d'une dynastie thébaine, la dix-huitième, qui ouvre l'ère des guerres étrangères. Sous la dix-neuvième dynastie, un mouvement inverse à celui qui s'était produit vers la fin de la sixième redresse peu à peu le centre de gravité vers le nord et vers la mer. Avec la vingt et unième dynastie, tanite, Thèbes perdit son rang de capitale, et les villes du Delta, Tanis, Bubaste, Mendès, Sébennytos et surtout Saïs, se disputèrent la primauté avec acharnement. Désormais toute la vie active se concentra dans les nomes maritimes : ceux de la Thébaïde, ruinés par les invasions éthiopiennes et assyriennes, furent privés de leur influence ; Thèbes tomba en ruines et ne fut plus qu'un rendez-vous de touristes curieux. Je proposerai donc de diviser l'histoire d'Égypte en trois périodes, correspondant chacune à la suprématie d'une ville ou d'une portion du pays sur le pays entier[110].
1° Période archaïque (Première-dixième dynasties). – Elle se subdivise on deux périodes secondaires :
a. Empire Thinite. Première-deuxième dynasties.
b. Empire Memphite. Troisième-dixième dynasties.
2° Période thébaine (Onzième-vingtième dynasties). - Suprématie de Thèbes et des rois thébains. - Cette période est divisée en deux parties par l'invasion des Pasteurs :
a. Ancien Empire thébain. Onzième-quatorzième dynasties.
b. Nouvel Empire thébain. Dix-septième-vingtième dynasties.
3° Période saïte (Vingt et unième-trentième dynasties). - Suprématie de Saïs et des autres villes du Delta. - Cette période est divisée on deux parties par l'invasion perse:
a. Première période saïte. Vingt et unième-vingt-sixième dynasties.
b. Deuxième période saïte. Vingt-septiéme-trentième dynasties.
Ménès
et les dynasties thinites.
Jusque dans ces dernières années les princes thinites, Si bien assurée que leur existence fût par le témoignage des listes royales, n'étaient pour nous que de simples fantômes, presque aussi insaisissables que les douteux serviteurs d'Horus, dont la tradition peuplait le monde primitif. On nous racontait qu'après son avènement Ménès n'avait point voulu fixer le siège de son gouvernement au lieu de sa naissance. A nouvel empire, nouvelle capitale : il fonda Memphis, sur la rive gauche du Nil, à quelques lieues au sud du Delta[111]. « Jadis en effet tout le fleuve coulait vers la Libye, le long de la montagne sablonneuse (qui borne l'Egypte à l'occident) : Ménès, à cent stades au-dessus de Memphis, combla le bras qui va vers le midi, mit à sec l'ancien lit, et contraignit le fleuve à couler au milieu de l'espace qui sépare les deux montagnes. Encore maintenant les Perses surveillent avec le plus grand soin ce bras du Nil qui coule dans un lit distinct, et consolident la digue chaque année car, si le fleuve voulait la rompre et déborder de ce côté, il serait à craindre que Memphis entière ne fût inondée. Lors donc que Ménès, le premier qui se fit roi, eut enclos de digues un terrain solide, il y bâtit cette ville qui est aujourd'hui appelée Memphis (car Memphis, elle aussi, est dans la partie étroite de l'Egypte) ; en dehors de la ville et tout autour d'elle, il creusa un lac qui, dérivé du fleuve, va vers le nord et l'ouest, car le côté de l'orient c'est le Nil qui l'enclôt.[112] »
Il est impossible de dire ce qu'il y a de vrai dans cette tradition, non plus que dans celles qui nous représentent Ménès comme le type achevé du monarque égyptien, à la fois constructeur, législateur et soldat. Il construit le grand temple de Phtah[113] et il règle le culte des dieux[114] ; il est conquérant à l'occasion et il conduit des armées hors de ses frontières[115] ; enfin, on assure qu'entre temps il perdit son fils unique à la fleur de l'âge : le peuple composa à ce sujet un chant de deuil, le Manéros, dont l'air et les paroles se transmirent de siècle en siècle[116]. On ajoute qu'il se montra ami du luxe, qu'il inventa l'art de servir un dîner, et qu'il enseigna à ses sujets la manière de manger étendu sur un lit[117]. Aussi un prince saïte, Tafnakhiti, père du Bocchoris de la vingt-quatrième dynastie, pendant une expédition contre les Arabes, où l'aridité du désert le força de renoncer à la pompe et aux délicatesses de la royauté pour mener quelques jours durant le train d'un simple particulier, maudit solennellement Ménès, et fit graver ses imprécations sur une stèle dressée dans le temple d'Amon, à Thèbes[118]. Cela n'empêcha point le premier roi humain de rester toujours cher aux Égyptiens son nom se retrouve en tête de presque toutes les listes royales, et son culte se perpétua jusque sous les Ptolémées[119].
Il mourut sous la dent d'un hippopotame après soixante ou soixante-deux ans de règne, et le peu que nous savons de ses successeurs tient plus du roman que de l'histoire. Manéthon énumérait avec une complaisance superstitieuse les miracles qui avaient attristé ou réjoui leurs règnes. Une grue à deux têtes apparue dans la première année de Têti, le fils de Ménès, avait été pour l'Egypte le présage d'une longue prospérité[120] ; sous Ouénéphès une famine terrible avait décimé le peuple[121]. Çà et là, quelques détails trop brefs sur les constructions royales : Têti avait jeté les fondations du grand palais de Memphis[122], et Ouénéphès élevé les pyramides de Kô-komè, près du bourg actuel de Saqqarah[123]. Plusieurs de ces vieux rois, si éloignés de nous qu'on a peine à s'imaginer qu'ils ont vécu, avaient, dit la tradition, ambitionné le renom d'écrivain ou de savant. Têti avait étudié la médecine et composé des traités d'anatomie[124] ; le chapitre lxiv du Livre des Morts[125] et l'un des ouvrages contenus au Papyrus Médical de Berlin passaient pour avoir été découverts « dans les jours de la sainteté du roi des deux Égyptes, Housaphaïti, le véridique[126] ». Sous Sémempsès, petit-fils d'Housaphaïti, la peste ravagea la contrée : les lois se relâchèrent, de grands crimes furent commis, et des révoltes éclatèrent, qui amenèrent bientôt la chute de la première dynastie.
La seconde n'était pas mieux partagée que la première. Manéthon n'avait enregistré du fondateur Boêthos que la mention d'un désastre épouvantable : un gouffre s'était creusé près de Bubaste et avait englouti beaucoup de gens[127]. Kakoou aurait proclamé dieux l'Hapi de Memphis, le Mnévis d'Héliopolis et le bouc de Mendès : aussi son nom royal signifie-t-il « le mâle des mâles » ou « le taureau des taureaux », par allusion sans doute aux idées symboliques qui prévalaient de son temps, et auxquelles la divinisation des animaux conféra une confirmation éclatante[128]. Son successeur, Binôthris, aurait accordé le droit de succession aux femmes de sang royal. On ne savait des autres que quelques histoires ridicules : sous Nepherkherês, le Nil avait roulé du miel onze jours durant, et Sésochris passait pour avoir été un géant[129]. Pourtant leur figure s'ébauchait déjà plus réelle que celle de leurs prédécesseurs, et quelques-uns des mastabas disséminés dans les cimetières de Memphis, le tombeau de Thothhotpou à Saqqarah, la grande stèle de Shiri au Musée du Caire[130], les statues de Sapi au Louvre[131], semblaient pouvoir être reportés jusqu'à leur époque. Les fouilles de ces dernières années ont rompu enfin le charme d'oubli, qui pesait si lourdement sur ces vieux souverains et elles ont ramené à la lumière leurs monuments, chapelles ou tombeaux[132]. C'est sur le territoire même du nome dont ils étaient originaires, à l'ouest de Thinis, dans la nécropole d'Abydos, c'est à Neggadéh et à Kom el Ahmar dans la Haute Égypte, c'est à Sakkarah, près de Memphis, qu'ils ont reparu au jour, et désormais nous pouvons espérer que les traces de leur activité se manifesteront partout, du Delta à la première cataracte. Les tombeaux d'Abydos, les plus nombreux jusqu'à présent, sont comme l'ébauche grossière des pyramides de la plaine memphite, des constructions rectangulaires s'élevant médiocrement au-dessus du sable et bâties de briques posées à cru sans mortier. La chambre funéraire, en partie creusée dans le roc, avait un toit plat de poutres, recouvert d'une couche de sable d'un mètre d'épaisseur ; le plancher était de bois également, et le cadavre du souverain y était posé au milieu, environné de son mobilier funéraire. De petites chambres ménagées symétriquement autour de la pièce principale recevaient le gros des provisions, et souvent aussi les corps d'esclaves, de femmes et d'animaux domestiques, sacrifiés au jour de l'enterrement pour accompagner le maître dans l’autre monde. Des stèles grossières se mêlent aux présents, dont beaucoup contiennent le nom de ses serviteurs ou l'épitaphe de ses nains et de ses chiens favoris ; des tablettes d'ivoire, d'os ou de schiste, sculptées habilement, représentent les scènes des funérailles ou certains des exploits du mort. Les offrandes sont en substance les mêmes que celles qui abondent dans les tombeaux des âges postérieurs et qui sont inscrites sur les listes funèbres, les gâteaux, les différentes sortes de pains, les vins, la bière, les liqueurs, les légumes, les fruits, la volaille, la viande de boucherie. Le mobilier comprend, outre les nattes et les étoffes du trousseau, des chaises, des tabourets, des fauteuils, des lits à pieds et à têtes de lions, et une quantité prodigieuse de vases en terre cuite ou en pierres dures, telles que le granit, le cristal de roche, l'albâtre, sur lesquels le prénom et les titres royaux sont gravés. Les outils et les armes sont en un silex blond, travaillé d'une perfection qui n'a d'égale en aucune partie du monde, parfois avec la poignée en or estampée. Au-dessus du tombeau, deux stèles se dressaient sur lesquelles on lisait en hiéroglyphes massifs le nom d'intronisation du souverain, celui qu'il recevait comme descendant d'Horus et comme identifié à Horus lui-même : c'est devant elles qu'aux jours de fêtes les sacrifices s'accomplissaient et qu'on entassait les viandes et les pains destinés au double pour la suite des siècles. Des tombeaux privés se groupaient autour de chaque hypogée royal, où venaient reposer les officiers de l'entourage du souverain, si bien que la Majesté défunte était entourée après sa mort des mêmes personnages qui l'avaient servie durant sa vie terrestre.
L'usage de graver sur les monuments non pas le nom propre du Pharaon, mais son nom d'Horus, ne nous a point permis encore de classer d'une manière certaine tous les rois qui surgissent ainsi de la poussière Manéthon et les listes antiques ne nous ayant transmis que les noms propres, il nous est impossible d'assimiler les membres de leurs dynasties thinites aux maîtres des tombeaux d'Abydos, sauf dans les cas, fort rares, où les deux sortes de noms se trouvent réunies sur l'un des objets recueillis récemment. C'est le cas pour Ménès probablement, et pour trois de ses successeurs, Miébis, Ousaphaîs et Sémempsès[133], mais toutes les tentatives faites jusqu'à présent pour identifier les autres n’ont produit aucun résultat sérieux. Et pourtant, malgré cette incertitude, quels progrès cette résurrection ne nous a-t-elle pas procurés dans la connaissance de l'Égypte primitive ? Ces rois étaient des conquérants et des constructeurs : leurs victoires sont représentées avec les noms des peuples ou des villes qu'ils vainquirent. La religion et les rites funéraires étaient déjà complètement fixés sous eux, et le système d'écriture qu'ils employaient ne diffère que par des détails de celui que nous déchiffrons sur les inscriptions des temps memphites ou thébains. Enfin leurs bijoux, leurs armes, leur vaisselle sont d'un fini d'exécution qui suppose une longue habitude. Les quelques stèles et les quelques statues que nous avons d'eux jusqu'à présent ne trahissent pas plus que le reste les caractères d'un art encore dans l'enfance. Sans doute les hiéroglyphes y sont comme en désordre et les figures ébauchées à grands coups plutôt que finies ; mais ces imperfections prouvent simplement que les pièces tombées entre nos mains n'étaient pas des plus soignées. Il y a de mauvaises oeuvres a toutes les époques, et le hasard des fouilles ne nous a pas rendu ce que les sculpteurs de ces premières dynasties avaient exécuté de mieux : si rudes que soient les statues de Sapi et la stèle de Shiri, elles ne sont pas plus grossières que mainte statue ou mainte stèle de la IVe ou de la VIe dynastie.
Avec le dernier roi de la deuxième dynastie s'éteignit probablement la descendance directe de Ménès. Elle avait régné cinq siècles et demi, et accompli durant cet intervalle une oeuvre qui n'était ni sans gloire ni sans difficulté. Les princes des nomes durent s'habituer difficilement à leur vasselage, et ils saisirent sans doute tous les prétextes de révolte que la cruauté ou la faiblesse de certains rois leur offrirent. Il est vraisemblable que plusieurs d'entre eux réussirent à regagner leur indépendance et même à établir des dynasties collatérales, qui disputèrent le pouvoir suprême à la famille régnante ou parfois la réduisirent à une impuissance momentanée. La plupart des noms royaux, qui figurent sur certaines listes pharaoniques et ne se retrouvent pas dans des listes de Manéthon, appartiennent probablement à ces dynasties illégitimes. Les descendants de Ménès finirent par triompher de ces résistances et par s'imposer au pays entier. Les clans se mêlèrent et se fondirent « d'Abou jusqu'à Adhou », d'Éléphantine au Delta. Ménès avait fondé un royaume d'Egypte : ses successeurs des deux premières dynasties en unirent les éléments disparates et ils en formèrent une nation égyptienne.
Chapitre
II : Empire memphite - de la troisième à la dixième dynastie
(Ancien empire)
Les
tombes memphites : La quatrième et la cinquième dynastie.
La troisième dynastie était memphite, mais malgré cette origine elle dut au début ne faire autre chose que continuer la tradition des dynasties thinites. Les historiens de l'époque classique n'avaient donc conservé d'elle que des légendes analogues à celles que nous possédons sur les deux dynasties précédentes[134]. Le règne du premier de ses Pharaons fut marqué, nous dit-on, par des désordres sérieux. Les Libyens, tributaires depuis Ménès, se révoltèrent contre le roi Nékhérôphès et menacèrent l'intégrité de l'empire. Au moment décisif, la superstition vint en aide aux Égyptiens. Une nuit, tandis que les deux armées étaient en présence, le disque de la lune sembla s'accroître démesurément, au grand effroi des ennemis, qui prirent ce phénomène pour un signe de la colère céleste et qui se soumirent sans combat[135]. La paix ne fut plus troublée de longtemps, et sa durée favorisa le développement des sciences et des arts. Le successeur de Néchérôphès, Tosorthros, perfectionna l'écriture et la taille des blocs de pierre. Médecin comme Têti, il aurait composé des traités qui existaient encore aux premiers siècles de l'ère chrétienne : aussi les Grecs l'avaient-ils identifié avec leur dieu Asclépios, l'Imhotpou des Égyptiens[136]. Sous l'influence de ce roi et de ses descendants, la richesse du pays s'accrut, les monuments se multiplièrent ; par malheur, l’habitude qu'ils conservaient de se faire désigner officiellement par leurs noms d'Horus ne nous permet pas encore de déterminer quel est celui d'entre eux qui édifia un temple à Hieracônpolis en face d'El-Kab[137]. Encore quelques règnes, et les tombeaux vont nous livrer une telle masse de documents originaux que nous pourrons reconstituer d'une manière certaine, non seulement l'histoire des souverains, mais la vie des simples particuliers.
Une lieue environ à l'ouest de Memphis, la chaîne Libyque se déploie en un vaste plateau, qui court, dans la même direction que le Nil, sur mie longueur de plusieurs lieues. A l'extrémité septentrionale, un prince demeuré inconnu, mais qu'il faut peut-être reporter jusqu'aux siècles antérieurs à Ménès, avait taillé en plein roc un sphinx gigantesque, symbole d'Harmakhis, le soleil levant. Plus tard un temple d'albâtre et de granit, le seul spécimen que nous possédions de l'architecture monumentale de l'Ancien Empire, fut construit à quelque distance de l'image du dieu; d'autres temples, aujourd'hui détruits, s'élevèrent çà et là et firent du plateau entier comme un vaste sanctuaire consacré aux divinités funéraires. Les habitants de Memphis vinrent y déposer leurs morts à l'abri de l'inondation. Les gens du vulgaire étaient enterrés dans le sable à un mètre de profondeur, le plus souvent nus et sans cercueils. D'autres étaient ensevelis dans de petites chambres rectangulaires, grossièrement bâties en briques jaunes, le tout surmonté d'un plafond en voûte, d'ordinaire ogivale. Aucun ornement, aucun objet précieux ne les accompagnait au tombeau : seulement des vases en poterie étaient placés à côté du cadavre et renfermaient les provisions qu'on lui assignait pour l'autre vie[138].
Les tombes monumentales sont, à proprement parler, la demeure du double. Lorsqu'elles sont complètes, elles se divisent en trois parties une chapelle extérieure, un puits et des caveaux souterrains. La chapelle est une construction quadrangulaire qu'on prendrait de loin pour une pyramide tronquée. Les faces, bâties en pierres ou en briques, sont symétriquement inclinées et le plus souvent unies : parfois cependant les assises sont en retrait l'une sur l'autre et forment presque gradins. La porte, qui s'ouvre d'ordinaire dans la paroi de l'est, est tantôt surmontée simplement d'un tambour cylindrique, tantôt ornée sur les côtés de bas-reliefs représentant l'image en pied du défunt, et couronnée par une large dalle couverte d'une inscription en lignes horizontales. C'est une prière et l'indication des jours consacrés au culte des ancêtres. « Proscynème fait à Anubis, résidant dans le palais divin, pour que soit donnée une sépulture dans l'Amentit, la contrée de l'ouest, la très grande et très bonne, au féal selon le Dieu grand pour qu'il marche sur les voies où il est bon de marcher, le féal selon le dieu grand, pour qu'il ait des offrandes en pains, farines et liqueurs, à la fête du commencement de l'année, à la fête de Thot, au premier jour de l'an, à la fête de Ouagaît, à la grande fête du feu, à la procession du dieu Minou, à la fête des offrandes, aux fêtes du mois et du demi-mois, et chaque jour. »
D'habitude, l'intérieur de la chapelle ne renferme qu'une seule chambre. Au fond, à la place d'honneur, se dresse une stèle quadrangulaire de proportions colossales, au pied de laquelle on aperçoit une table d'offrandes en albâtre, granit ou pierre calcaire, posée à plat sur le sol, et quelquefois deux obélisques minuscules ou deux autels, évidés au sommet pour recevoir les dons en pains sacrés, en liqueurs et en victuailles dont il est parlé dans l'inscription extérieure. L'aspect de la stèle est celui d'une porte un peu étroite, un peu basse, dont la baie serait toujours close. L'inscription gravée sur le linteau nous apprend le nom du maître du tombeau. Les figures taillées dans les montants sont ses portraits et ceux des personnes de sa famille. La petite scène du fond le montre assis devant sa table, et l'on a poussé le soin jusqu'à graver auprès de lui le menu de son repas. La stèle était à proprement parler la façade extérieure de la maison éternelle où chacun allait s'enfermer à son tour. Rien d'étonnant qu'on l'ait faite à la semblance d'une porte : si la porte est fermée, c'est que nul ne devait pénétrer dans le caveau, ni voir te sarcophage, passé le jour de l'enterrement. La formule qu'on y inscrivait n'était pas seulement une épitaphe destinée à rappeler aux générations futures que tel ou telle avait existé jadis ; elle préservait le nom et la filiation de chacun, et elle attribuait au mort un état civil, sans lequel il n'aurait pas eu de personnalité dans sa vie nouvelle : un mort sans nom aurait été comme s'il n'existait pas. Ce n'était là toutefois que la moindre vertu de la stèle : la prière et les figures qui y étaient tracées avaient pour effet d'assurer des moyens d'existence au personnage auquel elle était consacrée. Comme les vivants ne sont pas en communication directe avec les morts et ne peuvent leur transmettre les offrandes de la main à la main, ils élisent un dieu pour intermédiaire et ils lui dédient le sacrifice, à la condition qu'il prélèvera la part de son féal sur toutes les bonnes choses qu'on lui voue et dont il vit. L'être invoqué est presque toujours le chacal Anubis ou le Dieu grand, c'est-à-dire Osiris. L'âme ou plutôt le double du pain, des boissons, de la viande, se rendait de la sorte dans l'autre monde et il y nourrissait le double de l'homme. Il n'y avait même pas besoin que cette offrande fût réelle pour être effective le premier venu, répétant avec la voix juste la formule de l'offrande, procurait par cela seul au double la possession de tous les objets dont il récitait l'énumération.
Dans bien des cas, la stèle seule était gravée ; souvent aussi, les parois de la chambre étaient décorées de tableaux et de scènes sculptés avec soin. Un seul de ces tableaux a une signification funéraire bien marquée et représente la façon dont le mort exécutait son voyage d'outre-tombe. Les Égyptiens pensaient, comme la plupart des peuples, que le passage de cette terre-ci à l'autre terre ne peut pas s'opérer indifféremment à tous les endroits. Le point exact d'où leurs âmes partaient pour entrer dans le monde surnaturel se trouvait à l'ouest d'Abydos, et c'était une fente de la montagne. La barque du soleil, le soir, arrivée au terme de sa course diurne, se glissait avec son cortège de dieux par la bouche de la fente et pénétrait dans la nuit. Les âmes s'y insinuaient avec elle sous la protection d'Osiris. Il fallait donc qu'elles se rendissent à Abydos de tous les points de l'Égypte, et l'on supposait qu'elles faisaient le voyage par eau. Cette expédition est fréquemment représentée sur les peintures des tombeaux. D'ordinaire, le mort, habillé de ses vêtements civils, commande la manoeuvre comme s'il eût été encore en vie. D'autres fois, il était enfermé dans un catafalque entouré de pleureuses et de prêtres. Des canots et des chalands chargés d'offrandes escortent les barques principales. Les gens de l'équipage poussent des cris de bon augure : « En paix, en paix, auprès d'Osiris ! » ou causent et se disputent entre eux. On serait tenté de croire qu'il s'agit d'une véritable traversée, et les Grecs se sont laissé tromper aux apparences. Ils racontaient que les plus considérés et les plus riches des Égyptiens se font enterrer dans Abydos parce qu'ils estiment à honneur de reposer auprès d'Osiris. En fait, les personnages des tableaux d'hypogées ne vont pas réellement à Abydos. Ils reposent à Memphis, à Béni-Hassan, à Thèbes ou dans telle autre ville : leur âme seule partait en excursion après la mort[139].
Toutes les autres scènes nous font assister à la préparation et au transport des offrandes funéraires. De leur vivant, les grands seigneurs passaient avec les prêtres de véritables contrats, par lesquels ils donnaient à tel ou tel temple des terres et des revenus en échange de sacrifices aux époques réglées par la coutume. Ces terres constituaient les biens du tombeau et elles fournissaient les viandes, les légumes, les fruits, le linge, tout ce qu'il faut pour monter et pour entretenir une maison[140]. Les bas-reliefs sculptés sur les murs représentent donc les épisodes les plus notables de la vie agricole, industrielle et domestique. D'un côté, c'est le labourage, le semage, la récolte, la rentrée des blés, l'emmagasinement des grains, puis l'élevage des bestiaux, l'empâtement des volailles. Un peu plus loin, des escouades d'ouvriers vaquent chacun aux travaux de son métier : des cordonniers, des verriers, des fondeurs, des menuisiers sont rangés et groupés à la file ; des charpentiers abattent des arbres et mettent une barque en chantier ; des femmes tissent au métier, sous la surveillance d'un contremaître renfrogné qui paraît peu disposé à souffrir leur babil. Tout cela est accompagné de légendes explicatives où les paroles des personnages en scène sont reproduites. « Tiens bon ; saisis fortement », commande à son aide le boucher prêt à tuer un bœuf. « C'est prêt, agis à ton bon plaisir », lui répond celui-ci. Un batelier de bonne humeur crie de loin à un vieillard qui pêche sur la rive : « Viens sur l'eau » ; et le vieillard : « Allons, pas tant de paroles », lui dit-il[141]. Scènes et légendes avaient une intention magique : qu'elles se référassent à la vie civile ou à l'enfer, elles devaient assurer au mort une existence heureuse ou le préserver des dangers d'outre-tombe. De même que la répétition de la formule des stèles : « Proscynème à Osiris pour qu'il donne un revenu de pains, liqueurs, vêtements, provisions, au défunt » procurait à ce défunt, sans offrande réelle, la jouissance des biens énumérés, de même la reproduction de certains actes sur les parois de la tombe lui en garantissait l'accomplissement véritable. Le double, retiré au fond de sa chapelle, se voyait sur la muraille allant à la chasse, et il allait à la chasse, mangeant et buvant avec sa femme, et il mangeait et buvait avec sa femme ; le labourage, la moisson, la grangée des parois se faisaient pour lui labourage, moisson et grangée réels. Les gens de toute sorte peints dans les registres cousaient des souliers et cuisinaient à son intention, le guidaient à la chasse dans le désert ou à la pêche dans les fourrés de papyrus. Après tout, ce monde de vassaux plaqué sur le mur n'était pas moins réel que le double dont il dépendait : la peinture d'un serviteur était bien ce qu'il fallait à l'ombre d'un maître. L'Égyptien croyait, en remplissant sa tombe de figures au travail, qu'il prolongeait au delà de la vie terrestre la jouissance de tous les objets qu'elles y fabriquaient et de toutes les richesses qu'elles lui apportaient[142].
C'est dans cette chambre ainsi ornée que les descendants du mort et les prêtres attachés à son culte se réunissaient aux jours indiqués afin de rendre hommage à l'ancêtre. Ils le revoyaient là tel qu'il avait été durant son existence, escorté de ses serviteurs et entouré de ce qui avait fait la joie de sa vie terrestre, partout présent et polir ainsi dire palpitant au milieu d'eux. Ils savaient que, derrière l'une des parois, dans un étroit réduit, dans un serdab ménagé au milieu de la maçonnerie, ses statues était entassées pêle-mêle. D'ordinaire, ce serdab ne communiquait pas avec la chambre et il restait perdu dans son mur ; quelquefois, il était relié avec le dehors par une sorte de conduit si resserré qu'on a peine à y glisser là main. A jours fixes, les parents venaient murmurer des prières et brûler des parfums à l'orifice[143] : c'était bien leur mort lui-même qui les recevait par là. En effet, pour persister dans l'autre monde, le double exigeait un corps tangible. La chair sur laquelle il s'était appuyé pendant l'existence terrestre lui servait encore de support principal, et c'est pour cela sans doute qu'on essayait d'en retarder la destruction par les pratiques de l'embaumement. Mais la momie défigurée ne rappelait plus que de loin l'aspect du vivant. Elle était, d'ailleurs, unique et facile à détruire : on pouvait la brûler, la démembrer, en disperser les morceaux. Elle disparue, que serait devenu le double ? On adjoignait pour suppléants au corps de chair des corps de pierre ou de bois qui reproduisaient exactement ses traits, des statues. Les statues étaient plus solides, et rien n'empêchait qu'on les fabriquât en la quantité qu'on voulait. Un seul corps était une seule chance de durée pour le double : vingt statues lui ajoutaient vingt chances. De là ce nombre vraiment étonnant de statues qu'on rencontre quelquefois dans une seule tombe. La prévoyance du mort et la piété des parents prodiguaient les images du corps terrestre, et par suite les supports, les corps impérissables du double, lui conférant par cela seul une presque immortalité. La même raison multipliait parfois, autour des statues du mort, les statues de ses serviteurs, immobilisés dans différents actes de domesticité, pétrissant la pâte, broyant le grain, poissant les jarres destinées à contenir le vin.
On comprend quel caractère particulier cette conception de la vie de l'âme imprima à l'art égyptien. La première condition à remplir pour que le double pût s'adapter à son soutien de pierre, c'est que celui-ci reflétât jusque dans leurs moindres détails les traits et les portions du corps de chair. De là ce caractère réaliste et idéal à la fois qu'on remarque dans les statues. Le corps et la pose sont idéalisés presque toujours. Il est rare en effet qu'on observe un buste émacié de vieillard, le sein flétri et le ventre gonflé des femmes sur le retour : les hommes sont toujours, ou des adolescents aux membres élancés, ou des hommes faits dans la force de l'âge ; les femmes ont toujours le sein ferme et les hanches minces de la jeune fille. Le corps est, pour ainsi dire, un corps moyen, qui montre le personnage au meilleur de son développement, et qui le rend capable d'exercer dans l'autre monde la plénitude de ses fonctions physiques. C'est seulement dans le cas d'une difformité par trop accentuée, que l'artiste se départ de cet idéal : il laisse à la statue d'un nain toutes les laideurs du corps du nain. Il fallait bien qu'il en fût ainsi : si l'on avait placé dans l'hypogée d'un nain la statue d'un homme normal, le double, habitué ici-bas aux irrégularités de ses membres, n'aurait pu se plier à ce corps régulier et il n'aurait pas été dans les conditions nécessaires pour se plaire au monde des tombeaux[144]. Mais, une fois admise cette manière d'idéaliser ses modèles, le sculpteur devait traduire avec fidélité les traits de leur visage et les particularités de leur démarche. Il le faisait parfois avec brutalité, le plus souvent avec une fidélité naïve. Les statues sont de véritables portraits, et nous permettent de reconstituer la population de l'Égypte aux premières dynasties avec plus de facilité que nous ne reconstituons la population de l'Italie aux premiers temps de l'empire romain. Les poses sont celles de la classe à laquelle appartient l'original : la statue est accroupie, s'il s'agit d'un scribe ; debout dans l'attitude de commandement ou assise sur le siège d'apparat, s’il s'agit d'un roi ou d'un noble qui attend les offrandes de ses vassaux[145].
Le puits qui descend au caveau s’ouvre quelquefois dans un coin de la chambre ; mais souvent, pour en découvrir la bouche, il faut monter sur la plate-forme de la chapelle extérieure. Il est carré ou rectangulaire, bâti en grandes et belles pierres jusqu'à l'endroit où il s'enfonce dans le roc. Sa profondeur moyenne est de douze à quinze mètres, mais il peut aller jusqu'à trente et au delà. Au fond et dans la paroi du sud, se creuse un couloir où l'on ne pénètre que courbé et qui mène à la chambre funéraire proprement dite. Elle est taillée dans la pierre vive et dépourvue d'ornements au milieu s'allonge un grand sarcophage en calcaire fin, en granit rose ou en basalte noir, gravé quelquefois aux noms et titres du défunt. Après avoir scellé le corps, les ouvriers déposaient sur le sol les quartiers d'un boeuf qu'on venait de sacrifier dans la chambre du haut, de la vaisselle avec des fruits ou des légumes, des amphores de vin, des vases en poterie rouge pleins d'eau bourbeuse ; puis ils muraient avec soin l'entrée du couloir et ils remplissaient le puits jusqu'au sommet d'éclats de pierre mêlés de sable et de terre. Le tout, largement arrosé, finissait par constituer un ciment presque impénétrable dont la dureté mettait le mort à l'abri de toute profanation[146].
Ces tombes, véritables monuments dont l'aspect faisait dire aux Grecs qu'elles étaient les demeures éternelles des Égyptiens, auprès desquelles leurs palais ne paraissaient que des hôtelleries, formaient plusieurs villes funéraires plus étendues que la ville des vivants. A Gizeh, elles sont disposées sur un plan symétrique et rangées le long de véritables rues ; à Saqqarah, elles sont semées en désordre à la surface du plateau, espacées dans certains endroits, entassées pêle-mêle dans certains autres. Au plus pressé de leur foule, on rencontre des pyramides isolées ou assemblées en groupes inégaux[147]. Les unes ont sept à huit mètres de haut et dépassent à peine le niveau des tombes voisines ; les autres atteignent jusqu à cent cinquante mètres et comptent encore aujourd'hui parmi les masses les plus considérables que la main de l'homme ait jamais édifiées. Ce sont des tombes royales. Pour les préparer chaque Pharaon avait découpé le roc et remué la terre dès le début de son règne ; les personnages les plus importants de son entourage avaient parcouru le royaume à la recherche d'un bloc d'albâtre ou de granit digne de faire le sarcophage d'un roi ; la population de villes et de provinces entières avait été envoyée aux carrières et aux chantiers de construction. Un temple était joint à chaque pyramide, où le monarque défunt recevait les offrandes de ses sujets et les hommages d'un collège de prêtres attaché spécialement à son culte.
En ce temps-là, « voici que la majesté du roi Houni mourut, et que la majesté du roi Snofroui s'éleva en qualité de roi bienfaisant dans ce pays tout entier[148] ». Snofroui, le Sôris de Manéthon[149], fit la guerre aux tribus nomades (Monatiou) qui harcelaient sans cesse la frontière orientale du Delta, et pénétra jusqu'au fond de la péninsule du Sinaï. Un bas-relief de l'Ouadi-Magharah, trophée de sa campagne, nous montre « le roi des deux Égyptes, le seigneur des diadèmes, le maître de justice, l'Horus vainqueur, Snofroui, le dieu grand », écrasant de sa masse d'armes un barbare terrassé devant lui[150]. Il exploita à son profit les mines de cuivre et de turquoises du Sinaï ; et, afin de mettre désormais le Delta à l'abri des incursions, il garnit la frontière d'une série de forteresses, dont une au moins, Shè-Snofroui[151], existait encore sous les premiers rois de la douzième dynastie[152]. Sa religion, établie immédiatement après sa mort, se perpétua à travers les siècles et dura jusque sous les Ptolémées[153].
Mais son renom, si grand qu'il fût aux bords du Nil, s'efface devant celui de ses trois successeurs, Khoufoui (Kheops), Khâfrî (Khephren) et Menkaourî (Mykérinos), les constructeurs des pyramides. « Kheops bâtit le vaste monument de sa gloire ou de sa folie dans un siècle si éloigné du temps où commencent les données certaines de l'histoire profane, que nous n'avons pas de mesure qui nous permette d'évaluer la largeur de l'abîme qui sépare les deux époques ; si étranger à toutes les sympathies et à tous les intérêts de la grande famille humaine qui peuple maintenant la terre, que même l'histoire sacrée ne sait rien des hommes de la génération de Kheops, rien, si ce n'est qu'ils vécurent, devinrent pères et moururent. Et pourtant, la pyramide de Kheops domine encore de haut le sable du désert : la blancheur sépulcrale de ses blocs de nummulite flamboie encore au soleil brûlant, son ombre immense s'allonge à travers les plaines stériles qui l'entourent et sur le déclin du jour vient assombrir les champs de maïs et de froment de Gizeh. Quand le spectateur, placé sur quelque point favorable, arrive à se faire une idée distincte de l'immensité du monument, aucune parole ne peut décrire le sentiment d'écrasement qui s'abat sur son esprit. Il se sent oppressé et chancelle comme sous un fardeau. Au contraire de bien d'autres grandes ruines, les pyramides, de quelque point qu'on les regarde, ne deviennent jamais des amas de débris ou des montagnes. Elles restent l'oeuvre des mains humaines. La marque de leur origine apparaît et ressort toujours ; et c'est de là sans doute que vient ce confus sentiment de crainte et de respect qui bouleverse l'esprit lorsqu'il reçoit pour la première fois l'impression distincte de leur immensité[154]. »
Ce qu'il fallut d'efforts pour élever ces masses gigantesques, le simple aspect des lieux nous le laisserait deviner, quand même l'histoire ne serait pas là pour nous le dire. Lorsque le règne de Kheops et de Khephren fut bien passé, longtemps après que les Pharaons de l'Ancien Empire et leurs sujets se furent perdus dans la nuit des âges, le souvenir des foules qu'avait coûtées l'érection des pyramides hanta l'esprit du peuple égyptien. Au temps d'Hérodote et de Diodore, Kheops avait acquis la réputation d'un tyran odieux. « Il commença par fermer les temples et par détendre qu'on offrit des sacrifices ; puis il contraignit tous les Égyptiens à travailler pour lui. Aux uns, on assigna la tâche de traîner les blocs des carrières de la chaîne Arabique jusqu'au Nil ; les blocs une fois passés en barque, il prescrivit aux autres de les traîner jusqu'à la chaîne Libyque. Ils travaillaient par cent mille hommes, qu'on relevait chaque trimestre. Le temps que souffrit le peuple se répartit de la sorte : dix années pour construire la chaussée sur laquelle on tirait les blocs, oeuvre, à mon sembler, de fort peu inférieure à la pyramide (car sa longueur est de cinq stades, sa largeur de dix orgyies et sa plus grande hauteur de huit, le tout en pierres de taille et couvert de figures) ; on mit donc dix années à construire cette chaussée et les chambres souterraines creusées dans la colline où se dressent les pyramides… Quant à la pyramide elle-même, on mit vingt ans à la faire ; elle est quadrangulaire, et chacune de ses faces a huit plèthres de base, avec une hauteur égale ; le tout en blocs polis et parfaitement ajustés : aucun des blocs n'a moins de trente pieds[155]. » – « Les caractères égyptiens gravés sur la pyramide marquent la valeur des sommes dépensées en raves, oignons et aulx pour les ouvriers employés aux travaux ; si j'ai bon souvenir, l'interprète qui me déchiffrait l'inscription m'a dit que le total montait à seize cents talents d'argent. S'il en est ainsi, combien doit-on avoir dépensé en fer pour les outils, en vivres et en vêtements pour les ouvriers, puisqu'il a fallu pour bâtir tout le temps que j'ai dit, et le temps non moins considérable, ce me semble, qu'ont exigé la taille des pierres, leur transport et les excavations souterraines ?[156] » La tradition conservée par Hérodote allait plus loin encore. Elle représentait Kheops, à bout de ressources et réduit à faire argent de tout, vendant sa fille à tout venant[157]. Une autre légende, recueillie par Manéthon, est moins cruelle pour le pauvre Pharaon : sur ses vieux jours, il se serait repenti de son impiété et il aurait écrit un livre sacré tenu en grande estime par ses concitoyens[158].
« Les Egyptiens me dirent que ce Kheops régna cinquante ans et qu'après sa mort son frère Khephren hérita de la royauté. Khephren en usa de même que son frère en toutes choses et construisit une pyramide qui n'atteint pas aux dimensions de la première, car nous l'avons mesurée nous-mêmes… Les deux sont sur une colline haute d'environ cent pieds. On dit que Khephren régna cinquante-six ans. On compte donc cent six ans pendant lesquels les Égyptiens souffrirent toutes sortes de malheurs, et les temples furent fermés sans qu'on les ouvrit une seule fois. Par haine, les Égyptiens évitent de nommer ces princes ; ils vont jusqu'à donner aux pyramides le nom du berger Philitis, qui paissait alors ses troupeaux dans ces parages[159]. » D'après la tradition, ni Kheops ni Khephren ne jouirent des tombeaux qu'ils s'étaient préparés au prix de tant de souffrances : le peuple exaspéré se révolta, arracha leurs corps des sarcophages et les mit en pièces[160].
A côté de ces deux tyrans, la tradition place un monarque débonnaire, Mykérinos, fils de Kheops, et constructeur de la troisième pyramide. « Les actions de son père ne lui furent pas agréables : il rouvrit les temples et renvoya aux cérémonies religieuses et aux affaires le peuple réduit à l'extrême misère ; enfin il rendit la justice plus équitablement que tous les autres rois. Là-dessus on le loue plus que tous ceux qui ont jamais régné sur l'Égypte ; car non seulement il rendait bonne justice, mais à qui se plaignait de son arrêt il faisait quelque présent pour apaiser sa colère[161]. » Ce pieux roi eut pourtant grandement à souffrir : il perdit sa fille unique, et peu de temps après, il connut par un oracle qu'il n'avait plus que six ans à vivre. Pour se consoler, il enferma le cadavre de son enfant dans une génisse de bois creux, qu'il déposa dans Saïs et à qui l'on rendit les honneurs divins. Le moyen qu'il employa pour éluder l'oracle est original et mérite d'être rapporté. « Il envoya des reproches au dieu, se plaignant que son père et son oncle, après avoir fermé les temples, oublié les dieux, opprimé les hommes, eussent vécu longtemps, tandis que lui, si pieux, devait périr si vite. L'oracle lui répondit que pour cela même sa vie serait abrégée, car il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire. L'Egypte aurait dû souffrir cent cinquante ans, et les deux rois, ses prédécesseurs l'avaient su, au contraire de lui. A cette réponse, Mykérinos, se jugeant condamné, fabriqua nombre de lampes, les alluma chaque soir, à la nuit, et se mit à boire et à se donner du bon temps, sans jamais cesser, nuit et jour, errant sur les étangs ou dans les bois, partout où il pensait trouver occasion de plaisir. Il avait machiné cela afin de convaincre l'oracle de faux et de vivre douze ans, les nuits comptant comme des jours[162]. »
Le récit des historiens grecs ne ressemble guère à ce que les monuments nous apprennent. Il est impossible que Khephren ait été le frère de Kheops : la durée des deux règnes s'y oppose absolument. Même Khephren ne fut pas le successeur immédiat de Kheops : les listes monumentales intercalent entre les deux un roi nommé Didoufri dont la pyramide a été découverte récemment, vers Abou-Roache[163], un peu au nord de celles de Gizeh. Le règne très court de ce prince, qui n'a d'ailleurs aucune importance historique, peut nous servir à expliquer l'un des points de la légende recueillie par les Grecs. Peut-être Didoufri était-il le fils de Kheops et le frère aîné de Khephren. De là cette notion que Khephren était le frère de son prédécesseur immédiat, et, comme Didoufri disparut sans laisser aucune trace dans la mémoire du peuple, cette notion que Kheops était le prédécesseur immédiat et par suite le frère aîné de Khephren.
L'impiété traditionnelle des deux rois n'est pas moins problématique que leur parenté. Les titres qu'ils prennent et ceux que portent les personnes de leur famille ou de leur cour témoignent du respect qu'ils marquaient pour la religion. Khépbrên s'appelle « l'Horus et le Sit », « l'Horus, coeur puissant », « le bon Horus, le dieu grand, seigneur des diadèmes » ; sa femme, la reine Marisânkh, est prêtresse de Thot[164] ; un de ses parents, le prince Mînan, ètait grand-prêtre de Thot à Khmounou ou Hermopolis[165]. Enfin, une stèle, refaite à l'époque saïte et attribuée par les scribes du temps à sa fille Honîtsen, nous montre le Kheops historique édifiant et restaurant des temples à l'inverse du Kheops légendaire. « L'Horus vivant, celui qui écrase ses ennemis, le roi d'Égypte Khoufoui vivificateur, a trouvé le temple d'Isis, rectrice de la pyramide, près du temple du Sphinx, au nord-ouest du temple d'Osiris, seigneur du tombeau ; il a construit sa pyramide prés du temple de cette déesse, et il a construit la pyramide de sa royale fille, Honîtsen, près de ce temple. - Il a fait ceci à sa mère Isis, mère divine, à Hathor, dame des eaux [d'en haut][166]. Inscrivant sa donation sur une stèle, il lui a donné de nouveau un apanage, il a reconstruit son sanctuaire en pierre, et il trouva ces dieux dans son temple. » Suivent la liste et l'image de ces dieux : Horus et Isis, sous plusieurs de leurs formes, Nephthys, Selkit, Phtah, Sokhit, Osiris, Hapi. Derrière chaque image on lit l'indication des matières dont elle était fabriquée : la barque d'Isis, l'épervier d'Horus, l'ibis de Thot étaient en bois doré ; Isis était en or et en argent ; Nephthys en bronze doré ; Sokhit en bronze[167]. Ailleurs nous voyons que le même prince avait agrandi ou au moins réparé le temple d'Hathor, à Dendérah[168]. Nous voilà bien loin du Kheops d'Hèrodote qui fermait tous les sanctuaires de l'Égypte et qui proscrivait les dieux.
On sait aujourd'hui d'où vient cette différence entre les récits des écrivains grecs et la réalité. Ce qu'Hérodote raconte n'est que la transcription d'un conte populaire. Les Égyptiens ont traité Kheops, Khephren et Mykérinos de la même manière que les poètes du moyen âge ont traité Charlemagne : après les avoir exaltés de toutes les manières, ils les ont rendus odieux et ridicules. Les romans égyptiens que nous possédons encore en original montrent que la fantaisie du vulgaire n'hésita jamais à imputer aux meilleurs des Pharaons les exploits les plus invraisemblables : les conteurs se plaisaient à choisir pour leurs héros des noms connus, Ramsès, Méneptah, et cela seul suffit à nous expliquer l'origine des fables que les Grecs nous ont transmises sur les rois de la quatrième dynastie. Le Kheops d'Hérodote et le Kheops des inscriptions portent le même nom, et tous deux ont construit la grande pyramide : à cela près, ce qu'on nous apprend d'eux diffère. Kheops et Khephren sont de simples héros de roman[169] ; Khoufoui et Khâfrî nous apparaissent comme des rois puissants, pieux envers la divinité, et redoutables à leurs ennemis non moins qu'à leurs sujets. Kheops guerroya contre les nomades d'Arabie, et défendit victorieusement contre leurs attaques les établissements miniers que Snofroui avait fondés dans la péninsule du Sinaï[170]. Les prisonniers ramassés dans ces campagnes furent sans doute employés, selon l'usage, à la construction des pyramides. Est-ce à dire pour cela que la conception populaire soit entièrement fausse et qu'il ait ménagé ses sujets ? Le nombre des prisonniers, si large qu'on le suppose, ne pouvait suffire à l'immensité de l’œuvre ; sans doute il fallut avoir recours aux Égyptiens de race pure et les réquisitionner, ainsi que le rapporte Hérodote. « Il y eut une grande clameur d'un bout à l'autre de son empire ! une clameur de l'oppressé contre l'oppresseur ; une clameur de tourment et d'amère angoisse ; une clameur telle qu'elle résonne encore dans sa mémoire tandis que j'écris ; une de ces clameurs qui, depuis les jours de Souphis, se sont souvent élevées de la terre d'Égypte et ont percé les oreilles du seigneur des armées. Et Souphis s'en inquiéta ? Pas plus que Mohammed-Ali ou Ibrahim-Pacha ! Le caprice égoïste du tyran, que ce soit la grande pyramide ou le barrage, avance : qu'importent au maître les souffrances de son peuple ?[171] » L'Egypte peut changer de religion, de langue et de race; que le souverain s'appelle pharaon, sultan ou pacha, la destinée du fellah est toujours la même. Les historiens grecs ont recueilli, à quatre mille ans de distance, l'écho des malédictions dont les Égyptiens chargèrent la mémoire de Kheops. Rien n'empêche de croire que cette révolte dont parle Diodore[172] eut vraiment lieu : des statues de Khephren brisées ont été retrouvées prés du temple du Sphinx, dans un puits où elles avaient été jetées anciennement, peut-être un jour de révolution[173].
L'idée de piété que la tradition populaire attachait au règne de Menkaourî, le Mykérinos d'Hérodote, est confirmée par le témoignage des contemporains : non que ce prince ait, comme on le dit, rouvert les temples (nous avons vu qu'ils n'avaient jamais été fermés), mais il ordonna à l'un de ses fils, Didoufhorou, de parcourir les sanctuaires de l'Égypte, sans doute afin de restaurer ceux qui lui sembleraient en mauvais état, et de faire dans toutes les villes des fondations nouvelles. C'est au cours de cette inspection que le prince découvrit, suivant quelques documents, le chapitre lxiv du Rituel Funéraire, « à Khmounou (Hermopolis), aux pieds du dieu Thot, écrit en bleu sur une dalle d'albâtre… Le prince l'apporta au roi comme un objet miraculeux.[174] » Ces révélations de livres religieux ou scientifiques sont fréquemment mentionnées dans l'ancienne littérature égyptienne. Nous avons déjà vu que l'invention du chapitre lxiv est attribuée par quelques autorités au roi Ousaphaîs, et que le roi Têti passait pour avoir recueilli un livre de médecine, dont nous possédons encore la meilleure part. Un autre traité de médecine signalé récemment remonterait de la même manière au règne de Kheops. Il s'était manifesté à Coptos, une nuit, devant un ministre du dieu, qui était entré dans la grande salle du temple et avait pénétré jusqu'au fond du sanctuaire. « Or la terre était plongée dans les ténèbres, mais la lune brillait sur ce livre de tous côtés. Il fut apporté, en grand merveille, à la sainteté du roi Khoufoui, le juste de voix.[175] » Le chapitre lxiv, résumé de la doctrine égyptienne sur la vie future et la condition de l'âme, est une des sections les plus obscures du Livre des Morts : « Tu viens à moi », dit Un scribe de l'époque des Ramessides, « bien muni de grands mystères, tu me dis au sujet des formules du prince Didoufhorou : “Tu n'y as rien connu, ni bien, ni mal. Un mur d'enceinte est par devant que nul profane ne saurait forcer”. Toi, tu es un scribe habile parmi ses compagnons, instruit dans les livres, châtié de coeur, parfait de langue, et quand tes paroles sortent, une seule phrase de ta bouche est trois fois importante ; tu m'as donc laissé muet de terreur.[176] » Les modernes qui ne saisissent pas toujours le sens de ces morceaux mystiques peuvent se consoler : les anciens Egyptiens n'étaient pas beaucoup plus avancés qu'eux.
Le sarcophage de Mykérinos, conservé longtemps dans la troisième pyramide, était l'une des oeuvres les plus admirables de l'art égyptien archaïque. Il a péri sur la côte du Portugal avec le navire qui le transportait en Angleterre. Nous n'avons plus aujourd'hui que le couvercle du cercueil en bois de sycomore dans lequel la momie du pharaon reposait. Ce cercueil est de forme humaine, et on y lit une inscription : « Ô l'Osiris, le roi des deux Égyptes Menkaourî, vivant pour l'éternité, enfanté par le ciel, porté [dans le sein] de Nouît, germe de Gabou ! Ta mère Nouît s'étend sur toi en son nom d'abîme du ciel. Elle te divinise en mettant à néant tes ennemis, ô roi Menkaourî, vivant pour l'éternité ![177] »
La littérature de l'époque grecque associait à ces trois Pharaons un prince fabuleux nommé Asychis par Hérodote, et Sasychis par Diodore de Sicile. « Il éleva dans le temple de Phtah, à Memphis, le portique méridional, le plus beau et le plus grand de tous ; car, s'ils sont tous ornés de sculptures, si l’aspect de la construction y varie à l'infini, ce côté est plus varié et plus magnifique encore que les autres. Dans l'intention de surpasser ses prédécesseurs, il bâtit en briques une pyramide où se trouve l'inscription suivante gravée sur une pierre : « Ne me méprise pas à cause des pyramides de pierre ; je l'emporte sur elles autant que Jupiter sur les autres dieux. Car, plongeant une pièce de bois dans un marais et réunissant ce qui s'y attachait d'argile, on a fait la brique dont j'ai été construite.[178] » Au témoignage de Diodore, Sasychis aurait été l'un des cinq grands législateurs de l'Égypte : il aurait réglé avec le plus grand soin les cérémonies du culte, inventé la géométrie et l'art d'observer les astres[179]. Il promulgua aussi une loi sur le prêt, par laquelle il autorisait tout particulier à mettre en gage la momie de son père, avec faculté au prêteur de disposer du tombeau de l'emprunteur. Au cas où la dette n'était pas payée, le débiteur ne pouvait obtenir sépulture pour lui ou pour les siens, ni dans la tombe paternelle, ni dans une autre tombe[180].
La cinquième dynastie est en toute chose le prolongement de la quatrième. Ses rois eurent à réprimer au dehors les razzias peu dangereuses des nomades d'Asie, et ils exploitèrent les mines du Sinaï avec une certaine activité[181]. Ils entretinrent des relations vers le Sud avec les régions de la Mer Rouge qui fournissent l'encens ; ils poussèrent même jusqu'au Pouanît et ils en rapportèrent, entre autres merveilles, des danga, de ces nains dressés à danser ce qu’on appelait la danse du dieu[182]. Au dedans, leur vie fut conforme à la routine des Pharaons memphites. Ils s'occupèrent à construire leurs pyramides funéraires[183], à réparer les temples, à édifier des villes nouvelles[184]. Somme toute, ils maintinrent l'Égypte au point de prospérité et de grandeur où les rois de la dynastie précédente avaient su l'exalter[185].
La
littérature égyptienne pendant la période memphite.
Dans un des tombeaux de Gizeh, un grand fonctionnaire des premiers temps de la sixième dynastie s'attribue le titre de Gouverneur de la maison des livres[186]. Cette simple mention jetée incidemment entre deux titres plus ronflants suffirait, à défaut d'autres, afin de nous prouver le développement extraordinaire que la civilisation égyptienne avait pris dès lors. Non seulement il y avait déjà une littérature, mais cette littérature était assez considérable pour remplir des bibliothèques, et son importance assez forte pour qu'un des fonctionnaires de la cour fût attaché spécialement à la Conservation de la bibliothèque royale. Il avait sans doute à sa garde, avec les oeuvres contemporaines, des livres écrits sous les premières dynasties, des livres datés de Ménès et peut-être des rois antérieurs â Ménès. Le fond de cette bibliothèque devait se composer d'ouvrages religieux, de chapitres du Livre des Morts, copiés d'après les textes authentiques déposés dans les temples ; de traités scientifiques sur la géométrie, la médecine et l'astronomie ; de chroniques où étaient consignés les dits et faits des anciens rois, ensemble le nombre des années de leur vie et la durée exacte de leur règne ; des manuels de philosophie et de morale pratique ; bien certainement aussi quelques romans[187]. Tout cela, si nous l'avions, formerait « une bibliothèque qui serait bien plus précieuse pour nous que celle d'Alexandrie[188] » ; par malheur, nous ne possédons plus de tant de richesses que les fragments d'un recueil philosophique. Pour tout le reste, nous en sommes réduits à de rares indications qui, éclairées et complétées au moyen des données monumentales, nous permettent à peine de déterminer avec quelque certitude l'étendue des connaissances qu’avaient alors les Égyptiens.
Dés les premiers jours, leurs astronomes constatèrent qu'un certain nombre des astres qui brillaient la nuit au-dessus de leurs têtes paraissaient animés d'un mouvement de translation à travers les espaces, tandis que les autres demeuraient immobiles. Cette observation, répétée maintes et maintes fois, les conduisit à établir la distinction des planètes et des étoiles ou, comme ils les appelaient, des indestructibles (akhimou-sokou). Ils comptèrent parmi les premières « Horus, guide des espaces mystérieux » (Hartapshitiou), notre Jupiter, que son éclat désigna comme le chef de la bande ; « Horus, générateur d'en haut » (Harkahri), Saturne, la plus éloignée de celles qu'oeil humain puisse apercevoir sans le secours des instruments ; Harmakhis, Mars, à qui sa couleur rougeâtre valut aussi le surnom d'Hardoshir, l'Horus rouge, et dont le mouvement rétrograde en apparence à divers moments de l'année ne leur échappa point ; Sovkou, Mercure ; Vénus enfin, qui dans son rôle d'étoile du matin s'appelle Douaou, et Bonon peut-être dans celui d'étoile du soir[189]. Le soleil lui-même, ce centre fixe de tous les systèmes anciens, subit chez eux la loi du mouvement universel et il voyagea dans le ciel en compagnie des étoiles errantes[190].
Pour les Égyptiens le ciel est une sorte de plafond solide, en fer pensait-on, sur lequel roulent les eaux mystérieuses qui enserrent la terre de toutes parts. Aux jours de la création, quand le chaos se résolut en ses éléments, le dieu Shou souleva ce plafond : le Nil d'en haut commença à couler au sommet des montagnes qui bornent notre monde, et c’est sur ce fleuve céleste que flottent les planètes et généralement tous les astres qui ont un lever et un coucher visibles dans la vallée : les monuments nous les montrent figurés par des génies à formes humaines ou animales qui naviguent chacun dans sa barque à la suite d'Orion. D'autre part, on se représentait les étoiles fixes comme des lampes (khabisou) suspendues au plafond de fer et qu'une puissance divine allumait chaque soir pour éclairer les nuits de la terre. Au premier rang de ces astres-lampes, on mettait les décans, simples étoiles ou groupes d'étoiles en rapport avec les trente-six ou trente-sept décades dont l'année égyptienne se composait : Sopdit ou Sothis, sainte à Isis ; Orion-Sahou, consacré à Osiris et considéré par quelques-uns comme le séjour des âmes heureuses ; les Pléiades, les Hyades, et beaucoup d'autres dont les noms anciens n'ont pas été encore identifiés d'une manière authentique avec les noms modernes. Bref, toutes les étoiles qu'on peut apercevoir à l'oeil nu avaient été relevées, enregistrées, cataloguées avec soin[191]. Les observatoires de la haute et de la Basse Égypte, à Dendérah, à Thinis, à Memphis, à Héliopolis, signalaient leurs phases et dressaient chaque année des tables de leurs levers et de leurs couchers, dont quelques débris sont arrivés jusqu'à nous.
De tous ces astres, le mieux connu et le plus important était l'astre d'Isis, Sinus, que les Égyptiens nommaient Sopdit, d'où les Grecs ont fait Sothis. Son lever héliaque, qui marquait le premier instant de l'inondation, marquait aussi le début de l'année civile, si bien que tout le système chronologique du pays reposait sur lui. L'année primitive des Égyptiens, ou du moins la première année que nous leur connaissions historiquement, se composait de douze mois de trente jours chacun, soit en tout trois cent soixante jours. Ces douze mois étaient répartis entre trois saisons de quatre mois : la saison du commencement (Sha), qui répond au temps de l'inondation ; la saison des semailles (Pro), qui répond à l'hiver ; la saison des moissons (Shomou), qui répond à l'été. Chaque mois se subdivisait en trois décades ; chaque jour et chaque nuit se partageaient en douze heures : si bien que midi répondait à la sixième heure du jour, et minuit à la sixième heure de la nuit.
Ce système, pour simple qu'il parut, avait ses inconvénients, qui ne tardèrent pas à se manifester brutalement. Entre l'année telle qu'il la définissait et l'année tropique, il y avait une différence de cinq jours un quart ; à chaque douze mois qui s'écoulèrent, l'écart entre l'année courante et l'année fixe augmenta de cinq jours un quart, et par suite les saisons cessèrent de marcher avec les phases de la lune. Des observations nouvelles, opérées sur la marche du soleil, décidèrent les astronomes à intercaler chaque année, après le douzième mois, et avant le premier jour de l'année suivante, cinq jours complémentaires, qu'on nomma les cinq jours en sus de l'année ou jours épagomènes. L'époque de ce changement était si ancienne que nous ne saurions lui assigner aucune date, et que les Égyptiens eux-mêmes l'avaient reportée jusque dans les temps mythiques antérieurs à l'avènement de Ménès. « Rhéa (Nouît) ayant eu un commerce secret avec Kronos (Gabou), le Soleil (Râ), qui s'en aperçut, prononça contre elle un charme qui l'empêcha d'accoucher dans aucun mois et dans aucune année ; mais Hermès (Thot), qui avait de l'amour pour la déesse, joua aux dés avec la Lune et lui gagna la soixantième partie de chaque jour, dont il constitua cinq jours, qu'il ajouta aux trois cent soixante jours de l'année.[192] » Même ainsi corrigée, l'année de trois cent soixante-cinq jours ne répond pas encore exactement à l'année astronomique de trois cent soixante-cinq jours et quart. Il y eut donc tous les quatre ans un retard d'un jour sur cette année, si bien que pour 365x4 ou 1460 années astronomiques, on compta 1461 années civiles écoulées. Au bout de quatorze siècles et demi, l'accord, si longtemps rompu, était parfait de nouveau : le commencement de l'année civile se superposait alors, et pour une fois seulement, à celui de l'année astronomique ; le commencement de ces deux années concordait avec le lever héliaque au matin de Sinus-Sothis, et par suite avec le début de l'inondation. Les prêtres célébrèrent le lever de l'astre par des fêtes solennelles, dont l'origine devait remonter plus haut que les rois de la première dynastie, au temps des Shosou-Horou, et plus tard, à l'époque romaine, les astronomes donnèrent le nom de période sothiaque à la période de 1460 = 1461 dont cette coïncidence merveilleuse leur suggéra l'invention.
De la littérature mathématique de l'époque, nous ne connaissons rien. Les monuments nous prouvent cependant que, dès le siècle des pyramides, la géométrie devait être fort avancée : sinon la géométrie théorique, au moins la géométrie pratique, celle qui sert à mesurer les surfaces et à calculer le volume des corps solides. Les architectes qui ont bâti les pyramides et les grands tombeaux de Saqqarah étaient nécessairement des géomètres fort estimables. Malheureusement nous n'avons plus rien des livres dans lesquels ils enregistraient leurs doctrines : le seul traité de mathématiques qui nous soit parvenu est postérieur de deux mille ans au moins à leur époque, et il nous enseigne l'état de la science dans les temps relativement modernes de la dix-neuvième dynastie[193].
Pour nous figurer ce que pouvait être la médecine égyptienne, nous n'en sommes pas réduits à de simples inductions. Outre un traité dont l'invention était attribuée au règne de Kheops et qui n'a pas encore été publié, nous possédons deux livres ; le premier renferme aussi des recettes attribuées à des savants étrangers[194] ; le second, trouvé sous Ousaphaïs, aurait été complété par Sondou[195]. Les manuscrits de ces deux ouvrages remontent à la dix-huitième et à la dix-neuvième dynastie : le texte avait dû s'en modifier à la longue, mais l'ancienneté de leur origine les maintenait dans les écoles. Ils faisaient sans doute partie de cette bibliothèque du temple d'Imouthès, à Memphis, qui existait encore aux temps romains et où les médecins grecs allaient puiser des recettes pour leurs clients[196].
L’Égypte est naturellement une contrée fort saine. « Les Egyptiens, disait Hérodote, sont les mieux portants de tous les mortels ». Ils n'en étaient que plus attentifs à soigner leur santé. « Chaque mois, trois jours de suite, ils provoquent des évacuations au moyen de vomitifs et de clystères ; car ils pensent que toutes les maladies de l'homme viennent des aliments.[197] » - « La médecine chez eux est partagée : chaque médecin s'occupe d'une seule espèce de maladie et non de plusieurs. Les médecins en tous lieux abondent, les uns pour les yeux, les autres pour la tête, d'autres pour les dents, d'autres pour le ventre, d'autres pour les maux internes.[198] » Il n'est pas certain que cette division dont parle Hérodote ait été aussi absolue que l'historien a bien voulu le prétendre. Le même individu pouvait traiter toutes les maladies en général; seulement, pour les maux d'yeux et pour quelques autres affections, il y avait comme chez nous des spécialistes que l'on consultait de préférence aux praticiens ordinaires. Si le nombre en paraissait considérable à l'historien grec, cela tient à la constitution médicale d'un pays où les ophtalmies et les maladies intestinales, par exemple, sont encore aujourd'hui plus fréquentes que partout en Europe.
La médecine théorique ne semble pas avoir réalisé des progrès sérieux, bien que les manipulations de la momification eussent dû fournir aux médecins l'occasion d'étudier à loisir l'intérieur du corps humain. Une sorte de crainte religieuse ne leur permettait pas plus qu'aux médecins chrétiens du moyen âge de découper en morceaux, dans un but de pure science, le cadavre qui était destiné à revivre un jour. Leur horreur pour quiconque rompait l'intégrité des tissus humains était Si forte, que l'embaumeur chargé de pratiquer les incisions réglementaires était l'objet de l'exécration universelle. Toutes les fois qu'il venait d'exercer son métier, les assistants le poursuivaient à coups de pierres et l'auraient assommé sur place s'il ne s'était enfui à toutes jambes. De plus, les règlements médicaux n'étaient pas de nature à encourager les recherches scientifiques. Les médecins étaient obligés à traiter le malade d'après les règles posées dans certains livres d'origine réputée divine. S'ils s'écartaient des prescriptions sacrées, c'était à leurs risques et périls : en cas de mort du patient, ils étaient convaincus d'homicide volontaire et punis comme assassins[199].
Le seul point qui nous soit familier de leurs doctrines est la théorie de la circulation. Le corps renfermait un certain nombre de vaisseaux qui charriaient des esprits vivifiants. « La tête a trente-deux vaisseaux qui amènent des souffles à son intérieur ; ils transmettent les souffles à toutes les parties du corps. Il y a deux vaisseaux aux seins qui conduisent la chaleur au fondement… Il y a deux vaisseaux de l'occiput, deux du sinciput, deux à la nuque, deux aux paupières, deux aux narines, deux à l'oreille droite par lesquels entrent les souffles de la vie ; il y en a deux de l'oreille gauche, par lesquels entrent les souffles.[200] » Les souffles dont il est question dans ce passage sont appelés ailleurs « les bons souffles, les souffles délicieux du Nord ». Ils s'insinuaient dans les veines et les artères, se mêlaient au sang qui les entraînait par tout le corps, faisaient mouvoir l'animal et le portaient pour ainsi dire. Au moment de la mort, « ils se retirent avec l'âme, le sang se coagule, les veines et les artères se vident et l'animal périt[201] ».
Les maladies dont il est question dans les traités égyptiens ne sont pas toujours faciles à déterminer. Ce sont, autant qu’on peut en juger, des ophtalmies, des varices ou des ulcères aux jambes, l'érysipèle, le « ver », « la maladie divine mortelle », le divinus morbus des Latins, l'épilepsie. Un chapitre spécial traite de quelques points relatifs à la conception et à l'accouchement. Le diagnostic est détaillé dans plusieurs cas et permettrait peut-être à un médecin de spécifier la nature de l'affection. Voici celui d'une fièvre typhoïde : « Lourdeur au ventre ; le col du coeur, malade ; au coeur, inflammation, battements accélérés. Les vêtements pèsent sur le malade ; beaucoup de vêtements ne le réchauffent pas. Soifs nocturnes. Le goût pervers, comme celui d'un homme qui a mangé des fruits de sycomore. Chairs amorties comme celles d'un homme qui se trouve mal. S'il va à la selle, son ventre est enflammé et refuse de s'exonérer.[202] »
Les médicaments indiqués sont de quatre sortes : pommades, potions, cataplasmes et clystères. Ils sont composés chacun d'un assez grand nombre de matières empruntées à tous les règnes de la nature. On trouve citées plus de cinquante espèces de végétaux, depuis des herbes et des broussailles jusqu'à des arbres, tels que le cèdre, dont la sciure et les copeaux passaient pour avoir des propriétés lénitives, le sycomore et maints autres dont nous ne comprenons plus les noms antiques. Viennent ensuite des substances minérales, le sulfate de cuivre (?), le sel, le nitre, la pierre memphite (aner sopdou), qui, appliquée sur des parties malades ou lacérées, avait, dit-on, des vertus anesthésiques. La chair vive, le coeur, le foie, le fiel, le sang frais ou desséché de divers animaux, le poil et la corne du cerf, jouaient un grand rôle dans la confection de divers onguents souverains contre les inflammations. Nombre de recettes se recommandent par l'imprévu des substances préconisées : le « lait d'une femme accouchée d'un enfant mâle », la fiente du lion, la cervelle d'une tortue, un vieux bouquin bouilli dans l'huile[203]. Les ingrédients constitutifs de chaque remède étaient pilés ensemble, bouillis et filtrés au linge. Ils avaient d'ordinaire pour véhicule l'eau pure ; mais souvent on les mélangeait avec des liquides d'espèces variées, la bière (haq), la bière douce (haq nozmou) ou tisane d'orge, le lait de vache ou de chèvre, l'huile d'olive verte et l'huile d'olive épurée (biq nozmou), ou même, comme dans la médecine de Molière, l'urine humaine ou animale. Le tout, sucré de miel, s'avalait chaud matin et soir[204].
Mais les maladies n'avaient pas toujours une origine naturelle. Elles étaient produites par des spectres ou par des esprits malfaisants qui entraient au corps de l'homme et qui y trahissaient leur présence par des désordres plus ou moins graves. En combattant les effets extérieurs, on parvenait tout au plus à soulager le patient. Pour arriver à la guérison totale, il fallait supprimer la cause première en éloignant par des prières le démon possesseur. Une bonne ordonnance de médecin se composait donc d'au moins deux parties : d'une formule magique et d'une recette médicale. Voici une conjuration destinée à corroborer l'action d'un vomitif : « Ô revenant démon qui loges dans le ventre d'un tel fils d'une telle, ô toi dont le père est nommé Celui qui abat les têtes, dont le nom est Mort, dont le nom est Mâle de la Mort, dont le nom est Maudit pour l'éternité ![205] » Pour guérir le mal de tête, on n'avait qu'à dire : « Le devant de la tête est aux chacals divins, le derrière de la tête est un pourceau de Râ. Place-les sur un brasier ; quand l'humeur qui en sortira aura atteint le ciel, il en tombera une goutte de sang sur la terre. Ces paroles devront être répétées quatre fois[206]. » Si ce galimatias ne guérissait pas le malade, au moins le débarrassait-il des terreurs superstitieuses dont il était assailli. Le médecin, après avoir calmé les craintes du patient, essayait sur le corps l'efficacité des remèdes traditionnels. L'invocation magique était censée anéantir du coup la cause mystérieuse ; le traitement palliait les manifestations visibles du mal.
La littérature philosophique était déjà en honneur. Un papyrus de Berlin nous a conservé le fragment d'un dialogue entre un Egyptien et son âme : l'âme essaye de démontrer que la mort n'a rien d'effrayant pour qui la regarde en face[207]. « Je me dis à moi-même chaque jour : Ainsi la convalescence après la maladie, telle est la mort ! Je me dis à moi-même : Ainsi que l'odeur d'un parfum de fleurs, ainsi que s'asseoir dans un pays d'ivresse, telle est la mort ! Je me dis à moi-même, chaque jour : Ainsi qu'au moment où le ciel s'éclaircit, un homme sort pour aller prendre des oiseaux au filet, et soudain se trouve dans une contrée inconnue, telle est la mort ! » Un autre papyrus, donné par Prisse à la Bibliothèque Nationale de Paris, renferme le seul ouvrage complet qui nous reste de cette sagesse archaïque[208]. Il fut copié sous l'un des premiers règnes de la douzième dynastie, et on y lit les élucubrations de deux auteurs dont l'un vivait sous la troisième, l'autre sous la cinquième : ce n'est donc pas sans raison qu'on l'a nommé le plus ancien livre du monde. Incomplet au début, il contient d'abord la fin d'un livre de morale rédigé par un certain Kaqimni à l'avènement du Pharaon Snofroui. Venait ensuite un ouvrage aujourd'hui perdu ; un des possesseurs antiques du papyrus l'avait fait effacer afin de lui substituer un autre morceau, qui n'a jamais été écrit. Les quinze dernières pages sont occupées par un opuscule célèbre dans la science sous le nom d'Instructions de Phtahhotpou.
Ce Phtahhotpou était le fils d'un roi de la cinquième dynastie. Il était sans doute assez âgé à l'époque où il prit la plume, car il entre en matière par un portrait assez peu flatté de la vieillesse. « Le monarque Phtahhotpou dit : Sire le roi, mon maître, quand l'âge est là et que la vieillesse se produit, l'impuissance arrive et la seconde enfance sur laquelle la misère s'appesantit de plus en plus chaque jour ; les deux yeux se rapetissent, les deux oreilles s'amoindrissent, la force s'use, tant que le coeur continue à battre. La bouche se tait : elle ne parle plus. Le coeur s'obscurcit, il ne se rappelle plus hier. Les os souffrent à leur tour, tout ce qui était bon tourne au mauvais, le goût s'en va tout à fait. La vieillesse rend un homme misérable en toutes choses, car son nez se bouche, il ne respire plus, qu'il se tienne debout ou assis. Si l'humble serviteur qui est devant toi reçoit l'ordre de tenir les discours qui conviennent à un vieillard, alors je te dirai les paroles de ceux qui ont écouté l'histoire des temps antérieurs, de ceux qui ont entendu les dieux eux-mêmes, car si tu agis selon elles, le mécontentement disparaîtra d'entre les vivants et les deux terres travailleront pour toi ! » La Sainteté de ce Dieu a dit : « Instruis-moi dans les paroles du passé, et cela fera l'étonnement des enfants des grands ; quiconque entre et comprend cela, son coeur en pèsera le sens avec soin, et ce qu'il dira ne donnera jamais de satiété.[209] » Comme on voit, c'est afin de montrer aux vieillards le moyen de se rendre utiles que Phtahhotpou se résigne à sa tâche. Il veut les instruire dans la sagesse des ancêtres, afin qu'ils puissent l'enseigner à leur tour aux jeunes gens et maintenir la vertu par le monde entier.
Il ne faut pas s'attendre à trouver dans cette oeuvre une grande profondeur de conception. Les analyses savantes, les distinctions raffinées, les abstractions métaphysiques n'étaient pas de mode à l'époque de Phtahhotpou. On négligeait les idées spéculatives pour les faits positifs, la théorie pour la pratique : on observait l'homme, ses passions, ses habitudes, ses tentations, ses défaillances, non pas afin de construire à ses dépens un système de philosophie nouveau, mais afin de réformer ce que sa nature a d'imparfait en soi, et de montrer à l'âme le chemin de l'éternité glorieuse. Aussi Phtahhotpou ne se met-il pas en frais d'inventions et de déductions. Il enregistre les réflexions et les conseils qui lui viennent à l'esprit, tels qu'ils lui viennent, sans les grouper et sans en tirer la moindre conclusion d'ensemble. La science est utile pour arriver à la connaissance du bien : il recommande la science. La douceur envers les subalternes est de bonne politique : il fait l'éloge de la douceur. Le tout est entremêlé d'avis sur la conduite à suivre dans les diverses circonstances de la vie, quand on comparaît devant un supérieur impérieux, quand on va dans le monde, quand on prend femme. « Si tu es sage, tu t'enfermeras dans ta maison et tu aimeras ta femme chez toi ; tu la nourriras bien, tu la pareras, car les vêtements de ses membres et les parfums sont la joie de sa vie : aussi longtemps que tu observeras ce précepte, elle sera un champ qui profite à son maître.[210] » Analyser en détail un tel ouvrage est impossible, le traduire entièrement plus impossible encore. La nature du sujet, l'étrangeté de certains préceptes, la qualité du style, tout concourt à dérouter l'étudiant et à l'égarer dans ses recherches. Dés les temps les plus reculés, la morale a été considérée comme une science bonne et louable en elle-même, mais tellement rebattue qu'on ne peut la rajeunir que par la forme. Phtahhotpou n'a pas échappé aux nécessités du genre qu'il avait choisi. D'autres avaient dit et bien dit avant lui les vérités qu'il prétendait exprimer de nouveau : il lui fallut, pour allécher le lecteur, inventer des formules imprévues et piquantes. Il n'y a pas manqué : dans certains cas il a su envelopper sa pensée d'un tour si ingénieux que le sens moral de la phrase nous échappe sous le déguisement des mots.
De
la sixième à la dixième dynastie.
Il semble que le passage de la cinquième à la sixième dynastie ne se fit pas sans troubles. Deux rois sont mentionnés sur les monuments contemporains, Têti et Ousirkeri Ati, qui sans doute se disputèrent le trône. Ati est probablement l'Othoés de Manéthon, qui fut, dit-on, tué par ses gardes[211]. Têti, qui l'emporta, était-il apparenté à son prédécesseur ? La liste de Turin interrompt la série des noms royaux entre lui et Ounas, ce qui indique un changement de famille les listes grecques prétendent que la dynastie nouvelle était originaire de Memphis[212].
Pépi 1er Mirisî succéda à Têti. A partir de Pépi 1er, l'autorité de Memphis sur le reste de l'Égypte commença de décliner. Les princes de la dynastie nouvelle, sans abandonner l'ancienne capitale, paraissent lui avoir préféré les villes de la Moyenne Égypte, et surtout Abydos, dont la nécropole a conservé tant de souvenirs de leur règne. Du reste, ils ne laissèrent pas péricliter entre leurs mains la grandeur de leur pays ils entreprirent des guerres heureuses au dehors et ils poussèrent leurs conquêtes plus loin qu'aucun autre Pharaon n'avait fait avant eux, Pépi 1er, le second de la dynastie, en est aussi le héros. Pendant un règne qui dura au moins dix-huit ans, son activité ne se ralentit jamais. Secondé habilement par Ouni, son premier ministre, il recouvra sur les nomades asiatiques les établissements du Sinaï que ses prédécesseurs avaient perdus, soumit l'Éthiopie et sema l'Égypte de monuments.
Ouni avait débuté tout enfant à la cour du roi Têti. D'abord simple page (porte couronne), il avait bientôt obtenu un emploi dans l'administration du Trésor, puis un titre d'inspecteur des bois de l'État. Pépi le prit en grande amitié dés le début de son règne et lui confia successivement les charges de surveillant des prophètes de la pyramide funéraire et d'auditeur, dont il s'acquitta mieux que personne avant lui ; aussi lui accorda-t-on comme récompense une garniture de tombeau et un sarcophage en belle pierre blanche de Troja. Il redoubla de zèle pour justifier cette distinction, et l'activité qu'il déploya lui valut des faveurs nouvelles : il fut promu à la dignité d'ami royal, nommé surintendant de la maison de la reine, et attira à lui la direction de toutes les affaires. « Je faisais, dit-il, toutes les écritures avec l'aide d'un seul secrétaire. » L'Égypte n'eut pas à se plaindre de son administration. Les mines du Sinaï, exploitées avec plus de suite et soumises à des inspections régulières, rendirent des revenus supérieurs à ce qu'on tirait d'elles auparavant[213]. Une route fut tracée à travers le désert de Coptos à la mer Rouge et ouvrit au commerce une voie commode. L'exploitation des carrières de Rohanou fut poussée avec vigueur[214], et, bien que les monuments édifiés alors aient disparu sans laisser presque aucun vestige, les inscriptions sont là pour témoigner de l'activité avec laquelle les travaux de construction furent menés. Une ville nouvelle fut fondée dans l'Heptanomide prés de l'endroit où végète aujourd'hui le bourg de Sheikh-Saïd[215]. Le temple d'Hathor à Dendérah, élevé par les serviteurs d'Horus aux temps fabuleux de l'histoire et ruiné depuis lors, fut rebâti en entier sur les plans primitifs qu'on retrouva par hasard[216]. Cette piété envers l'une des divinités les plus vénérées fut encouragée comme elle méritait de l'être par le titre de fils d'Hathor que Pépi désormais inséra dans son cartouche royal[217].
Au dehors, le ministère d'Ouni fut signalé par des conquêtes. La Nubie était alors habitée en partie par des tribus nègres[218], la queue probablement de celles qui avaient formé la population primitive de l'Égypte. Sans cesse révoltées et sans cesse vaincues, elles fournissaient de faciles triomphes aux généraux de Pharaon, et elles remplissaient de soldats les cadres de son armée. Ouni les employa contre les Amou et contre les Hiroushaïtou qui dominaient alors aux déserts de l’isthme et dans la Syrie méridionale. « Sa Sainteté eut à repousser les Amou et les Hiroushaïtou. Sa Sainteté fit une armée de plusieurs fois dix mille soldats, pris dans le pays tout entier depuis Éléphantine jusqu'à la mer du nord, dans toutes les maisons, dans les villes, dans les places fortes, dans le pays d'Iritit, parmi les nègres du pays de Maza, parmi les nègres du pays d'Amamît, parmi les nègres du pays des Ouaouaîtou, parmi les nègres de Kaaou, parmi les nègres du pays de Tomam[219], et Sa Sainteté m'envoya à la tête de cette armée. Certes, il y avait tous les généraux, il y avait les chambellans, il y avait les amis du palais, il y avait les chefs, les princes des villes du midi et du nord, les amis dorés, les chefs des prophètes du midi et du nord, les intendants des temples à la tête des capitaines du midi et du nord, des villes et des temples, et aussi les nègres des régions mentionnées, et pourtant ce fut moi qui les dirigeai, bien que ma fonction ne fût que celle d'un surintendant des bois de Pharaon ! » A travers les phrases mutilées qui suivent, on devine les difficultés de toute nature contre lesquelles il dut lutter. On eut, paraît-il, quelque peine à organiser le service des vivres et de l'habillement. A force de patience et d'industrie, l'ordre finit par s'établir et l'expédition entra en mouvement.
« Cette armée alla en paix : elle entra, comme il lui plut, au pays des Hiroushaïtou. Cette armée alla en paix : elle écrasa le pays des Hiroushaïtou. Cette armée alla en paix : elle fit brèche dans toutes leurs enceintes fortifiées. Cette armée alla en paix : elle coupa leurs figuiers et leurs vignes. Cette armée alla en paix : elle incendia toutes leurs maisons. Cette armée alla en paix : elle massacra leurs soldats myriades. Cette armée alla en paix : elle emmena leurs hommes, leurs femmes et leurs enfants en grand nombre, comme prisonniers vivants, ce dont Sa Sainteté se réjouit plus que de toute autre chose. » Ces prisonniers, employés aux travaux publics ou vendus comme esclaves à des particuliers, contribuèrent pour leur part à la prospérité du règne de Pépi. « Sa Sainteté m'envoya pour écraser ses ennemis, et j'allai cinq fois frapper la terre des Hiroushaïtou pour aller abattre leur rébellion avec cette armée ; et j'agis de telle sorte que le roi fut satisfait de cela plus que de toute autre chose. » Malgré ces victoires répétées, la lutte n'était pas encore terminée : « On vint dire que des barbares s'étaient assemblés au pays de Tiba[220]. Je partis encore dans des navires avec cette armée, et je pris terre aux extrémités reculées de cette région, au nord du pays des Hiroushaïtou. Voici que cette armée se mit en chemin : elle les battit tous, et détruisit tous ceux d'entre eux qui s'étaient assemblés. » Cette affaire décisive termina les opérations et entraîna la soumission complète des ennemis. Au retour de ces expéditions, Ouni, déjà comblé d'honneurs, reçut la faveur la plus insigne qu'un roi pût accorder à un sujet, l'autorisation de garder ses sandales dans le palais et même en présence de Pharaon. La paix régnait à l'intérieur : au dehors, la Nubie, la Libye et les parties de la Syrie contiguës au Delta reconnaissaient la suzeraineté de l'Égypte. Jamais, depuis Kheops, le pays n'avait été plus puissant et plus heureux. Pépi ne jouit pas longtemps de sa gloire. Peu de temps après le triomphe d'Ouni, il mourut, laissant la couronne à Mirinri Métésouphis, l'aîné des fils qu'il avait eus de sa seconde femme, la reine Mirirî-Ankhnas.
Métésouphis était presque un enfant lorsqu'il monta sur le trône[221]. Il n'eut pas de guerres sérieuses à soutenir. Le souvenir des victoires de son père était encore trop présent à l'esprit des barbares pour qu'ils éprouvassent la tentation de se révolter. Ouni, qui avait tant fait pour la grandeur du roi précèdent, fut confirmé dans tous ses emplois et comblé de charges nouvelles. Il fut nommé prince gouverneur des pays du sud depuis Eléphantine jusqu'à Létopolis, vers la pointe du Delta : « Jamais sujet n'avait eu cette dignité auparavant ». Selon l'usage, il commença par suspendre les autres travaux, pour s'occuper sans retard du tombeau destiné au souverain. La construction de la pyramide funéraire le contraignit à entreprendre, dans les contrées rangées sous son autorité, plusieurs voyages longs et difficiles. « Sa Sainteté m'envoya au pays d'Abhaît[222] pour y chercher le sarcophage royal avec son couvercle et le pyramidion précieux de la pyramide funéraire de Mirinri. Sa Sainteté m'envoya vers Eléphantine pour en rapporter le granit du naos et du seuil, le granit des jambages et des linteaux, pour ramener le granit des portes et des seuils de la chambre supérieure de la pyramide de Mirinri. Je partis pour la pyramide de Mirinri avec six chalands, trois bateaux de charge, trois radeaux et un navire de guerre : jamais dans le temps d'aucun ancêtre Abhaît ou Éléphantine n'avaient construit navires de guerre. Sa Sainteté m'envoya au pays de Hanoubou pour en rapporter une grande table à libations en albâtre du pays de Hanoubou. Je lui fis amener cette table à libations en dix-sept jours. » Pour embarquer et pour convoyer ces blocs de pierre, il avait fallu entreprendre et mener à bonne fin quantité de travaux secondaires, mettre en chantier des bateaux, creuser des bassins et des canaux au sud d'Éléphantine, dans le pays nouvellement conquis des Ouaouaîtou. Ouni réquisitionna à cet effet les peuplades noires chez qui il avait déjà recruté une armée sous Pépi. « Voici que le prince du pays de Irrithit, Ouaouaîtou, Amam, Maza fournirent le bois nécessaire aux navires. » En un an, les différentes missions étaient achevées ; les vaisseaux construits en Nubie franchissaient la première cataracte à la faveur des hautes eaux et descendaient le Nil. Mirinri visita lui-même les travaux en l'an V : il reçut l'hommage des chefs nubiens, et, pour laisser à la postérité le souvenir de son séjour, il grava son image de plain-pied sur les rochers d'Assouan[223]. La préparation de cette pyramide fut le dernier grand acte administratif de la vie d'Ouni. Il mourut peu de temps après, et son souverain ne tarda pas à le suivre au tombeau[224].
Mirinri eut pour successeur son frère cadet Nofirkerî Pépi II. Manéthon prêtait à ce prince cent années de règne, et son témoignage est confirmé par le Papyrus de Turin, qui attribue à un Pharaon, dont le nom est malheureusement détruit, un règne de quatre-vingt-dix ans au moins. Une inscription d'Ouadi-Magharah, datée de la onzième année, montre qu'il fit continuer l'exploitation des mines du Sinaï et qu'il repoussa de ce côté les attaques des barbares[225]. D'autre part, le nombre et la beauté des tombeaux qui portent son cartouche semblent attester que, pendant une partie au moins de ce règne séculaire, l'Égypte ne perdit rien de sa vigueur ni de sa prospérité. C'est au Midi surtout que la vie se développa la plus intense, grâce à l'habileté des seigneurs d'Éléphantine. Ces seigneurs, postés au danger, dans les marches méridionales, entretenaient avec les peuples de la vallée au Sud de la cataracte et avec ceux du désert des rapports tantôt d'amitié et de commerce, tantôt de guerre ouverte ou d'inimitié sourde : leurs caravanes pénétraient à l'Occident jusque par delà les Oasis thébaines, vers l'Orient aux rives de la mer Rouge. L'un d'eux, Hirkhouf, se distingua par son adresse et par l'heureux succès de ses entreprises : dans trois voyages successifs sous Pépi 1er et sous Métésouphis 1er, non seulement il noua des relations précieuses avec les tribus des Timihou, mais il amena plusieurs d'entre elles à reconnaître la suzeraineté de l'Égypte. Pépi II ne régnait que depuis deux ans lorsque Hirkhouf revint de son dernier voyage, et il n'était encore qu'un enfant : ce qui lui plut dans cette affaire, ce fut un danga, un nain habitué à danser la danse sacrée, et qui venait du Pouanit. Il se le fit amener à Memphis avec toute sorte de précautions, et il récompensa largement Hirkhouf[226]. Tous les membres de la famille étaient imbus du même esprit d'aventures que celui-ci, mais ils ne furent pas toujours aussi heureux. L'un d'eux, Papinakhîti, après avoir visité plusieurs fois les contrées des Ouaouaîtou et de l'Iritit, au profit de Pépi II, partit en reconnaissance aux mines du Sinaï ; mais, tandis qu'il se construisait un navire afin de franchir la mer Rouge, les nomades le surprirent et le tuèrent : c'est au plus si ses soldats sauvèrent son corps et le ramenèrent à Éléphantine, où il fut enterré. Grâce à ces expéditions continuelles, l'influence de l'Égypte se propagea au loin, et la colonisation de la Nubie commença. Elle avait pénétré jusque vers Korosko, lorsque Pépi II mourut. Lui disparu, le trouble se glissa dans l'État, et nous ne possédons plus, au lieu d'histoire positive, que les légendes romanesques recueillies par Hérodote et par Manéthon. Menthésouphis (Mihtimsaouf II) fut assassiné dans une émeute une année à peine après son avènement. Sa soeur, Nitaqrît, la Nitokris des conteurs, la belle aux joues de rose, qu'il avait épousée, selon l'usage, lui succéda et n'accepta la royauté que dans l'idée bien arrêtée de le venger. « Elle fit bâtir une immense salle souterraine ; puis, sous prétexte de l'inaugurer, mais en réalité dans une toute autre intention, elle invita à un grand repas, et reçut dans cette salle bon nombre d'Égyptiens, de ceux qu'elle savait avoir été surtout les instigateurs du crime. Pendant le repas, elle fit entrer les eaux du Nil dans la salle par un canal qu'elle avait tenu caché. Voilà donc ce qu'on raconte d'elle. On ajoute que, après cela, la reine se jeta d'elle-même dans une grande chambre remplie de cendres, afin d'éviter le châtiment.[227] »
Pendant les sept années de son règne. Nitokris avait terminé la troisième des grandes pyramides que Mykérinos n'avait pas achevée. Elle avait plus que doublé les dimensions du monument et elle lui avait ajouté ce coûteux revêtement de syénite qui excita plus tard, à juste titre, l'admiration des voyageurs grecs, romains et arabes. C'est au centre même de l'édifice, au-dessus de la chambre où le pieux Mykérinos reposait depuis plusieurs siècles, qu'elle fût ensevelie à son tour dans un magnifique sarcophage de basalte bleu, dont on a retrouvé les fragments[228]. Cela donna lieu plus tard de lui attribuer, au détriment du fondateur réel, la construction de la pyramide entière. Les voyageurs grecs, à qui leurs exégètes racontaient l'histoire de la belle aux joues de rose, changèrent la princesse en courtisane et substituèrent au nom de Nitaqrît le nom plus harmonieux de Rhodopis. Un jour qu'elle se baignait dans le fleuve, un aigle fondit sur une de ses sandales, l'emporta dans la direction de Memphis et la laissa tomber sur les genoux du roi qui rendait alors la justice en plein air. Le roi, émerveillé et par la singularité de l'aventure et par la beauté de la sandale, chercha par tout le pays la femme à qui elle avait appartenu, et c'est ainsi que Rhodopis devint reine d'Égypte. A sa mort, elle fut ensevelie dans le tombeau de Mykérinos[229]. Le christianisme et la conquête arabe modifièrent encore une fois le caractère de la légende sans effacer entièrement le souvenir de Nitokris. « L'on dit que l'esprit de la pyramide méridionale ne paroist iamais dehors qu'en forme d'une femme nuë, belle au reste, et dont les manières d'agir sont telles que, quand elle veut donner de l'amour à quelqu'un et luy faire perdre l'esprit, elle luy rit, et, incontinent, il s'approche d'elle et elle l'attire à elle et l'affole d'amour ; de sorte qu'il perd l'esprit sur l'heure et court vagabond par le pays. Plusieurs personnes l'ont veue tournoyer autour de la pyramide sur le midy et environ soleil couchant.[230] » C'est Nitokris qui hante ainsi le monument dont elle avait terminé la construction.
Des découvertes récentes ont donné à la sixième dynastie une authenticité que n'ont pas plusieurs des dynasties postérieures. Ces pyramides qu'Ouni bâtissait pour ses maîtres, nous les avons ouvertes à Sakkarah, et les inscriptions qu'elles renferment nous ont rendu le nom du souverain qui y reposait jadis[231]. Ounas, le dernier roi de la cinquième dynastie, Têti, le premier de la sixième, Pépi 1er, Mirinri 1er, Pépi II sont devenus de la sorte des personnages aussi réels que Sétouî 1er ou Ramsès II : même la momie de Mirinri a été découverte à côté de son sarcophage, et elle est déposée aujourd'hui au Musée du Caire[232]. Toutes les pyramides de ce groupe sont ordonnées sur le même plan. Un long couloir incliné, bouché par d'énormes blocs de pierre, conduit à une sorte d'antichambre qui, tantôt est entièrement nue, tantôt est décorée d'interminables inscriptions hiéroglyphiques. Puis, c'est un second couloir horizontal, interrompu en son milieu par trois herses de pierre ; puis, une chambre oblongue, flanquée à gauche de trois petites pièces basses et sans ornements, à droite de la salle ou s'élève le sarcophage. Les inscriptions sont destinées, comme les tableaux des tombes privées, à fournir le mort des provisions et des amulettes nécessaires à le protéger contre les serpents et les dieux malfaisants, à empêcher son âme de mourir. Elles forment comme un livre immense dont les chapitres épars reparaissent par intervalles sur les monuments des temps postérieurs. Et ce n'est pas seulement la religion qu'elles nous restituent, c'est la langue la plus ancienne de l'Égypte : la plupart des formules qu'elles renferment ont été rédigées avant l'époque thinite, au temps de la prédominance Héliopolitainne.
De la mort de Nitokris à l'avènement de la onzième dynastie, près de cinq siècles s'écoulèrent, sur lesquels l'histoire reste à peu près muette. Quatre dynasties surgirent, puis retombèrent rapidement pendant cet intervalle, sans qu'il nous soit possible encore de déterminer les noms et l'ordre de succession des Pharaons qui les composent. Manéthon indiquait en premier lieu une septième dynastie memphite, qui, d'après une version, aurait duré seulement soixante-dix jours et n'aurait pas compté moins de soixante-dix rois, d'après une autre, aurait consisté de cinq rois et aurait régné soixante-quinze ans. Il parlait ensuite d'une seconde dynastie memphite, la huitième, dont les vingt-sept souverains exercèrent l'autorité pendant cent quarante-six ans. Le Papyrus de Turin, tout mutilé qu'il est, contient en effet pour cette époque l'indication de règnes fort courts. Le roi Nofirka, successeur immédiat de Nitaqrît, garda le pouvoir deux ans, un mois, un jour ; le roi Nofrous (Snofroui II ?), quatre ans, deux mois, un jour ; le roi Abou, deux ans, un mois, un jour ; un autre roi, dont le nom est illisible, un an et huit jours. Il faut voir dans l'insignifiance de ces chiffres la preuve des intrigues incessantes et des guerres civiles qui ruinèrent l'Égypte et qui amenèrent probablement sa division en plusieurs États indépendants, sur lesquels les princes de la dynastie officielle, retirés à Memphis, n'exercèrent plus qu'un droit de suzeraineté purement nominal.
Après un siècle et demi d'agitations et de luttes, la lignée memphite s'éteignit et elle fut remplacée par une famille d'origine héracléopolitaine. Hâkhninsouten[233], l'Héracléopolis des géographes grecs, dont le nom, altéré successivement en Khninsou et Hnés[234], est reconnaissable encore aujourd'hui dans la forme arabe Ahnas-el-Médinéh, était l'une des villes les plus anciennes et les plus riches de l'Égypte. Située au coeur même de l'Heptanomide, à trente lieues environ au sud de Memphis, elle s'élevait dans une île assez considérable resserrée entre le Nil à l'orient, et le grand canal qui longe le pied de la montagne Libyque, à l'occident. Fondée, aux temps antéhistoriques, autour de l'un des sanctuaires les plus vénérés du pays, elle n'avait pas encore de rôle politique, lorsqu'un de ses princes, Khitoui, dont le nom nous est arrivé, avec la prononciation de l'âge grec, en Achtoès, la tira de son obscurité et parvint à lui transférer la prééminence, qui avait appartenu si longtemps à Memphis. Un roman d'époque tardive le représentait comme ayant été « le plus cruel de tous ceux qui avaient régné jusqu'alors après avoir commis beaucoup de crimes, il fut enfin frappé soudain de démence et il fut dévoré par un crocodile[235] ». Il régna pourtant sur l'Égypte entière : son nom a été trouvé sur les rochers de la première cataracte[236], et nous savons qu'il guerroya contre les nomades de la péninsule sinaïtique[237]. Ses premiers successeurs continuèrent de commander un siècle au moins à toute la vallée[238], mais les grandes familles féodales qui dominaient dans les nomes, à Hermopolis, à Siout, à Thinis, à Koptos, à Thèbes, à Éléphantine, se lassèrent enfin de leur obéir. Au bout de trois ou quatre générations, les barons de Thèbes, ayant groupé autour d'eux tons les seigneurs du Midi, assumèrent la dignité royale. Dès lors, l'empire fut divisé entre deux maisons rivales dont l'une, siégeant à Héracléopolis, fut comptée par les chronologistes comme formant une dixième dynastie, héracléopolitaine de même que la ixe. La guerre fit rage du Nord au Sud et se prolongea avec des chances variées. Au début, l'habileté des princes de Siout, Khitoui 1er, Tefabi, Khitoui II, parut faire pencher la balance du côté des Héracléopolitains : Khitoui II réinstalla le pharaon Marikari dans sa capitale qui l'avait expulsé, et il tint en échec les dynastes du Midi[239]. Bientôt toutefois la fortune changea. Les Thébains toujours battus revinrent toujours à la charge après une lutte de près de deux siècles, ils finirent par triompher des derniers Héracléopolitains, et ils réunirent sous leur autorité les deux moitiés de l’Égypte[240].
Chapitre
III : Période thébaine – De la onzième à la quinzième dynastie
(Moyen Empire)
La
onzième dynastie ; débuts de la puissance thébaine.
Depuis l'avènement de Ménès, toute la civilisation égyptienne semblait s'être concentrée dans la partie moyenne du pays, entre Thinis et Memphis. C'est à Thinis ou à Memphis que les princes avaient trôné, à Thinis ou à Memphis que les arts s'étaient développés et avaient produit leurs chefs-d'œuvre : les nomes du sud avaient été relégués au second plan. Leurs métropoles vivaient dans une obscurité profonde ; leurs dieux même étaient ignorés à ce point que, sur les monuments des six premières dynasties publiés jusqu'à ce jour, j'ai trouvé une seule fois, dans un nom propre, le nom du grand dieu de Thèbes, Anion, le seigneur des deux mondes, le patron de l'Egypte au temps des conquêtes syriennes.
Lorsque Memphis eut perdu la suzeraineté, au milieu des révolutions qui désolèrent le règne des princes Héracléopolitains, les villes du sud de l'Egypte, Coptos, Silsilis, Thèbes surtout, commencèrent de naître à la vie politique. Les premiers monuments que nous connaissons d'elles dérivent directement des derniers monuments que la sixième dynastie nous a légués, mais ils sont empreints encore de gaucherie et de rudesse provinciale. Ce sont des tombeaux creusés dans le roc, peints mais non sculptés. Les scènes de la vie civile n'y sont pas représentées ; on y voit seulement dessinés sur les murs des amas d'offrandes, accompagnés de prières empruntées, partie au Livre des Morts, partie ail Rituel des pyramides royales. Comme à l'âge memphite, la stèle est un résumé de la chapelle du tombeau ; mais elle affecte une forme cintrée qui rappelle les voûtes des hypogées de la Haute Égypte, et elle suffit seule à procurer au mort tout ce qui est nécessaire à son existence. Souvent le dieu à qui l'on recommande le maître de la stèle est figuré avec ses attributs. C'est Osiris, c'est Khnoumou, c'est Minou, c'est Amon surtout qu'on invoque. Phtah, Atoumou, Râ, tous les dieux memphites et héliopolitains se sont abaissés au rang des dieux provinciaux, dans le même temps que Memphis descendait de la dignité de capitale à la condition de ville de province.
La onzième dynastie était originaire de Thèbes elle se rattachait à Pépi-Miriri par des liens inconnus et elle fut la souche de la dix-huitième dynastie. D'abord vassale des rois Héracléopolitains, nous avons vu qu'elle ne parvint pas aisément à conquérir son indépendance. Le premier de ses princes dont nous sachions le nom, Antouf 1er, n'avait pas droit au cartouche : il était simple noble, sans plus de titres que les autres chefs des familles féodales. Son fils, Montouhotpou 1er, tout en assumant le cartouche et le protocole, demeure un Horou, un souverain partiel, chef des pays du sud sous la suzeraineté des rois légitimes. Trois générations après lui, Antouf IV rompit le dernier lien de vasselage et se fit appeler Dieu bon, maître des deux pays[241]. il ne faudrait pas toutefois se laisser abuser à ce dernier titre et croire que son autorité prévalût dès lors sur l'Egypte entière : les Pharaons d'Héracléopolis conservaient la possession du Delta et ils firent sentir plus d'une fois leur pouvoir aux monarques thébains. Le premier de ceux-ci qui parvint à « réunir les deux régions » sous un sceptre unique fut Montouhotpou IV (Nibhapouîtrî), à qui cet exploit valut plus tard d'occuper dans les listes royales une place d'honneur et parfois même de représenter à lui seul la famille à laquelle il appartenait[242]. Ses successeurs ne réussirent pas à se maintenir longtemps sur le trône, et ils cédèrent la place au fondateur de la douzième dynastie, après avoir dominé un peu moins d'un demi-siècle sur l'Egypte entière[243].
Quelques tablettes sculptées sur les rochers, quelques stèles funéraires et quelques menus objets dispersés dans les différents musées de l'Europe, quelques tombeaux à moitié ruinés, voilà tout ce qui nous reste des seize rois[244] qui composèrent la première dynastie thébaine dans sa longue période de vasselage et dans sa courte grandeur. Les luttes constantes qu'ils eurent à soutenir contre les rois Héracléopolitains ne les empêchèrent pas de diriger quelques expéditions heureuses contre les peuples voisins de l'Égypte. Montouhotpou III (Nibhotpourî) se fit représenter près de Philae, vainqueur des nations barbares[245] ; Sonkhkherî Montouhotpou prétendait inspirer la terreur à toutes les nations, et plusieurs de ses monuments semblent prouver qu'il avait fait des guerres heureuses[246]. Leurs succès devaient être fort peu de chose. Au nord et à l'ouest, les mines du Sinaï avaient été abandonnées ; vers le sud, les conquêtes de Pépi et de ses successeurs étaient perdues, et la frontière ne dépassait pas Éléphantine de beaucoup. C'est aux rois de la douzième dynastie qu'il était réservé de réduire la Nubie en province égyptienne.
Comme rois constructeurs, les Antouf, les Montouhotpou ont laissé peu de traces : les ressources dont ils disposaient, même au temps de leur prospérité le plus notoire, n'étaient pas suffisantes pour leur permettre d'élever des monuments considérables. La ville de leur origine, Thèbes, fut embellie par eux dans la mesure de leurs moyens : du moins une inscription de l'an II de Montouhotpou III (Nibhotpourî) nous apprend que ce prince manda une expédition à la vallée de Hammamât pour chercher la pierre nécessaire aux constructions qu'il méditait dans Thèbes[247]. Les seules ruines de cette époque qui subsistent se trouvent à Drah-Abou'l-Neggah, au milieu de la nécropole. C'était là que s'étaient fait ensevelir Antoufâ 1er, Antoufâ II, Montouhotpou IV (Nibhotpoutrî) et plusieurs de leurs successeurs. Les tombes, déjà violées par les malfaiteurs au temps de la vingtième dynastie[248], sont aujourd'hui détruites, excepté celles d'Antoufâ 1er et de Montouhotpou IV. Celle de Montouhotpou était une pyramide considérable bâtie au fond du cirque de Deîr el-Bahari. Celle d'Antoufâ était en briques crues, de travail médiocre, presque à cheval sur la lisière du désert. La chambre sépulcrale renfermait, outre le sarcophage disparu sans retour, une stèle de l'an L, où le roi était figuré en pied, l'uræus au front, accompagné de quatre de ses chiens favoris[249].
Après Thèbes, c'est Coptos qui paraît avoir eu le plus à se louer de l'activité de ces premiers Thébains. Située au débouché des routes qui mènent au bord de la mer Rouge et aux carrières de Rohanou[250], Coptos avait pris dès lors un grand développement. Antouf IV (Noubkhopirrî) y avait élevé des édifices dont les fragments ont servi de nos jours à la construction d'un pont[251]. Montouhotpou Il et Montouhotpou III (Nibhotpourî) professait une dévotion spéciale pour le dieu local Minou, forme d'Amonrâ générateur, et ils marquèrent leur zèle pur la restauration de divers temples aujourd'hui détruits. L'exploration de la vallée de Hammamât devait mener plus loin encore un des derniers princes de la dynastie, Sonkhkherî Montouhotpou. Désireux d'établir des communications directes avec l'Arabie et l'Egypte, il envoya un des hauts fonctionnaires de sa cour aux abords de la mer Rouge, très probablement dans le voisinage de Qocéyr[252]. Comme on voit, l'esprit d'initiative ne manquait pas à ces princes obscurs, mais le développement de leur puissance fut interrompu par des révolutions dont nous ne savons ni la cause, ni les détails. Lorsque l'Égypte, divisée pour quelques années, se trouva de nouveau réunie tout entière entre les mains d'un seul homme, la onzième dynastie avait cessé de régner.
La
douzième dynastie ; conquête de la Nubie ; le lac Moeris.
L'avènement de la dynastie nouvelle ne s'opéra pas sans combat. Amenemhaît 1er d'origine thébaine comme ses prédécesseurs, eut à batailler contre les compétiteurs dont les entreprises troublèrent ses premières années. « Ce fût après le repas du soir », dit-il dans des Instructions au roi Sanouasrît 1er qui lui sont attribuées, « quand vint la nuit, - je pris une heure de joie. - Je m'étendis sur les couches moelleuses de mon palais, je m'abandonnai au repos, - et mon coeur commença de se laisser aller au sommeil ; -quand, voici, on s'assembla en armes pour se révolter contre moi, - et tandis que j'étais aussi faible que le serpent des champs. - Alors je m'éveillai pour combattre moi-même, de mes propres membres, - et je trouvai qu'il n'y avait qu'à frapper qui ne résistait pas. - Si je prenais un assaillant les armes à la main, je faisais retourner cet infâme ; - il n'avait plus de force même dans la nuit on ne combattit point, - aucun accident fâcheux ne se produisit contre moi.[253] » A force de persévérance, le roi triompha de ses adversaires. « Soit que les sauterelles aient organisé le pillage, - soit qu'on ait machiné des désordres dans le palais, - soit que l'inondation ait été insuffisante et que les citernes se soient desséchées, - soit qu'on se soit souvenu de ta jeunesse pour agir [contre moi], - je n'ai jamais reculé depuis ma naissance.[254] »
Dés lors Amenemhaît s'appliqua sans relâche à réparer les malheurs des discordes civiles et à repousser les peuples voisins, Libyens, Nubiens, Asiatiques, dont les excursions perpétuelles troublaient sans cesse le repos de l'Égypte. « J'ai fait que l'endeuillé ne fût plus en deuil, et il n'a plus été entendu ; - les batailles perpétuelles[255], on ne les a plus vues, - tandis qu'avant moi l'on s'était battu comme un taureau qui ignore le passé - et que le bien-être de l'ignorant ou du savant n'était pas assuré.[256] » - « J'ai fait labourer le pays jusqu'à Abou[257], - j'ai répandu la joie jusqu'à Adhou[258]… - Je suis le créateur des trois espèces de grains, l'ami de Nopri[259]. - Le Nil a accordé à mes prières l'inondation sur tous les champs - point d'affamé sous moi, point d'altéré sous moi, - car on agissait selon mes ordres, - et tout ce que je disais était un nouveau sujet d'amour. - J'ai renversé le lion - et pris le crocodile ; - j'ai réduit les Ouaouaîtou[260], - j'ai emmené les Mazaiou en esclavage[261] ; - j'ai forcé les Asiatiques à marcher prés de moi comme des lévriers.[262] » En Nubie, le roi, après avoir pacifié la vallée, pénétra dans la montagne et il y rouvrit les mines d'or négligées depuis le temps de Pépi.
Amenemhaît 1er n'était plus un jeune homme au jour de son avènement : après dix-neuf ans de règne, il appela au pouvoir son fils Sanouasrît 1er, qui dés lors partagea avec lui les titres royaux[263]. « De sujet que tu étais je t'élevai, - je te remis l'usage de tes bras, pour que tu fusses craint à cause de cela. - Quant à moi, je me parai des fines étoffes de mon palais, pour paraître aux yeux comme une des plantes de mon jardin, - je me parfumai des essences comme si je répandais l'eau de mes citernes.[264] » Au bout de quelques années, le rôle du vieux roi était tellement effacé qu'on oubliait parfois d'inscrire son nom dans les actes officiels à côté du nom de son fils[265]. Enfermé dans son palais, il se bornait à donner des avis qui contribuèrent beaucoup, paraît-il, à la prospérité de l'État. La réputation de sagesse qu'il s'acquit de la sorte se répandit si fort, qu'un scribe à peu près contemporain composa sous son nom un pamphlet où le roi, « se levant comme un dieu », fut représenté adressant à son fils quelques instructions sur l'art de gouverner. « Écoute mes paroles. - Tu règnes sur les deux mondes ; tu régis les trois régions[266]. - Agis mieux encore que n'ont fait tes prédécesseurs. - Maintiens la bonne harmonie entre tes sujets et toi, - de peur qu'ils ne s'abandonnent à la crainte ; - ne t'isole pas au milieu d'eux ; - n'emplis pas ton coeur, ne fais pas ton frère uniquement du riche et du noble, -mais n'admets pas non plus auprès de toi les premiers venus dont l'amitié n'est pas éprouvée.[267] » A l'appui de ses conseils, le vieux prince raconte sommairement ses propres exploits. Ce petit ouvrage, qui ne compte guère plus de trois pages, devint bientôt classique et conserva sa vogue pendant prés de vingt siècles. Encore au temps de la dix-neuvième dynastie, c'était un des morceaux qu'on étudiait dans les écoles et que les jeunes gens copiaient comme exercice de style[268].
Rien ne saurait mieux montrer l'état de l'Égypte et des pays voisins à cette époque que certains passages des Mémoires d'un aventurier contemporain nommé Sinouhît[269]. Il était l'un des fils puînés d'Amenemhaît, et ayant surpris un secret d'État au moment de la mort de son père, il quitta l'armée avec laquelle il guerroyait pour s'enfuir en Asie. Arrivé à la cour d'un petit chef asiatique, on lui demanda des détails sur la puissance des souverains égyptiens. « Y aurait-il eu une mort dans le palais d'Amenemhaît sans que nous le sachions ? » Alors je lui dis : « Il n'en est rien… Mon exil en ce pays est comme le dessein d'un dieu ». Le chef me dit : « L'Égypte est aux mains d'un maître qu'on appelle le dieu bienfaisant et dont la terreur s'étend sur toutes les nations environnantes, comme la déesse Sokhit s’étend sur la terre dans la saison des maladies ». Je lui répondis : « Oui, par mon salut ! son fils[270] entre au palais, car il a pris la direction des affaires de son père ; c'est un dieu sans second, nul autre comme lui auparavant ; c’est un conseiller sage en ses desseins, bienfaisant en ses décrets, qui entre et sort à son gré ; il dompte les régions étrangères, et, tandis que son père reste au palais, lui, annonce ce qu'il a gagné. C'est un brave qui agit par l'épée, un vaillant qui n'a point d'égal il voit les barbares, s'élance, fond sur les pillards. C'est un lanceur de javeline, qui rend débiles les mains de l'ennemi : ceux qu'il frappe ne lèvent plus la lance. C'est un redoutable[271], qui brise les fronts : on ne lui a point résisté en son temps. C’est un coureur rapide, qui massacre le fuyard ; on ne l'atteint pas à courir après lui. C'est un coeur debout dans son heure. C'est un lion qui frappe de la griffe[272] et n'a jamais rendu son arme. C'est un coeur cuirassé à la vue des multitudes et qui n'a rien laissé subsister derrière lui. C'est un brave qui se jette en avant quand il voit la lutte. C'est un soldat joyeux de s'élancer sur les barbares : il saisit son bouclier, il bondit, et, sans redoubler son coup, il tue, personne ne peut éviter sa flèche ; sans qu'il ait besoin de tendre son arc, les barbares fuient ses bras comme des lévriers, car la grande déesse lui a donné de combattre qui ignore son nom, et quand il atteint, il n'épargne rien, il ne laisse rien subsister. C'est un ami[273] merveilleux qui a su s'emparer de l'affection : son pays l'aime plus que soi-même et se réjouit en lui plus qu'en un dieu : hommes et femmes accourent lui rendre hommage. Il est roi, il a commandé dés l'œuf ; depuis sa naissance, il a été un multiplicateur de naissances, un être unique d'une essence divine, par qui cette terre se réjouit d'être gouvernée. C'est un agrandisseur de frontières qui saisira le pays du sud et ne convoite pas les pays du nord ; il s'est rendu maître des Asiatiques et a écrasé les Nemmâshaîtou[274]. » L'association de Sanouasrît 1er à la couronne avait habitué les Égyptiens à considérer ce prince comme, roi de fait, du vivant même de son père. Aussi, lorsque Amenemhaît mourut, après au moins dix années de corégence et trente ans de règne, la transition, si délicate dans une dynastie nouvelle, du fondateur à son successeur immédiat, s'opéra sans secousse. Sanouasrît 1er était engagé dans une expédition contre les Libyens. Les fonctionnaires demeurés dans la capitale auprès de son père le firent aussitôt prévenir ; il quitta son camp en secret et revint à Memphis où il fut proclamé roi[275]. L'exemple d'Amenemhaît 1er fut suivi dès lors par la plupart de ses descendants. Après quarante-deux ans, Sanouasrît 1er associa au trône son fils Amenemhaît II[276], et celui-ci, trente-deux ans plus tard, partagea le pouvoir avec Sanouasrît II[277]. Amenemhaît III et Amenemhaît IV régnèrent longtemps ensemble[278]. Les seuls règnes pour lesquels nous n'ayons point la preuve de ce fait sont ceux de Sanouasrît III et de la reine Sovkounofriou, la Skémiophris de Manéthon, avec laquelle la douzième dynastie s'éteignit, après deux cent treize ans, un mois et vingt-sept jours de durée totale[279].
Parmi les dynasties égyptiennes, la douzième est à coup sûr celle dont l'histoire offre le plus de certitude et le plus d'unité. Sans doute nous sommes loin de connaître tous les événements qu'elle vit s'accomplir : la biographie des huit souverains qui la composent et le détail de leurs guerres sont encore des plus incomplets. Mais du moins nous suivons sans interruption le développement de leur politique ; on peut, après quatre mille ans et plus, reconstituer leur Égypte telle qu'ils se l'étaient faite et qu'ils la léguèrent à leurs successeurs. A la fois ingénieurs et soldats, amis des arts et protecteurs de l'agriculture, ils ne cessèrent un seul instant de travailler à la grandeur du pays qu'ils gouvernaient. Reculer les frontières de l'empire au détriment des peuples barbares et coloniser la vallée du Nil dans toute sa partie moyenne, de la première cataracte à la quatrième; régula¬riser le système des canaux et obtenir, une plus juste répartition des eaux dans ce qui est aujourd'hui le Fayoum ; orner d'édifices Héliopolis, Thèbes, Tanis, Héracléopolis, et cent cités moins célèbres : telle fut l'oeuvre qu'ils s'imposèrent et qu'ils continuèrent de père en fils pendant plus de deux siècles. Au sortir de leurs mains, l'Égypte, agrandie d'un tiers par la conquête de la Nubie, enrichie par de longues années de paix et, de bonne administration, jouissait d'une prospérité sans égale. Plus tard, au temps des guerres asiatiques et des conquêtes lointaines, elle eut plus d'éclat apparent et fit plus de bruit dans le monde : au temps des Sanouasrît, elle était plus riche et plus heureuse.
Deux champs de bataille s'ouvraient aux Pharaons, l'un à l'est du Delta, en Syrie, l'autre au sud d'Éléphantine, dans la Nubie proprement dite. A l'est, l'Égypte, séparée des populations syriennes par le désert, semblait n'avoir rien à craindre derrière sa ceinture de sables. Tout au plus lui fallait-il subir quelques incursions des barbares nomades, plus ruineuses pour la fortune de certains particuliers que pour la sécurité du pays. Pour se mettre à l'abri de ces razzias, difficiles à éviter malgré la vigilance des garde-frontières, les souverains de l'Ancien Empire avaient, de la mer Rouge au Nil, élevé une série de forteresses et bâti une muraille qui barrait aux pillards l'entrée de l'Ouady-Toumilât[280]. Cette muraille, entretenue avec soin par Amenemhaît 1er et par ses successeurs, marquait de ce côté l'extrême limite de l'empire. Au delà, le désert commençait et, pour la masse des Égyptiens de cette époque, un monde à peu près inconnu. Sur les peuples de la Syrie, ils ne possédaient que des notions flottantes empruntées aux caravanes ou apportées dans les ports de la Méditerranée par les marins qui les fréquentaient. Parfois cependant les riverains du Delta voyaient descendre dans leurs villes des bandes d'émigrés ou même des tribus entières qui, chassées de leur canton natal par la misère ou par les révolutions, venaient chercher asile en Égypte. Un des bas-reliefs du tombeau de Khnoumhotpou à Béni-Hassan nous fait assister à la réception d'une troupe de ces malheureux. Au nombre de trente-sept, hommes, femmes et enfants, ils sont amenés devant le gouverneur du nome de Mihi, auquel ils présentent une sorte de fard verdâtre nommé moszimit et deux bouquetins. Ils sont armés, comme les Égyptiens, de l'arc, de la javeline, de la hache, de la massue, et vêtus de longues robes ou de pagnes étroits bridant sur la hanche ; l'un d'eux, tout en marchant, joue d'un instrument qui rappelle, par la forme, les lyres de vieux style grec[281]. Les détails de leur costume, l'éclat et le bon goût des étoffes bariolées et garnies de franges dont ils sont revêtus, l'élégance de la plupart des objets qu'ils ont avec eux, témoignent d'une civilisation avancée. C'était déjà d'Asie que l'Égypte tirait les esclaves, les parfums dont elle faisait une consommation énorme, le bois et les essences du cèdre, les vases émaillés, les pierreries, le tapis et les étoffes brodées ou teintes dont la Chaldée se réserva le monopole jusqu'au temps des Romains[282].
Sur un point seulement du territoire asiatique, les Pharaons de la douzième dynastie songèrent à s'établir solidement : ce fut dans la péninsule du Sinaï, auprès des mines de cuivre et de turquoise exploitées jadis par les princes de l'Ancien Empire. Des postes échelonnés dans les gorges de la montagne protégèrent les ouvriers contre les tentatives des Bédouins. Grâce à cette précaution, on put reprendre l'exploitation des anciens filons, ouvrir des filons nouveaux et imprimer aux travaux une activité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Sanouasrît 1er [283], Amenemhaît II[284], Amenemhaît III[285], Amenemhaît IV[286] y ont laissé des inscriptions à leur nom. Toutefois, même en cet endroit, les rois de la douzième dynastie ne se départirent point de leur politique habituelle ; ils ne saisirent de terrain que ce qui leur était nécessaire pour l'exploitation des mines, et ils ne disputèrent pas le surplus aux tribus nomades du désert.
De toutes ces tribus, celles qu'ils connaissaient le mieux, pour avoir souvent à repousser ou à châtier leurs incursions, étaient les Sitiou ou Shasou, pillards effrontés, ainsi que l'indique le nom qu'ils s'appliquaient à eux-mêmes[287]. Répandus sur les frontières de l'Égypte et de la Syrie, à la lisière du désert et des terres cultivées, ils vivaient comme les Bédouins d'aujourd'hui, sans demeure fixe, moitié de pillage, moitié du profit de leurs maigres troupeaux. Quelques-uns de leurs royaumes, celui de Kadouma par exemple, étaient fréquentés des marchands égyptiens et servaient de refuge aux bannis. Un conte populaire, dont le héros vivait sous Amenemhaît et Sanouasrît 1er, nous dépeint d'une manière saisissante l'existence que ces exilés menaient à la cour des petits sheïkhs asiatiques. Sinouhît, forcé de fuir l'Égypte pour avoir surpris un secret d'État, franchit la muraille orientale et s'enfonce dans le désert. « Je cheminai, dit-il, pendant la nuit, et à l'aube je gagnai Pouteni et me dirigeai vers le lac de Qîmoîri. Alors la soif, elle fondit sur moi ; je faiblis, mon gosier s'embrasa, je me disais déjà : “Voici le goût de la mort”, quand soudain je relevai mon coeur et raidis mes membres, j'entendais la voix douce des bestiaux. J'aperçus des Bédouins ; leur chef qui avait été en Égypte me reconnut et il me donna de l'eau, il me fit bouillir du lait, puis j'allai avec lui dans sa tribu.[288] »
Les Bédouins qui avaient accueilli Sinouhît le conduisent de station en station jusqu'au territoire de Kadouma. Un des chefs de cette contrée l'envoie chercher et l'invite à s'installer près de lui : « Demeure avec moi, tu pourras entendre le langage de l'Égypte ». Et en effet, Sinouhît rencontre près du prince « certains hommes d'Égypte qui étaient parmi ses hôtes[289] ». Cette circonstance décide l'aventurier à se fixer dans le pays, où il fait rapidement fortune. « Le chef me mit à la tête de ses enfants, me maria à sa fille aînée, et me donna mon choix parmi les terres les meilleures qui lui appartenaient jusqu'aux frontières du peuple voisin. C'est un bon lieu nommé Aïa[290] ; il a des figues et du raisin, et produit plus de vin qu'il n'a d'eau. Le miel y est en quantité, ainsi que les oliviers et tous les fruits des arbres. On y trouve de l'orge ; ses froments n'ont point de nombre, non plus que ses bestiaux. Ce fut grand, certes, ce qu'on me conféra, quand le prince vint pour m'investir et m'établit chef de tribu parmi les meilleures du pays. J'eus des rations quotidiennes de pain et de vin, chaque jour des viandes cuites, des oies rôties, outre le gibier du pays que je prenais ou qu'on posait devant moi en plus de ce que me rapportaient mes chiens de chasse ; on me faisait toute espèce de beurre et de fromage. Je passai de nombreuses années, mes enfants devinrent des braves, chacun d'eux dirigeait sa tribu. Le voyageur qui allait et revenait dans l'intérieur du pays se détournait vers moi, car j'accueillais bien tout le monde je donnais de l'eau à qui avait soif, je mettais l'égaré sur sa route, je saisissais le brigand. Les archers qui s'en allaient au loin pour battre et pour repousser les princes du pays, j'ordonnais et ils marchaient ; car ce roi de Tonou me fit passer plusieurs années parmi son peuple comme général de ses soldats. Aussi chaque pays que j'envahis, je le forçai de payer tribut des produits de ses terres ; je pris ses bestiaux ; j'emportai ce qui lui appartenait, j'enlevai ses boeufs, je tuai ses hommes ; il était à la merci de mon sabre, de mon arc, de mes expéditions, de mes desseins pleins de sagesse qui plaisaient au roi. Donc il m'aima, connaissant ma vaillance ; il me mit à la tête de ses enfants, voyant la valeur de mon bras.
« Un brave de Tonou vint me défier dans ma tente ; c'était un illustre, sans pareils, car il avait détruit tous ses rivaux. Il disait : “Que Sinouhît se batte avec moi, car il ne m’a pas encore frappé” ; il se flattait de prendre mes bestiaux pour sa tribu. Le roi se consulta avec moi, et je dis : “Je ne le connais point. Certes je ne suis pas son frère, je me tiens éloigné de son logis ; est-ce que j'ai jamais ouvert sa porte ou franchi ses clôtures ? C'est quelque aventurier désireux de me voir et qui se croit appelé à me dépouiller de mes chats et de mes chiens, en plus de mes vaches, de fondre sur mes taureaux, mes chèvres, mes veaux, afin de se les approprier…” Je bandai mon arc, je préparai mes flèches, je donnai du jeu à mon poignard ; je fourbis mes armes. Quand l'aube arriva, Tonou vint lui-même, après avoir rassemblé toutes ses tribus et convoqué tous ses vassaux, car il désirait voir ce combat. Tous les coeurs brûlaient pour moi ; hommes et femmes poussaient des “Ah !” et chaque coeur s'attrista pour moi ; car on disait : “Est-ce que c'est un autre brave qui va lutter avec lui ? Voici, l'adversaire a son bouclier, sa javeline, son paquet de dards”. Quand je sortis et qu'il eut paru, je détournai de moi ses traits. Comme pas un seul ne portait, il fondit sur moi ; et alors je déchargeai mon arc contre lui. Quand mon trait s'enfonça dans son cou, il poussa un grand cri et tomba à terre.[291] » Telle était, il y a plus de quatre mille ans, la vie des tribus du désert, telle elle est encore aujourd'hui ; le récit de Sinouhît, à peine modifié, s'applique fort bien aux Bédouins de nos jours.
Ce fut surtout vers l'Éthiopie que l'attention des princes de la douzième dynastie se concentra. Là, en effet, l'Égypte était directement menacée par des peuplades remuantes qui habitaient les deux rives du Nil et les déserts environnants. C'étaient d'abord, au delà de la première cataracte et jusqu'à mi-chemin de la seconde, les Ouaouaîtou, ces vieux ennemis des Pharaons, auxquels Pépi avait eu affaire et que les princes d'Éléphantine avaient réduits en partie. Battus par les princes de la onzième dynastie et pourchassés par Amenemhaît 1er, ils reculaient sans cesse vers le Midi ou vers la mer Rouge, et ils préféraient s'expatrier plutôt que se soumettre. Plus au sud, auprès de la seconde cataracte, on trouvait le pays de Hehou et celui de Shaad, avec des carrières de calcaire blanc[292]. Dans le désert et au delà de la seconde cataracte erraient cent tribus aux noms étranges, Shemîk, Khasa, Sous, Kaâs, Aqîn, Anou, Sabiri, Akîti, Makisa, toujours prêtes aux razzias, toujours battues et jamais pacifiées[293]. Elles appartenaient à une race blanche, la race de Koush, qui, peu après la conquête memphite[294], avait fait son apparition sur les bords de la mer Rouge et avait refoulé les Nègres vers les régions du Haut Nil[295]. Ces peuples nouveaux, issus de la souche d'où sortirent plus tard les Phéniciens, apportaient avec eux les éléments d'une civilisation à peine inférieure à celle de l'Égypte. Les Pharaons comprirent combien il leur était nécessaire de les dompter, tandis qu'ils étaient encore indécis et flottants, et ils tournèrent contre eux toutes les forces vives de la nation. A force de persévérance, ils parvinrent à en annexer complètement la plupart, à détruire ou à pourchasser vers le sud ceux qui s'obstinèrent à la lutte et à les remplacer par des colonies de fellahs. Dés lors toute la vallée, depuis l'endroit où le Nil quitte les plaines d'Abyssinie pour entrer dans le lit étroit qu il s'est creusé au milieu du désert, jusqu'à l'endroit où il se décharge dans la Méditerranée, ne constitua plus qu'un seul empire, habité par un seul peuple, parlant la même langue, adorant les mêmes dieux et obéissant au même souverain.
Amenemhaît 1er avait battu les Ouaouaîtou dans la trentième année de son règne[296] ; son fils, Sanouasrît 1er, vainquit sept peuples nègres confédérés et courut triomphant jusqu'à Ouadi-Halfa[297]. Sous Amenemhaît II, le pays des Ouaouaîtou n'était déjà plus qu'une province égyptienne gouvernée comme les autres nomes par un fonctionnaire royal[298]. Sanouasrît II continua, avec éclat ce semble, l'oeuvre de ses prédécesseurs, que son fils, Sanouasrît III, acheva. Ce prince, si populaire en Égypte que Manéthon ou ses compilateurs l'identifiaient avec le Sésostris de la tradition grecque et lui attribuaient la conquête du monde[299], marcha lui-même à la tête de ses armées[300] et soumit toute la Nubie d’une manière définitive. Après l'annexion du canton de Heh, il fixa la frontière de l'empire à Semnéh, prés de la seconde cataracte. Une inscription gravée en l'an VIII constate le fait : « [C'est ici] la frontière méridionale réglée en l'an VIII, sous la sainteté du roi des deux régions Khakerî Sanouasrît III, vivificateur à toujours et à jamais, afin que nul Nègre ne la franchisse en descendant le courant, si ce n'est pour le transport des bestiaux, boeufs, chèvres, moutons appartenant aux Nègres.[301] » Une autre inscription de l'an XVI renouvelle cette défense, et nous apprend que « sa Sainteté avait permis qu'on érigeât une statue d'elle sur la frontière qu'elle-même avait établie.[302] »
Nul emplacement n'était mieux choisi pour servir de boulevard permanent contre les invasions du sud. La large chaîne de rochers granitiques qui coupe perpendiculairement la vallée en cet endroit, et qui détermine une série de rapides difficiles à franchir, excepté au temps des hautes eaux, opposait une barrière assurée aux flottes qui auraient essayé de brusquer le passage. De chaque côté, sur des rochers qui plongent à pic dans le courant, Sanouasrît III construisit une forteresse destinée à commander entièrement le fleuve et la vallée. Bâtis en briques crues, comme tous les édifices militaires de l'Égypte, ces forts présentent non seulement les hautes murailles et les tours massives des citadelles antiques, mais l'escarpe, le fossé, la contre escarpe et le glacis des places plus récentes, et ils pouvaient défier pendant longtemps tous les moyens d'attaque dont on disposait à cette époque. Leur enceinte renfermait un temple dédié au fondateur, et de nombreuses habitations aujourd'hui ruinées[303].
Désormais les expéditions dirigées par les monarques égyptiens au delà de Semnéh n'eurent plus pour objet la conquête : on se borna à exiger un tribut et à réclamer un droit de suzeraineté, toujours incertain. C'est ainsi qu'on voit Sanouasrît III diriger en l'an XVI une razzia méthodique contre le pays de Houà sur le Tacazze[304], et Amenemhaît III se vanter de victoires remportées sur les nègres éthiopiens, mais sans mention d'acquisition nouvelle[305]. On se contenta de fortifier et d'aménager le territoire annexé récemment. Sanouasrît III y fonda, un peu au sud d'Éléphantine, une ville qu'il appela de son nom Hirou-Khakerî, « les voies de Khakerî », et jeta le long du fleuve tant de fondations utiles, qu'après sa mort il fut divinisé à Semnéh[306] et adoré pendant plus de dix siècles sur le même pied que Doudoun, Anoukit, Khnoumou et les autres divinités locales. Son temple, ruiné pendant les premiers règnes de la dix-huitième dynastie, fût restauré par Thoutmosis III et il a duré jusqu'à nos jours. Son fils et successeur, Amenemhaît III, construisit en face de Pselkis une forteresse importante[307]. Il eut aussi l'idée de faire observer les hauteurs que le Nil atteignait à Semnéh pendant l'inondation, et les cotes qu'il a enregistrées sur les rochers voisins ne sont pas au nombre des souvenirs les moins curieux de son règne[308].
Ce n'était pas dans un simple intérêt de curiosité que les ingénieurs postés à Semnéh se livraient à ce travail de relevé. Ils amassaient les éléments de calcul nécessaires à ceux de leurs confrères qui étaient chargés en Egypte de l'entretien des canaux. On sent quelle devait être l'utilité de cette tâche dans une contrée où le succès de la culture dépend de la répartition des eaux à la surface du sol, et dans un temps où les princes ne cessaient de rechercher tous les moyens possibles pour remédier à l'excès ou à l'insuffisance de l'inondation. Sanouasrît 1er traça une ligne de digues le long de la rive occidentale, contre laquelle portait surtout le fleuve, et ses successeurs, occupés qu'ils étaient par les guerres nubiennes, n'en exercèrent pas moins la plus active surveillance sur le service des eaux. A quelques lieues en amont de Memphis, la chaîne Libyque s'interrompt soudain et démasque l'entrée d'une vallée qui, d'abord étouffée entre les parois de là montagne, s'élargit à mesure qu'elle b 'enfonce vers le couchant et finit par s'épanouir en amphithéâtre. « Au centre s'étend un large plateau dont le niveau général est celui des plaines de l'Egypte ; à l'ouest, au contraire, une dépression considérable de terrain produit une vallée qu'un lac naturel de plus de dix lieues de long (le Birket-Qèroun) emplit de ses eaux.[309] » Au début de l'histoire, le lac était beaucoup plus considérable que nous ne le voyons aujourd'hui : il remplissait l'amphithéâtre entier, à l'exception d'un canton marécageux qui se déployait en bordure au pied de la montagne orientale, vers le point où s'ouvre la gorge qui communiquait avec la vallée. Là se trouvait de toute antiquité ce qu'on appelait To-shaît, la terre du lac, et sur cette terre la ville de Shodît, celle à qui les Grecs attribuèrent plus tard le nom de Crocodilopolis. Les rois de la XIIe dynastie, qui allaient souvent chasser les oiseaux dans ces marais, se prirent d'affection pour le site. Amenemhaît 1er y construisit un édifice dans lequel on a déterré sa statue[310]. Sanouasrît 1er y éleva un temple, dont il ne subsiste plus rien, si ce n'est les fragments de l'un des obélisques qui en décoraient l'entrée[311]. Amenemhaît III fit plus encore. S'il ne fonda point Crocodilopolis, comme le veulent certains auteurs classiques[312], du moins il y érigea des monuments dont la nature, mal comprise à l'époque hellénique, donna naissance à la légende du lac Moeris et du Labyrinthe.
Hérodote est le premier des historiens occidentaux qui en parle, le seul qui les ait vus, et c'est à lui que les écrivains postérieurs en empruntèrent la description, non sans l'embellir de traits plus ou moins fabuleux. Il racontait donc qu’un Pharaon Moeris, inconnu aux documents indigènes, avait établi en cet endroit un réservoir immense où il emmagasina le surplus de l'inondation. Ce réservoir était ceint de fortes digues et il mesurait un pourtour de quatre-vingt-dix milles[313]. Deux canaux munis d'écluses procuraient la communication avec le Nil et régularisaient l'entrée ou la décharge des eaux[314]. L'un d'entre eux s'emmanchait sur le fleuve à quelque distance au sud et courait en diagonale le long de la chaîne Libyque, à peu près dans la direction du Bahr-Yousouf actuel ; l'autre branchait beaucoup plus bas, à l'est du Fayoum, et suivait probablement le lit du canal auxiliaire qui s'amorce aujourd'hui au voisinage de Béni-Souef. C'était probablement au point d'intersection de ces cieux canaux qu'étaient placées les écluses, et le rameau nord était seul ouvert pendant le moment de l'étiage[315]. La crue était-elle suffisante ? l'eau, emmagasinée dans le lac, puis relâchée au fur et à mesure que le besoin s'en faisait sentir, maintenait le niveau à la hauteur convenable dans toute la moyenne Egypte et sur la rive gauche du Nil jusqu'à la mer. L'année d'après, la crue menaçait-elle d'envahir les villes ou d'emporter les villages du Delta, malgré les mottes artificielles sur lesquelles on les avait exhaussés, ou simplement de séjourner trop longtemps sur les terrains bas et de les changer en marécages ? le Moeris absorbait le surplus des eaux et l'emprisonnait jusqu'au moment où le fleuve commençait à baisser. Au milieu du lac se dressaient, dit-on, deux pyramides couronnées chacune d'un colosse assis, dont l'un représentait Moeris et l'autre la reine sa femme[316]. Du haut de ce piédestal, le vieux Pharaon semblait dominer son oeuvre et contempler éternelle ment les campagnes dont il avait assuré la fortune.
Le réservoir construit, Moeris établit sa résidence dans le voisinage et s'y érigea à la fois un palais et un tombeau[317]. Le palais, devenu temple après la mort de son fondateur, et appelé Labyrinthe, gisait à l'orient du lac, sur un petit plateau qui joint presque l'emplacement de Crocodilopolis. La façade qui donnait sur le Moeris était tout entière d'un calcaire si blanc, que les anciens la supposaient en marbre de Paros. Le reste de l'édifice était en granit de Syène[318]. Une fois dans l'enceinte, on se sentait bientôt comme perdu au milieu d'un dédale de petites chambres obscures, toutes carrées, toutes coiffées d'un seul bloc de pierre en guise de toit, et reliées les unes aux autres par des couloirs si habilement enchevêtrés qu'un étranger sans guide s'évertuait vainement à en sortir[319]. Il y en avait, dit-on, trois mille, dont moitié sous terre[320]. Les murs et les plafonds étaient décorés d'inscriptions et de figures sculptées en bas-relief dans le creux. On enfermait là les emblèmes des divinités ou les statues des rois défunts[321], et sans doute aussi les objets précieux, les vêtements sacrés, les sistres, les colliers, les parures emblématiques, en un mot tout le matériel du culte qu'une obscurité perpétuelle pouvait seule préserver des insectes, des mouches, de la poussière et du soleil. Au centre du massif on voyait douze grandes salles hypostyles, affrontées deux à deux, et dont les portes s'ouvraient, six au midi, six au nord. A l'angle nord du carré, Moeris avait préparé son tombeau, une pyramide en briques crues revêtue de pierre sculptée. C'était aux yeux des Grecs le monument le plus parfait de l'art égyptien. « J'ai vu le Labyrinthe, disait Hérodote, et je l'ai estimé plus grand encore que sa renommée. On rassemblerait tous les édifices et toutes les constructions des Grecs, qu'on les trouverait inférieurs comme travail et comme coût à ce Labyrinthe ; et, pourtant, le temple d'Éphèse est remarquable, aussi celui de Samos. Les pyramides encore m'avaient paru plus grandes que leur renommée, et une seule d'entre elles équivaut à beaucoup des plus grandes constructions grecques ; et si, le Labyrinthe surpasse-t-il même les Pyramides.[322] » On avait raconté à Hérodote que le Labyrinthe n'était pas l'oeuvre de Moeris, mais celle de Psammétique et de ses onze corégents. D'autres auteurs remplacèrent Psammétique et Moeris par un Mnévis[323], par un Imendès[324], par un Pétésoukhis[325], qu'on aurait tort de chercher sur les listes de Manéthon.
Ce sont là des légendes où la vérité ne tient qu'une place très mince. Le réservoir fameux, qui réglait l'inondation et qui assurait la fertilité à l'Egypte, n'a jamais existé : ce qu’Hérodote a vu c'est l'inondation - mou-oîri - et ce qu'il a pris pour les digues qui constituaient l'enceinte du réservoir, ce sont les chaussées qui séparaient les bassins l'un de l'autre. Au temps qu'il visita l'Egypte, le lac naturel, qui s'étalait à l'Est de la vallée, occupait une surface beaucoup plus considérable que celle qu'il a de nos jours, et son niveau était assez élevé pour qu'au moment de la crue le pays entier semblât ne plus former qu'une seule nappe d'eau de la montagne au désert[326]. Le labyrinthe lui-même n'était pas ce palais merveilleux que nous décrit Hérodote ; c'est la ville qu'Amenemhaît III fonda comme dépendance de sa pyramide, et dont les ruines sont visibles près du village moderne de Haouaara[327]. Les rois de la XIIe dynastie, s'ils n'ont point exécuté les travaux gigantesques que la tradition leur attribuait au Fayoum, n'en furent pas moins des constructeurs acharnés. A Thèbes, Amenemhaît et Sanouasrît 1er embellirent de leurs offrandes le grand temple d'Amon[328]. Dans la ville sainte d'Abydos, Sanouasrît 1er restaura le temple d’Osiris[329]. A Memphis, Amenemhaît III édifia les propylées au nord du temple de Phtah[330]. A Tanis, Amenemhaît 1er commença, en l'honneur des divinités de Memphis, un temple que ses successeurs agrandirent à l'envi[331]. Bubaste[332], Fakous[333], Héliopolis[334], Hakhninsou[335], Zorit[336], Edfou[337], et d'autres localités moins importantes ne furent pas négligées. Comme leurs ancêtres de l'Empire Memphite, les princes de la douzième dynastie mettaient tous leurs soins à se préparer des tombeaux magnifiques. « Mon maître, disait sous Sanouasrît 1er le scribe Mirri, m'envoya en mission pour lui deviser une grande demeure éternelle. Les couloirs et la chambre intérieure. étaient en maçonnerie et renouvelaient les merveilles de construction des dieux. Il y eut en elle des colonnes, sculptées, belles comme le ciel, un bassin creusé qui communiquait avec le Nil, des portes, des obélisques, une façade en pierre blanche de Rouou ; aussi Osiris, seigneur de l'Amentit, s'est-il réjoui des monuments de mon seigneur, et moi-même, j'ai été dans le transport et l'allégresse en voyant le résultat de mon travail.[338] » Cette pyramide de Sanouasrît 1er a été retrouvée à Licht[339], celle de Sanouasrît III à Dahchour[340], celles de Sanouasrît II et d'Amenemhaît II à Illahoun et à Haouara[341]. Elles sont assez endommagées pour la plupart, mais c'est dans l'une d'elles, celle de Sanouasrît III, qu'ont été recueillis ces admirables bijoux qui font aujourd'hui l'une des richesses du musée du Caire[342]. Ce sont des bijoux de mort, à la monture un peu trop légère pour le poids des émaux qui y sont enchâssés, mais, ce défaut indiqué, quel goût dans le dessin, quelle richesse de couleur, quelle habileté d'exécution : l'art de l'orfèvrerie n'a jamais rien produit qui dépasse ces chefs-d'oeuvre des vieux artisans égyptiens[343]. Toutefois les tombes royales comme les temples sont trop ruinés pour qu'on puisse juger, par ce qui nous reste d'eux, l'état de la sculpture et les conditions de la vie princière. Les hypogées où reposaient les barons féodaux, qui se partageaient le territoire sous la suzeraineté des Pharaons, se révèlent de jour en jour, à Siout, à Berchéh, à Meîr, à Éléphantine : mieux protégés contre la rapacité des envahisseurs de l'Égypte et contre les ravages du temps, ils ont survécu et ils suscitent à nos yeux la vallée du Nil telle qu'elle était il y a cinq mille ans depuis la première cataracte jusqu'au voisinage de Memphis.
Toutefois c'est à Béni-Hassan, dans le cimetière des sires héréditaires de Mihi[344], que l'on comprend le mieux quelle était alors la condition du pays. Ces princes appartenaient à ce que j'ai appelé ailleurs la féodalité égyptienne. Aux temps agités de la dixième et de la onzième dynastie, leurs ancêtres avaient probablement joui d'une indépendance complète et formé une de ces dynasties locales, inconnues aux annales officielles du royaume, mais si vivaces qu'elles reparaissaient à chaque nouvelle révolution qui affaiblissait l'autorité du pouvoir central. Soumis par les Antouf et les Montouhotpou avant d'avoir réussi à s’étendre sur les nomes voisins, ils se contentaient pour le moment d'occuper auprès de la personne du Pharaon les places les plus exaltées auxquelles la hiérarchie leur permettait d'aspirer. Aussi rien n'est-il plus curieux que leur biographie pour se faire une idée de l'histoire des classes nobles. Le premier d'entre eux que nous connaissions avait été institué nomarque dans la ville de Monâït-Khoufoui par Amenemhaît 1er, au cours des victoires qui assurèrent à celui-ci la possession incontestée de l'Égypte. Lorsqu'il devint seigneur de Mihi, son fils Nakhîti lui succéda à Monâït-Khoufoui, avec le titre de gouverneur ; mais, Nakhîti étant mort sans postérité, le roi Sanouasrît 1er voulut bien accorder à la soeur du jeune homme, Baqit, la qualité de princesse héritière. Baqit apporta le nome de Mihi en dot à Nouhri, qui était de la famille des barons de Khmounou, et doubla de la sorte la fortune de ce dernier. L'enfant qui naquit de leur union, Khnoumhotpou, fut nommé tout jeune gouverneur de Monâït-Khoufoui, titre qui paraît avoir appartenu dans la famille à l'héritier présomptif, comme plus tard sous la dix-neuvième dynastie le titre de prince de Koush appartenait à l'héritier présomptif de la couronne d'Égypte. Son mariage avec la dame Khiti, princesse héritière du dix-septième nome, rangea sous son autorité l'une des provinces les plus fertiles de l'Heptanomide. Sous son fils Nakhîti la maison atteignit l'apogée de la grandeur. Nakhîti, confirmé dans toutes ses dignités. prince du dix-septième nome des droits de sa mère, reçut de Sanouasrît II un grand gouvernement, qui renfermait quinze des nomes du midi, d'Aphroditopolis jusqu'aux frontières de Thèbes[345].
On voit par cet exemple avec quelle facilité les nomes, principautés héréditaires distribuées entre quelques familles illustres, passaient de l'une à l'autre par mariage ou par succession, à condition pour le nouveau titulaire de régulariser son acquisition et de se faire investir par le souverain régnant. Les devoirs de ces petits princes envers leur suzerain et leurs sujets étaient fort nettement définis ils devaient l'impôt et le service militaire à l'un, bonne et exacte justice aux autres. « J'ai suivi mon maître, lorsqu'il marcha pour battre les ennemis dans les contrées étrangères. J'ai marché en qualité de fils~d'un chef, de chambellan, de général de l'infanterie, de nomarque de Mihi. Je vins contre Koush, et en marchant je fus conduit jusqu'aux extrémités de la terre. Je conduisis les butins de mon maître, et ma louange atteignit le ciel. Quand Sa Majesté revint en paix, après avoir battu ses ennemis dans Koush la vile, je vins le servir devant lui. Pas un de mes soldats n'a déserté lorsque je convoyai les produits de mines d'or à la Sainteté du roi Sanouasrît 1er, vivant à toujours et à jamais. J'allai alors avec le prince héritier, fils aîné du roi de son flanc, Amoni v. s. f. ; j'allai avec quatre cents hommes tous choisis d’entre mes guerriers, je vins en paix, et aucun d'eux ne déserta quand je conduisis le produit des mines d'or. Mon entreprise me fit louer par les rois.[346] » - « Moi j'étais un maître de bonté, plein d'amabilité, un gouverneur qui aimait son pays… J'ai travaillé et le nome entier fut en pleine activité,. Jamais petit enfant ne fut affligé par moi, jamais veuve maltraitée par moi ; jamais je n'ai repoussé laboureur, jamais, je n'ai empêché pasteur. Jamais n'exista commandant de cinq hommes dont j’aie réquisitionné les hommes pour mes travaux. Jamais disette ne fut de mon temps, jamais affamé sous mon gouvernement, même dans les années de disette[347] ; car alors je labourai tous les terrains du nome de Mihi jusqu'à ses limites au sud et au nord ; je fis vivre ses habitants en leur répartissant ses productions, si bien qu'il n'y eût pas d'affamés en lui. J'ai donné également à la veuve et à la femme mariée, et je n'ai pas préféré le grand au petit dans ce que j'ai donné. Quand la crue du Nil était haute et que les propriétaires de champs ainsi que les propriétaires de toutes choses avaient bon espoir, je n'ai pas coupé les bras d'eau qui arrosent les champs.[348] »
Sous l'influence pacifique des barons locaux, la richesse, déjà générale même en temps de trouble, se développa d'une manière merveilleuse. Il faut avoir étudié, sur les murailles des tombeaux de Béni-Hassan ou sur les planches de Champollion, de Rosellini ou de Lepsius[349], les peintures où les artistes du temps ont représenté les différents métiers alors en usage, pour se faire une idée de l'activité avec laquelle tous les travaux utiles étaient poussés. C'est d'abord le labourage à farce de boeufs ou à bras d'hommes ; le semage, le foulage des terres par les béliers ; le hersage, la récolte et la mise en gerbes du lin et du blé, le battage, le mesurage, le transport au grenier à dos d'ânes ou par chalands ; la vendange, l'égrenage du raisin, la fabrication du vin dans deux pressoirs différents, la mise en amphores et l'aménagement des caves. D'autres tableaux montrent le sculpteur sur pierre et le sculpteur sur bois à leurs pièces ; des verriers soufflant des bouteilles, des potiers modelant leurs vases et les enfournant ; des cordonniers, des charpentiers, des menuisiers, des corroyeurs, des femmes au métier, tissant la toile sous la surveillance des eunuques, sans trêve ni relâche. Malgré les professions de charité que les nomarques étalaient sur leurs pierres funéraires, la condition de ces classes ouvrières était des plus dures. Sans cesse courbées sous le bâton du contremaître, il leur fallait peiner du matin au soir contre une maigre ration de vivres à peine suffisante pour leur nourriture et celle de leur famille. « J'ai vu le forgeron à ses travaux, - à la gueule du four, » disait un scribe du temps à son fils. « Ses doigts sont rugueux comme des objets en peau de crocodile, - il est puant plus qu'un oeuf de poisson. Tout artisan en métaux, - a-t-il plus de repos que le laboureur ? - Ses champs à lui, c'est du bois ; ses outils, du métal. - La nuit, quand il est censé être libre, - il travaille encore, après tout ce que ses bras ont déjà fait pendant le jour, - la nuit, il veille au flambeau.
« Le tailleur de pierre cherche du travail, - en toute espèce de pierres dures. - Lorsqu'il a fini les travaux de son métier, - et que ses bras sont usés, il se repose ; - comme il reste accroupi dès le lever du soleil, - ses genoux et son échine sont rompus. - Le barbier rase jusqu'à la nuit : - lorsqu'il se met à manger, alors seulement il se met sur son coud~ pour se reposer. - Il va de pâté de maisons en pâté de maisons pour chercher les pratiques ; - il se rompt les bras pour emplir son ventre, comme les abeilles qui mangent le produit de leurs labeurs. - Le batelier descend jusqu'à Natho pour gagner son salaire. Quand il a accumulé travail sur travail, qu'il a tué des oies et des flamants, qu'il a peiné sa peine, - à peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il à sa maison, qu'il lui faut s'en aller.
« Je te dirai comme le maçon - la maladie le goûte ; -car il est exposé aux rafales, - construisant péniblement, attaché aux chapiteaux en forme de lotus des maisons, - pour atteindre ses fins ? - Ses deux bras s'usent au travail, - ses vêtements sont en désordre ; - il se ronge lui-même, - ses doigts lui sont des pains ; - il ne se lave qu'une fois par jour. - Il se fait humble pour plaire : - c'est un pion qui passe dé case en case - de dix coudées sur six ; - c'est un pion qui passe de mois en mois sur les poutres d'un échafaudage, accroché aux chapiteaux en forme de lotus des maisons, - y faisant tous les travaux nécessaires. - Quand il a son pain, il rentre à la maison, et bat ses enfants…
« Le tisserand, dans l'intérieur des maisons, - est plus malheureux qu'une femme. - Ses genoux sont à la hauteur de son estomac ; il ne goûte pas l'air libre. - Si un seul jour il manque à fabriquer la quantité d'étoffe réglementaire, - il est lié comme le lotus des marais. C'est seulement en gagnant par des dons de pains les gardiens des portes, - qu'il parvient à voir la lumière du jour. - Le fabricant d'armes peine extrêmement - en parlant pour les pays étrangers - c'est une grande somme qu'il donne pour ses ânes, - c'est une grande somme qu'il donne pour les parquer, - lorsqu'il se met en chemin. - A peine arrive-t-il à son verger, - arrive-t-il à sa maison, le soir, - il lui faut s’en aller. - Le courrier, en partant pour les pays étrangers, - lègue ses biens à ses enfants, - par crainte des bêtes sauvages et des Asiatiques. - Que lui arrive-t-il quand il est en Egypte ? - A peine arrive-t-il à son verger. - arrive-t-il à sa maison - il lui faut s'en aller. - S'il part, sa misère lui pèse ; - s'il ne s'en va pas, il se réjouit. - Le teinturier, ses doigts puent - l'odeur des poissons pourris ; - ses deux yeux sont battus de fatigue ; - sa main n'arrête pas. - Il passe son temps à couper des haillons ; - c'est son horreur que les vêtements. - Le cordonnier est très malheureux ; il mendie éternellement ; - sa santé est celle d'un poisson crevé ; - il ronge le cuir pour se nourrir.[350] »
Les portraits ne sont pas flattés : s'il fallait les prendre au sérieux, on n'aurait rencontré que misère dans l'Égypte de la douzième dynastie. Aussi bien l'auteur à qui je les emprunte est-il un vieux scribe gourmé et tout infatué des avantages de sa profession, qui veut dégoûter son fils des métiers et l'encourage à suivre la carrière des lettres. « J'ai vu la violence, j'ai vu la violence ; - c'est pourquoi mets ton coeur après les lettres ! - J'ai contemplé les travaux manuels, - et en vérité il n'y a rien au delà des lettres. - Comme on fait dans l'eau, plonge-toi au sein du livre Qimi[351], - tu y trouveras ce précepte en propres termes : “Si le scribe va étudier au palais, - son inactivité corporelle ne sera point sur lui. - Lui, c'est un autre qui le rassasie ; - il ne remue pas, il se repose” ». – « J'ai vu les métiers figurés », y est-il dit en propres termes, - « aussi te fais-je aimer la littérature, ta mère ; je fais entrer ses beautés en ta face. - Elle est plus importante que tous les métiers, - elle n'est pas un vain mot sur cette terre ; - celui qui s'est mis à en tirer profit dés son enfance, il est honoré ; - on l'envoie remplir des missions. - Celui qui n’y va point reste dans la misère.[352] » - « Celui qui connaît les lettres - est meilleur que toi par cela seul. - Il n'en est pas de même des métiers que j'ai mis à ta face - le compagnon y méprise son compagnon. - On n'a jamais dit au scribe - Travaille pour un tel ; - ne transgresse pas tes ordres. - Certes, en te conduisant au - palais, certes, j'agis par amour pour toi ; - car, si tu as profité un seul jour dans l'école, - c'est pour l'éternité, les travaux qu'on y fait sont durables comme les montagnes. - Ce sont ceux-là, vite, vite, que je te fais connaître, que je te fais aimer, - car ils éloignent l'ennemi.[353] » L'étude des lettres sacrées et le rang de scribe menaient à tout ; le scribe pouvait devenir selon ses aptitudes et son adresse, prêtre, général, receveur des contributions, gouverneur des nomes, ingénieur, architecte. Aussi la science des lettres, considérée comme moyen de parvenir, était-elle fort en honneur à cette époque, et nous est-elle vantée dans un certain nombre de morceaux réputés classiques dans les siècles postérieurs. J'ai déjà eu plusieurs fois occasion de citer presque toutes les oeuvres qui nous restent de la douzième dynastie, le Conte de Sinouhit[354], les Instructions du roi Amenemhaît 1er à son fils Sanouasrît, les Recommandations du scribe Khatoui, fils de Douaouf, à son fils Pépi, et le bel Hymne au Nil du Musée britannique[355]. On jugera, par les extraits que j'en ai donnés, du mérite qu'elles pouvaient avoir aux yeux des Égyptiens.
Nous sommes encore mieux placés pour apprécier la perfection que les arts plastiques avaient atteinte. Sans doute nous ne pouvons nous figurer exactement ce qu'était un temple ou un palais ; le temps a balayé presque jusqu'aux débris des édifices immenses qui ornaient alors les villes royales de l'Égypte. Les portiques des tombes de Béni-Hassan nous autorisent cependant à affirmer que l'architecture avait dès lors produit des chefs-d'oeuvre. L'un d'eux est décoré de colonnes analogues aux colonnes doriques, et antérieures de deux mille ans pour le moins aux plus anciennes colonnes de cet ordre, qui aient été élevées en Grèce. La sculpture, bien qu'inférieure en certains points au grand art de l'Ancien Empire, nous a laissé tant de morceaux admirables, qu'on se demande où l'Égypte a pu enrôler assez d'artistes pour les exécuter. Les statues d'Amenemhaît 1er et de Sanouasrît 1er, que Mariette a découvertes à Tunis, sont presque aussi belles que la statue de Khephren. Elles inspiraient tant d'admiration aux Égyptiens eux-mêmes, que les Pharaons d'époque postérieure, Ramsès II et Mineptah, les ont usurpées[356]. Le colosse en granit rose dressé par Sanouasrît III devant une des portes des temples d'Osiris à Abydos, montre que les sculptures de la haute Égypte ne le cédaient en rien à celles du Delta[357]. Une école locale, dont le siège paraît avoir été Tanis, nous a légué des oeuvres d'un style particulier où Mariette voulut d'abord reconnaître les souverains Hyksôs, mais qui représentent en réalité Amenemhaît III. En général, le style de ces monuments est remarquable par une vigueur exagérée; les jambes sont traitées avec une liberté de ciseau surprenante. Tous les accessoires, dessin des ornements, gravure des hiéroglyphes, sont poussés à une finesse qu'ils ne retrouveront jamais plus. Les bas-reliefs, toujours dénués de perspective, sont, comme pendant la période memphite, d'une délicatesse extrême; on les habillait de couleurs vives, qui conservent encore aujourd'hui tout leur éclat premier. L'art de la douzième dynastie, examiné dans son en¬semble, était de bien peu inférieur à celui des dynasties précédentes. Les défauts qui plus tard arrêtèrent le progrès de la sculpture égyptienne, la convention dans le rendu des détails, la lourdeur des jointures, la raideur hiératique, se laissaient à peine sentir. Toutes les fois qu'au milieu de la décadence artistique une renaissance partielle s’annonçait, les sculpteurs de la dix-huitième et de la vingt-sixième dynastie allaient chercher leur modèle parmi les oeuvres de la douzième ou de la quatrième, et ils s'essayaient à en imiter le style.
De
la treizième à la quinzième dynastie.
L'Égypte était donc en pleine prospérité à la mort d'Amenemhaît III. La dynastie avait conquis la Nubie et recouvré la péninsule du Sinaï, assaini le sol, régularisé l'inondation, orné les villes principales de temples et de monuments, assuré la bonne administration et par sui le doublé la richesse du pays ; en un mot, elle avait terminé l'oeuvre de réparation que la onzième dynastie n'avait pu qu'ébaucher. C'est à ce moment qu'elle s'éteignit, après deux règnes insignifiants, ceux d'Amenemhaît IV et de sa soeur Sovkounofriou. Treize ans et quelques mois s’étaient à peine écoulés depuis la mort d'Amenemhaît III, quand le Thébain Sovkhotpou 1er Khoutoouïrî monta sur le trône et inaugura une dynastie nouvelle.
Elle dura, dit-on, quatre cent cinquante-trois ans et compta soixante rois, dont l'ordre de succession est encore incertain[358]. Pendant ce long intervalle de temps, la série dynastique, plusieurs fois interrompue par le manque de lignée mâle, se renoua sans secousse, grâce aux droits héréditaires que possédaient les princesses, et qu'elles transmettaient à leurs enfants. Sovkhotpou II Skhemouaztoouïrî, fils d'un simple prêtre, Montouhotpou, et d'une princesse royale, hérita de sa mère la couronne d'Égypte[359] ; Nofirhotpou II Khâsoshshourî, dont le père n'appartenait pas à la famille régnante, devint roi du chef de sa mère Kama[360]. Quoi qu'il en soit de ces interruptions dans la succession directe, l'examen des monuments nous enseigne que la treizième dynastie assura à l'Egypte entière quelques siècles de prospérité. Les Sovkhotpou et les Nofirhotpou qui se pressent sur ses listes, et dont les noms rappellent involontairement à l'esprit les dix-huit rois éthiopiens qui, au dire d'Hérodote, étaient bien antérieurs à Sabacon[361], surent conserver les conquêtes de leurs prédécesseurs et parfois même les étendre. Le vingt-quatrième ou vingt-cinquième d'entre eux, Sovkhotpou Khânofirri[362], pouvait encore ériger des colosses dans l'île d'Argo au fond de l'Éthiopie, à peu prés cinquante lieues au sud de Semnéh[363]. A l'intérieur, ils continuèrent les travaux d'hydrographie entrepris par les Sanouasrît et les Amenemhaît. L'un d'eux, Sovkhotpou Skemkhoutoouïri[364], faisait relever et inscrire à l'observatoire de Semnéh les hauteurs de la crue du Nil pour les quatre premières années de son règne[365]. Ils mirent tous leurs soins à l'embellissement des grandes villes de l'Egypte, et ils exécutèrent des travaux à Thèbes dans le grand temple d'Amon[366], à Bubaste, dans le Delta, où fut trouvée, dit-on, la belle statue de Sovkhotpou Khânofirri, aujourd'hui conservée au Louvre[367], à Tanis, où ils semblent avoir eu l'une de leurs résidences favorites[368]. Le sanctuaire d'Abydos fut de leur part l'objet d'une vénération particulière. Le roi Nofirhotpou Khâsoshshourî lui concéda des dons considérables[369], le roi Rânouzir Rànmàtan le restaura et le décora à neuf par l'entremise d'un de ses officiers[370], Sovkoumsaouf Skhemouazkourî y consacra sa statue[371], et les particuliers, suivant l'exemple du maître, prodiguèrent les faveurs de tout genre au temple d'Osiris. Le style des oeuvres de cette époque est déjà inférieur à celui des oeuvres de la douzième dynastie les proportions de la figure humaine commencent à s'altérer, le modelé des membres à perdre de sa vigueur et de son fini. Malgré ces défauts, souvent peu apparents, la plupart des statues royales jusqu'à présent connues sont d'une beauté que l'art des époques postérieures a rarement égalée. Il suffit d'examiner avec soin l'un de ces morceaux et de se rappeler qu'on en rencontre de semblables tout le long de la vallée du Nil, depuis la troisième cataracte jusqu'à l'embouchure du fleuve, pour rester convaincu que l'Égypte était alors une grande puissance, réunie sous un seul sceptre et non pas, comme le voudraient certains auteurs, un État divisé en deux royaumes indépendants l'un de l'autre[372], ou possédé militairement par les rois pasteurs établis dans le Delta[373]. Les dernières années de la treizième dynastie furent-elles aussi heureuses que les premières ? On ne saurait le dire dans l'état actuel de la science. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que les monuments en sont rares, et qu'ils ne présentent pas le même mérite que ceux des souverains du début. Les listes de Manéthon enregistrent un fait certain vers cette époque, le centre de la puissance égyptienne se déplaça. La prépondérance que Thèbes avait maintenue pendant sept cents ans et plus sur le reste des cités lui échappa et dévolut aux populations du Delta. Les Pharaons de la douzième et surtout ceux de la treizième dynastie avaient préparé ce résultat en favorisant le nord, Mendès, Saïs, Bubaste, Tanis surtout, au détriment du midi. Quand ils disparurent, Thèbes perdit son rang de capitale, et ce fut ~ne ville de la Basse Égypte, ce fut Xoïs, qui lui succéda. Le Delta avait profité des travaux exécutés naguères par les Thébains autant, sinon plus, que la vallée proprement dite : ses marais s'étaient colmatés, ses campagnes assainies, ses canaux régularisés et le commerce avec l'Asie y apportait mie richesse sans cesse croissante. Xoïs, située au centre même de la plaine, entre les branches phatmétique et sébennytique du Nil[374], n'avait jusqu'alors joué qu'un rôle des plus effacés : elle sembla avoir gagné plus que les autres à la prospérité générale. La quatorzième dynastie, sortie de ses murs, compta, dit-on, soixante-quinze rois, qui dominèrent quatre cent quatre-vingt-quatre ans. Leurs noms mutilés se pressaient en colonnes sur les pages du Papyrus royal de Turin, et les chiffres qui désignent la longueur de leur règne sont souvent assez bas, deux ans, un an, trois ans : on voit qu'ils se sont succédé sur le trône très rapidement, mais leur histoire est inconnue. Tout au plus pourrait-on supposer que les derniers d'entre eux furent assaillis par des révolutions et par des guerres civiles qui amenèrent leur chute[375].
[1] Hérodote, II, vii, qui l'emprunta probablement à Hécatée de Milet.
[2]
Obsurn, The Monumental History of Egypt, t. I. p. 9-14.
[3] Ainsi dans le Conte des Deux frères, où il est toujours appelé iaumâ, iôm, la mer.
[4] Hérodote, II, xxviii.
[5] Quatremère, Mémoires géographiques sur L'Égypte et sur quelques contrées voisines, t. II, p. 484-482, d'après Macoudi.
[6] Cf. le conte découvert en 1880 par M. Golénischen ; Maspero, les Contes populaires de l'Égypte ancienne, p. LXX-LXXIX, p. 457-448.
[7] Hérodote, II, xvii.
[8] Hérodote, II, xvii ; Skylax, Peripl., § 106 ; Strabon, XVII.
[9] Pline, Hist., nat., V. 40.
[10] Hérodote, II, iv.
[11] Diodore, I, 34.
[12] Sur une troisième espèce fort rare, mentionnée dans quelques documents, cf. Loret, Recueil de travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes, t. III, p. 21 sqq.
[13] Hérodote, II, xcii.
[14] Diodore, I, 34.
[15] Hérodote, II, xxxvi.
[16] Papyrus Anastasi IV, pl. XIV, l. 1.
[17] Hérodote, II, xxxvi.
[18] Strabon, 1. XVII, 4. Le Musée du Caire possède un véritable herbier égyptien antique, fait par M. Schweinfurth avec les fleurs, les graines et les tiges découvertes dans les tombeaux. Cf. Schweinfurth, la Flore de l'ancienne Égypte, dans le Bulletin de l'Institut égyptien, 1882, et la Revue scientifique, n° du 21juillet 1885.
[19] Fr. Lenormant, Sur l'antiquité de l’Ane et du Cheval, p. 2 ; Lefébure, Sur l'ancienneté du Cheval en Égypte, dans l'Annuaire de la Faculté des Lettres de Lyon, 2e année, p. I-II, admet que le cheval était connu en Égypte sous la XIIe dynastie et très probablement aux temps antérieurs. Le chameau semble n'avoir été introduit que vers l'époque romaine.
[20] Fr. Lenormant. Sur les animaux employés par les anciens Égyptiens à la chasse et à la guerre, p. 2-5.
[21] Fr. Lenormant, Sur l'antiquité de l'Ane et du Cheval, p. 2.
[22] Fr. Lenormant, Notes d'un voyage en Égypte, p. 17.
[23]
Hartmann, Zeitschrift für Ægyptische
Sprache, 1864-1865.
[24] C'était un des devoirs des rois de poursuivre et de détruire les animaux féroces. Un fait montrera quelle conscience ils mettaient à s'en acquitter : Aménôthès III tua deux cents lions dans les dix premières années de son règne.
[25] Mariette, Itinéraire des Invités, p. 175. La prédiction de Mariette s’est complètement réalisée : il n'y a plus aujourd'hui de crocodiles au nord d'Assouan.
[26] Brugsch, Ægyptische Gräberwelt, p. 14, affirme que le poulet était inconnu aux anciennes époques. Cependant deux poulets sont représentés à Béni-Hassan (Champollion, Notices, t. II. p. 587).
[27] Papyrus Anastasi III, pl. II, 1. 6-7. Cf. Maspero, Du Genre épistolaire, p. 104 sqq.
[28] Papyrus Sallier II, pl. XI, 1. 6.
[29] Diodore de Sicile, I, III, c. 8.
[30] Genèse, ch. X, v. 3-6.
[31] E. de Rougé, Recherches sur les monuments qu’on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon, p. 4-8 ; Ebers, Ægypten und die Bücher Moses, p. 54 sqq.
[32] Pline, H. N., I. VI, c. XXIX.
[33] L'une des plus belles statues en bois du Musée du Caire a été nommée le Sheikh-el-Beled, parce qu'elle est trait pour trait l'image du Sheikh-el-Beled de Saqqarah au moment de la découverte. On trouvera reproduits dans O. Hayet, les Monuments de l'art antique, t. I, quelques-uns des monuments où le type égyptien est le mieux caractérisé.
[34] C'est l'opinion à laquelle la plupart des Égyptologues contemporains, Brugsch, Ebers, Lauth, Lieblein, Erman, Sethe, Steindorff, se sont ralliés à la suite d'E. de Rougé, Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties, p. 1-11. L'assyriologue Hommel a poussé cette thèse à l'extrême, et il a soutenu, dans son mémoire sur der Babylonische Ursprung der Ægyptischen Kultur, 1892, que l'ensemble de la civilisation et de la religion égyptiennes dérive de la civilisation et des cultes chaldéens, notamment des cultes d'Éridou.
[35]
1. E. de Rougé, Recherches,
p. 4, Brugsch,
Geschichte Ægyptens,
p. 8; Wiedemann, Ægyptische Geschichte, p. 21 sqq.
[36] Ebers, Ægypten und die Bücher Moses, p. 41; Dümichen, Geschichte des Alten Ægyptens, p. 118, 119; Brugsch, Ægyptische Beiträge, dans la Deutsche Revue, 1881, p. 41. Des systèmes plus compliqués, et qu'on peut laisser de côté pour le moment, ont été proposés par Lieblein et par Petrie.
[37] C'est la théorie que préfèrent les naturalistes et les anthropologistes, tels que Hartmann, Morton, Hamy, et qui a été développée récemment par Sergi, fort en détail.
[38] Lortet, la Faune momifiée de l'Ancienne Égypte, p. 70-71.
[39]
Lepsius, Ueber die Annahme, dans
la Zeitschrift, 1870, p. 90
sqq.
[40] C'est l'opinion que j'ai soutenue, ainsi que Rochemonteix, et que je me réserve de développer ailleurs.
[41] Benfey, Ueber das Verhältniss der Ægyptischen Sprachen zum semitischen Spraehstamm, Leipzig, 1844 ; cette théorie a été reprise par Erman et par ses élèves principaux, Steindorff et Sethe, pour lesquels l'égyptien n'est qu'une langue sémitique usée et déformée en bien des endroits par une longue pratique.
[42] Maspero, Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, t. II, p. 4-8.
[43]
E. de Rougé, Recherches,
p. 5. cf. Hommel, Die
Semitischen Völker und Sprachen, t. I, p. 94 sqq., 439 sqq.
[44] Cette restitution de la plus ancienne civilisation connue résulte en partie de l'étude faite par Maspero des hiéroglyphes et des coutumes de l'Égypte pharaonique, en partie des fouilles exécutées depuis une dizaine d'années dans les cimetières préhistoriques du pays. On trouvera tous les renseignements désirables sur ce point dans les deux ouvrages de M. Morgan, L'âge de la pierre en Égypte, et Ethnographie préhistorique.
[45] Lepsius, Denkm., III, 5 a ; Dümichen, Bauurkunde der Tempelanlagen Von Denderah, pl. XVI ; cf. E. de Rougé, Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon, p. 42, note 4, p. 465 sqq.
[46]
Brugsch, Geographische Inschriften,
t. I, p. 95 sqq.
[47] Jacques de Rougé, Textes géographiques du temple d'Edfou, p. 29.
[48] Lepsius, Denkmæler, II, pl. 124-125. Cf. Brugsch, G. Inschriften, t. I, p. 111-116 ; Maspero, Une Enquête judiciaire à Thèbes, p. 9, note I.
[49] Diodore, I, 44 ; Strabon, 1. XVII, c. i. - Pline (H. N., V, 9,9) en mentionne quarante-trois, et Ptolémée (IV, 5) quarante-sept.
[50]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
99
[51]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
178.
[52]
Ibid.,
L. I, p. 176.
[53]
Strabon, I,
XVII, c. i.
[54]
Brugsch, G.
Inschr.,
t. I, p. 193-195
[55]
Strabon, I,
XVII, c. i.
[56] Corpus inscr. græc., n° 4925.
[57] Sept de ces nomes, détachés de la Haute Égypte et réunis en un seul gouvernement, formèrent, à l'époque romaine, la province d'Heptanomide.
[58] Hérodote, I. II, c. xci.
[59] Jacques de Rougé, Revue archéologique, juillet 1870, p. 5-6.
[60] Ibid., p 1 sqq.
[61]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
217-219.
[62] Jacques de Bougé, p. 42-15.
[63] Brugsch, Dict. géog., p. 749.
[64] Jacques de Rougé, Revue archéologique, février 1872, p. 68 sqq.
[65] Jacques de Rougé, I. I., p. 76.
[66] Id., p. 76-80.
[67]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
85.
[68]
Hérodote, III, xci :
.. ¢n
tÒ leuxÒ teÛxeâ tÒ ¢n M¡mfi.
Cf. Brugsch, Zeitschrift für Ægyptische
Sprache, année 1865, p. 9
[69] Aballatif (traduction de Sacy), II. c. iv.
[70]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
243-244.
[71] Diodore de Sicile, I. I, c. lvi ; Strabon, I. XVII, c. i. Cf. sur Taroiou, Brugsch, Zeitschr., 1867, p. 89-95.
[72] Brugsch, Zeitschrift, 1871, p. 11-13.
[73] Les identifications proposées par M. Brugsch, dans son Dictionnaire géographique, pour cette ville et pour les villes voisines, ont été assez fortement compromises par les fouilles que MM. Naville et Petrie ont exécutées à Tell-el-Maskhouta de 1885 à 1890. La géographie de l'Égypte ancienne a été traitée de main de maître par J. Dümichen dans le tome I de sa Geschichte des alten Ægyptens (1880-1881) et par J. de Rougé.
[74]
Lepage-Renouf, Lectures
on the Origin and Growth of Religion as illustrated by the Religion 0f
Ancient Egypt, Londres,
1880, p. 99.
[75] Maspero, dans la Revue de l'Histoire des Religions, 1880, p. 125-126.
[76] Dr Parrot, Sur l'origine de l'une des formes du dieu Phtah, dans le Recueil de Travaux, t. II, p. 129-155.
[77] Maspero, dans la Revue de l'Histoire des Religions, 1880, t. I, p. 121.
[78] Maspero, Notes sur quelques points de Grammaire et d'Histoire dans le Recueil de Travaux, t. Il, p. 115. Voir la liste des animaux sacrés dans Parthey, De Iside et Osiride, p. 260 sqq., et Erdkunde des Alten Ægyptens, pl. XVI.
[79] Le premier auteur qui ait mis en lumière le côté fétichiste de la religion égyptienne est M. Pietschmann, der Ægyptische Fetischdienst und Götterglaube, dans la Zeitschrift für Ethnologie, 1878, p. 155 sqq.
[80] Hérodote, II, LXIX.
[81]
Strabon, I.
XVII, ch. i.
[82] Diodore, I, 84.
[83] Diodore, I, 83.
[84] Hérodote, II, lxxiii.
[85] De Iside, c. xx ; Strabon, I. XVII, c. i.
[86] Hérodote, III, xxviii. Cf. Pomponius Mela, I, 9 ; Pline, H. N. VIII, xlvi.
[87] Mariette, Renseignements sur les Apis, dans le Bulletin archéologique de l'Athenæum français, 1855, p. 54.
[88] Pline, H. N., VIII, ch. iv, 6.
[89] Auguste Mariette, Renseignements, dans le Bulletin archéologique, 1855, p. 94-100.
[90] Le dernier Hapi dont on connaisse l'existence d'une manière certaine est celui qui fut inauguré sous Julien, en 562 (Ammien, I. XXII, xiv, 6).
[91] Cf. pour tout ce qui se rapporte à la tombe d'Apis, Manette, le Serapeum de Memphis, t. I, Paris, 1882, in-4°.
[92] Voici le nom de ces dieux-rois, sous la forme grecque : …Hfaistow, …Hliow, SÇw, Krñnow, …Osiriw, TufÇn, ŠYrow. Les lettres v. s. f. sont l'abréviation de la formule vie, santé, force, qui accompagne les noms royaux dans les textes égyptiens.
[93] Naville, la Destruction des hommes par les dieux, dans les Transactions of the Society of Biblical Archœology, vol. IV, 1875, p. 1-19.
[94] Osiris a été étudié plus particulièrement par M. Lefébure, le Mythe Osirien ; t. I : les Yeux d'Horus, in-4°, Paris, 1874 ; t. II : Osiris, in-4°, Paris, 1875. Sit a fourni un sujet de thèse à M. Ed. Meyer, Set-Typhon, in-8°, Leipzig, 1875.
[95] Maspero, Études égyptiennes, t. I, p. 191-192.
[96] Todlb., ch. cxxv.
[97] Todlb., ch. xxx, 1.1 sqq. « Ô coeur, mon coeur qui me vient de ma mère, mon coeur de quand j'étais sur terre, ne te dresse pas comme témoin ; ne lutte pas contre moi en chef divin, ne me charge point devant le dieu grand ! »
[98] Celles de l’Epervier d'or (Todlb., ch. lxxvii), du Lotus (ch. lxxxi), du Phénix (ch. lxxxiii), de la Grue (ch. cxxxiv), de l'Hirondelle (ch. lxxxvi), de la Vipère (ch. cxxxii). L'assomption de toutes ces formes est volontaire et ne prouve pas le passage de l'âme humaine dans un corps de bête. Chacune d'elles était une des figures de la divinité ; l'entrée de l'âme en elles marquait seulement l'assimilation de l'homme au type divin que chacune représentait.
[99] Dans les vignettes des Papyrus funéraires, le mauvais principe est figuré par le Crocodile (ch. xxxi, xxxii), la Tortue (ch. xxxvi) et diverses espèces de serpents (ch. xxxiii, xxxv, xxxvii, xli).
[100] A partir de la XIIe dynastie, le défunt est nommé couramment l'Osiris N. Aux époques antérieures, ce titre est joint rarement à son nom, mais l'ensemble des textes connus jusqu'à présent prouve que l'identification était complète entre le mort et le dieu.
[101] Todlb., ch. lxxiv-lxxv.
[102] Id., ch. cx-cxlvi.
[103]
Lepsius, Denkm.,
pl. II, 43 et 81.
[104] Revue critique, 1872, t. II, p. 538-548.
[105] Une date de l'an 400 du règne de Sit, roi d'Égypte, se trouve sur un monument de Ramsès II, découvert à Tanis par M. Mariette (Maspero, Revue critique, 1880, t. I, p. 467).
[106]
Naville, le Mythe
d'Horus, 1870, Genève,
in-folio ; Brugsch, Die
Sage Von der geflügelten Sonnenseheibe, Göttingen, 1870, in-4°.
[107] Goodwin, dans Chabas, Mélanges égyptologiques, IIIe série, t. I, p. 246-280.
[108] Sur la vocalisation de ce nom et des noms égyptiens en général, voir Maspero, Réponse à la lettre de M. Edouard Naville, dans la Zeitschrift, 1885, p. 110-123.
[109] Des fouilles exécutées en 1883-1884 me portent à croire que Thini est, ou bien la ville même de Girgéh, ou bien le village de Birbéh situé un peu au nord-ouest de Girgéh, sur la rive gauche du Nil.
[110] Revue Critique, 1875, t. I, p. 82-85
[111] Diodore (1, 50) attribue la fondation de Memphis à un autre Pharaon, qu'il nomme Ouchoreus.
[112] Hérodote, II, xcix.
[113] Ibid.
[114] Diodore, I, 94, qui en cet endroit donne à Ménès le nom de Mnévis ; d'après Elien, Hist. Anim., XI, 10, il aurait institué le culte d'Hapi.
[115] Manéthon, édit. Unger, p. 78.
[116] Hérodote, II, lxxix. Cf. sur le Manéros, Hésychius, s. v. Man¡rvw, Suidas, s. vv. Man¡rvw et Peri manÅw.
[117] Diodore, I, 45.
[118] Diodore, I, 45 ; De Iside et Osiride, § 8, où Tafnakhiti et son fils sont appelés Tn¡faxyow ou T¡xnatiw et Bñaxoriw.
[119] Stèle d'Ounnofri au Louvre, Salle historique, 421. Cf. E. de Rougé, Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon, p. 50-51.
[120] Élien, H. Anim., XI, 40, qui donne au fils de Ménès le nom d'OÞnÛw.
[121] Manéthon, édit. Unger, p. 79.
[122] Id., p. 78. 2° Manéthon, éd. Unger, p. 78-81.
[123] Id., p. 79; Brugsch, G. Inschr. I, p. 124, 240 ; Mariette, Histoire d'Égypte, 2° édit., p. 134, qui croit devoir reconnaître dans la pyramide à degrés la pyramide d'Ouénéphès.
[124] Manéthon, édit. Unger, p. 78.
[125]
Goodwin dans
la Zeitschrift, 1867, p. 55-56.
[126] Papyrus Médical, édit. Brugsch, pl. XV, I. 1-2 ; Papyrus Ebers, pl. CIII, I. 1-2.
[127] Manéthon, édit. Unger, p. 84 ; E de Rougé, Recherches sur les monuments, p. 20-21.
[128] Manéthon et de Rougé, loc. cit.
[129] Manéthon, édit. Unger, p. 84.
[130] Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, p. 18.
[131] E. de Rougé, Notice des principaux monuments, 1855, p. 50-7.
[132] Le mérite d'avoir découvert et reconnu le premier les monuments thinites revient à Amélineau, qui a fouillé la nécropole d'Abydos quatre années de suite, de 1895 à 1899. Il en a publié les résultats dans trois volumes intitulés Les nouvelles fouilles d’Abydos, 1897-1902 et le Tombeau d’Osiris, 1899. Morgan découvrit, en 1896, le tombeau de Ménès à Neggadéh et le publia dans ses Recherches sur les origines, t. II. Les fouilles de Quibell à Kom el Ahmar, celles de Petrie à Abydos sur le champ déjà exploité par Amélineau, celles de Maspero à Sakkarah ont augmenté le nombre des rois connus : Petrie a essayé de les classer dans ses Royal Tombs of the First Dynasty, t. I et II, mais sans grand succès.
[133]
Sethe, die älteste geschichtliche
Denkmater der Æqypter, dans
la Zeitschrift, 1897, p. 1-6.
[134] Voici, restitué aussi complètement qu'on peut le faire en ce moment, le tableau de ces deux premières dynasties à demi légendaires :
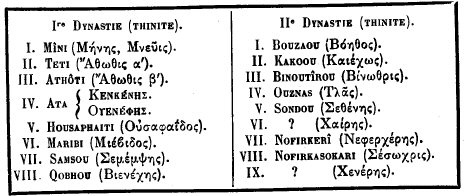
Cf. Mariette, la Table de Saqqarah et la Nouvelle Table d'Abydos.
[135] Manéthon, édit. Unger, p. 86-87.
[136]
Id., p. 87; cf. Sethe, Imouthes,
1902.
[137] Quibell, Hieracônpolis, t. I, pl. II.
[138] Mariette, Sur les tombes de L'Ancien Empire, p. 2-5.
[139] Maspero, Études Égyptiennes, t, I. p. 121-128
[140]
Maspero, Egyptian
Documents relating to the Dead, dans
les Transactions of the Society of
Biblical Archœology, t. VII, p. 6-36.
[141] Mariette, Sur les tombes de l'Ancien Empire, p. 17-22 ; Brugsch, Die Ægyptiche Gräberwelt, p. 15-26.
[142] Maspero, Études égyptiennes, t. I, p. 191-194.
[143] Mariette, Sur les tombes de l'Ancien Empire, p. 8-9.
[144] Cf. la statue du nain Khnoumhotpou au Musée du Caire (Maspero dans O. Rayet, les Monuments de l'art antique, t. I).
[145] Maspero, Guide du Visiteur au Musée de Boulak, p. 214-216, d'où cette théorie s'est répandue dans les oeuvres d'autres savants.
[146] Mariette, Notice des principaux monuments, p. 54-56 ; Sur quelques tombes de l'Ancien Empire, p. 9-10.
[147] La pyramide n'est à proprement parler que la forme régularisée du tumulus. Sur le sens mystique que les Égyptiens attachaient à cette classe de monuments, voir Schiaparelli, Il Significato simbolico delle Piramidi Egiziane, in-4°, Rome, 1884.
[148] Papyrus Prisse, pl. II, I, 7, 8.
[149] E. de Rougé, Recherches sur les monuments, etc., p. 28-41. Snofroui figure dans un conte trouvé à Saint-Pétersbourg par M. Golénischeff (Zeitschrift, 1876, p. 107-111).
[150] Lepsius, Denkm., II, 2.
[151] « L'Ouadi de Snofroui ».
[152] Chabas, les Papyrus de Berlin, p. 91 ; E. de Rougé, Recherches, p. 90.
[153] E. de Rougé, Recherches, p. 41. Les fouilles de ces dernières années paraissent démontrer que ce roi eut une pyramide à Dahshour, et une autre à Méidouin : il y a là un problème qui n'est pas résolu encore.
[154]
Osburn, The Monumental history of
Egypt, t. I, p. 270-271.
[155] Hérodote, II, cxxiv.
[156] Ibid., cxxv.
[157] Ibid., cxxvi. Cf. Maspero, Fragment d'un commentaire sur le second livre d'Hérodote, 1875, p. 4-7.
[158] Manéthon, édit. Unger, p 91. Parmi les écrits alchimistes s'en trouve un attribué à Sophé l'Égyptien ; c'est celui-la probablement que l'on vendait sous le nom de Souphis-Kheops, au temps de l'Africain.
[159] Hérodote, II, cxxvii-cxxviii.
[160] Diodore de Sicile, I, 64.
[161] Hérodote, II, cliii.
[162] Hérodote, II, cxxix-cxxxiii.
[163] E. de Rougé, Recherches, p. 52-54. M. de Rougé lisait le nom Râ-tot-ef et identifiait le prince avec le Ratoisès de Manéthon, cinquième roi de la quatrième dynastie. Mais l'analogie des autres noms force à lire Didoufri, comme on dit Menkaourî, et non pas Râ-men-kaou. La pyramide de Didoufri a été découverte à Abou-Roache, en 1901, par M. Chassinat.
[164] E. de Rougé, Recherches, p 54.
[165] Ibid., p 62.
[166] Le ciel, comme au premier chapitre de la Genèse.
[167] Mariette, Notices des principaux monuments, 2° édit., p. 207-209, et Monuments divers, pl. 55. Cf. E. de Rougé, Recherches, p. 46-50.
[168]
Dümichen, Bauurkunde, pl. xvi,
a, b.
[169] Maspero, Fragment de commentaire dans l'Annuaire de l'Association pour l'encouragement des Etudes grecques, 1875 et 1878 ; les Contes populaires de l'Ancienne Egypte, p. xx sqq.
[170] Lepsius, Denkm., II, pl. 2.
[171]
Osburn, The Monumental History 0f
Egypt, t. I, p. 275-276.
[172] Diodore, I, 64.
[173] Mariette, Lettre à M. le vicomte de Rougé, p. 7.
[174]
Todtb., cxiv, 30-52 ;
Birch, On formulas relating to the
heart, dans
la Zeitschrift,
1867, p. 54-55.
[175]
Birch, Medical Papyrus with the
name of Cheops, dans
la Zeitschrift,
1871, p. 61-64.
[176] Papyrus Anastasi, I, pl. X, I. 8, pl. XI, I. 4.
[177] Vyse, Pyramids of Gizeh, t. II, p. 80 sqq. ; Ch. Lenormant, Éclaircissements sur le cercueil de Mycérinus ; J. de Rougé, Recherches sur les monuments, p. 65-66.
[178] Hérodote, II, cxxxvi.
[179] Diodore, I, 94.
[180] Hérodote, II, cxxxvi.
[181] Stèles de Sahoun (Lepsius, Denkm., II, pl. 39 a), d'Ousirniri Anou (Lepsius, Denkm., II, pl. 152 a), de Dadkerî (Lepsius, Denkm., II, pl. 39 d ; Birch, dans la Zeitschrift, 1869, p. 26 ; Ebers, Durch Gozen zum Sinaï, p. 556), de Mnekaouhorou (Lepsius, Denkm., II, 39 a) ; dans l'Ouadi-Magharah, commémorant les victoires de ces princes sur les Bédouins (Mentiou).
[182] Ce fait nous a été révélé incidemment par un passage de la grande inscription de Hirkhouf, qui place l'événement sous le règne d'Assi.
[183] Les pyramides d'Abousir ont servi de tombeaux à plusieurs des Pharaons de la ve dynastie, à Sahourî, à Ousirniri Anou. Je pense que la pyramide n° 2 de Saqqarah (plan de Perring) a été construite par Assi. La pyramide d'Ounas a été découverte en 1881 (cf. Maspero, la Pyramide du roi Ounas dans le Recueil des Travaux, t. III).
[184] Ainsi Pasahouri, près d'Esnéh (Dümichen, Geschichte des Alten Ægyptens, t. I, p. 61), construite par Sahourî (E. de Rougé, Recherches, p. 93).
[185] Voici, restitué aussi complètement qu'on peut le faire en ce moment, le tableau des troisième, quatrième et cinquième dynasties :

[186] Lepsius, Denkm., II, 50.
[187] Un fragment de conte (Pap. de Berlin, III) pourrait bien remonter jusqu’à la Ve dynastie. Cf. Maspero, Études égyptiennes, t. 1, p. 73-80.
[188] E. de Rougé, Recherches, p. 75.
[189] E. de Rougé, Recherches sur le nom égyptien des planètes, dans le Bulletin archéologique de l'Athenœum français, 1846, p. 48-21, 25-28.
[190] Papyrus de Berlin, n° VIII, I. 56.
[191] Le dernier et de beaucoup le meilleur travail sur la matière est dû à Henri Brugsch, Thesaurus Inscriptionum Ægyptiacarum, t. I ; Astronomische und Astrologische Inschriften in-4°, 1882.
[192] De Iside et Osiride, C. xxii.
[193]
Il a été publié
par M. A. Eisenlohr, Ein
mathematisches Handbuch der Allen Ægypter (Papyrus
Rhind des British Museum), 1877.
[194]
G. Ebers, Papyrus Ebers, das
Hermetische Buck über Arzneimittel der allen Ægypter, Leipzig, 1875.
[195] Brugsch, dans le Recueil de Monuments égyptiens, t. II, p. 401-120, et pl. lxxxv-cvii ; Chabas, Mélanges égyptologiques, 4° série, p. 51-79.
[196] Galien, De compos. medic. sec. gen., I. V, c. 11. Quelques-uns de ces remèdes sont entrés par cette voie dans notre pharmacopée.
[197] Hérodote, II, lxxxii.
[198]
Ibid.,
lxxxiv.
[199] Diodore de Sicile, I, 82.
[200] Papyrus Ebers, pl. XCIX, I. 4. c., 1.44 ; Papyrus Médical de Berlin, pl. XV, 1.5 ; pl. XVI, 1.5. Cf. Chabas, Mél. égyp., I, p. 63-64.
[201] Pœmander (édit. Parthey), X.
[202] Papyrus de Berlin, pl. XIII, 1.5-6 ; cf. Brugsch, I. I., p. 122-115
[203] Papyrus Ebers, pl. LXVIII, 1.22 ; pl. LXIX, 1.2.
[204] Pour plus de détails sur la médecine égyptienne, cf. Maspero, dans la Revue critique, 1876, I. I, p. 233-239.
[205] Papyrus de Leyde, I, 548, verso ; pl. XIII, I. 5-6. Cf. Pleyte, Etudes égyptologiques, t. I, p. 145-146.
[206]
Id.,
pl. IV, 1. 9-40. Cf. Pleyte,
Etudes, t. I. p. 61-62.
[207] Lepsius, Denkm., VI, pl. 111-112
[208] Ce papyrus a été publié à Paris, en 1847, chez Franck, in-folio ; il a été analysé par Chabas, dans la Revue archéologique, 1ère série, t. XIV, p. 1 sqq., puis traduit en anglais par Heath, A Record of the Patriarchal Age or the Proverbs of Aphobis, in-12, Londres, 1856, en allemand par Lauth, en français par Philippe Virey, dont la traduction a été traduite en anglais.
[209] Papyrus Prisse, I. IV, I. 1 pl. V, 1. 7
[210] Papyrus Prisse, pl. X, I. 9-10
[211] Manéthon, édit. Unger, p. 401.
[212] Manéthon, édit. Unger, p. 101-102 ; d'après Lepsius, le texte de Manéthon serait erroné et il faudrait transporter la mention d'Eléphantine de la Ve dynastie à la VIe.
[213]
Lepsius, Denkm.,
II, pl. 116 a.
[214] Cf. Maspero, les Monuments égyptiens de la vallée de Hammamât, dans la Revue orientale et américaine, L. I, p. 550 sqq.
[215]
Lepsius, Denkm.,
II, pl. 112 d. e.
[216] Dümichen, Bauurkunde der Tempelanlagen von Dendérah, pl. XIV, 1.20 ; Mariette, Dendérah, t. III, pl. 71-72.
[217] Sur un bloc trouvé à Tanis ; cf. E. de Rougé, Inscriptions recueillies en Égypte, t. I, pl. LXXV.
[218]
Lepsius, Nubische Grammatik.
Einleitung, p. lxxxvi-lxxxvii.
[219]
Ce sont les peuples situés au sud et à l'est de l'Égypte, entre le Nil
et la mer Rouge. Cf.
Brugsch, Die Negerstämme der Una
Inschrift, dans la Zeitschrift,
1882, p. 30-36.
[220] Sur ce nom et sa lecture, cf. Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans la Zeitschrift, 1885, p. 64 ; le pays était situé probablement dans la Syrie méridionale.
[221] Sa momie, qui est conservée aujourd'hui au Musée du Caire, a encore la longue tresse de cheveux que portaient les jeunes gens (Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, p. 397, n° 106).
[222] Abhaît est le canton situé vis-à-vis de Sehel, dans la première cataracte.
[223] Champollion, Monuments de l’Égypte, t. I, p. 214 ; Sayce, Gleanings, dans le Recueil de Travaux, t. XV, p. 147-148.
[224] E. de Rougé, Recherches sur les Monuments, p. 80 sqq. ; Erman, Commenter zur Inschrift des Una, dans la Zeitschrift, 1882, p. 1-29.
[225] Lepsius, Denkm., II, 116 a.
[226] Pour l'histoire de Hirkhouf, voir Schiaparelli, Una tomba Egizio inedita della VIa dinastia, et les deux articles d'Erman (Deutsch Morgenl. Gesells. t. XLVI, p. 574-579), et de Maspero (Revue Critique, 1892, t. II, p. 357-366).
[227] Hérodote, II, c.
[228]
Vyse, Pyramids of Gizeh, p. 79
sqq.
[229]
Strabon, I, XV,
c. i. Cf. Hérodote,
II, cxxxiv-cxxxv.
[230] L'Égypte de Murtadi, fils du Gaphiphe, de la traduction de M. Pierre Watier. A Paris, MDCLXVI, p. 65.
[231] Brugsch, Zwei Pyramiden mit Inschriften ans den Zeiteu der VI Dynastie, dans la Zeitschrift, 1881, p. 1-15 Les textes en ont été publiés par Maspero de 1884 à 1889.
[232] Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, p. 397, n° 406.
[233] Littér. : la demeure de l'enfant royal.
[234] Isaïe, XXX, 4 ; Champollion, l'Égypte sous les Pharaons, t. I, p. 309-310.
[235] Manéthon, éd. Unger, p. 107.
[236] Il y a été trouvé par Sayce, the Academy, 1892, t. I. p. 332.
[237] Golénischeff, le Papyrus n° 4 de Saint-Pétersbourg, dans la Zeitschrift, 1870, p. 409.
[238] J'ai adopté pour la IXe dynastie le chiffre de cent dix-neuf ans, proposé par Lepsius (Königsbuch, p. 56-57) la dynastie compta probablement quatre ou cinq rois au plus, dont trois au moins sont inscrits sur les fragments du Papyrus de Turin.
[239] L'histoire des princes de Siout se déduit aisément des inscriptions de leurs tombeaux, qui ont été publiées par Griffith, the Inscriptions of Siut ; cf. Maspero, Revue Critique, 1889, t. II, p. 448-449.
[240] Voici, restitué aussi complètement qu'on peut le faire en ce moment, le tableau des dynasties dont je viens de raconter l'histoire :
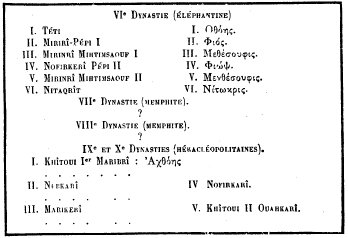
[241] Ces faits ressortent des légendes de la Table de Karnak. Cf. Prisse d'Avennes, Notice sur la Salle des Ancêtres, p. 14-15 ; E. de Rougé, Lettre à M. Leemans, p. 5-6 et 13.
[242] Mariette, la Table de Saqqarah, p. 6.
[243] En tout quarante-trois ans, au dire de Manéthon (édit. Unger). Le vrai sens de ce chiffre a été découvert par F. Barucchi, Discorsi critici sopra la Cronologia Egzia, in-4°, Turin, 1844, p. 131-134.
[244] Steindorff (Zeitschrift, t. XXXIII, p. 77-96) a reporté à la XIIIe dynastie une partie des souverains que l'on place dans la XIe dynastie depuis E. de Rougé.
[245] Champollion, Monuments de l'Égypte, pl. CCCVI, 3 ; Daressy, Notes et Remarques, § XXXIJ, dans le Recueil de Travaux, t. XIV, p. 26 ; t. XXVI, p. 12.
[246] Lepsius, Denkm., II, 150, p. 107.
[247] Lepsius, Denkm., II, 149 a ; Maspero, les Monuments égyptiens de la vallée de Hammamât, dans la Revue orientale et américaine, t. I, p. 333 sqq.
[248] Birch, le Papyrus Abbott ; Chabas, Mélanges égyptologiques, IIIe série, t. I ; Maspero, Une enquête judiciaire à Thèbes.
[249] Mariette, Lettre à M. le Vicomte de Rougé, p. 16-17, et Monuments divers, pl. 49, 50 ; Birch, The Tablet of Antef-Aâ II, dans les Transactions of the Society 0f Biblical Archœology, IV. p. 172-195.
[250] Aujourd'hui Ouadi Hammamât.
[251] Wilkinson, A Handbook for Travellers, p. 521 ; Petrie y a découvert plusieurs débris de ces temples.
[252] Lepsius, Denkm., II, pl. 150 a ; Chabas, Voyage d'un Égyptien, p. 57 ; Maspero, Sur quelques navigations des Égyptiens, p. 8-10.
[253]
Papyrus Sallier,
II, pl. I, 1. 9, pl.
III, 1. 3. Cf. Dümichen, Zeitschrift,
1874, p. 30 sqq.
[254] Papyrus Sallier, II, pl. III, 1.4-6. Cf. la traduction complète de ce texte par Maspero, The Instructions of King Amenemhat I unto his son Usertesen I, dans les Records of the Past, t. II, p. 9-46, et par Schack, Die Unterweisung des Koenigs Amenemhat I, in-4°, 1882-1884.
[255] Littéralement : « le grand lieu de se battre ».
[256]
Papyrus Sallier,
II, pl. I, 1.7-9.
[257] Éléphantine, la frontière méridionale de l'Égypte.
[258] Adhou, ou Nou-adhou, la NayÆ d'Hérodote, dans le Delta : aussi le Delta lui-même.
[259] La divinité des grains.
[260] En l'an XXIX de son règne (Brugsch, Die Negerstämme, dans la Zeitschrift, 1884, p. 30).
[261] Peuple nomade entre le Nil et la mer Rouge.
[262] Papyrus Sellier, II, pl. II,1. 7, pl. III, 1. 4.
[263] Mariette, Abydos, t. II, pi. 22. M. Sethe a proposé de lire ce nom Senouesrît, et cette lecture est assez probable, pour que je ne conserve plus ici la lecture traditionnelle.
[264]
Papyrus Sallier,
II, pl. I, 1.5-7.
[265] Par exemple sur deux stèles de l'an IX de Sanouasrît 1er (Louvre, C 2, 3) et sur une stèle de l'an VII (Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, Zeitschrift, 1881, p. 116 sqq.).
[266] Les deux Égyptes et la Nubie.
[267]
Papyrus Sellier,
II, pl. I, 1.2-4.
[268] Cf. dans Maspero, The Instructions of Amenemhat I unto his son Usertesen I (Records of the Past, 1st séries, t. II, 1874, 11-12), la liste des manuscrits qui nous sont parvenus de cet ouvrage.
[269] Chabas, les Papyrus hiératiques de Berlin, p. 37-51, et Goodwin, The Story of Saneha, dans le Fraser's Magazine, 1865, p. 185-202, Cf. les Records of the Past, t. VI, p. 131-150 ; Maspero, le Papyrus de Berlin n° I, dans les Mélanges d’archéologie égyptienne et assyrienne, t. III, p. 68-82, et dans les Contes populaires de l'ancienne Égypte, p. 96-134
[270] Ousirtasen 1er
[271] Mot à mot : « un laveur de face ».
[272] Mot à mot : « c'est un frappant avec la griffe ».
[273] Mot à mot : « un semour ». Le titre de semour est traduit en grec par filòw basilixñw « ami du roi ». Ce rapprochement a été contesté par Lepage-Renouf.
[274] Maspero, les Contes populaires, p. 108-111. D'après la forme de leur nom, les Nemmâshaîtou devaient être les Bédouins du désert.
[275] Maspero, les Contes populaires, p. 96-97. Une stèle du Musée du Caire porte la date de l'an XXX d'Amenemhaît 1er et de l'an X de Sanouasrît 1er (Manette, Abydos, t. II, pl. XXII). Deux autres stèles du même musée (Mariette, Abydos, t. III, p. 428, la seconde inédite) donnent l'an X de Sanouasrît 1er, seul. On pourrait conclure de l'absence du nom d'Amenemhaît 1er que ce prince mourut en l'an XXX de son règne, l'an X du règne de son fils, si les trois stèles, citées plus haut, ne montraient combien il faut se défier des indications de ce genre que fournissent les monuments. La première stèle du Caire prouve qu'Amenemhaît vivait encore en l'an X de son fils : les autres ne prouvent nullement qu'il mourut dans cette même année.
[276] Stèle de Leyde, V 4, datée de l'an XLIV de Sanouasrît 1er et de l'an II d' Amenemhaît II.
[277] Proscynème d'Assouan (Young, Hieroglyphics, pl. 61) datée de l'au XXXV d'Amenemhaît II et de l'an III de Sanouasrît II.
[278] E. de Rougé, Lettre à Leemans, p. 17.
[279] C'est le chiffre du Papyrus royal de Turin. La douzième dynastie avait été méconnue au début par Champollion, qui faisait des Amenemhaît les princes de la dix-septième dynastie, contemporains des Pasteurs. Pendant les derniers jours de sa vie, il reconnut son erreur, mais sa découverte demeura ensevelie dans ses papiers et ne fut publiée qu'en 1875. L'honneur d'avoir remis les choses en leur place revient donc à Lepsius, Ueber die zwölfte Ægyptische Kœnigsdynastie, dans les Mémoires de l’Académie des Sciences de Berlin, 1852.
[280] Chabas, les Papyrus hiératiques de Berlin, p. 58-59, 84-82, 91.
[281] Ce bas-relief fut signalé et décrit pour la première fois par Champollion (Monuments, t. IV, pl. CCCXLI, etc.), qui prit les immigrants pour des gens de race grecque. Il se trouve reproduit dans Lepsius (Denkm., II, p. 131-133) et dans Brugsch (Histoire d’Égypte, p. 63).
[282] Cf. sur ce sujet, Ebers, Ægypten und die Bücher Moses, t. I, p. 228 sqq.
[283] Félix, Note sopra le Dinastie de Faraoni, p. II ; Brugsch, Geschichte Ægyptens, p. 152.
[284]
Account of the
Survey, p. 183.
[285] Burton, Excerpta hieroglyphica, pl. XLII ; Champollion, Monuments, t. II, p. 690-692.
[286]
Lepsius, Denkm.,
II, 140 o-p.
[287] Shasou vient de la racine sémitique
![]() ,
piller, exercer le brigandage.
,
piller, exercer le brigandage.
[288] Papyrus de Berlin n° I, I. 19-28 ; Maspero, Contes populaires, p. 107.
[289] Chabas, les Papyrus hiératiques de Berlin, p. 40.
[290] Aïa ou Ia rappelle jusqu'à un certain point le nom d'Æan, ƒAi‹n, donné par les géographes anciens aux cantons qui avoisinent le golfe d’Akaba.
[291] Papyrus de Berlin, n° I, I. 76-141 ; Maspero, les Contes populaires, p. 111-115.
[292]
Brugsch, G. Inschr., t. I, p.
460.
[293] Brugsch, Die Negerstämme dans la Zeitschrift, 1882, p. 54 sqq. C'est à cette époque qu'il faut attribuer les noms des peuples gravés sur la statue k 18, 49, du Louvre, usurpée par Amenôthés III (Devéria, Lettre à M. A. Mariette, dans la Revue archéologique, 1861, t. III, p. 251.
[294] Voir plus haut. Les formes Kishou, Kashou se trouvent aussi dans les textes.
[295]
Lepsius, Nubische Grammatik, Einleitung,
p. xc sqq.
[296] Brugsch, Die Negerstämme, dans la Zeitschrift, 1882, p. 52 ; cf. Papyrus Sallier n° II, pl. II, 1.10.
[297] Stèle du Musée de Florence, Rosellini, Monumenti storici, t. XXV, n° 4 ; Champollion, Monuments, t. I, pl. 4, et Notices, t. I, p. 692 sqq. ; Berend, Principaux monuments du Musée égyptien de Florence, p. 51-52.
[298]
Lepsius, Denkm., II, 425 a;
Birch, dans la
Zeitschrift, 1874, p. 144 sqq.
[299] Cette opinion a été reprise par M. E. de Rougé dans un de ses premiers mémoires : Deuxième lettre à M. Alfred Maury sur le Sésostris de la douzième dynastie de Manéthon, puis plus récemment par Sethe, Sésostris, in-8°, 100. Cf. l'article contraire de Maspero, dans le Journal des Savants, 1901.
[300] Expédition de l'an VIII dans Birch, Zeitschrift, 1875, p. 50 sqq. ; de l'an XIX, dans Maspero, Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne, t. II, p. 217-219.
[301] Lepsius, Denkm, II, 136 i.
[302] Lepsius, Denkm, II, 156 h. Ces inscriptions, mutilées par des voyageurs qui avaient voulu les emporter, sont passées du Musée de Gizeh à celui de Berlin.
[303] M. de Voguë, Fortifications de Semnéh en Nubie, dans le Bulletin archéologique de l'Athenæum français, 1855, p. 81 sqq.
[304] Naville, Bubastis, pl. XXXIV A et p. 9-10.
[305] Lepsius, Denkm., II, 458.
[306] Lepsius, Denkm., II, 456 b ; Brugsch, G. Ins., t. I, p. 46 ; E. de Rougé, Inscriptions des rochers de Semnéh, p. 2-5.
[307] Prisse d'Avennes dans Chabas, les Inscriptions des mines d'or, p. 13-14.
[308]
Lepsius, Brief an Ehrenberg,
dans le Monatsberichte de
l'Académie de Berlin, 1845 ; Denkm.,
II, 159.
[309] Mariette, Aperçu de l'histoire d'Égypte, p. 55.
[310] Lepsius, Denkm., II, pl. 118.
[311] Lepsius, Denkm., II, pl. 119.
[312] Diodore de Sicile, I, 89, 8.
[313] Hérodote, II, CXLIX ; Cf. Linan-Bey, Mémoire sur le lac Moeris.
[314]
Strabon, I, XV,
ch. I.
[315] Wilkinson, Handbook, p. 238 b.
[316]
Hérodote, II, cxlix
; Diodore, I, 52.
[317] Lynceus de Samos et Demoteles dans Pline, H. N., XXXVI, 13.
[318] Pline, H. N., XXXVI, 45.
[319]
Strabon, I,
XVII, c. i.
[320] Hérodote, II, cxlviii.
[321] Pline, XXXVI, 13.
[322] Hérodote, II, cxlviii.
[323] Pline, H. N., XXXVI, 15.
[324]
Strabon I.
XVII, Ch. I.
[325] Pline, XXXVI, 15.
[326] Limant de Bellefonds, dans son Mémoire sur le lac Moeris, avait cru reconnaître les restes des digues mentionnées par Hérodote dans les restes de chaussées qu'on voyait encore au milieu du xixe siècle entre les villes d'Illahoun et de Médinet-el-Fayoum. Le major Brown a montré l'inanité de cette supposition (The Fayûm and Lake Moeris).
[327] L'identité du Labyrinthe avec les ruines de Haouarah, indiquée par Caristie-Jomard, Description des ruines situées près de la pyramide d'Haouarah (dans la Description de l'Égypte, t. IV, p. 478-524) et par Lepsius, Briefe aus Ægypten, p. 74 sqq., a été mise hors de doute par Petrie, Hawara, Biahmu and Arsinoe, p. 4 sqq.
[328] Table d'offrandes d'Amenemhaît 1er (Mariette, Karnak, pl. 8 c) et groupe de statues portant le nom de ce prince (Id., pl. 8 d) blocs au nom do Sanouasrît 1er (Id., pl. 8 a-c).
[329] Stèle de Montouhotpou, au Caire (Mariette. Abydos, t. II, pl. 23 1.111, p. 144), traduite en partie par Lushington (Transactions of the Society of Biblical Archœology, t. VII, p. 353 sqq.).
[330] Diodore, I, 51
[331] E. de Rougé, Cours au Collège de France, 1869 ; Pétrie, Tanis, I p. 5.
[332]
Naville, Bubastis, p. 8-9 et
11, pl. V-IX, XXIII, XXIV,
XXXIII, XXXIV.
[333] Porte en granit au nom d'Amenemhaît 1er, découverte à Fakous en juin 1883.
[334] Consécration d'un temple à Héliopolis, l'an III de Sanouasrît 1er (L. Stern, The foundation of the Temple of the sun of Heliopolis, dans les Records of the Past., t. XII p 51 57 cf. Zeitschrift, 1874, p. 85 sqq.). Le Papyrus de Berlin n° VII est soi-disant, la copie d'un texte écrit sur l'un des murs du temple bâti pas Sanouasrît I à Héliopolis (Lepsius, Denkm., VI, pl, 121 c ; cf. Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans la Zeitschrift, 1870, p, 63). L'obélisque de Matariéh est probablement le seul débris visible de ce temple.
[335] Stèle de l'an XIV de Sanouasrît III (Lepsius, Denkm., II, pl. 136 a).
[336] Aujourd'hui Taoud. Table d’offrandes au nom de Sanouasrît 1er (Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans la Zeitschrift, 1882, p. 123).
[337] D’après une inscription du grand temple, dans laquelle Amenemhaît et Sanouasrît sont mentionnés, sans qu'on y ait joint aucun prénom qui permette de savoir duquel des rois de ce nom il s'agit (Brugsch, Drei Festkalender, A I. 25).
[338] Louvre, C 5. 1., 4-7 ; cf. Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans les Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne, t. I, p. 221.
[339] Elle fut ouverte par Maspero en 1882 et 1886, mais on ne put en examiner les chambres, tant elles étaient remplies d'eau : on constata pourtant qu'elle avait appartenu à Sanouasrît 1er (Maspero, Etudes de mythologie et d'archéologie, t. I, p. 148-149 ; Guide du Visiteur au Musée de Boulag, p. 222-223). Les fouilles de Gautier et Jéquier en 1895 ont confirmé cette identification et amené la découverte de onze statues de Sanouasrît 1er (Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, p. 47-48, n 1365.)
[340] E. de Bougé, Examen critique, p. 51 ; J. de Morgan, Dahchour, t. I, où les travaux qui ont amené l’ouverture de la pyramide sont racontés tout au long.
[341] Elles ont été explorées par Petrie, Kahun, Gurob, and Illahun, p. 5-8, 11, 12-17, 21-52, Illahun, Kahun and Gurob, p. 1-15, Hawara, Biahmu and Arsinoe, p. 38.
[342] Maspero, Guide du Visiteur au Musée du Caire, p. 417-423.
[343] Ils ont été découverts par M. de Morgan, et publiés en partie par lui dans Dahchour, t. I.
[344] Dans l'Heptanomide. Cf. Sur ces princes, Maspero, la Grande Inscription de Béni-Hassan, dans le Recueil, t. I, p. 160 sqq.
[345] Lepsius, Denkm., II, 140-143.
[346] Lepsius, Denkm., II, 122.
[347] Littéralement : « lorsqu’il y eut des années de faim ».
[348]
Lepsius, Denkm.,
II, 122 ; Cf. Birch, On a remarkable inscription of the xiith
dynasty ; Brugsch, Reiseberichten,
p. 95 sqq., G.
Inschr., p. 111-116.
[349] Lepsius, Denkm., II, pl. 120-130.
[350] Maspero, Du genre épistolaire, p. 50-62.
[351] Il est curieux de retrouver chez les alchimistes gréco-égyptiens (Berthelot, dans la Nouvelle Revue, 1884) la mention d'un livre égyptien nommé Khimas ou Khimis.
[352] Maspero, Du genre épistolaire, p. 49-50.
[353] Maspero, Du genre épistolaire, p. 66-67.
[354] Maspero, les Contes populaires de l'ancienne Égypte, p. 97-134.
[355] Maspero, Hymne au Nil, in-4°, Paris, 1868. Cf. p. 14-15 de cette histoire.
[356] Mariette, Catalogue, p. 200-261.
[357] Mariette, Abydos, I. pl. 21 a ; t. III, p. 29.
[358] La tentative la plus heureuse qu'on ait faite jusqu'a présent, pour restituer les parties du papyrus de Turin où sont énumérés les rois de cette dynastie et de la suivante, est celle de Lauth, Manetho und der Turiner Königspapyrus, p. 255 sqq.
[359] Brugsch, Geschichte Ægyptens, p. 180. La filiation est prouvée par plusieurs scarabées contemporains (Mariette, Mon. divers, pl. 48 j). Cf. Louvre, C 8.
[360]
Lepsius, Denkm., II, 151, e-h.
[361] Hérodote, II, c.
[362] Sovkhotpou IV d’après E. de Rougé, VI d'après Brugsch.
[363] Lepsius, Denkm., II, 451 i.
[364] Sovkhotpou III de Brugsch. Geschichte, p. 185.
[365] E. de Rougé, Sur une inscription trouvée à Semnéh ; Lepsius, Denkm., II, 151 b et d.
[366] Statues de Sovkhotpou Skhemouaztoouïrî trouvée à Karnak (Mariette, Karnak, pl. 8 m), de Sovkhotpou Nibka… et de Sovkhotpou Mirkoourî, jadis conservées à Louqsor, dans la maison de France, aujourd’hui à Paris (Mariette, Karnak, pl. 8 k-l) ; bloc trouvé à Karnak, et portant les cartouches de Nofirhoptou Khâsoshshourî et de Sovkhotpou Khânofirri (Mariette, Karnak, n-o), etc.
[367] Louvre, A 46 ; une autre statue du même roi (A 7) est de provenance inconnue.
[368] Mariette, Abydos, t II, pl. 28-30.
[369] Louvre, C 14 et 12, traduction de Horrack, Sur deux stèles de l'Ancien Empire, dans Chabas, Mélanges égyptologiques, IIIe série, t 11, p. 205 sqq. Le nom du roi, que j’ai vérifié sur l'original une fois de plus, est bien Rànmàtan (Maspero, Notes sur quelques points de grammaire et d'histoire, dans les Mélanges, t. II, p 440), et non Rà-en-Maâ-ent (Wiedemann, Ægyptische Geschichte, t. I, p. 278, n. 4).
[370] Aujourd'hui au Musée du Caire (Mariette, Abydos, II, pl. 26, et III, p. 30).
[371] Mariette, Première et Deuxième lettres à M. le vicomte de Rougé sur les fouilles de Tunis. Cf. E. et J. de Rougé, Inscriptions recueillies en Egypte, pl. LXXVI, l’inscription d'une statue de Sovkhotpou Khânofirri trouvée à Tanis.
[372] Brugsch, Histoire, t I, p. 71-72.
[373] Cette théorie, qui est de Lepsius, a été combattue dés sa naissance par M. de Rougé, Examen critique, deuxième article, p. 50 sqq. ; elle paraît être abandonnée aujourd'hui.
[374] Xoïs est aujourd'hui Sakha (Champollion, l'Égypte sous les Pharaons, t. II, p. 211-225).
[375] Voici, rétablie en son entier, la série des Pharaons de la XII dynastie :
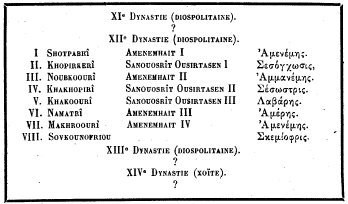
Depuis une dizaine d'années, une partie de l'école allemande a réduit considérablement la durée du Premier Empire thébain et de la domination des Hyksôs, en s'autorisant d'une mention d'un lever héliaque de Sirius dans un document écrit sous la XIIe dynastie celle-ci aurait régné entre le XXIe et le XIXe siècle avant J.-C. Sans entrer dans le détail, il suffit pour le moment d'indiquer qu'en admettant cette donnée, l’espace manque pour placer convenablement les XIIIe, XIVe, XVe, XVIe et XVIIe dynasties. Si les chiffres fournis par Manéthon pour l’époque sont trop forts, ceux de l'école allemande sont trop faibles.