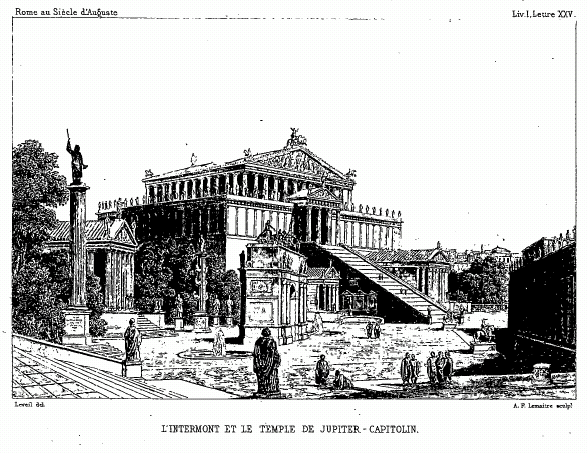
| RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE | ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DEZOBRY |
Dezobry, Charles (1798-1871)
Rome au siècle
d'Auguste,
ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une
partie du règne de Tibère
LETTRE XIX.
LES CENSEURS. - LA REVUE DU SÉNAT, DES CHEVALIERS. ET DU PEUPLE.
La plèbe romaine
a un caractère extrêmement impressionnable, qui en fait un être rempli de
contrastes, susceptible de tous les sentiments nobles et élevés, et
tributaire. des plus déplorables passions ; ferme, généreux, spirituel, plein
de sens ; puis faible, fantasque, injuste, superstitieux jusqu'à la stupidité,
cruel jusqu'à la férocité. Je l'ai vu, il y a quelque temps, dans les
transports de la joie la plus immodérée à propos de la puissance
tribunitienne décernée à l'Empereur. Ces jours-ci peu s'en est fallu que
cette même plèbe ne se portât aux plus sanguinaires violences contre le
conseil suprême de la République : elle a cerné, assiégé la maison du
Sénat ; elle a tenu les sénateurs enfermés dans la curie, en menaçant de les
y brûler s'ils ne décernaient à l'Empereur la Dictature, abolie depuis plus
de vingt ans ! Comment tenir contre une aussi terrible sollicitation ? Le Sénat
a cédé. Le décret rendu, cette plèbe s'est portée au Palatin pour y tenter
contre Auguste une autre scène de violence : « César, » lui crièrent-ils,
en poussant devant eux vingt-quatre licteurs qu'ils avaient ramassés à la
hâte, « César, nous t'apportons la Dictature.» Le chef de l'Empire, soit
respect pour la légalité, soit plutôt parce que ce titre pouvait le rendre
odieux aux citoyens, sans lui donner plus de puissance, répondit qu'il
n'accepterait jamais une magistrature qui avait été abolie comme hostile à la
liberté. Ses paroles produisant peu d'effet et se perdant au milieu des cris de
la foule, il prit une posture suppliante, mit un genou en terre, ouvrit sa
tunique, et découvrant sa poitrine, fit signe qu'il se laisserait tuer plutôt
que de céder .
Tu seras bien surpris, cher Induciomare, quand je te dirai l'origine de cette
horrible émeute de servilité : depuis la fin de l'an dernier; une peste sévit
en Italie et dans plusieurs pays étrangers.
Elle a fait tant de ravages, que les bras ont manqué pour la culture des
terres, et il y a cherté de vivres. Le peuple ne s'est-il pas imaginé que ces
maux ne l'affligent que parce que l'Empereur n'est pas consul ! Croyance
extravagante, sortie sans doute de quelque cerveau frappé par la maladie. Mais
comme ici les masses agissent par entraînement plus que par raisonnement,
souvent d'après l'exemple de quelques-uns, à l'instar d'un troupeau de
moutons, le peuple s'est persuadé que les fléaux dont il souffre cesseraient
leurs ravages dès que l'Empereur occuperait une magistrature. Or le consulat
étant rempli, ces farouches solliciteurs se sont rejetés sur des magistratures
tombées en désuétude, et ils ont offert impérieusement à leur héros
tutélaire, non seulement la Dictature, mais encore la Censure perpétuelle, et
l'intendance générale des vivres. Auguste a pris cette dernière charge, qu'il
lui était bien difficile de refuser dans un temps de disette, mais il n'a voulu
ni de la Dictature ni de la Censure, et ces furieux à demi satisfaits ont fini
par s'apaiser.
La Censure est une magistrature dont je ne t'ai pas encore entretenu. Elle joue
un assez grand rôle dans l'histoire de Rome pour que je te la fasse connaître.
Le roi Servius, en modifiant et perfectionnant l'organisation politique du
peuple romain, rétablit une coutume parfaitement en harmonie avec l'ordre qu'il
avait introduit dans les diverses classes, et qui contribua tant au maintien
ainsi qu'à l'affermissement de cet ordre : je veux parler du Cens ou
dénombrement général des citoyens. Il ordonna que ce dénombrement aurait
lieu tous les cinq ans, et il en chargea la royauté. On en compte quatre faits
par lui-même.
Les Consuls, et les Dictateurs qui les remplaçaient quelquefois, héritèrent
de cette fonction en héritant du pouvoir royal ; mais absorbés par leurs
nombreuses occupations, il leur arriva fréquemment d'omettre le Cens. Cette
omission s'étant une fois prolongée pendant dix-sept ans, les Consuls de
l'année trois cent onze, convaincus de l'impossibilité pour le Consulat de
s'acquitter désormais avec quelque exactitude d'une opération si importante,
représentèrent au Sénat que les détails où elle entraînait, trop pénibles
par eux-mêmes, et d'ailleurs peu consulaires, exigeaient une magistrature
spéciale qui s'y dévouât exclusivement ; ils proposèrent la création de
magistrats sous les ordres desquels on placerait le corps des scribes, et qui
pour attributions auraient la garde, le contrôle des registres de recensement,
et la décision de toutes les contestations relatives à l'état des citoyens.
Ces magistrats devaient être patriciens, et de plus avoir passé par le
Consulat et par la Préture. Le Sénat accueillit donc avec empressement une
proposition qui tendait à multiplier le nombre des magistratures patriciennes.
Peut-être aussi se persuada-t-il, comme il arriva en effet, que le crédit
personnel de ceux qui seraient revêtus de cette place saurait lui donner du
lustre et de la dignité. Les Tribuns du peuple, d'un autre côté, ne lui
voyant que des attributions plus utiles que brillantes, ne firent aucune
réclamation, et l'on élut deux magistrats qui prirent le nom de Censeurs, du
nom des fonctions qui leur devaient être confiées.
Mais la Censure, que les principaux patriciens commencèrent par dédaigner, à
cause du cercle étroit où sa loi d'institution la renfermait, s'augmenta peu
à peu, comme tous les pouvoirs non contestés ; elle finit par obtenir la
surveillance générale des moeurs et de la discipline de Rome, l'inspection sur
le Sénat et sur les chevaliers. Sa juridiction s'étendit dans tous les
endroits publics et privés ; les Censeurs furent chargés de l'adjudication et
de la réception des travaux publics monuments, routes, aqueducs, cloaques, tant
à Rome que dans l'Italie ; de la mise en ferme, de la levée et de la
répartition de beaucoup d'impôts ; de l'estimation des biens sur lesquels
étaient assis les impôts ; de l'établissement des taxes qu'ils jugeaient
nécessaires ; de l'administration du Trésor de la République; enfin de la
surveillance des écoles. Le centre de leur administration était à l'Atrium de
la liberté, près du Forum de César, et leurs archives au temple des Nymphes.
Quand la Censure fut devenue si importante, elle éveilla aussi, l'ambition des
plébéiens, qui voulurent y être admis comme ils l'avaient été au Consulat.
Dans les premières années du cinquième siècle ils y portèrent un membre de
leur ordre. Les patriciens le souffrirent avec peine ; mais ils durent, comme
toujours, plier sous l'inflexible volonté du peuple, et peu d'années après,
un dictateur, Publius Philon, porta une loi qui assurait aux plébéiens l'une
des deux places de Censeur.
Les patriciens, jaloux de ce partage, cherchèrent souvent, dans les comices, à
faire oublier au peuple cette disposition législative, et souvent y
réussirent. On mit fréquemment aussi en oubli la condition de ne choisir que
des hommes consulaires ou prétoriaux.
Les Censeurs étaient réellement les maîtres de l'ordre social : tous les cinq
ans, ils arrêtaient la liste des sénateurs, révisaient celle des chevaliers,
remaniaient la distribution du peuple dans le tribus, les classes et les
centuries enfin régularisaient la hiérarchie civile en introduisant dans une
classe plus élevée les citoyens qui, pendant l'intervalle d'une Censure à
l'autre, avaient acquis les conditions d'admissibilité dont j'ai parlé plus
haut, en abaissant ceux qui, par la diminution ou la perte de leurs biens,
devaient descendre dans une classe inférieure.
C'était là de la justice administrative, la constatation d'un fait,
l'accomplissement de ses conséquences. Mais les Censeurs suivaient encore le
citoyen dans ses relations sociales, dans sa vie privée, dans tous ses devoirs
comme fils, comme époux, comme frère a, pour l'empêcher de s'écarter du
chemin de la vertu, et de transgresser les ordonnances et coutumes de la
République ; ils punissaient tout manquement à l'honneur, à la probité ou à
la décence. Il n'y avait pour ces cas qu'une seule pénalité : l'exclusion du
citoyen plébéien de sa centurie par son inscription sur les tables des
Cérites. Les Cérites étaient un peuple d'Étrurie qui donna asile aux choses
sacrées que les prêtres emportèrent de la ville, lors de la prise de Rome par
Brennus. Ils reçurent en récompense le droit de cité romaine sans celui de
suffrage. Pour le véritable Cérite c'est un avantage, mais une grave
pénalité pour le Romain, qui, en perdant un de ses plus précieux privilèges,
n'en continue pas moins, en qualité de citoyen, de contribuer aux charges de la
cité ; aussi dit-on indifféremment inscrit sur les tables des Cérites, ou
fait contribuable, reporté clans les contribuables, c'est-à-dire parmi ceux
qui sont uniquement contribuables.
La punition des sénateurs et des chevaliers consistait dans l'exclusion de leur
ordre. Alors, suivant leur plus ou moins de richesse, ils retombaient
naturellement dans une classe plus ou moins élevée des centuries. Souvent les
Censeurs ne se bornaient pas à cette simple radiation : ils portaient aussi les
exclus sur les tables des Cérites. Aucune considération, pas même celle de
parenté de frère à frère, de descendant à ascendant, ni celle du grand
nombre des coupables, n'arrêtait la sévérité censoriale ; au commencement du
VIe siècle, quatre cents chevaliers, commandés en Sicile pour aller creuser un
retranchement, s'y étant refusés, furent privés de leur cheval et faits
contribuables. La même peine fut infligée, une quarantaine d'années plus
tard, à un questeur et à beaucoup de chevaliers qui avaient juré d'abandonner
l'Italie. On flétrit également d'une note infamante ceux des prisonniers
romains qui, après la funeste journée de Cannes, députés par Annibal auprès
du Sénat pour traiter de l'échange des captifs, étaient restés à Rome,
quoiqu'ils eussent promis de retourner au camp du vainqueur. Les Romains ont
toujours voulu que le serment fût le lien le plus solide pour enchaîner la
foi, et jamais les notes d'infamie et les punitions infligées par les Censeurs
ne furent plus rigides que quand il s'agissait d'une violation de la foi.
Néanmoins, comme. ces magistrats jouissaient, dans leurs attributions, d'un
pouvoir absolu, qu'ils prononçaient sans jugement préalable, sans contrôle,
sans appel, il arriva souvent qu'ils sévirent contre des fautes d'une médiocre
gravité. P. Scipion Nasica, passant la revue des chevaliers, en remarqua un
dont le cheval était maigre et chétif, tandis que l'homme était gras et
brillant de santé : « Pourquoi, lui dit-il, avez-vous si bonne mine, et votre
cheval est-il en si pauvre état ? - Parce que, répondit le chevalier, je me
soigne moi-même, et que mon esclave soigne mon cheval. » Cette réponse parut
trop peu respectueuse, et le chevalier fut rejeté dans la classe des
contribuables. L'an quatre cent soixante-dix-huit, Rufinus, ancien dictateur et
deux fois consul, fut exclu du Sénat pour avoir possédé dix livres d'argent
travaillé, à l'usage de la table ; l'an six cent quarante-six, C. Junius
Bubulcus encourut la même peine, parce qu'il avait répudié sa jeune épouse
sans prendre conseil de ses amis ; dix ans après, Duronius, parce qu'étant
tribun du peuple, il abrogea une loi contre le luxe des repas. Le vieux Caton
raya aussi de la liste des sénateurs un certain Manilius, que l'opinion
publique désignait pour le consulat, parce qu'en plein jour il avait donné à
sa femme un baiser en présence de sa fille.
La Censure était une véritable dictature morale et civile ; elle n'avait pas
le droit formel de toucher aux bases fondamentales de la constitution de la
République, de détruire ni les classes, ni le Sénat, ni l'ordre équestre,
bien que tous les membres fussent individuellement soumis à son pouvoir ; mais
la formation des listes civiques, mais le classement des citoyens, entièrement
remis à l'arbitraire des Censeurs, les rendaient, de fait, maîtres des
Comices, rien ne se faisant que dans ces assemblées. Ils avaient même, dans
une certaine mesure, influence sur les délibérations du Sénat, car ils
pouvaient aussi en exclure les Tribuns du peuple qui y sont admis, comme je le
dirai plus tard, pour protéger les plébéiens contre les patriciens.
L'heureuse fortune du peuple romain a voulu qu'il ne se soit rencontré qu'un
seul Censeur qui ait tenté ce bouleversement politique : vers le milieu du
quatrième siècle, Appius Claudius, renversant l'ordre établi, répandit dans
toutes lés tribus indistinctement la classe la plus infime du peuple,
jusqu'alors renfermée dans les dernières centuries, de sorte que Rome fut
divisée en deux partis, l'un des citoyens honnêtes, et l'autre de cette
faction du Forum. La scission dura cinq ans, jusqu'à la, Censure de Q. Fabius
et P. Décius. Fabius, pour rétablir la concorde, et que les Comices ne fussent
plus dans les mains de ce que Rome renfermait de plus abject, écuma toute cette
lie, et la rejeta dans quatre tribus uniques, appelées Tribus urbaines.
Un pouvoir si étendu, tout à la fois, et si absolu, devant lequel les fautes
ne se prescrivaient jamais ne devait pas demeurer sans frein. D'abord, comme
premières garanties, l'élection des Censeurs fut remise aux Comices les plus
vénérés, aux Comices par centuries ; en entrant en charge les élus durent
jurer de régler leur conduite sur la vérité, la justice et l'impartialité.
En sortant de charge, ils prêtent un nouveau serment pour affirmer qu'ils n'ont
rien fait de contraire aux lois.
Plus tard, à mesure qu'on éprouva tout ce que cette magistrature pouvait
faire, il fut établi que le pouvoir censorial serait collectif pour sévir, et
qu'une condamnation prononcée par un seul des deux Censeurs pourrait être
annulée par l'autre ; que dans le cas où l'un de ces magistrats viendrait à
décéder avant l'expiration de sa magistrature, l'autre serait oblige
d'abdiquer, parce que les Romains attachent des idées sinistres au remplacement
d'un Censeur ; enfin, qu'aucun citoyen ne pourrait occuper la Censure deux fois.
Par une sorte de raffinement de sévérité assez bien placée, et sans doute
pour ne créer aucun privilège, chaque Censeur, pris isolément, devenait tout
puissant dès qu'il s'agissait de punir son collègue. Il y a deux siècles
environ, Livius Néron et Claudius Salinator étant Censeurs, se trouvaient, par
une rencontre singulière, avoir chacun, en qualité de chevaliers, un cheval
entretenu aux dépens du public. Ils passaient en revue les centuries
équestres, dont leur âge et leur forte constitution leur permettaient encore
de faire partie. Quand on en fut à la tribu Pollia, le crieur, voyant sur la
liste le nom de Salinator, s'arrêta, incertain s'il devait l'appeler. Néron
comprit son embarras : non seulement il fit citer son collègue, mais encore il
lui commanda de vendre son cheval, pour avoir été condamné par un jugement du
peuple.
Lorsque vint le tour de la tribu Narnia et le nom de Livius Néron, Salinator
lui rendit la pareille, pour deux raisons : la première, pour avoir porté
contre lui un faux témoignage ; la seconde, pour ne s'être pas réconcilié
sincèrement avec lui. Rien de plus blâmable sans doute que cet assaut de notes
infamantes entre deux Censeurs, mais du moins rien de plus digne de cette
magistrature et de la sévérité de ce temps-là.
ACHÈVEMENT.
Lorsque l'Empereur eut rétabli la Censure, il n'en conserva pas moins le titre
et les attributions de directeur perpétuel des moeurs ; mais soit qu'il
reconnût l'inutilité des deux pouvoirs, qui avaient presque. les mêmes
attributions; soit qu'il jugeât la Censure, magistrature essentiellement
despotique, incompatible avec le pouvoir absolu dont il jouissait lui-même sous
le titre de puissance tribunitienne, il ne fit point réélire d'autres Censeurs
lorsque Munatius et Lépidus sortirent de charge. Auguste était directeur des
lois en même temps que directeur des moeurs, il laissa tomber dans l'oubli la
loi sur la Censure, et il eut raison puisque le peuple ne réclama pas.
Tibère, en héritant de l'Empire, n'eut garde de répudier aucun des pouvoirs
envahis par son prédécesseur. Le Sénat ayant un jour essayé de lui faire
pressentir, à propos du luxe excessif qui ravageait Rome, qu'il serait
peut-être utile de rétablir la Censure, il répondit qu'elle était trop
austère pour les temps actuels, et que si les moeurs périclitaient
réellement, il se trouverait une autorité pour les corriger. Cette réponse à
la fois évasive et très significative fut le seul fruit que les sénateurs
tirèrent de leur timide insinuation. Elle apprit aux moins clairvoyants que,
dans une République asservie, toute institution de liberté tombée en
désuétude équivalait à une institution morte ; que personne ne devait plus
prétendre à exercer une puissance suprême quelconque, et que la Censure
était engloutie à jamais dans le monstrueux assemblage de pouvoirs que
l'audace et l'astuce d'une part, la lâcheté et la servilité de l'autre, ont
réunis, livrés, abandonnés dans les mains de l'Empereur perpétuel de la
République romaine.
LA POLICE DE ROME.
Dans
une ville qui ressemble à un monde; où des milliers d'intérêts, de passions
bonnes et mauvaises, d'industries de toute espèce sont en contact perpétuel ;
où la population, prodigieuse en nombre, ne l'est pas moins en diversité, la
première condition d'existence sociale était un gouvernement particulier,
chargé de prévenir les trop grands froissements, de régler, pour ainsi dire,
l'action relative de chacun, de surveiller toujours, de s'interposer
quelquefois, de réprimer et de punir au besoin : ce gouvernement domestique,
c'est la Police de Rome.
De même que la République a des consuls, des proconsuls, des préteurs, etc.,
pour la régir au dehors, Rome a des magistrats spéciaux pour la gouverner, la
défendre, la protéger, veiller à sa sûreté, à sa tranquillité, à son
bien-être, non seulement pendant le jour, mais aussi pendant la nuit : ces
magistrats sont le Préfet de la ville, les Édiles curules, les Édiles
plébéiens, et le Préfet des Vigiles. Ils ont sous leurs ordres une foule de
délégués et d'agents répandus, postés ou circulant sur tous les points de
la cité, où ils font sentir incessamment l'action salutaire d'un pouvoir
protecteur, qui empiète bien un peu sur la liberté absolue de chacun, mais
pour mieux assurer celle de tous.
Le Préfet de la ville est le principal magistrat de ce gouvernement : il
embrasse en grand tout ce qui intéresse la sûreté et la tranquillité
publiques, et jouit d'un tel pouvoir, qu'il a le droit de bannir de Rome tout
individu dont la présence lui semble nuisible ou dangereuse ; il doit veiller
aussi à ce qu'aucun culte étranger ne soit introduit dans la cité, ce qui
pourrait produire des sujets de troubles et de discordes. Son pouvoir s'étend
jusqu'à cent milles à la ronde. La préfecture urbaine est une grande
magistrature, une magistrature curule. Celui qui en est revêtu porte la toge
bordée de pourpre, et il a deux licteurs. Le monarchisme de la puissance
impériale éclate dans l'institution du Préfet : il est nommé directement par
l'Empereur, et pour un temps illimité.
L'Édilité, qui vient après la Préfecture urbaine, s'occupe des détails de
l'administration, des affaires courantes de la vie de chaque jour. Il y a deux
sortes d'Édilité, la curule et la plébéienne, et quatre édiles, deux pour
chaque magistrature. La ville est divisée en quatre circonscriptions, que ces
magistrats se partagent ou tirent au sort dans les cinq jours qui suivent leur
élection, laquelle se fait toujours, un an à l'avance. Les Édiles ont dans
leurs attributions tout ce qui tient au bien-être de la ville ; ils inspectent
les marchés, veillent à ce que le pain soit bien fabriqué, à ce que son
volume , ou plutôt son poids soit en rapport avec son prix. Ils surveillent
aussi la bonne qualité de toutes les denrées mises en vente , et font jeter
dans le Tibre celles qui leur semblent avariées. Leur surveillance sur ce point
est très sévère, et ils peuvent aller jusqu'à interdire la vente de telle ou
telle denrée. Ces magistrats font des édits, espèces de petites lois qui
n'ont besoin pour être valides que d'être promulguées de l'autorité
collective des deux ou des quatre membres de leur magistrature.
La bonne foi et la sincérité dans les transactions sont aussi l'objet de la
surveillance des édiles. Ils vérifient les poids et les mesures, et font
briser ceux qui leur paraissent frauduleux et non conformes à certains étalons
publics gardés, pour les poids dans le temple d'Ops, pour les mesures de
capacité dans le temple de Jupiter Capitolin, et pour celles de longueur dans
le temple de Junon-Moneta. Le bris est d'autant plus facile, particulièrement
pour les poids, dont on abuse plus facilement, qu'ils sont en marbre. Les
édiles ont encore l'inspection des bains, des tavernes, et des auberges ; ils
obligent les maîtres de ces derniers établissements à tenir note des
personnes qui viennent loger chez eux, et à déclarer leurs noms à des
licteurs envoyés chaque jour pour les transcrire sur des registres publics.
Les moeurs des femmes sont également sous leur surveillance, et les courtisanes
dépendent tout à fait de ces magistrats ; ils tiennent la liste de toutes
celles qui habitent dans leur ressort ; elles ne sont tolérées qu'à la
condition d'aller se déclarer elles-mêmes devant eux et chez eux ; car entrer
dans le repaire de ces femmes de mauvaise vie leur est interdits ; gardiens de
la morale publique, ce serait pour eux une souillure.
La propreté, la sûreté, la liberté et la conservation des rues de Rome sont
aussi confiées aux Édiles ; ils en font enlever la boue, les immondices et les
décombres, qui ne s'y amassent toujours que trop. Cette dernière partie de
leur tâche, qu'ils partageaient jadis avec quatre officiers spéciaux appelés,
de leur nombre, Quatuorvirs, exige une grande surveillance, parce que
beaucoup de rues n'étant point pavées, rien n'en fixe le niveau, de sorte que
les citoyens profitent de cette incertitude pour répandre sur la voie publique
des décombres qui finissent par relever le sol d'une manière très sensible.
Relativement à la propreté et à l'entretien des rues pavées, les maîtres
des maisons, et à leur défaut les habitants leur servent d'auxiliaires, mais
d'auxiliaires forcés ; ils sont tenus de balayer les ruisseaux, d'enlever les
ordures et d'arroser pour empêcher la poussière : ils en sont prévenus à
certaines heures par une sonnette, que des. esclaves vont tinter de rues en
rues. Dans les rues pavées, ils doivent entretenir, devant leurs maisons, le
pavé, et les sentiers dallés pour les piétons, c'est-à-dire les marges qui
bordent la plupart des voies publiques, et de les maintenir unis de manière que
l'eau n'y séjourne pas. Lorsqu'une maison se trouve vis-à-vis d'un temple,
d'un autre édifice ou lieu public, la moitié de la servitude reste à la
charge du trésor de l'État. Les riverains, soit dans la ville, soit dans les
faubourgs jusqu'à un mille de distance, doivent exécuter les réparations dès
que l'Édile les juge nécessaires ; s'ils ne les font pas, le magistrat les
adjuge à un entrepreneur. Mais, comme on veut ménager même les
récalcitrants, il annonce l'adjudication au moins dix jours à l'avance, par
écriteau posé dans le Forum, devant son tribunal, et contenant la désignation
des lieux à réparer, et la mention du jour où les travaux seront criés pour
être adjugés.
Cet écriteau est dénoncé devant la maison du propriétaire en défaut, ou de
ses procurateurs s'il est absent. L'adjudication a lieu publiquement, sur le
Forum, par un magistrat chargé du Trésor. La somme estimative des travaux est
portée sur des livres d'impôts à recouvrer, et si le propriétaire ou son
procurateur ne l'a pas versée entre les mains de l'adjudicataire dans un délai
de trente jours, ou s'il n'a pas fourni caution, il est condamné à payer le
double, et passible de contrainte judiciaire à la requête de son créancier.
Quiconque détériore la rue, ou avance une construction hors de l'alignement,
s'il est esclave, tout passant a le droit de le bâtonner ; s'il est citoyen, il
peut le dénoncer à l'édile, qui condamne le délinquant à l'amende et
ordonne la destruction de l'oeuvre faite.
Certaines malpropretés qu'aucune autorité ne saurait empêcher ont fait
imaginer quelques mesures préventives qui les dissimulent un peu ; ou du moins
en sauvent l'inconvénient. Par exemple. il y a dans beaucoup d'endroits des
latrines publiques et dans presque tous les carrefours, des tonneaux sciés ou
de larges amphores où les passants peuvent se débarrasser de la surabondance
du fluide qui les tourmente. Malgré ces précautions, les édifices publics,
les temples, ne sont pas toujours à l'abri d'impures aspersions. Pour les en
garantir on fait peindre sur les murs deux serpents ; cette image avertit les
gens distraits de la sainteté du lieu, et leur sert d'avis tacite de se porter
ailleurs. Les taverniers ont les premiers, dit-on, inventé ce moyen pour
épouvanter les enfants qui venaient souiller les angles extérieurs de leurs
tavernes. Il y a des prêtres qui ne se contentent pas de cet épouvantail
symbolique ; dans une inscription en toutes lettres, ils n'invoquent rien moins
que la colère des douze grands dieux, et nominalement celle de Diane et de
Jupiter, très bon, très grand, n'oublient-ils pas d'ajouter, contre les gens
grossiers qui oublieraient au pied de leur temple qu'ils ne sont ni devant des
tonneaux ou des amphores de carrefour, ni dans les lieux plus secrets réservés
pour d'autres nécessités.
Il faut une surveillance incessante pour tout ce qui tient à la sûreté et à
la liberté des rues. Cette surveillance consiste à empêcher que personne ne
laisse courir dehors aucun anima! dangereux, tels qu'un chien enragé, ou bien
un sanglier, un lion, un ours, une panthère, accidents qui peuvent se produire
d'autant plus aisément, qu'il y a toujours ici de ces animaux étrangers
amenés pour certains jeux publics. Il est aussi défendu, sous peine de
punition, de se battre dans les rues, d'y jeter des fumiers, des débris
d'animaux, ou de rien répandre sur les passants.
Quant à la liberté, non seulement des rues, mais des places et des portiques
on l'entend d'une manière un peu plus large : le mot de voie publique est pris
à la lettre par les citoyens ; les riverains la considèrent comme leur
appartenant en partie, et, à ce titre, s'en mettent en possession : ainsi le
foulon étend ses étoffes humides au-dessus de la rue, le charron expose des
chars à sa porte, et n'est point en contravention tant que son étalage laisse
le passage libre pour une voiture ; mais s'agit-il du service du public, de
faire des préparatifs de jeux ou de donner des jeux au peuple, il est permis
d'occuper partie ou la totalité de la voie publique ou d'un portique, toujours
dans le rayon d'un mille autour de la ville.
La liberté de la circulation est essentiellement pour les gens de pied, et sur
ce point on leur sacrifie tout ce qui pourrait les gêner ou leur nuire. En
vertu d'une loi Julia sur la matière, les rues de la ville et celles des
faubourgs sont interdites pendant presque toute la journée aux chariots
pesamment chargés et même aux chars des particuliers ; ils ne peuvent y
circuler qu'après la dixième heure du jour aux Calendes de Janvier, jusqu'au
lever du soleil du jour suivant. L'édit n'admet d'exception que pour le
transport des matériaux nécessaires à la construction d'un temple ou d'un
édifice public, ou pour enlever d'un lieu public des matériaux de démolition
; encore faut-il obtenir une autorisation préalable. La plupart des rues sont
si étroites, le sol de la ville est si montueux, qu'une circulation un peu
active de ces pesants chariots serait vraiment dangereuse pour les passants, et
qu'il a fallu la diminuer autant que possible. Parmi les exceptions il faut
compter encore les voitures des Vestales, du Roi des sacrifices, des Flamines,
ainsi que les chars qui figurent dans certaines cérémonies religieuses, et
dans les pompes triomphales.
Les Édiles, tu le vois, exercent une surveillance générale ; mais comme ces
magistrats sont trop peu nombreux, l'action potentielle, qui doit agir sur tous
les points à la fois, se délègue en partie à un autre ordre de magistrats,
secondés eux-mêmes par des officiers subalternes. Les quatorze régions de la
ville, organisation récente de l'Empereur (auparavant on n'en comptait que
quatre), se subdivisent en deux cent soixante-cinq quartiers, formant comme
autant de gouvernements et sous-gouvernements. Chaque région est sous
l'autorité supérieure d'un chef, tiré au sort parmi les édiles, les tribuns
du peuple, et les préteurs ; chaque quartier, sous l'administration directe
d'un Curateur nommé par l'édile, le tribun, ou le préteur préposé à la
région. Ce Curateur, choisi dans le quartier, est plébéien et affranchi. Un
Dénonciateur, bas officier, l'accompagne en tous lieux. Il a, en outre, quatre
lieutenants dits Procurateurs ou Maîtres de quartiers, affranchis aussi. Enfin
ces derniers ont eux-mêmes chacun un esclave sous le nom vague de ministre. Les
Curateurs veillent à la rentrée et l'équitable perception des impôts ; les
Maîtres de quartiers, institués déjà dans l'ancienne République,
maintiennent l'ordre et la sûreté dans les rues. Les uns et les autres ont
droit, à certains jours de fête, de porter la prétexte des magistrats, dans
leurs circonscriptions respectives, et de se faire précéder de deux licteurs.
L'ensemble de ces fonctionnaires forme un effectif de quinze cent
quatre-vingt-dix individus.
Il y a une dérogation à cet arrangement du gouvernement de police de Rome,
pour deux régions, la XIIIe et la XIVe, autrement
l'Aventin et le Janicule : ces deux points étant hors de l'enceinte sacrée (le
Pomoerium, dont j'ai parlé) sont considérés comme « bourgs, » bien
qu'appartenant à la ville. Chacun a un maître de bourg pour toute sa
circonscription. Cela existe depuis les premiers temps de Rome, et c'est par
suite de cette séparation que les célèbres sécessions de la plèbe, aux
troisième, quatrième et cinquième siècle, eurent lieu sur l'Aventin ou sur
le Janicule.
La Préfecture de la ville date du temps de la royauté : lorsque les rois
s'absentaient, ils nommaient pour les suppléer un magistrat temporaire qui,
sous le titre de gardien de la ville, rendait la justice à leur place, et
remédiait aux accidents imprévus.
Les Consuls, héritiers du pouvoir royal, se firent aussi suppléer, mais
perpétuellement. Les Tribuns du peuple se chargèrent de les remplacer dans les
affaires domestiques ; puis, trop occupés eux-mêmes, le peuple demanda au
Sénat l'autorisation d'élire annuellement deux plébéiens pour soulager ses
Tribuns dans toutes les choses où ils auraient besoin d'aide, juger les causes
que ces derniers leur renverraient, avoir soin des édifices sacrés, inspecter
les édifices privés, veiller à la commodité des vivres, et fixer le prix des
denrées. Les Sénateurs ayant consenti à cette nouvelle demande, l'an deux
cent soixante on créa deux magistrats qui furent appelés Édiles, de celles de
leurs fonctions touchant aux édifices sacrés et privés. Ils durent être pris
parmi d'anciens questeurs, âgés de vingt-sept ou vingt-huit ans, c'est-à-dire
plus jeunes que les tribuns du peuple. On leur donna, comme aux Tribuns, un
viateur pour marque de leur pouvoirs.
Environ cent trente ans après la création de ces Édiles, deux autres furent
institués qui, pris parmi les patriciens, n'eurent d'abord d'autres
attributions que de faire célébrer certaines fêtes religieuses. Ensuite
quelques fonctions de judicature et de police leur furent déléguées ; et par
la force des choses, par une sorte de loi qui fait que tout pouvoir nouveau non
contesté devient envahissant, ils finirent par effacer presque les édiles
plébéiens leurs aînés, à les réduire à n'être plus guère que leurs
auxiliaires. Ces nouveaux Édiles furent appelés curules, parce qu'en raison de
leur noble origine, ils étaient assimilés aux grands magistrats et avaient
aussi la chaise curule. On ne pouvait les élire que parmi les citoyens âgés
au moins de trente ans.
L'envahissement de l'Édilité curule rencontra peu d'obstacles, parce que dès
la seconde année de son établissement les plébéiens y purent être admis.
Néanmoins l'Édilité plébéienne garda, comme elle garde encore, la marque
originelle de son infériorité : les citoyens qui l'occupent, créés pour
être les lieutenants des Tribuns du peuple, n'ont, à l'instar de ces derniers,
ni la toge prétexte, ni la chaise curule.
Pendant que les deux Édilités se partageaient, bien que d'une manière
inégale, l'administration de la ville, la Préfecture urbaine s'amoindrissait,
et finit par s'éclipser entièrement lorsqu'on eut achevé de diviser des
attributions devenues trop importantes pour pouvoir être cumulées ; je veux
parler des attributions purement judiciaires, pour lesquelles deux magistrats
spéciaux nominés Préteurs, dont je parlerai plus tard, furent institués.
Il y avait trois siècles qu'on ne nommait plus de Préfet de la ville, lorsque,
pendant les dernières guerres qui déchirèrent la République, l'Empereur
confia l'administration générale de Rome et de l'ltalie à Mécène, son
ministre. Depuis, devenu maître de l'Empire, et considérant la grande
population de Rome, la lenteur des secours qu'on trouve dans les lois, il
chargea un consulaire de contenir les esclaves, et cette partie du peuple dont
l'esprit turbulent et audacieux ne connaît de frein que la crainte. Telle fut
la manière dont il ressuscita la Préfecture urbaine.
Une institution non moins utile, et due encore à l'Empereur, est celle d'une
troupe de gardes nocturnes. L'an 718, après la défaite des enfants de Pompée,
l'Italie, Rome et la Sicile étaient infestées de brigands qui exerçaient
leurs pillages à force ouverte. César Octave chargea un de ses légats,
Calvisius Sabinus, de réprimer leurs attentats. Un grand nombre furent pris et
suppliciés, et dans l'espace d'une année, la tranquillité et la sécurité
régnèrent partout. Ce prompt résultat causa tant de satisfaction à César
Octave, qu'il voulut conserver pour Rome une institution d'abord créée
temporairement. Elle prit le nom de Vigiles, et fut chargée d'assurer la
sécurité de la Ville contre les voleurs et les bandits, au moyen de rondes
nocturnes. Le corps se compose de sept cohortes, soit quatre mille deux cents
hommes, soldats légionnaires ; un tribun commande chaque cohorte, et le corps
entier a pour chef unique un commandant, dit Préfet des Vigiles, choisi par
l'Empereur dans l'ordre. Équestre. Les sept cohortes sont réparties dans la
ville de manière qu'une seule surveille deux régions et puisse secourir
d'autres cohortes. Prends la petite carte Site et Murs de Rome, j'y ai marqué
d'une étoile les stationnements des Vigiles, et tu saisiras d'un coup d'oeil la
bonne distribution de ces postes. Ainsi, la Ire cohorte stationne
dans la VIIe région, auprès de la porte Sanqualis, et garde aussi
la IXe ; la IIe siège dans la Ve région, vers
la porte Esquiline. et l'Agger de Servius, et veille aussi la IIIe ;
la IIIe cohorte est sur la VIe région, et son service
s'étend sur la IVe ; la IVe cohorte loge à l'Aventin,
dans la XIIIe région, et garde aussi la XIIe ; la Ve
appartient à la IIe région et protège en même temps la Ire,
hors des murs ; la VIe reste dans la VIIIe région et
comprend la Xe dans son service ; enfin la VIIe cohorte,
logée dans la XIVe région, hors des murs, prolonge son service
sur la XIe. Les trois stations des VIIe, XIIe
et XIVe régions sont les seules hors des murs : il n'en existe plus
d'autres pour les faubourgs.
Cette création des Vigiles n'est, comme bien d'autres, qu'un perfectionnement
d'antiques institutions ou coutumes : ainsi, depuis les premiers siècles de
Rome, jamais après le coucher du soleil, les magistrats ne peuvent paraître
dehors avec leur caractère public. Créés pour s'occuper des affaires du
peuple, et toutes cessant à la chute du jour, ils n'ont plus alors de pouvoir
légal, et rentrent, de fait, dans la classe des simples. citoyens. Cet usage,
établi dans l'enfance de Rome, ne pouvait subsister sans de graves
inconvénients quand l'importance de la ville et son opulence en eurent fait le
rendez-vous d'une foule de gens sans aveu, vivant de larcins et de vols, et
souvent employant la violence comme auxiliaire de leur astuce. Cependant les
Romains ayant un grand respect pour leurs coutumes, n'abolirent pas celle-ci,
mais la neutralisèrent en instituant, vers la fin du cinquième siècles, trois
magistrats chargés de faire des rondes de nuit. Cette surveillance incessante
était d'autant plus nécessaire, que le port d'armes ayant toujours été
défendu dans la ville, le citoyen ne peut se protéger lui-même. On appela les
nouveaux magistrats Triumvirs nocturnes ; on mit sous leurs ordres cinq citoyens
ou Quinquevirs pour les suppléer dans les quartiers tant au delà qu'en deçà
du Tibre.
Le Préfet des Vigiles avec ses cohortes, ses tribuns, ses centurions, a
remplacé sans désavantage les Triumvirs nocturnes et les Quinquevirs ; aussi
l'Empereur l'a-t-il investi d'une certaine juridiction : il juge les voleurs
simples, les voleurs avec effraction ou violence, et les receleurs, à moins que
l'infamie attachée au délinquant ne le rende justiciable du Préfet de la
ville.
Il y a aussi certaines mesures prises contre les incendies, cet éternel fléau
de Rome, malgré la déesse Stata, qui a des statues dans tous les quartiers,
parce qu'elle est censée arrêter les ravages du feu : trois Triumvirs
nocturnes, nom pris de leur nombre et du temps où leur vigilance doit surtout
s'exercer, veillent, avec un corps d'esclaves, à la répression des incendies,
et sont eux-mêmes sous les ordres d'un Préfet spécial, qui répond du service
sous peine de punition. Cette création date, m'a-t-on dit, de la fin du IVe
siècle, après l'invasion de Brennus qui brûla Rome. Les Édiles et les
Tribuns du peuple interviennent aussi dans ces occasions sinistres, et
quelquefois aussi de simples citoyens avec leurs propres esclaves, à prix
d'argent ou gratuitement. Depuis peu de temps, les Édiles curules en sont plus
spécialement chargés, par suite d'un ordre de l'Empereur, qui leur a donné
une troupe de six cents esclaves pour ce service, afin qu'ils n'aient besoin de
l'aide de personne.
Outre ces deux gardes de nuit, il y en a une autre de jour, pour protéger les
citoyens et maintenir l'ordre dans Rome : c'est un corps de six mille soldats,
divisé en quatre cohortes, dont trois sont toujours dans la ville', réparties
dans quatorze excubitoria ou corps de garde, un par région.
Voilà tout le gouvernement de Rome, sauf deux où trois magistratures pour
l'approvisionnement et la vente du blé, la distribution des eaux vives, et
l'administration de la justice. Je ne les connais pas encore assez pour t'en
parler aujourd'hui; elles mériteront, je crois, d'être traitées à part. Ce
que nous venons de voir de la Police est un assez vif reflet du gouvernement de
l'Empire : l'esprit d'un seul la domine. En effet, le Préfet de la ville et
celui des Vigiles sont les créatures de l'Empereur, et l'on peut en dire à peu
près autant des Édiles, bien qu'élus dans les comices par tribus, parce que
les comices ne font guère qu'obéir au chef de l'Empire. Mais ce dernier
simulacre de liberté pourra disparaître aussi bientôt, car l'Édilité tend
à s'abolir elle-même : autrefois, c'était le premier degré pour arriver au
consulat et au commandement des armées ; certains jeux publics que les Édiles
doivent donner au peuple leur en frayaient le chemin, alors que le peuple était
tout puissant. Depuis que la seule grande influence est celle de l'Empereur,
l'Édilité est devenue une charge sans, profit ; aussi, dernièrement, les
comices devant élire de nouveaux édiles pour l'an prochain, il ne s'est pas
présenté de candidats. C'est un fait phénoménal dont on n'avait encore vu
qu'un exemple pendant la désastreuse époque du Triumvirat. Cependant
l'Empereur voulait des édiles, et pour en avoir il n'a rien imaginé de mieux
que de réunir d'anciens questeurs ou tribuns du peuple, et de les faire tirer
au sort pour en condamner quatre à l'édilité. Autrefois c'eût été là un
événement énorme : aujourd'hui on n'y fait presque pas d'attention ;
seulement les gens qui l'ont remarqué en ont tiré la conclusion que désormais
le sort devra souvent tenir lieu des comices édilitiens.
ACHÈVEMENT. Les Vigiles militaires subsistaient depuis quarante-un ans, lorsque l'Empereur Auguste eut l'idée de créer aussi des Vigiles contre les incendies. C'était en 759, un certain nombre de ces malheurs avaient affligé la Ville, et plusieurs le même jour. Déjà il avait essayé, l'an 747, de rendre la répression plus efficace, en mettant la troupe des six cents esclaves sous les ordres des quatorze curateurs des régions, plus nombreux que les édiles curules ; en 759, allant plus loin, il remplaça la troupe des six cents esclaves par sept cohortes d'affranchis, qui formèrent un second corps de Vigiles, auquel il donna un Préfet pour chef, car ce titre qui signifie "préposé" s'applique à une foule de fonctions très diverses. Les accroissements et les embellissements de Rome exigeaient cette réforme. Les chances d'incendie étant plus nombreuses dans les faubourgs que dans la ville, Auguste répartit ses nouveaux Vigiles aux environs des portes et des murs de Rome en autant de corps de garde qu'ils ont de cohortes ; comme les murs passent presque partout sur des points culminants, et sont fort épais, les Vigiles peuvent monter dessus pour guetter au loin. En outre, ils entretiennent toute la nuit des rondes armées de crocs et de haches pour les premières attaques du feu. Le Préfet est investi d'une certaine autorité, et même d'une juridiction sur les citoyens : il avertit les locataires des maisons d'avoir soin qu'aucun feu n'arrive par leur négligence, et de tenir de l'eau dans les coenacula ; il juge les incendiaires, et comme l'incurie des habitants cause la plupart des incendies, l'Empereur lui a donné le droit d'infliger la bastonnade à ceux qui ont laissé du feu à l'abandon, ou de leur faire tout au moins une sévère réprimandes. Les riches, qui redoutent plus que personne les incendies , ont chez eux un esclave guetteur dit insulaire, parce qu'il veille autour de l'île que forme souvent une vaste demeure. Voilà bien des précautions sagement prises, au nombre desquelles je mets l'effectif des nouveaux Vigiles, égal à deux tiers de légion. Cependant à peine suffit-il dans les cas extraordinaires, qui sont ici moins rares qu'ailleurs. Il semble que le caractère extrême de Rome se reflète dans tout ce qui la touche, même pour les phénomènes de la nature : ainsi, il y a des années où les inondations du Tibre minent et ruinent les quartiers bas de la ville ; où des tempêtes fréquentes empêchent, pendant plusieurs mois de suite, les assemblées du peuple, et sont quelquefois si atroces, qu'elles dévastent les édifices, renversent les statues les plus lourdes , et arrachent jusqu'à des tables de lois, en airain, clouées aux murs des temples. Enfin viennent aussi les maladies contagieuses, appelées du nom général de «pestes, » suite naturelle d'une saison inclémente, et les incendies, fléau presque quotidien, et qui s'est bien des fois élevé à la hauteur d'une calamité publique. On m'a souvent parlé d'un de ces feux dévastateurs, qui, vingt-huit ans environ avant mon arrivée, réduisit presque toute la ville en cendres ; il éclata dans plusieurs quartiers à la fois, sans que jamais on en ait su la cause. La forte garde d'affranchis créée par l'Empereur a bien sa raison d'être, et sa création n'a pu être inspirée que par une prudence trop bien fondée. Plusieurs années après cet immense désastre, il en restait encore des traces nombreuses, et si profondes, que l'Empereur dut puiser dans le Trésor public des sommes considérables pour soulager les plus malheureux de ceux que le fléau avait atteints.
DU GOUVERNEMENT DE L'ITALIE.
Il
y a vingt ans environ, l'Italie s'étendait depuis le golfe de Tarente jusqu'au
petit fleuve du Rubicon, vers la mer Adriatique, et jusqu'à Luna, du côté de
la mer Tyrrhénienne. Maintenant elle va jusqu'aux Alpes et comprend toute la
Gaule Cisalpine.
Cette réunion fut faite peu d'années après la mort de César, lors de la
rupture du Triumvirat, au moment où l'Empereur, alors Octave, s'apprêtait à
marcher contre Antoine. Il trouva dangereux de laisser exister aussi près de
Rome une province, c'est-à-dire un pays avec un proconsul et une armée, et il
en prononça la réunion à la péninsule italique indépendamment de toute
autre considération, donner les Alpes pour limites à cette dernière contrée,
c'était lui assigner ses frontières naturelles. Mais je ne saurais t'exposer
la condition politique actuelle de l'Italie sans te parler d'abord de sa
condition ancienne.
L'Italie se composait autrefois de douze nations indépendantes. Chacune
renfermait plusieurs petits peuples qui tous avaient leurs lois, leur
gouvernement, leurs magistrats particuliers, et formaient autant d'États
séparés, dont quelques-uns ne se composaient uniquement que de bourgs : tous
ensemble ne formaient aucun grand corps de nation.
La fortune de Rome voulut que ce fût au milieu de ces petites peuplades que la
future ville-reine fût fondée. Admirablement placée pour se créer un État
et un territoire aux dépens de voisins faibles qu'aucune ligue né réunissait,
elle devint conquérante d'abord par nécessité, puis par caractère. Dès les
premiers temps elle mit en pratique la grande maxime politique que depuis elle a
constamment suivie : diviser pour régner.
Comme elle respecta les lois et les usages des pays conquis ; qu'elle fut assez
sage pour ne point vouloir faire la guerre aux moeurs ; il arriva que chaque
peuple, chaque province, put conserver son gouvernement. Elle se contentait de
dire aux vaincus : Je pourrais vous imposer mes lois, je vous laisse libres,
soyez mes alliés à telle condition. Dans les premiers temps, elle avait été
obligée d'absorber plusieurs peuples pour se donner à elle-même quelque force
et quelque consistance ; mais une fois ce but atteint, sa conduite fut toujours
telle que je viens de le dire.
La liberté laissée aux peuples conquis était, à la vérité, bien précaire,
car Rome les plaçait sous sa dépendance, en leur défendant de contracter
entre eux ni alliances politiques, ni alliances privées, sans sa permission ;
en leur ôtant quelquefois une partie de territoire, pour y fonder çà et là
des colonies, véritables armées permanentes en observation renfermant de la
cavalerie et de l'infanterie ; enfin, en leur imposant des tributs en hommes et
en argent.
L'expérience ayant démontré la bonté de ce principe, il fut toujours
pratiqué depuis ; César l'employa contre nos Gaules ; l'Empereur l'a imité,
en fondant des colonies sur le Rhin, afin d'assurer cette frontière contre nos
frères les Germains.
La tolérance politique envers les vaincus, quoique bien entendue en général,
eut cependant ses inconvénients : c'est que ces peuples, jouissant toujours de
leurs gouvernements, trouvèrent plus de facilités pour se révolter contre une
alliée aussi exigeante que Rome, et profitèrent souvent des occasions qui se
présentèrent.
Cet état de guerres incessamment renaissantes fit un peu mitiger la politique
romaine, et Rome mit les rigueurs et les bienfaits au nombre des moyens propres
à retenir ses vaincus dans l'obéissance. Elle concéda divers droits aux
peuples qui se montrèrent les plus fidèles, et sévit contre ceux qui
l'irritèrent par des révoltes ou des trahisons. La privation de la liberté,
pour un premier manquement à la foi des traités ; la destruction de la ville,
la confiscation d'une partie du territoire, ou même la déportation de tous les
habitants hors de leur pays, furent la punition des récidives plus ou moins
sérieuses. Rome était impitoyable dans ses vengeances. En voici un exemple qui
dure depuis trois siècles et demi : les Bruttiens, peuple de l'Italie
méridionale, prirent parti pour Annibal pendant la seconde guerre Punique.
Après la victoire ils furent privés à perpétuité, eux et leurs descendants,
de tous les droits d'hommes libres, et condamnés à servir d'appariteurs et de
messagers aux gouverneurs de provinces. Le nom de « Bruttiens » a dès lors
été, et reste encore synonyme « d'esclaves publics ».
Le système des bienfaits pour récompenser la fidélité, et des rigueurs pour
punir la trahison, donna naissance aux Municipes ou villes municipales, aux
villes Latines, aux villes Fédérées, et aux Préfectures. Ces diverses
conditions n'étant, en résumé, que celle des Colonies romaines, plus ou moins
altérée, plus ou moins incomplète, il faut que je te fasse connaître d'abord
cette dernière.
Les Colonies romaines furent comme autant de petites images, de copies de Rome
leur métropole. Elles observèrent les mêmes lois, la même jurisprudence, la
même religion, les mêmes fêtes ; elles eurent aussi deux Consuls et un Sénat
de cent membres, les Consuls appelés Duumvirs, de leur nombre, et les
sénateurs, Décurions, parce que dans la fondation d'une colonie on décimait
les colons pour composer le conseil public. Les Duumvirs, au lieu d'être
annuels comme les Consuls, furent nommés pour plusieurs années. Ils eurent
exactement le pouvoir qu'ont les Consuls à Rome, et de plus, leurs fonctions ne
les absorbant pas autant, ils rendirent la justice. Les colons jouissaient de
tous les privilèges de la Cité romaine, excepté du droit de Suffrage et du
droit d'Honneurs à Rome. Ces colonies, établies pour surveiller et contenir
des peuples conquis, auraient manqué au but de leur institution si l'on avait
donné à leurs citoyens ces deux droits, qu'ils ne pouvaient venir exercer
qu'en abandonnant leur poste. Ils y furent même comme enchaînés pendant une
grande partie de leur vie, et la loi ne permit aux colons primitifs de revendre
le lot de terre qu'ils avaient reçu, que vingt ans après la prise de
possession. Passons aux villes qui n'étaient point romaines d'origine. Les
Municipes, qu'il faut placer en tête, étaient des villes de pays conquis. Par
une faveur toute spéciale, Rome les gratifia des droits de Cité romaine, don
magnifique, incessamment rappelé par leur nom même, tiré de munus,
présent. Leur constitution, assez semblable à celle des colonies romaines,
ressemblait surtout à celle de la grande métropole, réformation qui paraît
s'être faite depuis la suppression de la royauté à Rome, car la plupart des
peuples italiotes commencèrent aussi par avoir des rois. Les Municipes eurent
leurs trois ordres, le sénat, les chevaliers, et le peuple ; leurs consuls
appelés duumvirs, comme dans les colonies, ou quatuorvirs quand ils étaient
quatre ; ou bien édiles, dictateurs, questeurs, toujours d'un nom romain, et en
nombre arbitraire, un dictateur, trois édiles, un ou plusieurs questeurs.
Les sénateurs portaient le nom de décurions. On y élut les magistrats et on y
sanctionna les lois dans des assemblées populaires, comme à Rome. Les
Municipes purent posséder des terres dont ils se firent un revenu, soit en les
cultivant, soit en les affermant, et il n'y eut pas nécessité que ces terres
fussent en Italien. Cette ressemblance de leur constitution avec celle de la
grande république doit d'autant moins étonner, que beaucoup de Municipes
adoptèrent la législation romaine, devinrent ce que l'on appelle peuples fundi.
Ce ne fut pas là cependant une condition de rigueur pour obtenir la
municipalité, et d'autres villes gratifiées de ce droit conservèrent leurs
sacrifices, pour lesquels elles ont un préfet spécial, leurs fêtes, leur
gouvernement indigène, leurs lois, comme Massilie, par exemple, dans la Gaule
Narbonnaise. Un point sur lequel les Municipes l'emportèrent sur les Colonies,
c'est qu'on leur accorda quelquefois le droit de suffrages et celui d'honneurs.
Lorsque Rome eut conquis le Latium, elle ne voulut pas admettre Ies Latins à
ses droits de cité : ainsi elle ne leur reconnut ni le pouvoir paternel absolu,
ni le droit de tutelle', ni le droit de testament, ni celui d'héritage envers
un citoyen romain. Les traitant en vaincus, elle leur défendit de se marier
hors de leur territoire, et ne leur accorda pas l'inviolabilité personnelle ;
ils purent être battus de verges et mis à mort Mais voulant néanmoins
s'attacher les habitants d'une province qui s'étendait jusqu'à ses portes,
elle déclara que tout citoyen Latin qui aurait été dans son pays préteur ou
dictateur (ce sont les grandes magistratures Latines) deviendrait de droit
citoyen romain, et que celui qui n'aurait pas été magistrat pourrait encore se
faire inscrire parmi les citoyens romains pourvu qu'en abandonnant sa patrie il
y laissât une postérité mâle, au moins un fils âgé d'un an. L'ensemble de
ces restrictions et de ces privilèges reçut le nom de Droit de Latium. On le
concédait comme une faveur du deuxième ordre à d'anciennes villes conquises,
et quelquefois à de nouvelles colonies.
Les villes qui n'étaient liées avec Rome que par un traité d'alliance
offensif ou défensif réciproquement, ou qui leur interdisait de faire la
guerre ou même de se défendre, Rome se chargeant de pourvoir à leur sûreté,
étaient nommées Fédérées, du mot même de traité, foedus, qui
rappelait leur condition. Elles conservaient leur . gouvernement, leurs lois,
et, suivant la condition de leur traité, presque toujours impératif du côté
de Rome, contribuaient plus ou moins au service militaire et à l'entretien des
armées. Sous une ombre d'alliance c'était une servitude.
Ces mêmes charges pesaient aussi sur les Colonies romaines, les Municipes, les
Colonies et les villes Latines ; les Colonies maritimes étaient seules
dispensées du recrutement : gardiennes des côtes, appeler leurs citoyens
ailleurs eût été affaiblir l'État.
Les villes Municipales ou Fédérées, qui, à la suite de révoltes ou de
trahisons, avaient été privées de leurs droits de cité et de leur
gouvernement, reçurent de Rome un magistrat ou plusieurs (quelquefois quatre),
élus par le peuple pour certaines villes, et pour d'autres par le Préteur
urbain. Ils étaient envoyés pour y rendre la justice, ce qui de fait
soustrayait ces petites républiques à leur propre gouvernement. On les nomma
Préfectures, du titre du magistrat qui les gouvernait.
Aucune des constitutions dont je viens de parler, pas même celle qui porte le
nom de Droit de Latium, n'était particulière à une province ou région
spéciale de l'Italie et l'on rencontrait souvent les unes auprès des autres
des Colonies, des villes Fédérées, des Municipes, des Préfectures ; mais
tous ces petits États ne formaient qu'un faisceau sous l'influence de la forte
République romaine, à laquelle ils tenaient par des liens de société, de
fédération ou de servitude, et dont le Sénat pouvait faire comparaître
devant lui les principaux magistrats, pour les juger s'ils ne se conduisaient
pas avec loyauté et fidélité. Enfin c'est la liberté du client, avec
sujétion, avec obligation de respecter et de défendre la majesté du peuple
romain.
Ce fut ainsi que, sans se constituer nominalement souveraine de l'Italie, Rome
parvint à s'en rendre maîtresse. Les subsides qu'elle exigeait de ses alliés
devinrent si considérables, quand elle commença à porter la guerre au dehors,
qu'enfin ces peuples ouvrirent les yeux ; ils virent que leur état était une
servitude réelle, puisqu'à chaque guerre et tous les ans, ils fournissaient un
double contingent de troupes à pied ou à cheval, qu'ils équipaient et
défrayaient ; et les colonies maritimes, des vaisseaux et des matelots ; que,
véritables défenseurs de Rome, cette ville avait acquis par leur puissant
secours la grandeur dont elle était fière ; et cela sans dédommagement pour
eux-mêmes des charges qui les accablaient, presque aucun, par le fait de la
privation des droits de Cité romaine, et des droits de suffrage et d'honneurs,
n'ayant d'influence sur ce gouvernement central, qui commandait la guerre et
seul en retirait tout le profit .
En effet, jusqu'à l'an six cent cinquante-neuf, le nombre des villes
Municipales de l'Italie s'élevait à peine à vingt, sur lesquelles un peu plus
de la moitié environ jouissait du droit de suffrage joint au droit de cité ;
et encore la presque totalité était-elle des villes du Latium. Déjà cette
iniquité avait été remarquée : C. Gracchus tenta de la faire disparaître,
en proposant de donner le droit de suffrage à tous les Latins, ainsi qu'à tous
les peuples fédérés de l'Italie. Il échoua. Le Tribun Livius Drusus reprit
ce projet et en obtint l'adoption ; mais il paya de sa vie un instant de
réussite, et le vote d'une loi qui ne fut point exécutée après lui.
Ces tentatives augmentèrent la convoitise des peuples pour le droit de suffrage
: un grand nombre de Colons et de Fédérés s'en emparèrent par fraude, en se
donnant pour citoyens romains. Une loi (la loi Licinia-Mucia) fut rendue l'an
six cent cinquante-huit pour arrêter et réprimer ces usurpations. Elle
indisposa violemment les principaux peuples de l'Italie, et devint la principale
cause d'une guerre terrible (la guerre Italique ou Sociale), qui éclata cinq
ans après. La plupart des peuples de la partie orientale de l'Italie se
liguèrent ensemble, et réclamèrent, d'abord par une ambassade au Sénat, qui
l'accueillit avec hauteur, puis les armes à la main, ces privilèges de Cité
romaine, ou, pour mieux dire, ce droit de suffrage qui leur était si bien dû,
et que d'ailleurs on leur avait promis. Ils succombèrent dans une lutte
opiniâtre qui dura trois ans, fit perdre à l'Italie plus de trois cent mille
hommes, la fleur de sa jeunesse, et mit Rome dans le plus grand danger :
néanmoins ils obtinrent, après leur défaite et leur soumission, les
privilèges vainement réclamés avant la guerre ; le peuple romain aima mieux
les leur accorder lorsqu'ils furent abattus et désarmés, que lorsqu'ils
étaient puissants et ligués. Néanmoins, les populations restées fidèles,
les Latins, les Sabins, et d'autres, les reçurent les premières comme
récompense de leur fidélité : la loi Julia, rendue l'an six cent
soixante-quatre, par le préteur Sext. Julius César, qui avait été l'un des
consuls chargés d'abord de combattre les révoltés, les leur conféra. On
n'admit les rebelles au droit de Cité romaine que trois ans après, en vertu de
la loi Pompeia, portée par le père du grand Pompée.
Les Romains eurent raison de n'accorder à ces provinces le droit de Cité
romaine que le plus tard possible, et seulement après qu'une longue domination
les eut identifiées avec la grande république centrale. J'ai fait voir combien
il est important de ne point déranger les colons de chez eux ; l'était-il
moins de ne pas attirer dans la ville, par le droit de suffrage, qui ne peut
s'exercer qu'à Rome, une multitude de peuples nouvellement conquis, et
mécontents encore de leur défaite? de leur fournir ainsi l'occasion de se
compter, de comparer la supériorité numérique de leurs forces réunies, de
les mettre à même d'attaquer les vainqueurs au sein de leurs foyers, ce qui
eût été facile, surtout dans les grands Comices, où ls citoyens sont
toujours venus en armes ? Voilà pour-quoi les droits de Cité romaine furent si
souvent accordés sans le droit de suffrage.
Une autre crainte arrêtait encore les Romains, celle de se trouver à la merci
de ces peuples, et de les-rendre maîtres des Comices. Quand ils se virent
contraints de leur concéder le droit de suffrage, ils y mirent une condition
qui empêcha beaucoup de l'accepter : c'était que ceux qui voudraient jouir de
la Cité romaine renonceraient d'abord à leurs propres lois et se feraient fundi.
Ensuite ils trouvèrent moyen, pour les étrangers qui se soumettaient, de
rendre à peu près illusoire le privilège capital de leur nouvelle position :
l'inscription dans une tribu constituant le droit de suffrage, ils
concentrèrent ces nouveaux citoyens dans les huit dernières tribus, des
trente-cinq dont se composait l'agrégation politique du peuple romain, afin
qu'ils ne devinssent pas plus puissants que ceux qui les avaient admis à
l'isopolitie.
La loi Julia n'avait donné le droit de Cité romaine qu'aux provinces de
l'Italie proprement dite ; la loi Pompeia l'étendit jusqu'à la Gaule
Cispadane, et Jules César, l'an sept cent cinq, y admit la Gaule Transpadane,
qui avait été sous son commandement. Cette concession facilita, neuf ans plus
tard, la réunion de la Cisalpine, réunion dont j'ai parlé au commencement de
cette lettre.
L'Italie, encore aujourd'hui comme avant la guerre Sociale, a des Municipes, des
villes Fédérées, des Colonies, des Préfectures. Cependant l'Empereur, soit
pour effacer d'anciennes divisions territoriales rappelant la conquête, soit
dans des vues d'une meilleure administration, a soumis, depuis plusieurs
années, toute cette contrée à une sorte d'uniformité politique en la
partageant en onze régions, désignées seulement par un numéro d'ordre . Il,
a en outre établi que dans les Municipes, les Colonies et les Préfectures,
tout citoyen âgé de vingt-deux ans pourrait occuper une magistrature
inférieure. Auparavant (cela en vertu d'une loi romaine dite Julia municipale,
portée par Jules César), l'âge magistral était de trente ans, et, par
exception, de vingt-trois et de vingt-six ans pour les citoyens qui avaient fait
trois campagnes dans la cavalerie légionnaire, ou six dans l'infanterie. La
même loi exigea que pour être magistrat ou décurion, il faudrait n'avoir subi
aucune condamnation judiciaire, ni exercé aucune basse profession, comme celle
de héraut , de comédien, de marchand d'esclaves, ou de libitinaire, sous peine
d'une amende de cinquante mille sesterces.
L'Empereur a introduit aussi une autre réforme assez heureuse dans l'exercice
du droit de suffrage, à peu près abandonné par les citoyens des provinces ou
des régions, dans l'impossibilité où ils sont de quitter leur pays plusieurs
fois par an pour venir voter à Rome dans les Comices ; il a permis aux
Décurions des colonies de prendre part à l'élection des magistrats de la
ville, en envoyant à Rome, le jour des Comices, leurs bulletins cachetés.
Ainsi donc, en nous résumant, l'Italie forme une agrégation de petites
républiques qui toutes ont leur gouvernement particulier, les unes régies par
leur propre législation, le plus grand nombre par la législation romaine, mais
toutes dépendant de Rome, contribuant à ses charges de guerre, et ne pouvant
ni rien entreprendre, ni rien faire au dehors sans son consentement préalable.
LES MAQUIGNONS ET LES ESCLAVES.
Je
descendais il y a peu de jours sur le Forum romain, lorsque je vis une grande
foule rassemblée auprès du temple de Castor, devant quelques tavernes
adossées au soubassement de l'un des côtés du temple. Je m'approchai,
toujours curieux d'observer, et je vis sur des échafauds des hommes, des
femmes, des jeunes garçons et des jeunes filles Tous, dans un état presque
complet de nudité, avaient un petit écriteau pendu au cou ; quelques-uns
étaient coiffés d'un bonnet de laine blanche tout uni, prenant la forme du
haut de la tête ; d'autres d'une couronne de laurier ; un plus grand nombre
avaient les pieds frottés de craie ou de gypse.
Un homme d'une figure ignoble, à l'air brutal et grossier, se promenait devant
les échafauds, et s'adressant à la foule avec une Volubilité et une assurance
imperturbables : « Rien ne me presse de vendre, citoyens; je suis pauvre, mais
je ne dois rien. Un autre ne vous les laisserait pas à ce prix, et moi-même je
ne les donnerais pas à d'autres qu'à vous, illustres Quirites. Voyez-moi cela,
continua-t-il en désignant un jeune homme exposé près de lui ; examinez comme
il est blanc ! comme il est beau de la tête aux talons ! admirez ses yeux
noirs, sa belle chevelure noire. Il entend parfaitement de ses deux oreilles, il
voit très bien de ses deux yeux, il est sain de corps et sain d'esprit. Je vous
garantis sa frugalité, sa probité, sa docilité ; il obéit au moindre signe :
c'est une argile humide ; on en fait tout ce qu'on veut. Il sait un peu de grec,
il chante quoiqu'il n'ait point de musique, et peut égayer un festin. C'est un
enfant des bords du Nil. » Puis s'approchant davantage, et le frappant
légèrement sur les joues avec le revers de la main : « Entendez-vous comme
cela résonne ? Quelle chair ferme ! la maladie n'aura jamais prise là-dessus.
Pour huit mille sesterces il sera bel et bien à vous. Est-ce cette jeune fille
que vous voulez ? Je vous garantis son innocence. » - Et la tirant à lui, il
lui donna trois ou quatre baisers : - « Voyez comme elle rougit ! ajouta-t-il,
quel meilleur témoignage de sa vertu et de sa modestie ? » Passant ensuite à
un jeune enfant à la peau d'ébène : - « Allons, toi, lui dit-il, fais voir
ta gentillesse aux maîtres du monde. » - Et l'enfant de sauter, de tourner, de
gambader sur ses planches, de débiter mille plaisanteries, de faire mille
agaceries lascives pour tenter la foule qui le regarde. - « Est-il leste !
est-il joli! est-il mignon! ajouta l'homme. Mais, citoyens, entrez dans ma
taverne, vous verrez mieux que tout cela : ce n'est ici que mon étalage ; tout
ce que j'ai de plus rare, de plus beau, de plus délicat, de plus séduisant, de
plus admirable, est sur les échafauds intérieurs ; veuillez entrer, citoyens,
veuillez entrer. »
Plusieurs personnes cédèrent à l'invitation, et pendant ce temps le
maquignon, c'est-à-dire le marchand d'esclaves (tu as déjà reconnu qu'il
s'agit d'un de ces trafiquants), fit commencer une enchère par un héraut. Tout
auprès se tenait un homme devant qui étaient une table et une balances. Le
jeune esclave qui avait fait mille gambades tenta divers spectateurs ; ils le
firent dépouiller entièrement, pour voir s'il n'avait pas quelque difformité
cachée, ordonnant qu'on lui ôtât un ruban de parure qu'il avait au poignet,
et sous lequel pouvait être dissimulé un défauts ; ils s'informèrent de son
âge, de son pays , et l'enchère commença. La mise à prix fut de quatre mille
sesterces ; elle monta à six mille, et s'arrêta à huit mille. L'acquéreur
sortit de la foule, et tenant un as à la main, prononça la formule suivante :
« Je dis que ce jeune garçon, d'après le droit des Quirites, est à moi, et
que je l'ai acheté avec cette monnaie et cette balance. » Il fit sonner la
pièce d'airain dans la balance, compta le prix convenu, puis l'esclave lui fut
remis. Ainsi se passent la vente et l'acquisition des esclaves. J'en vis vendre
quelques autres encore, qui ne furent payés que deux mille à deux mille deux
cents sesterces environ, qui me parut être le prix moyen ordinaire.
A Rome, où tout est si bien organisé, où il y a de grands centres dans
lesquels on trouve réunies, par espèces, les diverses choses dont chacun peut
avoir besoin pour la vie ; où les industries secondaires se sont à peu près
agglomérées dans tels ou tels quartiers, je m'imaginais qu'il y avait aussi un
marché aux esclaves ; je me trompais, il n'existe aucun établissement de ce
genre, et tout cet immense trafic se fait dans des tavernes, et plus souvent à
domicile, par des marchands qui ont toujours provision de cette espèce de
marchandise humaine. Mais je me sers à tort des termes de « marchands » et de
« marchandise ; » les hommes ne sont point réputés marchandise bien qu'on
les vende, et ceux qui en trafiquent ne sont point appelés marchands, mais
Maquignons, ainsi que je l'ai dit en tête de ma lettre, vendeurs de choses
vénales. Le nom de Maquignon vient d'un mot grec qui signifie « prestige, »
ou d'un verbe qui veut dire « tromper par des prestiges, » arranger avec art ;
il est tout à la fois une désignation et une définition. En effet, il ne se
fait pas de trafic où l'on soit plus exposé à être trompé, ni de
trafiquants plus voleurs et plus astucieux que les Maquignons, qui, du reste,
sont les plus méprisés et les plus méprisables des hommes. Comme le parjure
est pour eux la moindre des choses, et qu'ils se jouent de tout respect humain
ou divin, il a fallu que la loi leur imposât une sorte de probité forcée,
dont ifs ne peuvent se départir sans encourir certains dommages en argent ou
certaines punitions ; ainsi un édit des Édiles curules les oblige à pendre au
cou des esclaves qu'ils mettent en vente un écriteau relatant d'une manière
très intelligible les maladies ou les vices de chacun, faisant connaître s'il
est fugitif, vagabond ; s'il est libre de toute espèce. de lien, c'est-à-dire
s'il n'a pas commis quelque délit qui pourrait donner lieu à une poursuite en
dommages et intérêts ; s'il est novice ou s'il a déjà servi, car on
préfère les novices, parce qu'on les croit plus simples, et surtout plus
propres à être employés à toutes sortes de fonctions.
Si l'acheteur découvre un défaut qui ne lui ait pas été annoncé, il a droit
de rompre le marché, et de rendre l'esclave à celui qui le lui a vendu. Le
Maquignon, pour avoir essayé de tromper, est passible d'une peine corporelle ou
d'une amende pécuniaire, évaluée sur les conditions du marché, et pouvant
s'élever quelquefois au double du prix de l'esclave dont les défauts ou les
vices non patents donnent lieu au cas rédhibitoire. La non-déclaration du pays
de l'esclave est un de ces cas, de même que l'épilepsie. Pour ce mal, on
pratique cependant sur place une épreuve qui doit, dit-on, le faire découvrir
immédiatement : elle consiste à exposer le sujet à une fumigation de gagate,
sorte de pierre noire poreuse, exhalant dans le feu une odeur de soufre qui fait
tomber les épileptiques. Les procès sur la tromperie sont si chanceux, que
souvent on transige avec le Maquignon : l'acquéreur qui n'est qu'à moitié
trompé, au lieu d'user de toute la rigueur de son droit, se contente d'une
simple réfraction sur le prix de la vente.
Pour assurer ces indemnités fortuites, bénévoles, ou forcées, le vendeur
donne des cautions. Ces dispositions fort prudentes sont gâtées, suivant moi,
par une autre bien singulière : c'est que la responsabilité du Maquignon cesse
s'il peut prouver qu'il a indiqué le défaut ou la maladie de l'esclave
seulement par signes, ce qui arrive assez souvent ; ou bien s'il s'est contenté
de vanter ses qualités, mais sans les garantir formellement, chose qui ne
prête pas moins à la fraude, tout le monde ne songeant pas à cette belle
distinction entre dire et promettre, la promesse seule étant un engagement.
Ces règlements s'appliquent aussi aux citoyens qui vendent des esclaves sans en
faire métier ; seulement ils sont dispensés de garantir ceux provenant d'un
héritage : on suppose que le vendeur ne connaît pas leurs défauts.
Le cas de garantie pour la santé n'est applicable pour per sonne aux esclaves
femelles enceintes. Quand les Maquignons ne veulent prendre aucune
responsabilité, ils doivent l'indiquer en coiffant d'un bonnet de laine blanche
les individus qu'ils rangent dans cette catégorie. L'acheteur se trouve averti
par là de se tenir sur ses gardes.
La couronne de laurier sur la tête indique le prisonnier de guerre, et les
pieds frottés de gypse ou de craie, les esclaves venus d'outre-mer. Ainsi, du
premier coup d'oeil, on connaît l'origine , les défauts et les qualités de
chacun.
Mais les jeunes esclaves de luxe étant très chers et très recherchés, les
Maquignons (et c'est par là surtout qu'ils méritent leur nom) ont inventé des
sophistications pour tromper tout à la fois et les magistrats et la nature ; au
moyen de certaines plantes, telles que le vaciet, ou la racine d'hyacinthe
infusée dans du vin doux, et employée en frictions, ils retardent chez les
jeunes sujets les signes de la puberté, ou les dissimulent.
En ont-ils dont les formes soient trop fluettes, trop délicates, ils leur
frottent tout le corps avec de la térébenthine, pour corriger leur maigreur en
élargissant les pores de la peau, et les rendre capables de contenir beaucoup
d'aliments : c'est ce qu'on appelle maquignonner les jeunes esclaves. D'autres,
afin de leur conserver les formes juvéniles, vont jusqu'à leur retrancher la
virilité, parce que la force des muscles et des bras, le poil et la barbe que
la nature a donnés aux mâles sont sans grâce pour eux, comme pour beaucoup de
maîtres qui préfèrent le service de ces esclaves mutilés. En un mot, ils
emploient tous les moyens de faire valoir et de parer les malheureux objets de
leur trafic, et ils ont continuellement à la main les pinces épilatoires, le
peigne, le miroir, les ciseaux, et le fer à friser.
Voici une petite anecdote qui pourra te donner une idée de l'effronterie et de
l'impudence de ces misérables. L'un d'eux nommé Thoranius, fameux dans sa
profession, avait vendu au triumvir Antoine deux enfants d'une rare beauté, et
si ressemblants, qu'il les avait fait passer pour jumeaux, quoique l'un fût né
en Asie et l'autre au delà des Alpes. La différence des idiomes trahit
bientôt la fraude. Antoine entre soudain en fureur, fait venir le Maquignon,
et, l'accablant d'injures, lui reproche, comme principal grief, la somme
exorbitante qu'il avait exigée ; elle n'allait pas à moins de deux cent mille
sesterces ! - « Pourquoi vous irriter en enflant les deux joues ? répond
Thoranius sans s'effrayer : ces enfants ne vous plaisent plus; ne cherchons
point un noeud dans un jonc, je les reprends. Le prétendu défaut dont vous
vous plaignez est au contraire ce qui fait leur plus grand mérite ; une
ressemblance entre deux jumeaux n'aurait rien de merveilleux ; mais la trouver
complète entre deux sujets nés dans des contrées si différentes, cela n'a
point de prix, et au lieu de me réprimander, vous devriez au contraire me
remercier. Faut-il que j'aie été assez champignon de ne vous en pas demander
davantage ! Mais vous n'en voulez plus : soit; un autre les payera plus cher. »
- Cette réponse obtint un plein succès ; le triumvir passa tout d'un coup de
la rage d'avoir été pris pour dupe, à l'admiration la plus passionnée pour
son acquisition, qu'il voulut garder, l'estimant dès lors comme plus précieuse
que tout ce qu'il possédait.
Les tavernes de ces « trafiquants de chair, » comme on les appelle, sont
alimentées en partie par la guerre. De tout temps les Romains ont, comme nous,
vendu leurs prisonniers. Les Maquignons les achètent de la République, ou des
soldats auxquels les généraux les donnent comme part de butin. On n'épargne
ni les femmes, ni les enfants, et la victoire se fait la pourvoyeuse de la
servitude. C'est même de là que viennent les noms de Servus et de Mancipium,
par lesquels on désigne les esclaves, parce qu'ils sont conservés, servati,
par la guerre, et qu'on les prend avec la main, manu capiuntur.
La piraterie fournit aussi Rome d'esclaves. Après la destruction de Carthage et
de Corinthe, les Romains devenus riches s'accoutumèrent à un nombreux
domestique ; les pirates, saisissant cette occasion que leur fournissait le
luxe, se mirent en course pour piller, et priver de leur liberté ceux qu'ils
rencontraient ; l'île de Délos, dans la mer Égée, était le repaire de leurs
proies, et il s'en faisait un trafic si considérable, que sur ce point seul, le
mouvement d'entrée et de sortie était de plusieurs milliers d'esclaves, non
par mois, mais par jour !
Les Romains ayant organisé leur personnel domestique avec toute la prodigalité
d'une prodigieuse opulence, ont établi dans sa plus grande extension la
division du service ; chez les riches, non seulement un esclave ne remplit
jamais plusieurs offices, mais souvent il y a plusieurs esclaves pour un même
office : ce sont les atrienses, chargés de l'entretien de l'atrium ;
l'apprêteur de lits pour les festins; les cubiculaires, pour le service de la
chambre à coucher ; le secrétaire de la main pour écrire les lettres, en
imitant l'écriture du maître, comme s'il eût écrit lui-même ; les lecteurs
; les introducteurs ; les nomenclateurs ; le dispensateur ou intendant ; le
manieur de monnaies (caissier) ; les commentariaires, ou teneurs de comptes ;
les vélaires, pour les voiles des portes; les conservateurs de la vaisselle
d'argent ; ceux des ornements d'argent et d'or ; ceux du mobilier, des portraits
ou images de famille, des statues, des tableaux ; les baigneurs ; les parfumeurs
; les cuisiniers ; les dresseurs ; les serveurs ; les dégustateurs ; les
échansons ; les portiers ; les palefrenier s; les muletiers ; les lecticaires ;
les coureurs ; les tabellaires, etc., etc.
Dans une grande maison la femme du maître a aussi son service à part ; ce sont
ses portiers ; ses aguayeurs ou porteurs d'eau ; son accoucheuse ; ses
coiffeuses ; ses distributeurs de laine ; ses ouvrières en vêtements ; son
esclave de la chaise ; sa porteuse d'éventail ; sa porteuse d'ombrelle ; ses
suivantes ; sa gardeuse de chienne ; sa nourrice, et bien d'autres encore. Il
deviendrait fastidieux d'épuiser cette liste ; d'ailleurs j'ai déjà parlé en
son lieu de quelques-uns de ces nombreux esclaves, et j'aurai plus d'une fois
encore l'occasion d'y revenir, suivant le besoin de mes récits. J'ajouterai
seulement ici qu'il y a plus de cent vingt emplois divers, uniquement pour les
esclaves de la ville ! Ils sont si nombreux qu'on les appelle la « plèbe de la
maisons ; » que beaucoup ne voient jamais, ne connaissent pas même leur
maître, et que les maîtres ne pouvant connaître tous ceux attachés à leur
service, sont obligés d'avoir un esclave spécial pour les leur nommer au
besoins. Il y a telle maison dans Rome où l'on trouve quatre cents, cinq cents
esclaves, et plus. Un certain Cécilius Isidorus, qui vient de mourir, en a
laissé, tant à la ville qu'à la campagne, quatre mille cent seize !
La plèbe domestique est divisée comme une armée, par décuries. Chaque
décurie a un chef ou décurion et ses fonctions fixes, sa province, comme on
dit, en empruntant une expression à un ordre de choses plus élevé. Les
esclaves attachés au service personnel sont assortis par âge et par couleur.
Enfin les serviteurs d'une grande maison sont si nombreux, que le maître peut
n'avoir à demander aucun service du dehors pour les besoins de la vie les plus
vastes et les plus multipliés. Il ne paraîtrait pas moins honteux à un riche
de ne pas être ainsi en état de se passer de tout le monde étranger à lui,
que d'habiter dans une maison à loyer. Il y a de la grandeur dans cette
manière d'envisager les choses ; rien n'est aussi dispendieux, mais, suivant
les Romains, une maison est pauvre si l'on n'y trouve en tout le plus abondant
superflu.
Cependant il y a certains calculs économiques habituellement pratiqués, et il
faut que je te dise comment un aussi nombreux domestique n'est pas ruineux pour
les maîtres, et surtout comment ils le maintiennent dans le devoir et dans
l'obéissance.
Un philosophe a défini les esclaves des «mercenaires perpétuels.» Telle est
effectivement leur condition, avec cette différence cependant qu'ils reçoivent
leur salaire en nature, c'est-à-dire que leur maître les loge, les nourrit et
les habille. Une grande parcimonie préside surtout à leur nourriture; les
malheureux ne sont nourris que de pain, qu'ils assaisonnent d'un peu de sel, et
ne boivent que de l'eau. Ils reçoivent leur ration en blé, à raison de cinq
modii par mois, distribués le premier jour du mois, sous le nom de demensum,
ou quotidiennement sous le nom de diarium, et produisant environ cent
huit livres de pain. Cette nourriture est si insuffisante, que les esclaves qui
servent dans les festins dérobent toujours quelque choses des plats qu'ils
enlèvent de la table pour les porter à l'office.
Chez les gens qui calculent, et font passer leur intérêt avant leur vanité,
les esclaves peuvent être un revenu plutôt qu'une dépense. Certains maîtres
les organisent en corps de métiers, et soit qu'ils les fassent travailler pour
eux, soit qu'ils louent leur travail à d'autres, ils en tirent un bon produit.
Rappelle-toi ce que je t'ai dit des tonstrines.
L'âge, les accidents, les maladies, tendent à diminuer, à détruire une
bande, un personnel, une famille d'esclaves. C'est donc une propriété d'une
valeur naturellement décroissante. Cependant cette chance de perte est
efficacement combattue par le contubernium. On nomme ainsi un simulacre
de mariage que les maîtres permettent, comme récompensé, entre leurs esclaves
des deux sexes. Tous les enfants qui naissent de ces unions leur appartiennent,
et remplacent, en partie du moins, les vides produits par la mort. Ce croît de
la famille forme une race d'esclaves qu'on appelle verne, de vere nati,
vraiment nés dans la maison.
Je n'ai pas besoin d'entrer dans de longs détails pour te faire connaître la
condition civile des esclaves ; qui dit esclave, dit tout : c'est un individu
qui n'a ni droit d'aucune sorte, ni aucune volonté permise, qui ne jouit
d'aucune protection légale, qui est la propriété, la chose de celui qui le
possède, et qui lui-même ne peut rien posséder. Mais de même qu'on permet
aux esclaves un simulacre de mariage, de même on leur laisse un simulacre de
propriété ; on leur accorde la permission d'avoir quelques petites sommes en
biens meubles ou immeubles : c'est ce qu'on nomme un pécule. Ce n'est qu'à
force de patience, de sobriété, en économisant sur sa ration de vivres, aux
dépens de son ventre, qu'un esclave vient à bout de commencer un pécule. Le
premier emploi qu'il en fait est ordinairement d'acheter un ou deux vicaires ou
suppléants, pour le soulager dans une partie de son service, et lui laisser le
temps de grossir lui-même son petit avoir. Il est assez singulier que des
esclaves aient des esclaves ; mais les maîtres permettent cela même aux
esclaves femelles, qui peuvent avoir des vicairesses ; ils sont, sur ce point,
d'autant plus faciles, qu'ils y trouvent leur intérêt, parce que, suivant la
loi, tout ce qui est acquis par l'esclave est acquis au maître : ainsi les
vicaires, et tout le pécule, quel qu'il soit, l'esclave n'en est que
l'usufruitier à titre précaire : le maître peut s'en emparer, le retenir pour
lui, soit qu'il vende son esclave, soit qu'il le lègue, soit, qu'il
l'affranchisse. Cette propriété appartient si peu au malheureux qui l'a
gagnée, qu'il n'en saurait avoir la gestion sans le consentement formel de son
maître, et que si dans la vente ou le legs d'un esclave elle n'est pas
expressément mentionnée, elle ne suit pas la condition de cet esclave, et
reste au vendeur. Le pécule est donc un capital pour les maîtres, ou tout au
moins un fonds de revenus pour ceux qui croient devoir le respecter, parce
qu'alors, à certaines époques solennelles, telles que l'anniversaire de leur
naissance, le mariage de leurs enfants, les couches de leurs filles, ils exigent
que les esclaves leur fassent des présents. Aussi un esclave péculieux est
toujours regardé comme un bon sujet.
Je ne sais pas s'il est exact de dire que l'on méprise ce que l'on craint ;
cependant les Romains sont animés de ce double sentiment pour leurs esclaves ;
ou mieux, ils craignent l'espèce en général, et méprisent les individus. Les
esclaves sont, à leurs yeux, tout au plus « une seconde espèce humaines, »ou
même « moins que des hommes . » Les citoyens chez qui les lumières de la
philosophie sembleraient devoir développer des sentiments d'humanité se
montrent tout aussi durs que les autres : Caton l'Ancien voulait que l'on vendit
ses esclaves quand ils étaient vieux, afin de ne point nourrir des êtres
inutiles ; j'ai vu une lettre de Cicéron, dans laquelle il écrit à l'un de
ses amis : « Je viens de perdre un aimable garçon nommé Sosithée, qui me
servait de lecteur, et j'en suis plus affligé qu'on ne devrait, ce me semble,
l'être de la mort d'un esclave. » Singulière honte ! qui regarde comme une
faiblesse un mouvement d'humanité !
On ne fait pas plus d'attention à un esclave qu'à un chien. Croiras-tu que
dans les grandes maisons le portier est attaché auprès de sa porte avec une
longue chaîne reliée à un anneau de fer rivé à chaque jambe ! Souvent on le
vend avec la maison quand elle change de maître, comme s'il tenait
invinciblement à la muraille où sa chaîne est scellée, comme s'il faisait
partie intégrante de sa construction !
Par suite du profond mépris qu'inspirent les esclaves, les maîtres n'osent pas
les employer dans bien des circonstances où ils le pourraient avec succès : «
Si l'un de vos esclaves s'est distingué par une fidélité exemplaire,
écrivait encore Cicéron, il y a quelques années, à son frère Quintus,
employez-le dans vos affaires domestiques et privées ; mais pour ce qui tient
au devoir de votre empire et aux intérêts publics, qu'il n'y porte jamais la
main. Un esclave fidèle pourrait s'acquitter avec succès de bien des emplois,
que cependant il ne faut pas lui confier, pour éviter les discours et le blâme
»
Un édit consulaire, rendu il y a une quinzaine d'années, a défendu de les
choisir pour licteurs ; et cela se conçoit quand on réfléchit qu'un licteur
peut être appelé par les devoirs de sa charge à porter la main sur un citoyen
romain. Il y a cependant des esclaves qui, sous le nom « d'esclaves publics du
peuple romain, » sont employés à des fonctions très subalternes auprès de
quelques prêtres et de divers magistrats. Ils reçoivent un salaire annuel sur
le Trésor public ; ils ont aussi le privilège de pouvoir acquérir en propre,
et celui de disposer par testament de la moitié de leurs biens.
Mais pour les esclaves privés, ils sont si méprisés, surtout ceux employés
au service domestique, qu'il est des maîtres qui la plupart du temps ne
daignent pas même leur parler : ils leur commandent par signes, par un geste de
la main, les appellent par un bruit des doigts. Quand il faut plus
d'explication, certains poussent l'orgueil jusqu'à écrire, de peur de
prostituer leurs paroles ! D'autres évitent, autant que possible, que leurs
esclaves leur parlent ; ils leur permettent seulement de répondre aux questions
sans y ajouter un seul mot. Je me trouvais hier à souper, chez un orateur
nommé Publius Pison. Les conviés étaient arrivés, à l'exception d'un seul.
Pison envoie son invitateur (c'est encore une fonction spéciale d'esclave)
s'informer s'il ne viendrait pas.
Cependant nous attendons toujours et l'heure se passe. Enfin, quand il fut si
tard qu'il n'y eut plus d'apparence que l'on pût compter sur le retardataire :
« Tu as été l'inviter ? dit Pison à son esclave. - Oui.-- Que t'a-t-il
répondu ? - Qu'il ne viendrait pas. - Que ne le disais-tu ? - Vous ne me-l'avez
pas demandé. »Enfin, la législation ne fait aucune différence entre les
esclaves et les bêtes ; une loi condamne à la même peine l'individu qui aura
tué l'esclave ou la bête de somme d'autrui ; il doit en payer le prix, qui
varie suivant que l'esclave était infirme ou valide, suivant le plus ou moins
de dommage causé au maître par sa mort.
Les Romains abusent avec une effroyable dureté du pouvoir absolu, de la
puissance sans frein que la loi donne au maître sur ses esclaves : ils les
traitent littéralement comme des animaux. L'immensité de la population servile
de Rome fait, dit-on, une nécessité d'une pareille conduite ; la douceur, ou
seulement l'équité compromettrait tout. Il y a plus de quatre cents ans,
déjà le nombre des esclaves était assez considérable pour inquiéter la
villes. Les anciens Romains redoutaient le génie de l'esclavage même dans le
temps où les esclaves, moins nombreux, et naissant dans les mêmes champs, sous
même toit, puisaient avec le jour l'attachement pour leurs maîtres. Ils les
contenaient alors par une terreur profonde, poussée jusqu'à la cruauté la
plus inique. Brutus affranchit comme sauveur de la patrie l'esclave qui vint lui
dénoncer la conjuration de ses fils en faveur de Tarquin, et le fit ensuite
crucifier comme délateur de ses maîtres. Dans le siècle dernier, Sylla
répéta à peu près l'action de Brutus : ayant promis la liberté aux esclaves
des proscrits qui décèleraient leurs maîtres, un esclave vint lui révéler
l'endroit où le sien se tenait caché. Sylla, pour demeurer fidèle à son
édit, affranchit ce parricide, mais dès qu'il fut libre, il le condamna à
mort pour crime de trahison envers son maître, et le fit précipiter de la
Roche Tarpéienne, comme citoyen.
La plus sévère cruauté vis-à-vis des esclaves est une tradition, et comme un
principe que les Romains n'ont jamais oublié ; l'Empereur en a fourni un
mémorable exemple : il y a douze ou quatorze ans, il fit arrêter tous les
esclaves qui pendant les guerres
civiles avaient été enrôlés dans la milice, soit d'eux-mêmes, en s'évadant
de chez leurs maîtres ; soit par la volonté de leurs maîtres, dont plusieurs
avaient ainsi formé des légions entières. Pendant la guerre civile, le Sénat
était intervenu, et sur la demande de Sextus Pompée la liberté avait été
accordée à ces nouveaux soldats, et même garantie par des traités ; mais des
esclaves ne doivent pas être dans le droit commun ; ni les engagements, ni les
promesses les plus authentiques ne sont valables avec eux : l'Empereur envoya,
dans chacune des armées de la République, une dépêche cachetée avec
injonction de ne l'ouvrir qu'à un jour fixe déterminé par lui. Elle contenait
l'ordre de saisir les soldats esclaves, et de les expédier à Rome. Au jour dit
on les arrêta tous, au nombre de trente-mille. Ceux qui purent être réclamés
furent rendus à leurs maîtres, ou aux héritiers de leurs maîtres, à Rome ou
en Italie. La même restitution eut lieu à l'égard des propriétaires de la
Sicile. Les malheureux que personne ne revendiqua, l'Empereur les fit égorger
dans les villes d'où ils étaient sortis, ou mettre en croix ; le nombre en
était de six mille !
Les anciens Romains défendaient à leurs esclaves toute relation avec des
étrangers, et de plus prenaient soin d'entretenir ouvertement la
mésintelligence entre eux, tenant leur amitié et concorde pour suspectes et
redoutables. Depuis qu'un maître, à moins de connaître toutes les langues, ne
peut plus parler à ses esclaves sans un interprète ; depuis que Rome voit dans
ses foyers toutes les nations ensemble de moeurs si opposées, de religions si
bizarres, souvent même n'en ayant point, il ne faut pas moins qu'une telle loi
pour imposer à ce ramas de barbares, et encore Rome tremble-t-elle au moindre
bruit d'une révolte d’esclaves.
Je conçois la dureté politique des Romains envers la race serve, et j'admets
qu'elle puisse être une nécessité ; mais elle a un grand défaut, c'est
d'habituer les esprits à ces sentiments inhumains, de sorte que la conduite
privée de bien des maîtres avec leurs esclaves est vraiment féroce. Je te
disais tout à l'heure que les esclaves ne peuvent ouvrir la bouche devant leurs
maîtres ; j'ajouterai qu'ils doivent être complètement silencieux : un accès
de toux, un éternuement, un hoquet, un souffle, sont autant de crimes suivis du
châtiment. Les plus légers manquements au service ne sont pas moins
sévèrement punis : on m'a cité un homme qui souvent frappe ses esclaves sans
qu'ils aient failli, uniquement de peur de n'avoir pas le temps de sévir quand
l'occasion s'en présenterait !
Les châtiments les plus horribles et les plus barbares sont infligés aux
esclaves : la fourche, le fouet, les verges, l'aiguillon, la torture, la marque,
les chaînes, la prison, la mort ! Je ne compte point parmi les châtiments les
coups qu'on leur donne sur la bouche, de manière à leur ébranler les dents,
ou bien sur la figure, et pour lesquels ils sont obligés de venir tendre la
joue et de la gonfler, afin que le soufflet soit mieux appliqué ; cela arrive
si fréquemment, que c'est tout au plus une simple punition.
La Fourche est une pièce de bois fixée sur la poitrine et aux épaules, et
s'étendant jusqu'aux extrémités des deux bras, qui sont attachés dessus. Le
condamné ainsi garrotté, et dépouillé de ses habits, est promené par le
milieu des places, des rues les plus fréquentées de la ville, et battu de
verges de baguettes d'orme, pendant toute cette promenade, par d'autres
esclaves, ses compagnons. Un écriteau pendu sur sa poitrine révèle la faute
pour laquelle il est châtié. Quelquefois le pauvre patient est obligé de la
confesser lui-même à haute voix.
Le Fouet se compose de plusieurs cordes à double tresse, ou de lanières de
cuir, garnies de balles de plomb et de noeuds. Le malheureux qui subit ce
supplice est nu, il a les poignets serrés dans des menottes, qui, par le moyen
d'une corde manoeuvrée sur une poulie fixée à une poutre, servent à
l'enlever et le tenir suspendu en l'air. Ensuite, afin que son corps en se
balançant sous le choc des coups n'en amortisse pas un peu la violence, on lui
attache aux pieds un poids de cent livres. Après que le pauvre esclave a été
taillé de coups, qui lui ont déchiré jusqu'à la chair, on le dépend, si
toutefois la cruauté de son maître est assouvie ; sinon, on le laisse encore
pendu pendant une nuit entière !
Le fouet est un des châtiments les plus prodigués : aussi voit-on beaucoup
d'esclaves qui, à force d'avoir été fouettés, en ont des calus sur les
reins.
Les femmes ne sont pas exemptes de ces cruautés, et n'inspirent pas plus de
pitié : elles sont esclaves. Ainsi, pour la plus légère faute, une matrone
fait suspendre une malheureuse par ses cheveux tordus en corde, et battre de
verges.
L'Aiguillon, moins cruel que le fouet, n'est qu'un châtiment instantané, pour
hâter la lenteur ou la paresse de l'esclave, exactement comme avec le boeuf de
travail. Les femmes en usent familièrement ; leur arme est une grande aiguille
de tête, presque un petit poignard, qu'elles enfoncent dans le bras des pauvres
filles appelées à les habiller et à les parer.
Pour mettre à la Torture on étend le patient sur un chevalet, on le déchire
à coups de verge ; on lui tiraille, on lui comprime les membres jusqu'à faire
craquer ses os, et on le brûle avec des lames de fer ardent. On répète
quelquefois cette cruelle opération jusqu'à six et huit reprises de suite. Les
maîtres s'y prêtent sans difficulté, pourvu qu'on s'engage, lorsque ces
tortures sont appliquées par suite d'une affaire judiciaire, à leur payer les
sujets qui périraient pendant le supplice.
La Marque a quelque chose de plus affreux peut-être, en ce que ce châtiment
est pour ainsi dire perpétuel ; on rase la tête et les sourcils du coupable ;
ensuite, une lettre de fer, la lettre F ; rougie au feu, lui est appliquée sur
le front, et le marque à perpétuité du nom de fugitif, ou de furcifer.
Les Chaînes et la Prison ne sont qu'une même chose, tous ceux qui sont jetés
en prison y étant enchaînés.
La Mort a lieu par le crucifiement. On attache sur la poitrine du condamné un
écriteau indicateur de son crime, et on le conduit à travers le Forum, en le
battant de verges, jusqu'en dehors de la porte Esquiline, sur une place nommée
Sestertium, destinée au supplice des esclaves. Là il est cloué sur une croix,
par un bourreau à qui le séjour et même l'entrée de Rome sont interdits. On
le laisse mourir de faim et de souffrances sur l'instrument du supplice, où son
corps est abandonné en pâture aux corbeaux et aux autres oiseaux de proie.
Si tu savais pour quels légers délits ces horribles châtiments sont
prodigués ! Jules César fit mettre aux fers un esclave qui avait servi à ses
convives un pain différent du sien. Caton l'Ancien, que j'ai déjà cité,
fouettait lui-même, aussitôt après le souper, ceux de ses serviteurs qui
avaient servi négligemment ou mal apprêté quelques mets. Qu'un pauvre esclave
dérobe la moindre chose ; qu'en desservant il touche à un reste de poisson ou
de ragoût, c'est assez pour qu'un maître cruel le fasse crucifier. Que trop
justement épouvanté de sa condition, il prenne la fuite, s'il est repris (et
il est rare qu'il ne le soit pas, car toutes les facilités sont fournies à son
maître pour le retrouver et le ressaisir), s'il est repris, dis-je, on le
marque.
Qu'un maître soit atteint par une accusation publique, ou qu'un vol ait été
commis dans la maison, aussitôt on applique tous ses esclaves à la torture,
non chez lui, mais à l'Atrium de la liberté, lieu de cette information
judiciaire, près du Forum romain. L'esclave cité en justice comme témoin
subit le même supplice, parce que sans la torture ses dépositions ne seraient
pas légalement valables. Une loi défend de requérir le témoignage des
esclaves contre leurs maîtres, sauf dans les affaires de conjuration et de
sacrilèges. Cette loi avait des inconvénients, on vient de la modifier ainsi :
quand la justice voudra entendre en témoignage les esclaves d'un accusé, le
juge ordonnera de les vendre à l'Empereur ou à la République, alors,
étrangers à l'accusé, ils pourront être interrogés contre lui, toujours
sous la garantie de la torture. On a vu dans de telles circonstances des sujets
torturés de la manière la plus affreuse, et, bien que le supplice n'ait pu
leur arracher aucun aveu, envoyés à la mort comme criminels.
Chez les anciens Romains, la condition des esclaves était, je ne dirai pas
moins dure, mais douce : leurs maîtres vivaient et travaillaient avec eux. Ils
appréciaient d'autant mieux leurs services, qu'ils n'avaient tout juste que le
nombre de serviteurs nécessaire, souvent un seul, ainsi que le prouvent les
noms de Quintipore, Marcipore, Lucipore, qu'on leur donnait, c'est-à-dire,
Marci-puer, Luci-puer, esclave de Marcius, esclave de Lucius. La modestie
touchant le nombre des esclaves se conserva assez longtemps : vers la fin du
cinquième siècle, Manius Curius, consul et trois fois triomphateur, n'avait
pour le servir dans les camps que deux Calones (valets de soldats) ;
Caton l'ancien, partant comme préteur en Espagne, l'an 560, emmenait trois
esclaves, puis, arrivé à la. Villa publica, craignant que ce ne fût pas
assez, il envoya au Forum acheter à la criée deux autres petits esclaves. Une
soixantaine d'années après, Carbon, consul l'an 622, et qui fut maître de la
République, n'avait que sept esclaves. Enfin, un autre illustre consulaire du
milieu du septième siècle, l'orateur Antoine, n'en possédait que huit.
Aujourd'hui, le personnel des esclaves est si nombreux, qu'on les dénomme
volontiers par le nom de leur pays, tels que Syrus, Cappadox « Syrien,
Cappadocien, » Hydaspes, équivalent d'Indien, et que sa couleur noire rappelle
aisément, etc. La maison du maître était jadis la République et la patrie
des esclaves. Loin de les traiter avec mépris, on cherchait à dissimuler
l'odieux de l'esclavage en les appelant familiers, c'est-à-dire « serviteurs,
» comme les enfants mêmes du maître, qui, lui, était appelé père de
famille. On se sert bien encore de ces désignations, mais depuis longtemps
elles ont perdu leur signification, et ne sont plus qu'une contre-vérité.
En effet, pour en revenir aux punitions, les maîtres ne sévissaient alors
qu'en vrais pères de famille, et l'une des plus grandes peines qu'ils faisaient
subir à leur familiers était de leur mettre un bois fourchu sur la nuque, et
de les promener ainsi par la ville. Très rarement fouettait-on un esclave, et
plus rarement encore le faisait-on mourir. Je ne crois pas qu'alors, ainsi que
cela a lieu maintenant, le fouet, ce terrible instrument de supplice, demeurât
perpétuellement en évidence au milieu de la maison comme un épouvantail
toujours menaçant.
Les maîtres d'aujourd'hui s'évertuent à raffiner de cruauté. J'en ai cité
tout à l'heure quelques exemples, parmi lesquels j'ai oublié celui d'un
Minucius Basillus, qui vient d'être égorgé par ses esclaves pour avoir voulu
faire infliger à quelques-uns d'entre eux le supplice de la castration. Mais
voici qui surpasse. tous ces traits de férocité : il y a quelque temps,
l'Empereur étant en Campanie soupait à Pausylippe, près de Naples, chez
Védius Pollion, riche chevalier romains. Un esclave casse un vase précieux ;
Védius fait aussitôt saisir le maladroit, et, comme s'il avait commis le plus
énorme des crimes, le condamne à un supplice extraordinaire, à être jeté
vivant à de grosses murènes, espèce de serpents aquatiques qu'il nourrit dans
une piscine, moins pour satisfaire sa gourmandise que pour assouvir sa cruauté.
L'esclave s'échappe et vient se jeter aux pieds d'Auguste, demandant, non qu'on
lui fît grâce de la vie, il connaissait trop bien son maître, mais à périr
d'une autre manière, et à n'être pas mangé par ces poissons cruels.
L'Empereur s'abaisse jusqu'à implorer la pitié de Pollion, qui demeure
inexorable ; alors, ému d'indignation et de colère, il accorde d'abord grâce
complète au coupable, puis, se faisant apporter tous les vases pareils à celui
dont la perte avait si fort irrité Védius, il les brise lui-même
sur-le-champ. Non content de cela, il commande de combler l'infâme piscine dans
laquelle ce Védius, de race d'affranchi, se donnait le spectacle d'un homme
vivant dépecé et dévoré en un instant par les monstres marins qu'il
engraissait de chair humaines. L'Empereur était apparemment en veine de bonté
ce jour-là, car il y a peu de temps il a fait crucifier un de ses esclaves pour
s'être passé la méchante fantaisie de rôtir et de manger une caille qui,
dans les combats de ces petits animaux, battait toutes les autres et avait
toujours été invincible.
Aucune loi ne protège les esclaves : la législation ne s'est occupée d'eux
que pour les châtier. Ainsi, quand un crime public a été commis, quand un
maître a été assassiné chez lui, la loi condamne à périr par le supplice
de la croix tous les esclaves indistinctement qui se sont trouvés sous le même
toit au moment du crime. Voici le raisonnement sur lequel on appuie cette
disposition si rigoureuse : un esclave forme rarement le projet de tuer son
maître sans que la moindre menace lui échappe, sans que la moindre
indiscrétion le trahisse ; en supposant même que son dessein demeure
impénétrable, qu'il prépare ses armes dans le plus grand secret, il ne peut
franchir la garde de nuit, enfoncer les portes, consommer le meurtre sans que
personne l'aperçoive. En effet, un maître a tant de motifs de crainte, que
toujours quelques esclaves veillent la nuit à la porte de sa chambre.
Ce serait peut-être ici le lieu de parler des esclaves employés à la
campagne, malheureux accablés de travaux pénibles, et qui, bien que n'étant
pas en rapport perpétuel avec des maîtres durs et cruels, n'ont pas, comme
ceux de la ville, de petits sujets de distraction, n'ont pas la taverne, où, de
temps en temps, ils trouvent moyen de venir chercher dans de grossiers plaisirs
l'oubli momentané de la servitude ; mais je n'aime à parler que de ce que j'ai
sous les yeux, et plus tard je trouverai l'occasion de voir aussi les esclaves
rustiques. Aujourd'hui je compléterai mon tableau des esclaves urbains en te
faisant connaître deux classes qui ne sont soumises habituellement ni aux
mépris, ni aux punitions corporelles infligés à. leurs compagnons de
servitude, bien que rien ne les en garantisse en droit ; mais parce que leurs
fonctions les rendent les favoris de leurs maîtres.
La première classe se compose des pédagogues : ce sont de jeunes enfants
beaux, bien faits, et que les Romains attachent plus spécialement au service de
leur personne. Ils les tirent d'Égypte, et particulièrement d'Alexandrie. Il y
a là des maquignons qui élèvent cette jeunesse pour la société et les
plaisirs des conquérants du monde, qui lui font enseigner à répondre avec
finesse, malice et promptitude, et à jaser agréablement ; aussi les « doctes
enfants du Nil, » comme on les appelle, sont-ils très recherchés. Les Romains
leur réservent principalement les fonctions d'échansons dans les festins, et
s'en servent pour satisfaire tour à tour leur ivrognerie et leur impudicité.
Ces enfants, auxquels on donne de jolis noms, tels que Hyacinthe, Achille,
Narcisse, Anthus, d'un mot grec qui signifie fleur, sont toujours bien parés et
bien assortis. En service, on les range selon leur pays, leur taille, la
longueur de leur poil follet, la qualité de leurs cheveux. Il ne faudrait pas
qu'une chevelure lisse fît contraste avec une chevelure frisée. On prend un
soin extrême de leur beauté, à ce point que, quand leur maître les emmène
en voyage, non seulement il les fait placer sur des chars, mais encore ils ont
la figure enduite de graisse, de peur que le soleil n'endommage leur peau douce
et délicate, n'altère la fraîcheur de leur teint.
La seconde classe se compose d'individus plus sérieux : ce sont des hommes ou
de jeunes hommes instruits dans les lettres, et qui à cause de cela sont
appelés à faire en quelque sorte partie de la société de leurs maîtres ;
ils leur servent de secrétaires, de copistes, de lecteurs. Les uns sont pour
les lettres grecques, les autres pour les lettres latines. Des amateurs
achètent ces esclaves savants dans la vue de tirer parti de leur savoirs, comme
d'autres spéculent avec des esclaves dressés aux métiers de maçon, de
charpentier, ou de forgeron. Ils leur font copier des livres pour les vendre,
les mettent à la tête d'une école, ou leur font faire quelque éducation
privée.
Certains richards possédés de la manie d'une instruction qu'ils n'ont jamais
pu ou su acquérir, et que néanmoins ils voudraient posséder, les ont pour
leur en tenir lieu. Savant par procuration, par la tête et par l'esprit d'un
autre ! voilà qui paraît bien bizarre. Rien de plus vrai cependant : oui, il y
a de ces gens-là à Rome ; mais que ne trouve-t-on pas dans cette ville ! Je
connais un nommé Calvisius Sabinus qui porte au plus haut degré cette étrange
passion de science sans savoir. Affligé d'une mémoire si malheureuse qu'il
oublie par instant jusqu'aux noms qu'il sait le mieux, il a voulu se créer une
réputation d'homme très versé dans la belle littérature de la Grèce,
persuadé qu'avec de l'argent rien n'est impossible. II a donc acquis à grands
frais une bande d'esclaves dont tout le service consiste à savoir par cœur les
principaux poètes grecs. Chaque genre de poésie, ou plutôt chaque auteur a
son homme : les lyriques, par exemple, sont autant de départements assignés à
neuf mémoires différentes. Ne t'étonne pas qu'il ait pu réunir une pareille
collection : il l'a commandée, on la lui a faite exprès, on la lui a dressée,
et elle ne lui coûte pas moins de neuf cent mille sesterces ! Avec cette
troupe, Sabinus, sûr de lui-même, ne doute plus de rien ; il la traîne
partout avec soi, tantôt les uns, tantôt les autres, et dans les soupers, ces
lieux de conversation, il se met à harceler ses convives : veut-il citer un
vers, il trouve à ses pieds à qui le demander dans l'esclave qui le sert, et
qui est censé n'être là que pour le service matériel de son maître. Le
malheur, c'est que Calvisius n'a pu se faire disposer aussi une mémoire moins
fugitive, de sorte qu'il interroge quelquefois le département du tragique ou de
l'épique quand il n'a amené que le lyrique, ou que d'autres fois sa mémoire
se montre tellement rebelle, qu'il oublie une partie de la citation à l'instant
même où elle vient de lui être soufflée, et ne parvient qu'après cieux ou
trois tentatives pénibles à redire quelques vers qu'il estropie. Ses convives
rient de lui ; mais il ne s'en aperçoit pas, tout occupé, tout inquiet qu'il
est de la science vivante dont il s'environne. Un jour l'un de ces hommes dont
Rome abonde, qui vivent aux dépens des riches. stupides, leur sourient et se
moquent d'eux, lui disait : « Vous devriez avoir aussi une collection de
grammairiens. - Savez-vous, répondit Sabinus, que chaque esclave me revient à
cent mille sesterces ? - Vous auriez eu les livres à moins, » repartit le
railleur. Sabinus croit de bonne foi savoir tout ce qu'on sait dans sa maison.
Il est maigre, pâle, infirme. «Exercez-vous à la lutte, lui dit quelqu'un,
cela vous fera du bien. - Et le moyen ? à peine ai-je la force de vivre. - Ne
dites pas cela : voyez donc cette foule d'esclaves bien portants qui vous
appartiennent. »
Mais en voilà assez sur ce vieux fou, je te parlerai dans ma prochaine lettre
des affranchissements et des affranchis.
DES AFFRANCHISSEMENTS ET DES AFFRANCHIS
Parmi
les droits de Cité romaine, il en existe un très véritable, très capital,
que je ne sais néanmoins comment nommer, parce qu'il n'est point formulé d'une
manière spéciale dans la loi : c'est celui de faire des citoyens romains par
l'affranchissement des esclaves. Ce droit anonyme, qui me paraît la
conséquence du droit paternel et du droit de propriété légitime, est
vraiment exorbitant, car il donne à un Romain le pouvoir de faire pour son
esclave ce qui ne peut être fait pour des étrangers qu'avec toute la puissance
du peuple. Il y a cependant une différence entre ces deux espèces de citoyens
: ceux du peuple jouissent de prime saut de toute la considération désirable ;
les autres, au contraire, forment comme une classe à part dont la position est
équivoque ; ils gardent quelque chose de l'esclavage dont ils sortent, et font
comme une tache dans la société romaine : on ne méprise pas l'affranchi comme
un esclave, on ne l'estime pas non plus à l'égal d'un vrai Romain, et sa
qualité de citoyen parvenu à la liberté, incessamment rappelée dans le nom
d'affranchi, lui laisse une marque de la servitude qui le place dans un
véritable état d'infériorité civile.
La réprobation publique a réagi jusque sur la condition légale de ces
libérés de l'esclavage ; ainsi ils ne jouissent pas du plein exercice du droit
de Cité romaine : le droit de suffrage est presque annulé pour eux, en ce que
les affranchis sont toujours inscrits dans l'une des quatre tribus urbaines,
dont les suffrages dans les Comices se comptent toujours collectivement ; le
droit d'honneurs leur demeure interdits ainsi que le droit de milice, hormis
dans des circonstances extraordinaires, et par exception ; on les relègue
habituellement dans le service de la marine, Si d'autre part ils usurpaient le
droit de milice, ils seraient mis à mort, comme le sont les esclaves pris dans
le même cas. Enfin le droit de mariage ne leur est pas non plus concédé, car
ils ne peuvent s'allier aux familles libres de race, tant les Romains tiennent
à la pureté de leur sang ! Dès l'origine ils eurent cette fierté, comme
s'ils avaient déjà le secret pressentiment qu'un jour ils seraient le
peuple-roi.
A la seconde génération ces exclusions presque injurieuses s'éteignent, et le
fils d'un affranchi est admis au droit d'honneurs. Cependant il ne jouit pas
encore de toutes ses conséquences : ce droit conduit le citoyen de race au
Sénat, par l'exercice d'une magistrature curule ; le fils d'affranchi, au
contraire, eût-il été consul, ne peut jamais devenir sénateur, et ce n'est
qu'à la troisième génération que cette exclusion disparaît. Il résulte de
toutes ces interdictions que les affranchis ne reçoivent véritablement qu'une
demi-civilité romaine si je puis m'exprimer ainsi ; qu'ils font souche de
citoyens, plutôt qu'ils ne sont citoyens eux-mêmes dans toute la vérité du
terme.
L'exercice du droit de testament et d'héritage n'est pas non plus sans
plusieurs restrictions pour les affranchis ; mais je dirai comment tout à
l'heure : j'ai hâte de reprendre ma lettre plus à son origine, car il me
semble que je ne l'ai point commencée par le commencement.
Le plus grand allégement que les esclaves puissent avoir dans leur misérable
condition, c'est l'espoir de l'affranchissement. Cette libération, qui
quelquefois tarde à se réaliser, ne se fait attendre le plus ordinairement que
peu d'années. Les esclaves ont deux moyens presque certains d'y arriver, soit
par leur bonne conduite, soit par la générosité de leurs maîtres. Ce dernier
mode était autrefois à peu près le seul. Aujourd'hui les serfs peuvent se
racheter, sans que ce soit néanmoins un droit pour eux ; ils conviennent du
prix de leur liberté, et moins de six ans, s'ils sont frugaux et laborieux,
leur suffisent à thésauriser un pécule assez fort pour la payer. Les maîtres
se montrent d'autant plus faciles à faire ces marchés, que c'est vraiment pour
eux un moyen d'entretenir sans frais, ou même avec avantage, leur famille
toujours jeune et vigoureuse, en remplaçant les affranchis par de jeunes
sujets. Il existe quelquefois des empêchements invincibles à ce que les
esclaves arrivent aussi promptement à la liberté : c'est lorsque les vendeurs
ont spécifié qu'ils ne pourraient être affranchis avant un certain nombre
d'années. Les infortunés n'ont qu'un seul maître, et la tyrannie de plusieurs
pèse sur eux ! Quand l'Empereur eut dompté les Salasses, petit peuple des
Alpes qui s'était rendu redoutable aux Romains, tous les prisonniers de guerre,
au nombre de quarante-quatre mille, furent vendus avec la condition qu'aucun ne
pourrait être affranchi avant un espace de vingt ans. Auguste élève ce temps
d'esclavage obligé à trente ans, pour les captifs faits sur des peuples
signalés par leurs révoltes fréquentes. Il y joint aussi la condition qu'on
les emmènera au loin et qu'on ne les emploiera pas dans un pays voisin.
Certains vendeurs, enchérissant encore sur la dureté de telles prescriptions,
ajoutent que les acquéreurs seront obligés de tenir ces esclaves aux fers, et
de les occuper à un travail des plus rudes ; d'autres, qu'ils ne pourront
jamais les affranchir. Ce qu'il y a de plus révoltant, c'est que de pareilles
conditions sont quelquefois insérées dans les testaments, par des maîtres
vindicatifs qui veulent sévir du fond de leur tombeau contre des esclaves qui
les ont mal servis. Bien rare ment trouve-t-on dans les contrats de vente des
dispositions favorables aux esclaves ; il y en a cependant, et j'ai vu vendre
des esclaves femelles avec la condition qu'on ne les prostituerait jamais, et
que, dans le cas contraire, elles deviendraient libres de plein droit.
Quels que soient les motifs d'affranchissement, il y a trois manières légales
d'y procéder : par la Baguette, par le Cens, ou par Testament.
L'affranchissement par la Baguette se pratique ainsi : le maître conduit devant
un magistrat, Préteur, Consul, ou Proconsul l'esclave qu'il veut affranchir, et
lui posant la main sur la tête, qu'il a fait préalablement raser, ou sur
quelque autre partie du corps, il prononce ces paroles : « Je veux que cet
homme soit libre, et jouisse des droits de Cité romaine. » Alors il le lâche.
Le magistrat touche trois ou quatre fois avec une baguette la tête de
l'individu présenté à l'affranchissement ; son maître le saisit ensuite par
le bras, le fait tourner sur les talons, lui donne un léger coup sur la joue,
le voilà libre. Cette cérémonie peut se faire partout, dans la rue, à la
campagne, à la promenade, sans qu'il soit nécessaire que le magistrat siège
alors sur son tribunal, ni qu'il ait l'appareil de sa dignité.
L'affranchissement par le Cens est beaucoup plus simple : il suffit que,
d'après l'ordre de son maître, l'esclave ait fait inscrire son nom sur les
rôles publics des citoyens romains pour sortir immédiatement des liens de
l'esclavage.
La liberté acquise par Testament se confère directement, ou par fidéicommis.
Elle est directe si le maître affranchit son esclave en ces termes : « Que
Stichus, mon esclave, soit libre. » S'il se sert au contraire de l'une des
formules : « Je prie, je supplie, je confie à votre foi, » alors la liberté
de l'esclave ne dépend plus de la volonté du maître, mais de la bonne foi de
celui qu'il a institué son héritier.
Une autre manière d'affranchissement direct consiste à tester en faveur d'un
esclave ; son maître est alors censé lui avoir donné la liberté. Cela arrive
principalement lorsqu'un homme prévoit que ses créanciers, après sa mort,
s'empareront de ses biens pour les vendre à l'encan, ce que les Romains
regardent comme une tache à leur nom. Pour éviter cette honte, ils instituent
un esclave leur légataire universel, et les biens du défunt se vendent au nom
de cet esclave, que l'on nomme l'héritier nécessaire, parce qu'il ne peut
refuser cette espèce d'héritage, et qu'au besoin même la loi le contraint à
l'accepter.
On compte encore un troisième mode d'affranchissement par Testament, c'est
lorsqu'un maître, dans cet acte de sa volonté posthume, a laissé la liberté
à son esclave, soit sous la condition qu'il payera une certaine somme à
l'héritier ou à un étranger, soit gratuitement, mais à une époque marquée
plus ou moins éloignée. Dans ce dernier cas, la condition de l'esclave est la
même que celle de tous les autres; il reste esclave de l'héritier, tant que
son terme d'affranchissement n'est point arrivé, et peut être vendu et passer
en d'autres mains ; mais sa condition le suit chez son nouveau maître, et,
l'époque fixée échue, il devient libre de plein droit. Il peut même, en cas
de vente, recouvrer sa liberté avant cette époque, en payant à celui qui
l'achète du citoyen dans l'héritage duquel il se trouve, la somme qu'il aurait
dû payer à ce citoyen avant de recouvrer la liberté. On appelle cet esclave statulibre,
c'est-à-dire libre d'état et non de fait, libre à une certaine condition
posée. Le statulibre n'est reconnu tel qu'au moment où le testament qui
le constitue en cet état a été accepté au moins par un des héritiers
institués.
Un esclave nommé tuteur des enfants de son maître arrive aussi à la liberté
par le fait seul de cet acte, qui le fait considérer comme ayant été
affranchi directement.
L'affranchissement effectué de l'une des manières ci-dessus procure la
liberté juste, dite aussi la grande liberté, irrévocable dans le premier
mode, et dans les autres également. Mais il y a une liberté inférieure ou
précaire que le maître, tant qu'il vit, peut toujours reprendre. Ce simulacre
(qu'est-ce autre chose puisqu'elle tient encore à la servitude?) se confère
aussi de trois manières : entre amis, par la table, et par lettre.
L'affranchissement entre amis se pratique en présence de cinq témoins, devant
lesquels le maître déclare qu'il donne la liberté à son esclave. Cet
affranchissement peut être sanctionné plus tard par les modes légaux
précédemment mentionnés.
Un esclave que son maître fait manger avec lui devient aussitôt libre, parce
qu'un maître ne s'abaisse jamais jusqu'à manger avec ses esclaves. Il lui
donne acte de cette marque d'honneur, et il est alors libre par la table.
Pour consommer l'affranchissement par lettre, il suffit que le maître écrive
à son esclave qu'il lui rend la liberté, et que le texte même du cartouche du
congé, ou la suscription porte la signature de cinq témoins qui puissent en
assurer la sincérité.
On appelle manumission l'affranchissement en général, parce que tout esclave
est sous la puissance, sous la main de son maître, et que l'affranchissement le
libère de la puissance. L'Empereur seul a le droit, qu'il s'est donné,
d'affranchir les esclaves en ordonnant qu'ils soient libres. La constatation
légale se fait par l'inscription des affranchis sur les registres du Cens, à
l'Atrium de la liberté, près du Forum.
Les maîtres conservent encore certains droits sur leurs anciens serfs, même
sur ceux dotés de la grande liberté : d'abord ils de-viennent leurs patrons,
et ceux-ci leurs affranchis. Il n'y a là rien que de naturel : tous les
citoyens d'un état médiocre s'abritant sous le patronage des puissants, les
esclaves doivent être les clients des maîtres qui les ont faits citoyens; mais
c'est pour eux un patronage obligé, et dans lequel, suivant l'ancienne coutume,
il y a encore beaucoup de la servitude : ainsi, en cas de mécontentement; les
patrons peuvent les chasser de la ville, les reléguer à vingt milles de Rome.
Autrefois un patron avait même droit de vie et de mort sur son affranchi. Si,
de son côté, ce dernier a des sujets de plainte contre son patron, s'il veut
lui intenter une action judiciaire qui pourrait atteindre l'honneur de cet
ancien maître, il ne peut le faire sans une autorisation préalable du juge, et
rarement elle lui est accordée.
Relativement aux biens, les patrons ont aussi des droits : jadis, lorsqu'un
affranchi mourait intestat sans laisser de fils, et que son patron ou le fils de
son patron lui survivait, alors, en vertu de la loi des XII Tables, la
succession passait de droit de la famille de l'affranchi au patron ou au plus
proche parent de ce dernier. Cette législation reconnaissait donc implicitement
le droit de testament aux affranchis. La cupidité romaine finit par trouver
exorbitant qu'un maître pût ne rien avoir de la succession de son ancien
esclave, et les Préteurs, réformant un état de choses regardé comme abusif,
créèrent une nouvelle jurisprudence qui est celle-ci : quand l'affranchi mort
intestat laisse un enfant seulement adoptif, ou bien une épouse, le patron est
encore admis contre de semblables héritiers à succéder à la moitié des
biens de celui qui fut son affranchi. Si ce dernier n'a rien légué au patron,
ou ne lui a légué que la moitié de ses biens, un tel oubli, volontaire ou
non, ne nuit pas aux droits de celui-ci, qui prélève toujours sa moitié. Il
ne peut être exclu de cet héritage que par les enfants véritables, et encore,
pourvu que ceux-ci aient été institués héritiers, ou aient réclamé la
possession des biens ; autrement on les regarde comme déshérités. L'affranchi
n'échappe aux devoirs et aux charges de patroné que lorsqu'il a été rendu à
la liberté par un sénatus-consulte, pour avoir découvert les assassins de
son maître ; alors il est dit affranchi de Pluton.
Ces dispositions sont pour les affranchis hommes. Les femmes, sans distinction
d'état, se trouvant dans une minorité perpétuelle, les anciens maîtres des
esclaves femelles deviennent leurs tuteurs légitimes. Il s'ensuit qu'elles ne
peuvent, sans leur autorisation, ni tester, ni se mettre en pouvoir de mari ;
aussi ne sont-ils jamais frustrés des biens de leurs affranchies.
La loi sur le patronage et la clientèle s'applique aux affranchis-clients plus
rigoureusement encore qu'aux autres citoyens ; non seulement ils doivent prendre
soin de leurs patrons s'ils tombent dans l'indigence, les nourrir au besoin,
mais ce devoir s'étend jusque sur les ascendants, pères et mères de leurs
patrons malheureux. Si la prospérité ne cesse, au contraire, d'accompagner les
patrons, leur clientèle affranchie peut devenir pour eux une nouvelle source de
prospérité, car on a vu, et l'on voit chaque jour d'anciens esclaves arriver
à l'opulence, et une part de cette opulence revient au patron et à sa famille,
en vertu du droit d'héritage ci-dessus mentionné.
Si les affranchis sont pauvres, le patron en tire encore quelque chose : ils lui
doivent des journées de travail comprenant toute espèce de service, suivant
leur capacité. L'exigence des patrons n'a presque aucunes bornes, et souvent
ils font participer leurs enfants à ces droits d'ancien servage. Quelquefois un
père de famille cède tout à fait des affranchis à ses enfants, et cette
cession a tous les effets d'une aliénation irrévocable.
Les droits de patronage nominal et de quasi-propriété sur le libéré de la
servitude sont comme marqués par un usage qui veut qu'un affranchi fasse
précéder son nom du prénom et du nom de son ancien maître. En public,
l'affranchi porte un signe qui fait incessamment reconnaître sa condition ;
c'est une petite coiffe tout unie, en laine blanche, dont il se couvre la tête.
Les Romains furent environ deux siècles avant d'admettre qu'un esclave pût
jamais sortir de sa condition. Le roi Servius Tullius, dont on sait l'origine
serve, fut le premier qui affranchit des esclaves et les éleva au rang de
citoyens. Il ne crut ni honteux pour la République, ni préjudiciable à ses
intérêts de rendre la liberté et une patrie à des gens qui avaient perdu
l'une et l'autre par suite des rigueurs de la guerre. Alors on était sûr que
ces affranchis seraient bons citoyens, car la plupart revenaient à la liberté
en considération de leur bonne conduite, de leur probité, et sans qu'il leur
en coûtât rien. Très peu se rachetaient au moyen du pécule.
Aujourd'hui le désordre est si grand, la probité a tellement dégénéré, on
se montre si peu sensible au déshonneur et à l'infamie, que les esclaves
payent leur liberté avec un argent gagné par mille voies illégitimes; les
brigandages, les vols, la prostitution, tous les genres de crimes, sont les
moyens qu'ils emploient pour sortir de servitude et devenir citoyens romains.
Les uns reçoivent la liberté pour avoir été complices des abominations de
leurs maîtres, de leurs homicides, de leurs empoisonnements, et autres
attentats contre les dieux et contre la République ; les autres ne sont
affranchis que pour recevoir certaines rations de blé que l'on distribue
gratuitement tous les mois, pour mendier les libéralités des grands aux
pauvres, afin de porter cette récolte à ceux qui les ont faits libres.
D'autres enfin ne sont délivrés d'esclavage que par la légèreté des
maîtres, qui par là cherchent à se faire honneur. J'en sais qui dans leur
testament ont affranchi tous les esclaves qu'ils possédaient, afin de passer
après leur mort pour de bons maîtres, et que leur pompe funèbre fût suivie
d'un nombreux cortège d'affranchis. On a vu dans les funérailles certains
scélérats nouvellement sortis de prison, et qui méritaient les plus horribles
supplices pour les crimes énormes qu'ils avaient commis. La plupart des gens de
bien qui voient ces infâmes affranchissements ne peuvent s'empêcher de faire
éclater leur indignation.
On dit que cet abus d'une institution sage en elle-même, que cette prostitution
du titre de citoyen commence à préoccuper l'Empereur, si jaloux, ainsi que je
l'ai déjà fait voir, de la dignité romaine. Il prépare, dit-on, de notables
changements dans la législation qui régit cette matière. Sans doute il
modérera les affranchissements, mais il ne les supprimera pas, parce qu'on ne
saurait, sans dommage véritable, réduire la République à se soutenir avec
les seuls citoyens nés dans la liberté.
ACHÈVEMENT.
Ce qui n'était qu'un bruit de ville quand je t'écrivis la lettre qui
précède, est devenu un fait, et l'Empereur Auguste a seulement limité, comme
je le pensais, la puissance d'affranchir, en l'entourant de beaucoup de
difficultés, surtout pour la pleine liberté. L'an sept cent cinquante-un, il
fit rendre la loi Furia-Caninia, qui restreignit les affranchissements par
testament : sur trois esclaves, on n'en put affranchir que deux ; jusqu'à dix,
il fut permis d'en libérer la moitié ; de dix à trente, le tiers ; de trente
à cent, le quart ; de cent à cinq cents, le cinquième ; le nombre de cent ne
dut jamais être dépassé. Tous les esclaves qu'on voulait rendre à la
liberté devaient être désignés nominalement ; une désignation de nombre
pure et simple devenait nulle. Si un testateur avait dépassé le taux légal,
les esclaves inscrits les premiers, et jusqu'à concurrence de la quantité
permise, étaient seuls déclarés libres; les autres, au delà de ce nombre,
demeuraient en servitude.
Cette loi ne parut pas suffisante à l'Empereur ; quatre ans après, il en porta
une autre qui fixa un âge avant lequel les maîtres ne pourraient affranchir
d'esclaves, ni les esclaves être affranchis. D'après cette loi, appelée
Aelia-Sentia, le maître doit être majeur de vingt ans pour affranchir par la
baguette, et il ne peut le faire que sur un motif légitime, jugé tel par un
conseil composé de cinq sénateurs et de cinq chevaliers romains pubères, et
si c'est en province, de cinq juges citoyens romains. L'affranchi doit être
majeur de trente ans pour devenir citoyen romain ; au-dessous de cet âge, il
n'est que citoyen latin. L'état de citoyen est interdit à l'affranchi marqué,
ou qui a subi la torture, ou qui a combattu dans les jeux publics.
Ces derniers affranchis forment une classe à part qu'on nomme des deditices,
c'est-à-dire de la condition des peuples qui se sont rendus à discrétion. Ces
malheureux, traités en ennemis, non seulement ne peuvent résider à Rome,
mais. pas même à moins de cent milles à la ronde, sous peine de perdre de
nouveau la liberté, d'être vendus eux et leurs biens. Tu sauras aussi que,
suivant un principe de droit public, le « manumisseur » (celui qui affranchit)
ne peut transmettre un droit supérieur au droit dont il jouit lui-même ; ainsi
donc, le citoyen latin ne peut faire de son affranchi qu'un Latin, comme lui.
Sous le principat de Tibère, une autre loi : la loi Junia-Norbana, rendue l'an
sept cent soixante-douze, imposa de nouvelles entraves au droit
d'affranchissement : elle établit que tout esclave vendu par un citoyen romain
à un autre citoyen romain, et non livré soit avec la formalité de la
mancipation, soit par une cession juridique, ou bien qui n'appartiendrait pas
depuis un an à son nouveau maître, n'acquerrait par l'affranchissement que les
droits de Latium. Ces affranchis, appelés Latins, ou Latins-Juniens, du nom de
la loi, sont censés retomber dans l'esclavage en mourant, et leurs biens
restent comme un pécule à ceux qui les avaient rendus libres, ou, à leur
défaut, passent au peuple. Un chef de cette loi permet cependant à tout Latin
qui épousé une Romaine ou une Latine, libre, de devenir citoyen romain, en
prouvant devant le Préteur, ou devant le gouverneur de la province, qu'il a un
fils ou une fille, et qu'il est marié depuis un an. Par cette déclaration, son
fils ou sa fille, ainsi que sa femme, acquièrent aussi le droit de Cité
romaine.
Cette libéralité étendue à la femme et à la fille de l'affranchi te
paraîtra peut-être extraordinaire, mais la législation de cette époque n'a
jamais été dirigée que contre les esclaves hommes, parce qu'on les craignait
en raison de leur grand nombre, et surtout qu'on ne voulait pas, en leur
concédant trop de droits, risquer d'avilir la condition de citoyen romain. Il
n'en était pas de même des esclaves femmes : du vivant de l'Empereur Auguste,
la loi Papia-Poppaea, rendue l'an sept cent soixante-deux, donna aux affranchies
mères de quatre enfants le droit de tester librement, et sans rien léguer à
leurs patrons. C'était là une grande innovation. Cependant, pour ne pas
détruire complètement le lien du patronage, on permit au patron de prétendre
sur la succession de son ancienne esclave une part égale à celle de chacun des
enfants survivants, ce qui équivalait au moins au quart, souvent au tiers ou à
la moitié de l'héritage.
Les législateurs se sont toujours fort préoccupés de ces questions
d'héritages. J'ai dit dans ma lettre que les enfants des affranchis héritaient
au préjudice des patrons ; la loi Papia-Poppaea modifia cette disposition ;
elle décida que lés patrons ne seraient exclus qu'autant que leur affranchi
laisserait trois enfants, ou bien quand sa succession ne s'élèverait pas à
cent mille sesterces. Mais lorsqu'elle atteignait cette somme, et qu'il y avait
moins de trois enfants, le patron avait droit à part virile, c'est-à-dire à
la moitié ou au tiers de la succession.
Maintenant que je suis loin de Rome, de ce brillant tourbillon qui m'enivrait,
et qui peut-être a faussé mon jugement sur bien des points, je ne puis encore
réfléchir de sang-froid à cette singularité d'une nation tout entière
servie par un peuple d'esclaves, sans admirer le dédain des soins domestiques,
la fierté qui empêchent un citoyen romain de se livrer, au profit d'un tiers,
à des fonctions serviles. Cette coutume qui est pour ainsi dire dans le sang
romain, et que rien ne saurait détruire, flatte singulièrement l'orgueil
national, car la foule d'esclaves de toutes les nations qu'elle rend
nécessaires, et dont Rome est encombrée, semblent dans cette ville les
représentants de la servitude de l'univers.
LES VOLEURS.
Sans
le chercher, et presque sans le vouloir, je me mets à la mode romaine : j'ai
quitté mon sayon pour une Lacerna, je me coupe la barbe, je crois même que je
me suis fait épiler les bras et les jambes. Voilà maintenant que je porte un
anneau. Mais ceci est moins une affaire de caprice qu'une chose de nécessité.
Les Romains écrivent beaucoup, tiennent beaucoup de comptes, correspondent
fréquemment avec leurs amis, et pour authentiquer leurs écrits, en assurer
l'exactitude, faire reconnaître leurs lettres, ils apposent au bas une
empreinte particulière fixée à un anneau qu'ils portent au petit doigt de la
main gauche. C'est ce qu'ils appellent un symbole. L'image qu'on y fait graver
est tout à fait de fantaisie ; quelquefois c'est le portrait d'un aïeul, ou un
souvenir de gloire : par exemple, Sylla signait avec un symbole où l'on voyait
Bocchus lui livrant Jugurtha, et le symbole de Pompée représentait trois
trophées, emblème de ses triomphes sur l'Europe, l'Asie, et l'Afrique. Enfin,
pour citer un exemple de nos jours, l'Empereur, pendant les guerres civiles,
signait avec un sphinx. Il adopta, depuis, une tête d'Alexandre le Grand. Mais
je me suis trop avancé en disant que la marque d'un symbole fait reconnaître
par qui une lettre est écrite ; cela ne serait pas possible, tout le monde ne
pouvant pas connaître le symbole de chacun. Aussi, pour obvier à cet
inconvénient, il est d'usage, en écrivant une lettre, de se nommer à la
première ligne, en mettant à la suite de son propre nom celui de la personne
à qui on écrit, comme, par exemple : « César à Pompée ; - Cicéron à
Brutus, etc. »
Je n'ose affirmer que jadis on se contentât d'inscrire son nom en tête de ses
lettres, sans mettre à la fin aucun signe ; ce que je puis dire seulement,
c'est que l'usage des symboles ne date que du milieu du cinquième siècle. Le
droit d'en porter fut, comme encore aujourd'hui, réservé aux: hommes libres.
Quoi de plus convenable, en effet, que les moyens de signer ne soient donnés
qu'à ceux qui peuvent engager leur parole !
La manie de briller a fait de cet objet d'utilité une parure de luxe en même
temps. Autrefois, l'anneau, qu'il fût de fer ou d'or, portait la signature sur
lui-même : on a imaginé depuis de la graver sur des pierres précieuses. Dès
lors se perdit la vieille coutume de mettre l'anneau à la main droite, qui est
la main d'action ; on le transporta à la gauche, qui demeure oisive, parce que
les élégants craignirent que le mouvement continuel de la droite
n'endommageât leur anneau. Les hommes ont fini par avoir des Dactyliothèques,
ou boîtes à bagues, tant ils poussèrent loin le luxe de cette bizarre et
futile parure ; et parmi beaucoup de ces élégants, on cite encore Scaurus,
beau-fils de Sylla, pour avoir, le premier à Rome, possédé une boîte de ce
genre.
Les anneaux servent aussi à garantir des vols domestiques : on met sous leur
empreinte tous les objets qu'on veut garder du larcin, les aliments, les
boissons, exposés à la gourmandise ou à l'ivrognerie des esclaves de menus
meubles, des ustensiles. Divers vols de ce genre, commis chez moi, me donnèrent
l'idée d'avoir aussi mon anneau-symbole.
Ces petits actes d'infidélité, assez fréquents malgré les précautions
prises pour les prévenir, ne sont rien en comparaison des vols de tous genres
qui se commettent au dehors. Je dois le dire, car j'en suis certain maintenant,
Rome est un pays de voleurs. Dans cette ville immense, qui est comme le cloaque
où viennent se rendre et se grossir tous les égouts de l'univers, certains
individus, bravant et les lois et les magistrats, font consister leur industrie
dans le vol.
Depuis des siècles, la race des voleurs infecte Rome et l'Italie, mais Rome
particulièrement. De nombreuses distributions de blé que l'on fait dans la
ville, et qui de toutes parts y attirent des paresseux et des fainéants ; les
somptueuses demeures qui l'embellissent ; les innombrables et riches présents
qui décorent ses temples, les objets précieux qui remplissent beaucoup de ses
tavernes, sont un appât pour la cupidité, et font de cette capitale comme la
patrie des voleurs. Les guerres civiles du commencement de ce siècle ont encore
fait pulluler cette engeance ; une foule de mauvais sujets, ayant contracté
dans ces temps désastreux les habitudes d'une vie de pillage, de débauche et
de prodigalité, réduits à la misère par le rétablissement de l'ordre,
incapables d'exercer une profession honnête, se sont faits voleurs pour
exister. Rappelle-toi ce que j'en ai dit en te parlant de la création des
Vigiles nocturnes dans ma lettre sur la Police de Rome. Le brigandage
s'exerçait avec une telle audace, que les malfaiteurs enlevaient les esclaves
sur les routes ou dans les champs, et même les hommes libres ; ils les
vendaient à certains agriculteurs, leurs complices, qui, libres ou non, les
réduisaient en esclavage, et hors le temps du travail, les enfermaient dans des
ergastutaires ou prisons d'esclaves.
Ces enleveurs d'hommes ont disparu ; mais il existe encore d'autres brigands
fort redoutables, connus sous les dénominations de Grassateurs et de Sicaires.
Les Grassateurs ou batteurs de grands chemins arrêtent les voyageurs pour les
détrousser. Ils commencent'à être moins nombreux, grâce à une surveillance
continuelle ; néanmoins, on cite encore certains lieux, aux environs de Rome,
où il n'est pas prudent de passer le soir : je le sais par expérience, et,
dernièrement, sans la vitesse de mon cheval, j'aurais été volé sur la voie
Appia, à peu de distance de la ville, dans un lieu dit le Tombeau de Basilus,
depuis longtemps célèbre par ce genre d'expéditions criminelles. C'est de ce
côté, à quatre milles de la porte Naevia, qu'est une forêt de ce nom, vrai
repaire de voleurs.
Les Sicaires marchent toujours armés d'un poignard court, sica, d'où
leur nom. L'assassinat leur est familier ; ils vont même jusqu'à attaquer les
maisons, en commençant par les incendier, pour commettre plus aisément leurs
vols. Cette espèce de brigands, la plus dangereuse de toutes, se forma à la
suite des guerres civiles de Marius et de Sylla. Lorsque ce dernier se fut rendu
maître de la République, l'Italie était infestée de Sicaires, et il fit une
loi spéciale contre eux.
Leur brigandage s'exerçait en grand, et par des citoyens romains, car la
pénalité prononce la déportation et la confiscation. Si les brigands
n'eussent été que des esclaves ou des gens sans aveu, le législateur n'aurait
prononcé que la mort par le crucifiement. Les voleurs d'hommes, dont je parlais
tout à l'heure, ne furent qu'une continuation amoindrie des sicaires primitifs,
aujourd'hui presque inconnus.
Si la vigilance de la police tient éloignés de la ville la plupart des voleurs
en grand, avec effraction et violence, Rome n'en reste pas moins leur point de
mire, et de temps en temps ils y font des incursions. Afin de pouvoir profiter
de tous les instants favorables, ils ont été se poster à une distance moyenne
de cette belle proie, assez loin pour être à l'abri des atteintes quotidiennes
des Vigiles, pas assez pour perdre la ville de vue. C'est dans la Campanie
qu'ils se sont réfugiés, et comme ils ne pouvaient vivre que dans un grand
centre de richesses, ils ont choisi les environs de Cumes et de Baïes, contrée
où les Romains ont de somptueuses maisons de plaisance. Il y a là, sur le bord
de la mer Thyrrhénienne, une forêt nommée Gallinaire, qui leur sert de
repaire habituel. De ce lieu ils poussent des reconnaissances dans les environs,
et s'avancent jusqu'aux Marais Pontins, à moitié chemin de Cumes et de Rome.
C'est une embuscade fort bien choisie pour attendre les voyageurs de la voie
Appia ; ils les laissent s'engager assez avant sur cette voie, qui n'est qu'une
étroite chaussée en plein dans les marais, puis ils les attaquent avec
d'autant plus de sécurité que la traversée ayant plus de dix-huit milles de
long, les voyageurs ne peuvent appeler du secours dans ce lieu désert, et moins
encore en recevoir. Si par aventure il survenait quelque troupe de soldats, ou
quelque cohorte de voyageurs, comme la route est toute droite, les agresseurs,
les voyant venir de loin, auraient le temps de fuir en sens contraire, ou bien
de se jeter dans des barques, et de gagner la mer ou les montagnes.
Une pensée toute simple vient en lisant ces détails : puisque l'on sait où
sont les repaires de voleurs, pourquoi ne les détruit-on pas ? Probablement
c'est que cela n'est pas possible, ou que le mal ne paraît pas assez
intolérable. Dans les affaires de ce genre, les Romains attendent toujours la
dernière extrémité ; il fallut que les esclaves de Spartacus fussent
organisés en armée pour qu'on songeât à les combattre ; Pompée ne fut
envoyé contre les pirates de la Méditerranée que lorsqu'ils affamèrent Rome,
en arrêtant les convois de blés expédiés du dehors pour sa subsistance ;
enfin de nos jours on s'occupa de réprimer les brigandages, quand les brigands
étaient maîtres du pays. Il semble que les Romains craignent ou dédaignent
d'employer la force militaire pour les affaires domestiques. Vois pour Rome,
dont la tranquillité leur importe tant, combien est récente l'institution du
corps des Vigiles militaires ; à plus forte raison ce qu'on fait à si
grand'peine pour la ville, ne le ferait-on point pour une province, bien que
cette province soit pour ainsi dire à la porte de Rome.
Cependant je crois que l'on commence à sentir la nécessité d'une répression
; de temps en temps la force armée va faire des recherches dans les Marais
Pontins et dans la forêt Gallinaire Alors les voleurs déguerpissent au plus
vite, et, mettant à profit cette recherche même, gagnent la mer, se jettent
dans des barques de pêcheurs, et se replient sur Rome, où ils se glissent à
la faveur de la nuit. Ils y accourent comme des chasseurs dans un lieu bien
peuplé de gibier, et s'y précipitent d'autant plus audacieusement, qu'ils la
savent dégarnie d'une partie de ses gardes.
Les voleurs, toujours à l'affût des occasions propices, affluent encore dans
la ville lorsqu'on y donne des spectacles publics. Dans ces circonstances tout
le monde est dehors, la population entière se porte aux théâtres ou aux
Cirques, les maisons sont abandonnées de leurs habitants, et Rome devient si
déserte, qu'il serait dangereux de s'aventurer seul dans ses rues, bien qu'en
plein jour, si l'Empereur n'avait toujours soin alors de faire poster de place
en place des corps de garde pour veiller à la sûreté des citoyens.
Les voleurs-grassateurs sont les plus dangereux, parce qu'ils portent toujours
des épées, pour attaquer, se défendre, assassiner au besoin, et des leviers
et des pinces pour enfoncer les portes ou percer les murs. Ils vont par troupes,
reconnaissent des chefs, et observent entre eux certaines lois pour le partage
du butin. Il n'est pas rare de trouver ici des esprits faibles ou
inconséquents, qui, tout en s'abandonnant à de mauvaises passions, conservent
des sentiments religieux, et sont assidus aux pratiques du culte. Les voleurs
ont un peu de cette singulière dévotion ; ils adorent une certaine déesse
Laverna qu'ils regardent comme leur protectrice, et dont le temple se trouve aux
portes mêmes de Rome, dans un bois situé au midi, sur la voie Salaria. C'est
une superstition plutôt qu'une dévotion, car le sentiment religieux est si
étranger au coeur de ces misérables qu'ils traitent les autres dieux ou
déesses à l'égal des hommes : non seulement ils ne se font pas scrupule de
piller leurs temples quand ils peuvent, mais ils vont jusqu'à s'attaquer à
l'image même de la divinité, l'emportent si elle est d'un métal précieux, ou
la grattent lorsqu'elle n'est que dorée. Les Romains ayant la manie des bustes
ou des portraits en argent, chez eux ou dans les temples, les voleurs ont
imaginé le « vol au lacet » pour attaquer ce riche butin : comme il est
généralement placé assez haut, les voleurs le décrochent à l'aide d'un
lacet adroitement lancé.
Le métier de voleur, même de celui qui ne recourt pas à la violence,
présente de grands dangers : la loi des XII Tables, qui remonte à l'an 303 et
304 de la villes, permet de tuer le voleur de nuit pris en flagrant délit, et
le voleur de jour, s'il se défend avec une arme quand on veut l'arrêter ; mais
celui qui le tue doit crier et appeler les citoyens, sage précaution dans une
loi qui permet de se faire justice soi-même : c'est le cri de l'innocence qui,
dans le moment de l'action, appelle des témoins, appelle des juges. Il faut que
le peuple prenne connaissance de l'action, et qu'il en prenne connaissance dans
le moment qu'elle a été faite, dans un temps où tout parle, l'air, le visage,
les passions, le silence, et où chaque parole condamne ou justifie. Une loi qui
peut devenir si contraire à la sûreté et à la liberté des citoyens, doit
être exécutée en la présence des citoyens. Crier ainsi publiquement, c'est quiriter,
c'est-à-dire appeler les Quirites, les citoyens.
La même loi statuait que les voleurs dont le crime aurait été commis en plein
jour, sans qu'ils eussent entrepris de se défendre, seraient fustigés puis
livrés à celui qu'ils auraient volé, pour lui rendre tous les services d'un
esclave, s'ils étaient d'une condition libre. Quant aux esclaves convaincus de
larcin, ils étaient battus de verges et mis à morts : on les précipitait de
la Roche Tarpéienne, sans doute après les avoir affranchis, pour la forme, la
précipitation étant un supplice de citoyen. Les impubères, coupables du même
crime, devaient être châtiés par ordre du Préteur, et réparer le dommage
qu'ils avaient causé.
Le temps a beaucoup modéré la sévérité de la loi décemvirale, et
aujourd'hui le voleur n'est plus condamné qu'à la restitution du quadruple, si
le vol est manifeste ; du triple, s'il est prémédité ; et du double seulement
s'il n'est point manifeste ; tout cela comme amende, indépendamment de la
restitution de l'objet volé.
Un vol est manifeste quand on prend le voleur sur le fait, dans le lieu même ;
ou quand on le trouve, dans un lieu public ou particulier, tenant encore la
chose volée. S'il l'a portée chez lui ou chez un receleur, le vol n'est plus
manifeste, mais recelé. Autrefois on procédait à la recherche d'un recel par
une perquisition domiciliaire, qu'en terme légal on appelait par le bassin et
la ceinture.
Cette perquisition se faisait avec l'autorisation du Préteur urbain, sur la
requête de la personne volée, qui devait jurer par les dieux que la visite
qu'elle réclamait n'avait d'autre but que de retrouver son bien. Le plaignant
lui-même, ou plus souvent l'un des licteurs du magistrat, fouillait la maison
suspecte.
Afin de prévenir toute fraude et d'empêcher que l'on n'abusât de ce moyen
pour nuire à des personnes innocentes en introduisant chez elles des objets
qu'on les accuserait d'avoir volés, et que l'on feindrait d'y trouver, celui
qui faisait la perquisition dépouillait ses vêtements avant d'entrer dans la
maison, et revêtait seulement une simple ceinture, par respect pour les mères
de famille et les jeunes filles ; de plus, il portait devant lui un bassin, dans
lequel il mettait d'abord la permission écrite autorisant la visite
domiciliaire, puis l'objet retrouvé, s'il pouvait tenir dans ce bassin, pour le
porter au Forum devant le magistrat.
Ce mode de perquisition domiciliaire est aboli depuis plus d'un siècle, soit
qu'on le regardât comme attentatoire à la liberté des citoyens, soit plutôt
qu'on se fût convaincu de son inutilité, les recherches ne pouvant guère
avoir de résultat. C'est le voleur qu'on cherche à saisir, et quand on y peut
parvenir, on atteint quelquefois le double but de la récupération de l'objet
volé, et de la punition du délit.
Les vols de nuit, avec effraction et violence, sont punis, soit de la
relégation, soit d'une condamnation temporaire aux mines ou aux travaux
publics.
Parmi les voleurs de la ville, beaucoup ne sont pour ainsi dire que des
volereaux, et ne se livrent qu'à des vols légers, qui n'exigent qu'un peu
d'effronterie et d'adresse : ils se contentent de dérober les habits dans les
bains publics, de l'encens et des parfums sur les lits funéraires et sur les
tombeaux, des serviettes dans les repas, des bourses aux passants. On appelle
cette classe de voleurs du dernier ordre Manticulaires, de manticula,
bourses et Derectaires, parce qu'ils se dirigent dans les maisons , pour y faire
leur main, y travailler de leur main gauche, qui est, dit-on, celle du vol. Les
voleurs de grande route ont un peu de la générosité des conquérants :
Palaemon, célèbre grammairien du jour, m'a raconté, qu'étant une fois tombé
dans une embuscade de grassateurs, ils le laissèrent aller sain et sauf dès
qu'il se fut nominé, à cause de, sa réputation littéraire. Je dois ajouter
que ce Palaemon est l'homme, le plus orgueilleux qu'il soit possible de
rencontrer.
Un autre trait plus singulier, et dont l'authenticité ne peut être révoquée
en doute, est celui-ci : un certain Corocotta désolait l'Espagne par ses
brigandages. L'Empereur, irrité, promit un million de sesterces à celui qui le
lui amènerait. Corocotta saisit l'occasion de cette menace pour en faire sortir
son pardon ; il eut l'audace de venir se présenter lui-même à l'Empereur, qui
lui fit délivrer la récompense promise, sans doute sous bonne caution pour
l'avenir.
Je viens de te peindre un petit coin des misères sociales de Rome, des moeurs
de la plus mauvaise partie de la plèbe, et des dernières classes sinon de la
société, au moins de la population de la ville. Mais si je voulais te faire
connaître tous les voleurs et toutes les sortes de vols, il me faudrait
remonter jusqu'aux classes les plus élevées ; car ici, où , après le glaive,
la première puissance est l'argent, il n'y a sorte de moyens qu'on ne mette en
oeuvre pour s'en emparer. Les principaux sont l'usure, vol pacifique. et sans
danger ; le pillage, vol en grand et à main armée ; la perception des impôts,
vol multiple, le plus productif et le plus sûr de tous, parce qu'il s'abrite
derrière la légalité ; la vénalité soit dans les tribunaux, soit dans les
comices, autre espèce de vol non moins réel, et plus infâme peut-être, parce
qu'il peut ravir la considération et l'honneur à ceux qu'il choisit pour
victimes ; l'infidélité dans les comptes de finances ; la tromperie sur
l'évaluation et l'exécution des travaux publics ; les fausses déclarations de
cens, et cent autres choses semblables. Je ne renonce pas à t'entretenir de
toutes ces turpitudes qui tiennent si intimement au tableau des moeurs de Rome,
mais je me contenterai de les mentionner aujourd'hui, parce qu'elles
appartiennent à des sujets spéciaux que je traiterai plus tard. Bien que la
société en masse se montre très tolérante pour ces mille manières de
s'emparer du bien d'autrui, cependant il se trouve encore des gens honnêtes qui
ne se font pas faute de les flétrir hautement ; le vieux Caton, si renommé
pour sa vertu, se plaignant de la licence et de l'impunité du péculat, ne
craignit pas de dire et d'écrire : « Les voleurs privés passent leur vie dans
les fers et dans les chaînes ; les voleurs publics, dans l'or et dans la
pourpre. » Le mot de Caton est resté, mais la chose aussi, malheureusement
pour les Romains.
MA SECONDE VISITE AU CAPITOLE
Je sors du Capitole. Je l'avais déjà vu sommairement ; mais cette fois je l'ai visité en détail, exploré dans toute son étendue. On appelle souvent Capitole un superbe temple de Jupiter bâti sur le mont Capitolin ; c'est une désignation abrégée : le Capitole est proprement toute cette colline, la plus petite des sept, située à l'occident de la ville, entre le Forum et le Champ de Mars. Il forme une espèce de petite ville dans la grande, avec ses murailles et ses portes, un quartier sans maisons et sans habitants, attendu qu'il n'est permis à aucun citoyen d'y demeurer. Au dehors, c'est-à-dire vers le Champ de Mars , il présente l'aspect d'un rocher inexpugnable, beaucoup plus long que large, et un peu courbé en croissant vers ses extrémités ; à l'intérieur, son sommet se partage en deux petites collines, l'une au midi, l'autre au septentrion.
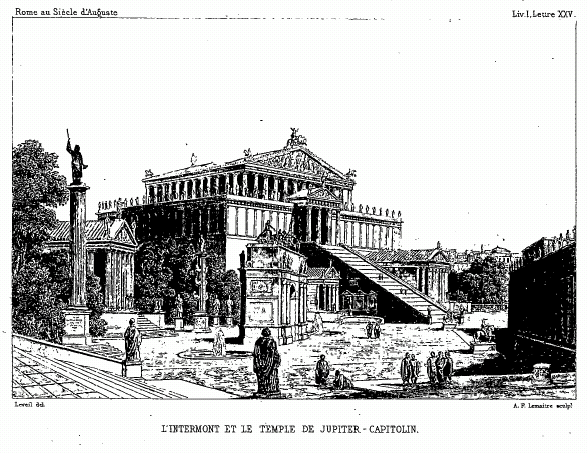
Un homme que je
vois souvent chez Mamurra, Petillius, gardien en chef du temple, m'a guidé dans
la visite que je viens de faire. Hier, il est arrivé chez moi : « Depuis
longtemps, me dit-il, je dois vous montrer notre Capitole ; voulez-vous que je
m'acquitte aujourd'hui de ma promesse ? - Partons, répondis-je. » Et nous
voilà cheminant ensemble. Nous suivons les longs murs du Janicule, nous
traversons le Tibre sur le pont Palatin ; puis, avançant à travers les
Vélabres, le vicus Jugarius, nous arrivons derrière le temple de Saturne, et
prenant à gauche une rue montante : « Nous voici dans le clivus Capitolin, »
me dit Petillius. A peu près au milieu de la montée, il me fit entrer à
gauche dans une voie large de vingt-cinq pieds environ, partagée en deux rampes
géminées, dans lesquelles sont taillés de larges degrés très inclinés;
avec de petits paliers de place en place : « C'est l'escalier de la Roche
Tarpéienne, continua-t-il, ce que nous appelons les Cent marches. Il faut que
vous visitiez tout le Capitole, et nous allons commencer par la Citadelle. »
La montagne capitoline se divise en trois quartiers bien distincts : la
Citadelle, le Temple de Jupiter, et l'Intermont. La Citadelle occupe la colline
méridionale ; le Temple, la colline septentrionale; et l'Intermont, l'espace
entre ces deux monticules, ainsi que son nom l'indique.
Nous entrâmes dans la Citadelle après avoir franchi deux portes, l'une au bout
de la première rampe des Cent marches, l'autre au sommet de la deuxième, où
cette voie, qui va toujours en se rétrécissant, n'a plus guère que dix pieds
de large. La Forteresse ne se compose pas uniquement d'une enceinte de murailles
crénelées et munies de tours, avec quelques logements pour les soldats ; on y
trouve encore six temples et divers autres monuments. En arrivant par la porte
des Cent marches, on débouche sur une petite place, où cinq temples frappent
d'abord les regards : ce sont la Curie Kalabra, le temple de Junon-Moneta, les
deux temples de la Fortune primigénie et de la Fortune obsequens, et le temple
de Jupiter-Férétrien, et celui de Jupiter-Praedator.
La Curie Kalabra, dont j'ai déjà parlé, est le premier édifice du côté des
Cent marches.
Le temple de Junon-Moneta, à côté et tout proche de la Curie, fut construit
dans les premières années du cinquième siècle de Rome ; Camille le bâtit
sur l'emplacement de la maison de Manlius. Originairement, la divinité à
laquelle il est consacré n'avait point de surnom ; mais un tremblement de terre
(phénomène trop ordinaire ici) ayant épouvanté la ville, on entendit sortir
du temple une voix, qui conseillait d'immoler une truie pleine en expiation du
prodige. Dès lors Junon fut appelée Moneta, c'est-à-dire conseillère, et
bien que depuis elle soit demeurée muette, le surnom lui est demeurés. Tout
auprès sont les temples adossés de la Fortune primigénie, déesse de la
destinée, et de la Fortune obsequens ou obéissante, l'un et l'autre fondation
du roi Servius.
Sur la droite de la place s'élève le temple de Jupiter-Férétrien, le plus
ancien des édifices du Capitole, et même de Rome. Romulus le construisit à la
suite d'une victoire qu'il remporta sur les Cénipates. Il tua leur roi,
rapporta lui-même à Rome les dépouilles de cet ennemi, en dressa un trophée
sur le mont Capitolin, et plus tard, érigea au même endroit un temple où il
ordonna que les dépouilles des généraux ennemis seraient désormais
consacrées. Ce n'est qu'un édicule ; à peine a-t-il quinze pieds dans, sa
plus grande longueur. Il est rempli de dépouilles opimes, de ces dépouilles
que le chef d'une armée romaine a conquises en tuant de. sa propre main le chef
d'une armée ennemie. Elles sont arrangées en trophées, et au-dessous une
inscription indique le nom du vainqueur. Le trophée de Romulus s'y voit encore
: on l'appelle la Première opime.
Ce petit temple finit par devenir insuffisant; le roi Ancus Martius, à là
suite de plusieurs guerres heureuses, l'agrandit par l'adjonction d'une aile, et
plus tard on éleva en parallèle le temple de Jupiter-Praedator, le dieu du
butin.
Sur la place vers l'Intermont une cabane ronde, en bois et couverte de roseaux,
attire les regards par son humble apparence : c'est le berceau de Rome,
l'habitation de Romulus au temps où ce fils adoptif de Faustule vivait comme un
berger. Cette chaumière, que le fondateur de la Ville construisit de ses mains
et appelée Cabane de Romulus, est conservée avec une sorte d'orgueil. Elle a
14 ou 15 pieds de diamètre, et sa paroi de muraille, 8 ou 9 pieds de haut.
Dessus s'élève, en forme de cône tronqué, à une hauteur de 40 à 50 pieds,
un toit de roseaux d'une grande espèce, qui croît encore dans le Latium. La
Cabane pourrait tenir une vingtaine de personnes couchées autour. Dans le
centre est le foyer, sous le cône dont l'extrémité tronquée sert de passage
à la fumée. Les pauvres pasteurs du Latium se construisent encore des cabanes
telles que celle-ci. Les Romains la vénèrent comme un lieu saint ; des
gardiens spéciaux sont chargés de l'entretenir et de veiller à ce que. ni sa
forme ni son aspect ne soient altérés toutes les fois qu'elle a besoin de
réparations. Rome veut qu'on voie d'où elle est partie pour arriver à
l'empire du monde. Devant, une statue en airain doré, représentant la Louve
allaitant Romulus et Rémus, illustre encore ce lieu d'un autre souvenir de
l'origine de Rome.
Du même côté, on voit un trophée de victoire, rapporté d'Apollonie, ville
de Pont, par M. Lucullus, c'est une statue colossale d'Apollon, haute de trente
coudées. A droite et à gauche sont deux autels : l'un, consacré à
Jupiter-Pisteur (faiseur de pain), parce qu'il avait inspiré aux Romains
assiégés par nos ancêtres de jeter des pains dans leur camp, afin de faire
croire que la Forteresse était bien approvisionnée, et, par cette ruse, de les
dégoûter du siège ; l'autre à Jupiter-Soter ou sauveur, autel sur lequel les
Romains, après le départ de Brennus, brûlèrent le reste des cuirs et des
vieilles chaussures qui leur avaient servi de nourriture vers la fin du siège.
Les autres édifices de la Citadelle sont l'Atelier des monnaies, derrière le
temple de Junon-Moneta, et les logements des soldats.
Dans cette tournée rapide, Petillius me fit remarquer un puits dont le fond
atteint le niveau des plus basses parties de Rome. Il est fort ancien, car ce ne
fut que dans le dernier siècle, l'an six cent vingt-sept, qu'on amena de l'eau
vive sur la montagne du Capitole.
Nous étions revenus devant la Cabane de Romulus, lorsque je vis ouvrir la porte
des Cent marches et s'avancer une procession sacrée, suivie d'une foule de
peuple. Les prêtres de Junon, qui semblaient présider à cette cérémonie,
escortaient une litière couverte dans laquelle se pavanaient quelques oies
blanches vêtues d'un lambeau de pourpre rehaussé d'or. La procession s'arrêta
devant le temple de la déesse, et les prêtres y firent entrer les oies ; puis,
du haut du portique, un de ces ministres congédia le peuple. Quand la foule se
fut écoulée, Petillius m'apprit que les oies que je venais de voir, non sans
surprise, traitées avec tant de vénération, appartenaient à Junon ; qu'on
les nourrissait dans son temple, aux frais du publics, comme les descendantes de
celles qui, par leurs cris, sauvèrent le Capitole de l'escalade des Gaulois. Il
ajouta qu'à l'époque anniversaire de ce jour mémorable, le III des nones
d'Auguste, on répétait la procession dont je venais devoir le dénouement ;
puis me conduisant sur l'une des tours méridionales de la Forteresse : «
Regardez à vos pieds, continua-t-il, près du pont Palatin, entre les temples
de la Jeunesse et de Summanus. - J'aperçois quelques croix ... En bois de
sureau, arbre malheureux... - Sur lesquelles sont attachés des quadrupèdes...
- Des chiens, les chiens du Capitole - Comment ?- Oui ; par la raison qu'on
récompense la vigilance des oies, que nous appelons toujours « les
conservatrices, les gardiennes de la Citadelle Tarpéienne, » on punit dans les
chiens la qualité contraire ; vous savez qu'ils s'endormirent au lieu de
veiller. Ces animaux ont été portés dans la procession sur l'instrument de
leur supplice.. Il est bon de perpétuer dans le peuple le souvenir que les
Barbares ont été chassés de notre ville. - Et si ,cela n'était pas vrai ?
repartis-je vivement. - Il faut que cela le soit, repartit Petillius en souriant
; mais, ajouta-t-il, ni moi ni vous ne sommes obligés de le croire. »
En effet, la Citadelle Capitoline, dernier refuge des Romains, réduite à
capituler et faisant offrir aux assiégeants mille livres pesant d'or ; Camille,
dictateur, rompant le traité par cette parole superbe : « Les Romains se
rachètent par le fer, non par l'or; » enfin Brennus battu par Camille, les-
Gaulois taillés en pièces et Rome sauvée par cette victoire, tout cela n'est
qu'un conte populaire. Si nos ancêtres n'ont pas pris la Citadelle, ils n'ont
quitté Rome que de leur plein gré, chargés d'or et de butin, et jamais la
rançon de la ville ne nous a été arrachée par la présence de Camille, ni,
comme on le dit, enfouie sous le trône même de Jupiter, place bien choisie
pour soustraire ce trésor aux regards de ceux dont une curiosité indiscrète
aurait pu porter atteinte à la crédulité publique. Il y a cependant dans la
Citadelle même un témoignage de notre victoire : c'est une porte Pandana,
c'est-à-dire ouverte, parce qu'elle n'a point de fermeture. Brennus, en dictant
les conditions de sa retraite, fit engager les Romains à laisser, lorsqu'ils
rétabliraient leur ville, une porte perpétuellement ouverte, en souvenir de
l'occupation gauloise. Ils le promirent sous la foi du serment ; mais pour
rendre illusoire l'effet de cette promesse, ils placèrent la porte Pandana dans
un lieu inaccessible, en haut du roc Tarpéien. On la voit auprès du quartier
des soldats.
Une large montée en escalier à cordons, comme les Cent marches, descend de la
Citadelle dans l'Intermont. Cette étroite vallée peut passer pour le second
berceau de Rome , on y trouve le fameux Asyle ouvert par Romulus en vue de
grossir son petit État. Dans l'origine c'était un grand bois, couvrant toute
la montagne jusque sur la partie basse du Forum actuel : ce n'est plus, depuis
bien longtemps, qu'un bocage de chênes, comme relégué au. fond de
l'Intermont, et pour ainsi dire un souvenir, mais toujours respecté, quoiqu'il
ne serve plus d'asile. Jadis il était fermé par un mur; maintenant il n'a plus
d'autre clôture qu'une haie vive. Au milieu, sur sa lisière orientale,
s'élève le Temple de Véjovis ou Jupiter malfaisant. On l'honore comme un dieu
funèbre.
Sous le rapport monumental, l'Intermont ne le cède pas à la Citadelle ; il
offre même un plus bel ensemble : devant le temple de Véjovis s'ouvre une
belle place dallée qui, à partir de l'Asyle, remplit presque toute la vallée.
Elle est encadrée, à l'orient, par la continuation du clivus Capitolin, qui la
traverse dans toute sa largeur ; au midi et au septentrion par deux bouts de
voie aboutissant à des temples. Un Arc triomphal, deux Fontaines jaillissantes,
en marbre, deux Colonnes monumentales, et diverses statues, dont plusieurs
équestres, et en airain doré, décorent cette place. L'Arc triomphal n'est
qu'honoraire, porte le nom de Scipion l'Africain, son fondateur, et fait face au
temple de Véjovis ; il est flanqué par les Fontaines jaillissantes, ouvrage
aussi de Scipion. Les Colonnes, dont l'une surmontée de la statue du roi des
dieux, est appelée Colonne de Jupiter, et l'autre, qui est une Colonne
rostrée, fut érigée par un certain Aemilius, s'élèvent aux parties
latérales de la place, près des deux Bois. Deux Statues équestres ornent les
angles de la place, sur le bord du clivus Capitolin ; d'autres sont
disséminées çà et là.
Au delà de la voie transversale, vis-à-vis de l'Arc de l'Africain, Scipion
Nasica a fait construire un Portique spacieux. Ici où la chaleur du jour est si
forte pendant une grande partie de l'année, l'ombre et l'eau sont des choses
délicieuses, et comme les Comices se tiennent quelquefois dans l'lntermont ,
les deux nobles Scipion ont voulu faire une chose agréable au peuple, l'un en
lui donnant des fontaines alimentées par l'eau la plus pure, la plus
transparente, la meilleure à boire de toutes celles de Rome, et l'autre, en lui
ménageant un superbe abri contre les feux accablants du soleil, ou bien contre
la pluie, non moins redoutable.
Ce bel ensemble est complété par le Tabularium, grande galerie ou sont les
archives de la République, et qui ferme en quelque sorte l'Intermont derrière
le Portique de Scipion Nasica. Dans le Tabularium, sont conservés, sur des
milliers de tables d'airain, les traités anciens et nouveaux avec les nations
étrangères et les peuples vaincus, ainsi que les lois et ordonnances du peuple
romain. Exposés là, ces actes deviennent plus respectables, et sont des
monuments authentiques consacrés par la garantie des dieux mêmes. « Cette
garantie, ajouta Petillius, est surtout de que l'on recherche ; mais comme le
Tabularium, malgré son étendue, ne suffirait pas à contenir et les lois et
les autres actes publics, tels que, par exemple, les traités avec les peuples
étrangers, un temple, n'importe lequel, est toujours propre à recevoir et
conserver de pareilles tables ; je vous citerai, parmi ceux qui contiennent de
ces dépôts, le temple même de Jupiter Capitolin, ceux de la Foi, de Castor,
des Nymphes, de Diane Aventine, et, près de ce dernier, l'Atrium de la
liberté. »
Pendant ces explications, nous étions entrés sous le Portique de Scipion, pour
nous mettre à l'ombre, car le mois d'Auguste est le plus chaud, peut-être, de
l'année. Après quelques instants de repos, nous fîmes le tour de la vallée
Capitoline, qui renferme encore quatre temples, celui de la Foi, dont Petillius
parlait tout à l'heure, sur la droite du grand escalier à cordons qui conduit
au temple de Jupiter Capitolin ; deux autres consacrés à mens et à Vénus
Erycine, entre cet escalier et le Bois de l'Asyle ; et le quatrième, au pied de
la Citadelle, vers la gauche de l'Asyle, à Mars Bisultor ou deux fois vengeur.
Ce dernier est un petit édifice circulaire, bâti par l'Empereur, il y a peu
d'années, lorsque Phraates, roi des Parthes, renvoya les enseignes et les
prisonniers jadis perdus par Crassus. Auguste en éprouva tant de joie,
qu'aussitôt il décréta l'édification de ce temple, et voulut que désormais
on y consacrât les enseignes récupérées.
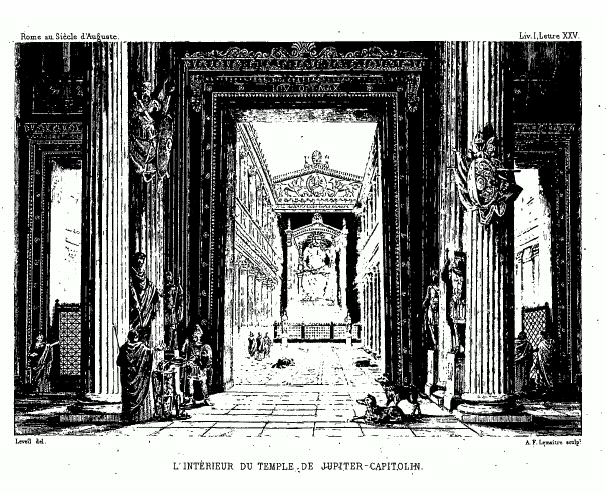
Montons
maintenant au Temple de Jupiter. Il se présente sous l'aspect le plus imposant
: bâti sur une esplanade ceinte d'une muraille décorée de pilastres et
surmontée de statues, il domine majestueusement l'Intermont, la Citadelle, et
la ville, dont on embrasse de là presque toute l'enceinte : c'est une position
toujours, choisie pour des dieux tutélaires de la cité. On arrive à
l'esplanade par le grand escalier à cordons que j'ai nommé tout à l'heure, au
sommet duquel est un petit portique en colonnade, unique entrée de cette
enceinte élevée, qu'on appelle l'Area. Elle est remplie, et presque encombrée
d'une foule de petits monuments, et surtout de statues, parmi lesquelles il y en
a deux colossales : l'une, à gauche du temple, est un Hercule en airain,
trophée de victoire de Fabius Maximus, qui l'enleva de la citadelle de Tarente
lorsqu'il la reprit aux Carthaginois. Fabius s'est dressé à lui-même, tout
auprès, une statue équestre, également en airain. La seconde, à droite, de
même métal et en parallèle d'Hercule, est un Jupiter. Cette statue fut
fabriquée avec les casques et les cuirasses des Samnites vaincus par Spurius
Carvilius, vers le milieu du cinquième siècle. Il y a une quarantaine
d'années, le Capitole avait été frappé de la foudre en plusieurs endroits ;
les Aruspices (ce sont des devins) appelés de tous les cantons de l'Étrurie
annoncèrent que les temps approchaient où l'on verrait des massacres, des
incendies, la subversion des lois, la guerre civile et domestique, la chute de
Rome et de l'Empire, si les dieux, apaisés à tout prix, ne faisaient fléchir
sous leur puissance la puissance même des Destins. Ils ordonnèrent d'ériger
au roi du ciel une statue plus grande que la première, et de la placer sur une
base élevée, la face tournée en sens contraire, c'est-à-dire vers l'orient.
Ils espéraient que cette image, qui fut érigée peu de temps avant la
conjuration de Catilina, regardant à la fois l'Aurore, le Forum et la Curie
Hostilia, alors seraient mis au grand jour, et dévoilés au Sénat et au
peuple, les complots tramés dans l'ombre pour la perte de Rome et de l'Empire.
Au pied de ce Jupiter on voit la statue de Spurius Carvilius, qui la fit faire
des seules ciselures sorties du colosse primitif.
On remarque encore sur l'Area du Capitole une Minerve dite catalane, de Catulus
qui l'érigea ; une statue du Bon Événement ; une autre de la Bonne Fortune ;
quelques statues équestres, dorées, parmi lesquelles celle de Scipion
l'Africain ; des Séjuges et des Quadriges dorée. A l'entrée, de chaque
côté, sont quelques loges pour les édituens ou gardiens du temple.
Au milieu de l'Area, sur un soubassement de trois degrés, s'élève le temple.
Sa forme est celle d'un parallélogramme presque carré, de deux cents pieds de
long sur cent quatre-vingt-dix de large environ, entouré de trois côtés d'une
superbe colonnade en marbre. Sa façade, tournée entre l'orient et le midi, se
compose d'un péristyle de trente-six colonnes corinthiennes, douze de front sur
trois de profondeur. Elles supportent un majestueux fronton, surmonté de
statues d'airain doré, et terminé par un quadrige de même matière, dans
lequel est la statue de Jupiter. Les colonnades latérales forment chacune un
portique à double rang seulement. Un mur ferme toute la partie postérieure du
temple, et le faîte de ce côté est orné de la statue de Summanus, dieu de la
foudre aussi, comme Jupiter, mais de la foudre nocturne.
Cet édifice paraît d'autant plus imposant, qu'il y a peu de reculement, peu
d'espace tout autour, de sorte que le spectateur saisit ses proportions pour
ainsi dire corps à corps. Son aspect annonce, le temple orgueilleux d'où le
peuple romain lance la foudre (c'est toujours au Capitole qu'on délibère sur
la guerre) ; où la victoire a réuni son arsenal : aux colonnes, aux frises du
péristyle, au-dessus des portes pendent des trophées militaires ; ce sont des
armes de généraux ennemis, des haches meurtrières, des boucliers criblés de
coups, des enseignes de toutes les nations, des épées rouillées de sang. Là,
on voit des rostres de navires carthaginois, des casques sénonais, une épée
redoutable, qu'on dit être celle de Brennus; plus loin, les dépouilles de
Pyrrhus, les étendards des Épirotes, les cônes pointus des Liguriens, les
parmes grossières des Espagnols, les gèses des habitants des Alpes.
« Autrefois, me dit Petillius, on admirait dans la frise du fronton une suite
de boucliers votifs dorés, que les édiles M. Aemilius et L. Aemilius Paulus
avaient fait faire avec le produit d'une amende imposée à quelques fermiers
des pacages publics, et au-dessus de la porte du temple de Jupiter, le bouclier
Marcien, ou, plus clairement, le bouclier d'argent d'Asdrubal, pris par Marcius,
vengeur des Scipions en Espagne, lorsqu'il força le camp du général
carthaginois. Mais ces belles décorations, et mille autres, ont été perdues
à jamais dans le terrible incendie qui dévora notre temple, il y a soixante.
et quelques années, quand Sylla et Carbon déchiraient la patrie et se
disputaient l'Empire. On dit que Carbon en fut l'auteur ; d'autres en accusent
les consuls L. Scipion, et C. Norbanus, d'autres, les partisans de Sylla : ce
qu'il y a de certain, c'est qu'on n'en a jamais pu connaître la cause. Ce
malheur arriva la veille des nones de Quintilis. J'étais bien jeune alors, mais
jamais je n'oublierai l'impression profonde de terreur causée dans Rome par la
ruine d'un temple aussi vénérable, qui existait depuis quatre cent vingt-cinq
ans !
«Dès l'année suivante, Sylla entreprit de le reconstruire tel que vous le
voyez. Tout heureux qu'il était ; il ne put l'achever, et mourut cinq ans
après avoir commencé. les travaux, qui durèrent quatorze ans : Lutatius
Catulus dédia, il y a un demi-siècle, le. nouvel édifice, qui est reconstruit
sur les mêmes fondations que l'ancien. Il n'en diffère que par la beauté des
matériaux (le premier était de pierre, celui-ci est de marbre), et surtout par
la magnificence de ses riches ornements ; l'immense fortune du peuple romain n'a
pu qu'ajouter à sa richesse et non à sa grandeur. Les ornements en dorure qui
brillent sur ses tuiles d'airain, que vous ne pouvez voir d'ici, sont dus à
Catulus. C'est une magnificence dispendieuse, qui fut blâmée par beaucoup de
monde. Ces belles colonnes en marbre de Paros viennent d'Athènes ; Sylla les
ravit au temple de Jupiter Olympien, comme s'il avait voulu que son Capitole
fût pour Rome et pour lui un perpétuel trophée de victoire. »
Le vaste péristyle qui précède l'entrée du temple proprement dit est orné
de neuf statues, placées dans les espaces du premier rang de colonnes ; sept
représentent les anciens rois de Rome ; la huitième est-celle de Brutus, le
vainqueur de la tyrannie ; et la neuvième, image de Jules César, lui fut
décernée après la fameuse victoire de Munda, par les sénateurs, sur la
proposition de Decimus Brutus, qui voulait par là tendre un piège à
l'oppresseur de la liberté. Par un hasard qui a quelque chose de fatal, la
statue de César se trouve auprès de celle de l'ancien Brutus, qui, pour avoir
chassé les rois, est représenté une épée nue à la main.
N'était-ce pas une menace au dictateur, un avertissement qu'à Rome., il se
trouverait toujours un Brutus peur abattre la tyrannie ?
L'intérieur du Capitole n'est pas moins imposant que l'extérieur : ce temple,
le plus vaste de tous ceux de Rome, est divisé en trois nefs par une double
colonnade composée de deux rangs de colonnes superposés. Chacune des trois
nefs se termine par un édicule, car, bien que le Capitole soit consacré
spécialement à Jupiter Très bon, Très grand, très bon pour ses bienfaits,
très grand pour sa puissance, néanmoins on y vénère aussi Junon-reine et
Minerve. Jupiter occupe l'édicule du milieu ; à sa droite est celui de
Minerve, à sa gauche celui de Junon : le père des dieux se trouve ainsi entre
sa femme et sa fille.
Trois larges portes d'airain, avec des seuils de même matière, s'ouvrent sous
le péristyle, et correspondent à chaque temple ou édicule. En pénétrant
dans l'édifice par la porte centrale, on croit d'abord entrer dans un atrium,
dans une cour flanquée de portiques, parce que cette nef n'a point de plafond ;
elle est à ciel ouvert, comme tous les temples toscans, disposition
merveilleusement convenable pour le roi des dieux. Ce culte rendu sous la voûte
du ciel, ainsi que font nos Druides, a quelque chose de plus grand, de plus
réellement religieux, que sous les plus riches lambris. A l'extrémité de
cette nef découverte, qui est pavée en marbres découpés, on aperçoit la
statue demi-colossale de Jupiter. Elle est d'ivoire ; avant Sylla, elle était
de terre cuite. Le dieu est assis ; son bras gauche s'élève sur une lance pure
qui lui sert de sceptre, signe de sa souveraineté céleste, et sa main droite,
posée sur ses genoux, tient un foudre d'or. Il a sur la tête une couronne
d'or, radiée ; sa figure est peinte en vermillon, et une toge de pourpre
rehaussée de fleurons d'or lui voile seulement la partie inférieure du corps.
Le sanctuaire où siège ce magnifique simulacre figure comme un petit temple
couvert, avec un fronton surmonté d'un quadrige doré.
Les nefs latérales, où se trouvent les temples de Minerve et de Junon, sont
couvertes par un plafond composé de poutres de bois qui se croisent à angles
droits. Leurs croisements forment des caissons resplendissants d'or.
Les étrangers vénèrent beaucoup le Capitole ; ils le regardent comme le
sanctuaire du peuple romain, et quand ils veulent témoigner à ces maîtres du
monde leur reconnaissance pour des avantages qu'ils en ont reçus, ou seulement
les féliciter sur leurs succès, ils envoient des ambassades offrir des
sacrifices dans cette demeure sacrée, et y déposer de riches présents.
Chacune des cella (ou édicules) est remplie de semblables offrandes, qui
consistent principalement en couronnes et en statues d'or. Petillius me montra
plusieurs couronnes d'un très grand prix dans la cella de Jupiter; une, entre
autres, du poids de cinquante livres, offerte par les Alabandiens ; une seconde
de cent, envoyée par Philippe, roi de Macédoine ; et une troisième de deux
cent cinquante-six, don du roi Attale. A la vue de tant d'or, je me crus presque
dans un temple de notre pays ; mais ce n'était encore là que la moindre partie
des richesses que mon guide allait me faire admirer : « Cette Victoire d'or, me
dit-il, pèse trois cent vingt livres : c'est un présent que Hiéron, roi de
Syracuse, fit au Sénat. Voici de ce côté de nouvelles Victoires d'or,
chargées de trophées, et un groupe de même métal, représentant Jugurtha
livré à Sylla par Bocchus, offrande de ce roi barbare, après que le Sénat
l'eut déclaré ami et allié du peuple romaine. Le grand Pompée dédia ici ces
pierres et ces coupes murrhines, ainsi que cet écrin, ces ornements, ces
bijoux, qui ont appartenu au roi Mithridate, cette énorme couronne d'or, et
cette vigne ou jardin de même métal. On estime la vigne vingt-cinq talents.
Aristobule, roi des Juifs, l'envoya à Pompée, quoique l'inscription porte le
nom d'Alexandre, autre roi de la même nation. Voici un morceau de cristal qui
pèse près de cinquante livres ; il a été donné par la princesse des
Romaines, par Livie. L'Empereur, qui n'a pas voulu se montrer moins généreux
que sa femme envers Jupiter, vient de nous envoyer seize mille livres d'or, et
pour cinq cent mille sesterces de perles et de pierreries ! Avant l'incendie,
dont plusieurs de ces objets ont été sauvés, on admirait encore dans cette
cella trois superbes patères d'or, fabriquées avec une partie du produit de la
vente des prisonniers faits par Camille, dans trois guerres successives
soutenues contre les petits peuples voisins de Rome. »
Petillius me fit encore voir le sceptre de Jupiter et le casque de Mars,
plusieurs vases magnifiques, ouvrage d'un célèbre sculpteur grec, et une
chèvre en airain, qu'il me dit être l'image de la nourrice du roi des dieux.
Après avoir admiré toutes ces richesses, toutes ces merveilles, j'arrêtai ma
vue sur deux statues placées de chaque côté d'une grille qui sépare la cella
de la nef : « Celle de droite, vêtue d'une chlamyde, me dit Petillius,
représente le premier Africain. Par une distinction unique, le Capitole sert
comme d'atrium à la race Cornelia. Scipion avait coutume de venir vers la fin
de la nuit, avant le crépuscule, dans cette cella qu'il se faisait ouvrir, et y
demeurait longtemps seul, comme s'il délibérait avec le roi des dieux sur les
affaires de la République. C'était, au reste, une habitude de ce grand homme
de ne jamais entreprendre d'affaires publiques ou privées sans être auparavant
venu se livrer à la méditation aux pieds de Jupiter Capitolin ; aussi le
disait-on fils de ce dieu. La statue de gauche est celle de Jupiter imperator.
Elle fut enlevée de Préneste, il y a près de quatre siècles, par le
dictateur Titus Quintius, ou, suivant une autre tradition, apportée de la
Macédoine par Flamininus. C'est une oeuvre parfaite, et d'autant plus
précieuse, qu'il n'existe que trois statues de Jupiter imperator dans
l'univers, et toutes trois fort belles. Celle-ci, par un véritable miracle, a
échappé à l'incendie du Capitole.
Les édicules de Minerve et de Junon sont un peu moins grands que celui de
Jupiter. On y voit les deux déesses représentées debout, dans leur costume et
avec leurs attributs particuliers, Minerve en guerrière, avec une chouette à
ses pieds ; Junon-reine, avec un paon auprès d’elle. L'une et l'autre appuie
sur une lance sa main gauche élevée à la hauteur de l'épaule.
Ces temples renferment aussi divers objets d'art précieux ; entre autres, dans
celui de Junon une oie d'argent, érigée en l'honneur de celle qui jeta les
premiers cris d'alarme contre les Gaulois ; et un chien léchant sa blessure,
oeuvre si vraie, d'un travail si parfait, que l'on considère ce morceau comme
hors de prix, et qu'en vertu d'un édit public les gardiens en répondent sur
leur tête.
La cella de Minerve contient, parmi beaucoup de butin fait par l'Empereur dans
les guerres civiles, la plupart des ornements de Cléopâtre, reine d'Égypte.
On y admire aussi un tableau représentant l'enlèvement de Proserpine. Il y a
près de ce tableau un curieux monument d'antiquité romaine : c'est une
ancienne loi, écrite en vieux langage et avec les anciens caractères, laquelle
ordonne que tous les ans, aux ides de septembre, le premier magistrat de la
République fichera un clou au côté droit du temple de Jupiter, vers la partie
où se trouve la cella de Minerve. Cette cérémonie , pratiquée d'abord
accidentellement, comme moyen expiatoire pour faire cesser des maux qui
affligeaient la ville, étant devenue annuelle, fut appliquée aussi au comput
du temps : l'écriture étant alors peu connue, les clous servirent à marquer
les années. La loi d'institution de cette cérémonie, que l'on dit d'origine
étrusque, est gardée dans la cella de Minerve, parce que l'on doit à cette
déesse la connaissance des nombres.
On remarque devant la grille du temple de Minerve, d'un côté, trois statues
repliées sur leurs genoux : ce sont les dieux Nixii, divinités des femmes en
couches ; de l'autre, une statue de Minerve, qui appartint à Cicéron, et qu'il
consacra dans ce lieu lorsqu'il partit en exil. Il y mit cette inscription : «
A Minerve, gardienne de Rome. »
« Ces trois petits temples contigus, dis-je à Petillius, renferment plus de
richesses que tous les autres temples disséminés dans la ville. - Je ne le
sais que trop ; un inventaire détaillé m'en a été remis lorsque j'entrai ici
et maintenant je suis responsable de tout. La surveillance la plus active est
organisée sur toute la montagne : nous avons des tutelares, gardes généraux ;
des aedituens, gardes des temples; des arcubes, gardes de la Citadelle. En
outre, des chiens sont lâchés la nuit dans l'enceinte du temple de Jupiter, et
des oies veillent dans la Citadelle. Malgré ces précautions, il se commet
encore quelques vols, et plus d'une couronne d'or a été furtivement enlevée
de nos temples. »
Nous étions sortis de l'édicule de Minerve ; je me dirigeais vers le
péristyle extérieur par la grande nef découverte, en regardant le ciel,
lorsqu'à quelque distance de la statue de Scipion l'Africain, mon pied heurta
une pierre. « C'est Terme, me dit un édituen qui me soutint en me voyant
chanceler : c'est tout à la fois l'autel et le dieu. » - Puis remarquant ma
surprise, et prévenant mes questions, il ajouta : « Lorsque Tarquin le Superbe
songea sérieusement à l'édification du Capitole, qu'il voulait laisser comme
un monument de son règne et de sa famille (l'aïeul avait fait le voeu, pendant
une guerre contre les Sabins, et le petit-fils l'accomplit ), afin que
l'emplacement fût réservé tout entier pour Jupiter, et que les autres dieux
ne le partageassent pas avec lui, il résolut d'exaugurer quelques autels
consacrés dans ce lieu par le roi Tatius. Les augures furent consultés, comme
on l'avait fait pour la consécration, et les dieux annoncèrent, par des signes
éclatants, la puissance de l'Empire. En effet, les auspices autorisèrent la
translation des autres divinités, mais se montrèrent constamment opposés à
celle des dieux Terme et Mars, et de la déesse Jeunesse. Ce refus opiniâtre
parut aux devins d'un bon présage : il annonçait. une puissance inébranlable
et éternelle ; on les conserva donc. Mais ce qui sembla plus étrange encore,
c'est qu'en creusant les fondations de l'édifice on trouva une tête d'homme
dont les traits n'étaient point altérés. Plus de doute, Rome devait être le
siège de l'Empire du monde et comme la tête de l'Univers : telle fut
l'explication que donnèrent les devins, tant ceux de Rome, que ceux que l'on
envoya consulter en Étrurie pour interpréter ce prodige. Des anciens autels
conservés, celui de Terme est à vos pieds. Il se trouve placé là parce qu'on
ne sacrifie jamais à ce dieu qu'en plein air. Quant à ceux de la Jeunesse et
de Mars, l'un est dans le temple même de Minerve, près de la statue de la
déesse ; l'autre sous le péristyle du temple. Vous ne les avez probablement
pas remarqués, parce qu'ils sont si peu considérables, que bien des personnes
passent auprès sans les voir, et que même les savants les connaissent à
peine. »
En quittant l'enceinte du temple de Jupiter, dont les portes, criant sur leurs
gonds d'airain, se fermèrent derrière nous, je voulus faire encore une fois le
tour de l'Intermont. Revenu au bas de l'escalier de la Forteresse, je me trouvai
auprès d'une porte dans laquelle aboutit le Clivus Capitolin. Nous descendîmes
par là, et arrivés vis-à-vis des Cent marches, Petillius me fit entrer dans
une longue galerie en portiques qui forme la partie inférieure du Tabularium. A
l'extrémité, nous trouvâmes le Clivus de l'Asyle, voie parallèle à celle
que nous venions de quitter. Nous le descendîmes en passant derrière la Prison
publique jusqu'à la voie du Forum de Marsa, dans le quartier des Lautumies,
ainsi nommé d'anciennes et vastes carrières creusées aux flancs du mont
Capitolin, sous les Favissae, grottes naturelles du temple de Jupiter. On tira
probablement des Lautumies les murs et les maisons de Rome primitive ; puis
elles servirent de prison, et conservaient encore cette destination il y a un
peu plus d'un siècle et demi. Je ne fus pas curieux d'y entrer : après ce que.
je venais de voir, quel intérêt pouvaient m'offrir ces antres obscurs et
poudreux, dont presque toutes les ouvertures sont murées ? Poursuivant donc
notre chemin, et sortant par la porte Ratumène, nous doublâmes l'extrémité
septentrionale de la montagne. Mon guide me fit ainsi visiter les substructions
du Capitole, l’un des ouvrages les plus étonnants de cette colline, qui
renferme tant de choses merveilleuses. Le sommet sur lequel Tarquin voulait
bâtir le temple qu'il avait voué au roi du ciel, était escarpé et terminé
en pointe ; il l'environna de hautes et fortes murailles, rapporta des terres et
créa l'esplanade sur laquelle le monument est assis. Le mont, qui s'appelait
auparavant Saturnien prit alors le nom de Capitolin.
Ces travaux durèrent fort longtemps, car ils sont vraiment prodigieux :
figure-toi un mur de terrasse, haut de plus de cent soixante pieds et d'un très
grand circuit, construit tout en grosses pierres de taille ajustées et posées
sans ciment, et remarquables encore au milieu de la magnificence actuelle de
Rome. Les Romains, habitués aux choses extraordinaires, les appellent les «
Substructions insensées du Capitole. » Elles sont en pierre grise ou tuf, et
forment une muraille qui n'a pas moins de dix-neuf à vingt pieds d'épaisseurs.
Rome Empire naissant, n'était pas en état de supporter une pareille dépense,
et dans cette entreprise Tarquin semblait poussé par une sorte de pressentiment
que ce temple recevrait un jour les voeux de toute la terre. Tarquin l'Ancien
mourut sans avoir pu faire autre chose que de préparer ainsi l'area du futur
temple de Jupiter, encore fut-ce Servius qui l'acheva. Mais ce roi n'osa pas
entreprendre l'édification du Temple, soit qu'il trouvât l'ouvrage au-dessus
des ressources de Rome, soit plutôt qu'après avoir ajouté les monts Quirinal,
Viminal, et Esquilin à la ville, il jugeât plus nécessaire de consacrer tous
ses efforts à la fortifier vers l'orient, par sa levée, le merveilleux Agger
que j'ai déjà décrit.
Tarquin le Superbe entreprit d'achever l'oeuvre conçue par son aïeul ; il jeta
les fondements du Temple, et le travail était si difficile, qu'il absorba
quatre cents talents, ou, suivant d'autres, la somme énorme de quarante mille
livres d'argent. Tarquin y consacra les dépouilles de ses conquêtes,
Suessa-Pometia, Apioles, Ardée, Gabies, et Ocriculum. Il manda de toutes les
parties de l'Étrurie d'habiles ouvriers, qu'il paya sur le Trésor publics ; en
outre, considérant l'entreprise comme une oeuvre nationale, il y fit
travailler, sans salaire, les artisans et les autres ouvriers romains.
Tant d'efforts accumulés avancèrent beaucoup l'édifice ; mais le roi fut
détrôné avant d'avoir pu le finir. La gloire d'achever cet illustre temple
était réservée à la liberté : il fut terminé sous les consuls Valérius
Publicola et Horatius Pulvillus, la troisième année après l'expulsion de
Tarquin, et dédié, aux ides de septembre, par Horatius Pulvillus.
Les Romains sont fiers de leur Capitole ; ils lui donnent les noms les plus
pompeux, les plus orgueilleux, et je dirais presque qu'ils ont raison ; ils
l'appellent « la Citadelle de toutes les nations, le domicile terrestre de
Jupiter, sa seconde demeure après le ciel. » Pour moi c'est la merveille de
Rome, c'est tout ce que l'esprit humain a pu inventer de plus imposant. Je ne
m'en éloignai qu'à regret ; il me semblait toujours que je ne l'avais, pas
assez vu, ou que j'avais encore mille choses à y voir. Pour rentrer chez moi
par la voie la plus courte, je longeai la partie de la région Flaminienne qui
confine au mont Capitolin ; je passai près du Cirque Flaminius, du temple de
Bellone, du temple antique d'Apollon, du Portique d'Octavie, du théâtre de
Marcellus ; je traversai l'île Tibérine sur les ponts Fabricius et Cestius, et
de tant de magnifiques monuments, pas un seul n'attira mon attention : je
rêvais du Capitole. Je me retournai pour le voir, et à plusieurs reprises,
dès que je fus arrivé sur les premières pentes du Janicule. Mon oeil se
promenait du Temple à l'Intermont, de l'Intermont à la Citadelle, et
s'abaissait de la Citadelle sur le roc Tarpéien, par où les soldats de Brennus
tentèrent leur célèbre escalade. Il me semblait les voir, au milieu d'une
nuit presque obscure, se poussant en silence les uns sur les autres ; puis
Manlius, dont le temple de Junon-Moneta me rappelait la maison, accourir
impétueusement, renverser nos malheureux compatriotes, et faire échouer cet
audacieux assaut, qui peut-être allait trancher le destin de Rome. Ce mont
escarpé de toutes parts, et si bien fortifié, m'apparaissait comme l'aire de
la gloire et de la puissance romaines. Alors de graves souvenirs, où se
mêlaient ceux de notre conquête par César, me roulaient dans l'esprit; un
profond sentiment de tristesse me serrait le coeur : « Là, me disais-je, est
le joug de l'univers; » et des larmes me tombaient des yeux en songeant à
notre patrie.