
| RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE | ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DEZOBRY |
Dezobry, Charles (1798-1871)
Rome au siècle
d'Auguste,
ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une
partie du règne de Tibère
LETTRE XII.
LES BAINS PRIVÉS ET LES BAINS PUBLICS.

Il est un genre
de luxe que je vois croître et se développer tous les jours, c'est celui des
Bains. Le bain est non seulement une jouissance, mais un besoin dans ce pays où
il fait si chaud que le corps se trouve dans une transpiration pour ainsi dire
continuelle. Aussi, riches et pauvres, grands et petits, tous se baignent, et se
baignent chaque jour. Il y a environ dix ans, Agrippa, gendre et ministre de
l'Empereur, faisant exécuter une foule de travaux et de monuments pour
l'agrément et l'utilité du peuple, établit entre autres cent soixante-dix
Bains publics, où pendant une année le peuple fut admis gratuitement.
Maintenant, excepté les enfants, qui jouissent encore de leurs entrées
franches, tout le monde paye à la porte la rétribution d'un quadrans, petite
monnaie d'airain. Pour cette minime somme, on peut prendre bain froid, bain
tiède, bain chaud, et bain de vapeur. C'est ce que font la plupart des
baigneurs, car, d'après les habitudes générales, se plonger dans l'eau froide
ou dans l'eau chaude, ce n'est pas se baigner.
Autrefois les bains n'étaient que de simples piscines où l'on venait nager, s’exercer,
se laver surtout, comme le prouve leur ancien nom de lavatrina. Vers la
fin du dernier siècle, du temps de Pompée, il y avait fort peu
d'établissements de ce genre, particuliers ou publics, bâtis avec soin et
pourvus des recherches qu'on y trouve communément aujourd'hui. La description
suivante te donnera une idée des Bains actuels ; bien que ce soit celle des
Bains de Mamurra ; auxquels je voulais consacrer une lettre spéciale, cependant
elle convient, sauf quelques détails d'ornementation, à tous les Bains en
général : les mêmes besoins ont commandé partout les mêmes dispositions.
Les Bains de mon hôte sont auprès de la Basilique, de l'Exèdre, et du
Sphaeristère ; ils ne s'en trouvent séparés que par une petite cour pavée en
mosaïque, entourée d'un péristyle en colonnes octogones, et à l'entrée de
laquelle est un Baptistère, grand bassin où l'on prend quelquefois le bain
froid en commun. Un toit léger, supporté par deux colonnes en avant-corps,
couvre le Baptistère. Des peintures représentant des arbres chargés de
fruits, des rivières où toutes sortes de poissons semblent nager dans la
profondeur des eaux, ornent les parois des portiques.
La première pièce où l'on entre en quittant la cour est une salle nommée
Apodytère, nom formé d'un mot grec qui signifie dépouiller, parce que c'est
là que l'on dépouille ses vêtements, et que l'on chausse des mules légères,
composées d'une semelle plate couverte seulement sur l'avant-pied.
De l'Apodytère on passe dans le Frigidaire, autre salle où l'on trouve encore
un Baptistère pour le bain froid, quand on ne veut point le prendre en plein
air. L'une des extrémités du Frigidaire se termine par un hémicycle au centre
duquel gît la cuve du bain, Labrum ou Solium,, entourée d'un
petit espace clos par un Pluteus ou mur d'appui. Des pilastres, des niches, des
statues décorent le pourtour de l'hémicycle, dont le soubassement, formé par
un double rang de gradins, s'appelle Schola, l'école, parce que c'est
là que ceux qui assistent aux Bains sans y prendre part, ou qui attendent qu'il
y ait place dans la cuve, viennent s'asseoir pour converser. Entre l'École et
la cuve, il reste un chemin, Alveus, pour circuler autour des baigneurs.
Le Frigidaire reçoit son jour par en haut, de sorte que les corps n'y
projettent point d'ombre.

Le bain tiède, Tepidaire, suit immédiatement le Frigidaire. A peu près
carré, et terminé aussi par une École, il est muni de deux grands bassins si
larges, que l'on pourrait presque y nager. Comme on n'entre guère dans le
Tepidaire que pour s'y baigner, son École sert essentiellement aux baigneurs,
soit pour s'essuyer lorsqu'ils se contentent du bain tiède, soit pour se
reposer en sortant de la pièce suivante où l'on prend le bain de vapeur, et
que pour cette raison l'on nomme Sudatoire, ou Caldaire.
Le Sudatoire est circulaire, entouré de trois gradins, et garni tout à
l'entour de niches étroites, contenant chacune un siège.
Un réservoir d'eau bouillante occupe le milieu de la salle. Il fournit des
tourbillons d'une vapeur qui se répand partout, monte en nuages épais vers la
voûte, de forme hémisphérique, recouverte d'un enduit épais de stuc fin et
s'y engouffre avec violence. Elle s'échappe au sommet par une ouverture
étroite, fermée avec un bouclier rond, en airain, qui se manoeuvre d'en bas,
à l'aide d'une chaîne ; on l'ouvre comme une soupape quand la chaleur devient
trop suffocante.
Je n'oublierai de ma vie la première fois que je suis entré dans un Sudatoire
: saisi par les flots de la vapeur, haletant, palpitant, poussant de gros
sanglots, je crus que j'allais étouffer. L'air mêlé de feu et d'humidité que
l'on respire en ce lieu ne laisse pas un seul endroit du corps en repos ; il le
secoue, il le remue jusque dans ses moindres parties ; on se croirait presque
dans le foyer d'un incendie ; la température de ce bain est si brûlante, que
l'on pourrait condamner à être baigné vif un misérable convaincu de quelque
crime.
Le Sudatoire et sa cuve sont chauffés par un fourneau extérieur nommé
Laconinum, ou Hypocaustum. Ses flammes circulent sous le pavé, qui est porté
sur une multitude de petits piliers, et, au moyen de canaux conducteurs, jusque
dans l'épaisseur des murs.
Un Eleothése ou Unctoire, lieu dans lequel se déposent les parfums, complète,
avec quelques autres petits cabinets, et avec le Sphaeristère, dont j'ai parlé
dans ma lettre précédente, l'ensemble des Bains de Mamurra.
Il faudrait être bien difficile pour ne pas trouver ces Bains, si élégants et
si riches, dignes de la somptueuse demeure de mon hôte ; cependant ils sont
surpassés de beaucoup par ceux de Mécène, et surtout d'Agrippa : le premier
possède un Bain avec des bassins d'eau chaude si vastes qu'on peut y nager ; et
le second, qui en fait de constructions et de travaux d'art n'a que de grandes
idées, s'est construit les Bains les plus spacieux, les plus beaux, les plus
somptueux qu'on ait jamais vus à Rome. Agrippa loge au Palatin ; mais il n'y
avait pas sur cette montagne un espace suffisant pour lui ; il s'est donc
transporté au milieu du Champ de Mars, qu'il avait déjà embelli par le
Panthéon, et là, derrière et joignant ce temple, il a construit son édifice,
qui occupe une superficie de terrain presque égale à la moitié de celle de la
montagne Palatine ; il est élevé sur un carré de six cent cinquante pieds en
tous sens où les Bains proprement dits sont un édifice de sept cent dix pieds
de face, sur trois cent quarante de côté.
Construit à l'imitation des Palestres grecques, on y trouve, outre les salles
destinées aux diverses lotions, des galeries pour les exercices de la paume, de
la lutte, et des autres jeux gymniques. La plupart sont autour de deux grandes
cours quadrangulaires, de cent soixante-seize pieds sur cent vingt-sept, et
entourées de portiques pour la promenade. Les murs des salles sont revêtus de
stuc ou peints à l'encaustiques, et le Sudatoire, ajouté aux Bains dix ans
après leur construction, est orné de tableaux encadrés de marbre.
L'agrément de cet édifice vraiment royal se trouve encore augmenté par un
jardin qu'Agrippa a créé tout exprès. Il y avait là un marais, le fameux
Marais de la Chèvre, près duquel Romulus disparut pour devenir immortel ;
Agrippa convertit le marais en étang alimenté par des eaux vives, planta
autour des jardins délicieux, et s'y bâtit une habitation de plaisance où il
peut se reposer après le bain, souper, et passer la nuit au milieu des frais
ombrages, jusqu'à ce que le retour du jour le rappelle à Rome, et ramène pour
lui le tracas et les soucis des affaires. Ceux qui ne sont pas assez riches pour
avoir des Bains à eux (et le nombre en est grand) vont aux Bains publics.
Personne ne dédaigne ces établissements ; à côté du pauvre plébéien, on y
voit d'illustres citoyens et des riches de second ordre : seulement ces derniers
s'y rendent accompagnés de leurs clients. L'heure générale est depuis midi
jusqu'au soir.
Aller aux Bains est plus qu'un besoin, c'est une mode; des milliers de personnes
y vont par désoeuvrement, par curiosité, pour y rencontrer leurs connaissances
ou leurs amis. Là, certains riches quêtent des convives pour souper, et une
foule de pauvres hères, un souper pour leur ventre affamés.
Les femmes fréquentent les Bains dans un but moins innocent : elles en font des
lieux d'intrigues ; aussi aiment-elles ces établissements avec passion. C'est
pour elles comme un terrain de liberté, où la tromperie est d'autant plus
facile qu'elle se passe dans la foule, et se cache sous les apparences d'une
démarche commandée au moins par l'usage, sinon par la santé.
Un citoyen qui n'appartient pas à la plèbe se fait suivre au bain par un ou
plusieurs esclaves qui portent son linge dans une petite corbeille, gardent ses
habits, le retirent de l'eau, le soutiennent quand il marche, l'aident à
s'avancer dans la foule en un mot lui rendent tous les services dont il peut
avoir besoin. Celui qui n'a point d'esclaves trouve là des gens pour lui en
tenir lieu ; ces serviteurs bénévoles n'appartiennent point à
l'établissement dont tout le personnel se compose d'un baigneur, gardien du
bain, d'un chauffeur ou fournier, et de quelques autres esclaves condamnés,
comme criminels, aux travaux publics ; mais ils n'en sont que plus empressés :
stimulés par leur intérêt privé, ils circulent dans toutes les salles, et se
montrent toujours prêts à courir au moindre signe des baigneurs. On les
rencontre d'abord dans l'Apodytère. Il y a là, tout autour des murs, de
petites niches carrées de deux pieds sur deux pieds et demi environ, où les
baigneurs qui se fient à la foi publique placent leurs habits. Les niches sont
à six ou sept pieds du pavé, de sorte qu'on n'y peut guère atteindre qu'avec
une escabelle. Ce léger obstacle n'arrêtant point certains indévots, des
individus se sont ingéniés de se faire les auxiliaires de la foi publique, en
offrant aux baigneurs de garder leurs habits moyennant une petite rétribution
de deux as où deux as et demi. Ils les mettent dans une cassette Capsa, ce qui
les a fait appeler Capsaires. Il est toujours prudent d'accepter leurs services
quand on n'a pas de serviteur à soi.
A l'intérieur, vous rencontrerez les aliptes ou oigneurs faisant les fonctions
de parfumeurs et de frictionneurs. Ils sont faciles à reconnaître, parce
qu'ils portent le petit bagage de leur métier : de la main droite une éponge,
de la gauche, et enfilés dans un gros anneau, une ampoule à anses, de terre ou
de corne, pleine de parfums, et quelques Strigiles pour les frictions. Les
strigiles sont des espèces de grattoirs d'airain , ou de fer, longs de neuf à
quinze onces, les uns courbés comme une petite faux ; les autres droits, et
tous creusés en cuiller dans la partie opposée à la poignée, de manière à
s'appliquer aisément sur les rotondités des bras, des épaules, des cuisses ou
des jambes. Après eux viennent les Alipiles, épileurs et les Masseurs : le
bain étant toujours accompagné de frictions nombreuses et multipliées ; que
les Romains recherchent avec délices.
Au sortir de la Cuve ou du Sudatoire, le baigneur s'étend sur une espèce de
lit de repos, et un jeune masseur (ce sont des enfants ou des ennuques qui
remplissent ces fonctions, surtout pour les citoyens qui ont des esclaves), un
masseur, dis-je, commence par lui presser tout le corps pour lui masser, lui
pétrir, pour ainsi dire, la chair, pour lui assouplir les articulations.
Ensuite il passe aux frictions : la main armée du Strigile, il frotte vivement,
ou plutôt racle la peau, pour enlever la partie de l'épiderme qui se
renouvelle, et forme, en se mêlant à la poussière, une impureté nuisible à
la transpiration. Ces frictions durent assez longtemps, et pour qu'elles ne
deviennent pas douloureuses, il faut que le frictionneur soit doué d'une
certaine habileté. Cette opération est suivie de la dépilation des aisselles,
que l'Alipile ou le Parfumeur pratique soit au moyen de petites pinces soit à
l'aide d'un onguent composé de graine de saule noir amerain, avec égal poids
de litharge L'onction suit les frictions : le patient est légèrement oint
d'abord avec un liniment de saindoux et d'ellébore blanc, qui a la vertu de
faire disparaître les démangeaisons et les échauloulures puis avec des huiles
et des essences parfumées Ensuite on l'essuie avec des étoffes de lin, ou
d'une laine fine et douce, et tout est fini. Alors il s'enveloppe dans une
gausape d'écarlate, espèce de grande toge velue en dedans ; ses esclaves
viennent l'enlever, le mettent dans une litière fermée, et le rapportent chez
lui : voilà pour les riches, ou les demi-riches.
Les pauvres se contentent d'une simple friction avec la main, ou bien d'une
autre, plus économique encore, qu'ils s'administrent eux-mêmes, en s'aidant
des murailles contre lesquelles ils se frottent les parties du corps que leurs
mains ne sauraient atteindre facilement ; cela suffit à ces petits plébéiens,
qui ne sont pas, en général, d'une propreté fort recherchée, et dont la
plupart ont pour habitude de se moucher sur le bras.
On se prépare aux frictions par des'jeux et des amusements violents, qui
provoquent une sueur abondante : les uns s'exercent à la lutte, ou balancent
leurs bras chargés de masses de plomb ; les autres jouent à la paume ;
d'autres, les mains liées, montrent leur adresse à ramasser des anneaux, ou
bien, mettant un genou en terre, se renversent en arrière,, jusqu'à ce qu'ils
touchent avec leur tête l'extrémité de leurs pieds.
Les sexes sont séparés dans les Bains publics, mais tout le monde est
entièrement nu. Ici, où le vêtement forme comme une partie de la condition,
cette nudité établit une sorte d'égalité dont personne ne se fait faute ;
aussi rien de plus bruyant qu'un Bain : figure-toi toute espèce de cris, de
clameurs ou de bruits qui peuvent importuner, fatiguer, déchirer les oreilles.
Là, ce sont les gémissements naturels ou imités de ceux qui se livrent aux
exercices violents ; leurs sifflements et leurs soupirs profonds quand ils
laissent échapper leur haleine longtemps retenue ; les exclamations des joueurs
de paume comptant leurs balles ; plus loin, des baigneurs qui s'amusent à
courir autour de la cuve, en se tenant par les mains, et se les chatouillant de
manière à provoquer les éclats de rire les plus perçants ; d'autres qui
lisent à haute voix, ou déclament des vers ; d'autres, chanteurs impitoyables,
ne trouvant leur voix belle que dans le bain, qui se mettent à chanter jusqu'à
faire trembler les voûtes de l'édifice. Des Alipiles, pour se faire mieux
remarquer, venant aussi se joindre à ce discordant concert, crient d'une voix
grêle et glapissante, et ne se taisent pas qu'ils n'aient trouvé des aisselles
à épiler, des patients à faire crier à leur place. Ajoute à ce vacarme, qui
serait insupportable, n'eût-il que l'inconvénient d'être renfermé, le bruit
des frictions plébéiennes, que l'on entend résonner, suivant que la main du
frictionneur frappe du creux ou du plat ; les baigneurs qui se jettent dans
l'eau avec fracas ; les filous, pris à voler les habits les ivrognes, les
marchands de comestibles et de boissons, car beaucoup de personnes boivent et
prennent quelques aliments légers en sortant de l'eau ; les marchands de
gâteaux, les vendeurs de boudin, les confiseurs, qui tous ont leur modulation
particulière pour crier leur marchandise ; figure-toi tout cela, dis-je, et tu
auras une faible idée de l'intérieur d'un Bain public. La seule loi de
décence qu'on y observe, c'est que jamais un père et un fils ne se baignent
l'un devant l'autre ni même un beau-père devant son gendre.
ACHÈVEMENT.
Depuis quelques années, se baigner n'est plus seulement un besoin, mais une
passion. Les luxurieux prennent le bain plusieurs fois par jour. Les Bains
publics, ou plutôt les Thermes, nom que l'on commence à leur donner, sont
devenus d'immenses monuments, où l'on a réuni tous les genres de jouissances,
en y plaçant jusqu'à des bibliothèques. Un luxe effréné gagne aussi les
Bains privés , qui conservent toujours le nom de Balnea ou Balinea.
Avec la propension des Romains à tout porter à l'extrême, je ne sais où cela
s'arrêtera. La lettre suivante de quelqu'un qui vient acquérir une maison
auprès de Literne, en Campanie, petite ville où Scipion, le premier Africain,
finit ses jours dans l'exil, te fera connaître l'état des Bains, tant privés
que publics, longtemps après le principat d'Auguste.
« C'est de la villa même de Scipion l'Africain que je vous écris cette
lettre, après avoir rendu hommage aux mânes de ce grand homme, sur un autel
que je soupçonne être son tombeau. L'âme de ce héros était descendue du
ciel, et elle y est remontée, je n'en doute point ; non parce qu'il a commandé
de grandes armées, avantage dont a joui comme lui ce furieux Cambyse dont la
frénésie eut de si heureux succès, mais à cause de sa rare modération et de
sa piété, bien plus admirable quand il quitta sa patrie que quand il la
défendit. Il fallait que Rome perdît Scipion ou sa liberté. « Je ne veux,
dit-il, déroger à nos lois ni à nos institutions ; la justice doit être
égale pour tous les citoyens. Jouis sans moi, ô ma patrie, d'un bien que tu me
dois : j'ai été l'instrument de ta liberté, j'en deviendrai la preuve. Je
pars, si je suis plus grand que ton intérêt ne le demande. » - Il se retira
à Literne, rendant son exil volontaire aussi honteux pour Rome que glorieux
pour lui-même.
« J'ai vu sa villa, bâtie en pierre de taille, environnée d'un mur -
qu'entoure une forêt, et flanquée de tours lui servant de fortifications. Au
bas de la maison et des jardins se trouve une citerne qui suffirait pour l'usage
d'une armée entière. Le Bain, fort petit, est obscur, selon la coutume de nos
ancêtres : ils ne trouvaient un Bain chaud que quand on n'y voyait pas clair.
Ce fut un grand plaisir pour moi de comparer les moeurs de Scipion avec les
nôtres. Dans ce réduit, ce héros, la terreur de Carthage, à qui Rome doit de
n'avoir été prise qu'une seule fois, baignait son corps fatigué des travaux
de l'agriculture ; car il s'exerçait à ce genre de travail, et, selon la
coutume des vieux Romains, cultivait son champ lui-même. Voilà donc la
chétive demeure qu'il habitait ! le vil pavé que foulaient ses pas
vénérables ! Qui voudrait aujourd'hui se baigner à si peu de frais ? On se
regarde comme pauvre et misérable, si les pierres les plus précieuses,
arrondies sous le ciseau, ne resplendissent de tous côtés sur les murs ; si
les marbres d'Alexandrie ne portent des incrustations de marbre de Numidie ; si
à l'entour ne règne pas une bordure de pierres dont les couleurs variées
imitent à grands frais la peinture ; si les plafonds ne sont lambrissés de
verre ; si la pierre de Thast, magnificence que montraient à peine autrefois
quelques temples, ne garnit les piscines où nous étendons nos corps épuisés
par une excessive transpiration ; si l'eau ne coule de robinets d'argent. Et je
ne parle encore là que de Bains destinés à la plèbe : que sera-ce si je
viens à décrire ceux des affranchis ? Combien de statues, combien de colonnes
qui ne soutiennent rien, mais prodiguées par le luxe pour un vain ornement !
Quelles masses d'eau tombant en cascades avec fracas ! Nous sommes parvenus à
un tel point de délicatesse, que nos pieds ne veulent plus fouler que des
pierres précieuses. Dans le Bain de Scipion, on trouve des rayères plutôt que
des fenêtres, pratiquées dans un mur de pierre pour introduire la lumière
sans nuire à sa solidité. Maintenant, on appelle les Bains des cachots, s'ils
ne sont pas disposés de manière à recevoir le soleil pendant toute la
journée, par d'immenses fenêtres ; si l'on ne s'y hâle en même temps qu'on
se baigne ; si de la cuve on n'aperçoit les campagnes et la mer ; si la cuve
n'est en argent. Aussi les Bains, qui lors de leur dédicace avaient attiré la
foule et excité l'admiration, sont méprisés comme des antiquailles depuis que
le luxe est venu à bout de s'écraser lui-même sous les nouveaux ornements
qu'il a fait inventer.
« Une des plus bizarres recherches des baigneurs voluptueux sont les bains
suspendus. On les prend dans des baignoires en métal, munies de quatre gros
anneaux où s'attachent, des chaînes tombant de la voûte du bain. Dès que le
baigneur est dans l'eau, on l'enlève avec sa baignoire, souvent très grande,
et pendue comme un lustre ; un appareil de machines mués par des esclaves le
balance plus ou moins vite, plus ou moins haut, plus ou moins fort, suivant son
commandement, tant que dure son bains. Cette invention date du milieu du siècle
dernier. Les Romains la trouvèrent si belle, qu'ils citent le nom de
l'inventeur : c'est un certain Sergius Orata, qui s'ingénia de disposer des
bains suspendus dans des villas, qu'il revendait ensuite avec avantage, tant son
invention obtint de succès !
« On ne comptait autrefois qu'un petit nombre de Bains, et ils étaient sans
aucune décoration. A quoi bon décorer des lieux où tout le monde pouvait
entrer pour un quadrant, des lieux destinés non pas à l'agrément, mais au
besoin ? On n'y voyait point, comme aujourd'hui, l'eau couler avec abondance et
se renouveler perpétuellement, comme le jet d'une source chaude ; on ne
regardait pas comme un point essentiel la transparence de l'eau dans laquelle on
déposait sa malpropreté. Mais, bons dieux, quel plaisir d'entrer dans ces
Bains obscurs et dont les murs était grossièrement enduits, quand on savait
qu'un édile comme Caton, comme Fabius Maximus, ou l'un des Cornélius en avait
lui-même réglé la température ! Ces nobles édiles s'acquittaient de ce
devoir; ils visitaient ces lieux fréquentés par le peuple, veillaient à leur
propreté, et à ce qu'on y entretînt une chaleur utile et salubre, différente
de celle que l'on a depuis peu imaginée, qui ressemble à un incendie. Combien
ne trouve-t-on pas Scipion grossier de n'avoir point ouvert son caldarium à
tous les rayons de la lumière, de ne s'être pas cuit au grand jour, de ne
s'être pas proposé de digérer dans le bain. Oh ! l'infortuné! qu'il savait
peu vivre ! L'eau dans laquelle il se baignait, loin d'être reposée, était
souvent trouble, et même presque bourbeuse pendant les grandes pluies. Mais il
ne s'en embarrassait guère : il venait y laver sa sueur et non ses parfums. «
Je n'envie pas le sort de Scipion, dirait-on aujourd'hui; c'est être vraiment
en exil que de se baigner de cette manière. » Mais je vous dirai plus encore :
il ne se baignait pas quotidienne-ment, car, au rapport des écrivains qui nous
ont transmis les anciens usages de la ville, on ne se lavait tous les jours que
les bras et les jambes, auxquels les travaux avaient pu faire contracter quelque
souillure ; l'ablution du corps entier n'avait lieu que tous les neuf jours, à
l'époque des marchés, ainsi que cela se pratique encore pour les esclaves de
nos villas.
«On était donc bien sale ! » me répondra-t-on. - Depuis l'invention des
bains de propreté, on est devenu plus dégoûtant. Que dit le poète Horace
pour peindre un homme décrié et, noté par l'excès de son luxe ? « Qu'il
sent les parfums. » Du temps de Scipion, les Romains sentaient la guerre, le
travail, le héros : lequel préférez-vous? »
LES REPAS.

« Quatre fois de
suite as partout, et mon adversaire trois fois le coup de Vénus ! décidément
je renonce aux Tessères, ce jeu me ruine.» C'est dans le Sphéristère même
de Mamurra, mon hôte, que j'écris ma lettre; en laissant échapper cette
exclamation, pour me consoler un peu de mon infortune de joueur. Vois si ce
n'est pas une vraie fatalité : le jeu des tessères se joue avec trois petits
cubes d'ivoire portant sur leurs six faces une série de points commençant par
un et s'augmentant successivement à chaque face par unité, jusqu'à six, de
manière que deux faces opposées composent toujours le nombre sept : ce sont
trois et quatre ; cinq et deux ; six et uns. On jette les dés dans un cornet,
on les agite, on les verse sur une table creuse ; quelquefois dans une petite
tour posée sur la table, et munie de plusieurs cercles où les dés font des
cascades. On les découvre, et le plus fort nombre de points fait gagner. Triple
six est le coup de Vénus.
Après avoir écrit ces quelques lignes, je fus forcé d'interrompre ma lettre,
tant j'étais distrait et dérangé par tout ce qui se passait. dans le
Sphéristère, et dans les Aleatoria, petits réduits qui sont à la
suite. On jouait partout : au milieu, à la paume trigonale ; ailleurs, aux Duodecimscripta,
aux Latrunculi, à la Mica, à Pair ou impair, et surtout aux Dés
et aux Osselets. Ce n'étaient que conversations à haute voix, exclamations,
cris, ou rires éclatants.
Les Osselets sont encore un jeu de hasard. On y joue comme aux Tessères, mais
avec quatre osselets soit naturels, soit d'ivoire. Ils ne portent aucune marque
; néanmoins chaque face a une valeur de convention : le côté plan vaut 1 ; le
concave, qui lui correspond, 3 ; le convexe, ou celui qui fait le dos, A ; et le
sinueux, ayant un peu la forme de la lettre 4, vaut 6. Les coups ne s'énoncent
pas par ces valeurs numériques, mais par des noms spéciaux qui en tiennent
lieu : c'est d'abord le coup de Vénus, quand les quatre osselets présentent
quatre faces différentes, répondant. aux points 1, 3, 4, 6 ; puis le coup
royal ou d'Hercule, les Vautours, enfin les Chiens, qui se composent d'as
partout. Lorsqu'un des osselets tombe de manière à présenter en l'air un de
ses petits bouts, le coup devient nul.
On fait aussi des Osselets un jeu d'adresse : le joueur en prend cinq, les lance
en l'air, et tâche à les recevoir sur le dos de la main. Presque toujours
plusieurs tombent à côté. Alors il rejette en l'air ceux recueillis sur la
main, ramasse très vivement les autres, et, avec non moins de célérité, tend
cette même main à ceux qui sont en train de retomber. L'adresse est qu'aucun
ne lui échappe.
J'ai peu de chose à te dire des Duodecimscripta ou Douze lignes, sinon
que c'est un jeu tenant du hasard et du calcul. Il se joue sur une petite table
creuse, quadrangulaire oblongue, et peinte, perpendiculairement à ses grandes
faces, de douze lignes de chaque côté. Deux joueurs, antagonistes, versent
alternativement sur la table deux tessères ou dés, après les avoir d'abord
agités dans un cornet ; ensuite, selon les nombres que ces dés amènent, ils
prennent des calculs, ou disques, blancs pour un joueur, noirs pour l'autre, et,
après un instant de réflexion, les rangent sur une ou plusieurs des douze
lignes, tantôt les avançant, tantôt les reculant. Ce jeu a des combinaisons
savantes, et je ne le comprends pas assez pour t'en expliquer plus en détail la
marche et les péripéties.
Le jeu des Latruncules (de latro, ancien nom des soldats
mercenaires offre une espèce d'image de la stratégie. On le joue à deux
personnes, qui sont comme deux généraux manoeuvrant l'un contre l'autre. Des
calculs de cristal ou de verre, les uns noirs, les autres blancs, sont leurs
soldats. Il y en a dans chaque couleur deux sortes, distinguées par une figure
de cire, qui fait des uns de l'infanterie légère, des autres de la grosse.
infanterie. Les premiers sont lancés en éclaireurs, tandis que les seconds ne
marchent qu'en ligne droite. Chaque joueur range sa couleur sur une table
divisée en carreaux alternativement blancs et noirs où il les fait manoeuvrer
suivant une foule de combinaisons que je ne saurais t'expliquer ici. Je te dirai
seulement que certaines consistent à bloquer un ou plusieurs ennemis, et qu'en
général, dans cette petite guerre, comme dans la grande, tout est au savoir,
à la ruse, et au nombre, de sorte qu'un seul disque risqué contre deux, se
trouve en prise', et serait presque toujours enlevé s'il ne faisait pas
retraite à temps ; qu'enfin la victoire consiste à porter le ravage jusque
dans les derniers rangs de son ennemi, ou de réduire à l'impuissance les
pièces que l'on n'a pu lui enlever. Le vainqueur est, comme à la guerre,
proclamé imperator.
Le jeu le plus bruyant après la paume, c'est la Mica ou Mourre. Il ne faut ni
table, ni ustensiles, ni appareil d'aucun genre : deux personnes se placent
debout l'une devant l'autre, le bras droit replié vers l'épaule. Elles
l'abaissent simultanément en étendant un ou plusieurs doigts de la main et
criant un nombre qui ne dépasse jamais dix. Cette énonciation est une
conjecture sur la somme totale des doigts ouverts des deux joueurs : on gagne
quand on a rencontré juste. Le hasard seul décide, attendu que des deux
côtés la parole est aussi prompte que le geste et devance le regard. La Mourre
se joue en cinq, et quelquefois en trois parties liées. Comme on jette très
vite (jeter est le terme consacré), chaque joueur compte ses victoires
partielles en élevant un doigt, deux doigts, etc. de la main gauche qu'il tient
immobile et perpendiculaire à la hauteur de son épaule.
Il n'y a que le jeu de Pair ou impair qui, par le bruit, se rapproche un peu de
la Mica ou Mourre.Le plus paisible des amusements consiste à former un tissu de
noeuds compliqués, que l'on donne à défaire à ceux qui en ignorent la
texture.
L'invitation de passer au Bain fit déserter le Sphéristère et les Aleatoria,
et bientôt on quitta le Bain pour entrer au Triclinium. Mais j'oublie de te
dire que ce sont les préludes du souper dans une grande maison, que je te conte
là. Mon dépit de joueur malheureux, peut-être aussi mon goût pour le jeu,
m'ont conduit à te donner ces détails ; car le but principal de ma lettre
d'aujourd'hui est de parler des repas. On en fait quatre par jour : le
déjeuner, Jentaculum ; le dîner, Prandium ; le souper, Coena
; et la Collation, Comissatio.
Le Jentaculum, par lequel en commence la journée, mérite à peine le
nom de repas : pour les gens frugaux, c'est un peu de pain et de fromage, ou un
coup de vins dans lequel on mêle une plante aromatique nommée Silum, ce
qui fait donner quelquefois au déjeuner le nom de Silatum. Pour les
enfants ce sont de petits gâteaux, que les pâtissiers mettent en vente dès
l'aurore.
Vers le milieu du jour, à la sixième heure, a lieu le Prandium ou
dîner, repas léger, d'un facile apprêt, que l'on prend souvent seul, et pour
se sustenter un peu jusqu'au soir. Rarement on y sert quelque chose de chaud, et
même bien des personnes ne se mettent point à table et se contentent d'un
morceau de pain sec. Autrefois le dîner s'appelait Merenda, de meridies,
midi. La ressemblance entre le dîner et le déjeuner a fait appeler
quelque-fois ce dernier Prandiculum, le petit dîner.Le souper, Coena,
fut toujours le principal repas, on pourrait même dire le seul repas. Cela se
conçoit : il se prend lorsque le soleil est à son déclin, quand les affaires
sont terminées, la journée finie, c'est-à-dire à la neuvième, ou plus
habituellement, la dixième heure. Ceux qui se mettent à table avant le soir,
ou dès la huitième heure, passent pour des gens d'une conduite peu
régulière.
Ce sont ces gens-là qui font la Collation, Comissatio ; en sortant de
souper dans une maison ils vont collationner dans une autre, et prolongent ce
dernier repas jusqu'au milieu de la nuit. Rigoureusement la Collation n'est
point un repas ; c'est plutôt une partie de débauche, une orgie pratiquée par
les jeunes gens et les courtisanes.
Le vrai, l'unique repas, c'est le Souper. On invite à souper, et jamais à
dîner, et ce repas du soir a presque rang parmi les institutions de la cité.
Tu te plains quelquefois de ce que chez nous les affaires sont toujours des
festins ; de ce que l'on passe des jours et des nuits à boire ; de ce que c'est
à table qu'on traite des réconciliations, des mariages, de la paix, de la
guerre, et de l'élection des chefs ; il en est presque de même à Rome, et
l'on n'y voit guère de cérémonie publique ou privée qui ne soit suivie d'un
ou de plusieurs festins. C'est ce qu'on appelle souper Aditial c'est-à-dire
d'admission ou d'installation. Les repas que les citoyens se donnent entre eux
en entraînent d'autres, l'usage étant que chaque convive, chef de maison,
rende le repas qu'il a reçu, et le rende pareil, autant que possible, à celui
qu'on lui a offert. Enfin les Romains, trouvant que les festins entretiennent la
sociabilité, ont, dans toutes les classes, des associations volontaires dites
sodalités, où des amis, des camarades se réunissent les uns chez les autres
pour souper, et passer la soirée dans la gaieté des conversations.
Voici maintenant sur le Souper, ce repas fondamental, les détails que je
t'annonçais tout à l'heure. Je reprends les choses où je les avais laissées.
En sortant du bain, ou l'on reste une heure environ, chaque convive revêt une
synthèse , habit de festin, tunique blanche sans ceinture, fournie par le
maître de la maison, puis on passe dans le Triclinium.
Je t'ai dit que les Romains mangent à demi couchés sur des lits ; j'ajouterai
que les trois lits d'un Triclinium ne sont pas indistinctement occupés par les
convives, et que même sur ces lits il y a des places désignées pour chaque
personne, suivant son rang, sa richesse, ses relations d'estime ou d'amitié
avec le maître de la maison. Parmi les lits, qui sont rangés, comme tu t'en
souviens, sur les trois côtés d'un carré dont le quatrième reste vide pour
le service, celui du milieu est le plus honorable on l'appelle le lit du haut.
Le maître de la maison s'y met, et prend la première place du côté de
l'intérieur du carré. Près de lui se range sa femme, ou ses enfants s'ils ne
sont pas trop jeunes : dans ce dernier cas, les enfants mangent assis sur des
chaises à côté du lit. La troisième et dernière place, vers le dehors du
carré, s'offre toujours au plus honorable personnage de la société. On la
nomme place consulaire, parce que, quand un Consul est parmi les convives,
jamais il ne se met autre part, afin que l'on puisse l'aborder avec plus de
facilité s'il survient quelque affaire dont il ait besoin d'être informé
sur-le-champ. Les convives de ce lit ont la figure tournée du côté du lit de
gauche, qui est le second plus honorable. Celui de droite, auquel les convives
du centre tournent à peu près le dos, est assigné aux convives les moins
considérés, et pour ce motif on l'appelle le lit inférieur. S'il y a
plusieurs femmes au festin, elles se mettent toutes ensemble.
On est ordinairement trois sur un lit, quelquefois quatre, quelquefois cinq et
six, quand les invités sont nombreux ; mais cela n'est pas de bon goût.
Il arrive néanmoins de temps en temps qu'un maître de maison se trouve forcé
de manquer malgré lui de ce bon goût ; car bien que les invitations se fassent
habituellement par écrit, et que souvent l'on y marque combien l'on pourra
amener de personnes avec soi, il est assez rare de savoir au juste le nombre de
convives qu'on aura, grâce à la coutume qui permet à chacun de se présenter
avec quelque ami. On donne à ces amis inattendus, ou invités indirectement, un
nom assez plaisant : on les appelle Ombres, comme s'ils étaient l'ombre du
corps de ceux qui les présentent. Il est cependant de la politesse d'amener peu
d'Ombres, de ne le faire qu'autant que ce sont des amis avec lesquels on
n'aurait point d'occasion favorable de se trouver, soit qu'ils arrivent d'un
lointain voyage, soit qu'ils partent ; ou bien encore quand on désire leur
faire faire connaissance avec le Père du festin, c'est-à-dire avec la personne
qui reçoit.
Une autre espèce de convives que l'on ne refuse guère, mais avec lesquels on
ne se gêne pas beaucoup, parce qu'ils font métier de courir les festins et de
vivre aux dépens d'autrui, ce sont les Parasites. Quand il n'y a plus de place
sur les lits, ils se mettent sur des bancs, et là on leur fait payer par toutes
sortes d'ignominies les repas qu'on prétend leur donner, et qu'ils ont
sollicités. Je reviendrai plus tard sur ce sujet.
D'après la disposition et l'ameublement des Triclinia, tu peux voir que les
Romains n'aiment pas les nombreuses réunions ; il n'y a réellement de place
dans leurs salles de festins que pour neuf personnes, et habituellement ils n'en
ont pas davantage. Le nombre des convives ne doit pas être moins grand que
celui des Grâces, a dit un de leurs écrivains, ni excéder celui des Muses,
prescription qui a été traduite dans le proverbe suivant : "Sept
convives, repas ; neuf convives, fracas." J'ai remarqué que les Romains
aiment le nombre impair : ils le regardent comme parfait, et plus heureux que le
nombre pairs.
Dans les grandes maisons, dès que l'on a pris place sur les lits, après avoir
d'abord quitté sa chaussure, de jeunes esclaves s'empressent autour de vous ;
les uns vous versent de l'eau fraîche sur les mains et vous présentent des
étoffes de laine rase pour vous essuyer ; d'autres vous lavent les pieds, vous
nettoient les ongles des orteils avec une surprenante dextérité. Cela est
nécessaire, puisque l'on va toujours les jambes et les pieds presque nus. Cette
opération terminée, et la table servie, le Père du festin adresse une prière
aux dieux avant de toucher aux mets, et fait, au son de la flûte, quelques
libations de vin. On distribue ensuite des couronnes de fleurs ou de feuillage,
que les convives gardent sur leur tête pendant toute la durée du repas. Elles
sont tressées d'ache et de lierre, ou d'ache et de lis, ou de myrte et d'ache
entremêlé s; et le plus souvent de roses, de violettes, de safran, ou de nard
; ou encore, bizarre recherche! composées de feuilles de roses cousues ensemble
sur des écorces de tilleul ornées de petits bas-reliefs. Dans les festins où
l'on doit faire plus d'excès (tu as déjà compris que je te parle ici des
repas priés), outre les couronnes de tête, on en a d'autres encore bien plus
grandes, passées autour du cou, et tombant un peu sur la poitrine. Les
couronnes sont des préservatifs contre l'ivresse. L'odeur des fleurs, ouvrant
les pores, donne au vin moyen d'évaporer ses fumées, et repousse les vapeurs
qui montent au cerveau. C'est pour le même motif qu'on se fait parfumer les
cheveux avec des essences de nard, de safran, de balanus, et d'autres substances
odorantes que le maître fournit chez les riches, mais que les convives
apportent eux-mêmes, chez les personnes d'une fortune médiocre.
L'hiver, quand toute végétation est éteinte, on a des couronnes d'amarante
d'Égypte, fleur qui se garde cueillie, et, lorsqu'elle est desséchée, reprend
sa première fraîcheur dès qu'on la met dans l'eau. On fait également usage
de fleurs artificielles, composées soit avec des raclures de cornes, soit avec
de l'étoffe de soie de diverses couleurs. Pour achever de rendre l'imitation
parfaite, ces couronnes sont imprégnées du parfum des fleurs qu'elles
représentent.
Un souper en règle, ce que l'on désigne sous le nom de Coena recta, se
compose de trois services, et quelquefois de six, c'est-à-dire de trois ou de
six petits soupers à la suite les uns des autres. On commence par manger des
oeufs durs, un ou deux, ou des laitues crues, des olives, des figues, quelques
fruits et des mets légers, pour se mettre en appétit ; aussi ce premier
service est-il nommé Gustatio, du mot Gustus, goût.
Au deuxième service brille tout l'art des cuisiniers : on sert des ragoûts en
grand nombre, toujours accompagnés d'un morceau de veau rôti.
Au troisième service, qui n'est réellement que la continuation du deuxième,
puisqu'on le désigne sous le nom de second service, ce sont des confitures, du
miel, ou de la graine de pavot blanc rôtie assaisonnée dans du miel, des
pâtisseries, des fruits servis dans de larges corbeilles de jonc, et
quelquefois de baguettes d'or tressées comme du joncs. Ces mets sont désignés
sous le nom général de Bellaria, et avec eux arrivent aussi des
parfums.
Je passe sur les détails : j'ai commencé à recueillir sur le luxe des repas
quelques notes que je t'enverrai dès qu'elles seront complètes ; pour
aujourd'hui, je t'entretiendrai seulement de la manière dont se fait le
service.
Les personnes qui se piquent de quelque élégance ont soin de n'avoir que des
esclaves jeunes, beaux , tous du même âge, et bien appareillés, surtout pour
servir à boire. Ils sont vêtus d'une petite tunique, descendant un peu
au-dessus du genou, ont les cheveux bien arrangés, et portent à leur ceinture
un linge dont ils se servent pour la propreté du service. Attentifs à
prévenir les désirs des convives, on n'a pas besoin de leur parler ; un signe
suffit : en faisant seulement claquer le pouce avec l'index, ils accourent
aussitôt. Tous les esclaves employés à l'apprêt et au service des festins
ont chacun leur grade et leurs fonctions : le Promuscondus est le
cellérier, le pourvoyeur de l'office, et l'inspecteur du cellier au vin; l'Archimagirus
est le chef de la cuisine, il ordonne le repas; le Structor le sert, met
sur table, et range les mets dans un ordre étudié et symétrique, car il ne
suffit pas de contenter le goût, il faut encore plaire aux yeux ; le Scissor
découpe, et son habileté est si grande, qu'il a aussi vite dépecé une
volaille qu'un autre l'a regardée ; enfin un Praegustator goûte chaque
mets avant qu'il soit servi aux convives.
Après ceux-ci viennent une foule d'autres serviteurs dont les noms
m'échappent. Ils sont sous l'inspection du Tricliniarque, esclave chargé de
veiller au service du Triclinium. Les uns vont offrir du pain dans des plats
d'argent, ou dans des corbeilles ; les autres versent à boire entre chaque
service ; d'autres, plus jeunes, veillent à la propreté du Triclinium,
essuient sur le pavé les traces de la malpropreté ou de l'ivresse des convives
; leur présentent, sur le lit même, le vase indispensable à tous ceux qui ont
bu avec un peu d'excès ; ramassent à terre, à chaque changement de service,
tout ce qui pourrait choquer la vue ou l'odorat ; nettoient la table avec un
torchon de pourpre, ou une éponge légèrement mouillée lorsqu'elle n'est pas
couverte d'une pièce de linge nommée Mantile, usage qui commence à
s'introduire ; entretiennent les lampes d'une huile mélangée de parfums.
D'autres font des aspersions avec une infusion de verveine et d'adiante, pour
exciter la gaieté des convives, et, au moment du dernier service, répandent
sur le sol de la sciure de bois.
Outre tout ce monde, on a encore son propre esclave, qu'il est assez d'usage
d'amener, et qui se tient debout au pied du lit oit vous êtes.
En été, par un raffinement de luxe et de mollesse, on joint à ce troupeau de
serviteurs un certain nombre de petits enfants et de jeunes et jolies filles :
les premiers, armés d'une baguette de myrte, sont chargés de chasser les
mouches qui importunent les convives, et il y a beaucoup de mouches ici en été
; les secondes les rafraîchissent en agitant devant eux un éventail de verdure
ou de légères feuilles de bois.
Les Romains, qui ont fabriqué une foule d'ustensiles pour tous les usages de la
vie, en ont inventé fort peu pour les festins ; ainsi l'on a des couteaux pour
couper les viandes, des cuillers pour manger des oeufs ou quelques aliments sans
consistance, des tuyaux de plume ou des brins de lentisque pour se curer les
dents, et voilà tout : quand les aliments solides sont dépecés, on saisit les
morceaux avec les doigts ; aussi ne va-t-on jamais souper dehors sans porter
avec soi une pièce de linge nommée Lintea ou Mappa, pour
s'essuyer en mangeant, ce qui est bien nécessaire, la position sur un lit ne
laissant pas aux mouvements assez de liberté pour que l'on ne se barbouille et
ne se tache pas continuellement. C'est afin de parer à cet inconvénient que
l'on quitte la toge, en se passant le Sudarium autour du cou, et qu'on
revêt une synthèse. La mappa serait même très insuffisante si les
esclaves ne venaient, après chaque service, donner à laver aux convives : de
la main gauche ils vous présentent un bassin, vous avancez les doigts
au-dessus, et ils vous les purifient en y versant de l'eau d'un Gutturnium,
vase à col étroit qu'ils tiennent de l'autre main.
Après cette lotion, de jeunes servants distribuent des coupes à la ronde, car
un lit ne permet pas d'en avoir près de soi. Souvent ce sont des coupes sans
pied dites Rhytium, ayant la forme d'une corne de boeuf longue de dix à douze
doigts ; elles sont en terre cuite avec ou sans anse, et leur petit bout se
termine par une jolie tête de chien de chasse, de jeune cerf ou de gros oiseau.
Des échansons suivent, chargés de plusieurs sortes de vins dans des cratères
vases à large ouverture; un esclave y puise avec un cyathe petite mesure à
long manche perpendiculaire, tenant environ la dixième partie d'une coupe, et
chacun dit combien il veut de cyathes soit de vin, soit d'eau On rend sa coupe
après avoir bu. Pendant ce temps, à un signal du maître, le service se
renouvelle vivement ; on l'apporte d'une seule fois sur un Ferculum ou Repositorium,
grand plateau d'argent ou revêtu d'argent, qui couvre toute la table et en
forme comme le dessus, de sorte que l'on dit la première Table, la seconde
Table, etc., ou le premier ferculum, pour le premier, le second service.
Les plats sont tout arrangés sur le Ferculum, et quelquefois posés sur
de petits réchauds, afin que les mets ne se refroidissent point.
Chez beaucoup de citoyens riches, on ne se contente pas de flatter le palais par
les saveurs les plus exquises ; on cherche encore à réjouir les oreilles par
des concerts de musique, à occuper les yeux par des spectacles pleins de charme
ou d'intérêt. A la fin du festin, quand chacun a cessé de boire et de manger,
on introduit soit un choeur de jeunes garçons qui chantent des poésies
érotiques grecques ou latines, ou quelques nouvelles élégies des poètes
modernes ; soit de jeunes filles qui exécutent seules ou à plusieurs les
danses les plus gracieuses. Elles sont vêtues de tuniques longues, un peu
amples et d'un tissu léger. Les Gaditanes sont surtout renommées pour les
danses voluptueuses où elles s'accompagnent avec des crotales.
Quelquefois ce sont des bouffons, ou bien des Pétauristaires,
saltimbanques-percheurs qui dansent au sommet d'une échelle qu'ils tiennent
eux-mêmes dans une position verticale, et assaisonnent leurs exercices de
plaisanteries grossières et souvent indécentes.
D'autres fois, des scènes sérieuses remplacent ces jeux futiles des acteurs
appelés Homéristes, et armés en guerriers, jouent des épisodes tirés de
l'Iliade ou d'autres acteurs, dits pantomimes, représentent des drames dont
toute l'action s'exprime par des gestes.
Ces spectacles sont le perfectionnement, ou plutôt la corruption d'un usage
fort louable des anciens Romains, chez lesquels de jeunes enfants, avec toute la
modestie de leur âge, et même tous les convives, chantaient, simplement au son
d'une flûte, les exploits et les vertus des grands hommes.
L'humeur querelleuse de nos compatriotes fait que souvent nos festins sont
ensanglantés, et que les convives se lèvent pour aller terminer, le glaive à
la main, une discussion entamée la plupart du temps sur des sujets frivoles.
Cette lutte sanglante, qui dans notre patrie n'est jamais qu'un accident, les
Romains en ont une image dans leurs repas : ils introduisent dans la salle du
festin des esclaves qui combattent avec des armes émoussées, et, dans une
lutte prolongée, récréent les convives par le simulacre d'un combat à
outrance. Ce spectacle est aussi très ancien : il a été inventé par les
Campaniens, qui commettaient ensemble des combattants, appelés Samnites en
commémoration d'une victoire remportée par eux sur le peuple de ce nom. Mais
en Campanie c'était un combat réel avec des armes véritables, et les coupes
et la table étaient arrosées de sang.
Les hommes graves et studieux mettent le temps du souper mieux à profit : ils
font faire une lecture à haute voix, dans quelque auteur grec ou latin et cela
dès que la table est servie. Quelquefois après souper, des déclamateurs dits
Arétalogues viennent discourir sur des sujets de vertu, ou bien il y a concert
de musique et comédie.
Dans les repas donnés à l'occasion des fêtes, on s'amuse assez habituellement
à élire un Roi du festin. Le sort le désigne ; on apporte une petite table et
quatre osselets', et le convive qui amène le coup de Vénus est déclaré roi.
Les autres sont tenus, sous peine d'amende, d'exécuter les ordres de ce
souverain qui, bien que revêtu d'un pouvoir despotique, néanmoins l'exerce
toujours d'une manière assez raisonnable : il se contente, pour l'ordinaire, de
fixer à chacun le nombre des coupes qu'il doit vider, et leur grandeur ; de
régler la conversation, de veiller sur les jeux, et de défendre ceux qui
pourraient causer du désordre. Il s'occupe aussi du plaisir de ses sujets,
commande à ceux qui ont de la voix de chanter, aux rhéteurs de déclamer, aux
philosophes de résoudre quelque difficulté, et aux poètes de réciter leurs
vers, ou d'en improviser : on ne saurait être meilleur roi.
Mais comme il n'existe point de despote qui n'ait de temps en temps ses petits
accès de tyrannie, ne fût-ce que pour éprouver son pouvoir, le Roi du festin
commande quelquefois à ses sujets des choses contraires à leur caractère
connu ; il se fait un malin plaisir de les embarrasser par des ordres contre
lesquels personne n'a jamais osé se révolter depuis l'établissement de cette
royauté, qui est fort ancienne. Un roi débonnaire laisse boire chacun à son
gré, sans obliger personne à égoutter sa coupe sur le pavé après avoir bu,
pour faire voir que l'ordonnance bachique a été remplie. Quand on est libre,
vers le milieu du festins on commence à se porter des santés, on échange sa
coupe avec la personne à laquelle on s'adresse, on boit autant de coups qu'il y
a de lettres dans son nom, et l'on se souhaite mutuellement autant d'années que
l'on absorbe de cyathes.
Il arrive aussi que ces repas sont égayés par une loterie : le roi fait
circuler à la ronde une coupe remplie de petites tablettes, chaque convive tire
son lot, et un jeune esclave proclame à haute voix la décision du sort. Le
piquant de ce jeu, c'est que certaines tablettes contiennent des objets d'une
valeur réelle, tels qu'un habillement, de l'or, de l'argent, des monnaies
étrangères ; tandis que d'autres donnent une tunique de poil de chèvre, une
éponge, une pelle à four, des pinces, ou des lots encore plus bizarres. Mais
la loterie la plus amusante est celle où, la plupart des lots ne sont point
conformes à l'énonciation de la tablette, de sorte qu'ils deviennent une
déception pour celui qui les reçoit. Cette innocente tromperie, bien que
prévue, excite toujours la gaieté pansa bizarrerie, sa soudaineté, et souvent
sa signification satirique. Dernièrement je pris une tablette dont la devise
philosophique semblait me promettre un beau cadeau ; le petit crieur avait lu :
« argent scélérat ! » Aussitôt on m'apporta un jambon sur lequel était une
burette à vinaigre. Parmi les autres lots tirés il y eut « absinthe et
affront, » qui valurent au convive des fraises sauvages, une perche et une
pomme ; des «poireaux et une persique », excellent fruit, se trouvèrent être
un fouet et un couteau ; « des passereaux et un chasse-mouches, » furent des
raisins secs et du miel ; une « toge de festin et une toge de Forum, » un
morceau de pâte crue et des tablettes ; « un tuyau et un pied » (mesure)
firent paraître un lièvre et une sandale ; une « murène (poisson rare) et
une lettre » devinrent une botte de poirée et un rat lié avec une grenouille
; enfin un « oreiller » fut une corde à étrangler.
Les Romains ont un singulier moyen d'engager, au milieu des festins, leurs
convives à jouir des plaisirs de la vie, moyen qui, tout philosophique qu'il
soit, ne me plaît guère : c'est de faire placer sur la table même un
squelette humain. J'en ai vu un construit en argent et disposé de manière à
ce qu'au moyen d'une petite chaîne de même métal, on mettait en mouvement
toutes ses articulations. Le maître de la maison l'animait ainsi dé temps en'
temps, puis s'écriait ensuite : « Combien l'homme est peu de chose ! la vie ne
tient qu'à un fil ! voilà ce que nous serons quand l'enfer nous aura engloutis
; parfumons nos, cheveux, couronnons-nous de roses, la mort approche,
hâtons-nous de vivre. »
La plupart des soupers se terminent parle partage aux convives des restes du
dernier service. Chacun choisit ce qu'il veut pour envoyer à ses parents ou à
ses amis. Les Mappae servent à envelopper ce butin friand.
Les dieux de la maison ne sont point oubliés dans le partage : deux petits
esclaves, en tuniques blanches, les apportent et les posent sur la table, autour
de laquelle un troisième promène une coupe de vin, en disant à haute voix :
« Que ces dieux nous soient propices ! » Ensuite on leur offre des mets, on
leur fait des libations, on mêle à leur nom le nom de l'Empereur et l'on prie
le ciel de combler le prince de félicités, sans oublier de faire des voeux
pour soi-même. Alors, si l'on ne veut pas se baigner une seconde fois, usage
qui commence à s'introduire, on dépouille la synthèse, on demande ses
chaussures à l'esclave qu'on a amené avec soi, et qui a dû en prendre soin on
lui crie d'allumer la torche et l'on se quitte en se souhaitant réciproquement
la santé du corps et de l'esprit.
Voilà, cher Induciomare, quels sont les repas chez les Romains. Si j'avais
uniquement voulu t'éblouir, t'étonner par des choses extraordinaires, je
t'aurais parlé d'un souper qui a eu lieu dernièrement, et dans lequel on a
déployé toutes les ressources de l'art du mécanicien joint à celui des
cuisiniers, pour offrir un spectacle aussi dispendieux que magnifique. On
imagina de disposer la voûte du Triclinium de manière qu'elle s'ouvrit en deux
parties. Au moment du dernier service, on l'entendit craquer tout d'un coup ;
les convives, qui n'étaient point prévenus, voulurent prendre la fuite,
croyant que la maison s'écroulait, quand aussitôt ils virent descendre au
milieu d'eux un cercle immense, autour duquel pendaient des couronnes d'or et de
petites boites d'albâtre pleines de parfums, présents que le Père du festin
leur offrait. En même temps la table se garnissait d'un service complet,
composé de quantité de fruits et de pâtisseries qui, dès qu'on les touchait,
répandaient une odeur parfumée de safran.
Mais ce caprice d'un dissipateur ne pouvait figurer dans un récit où j'ai
voulu peindre la coutume générale ; si je t'en parle ici, c'est afin que si
jamais ce récit arrivait jusqu'à toi par une autre voie que la mienne, tu ne
t'imaginasses pas que je t'ai fait un tableau incomplet des habitudes des gens
riches de Rome.
LES TAVERNES.

L'immensité de
Rome est toujours pour moi une chose merveilleuse, et quand du haut du Janicule,
où j'aime à m'aller promener, je contemple cette agrégation prodigieuse de
maisons, j'ai peine à me persuader que ce soit une seule ville. Les Romains
eux-mêmes paraissent être dans cette idée, car ils ont divisé Rome en
quatorze villes contiguës qu'ils appellent Régions, et subdivisé ces régions
en près de deux cents Quartiers. Chaque région a un numéro d'ordre et un non
emprunté soit à quelque monument, soit à la localité principale de sa
circonscription, soit encore à sa situation topographique. Quatre régions sont
à l'orient, une au septentrion, cinq à l'occident, deux au midi, et deux au
centre des autres.
Les régions orientales sont la Ire, dite Porte Capène ; la IIe,
Mont Coelius ; la IIIe, Isis et Sérapis ; et la Ve,
Esquiline.
Celle du septentrion est la VIe, appelée Alta semita, le Haut
chemin, très-haut en effet, car cette région est située sur la Colline des
Jardins, qui domine le Champ de Mars de plus de deux cents pieds.
Les cinq de l'occident portent les numéros VII, VIII, IX, XI et XIV, et sont
désignées sous les noms de Voie Lata, Forum romain, Cirque Flaminius, Cirque
Maxime, et Transtibérine.
Les deux régions dites Piscine publique, XIIe, et Aventine, XIIIe,
sont celles du midi.
Enfin les deux du centre sont la Palatine, la Xe, et la Voie Sacrée,
la plus centrale de toutes, la IVe.
Les quartiers n'ont point de numéro d'ordre, mais seulement un nom, pris d'un
magistrat ou d'un monument et souvent encore tiré du genre d'individus qui les
habitent. Il serait superflu de te dire les deux cents noms de ces subdivisions
de Rome, mais je m'arrêterai à quelques-uns qui sont une vraie topographie
morale de la ville, et prouvent que dans ce monde de maisons il s'est établi
une espèce d'ordre qui ressemble un peu aux classifications politiques du
peuple. Au centre, les quartiers qui avoisinent le Forum romain sont
particulièrement habités par les riches, les nobles, et les marchands qui
vivent aux dépens de ces deux classes. La plèbe occupe les extrémités, ce
sont les manoeuvres et les ouvriers : ainsi au bout du Coelius, dans la IIe
région, on trouve les quartiers des constructeurs, des loueurs d'ânes, des
ouvriers en laine ; dans la Ve région, sur l'Esquilin, il y a ceux
des brûleurs de cadavres, et des frotteurs de parfums genre de professions qui
vont ensemble dans la VIIe, au pied du Quirinal, vers la Colline des
Jardins, habitent les éleveurs de chèvres, les herbagers, les affranchis, les
pêcheurs, les ciseleurs, les constructeurs de litières, les tabletiers ; les
marchands ambulants peuplent la région Transtibérine la XIVe. Là
aussi sont les porteurs de litières au service des citoyens qui n'ont ni une
litière ni des porteurs à eux. Le quartier qu'ils occupent est appelé camp
des lecticaires, du peu d'importance de ses habitations, qui ne valent guère
mieux que des tentes.
Une fois que ces différentes nuances du grand tableau que j'ai sous les yeux me
furent connues, je me livrai à l'examen de quelques parties, et les tavernes,
étroits locaux dans lesquels les petits marchands font leur négoce ou exercent
leur industrie, attirèrent d'abord mon attention. Dans une société, ainsi que
dans une immense forêt, on aperçoit aisément les sommités, mais il est
difficile de voir ce qui est au bas. Or, les tavernes sont dans ce cas-là :
c'est dans les tavernes que vivent les petites gens, la plèbe, toute cette
foule de travailleurs qui sont les agents, les fabricateurs, et comme la
matière première du luxe, de la grandeur éblouissante, de la magnificence qui
fait de Rome la merveille du monde. Les tavernes donnent à la ville une
physionomie toute particulière, un aspect très pittoresque, très gai, très
animé. Elles se composent pour l'ordinaire d'une chambre de neuf à dix pieds
carrés environ, et d'un petit étage au-dessus où loge le marchand. La
devanture est occupée par une large baie ouverte pendant le jour, et fermée la
nuit au moyen de planches glissant dans deux rainures, l'une au linteau du
plafond, l'autre sur le seuils, et assujetties ensuite avec une chaîne, et une
barre tournante dont l'axe tient aux volets de la fermeture.
Il y a des tavernes dans de simples baraques de bois couvertes en planches et
adossées à une maison ; mais en général les tavernes font partie d'une île,
dont elles bordent la lisière au rez-de-chaussée. C'est si bien là leur place
habituelle que le nom leur en est resté, et que souvent on dit une île pour
une taverne. Quoique dans ces étroits locaux on mesure pour ainsi dire l'air et
le jour à ceux qui les habitent, quoique plusieurs n'aient point de logement
pour le marchand et sa famille, qui sont obligés d'aller coucher au faîte de
la maison, dans des cœnacula cependant ces cases se louent fort cher,
surtout dans les quartiers du centre ; le produit en est si avantageux, que de
riches propriétaires en font entourer leurs somptueuses et vastes demeures,
pour se créer par là un revenu quelquefois très considérable.
On trouve des tavernes dans toutes les rues, mais principalement sur les places
publiques et sous les portiques de certains monuments, tel que le Cirque Maxime,
par exemple, dont je parlerai plus tard avec détail. Le même instinct, ou la
même nécessité qui a conduit telles classes de citoyens ou d'habitants de
Rome à se loger dans tel quartier plutôt que dans tel autre, a de même
réglé, en quelque sorte, la distribution des tavernes dans les divers
quartiers de la ville, suivant leur nature et leur genre ; car il y a des
tavernes de toutes sortes, depuis celles où l'on trouve les objets du luxe le
plus recherché, jusqu'à celles où l'on vend à la plèbe les aliments communs
dont elle se nourrit.
Les endroits où il existe le plus de tavernes de haut étage, sont d'abord la
voie Sacrée, qui passe au milieu des plus opulentes régions; ensuite le
quartier situé au midi du Forum romain, et le Champ-de-Mars. La voie Sacrée,
depuis l'angle oriental du mont Palatin jusqu'à l'Arc de Fabius, est peuplée
de tous les fournisseurs des milles bagatelles brillantes qu'on offre en
présent aux femmes, telles que des éventails en plumes de paon, des boules de
cristal, des osselets d'ivoire, des tablettes à écrire, des coffrets de bois
précieux, des dés, des tables à jouer, et cent autres colifichets semblables.
Il y a encore dans cette rue des marchands de drogues médicinales', et des
ciseleurs.
A partir de l'Arc de Fabius, dans toute la traversée du Forum on ne trouve plus
sur la voie Sacrée que quelques tavernes de banquiers. En effet, le Forum est
le centre des affaires sérieuses ; on n'y vient que pour s'occuper de procès,
d'intrigues politiques, de nouvelles, de ventes, de prêts, d'usures d'argent,
de remboursements, etc. ; on n'a pas le temps d'y penser, aux futilités ;
voilà pourquoi les marchands se sont réfugiés en deçà de l'Arc de Fabius,
quartier moins bouillant, moins agité, où les passants peuvent s'arrêter,
voir, et se laisser tenter.
Si le Forum est comme un lieu mort pour les vendeurs d'objets de luxe, parce
qu'il n'y a ni tavernes ni maisons sur cette place, comme je l'ai déjà dit,
en-revanche, les taverniers, toujours avisés, se sont postés à ses abords, du
côté du midi, derrière la basilique Julia : on voit là un quartier dit Vicus
Tuscus presque rempli de marchands de soieries. La soie est une espèce de laine
très fine, que les Sères, peuple d'Asie, récoltent sur les feuilles des
arbre, de leurs forêts. On y trouve aussi des parfumeurs et des pigmentaires.
Ces derniers sont des débitants de drogues, telles que la ciguë, la
salamandre, l'aconit, les chenilles de pin, la buprestis, la mandragore, les
cantharides, etc.
Vis-à-vis, ou plutôt en parallèle, au pied du mont Capitolin, derrière le
temple et le Trésor de Saturne, le quartier d'Argilète est peuplé de
marchands de chaussures élégantes, dont les jeunes gens et les femmes se font
une parure. Les taverniers sont encore très bien placés dans ces deux endroits
: non seulement ils se trouvent aux deux débouchés du Forum de ce côté, mais
encore en partie sur le chemin du Champ de Mars, quartier très fréquenté,
lieu de récréation et d'affaires pour la ville, rendez-vous quotidien des
riches bien plus encore que des pauvres. En se reliant ainsi au Champ de Mars,
leurs tavernes font comme une longue traînée de luxe, car dans cette « ville
aux monuments » plusieurs des beaux portiques qui la décorent servent encore,
de refuge à tous ces pourvoyeurs de l'opulence, et c'est, par exemple, au
portique des Argonautes ou de Neptune, près des Septa Julia, qu'on trouve les
marchands de riches habits. Les environs des Théâtres, des Cirques, des Bains,
et généralement de tous les lieux où le-peuple se réunit en masse, sont
envahis par les marchands de vins, les débitants d'aliments cuits, les salsamentaires,
vendeurs de porc salé, et les botulaires, vendeurs de boudins. Dans le
Vélabre majeur, près du Forum Piscarium, on trouve les pâtissiers, les
bouchers, et les marchands d'huile. Après le choix de l'emplacement, il y a
encore deux choses très importantes observées par les marchands pour faire
distinguer leurs tavernes entre elles, c'est l'enseigne, et l'étalage dit
l'oculifère ou porte-à-l'oeil. L'enseigne se compose ordinairement de quelque
figure hideuse, ou d'un petit bas-relief en terre cuite, dont le sujet est
relatif à la profession du tavernier. Un marchand de vin suspend à sa porte
une couronne de lierre, attribut de Bacchus. L'oculifère, supplément ou
complément de l'enseigne, consiste dans une exhibition ingénieusement
arrangée des marchandises en vente. Afin de mieux frapper la vue des passants,
de séduire les curieux, de tenter les acheteurs, on leur barre pour ainsi dire
le passage en formant cet étalage sur la façade de la taverne, en dehors de la
porte, et empiétant sur la voie publique.
Les étals de luxe sont naturellement ceux auxquels cela réussit le mieux ;
cependant, les autres, même ceux qui paraissent se prêter le moins à ce genre
de séduction, ont aussi leur montre : le marchand de vin étale des bouteilles,
enchaînées, pour les garantir contre les voleurs ; le boucher expose sa viande
en dehors, et quand c'est de la chèvre, la pare avec quelques petits rameaux de
myrte, indice que l'animal dont elle provient a été élevé dans un pâturage
planté de cet arbuste et que la chair en sera plus tendre ; le marchand
d'aliments cuits place des tétines de truie, des foies, des oeufs, et en
général un échantillon des menus mets qu'il débite, dans des vases de verre
pleins d'eau, où, par un effet d'optique assez simple, ils paraissent plus gros
qu'ils ne sont en effet ; dans la taverne du salsamentaire, des centaines de
jambons ou de pièces de lard pendent du plafond ; dans d'autres on voit,
accrochés aux murs, des bottes de légumes, ou des fromages ronds traversés
dans leur centre par un brin de genêt. Cette coutume si rationnelle et si bien
entendue des petits commerçants, fait que Rome ressemble à une taverne
immense.

Chaque espèce de
taverne a son nom propre : on nomme Popinae celles où l'on vend des,
aliments cuits Ce nom vient de la manière dont elles s'approvisionnent
ordinairement : les popes, sacrificateurs victimaires, vendent aux taverniers
leur part des victimes, de là le nom de Popinae donné aux petits
établissements où se débitent ces viandes. Les taverniers s'approvisionnent
encore, mais sans trop s'en vanter, avec les chairs des sangliers, des cerfs, et
des ours, que l'on fait combattre contre des hommes dans certaines fêtes
publiques. On ne peut songer sans frémir qu'un homme qui mange de l'ours exhale
ensuite l'odeur de cette viande nourrie du sang et repue de la chair d'un autre
homme !
C'est dans les Popinae que se prépare la nourriture du peuple, des
esclaves et des artisans. On y trouve tous les comestibles dont ils composent
ordinairement leurs repas : des lupins, pois cuits à l'eau, et qui, mangés
froids, nourrissent et désaltèrent tout ensemble: des cicers, autre sorte de
pois qu'on vend bouillis ou frits ; des fèves avec leurs cosses, ou des choux
crus, et quelques autres légumes assaisonnés dans du vinaigre ; des noix
frites ; de la polenta, gruau d'orge, des bettes, dont la fadeur naturelle
disparaît dans une sauce composée de vin et de poivre ; des têtes de moutons
bouillis, surtout de la viande de porc, cette bonne chair que nous aimons tant,
fraîche ou salée, et des saucisses, dont ils sont grands amateurs, le tout
avec force ail, force ciboule, et autres ingrédients extrêmement relevés, et
accompagné d'un pain grossier de froment ou d'orge nommé pain plébéien. Les
petites gens trouvent à se rassasier dans ces tavernes pour deux as environ.
Les aliments y sont toujours prêts, et en cuisson perpétuelle et publique. Une
espèce de table en maçonnerie, dans laquelle sont scellées quatre urnes,
grands vases de terre cuite, qui servent à conserver les comestibles, occupe
presque toute la devanture de la taverne. En retour d'équerre est un fourneau
où une femme fait la cuisine ; et derrière le fourneau, sont trois gradins
couverts de diverses petites mesures de capacité.
Ces humbles établissements, où il fait une chaleur étouffante, et dans
lesquels règne une malpropreté extrême, sont les asiles de la joie, le
rendez-vous des esclaves, qui, pendant que leurs maîtres soupent en ville, ou
se récréent à quelque fête publique où ils les ont conduits, viennent les
attendre dans ces endroits. Assis sur des bancs, ils y passent le temps à boire
du vin, surtout du vin cuit de l'île de Crète ; à manger des gâteaux de
farine et de fromage ; des Bardeaux ayant la forme d'une tuile de bois, gâteaux
un peu grossiers, faites de farine d'ers avec du vin ; à jouer aux dés, à
raconter ce qui se passe dans la maison, et à médire de leurs maîtres, pour
se venger des mauvais traitements qu'ils en endurent. Une Syrienne, servante ou
maîtresse du lieu, récrée ses hôtes, par une danse de son pays : coiffée.
d'une petite mitre grecque, elle contourne ses hanches, contracte son corps de
cent manières différentes, souvent très libres, et accompagne du claquement
de longues castagnettes de roseaux cette danse, où les bras et les jambes sont
presque immobiles. Souvent une misérable courtisane prend une flûte, et la
troupe servile se met à bondir en faisant retentir l'air de paroles assorties
à la scène de ces ébats. Les Popinae sont le repaire de tout ce que
Rome a de plus vil, de plus misérable, de plus abject : on y trouve souvent des
voleurs, des assassins, des mariniers, des esclaves fugitifs, parmi des
bourreaux, des faiseurs de cercueils, et des prêtres de Cybèle étendus et
ronflant à côté de leurs, muettes cymbales, qu'ils vendent quelquefois pour
satisfaire leur intempérance. Les maîtres de ces tavernes ne valent pas mieux
que leurs hôtes ; la plupart n'ont pas même de vêtement et sont ordinairement
nus, avec un simple caleçon ; les moins misérables ont une tunique de lin.

Il y a un autre
genre de tavernes pour les gens d'une condition un peu plus relevée, quoique
encore inférieure : ce sont les Thermopoles. On y vend des boissons chaudes, du
vin cuit, du vin doux, de l'hydromel et du miel,. Leurs habitués sont
particulièrement des Grecs, espèce de faux philosophes qui, enveloppés du
Pallium, se couvrant soigneusement la tête, et chargés de livres et de
sportules, s'arrêtent pour discourir entre eux à la dérobée, vous ferment le
passage, et vous assomment de sentences. Ont-ils enlevé ou amassé quelque
chose, ils boivent chaud, en couvrant leur tête légère, et quand ils ont bien
bu, qu'ils ont grecqué et pergrecqué, comme on dit (leur
intempérance a fait forger ces verbes, qui signifient boire dans de grandes
coupes, et boire pur, ils s'en retournent à demi ivres, dissimulant leur
ivresse sous un air mélancolique.
Les Tavernes Vinariae sont celles où des marchands détaillent aux
personnes qui n'ont point de provisions chez elles, des vins de toutes
qualités, qu'assez ordinairement ils mélangent d'eau, pour augmenter leur
bénéfice, ce que le peuple de notre pays, si passionné pour le vin,
regarderait comme un véritable empoisonnement. Elles sont fréquentées par la
plèbe, qui souvent même y passe la nuit. A propos de ces tavernes et de celles
où l'on vend des fruits, il y en a où la vente se fait pour le compte d'un
riche citoyen, qui les alimente du produit de ses domaines. On les reconnaît en
ce qu'elles sont ordinairement situées en bordure d'une île, et qu'il y a une
communication avec l'intérieur de la maison du maître.
Un endroit à noter encore, où l'on trouve aussi beaucoup de belles tavernes,
surtout pour les objets d'art et de luxe, c'est la Villa publica,
particulièrement du côté de la place des Septa Julia. Les curieux, les
amateurs s'y portent en foule, et la réunion de ces tavernes, où Rome étale
les trésors de son opulence, provoque bien des tentations, fait naître bien
des désirs, et rend malheureux des gens qui ont la passion de ces objets,
presque tous inutiles, mais qu'ils mettraient leur bonheur à posséder.
Ce fut dans une de ces tavernes que j'appris à connaître la pourpre, sur
laquelle tu me demandes quelques détails. Cette étoffe précieuse est
foncièrement rouge, mais d'un rouge qui varie depuis la teinte la plus
éclatante jusqu'à la plus sombre. Au commencement de ce siècle on préférait
celle qui tirait sur le violet, puis l'écarlate devint en honneur. Maintenant
on considère comme la plus belle celle qui a la couleur du sang figé paraît
noirâtre de face, et brillante regardée devant le jour. Cette belle pourpre
s'expédie de Tyr, ville d'Asie. Elle est de beaucoup supérieure à l'écarlate
qui se fabrique en Italie même, à Tarente. La pourpre tyrienne est teinte dans
une liqueur qui vaut plus de mille deniers la livre ; c'est une véritable
essence, obtenue par la cuisson jusqu'à évaporation de quinze parties de
liquide sur seize. Un poisson de mer, appelé pourpre, fournit cette riche
teinture ; il la porte dans une petite veine blanchâtre située au milieu de
son gosier, et sa couleur naturelle est un rose obscur. Les pêcheurs tâchent
de prendre les pourpres vivantes ; parce que ce n'est qu'au moment de mourir
qu'elles dégorgent leur suc. On tire les grandes de leur conque pour le leur
enlever ; les petites sont écrasées dans la conque même, et d'un seul coup,
sans quoi la liqueur tinctoriale ne vaudrait rien. La belle pourpre, qui est une
nuancé combinée du violet et de l'écarlate, s'obtient par un mélange de deux
tiers de suc de buccin, autre poisson de mer, avec la véritable pourpre. On
imite cette teinture à Aquinum, ville du Latium ; mais un connaisseur un peu
exercé reconnaît aisément l'imitation. Pendant les dernières guerres
civiles, beaucoup de citoyens,. donnant carrière à leur goût pour la pourpre,
s'en faisaient faire des Paenula. Il y a une quinzaine d'années environ,
l'Empereur réprima ce luxe, et défendit à quiconque ne serait ni sénateur,
ni magistrat, de porter de la pourpre. Cette défense est toujours observée.
La Villa publica fait le malheur de tous ceux qui ne sont pas assez raisonnables
pour régler leurs désirs sur leur bourse. J'y ai vu des amateurs arrêtés
devant des coupes de myrrhe jaspées, devant de jeunes esclaves, devant des
meubles de bois de citre, verser des larmes de regret de ne pouvoir les
acquérir.
Un autre, c'est Albius, après avoir passé tous les étalages en revue, les
avoir mangés des yeux, rassasié de cet examen, entre enfin dans une des plus
riches tavernes. Il examine des tables, des vases couverts, et des patelles en
jolie terre rouge, fabriquées à Cumes ; des coupes d'argile de Sagonte ou de
Surrente ; des vases d'Arretium, en terre cuite aussi, couleur de corail et
ornés de petits bas-reliefs si jolis, que ces poteries sont préférées au
cristal ; s'arrête devant un lit de table orné d'airain, venant d'Asie, lui
dit le marchand, et pièce de butin du triomphe de Cn. Manlius, l'an 667,
choisie parmi les plus beaux meubles de ce genre, qui parurent alors pour la
première fois à Rome ; demande un riche meuble d'ivoire placé tout en haut de
la montre, prend jusqu'à quatre fois la mesure d'un Hexaclinon (lit de festin
à six places) enrichi d'écaille, et se désole de ne le point trouver assez
grand pour sa table de citre. Il consulte son nez pour savoir si des vases d'un
vert clair sont vraiment d'airain de Corinthe, matière plus précieuse que l'or
(on a vu un vase de cet airain vendu aussi cher qu'un fonds de terre) ; il
critique des statues de Polyclète, des plats de la main d'Évandre ; se plaint
de ce qu'on a gâté la pureté du cristal par l'alliance d'un verre de moindre
valeur. Cependant il a mis à part dix coupes de Murrhe, et il considère sous
toutes les faces ces vases fragiles, que les Romains aiment avec passion et font
venir de l'Orient et surtout du royaume des Parthes, où on les fabrique avec
une matière cuite au feu, dont on ignore la composition. Il les flaire, car un
de leurs mérites est d'être odorants ; il se mire dans leurs parois plutôt
luisantes qu'éclatantes; il fait admirer à plusieurs personnes qui l'entourent
comme ces délicieux calices sont mélangés de taches purpurines et blanches,
entremêlées d'une troisième couleur, nuance des deux autres, et où l'on voit
la pourpre tirant sur le feu, et le blanc prenant une teinte rouge ; il vante
dans les uns les bords chatoyants et certains reflets pareils à ceux de
l'arc-en-ciel ; dans d'autres des points glaceux ; il fait observer que dans
tous il n'y a rien de transparent, rien de pâle, et que nulle part la pâte
n'est déshonorée soit par des grains, soit par des inégalités en creux. Il
aperçoit une de ces coupes plus grande que les autres, et de la contenance de
trois Sextarii ; il la reconnaît pour avoir appartenu à un consulaire, qui,
par un excès de passion, en a rongé les bords. Ces objets de luxe acquièrent
de la célébrité, et par conséquent du prix, lorsqu'ils ont été possédés
par une succession d'amateurs de bon goût. Il marchande le précieux morceau,
qu'en raison de cette circonstance on lui fait la somme énorme de soixante-dix
talents ! « Ce n'est point trop, dit-il, elle vaut au moins cela. » Le
marchand ne se sent pas d'aise de voir un amateur si facile ; il a peine à
respirer, tant il éprouve de contentement, et lâche un peu la ceinture qui
tient sa tunique retroussée ; un mouvement machinal lui conduit aussi la main
à la bourse qu'il porte pendue au cou. Mais Albius passe à d'autres cratères
admirablement ciselés, il en prend deux qui ont appartenu à Lucius Crassus
auquel ils coûtèrent cent mille sesterces ; il s'arrête ensuite, à des
pendants d'oreilles dont il compte les émeraudes enchâssées dans un filigrane
d'or ; il cherche sur chaque tablette de véritables, sardoines, et met un prix
aux jaspes de la plus grande dimension. Enfin, excédé d'une visite qu'il
prolonge jusqu'à la onzième heure, il achète deux calices qu'il paye un as,
et se retire en les emportant avec lui.
Tous ces taverniers, tous ces gens de métiers étant plébéiens du plus bas
étage, ou esclaves, ou affranchis, ou étrangers, sont fort méprisés, et le
produit d'un trafic de détail est regardé comme un salaire de servitude, un
gain avilissant. Ce mépris s'étend plus ou moins sur la race des commerçants
en général ; celui qui trafique en grand, le Négociant, comme on l'appelle,
qui exerce une industrie profitable à la République, n'est pas encore
complètement estimé. Voilà sans doute pourquoi il n'y a guère à Rome
d'autre commerce que celui de consommation, celui des objets à l'usage
journalier de la ville. Les citoyens qui veulent commercer en grand et d'une
manière lucrative, le font dans les provinces, en Ligurie, dans la Gaules, en
Espagne, dans la Sicile, en Égypte, en Afrique, en Asie, et jusque dans les
Indes. Mais ceux qui se livrent à ce négoce sont en quelque sorte répudiés
par leur patrie, et comme si on ne voulait plus voir en eux des citoyens
romains, mais des étrangers, on les appelle Espagnols, Siciliens, Asiatiques,
etc., suivant la contrée où ils trafiquent. « Je fais cas d'un marchand actif
qui travaille à agrandir sa fortune, » a dit le vieux Caton ; on se tromperait
beaucoup si l'on prenait cette parole pour l'expression d'une opinion
générale, car de tout temps les Romains ont eu le commerce en aversion. Le peu
d'estime qu'ils en font tient à leur origine, et par suite à leurs moeurs. La
petite bande de pâtres fugitifs qui vint fonder Rome sur le mont Palatin était
habituée à vivre de violence et de rapine. Lorsque la ville fut constituée en
corps d'État, Romulus, voulant entretenir chez ses sujets cet instinct
guerrier, leur défendit toutes les professions qui tendaient à les détourner
du métier des armes, et notamment le commerce et les arts mécaniques. Le
règne pacifique de Numa ne fut qu'une trêve, après laquelle les agitations de
la guerre reprirent avec une nouvelle ardeur. Rome était trop petite encore ;
il lui fallait ou s'agrandir ou succomber, et, par nécessité, elle devint
envahissante. Tu sais comment d'exploits en exploits, et de conquête en
conquête, la vie de la nation romaine ne fut, pour ainsi dire, qu'un long duel
successif avec tous les peuples de la terre. La guerre devint la pensée
constante, l'occupation perpétuelle de Rome, et quelquefois presque un moyen de
gouvernement à l'intérieur. Carrière ouverte à tous, commandée même par
les lois sur le service militaire, on s'y jetait avec d'autant plus d'ardeur
qu'on était encouragé par des succès toujours nouveaux. Au milieu de cet
entraînement général, le commerce fut et dut être délaissé ; ceux qui s'y
livraient, être méprisés par leurs concitoyens, passer à leurs yeux pour des
gens à sentiments bas, sans énergie comme sans noblesse dans le caractère ;
enfin, pour des hommes qui dans leurs relations acceptaient une position
d'égalité ou d'infériorité, au lieu de rechercher celle du conquérant et du
maître, de préférer une profession qui non seulement illustrait la patrie,
mais pouvait donner en même temps la gloire personnelle, l'aisance, la
richesse, et jusqu'à la plus splendide opulence. En effet, si l'on veut
examiner l'origine des grandes fortunes de Rome, on verra qu'elles ont été
toutes acquises à la guerre ou dans les commandements des provinces. Les moyens
employés pour amasser ces richesses sont, il est vrai, indignes, souvent
affreux, et presque toujours déshonorants ; mais à Rome, ils ne choquent
personne, excepté peut-être quelques moralistes. On trouve tout naturel que
les généraux étant conquérants, ou envoyés pour régir des pays conquis, en
regardent les peuples comme leur proie, comme leur butin. Tant que ces peuples
ne sont pas citoyens romains, ils sont citoyens conquis, et traités comme tels
de génération en génération, sans prescription ; Rome est toujours prête à
répondre à leurs plaintes par cette fière parole que nous lui avons apprise
chez elle-même ; « Malheur aux vaincus !»
LES TONDEURS.
Il existe ici un
singulier usage, c'est que les jeunes gens portent leur barbe, et que les hommes
faits se la coupent. Il semble qu'en arrivant à l'âge mûr, un citoyen doive
mettre tous ses soins à cacher cette preuve de virilité, cette enseigne de
l'expérience et de la sagesse ; en un. mot, que les vieux doivent paraître
jeunes, et les jeunes vieux.
Jusqu'à l'âge de vingt ans ou vingt-cinq au plus, un Romain laisse croître sa
barbe, et pousser sa chevelure, qui flotte en longues boucles sur ses épaules.
Une fois la virilité arrivée, il les coupe l'une et l'autre. Cette opération,
qui constate la sortie de l'adolescence, forme une époque mémorable dans la
vie : on en fait un sujet de fête et de réjouissances ; les amis et les
clients y prennent part, et signalent leur joie par quelques présents qu'ils
envoient au nouvel hommes.
Quand l'Empereur, alors le jeune Octave, âgé de vingt-quatre ans, « déposa
sa barbe, » comme disent les Romains, il célébra cet événement par une
fête splendide, et donna un repas à tout le peuple.
Un jeune homme, en déposant sa première barbe et ses premiers cheveux, les
recueille soigneusement, et les enferme dans une petite boîte plus ou moins
riche, suivant son état de fortune. Il consacre ces singulières prémices à
quelque grande divinité, comme Jupiter Capitolin, ou bien il les conserve
auprès de ses dieux personnels, que l'on appelle Lares.
Autrefois les Romains de tout âge portaient leur barbe et leurs cheveux. L'an
quatre cent cinquante-quatre de la fondation de la ville, un nommé P. Ticinius
Ména eut l'idée d'amener de Sicile à Rome des barbiers, ou pour parler plus
exactement, des Tondeurs, parce qu'ils coupaient également la barbe et les
cheveux, comme encore aujourd'hui. La mode d'avoir le menton ras et les cheveux
courts régnait depuis longtemps en Grèce, d'où elle avait passé en Sicile.
Elle devint bientôt générale à Rome, et Scipion, le second Africain, se fit
couper la barbe tous les jours. Il avait alors quarante ans, et les citoyens les
plus distingués suivirent son exemple.
Dans l'origine, les Tondeurs commencèrent par exercer leur métier en plein
vent, comme ils le pratiquent encore pour la plèbe et pour les esclaves ; mais
bientôt ils eurent des tavernes que l'on appela tonstrines, et qui
finirent par devenir ce qu'elles sont maintenant, des lieux de réunion pour les
oisifs et les nouvellistes, qui s'y rassemblent dans le but de causer et de
passer le temps.
Les tonstrines sont très nombreuses ; on en trouve dans tous les quartiers,
dans les plus beaux comme dans les plus vilains, parce que l'immense majorité
des citoyens, à l'exception des riches qui ont chez eux des esclaves tondeurs,
se sert des tondeurs publics, et vient à la tonstrine. Aussi un tondeur du bon
genre doit savoir pratiquer les sept opérations suivantes : raser, épiler,
racler l'épiderme, poncer, coiffer, polir, et farder.
L'Oculifère d'une tonstrine se compose d'un étalage de rasoirs, de petits
couteaux et de miroirs, étalage plus ou moins simple, suivant la réputation et
l'habileté du Tondeur : les plus habiles affectent de ne laisser voir qu'un
petit nombre d'outils du métier, avec un seul miroir assez étroit ; ceux au
contraire qui n'ont aucune adresse véritable exposent aux regards des passants
une foule de petits couteaux et de grands miroirs. Ce luxe d'instruments
n'empêche pas leur inhabileté d'être connue, et ne tente personne : on vient
se mirer dans leurs miroirs, mais en sortant de faire faire sa barbe et ses
cheveux chez leurs voisins.
Les tonstrines des gens un peu élégants sont en haut du Forum, auprès de la
Graecostase, et dans le beau quartier des Carènes ; celles du petit peuple dans
la voie Suburane. Souvent dans ces dernières une femme fait l'office de
tondeuse, et la plupart du temps travaille devant sa porte, au risque de blesser
les passants. Ces tavernes sont fréquentées par tout ce que la ville renferme
de plus ignoble, des esclaves venant attendre là les enfants qu'ils ont
con-duits à l'école, des voleurs, qui en font le centre de leurs trames
criminelles. Des femmes de la plèbe s'y rendent aussi pour s'y faire coiffer.
Le salaire de l'opérateur ou de l'opératrice est de deux as.
Tous les Tondeurs sont curieux et bavards ; pas un événement ne se passe dans
leur quartier qu'ils ne soient les premiers à le connaître; les premiers à le
répandre. On reconnaît dans ce caractère l'influence, de la société
singulièrement mélangée qui se rassemble dans leurs tavernes, et peut-être
aussi le besoin, la nécessité où ils se trouvent d'amuser les gens qui
viennent réclamer leur ministère. Un jour quelqu'un entre chez un Tondeur, et
ce dernier lui demande comment il veut qu'on lui fasse la barbe : - « Sans
parler, » répond-il. C'était demander une chose presque pénible.
Voici comment se pratique le service de Tondeur : il commence par vous offrir un
siège, il faut que vous soyez assis pour qu'il puisse opérer plus sûrement,
et vous met autour du cou une pièce de linge qui retombe sur les épaules pour
garantir vos habits. Puis, avant de s'embesoigner, il vous adresse la question
d'usage, et vous donne à choisir entre les ciseaux, le rasoir, et les pinces
parce qu'il y a des personnes qui se font tondre, d'autres raser, d'autres
arracher la barbe, quoique cette opération soit douloureuse. Beaucoup se font
tondre ou raser certaines parties du visage, épiler les autres. La barbe
coupée aux ciseaux demeure encore très apparente; elle est assez longue pour
être rasée, quand on préfère le rasoir. Il faut d'abord une sorte de courage
pour l'affronter, car, au premier coup d'oeil, il paraît un instrument de
meurtre, et l'on pourrait craindre que le barbier ne vous coupât le cou. Ce
rasoir a la forme d'un croissant, avec le coupant en dehors. Ce n'est qu'une
lame d'airain, forte, large, percée au milieu d'un trou rond, et terminée par
un crochet à l'un des bouts. L'opérateur passe le pouce dans le trou, empoigne
le reste de la lame en mettant le petit doigt dans le crochet, et promène avec
dextérité l'outil sur la face du patient. La dépilation ne laisse aucune
trace. On la pratique souvent avec le Dropax ou le Psilothrum, sortes d'onguents
où il entre de la résine, et qui fait tomber le poil sans douleurs.
Donnez-vous la préférence au rasoir, aussitôt l'instrument est tiré de son
étui ; on vous présente un bassin plein d'eau, vous vous mouillez la barbe
pour l'attendrir puis l'opérateur promène sur votre visage sa lame, qu'il
essuie de temps en temps sur un petit sudarium de linge, pour la
débarrasser de la moisson barbue qu'elle a fauchée.
Quand on veut-se faire parer complètement, le tondeur passe de la barbe (c'est
toujours par là qu'il commence) à la chevelure. Armé d'un peigne et de
ciseaux, il retranche tout ce qui lui paraît superflu. Après cette opération
il vous frise avec un fer chaud, et vous parfume. Puis il arrive aux sourcils
qu'il peigne, qu'il lisse ; aux narines, et surtout aux aisselles qu'il épile.
Si l'on est un peu recherché, il passe aux bras et aux jambes qu'il traite de
même, ou bien dont il brûle les poils à la flamme d'une noix ardente, et
qu'il polit ensuite avec une pierre ponce, car tout le monde va nu-bras et
nu-jambes. Il finit en vous faisant les ongles. On se charge quelquefois
soi-même de cette dernière opération, mais dans la taverne même du Tondeur,
et avec ses petits couteaux dont on affûte le fil sur une pierre que l'on
mouille de salive.
Pendant que le maître de la tonstrine s'évertue sur votre barbe ou votre
chevelure, vous suivez ses mouvements dans un petit miroir qu'il vous a mis en
main avant de commencer ; vous appelez son attention tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre, et vous le faites revenir sur les parties qui vous semblent
oubliées ou négligées.
Les Tondeurs sont aussi prompts qu'habiles dans leur service et manient le
rasoir avec une dextérité, une hardiesse, et une légèreté de main
étonnantes. Il est vrai qu'ils font un apprentissage avec un fer émoussé,
longtemps avant de pratiquer.
Depuis que l'on ne porte plus sa barbe ni sa chevelure, les Tondeurs sont
devenus des personnages indispensables pour tout le monde ; aussi, il y a
quelques années, Agrippa, voulant plaire au peuple, fournit gratis, pendant un
an, des Tondeurs pour les hommes et pour les femmes. Ce genre de libéralité a
depuis été imité par l'Empereur.
Le besoin général de Tondeurs a fait tourner la spéculation vers ce genre
d'industrie : il y a des riches (ceci est un trait à joindre à ma lettre
précédente), il y a des riches, dis-je, qui se sont ingéniés d'avoir des
esclaves tondeurs ou tondeuses, installés dans des tavernes publiques. Ils y
travaillent pour leurs maîtres à qui ils rapportent et comptent les gains du
métier.
Mais entrons chez un Tondeur libre, riche, dit-on, ce qui prouverait que la
profession est lucrative. Il se nomme Licinius, et sa tonstrine, une de celles
qui touchent à la Graecostase, est toujours entourée de monde, parce qu'on y
voit une pie qui, d'elle-même et sans avoir été dressée, contrefait la
parole des hommes, la voix ou le chant des bêtes, et jusqu'au son des
instruments. A l'intérieur, cette taverne est le rendez-vous des efféminés,
qui y passent des heures entières pour se faire arracher . les moindres poils
qui ont pu croître la nuit précédente ; pour tenir conseil sur chaque cheveu
; soit pour qu'on relève leur coiffure abattue, soit pour qu'on ramène sur
leur front dépouillé les cheveux de droite et de gauche. Comme ils se mettent
en colère s'ils croient Licinius coupable de négligence ! Comme ils pâlissent
de courroux s'il a mal coupé la moindre parcelle de cette précieuse crinière,
si quelques cheveux dépassent les autres ; si tous ne tombent pas en boucles
bien égales ! Pas un de ces efféminés qui n'aimât mieux voir la République
en désordre que sa chevelure ; qui ne soit, plus soucieux de l'ajustement de sa
tête que de sa santé ; qui ne préférât être bien coiffé plutôt
qu'honnête homme. La chevelure de ces gens perpétuellement occupés entre le
peigne et le miroir, une fois arrangée à leur goût, devient pour ainsi dire
sacrée pour eux ; craignant d'y porter la main, ils n'y touchent plus que du
bout du doigt ; aussi les Romains, pour désigner les luxurieux et les
efféminés, disent-ils : « C'est un homme qui se gratte la tête d'un doigts.
»
J'aime assez ces rendez-vous de causeurs, parce que j'y trouve toujours moyen
d'apprendre quelque chose. Hier j'entrai dans la taverne de Licinius, où
j'avisai un homme de médiocre mine, qui semblait attendre son tour pour se
faire raser, et se tenait silencieusement à l'écart. Je voulus savoir sa
condition ; j'allai à lui, le saluai ; et lui demandai poliment s'il était
chevalier ?- « Je suis décurial scribe questorien, me répondit-il avec
douceur et modestie, et presque toute notre décurie vient habituellement chez
Licicius, dont nous aimons la dextérité. » Je n'avais encore entendu parler
ni de ces scribes, ni de cette décurie ; et ma curiosité s'éveillant
aussitôt, j'invitai mon scribe à venir faire quelques tours sur le Vulcanal,
jusqu'à ce que la taverne se fit un peu vidée. Tout en causant, voici ce que
j'appris :
Les magistrats ont, comme marque d'autorité, et comme auxiliaires subalternes
dans leur charge, un certain nombre d'appariteurs (c'est le nom générique)
appelés licteurs, hérauts, scribes ou scribes-libraires; accensi, viateurs,
nomenclateurs. Ces humbles fonctionnaires doivent être en disponibilité
perpétuelle, et, à cet effet, chaque sorte forme un collège dit décurie,
composé de citoyens romains du plus bas degré, car ils sont affranchis ou fils
d'affranchis. Les décuries ont un album ou tableau de leurs membres déposé au
Trésor de Saturne. C'est là qu'aux calendes de décembre de chaque année, un
mois avant d'entrer en charge, les magistrats désignés viennent demander le
genre et le nombre d'appariteurs afférents à leur magistrature, et qu'ils
garderont pendant toute sa durée ; par exemple, un consul reçoit 12 licteurs,
1 viateur, 1 héraut, et des scribes ; on donne à un questeur, 4 viateurs,
hérauts, et des scribes. Il en choisit un certain nombres, et d'autres lui sont
assignés par le sort. Le Trésor paye un salaire modique aux appariteurs qui
entrent en activité de service. Les décuries se distinguent entre elles par le
nom de la magistrature qu'elles doivent desservir; ainsi il y a la décurie
lictorienne consulaire ; la viatorienrie consulaire ; la questorienne ; celle
des hérauts ; celle des scribes-libraires pour les édiles curules ; celle des
viateurs pour les magistrats autres que les consuls. La décurie des scribes ou
scribes-libraires, réservée aux préteurs, aux questeurs, propréteurs,
proconsuls, édiles, est la première, parce que ses membres doivent avoir des
connaissances en comptabilité, et les scribes prétoriens être en état de
rédiger les jugements. Dans cette décurie, renommée pour sa probité, les
offices se vendent, tandis que les autres se recrutent par voie d'élection de
la décurie. On comprend que les viateurs, les licteurs, les hérauts soient
moins considérés, leur service étant quasi servile, et se bornant à
exécuter un ordre, une consigne, même un commandement où la force matérielle
doit exécuter. Ils en portent l'insigne. Les licteurs, des faisceaux de verges,
avec ou sans hache, suivant les circonstances ; les viateurs et les hérauts, un
long bâton.
Voilà un petit détail du grand gouvernement de la République romaine, détail
si mince, que le hasard seul pouvait me mettre à même de le connaître. Cette
espèce d'armée de serviteurs publics n'est-elle pas une conception bien
entendue ? Le service des appariteurs décurials dure autant que la fonction des
magistrats auxquels ils sont attachés. Tu vois que je n'ai pas perdu mon temps
chez Licinius.
En revenant au véritable sujet de ma lettre, tu vas sans-doute me dire : « Et
toi, as-tu conservé tes cheveux et ta barbe ? » Dans les commencements, j'ai
résisté à la mode du pays ; mais enfin il m'a fallu céder aux instances de
mes nouveaux amis : ma chevelure qui, relevée sur le front, s'élançait vers
le ciel, est tombée sous les ciseaux du Tondeur, et ma moustache inculte sous
son rasoir. Un philosophe cynique, en me voyant sortir de la tonstrine la figure
ainsi dégarnie, me cria dans son brusque langage : «Tu fais donc un crime à
la nature de ce qu'elle t'a fait homme, au lieu de te faire femme ? » Et je
crois que le cynique avait raison.
En Germanie et particulièrement chez les Cattes, les jeunes gens sont dans
l'usage, comme à Rome, de se laisser croître les cheveux et la barbe dès
qu'ils sont adultes, et par un voeu qui les enchaîne à la valeur, ils ne les
coupent qu'après avoir tué un ennemi. C'est sur son sang et sur ses
dépouilles qu'ils se découvrent le front. De ce moment seulement ils
prétendent avoir payé le prix de leur naissance, être dignes de leur patrie
et de leur père. Les lâches, et ceux qui ne vont point à la guerre, gardent
toute leur vie une barbe et une chevelure hideuse. Combien cette coutume de nos
frères n'est-elle pas plus noble que celle des Romains, fondée seulement sur
un vain caprice, ou une misérable recherche de parure.
MON EMMÉNAGEMENT. - LES MAISONS A LOYER. - UNE MAISON DE LA VOIE SUBURANE.

« Quelle que soit
l'amitié de l'hôte qui vous donne l'hospitalité, vous êtes à charge au bout
de trois jours. Ne demeurez jamais dix jours de suite, car le maître s'en
accommodât-il, les esclaves murmurent. »
Cette sorte d'adage répandu à Rome m'a servi de règle de conduite. Chez nous,
quand nos provisions sont consommées, nous conduisons notre hôte au voisin,
qui lui fait bon accueil, même sans le connaître ; ici la maxime est « tout
pour soi ; » et bien qu'il n'y ait guère que les riches qui exercent
l'hospitalité, et qu'on ne puisse pas craindre d'épuiser leur maison, il ne
faut user de leur générosité qu'avec beaucoup de réserve. Je ne dis pas cela
pour Mamurra ; si je l'écoutais, son hospitium serait ma demeure perpétuelle ;
je parle en général, je constate un esprit d'égoïsme rappelé et résumé
dans la sentence qui forme le début de cette lettre, sentence que je n'ai point
prise dans son sens rigoureux, puisque voilà plusieurs mois que j'use de
l'hospitalité de mon hôte. Cependant, malgré ses instances pressantes pour me
retenir, je me suis mis à la recherche d'un logement.
A Rome chaque famille n'a pas sa maison, comme dans notre petite Lutèce ; les
riches seuls jouissent de cet avantage : la plupart ont envahi les hauts lieux
de cette ville, dont le sol inégal semble une image de la société qui
l'habite. Mais à côté de ces belles et spacieuses demeures, on trouve dans
les vallées des sept collines beaucoup de maisons collectives, si je puis
m'exprimer ainsi, non moins considérables, et dans lesquelles la foule urbaine,
qu'on appelle le peuple-roi, s'entasse pour passer les quelques heures du jour,
et surtout de nuit, où elle n'est pas dehors, dans ce pays où l'on vit tant
dehors. Quiconque a peu de biens occupe un dixième, un vingtième, souvent
moins encore, d'un de ces grands domaines, moyennant une petite rétribution eh
argent ; on n'a que son mobilier à fournir. Il y a même certaines de ces
maisons où l'on trouve un mobilier tout en place ; le prix de l'usage en est
compris dans le loyer. Ces logements garnis sont particulièrement occupés par
les capitecensi et les prolétaires, qui ne sauraient avoir de demeure,
de lare fixe, comme on dit, parce qu'ils vivent au jour le jour, que, ne
possédant rien, ils ne tiennent à rien, et par suite ont l'esprit, le
caractère, et les goûts un peu vagabonds.
Entre ces pauvres citoyens et les riches, il existe une classe moyenne qui tient
à n'habiter que dans un logement à soi, qu'elle possède en propriété,
regardant comme une honte d'être ce qu'on appelle inquilinus, locataire.
Afin d'éviter cette note, ces demi-riches se réunissent, trois, quatre
ensemble, plus ou moins, pour simuler les opulents : ils bâtissent ou ils
achètent à frais communs une maison dont ils se divisent la propriété ; l'un
a le rez-de-chaussée, l'autre le premier étage, un autre le deuxième, et
ainsi de suite.
Ces demi, ces tiers, ou quarts de propriétaires sont néanmoins encore en petit
nombre comparativement au reste des habitants de Rome, et l'immense majorité
des citadins est simplement locataire. Les maisons à loyer sont une
spéculation, un placement d'argent très avantageux, et il est tel riche dont ,
elles forment presque tout le revenu. Le nombre de ces maisons et des logements
qu'elles renferment est très considérable ; aussi les propriétaires ont soin
de solliciter la préférence des inquilini en faisant inscrire sur les
murs l'annonce des logements qu'ils ont à louer, leur plus ou moins
d'importance, et jusqu'à l'indication du fondé de pouvoirs auquel il faut
s'adresser pour entrer en arrangement. C'est une habitude générale d'avertir
ainsi le peuple, même pour lui dire qu'on a perdu ou trouvé un objet, et que
le perdant ou l'inventeur est un tel. Les écriteaux sont souvent en grandes
lettres d'une coudée, et comme ils se succèdent assez fréquemment, on les
peint les uns sur les autres, après avoir couvert le précédent d'une peinture
blanche. Les lettres en sont noires, à l'exception de la dernière ligne,
contenant le nom du bailleur, pour les écriteaux de location, laquelle est en
rouge, afin de mieux attirer l'attention. Elles sont peintes à la grosse
brosse, et si l'écriteau est long, placé bas, et l'espace restreint, les
lettres n'ont que cinq à dix doigts de hauteur ; mais dans le cas contraire on
leur donne jusqu'à un pied et demi ; les grands. caractères sont ceux des deux
écriteaux suivants que je transcris dans leur teneur textuelle:
DANS
L'HÉRITAGE DE JVLIA, FILLE DE SPVRIVS FÉLIX.
SOIENT LOVÉS
VN BAIN, VN VENERIVM ET QUATRE-VINGT-DIX
TAVERNES, DES TREILLES
DES COENACVLA, A PARTIR DES PROCHAINES KALENDES D'AVGVSTE
AV SIX DES IDES D'AVGVSTE
POVR CINQ ANNÉES CONSÉCVTIVES.
QVE CELVI QVI NE CONNAÎTRAIT PAS LA MAÎTRESSE DE CE LIEV
AILLE TROVVER SVETTIVS VERVS ÉDILE.
DANS L'ÎLE
ARRIANA
POLLIANA DE GN. ALIFIVS NIGIDIVS L'AÎNÉ,
SOIENT LOVÉS DES PROCHAINES KALENDES DE JVLIVS DES TAVERNES
AVEC LEVRS TREILLES ET DES COENACVLA
ÉQVESTRES. QVE CELVI QVI VOVDRA LOVER
S'ADRESSE D'ABORD' A L'ESCLAVE DE GN. ALIFIVS
NIGIDIVS L’AÎNÉ .
Les locations étant
de véritables aliénations temporaires de propriétés, ne se font jamais que
pour une durée déterminée, soit de plusieurs années, soit seulement de six
mois.
Tout logement vacant peut être loué n'importe quand ; cependant, comme il a
paru commode, nécessaire même, que les volontés de ceux qui laissent et de
ceux qui cherchent des logements puissent coïncider, l'usage a établi une
périodicité dans les mutations, a réglementé, en quelque sorte, l'humeur
changeante, les caprices, les vouloirs. et les impatiences de chacun : ainsi les
Calendes de Julius, qui tombent dans la belle saison, sont l'époque
généralement choisie pour les locations et les déménagements. Alors il y a
dans la ville pendant quelques jours un redoublement d'activité. L'empressement
de chacun à profiter de l'époque fatale pour se pourvoir fait hausser
momentanément le prix des loyers. Afin d'éviter, pour mon compte, cet
inconvénient, je voulus commencer mes recherches quelques jours à l'avance. Je
m'informai quel était le quartier le plus proche du mont Coelius où je
pourrais me loger à meilleur marché, et l'on m'indiqua la voie Suburane, qui
s'en trouve effectivement peu distante : elle fait suite à la voie Sacrée, et
s'étend jusque sur le mont Esquilin. J'aurais bien aimé loger dans les
environs du Forum, mais tous les quartiers qui avoisinent cette place sont
envahis par les magistrats, par les citoyens qui poursuivent les honneurs ou
s'occupent d'affaires publiques et le petit nombre de logements à loyer qu'on y
pourrait trouver sont fort chers. Cette considération calma mon désir, et je
descendis vers Subure.
L'aspect du quartier n'a rien du tout de séduisant : dès l'abord on y trouve
des tondeurs, des cordonniers, et des marchands de fouets à châtier les
esclaves La rue étroite, sale, mal pavée, fangeuse, monte sur l'Esquilin par
une pente escarpée. Je fus sur le point de revenir sur mes pas ; mais une
espèce d'instinct d'observateur qui semblait me. dire : «Au moins il faut
voir, » me poussa en avant. Dès que je me fus engagé dans ce misérable
défilé, les aboiements d'une multitude de chiens saluèrent mon entrée, et.
quelques pas plus loin je faillis être renversé par de longues files de mulets
tirant à force de cordes un énorme bloc de marbre. Cependant à travers mille
aboiements sans fin, mille bruits qui, plus éclatants qu'ailleurs en raison de
l'étroitesse de la rue, lui ont valu la désignation de « Subure la criarde,
la bouillante Subure, » j'arrivai devant un large écriteau de location peint
sur une de ces vieilles maisons, où, dans une hauteur de plus de soixante-dix
pieds, six ou sept étages sont montés les uns au-dessus des autres.
Le genre d'habitants qui l'occupaient n'était guère propre à détruire
l'impression défavorable que le quartier m'avait inspirée ; c'étaient, pour
la plupart, des courtisanes, dont cette rue est infestée ; puis un maître
découpeur, chez lesquels les esclaves viennent apprendre à dépecer les
viandes. Il leur montre, avec un fer sans tranchant et sur des modèles de bois
représentant des lièvres, des sangliers, des gazelles, des oiseaux de
Gétulie, à les découper, à en séparer proprement toutes les parties. Le
moindre manque d'attention ou d'adresse est aussitôt puni par les verges et les
fouets, de sorte que son école est un véritable enfer. Plus haut, dans un
bouge , un vrai trou, je vis un malheureux qui fait profession de mendier un
festin, d'y dérober le plus de mets qu'il peut, et de les accumuler chez lui
pour revendre le lendemain ses larcins de la veille. Le dispensateur de Mamurra
(affranchi chargé des comptes de recette et de dépense) m'accompagnait : «
Que viens-je faire ici ? lui dis-je presque en courroux, et en m'éloignant,
repoussé par l'odeur qui s'échappait de ce bouge : vous raillez-vous de moi ?
- Cette maison est à mon patron, se hâta-t-il de répliquer ; plusieurs des
logements vont être libres aux Calendes prochaines, et j'ai pensé que vous
seriez bien aise de profiter de cette circonstance pour voir un spectacle que
vous n'aurez pas souvent occasion de rencontrer. - A ce compte, dis-je, en me
radoucissant, continuons notre visite. »
Ma vivacité avait rendu mon guide presque craintif, aussi me dit-il avec une
sorte de réserve : « Voulez-vous monter à la treille. » On nomme ainsi le
dernier étage d'une maison, par analogie de situation avec des treilles
véritables, qui souvent couronnent des maisons couvertes en terrasses. Ces
treilles nominales sont la demeure des plus pauvres gens. « Allons, »
repartis-je. Nous montâmes encore, et j'entrai dans un logement où nous
entendîmes d'abord des cris de douleur. C'étaient ceux d'une grosse et robuste
Syrienne ou Égyptienne que l'on battait. Une esclave de cette sorte est censée
bonne à tout, elle file, travaille en linge, moud le blé, fend du bois,
nettoie la maison, apprête chaque jour à manger pour la famille, et compose
ordinairement à elle seule tout le domestique d'un petit ménage. J'ignore la
faute de la malheureuse, mais notre présence n'interrompait pas les sévices
qu'on exerçait contre elle ; je me hâtai de me retirer, car ici personne n'a
rien à dire à quiconque maltraite son esclave.
J'entrai dans une chambre située sur le même palier. Là je trouvai le tableau
d'une affreuse misère : un grabat plein de punaises, couvert d'une natte en
guise de matelas, un coffre et une tasse, formaient à peu près tout le
mobilier de ce chétif logis.
C'était la demeure d'un grammairien, rhéteur ou philosophe je ne me rappelle
plus lequel, que sa science ne peut tirer de la pauvreté, et qui mange du pain
noir et boit de la piquette. Pour tout vêtement il n'avait qu'une toge qui lui
sert la nuit et le jour, et sur laquelle il dort. Un ami cependant adoucissait
son infortune en la partageant : c'était son chien. J'avais déjà monté deux
cents degrés, et je redescendis avec un certain plaisir.
En sortant je rencontrai le déménagement d'une de ces familles de la basse
plèbe qui compose essentiellement la population de la voie Suburane. Trois
femmes au teint couleur de buis, l'une rousse, l'autre d'une taille de géant,
et la dernière, à tête chauve, paraissant être leur mère, transportaient à
elles seules tout leur mobilier. On voyait un grabat à trois pieds, une table
qui n'en avait que deux, une lampe, une tasse de corne, un vieux vase de nuit
ébréché. La plus grande portait sur la tête une amphore surmontée d'un
foyer. L'odeur empoisonnée qui s'exhalait de l'amphore annonçait la présence
de quelques vieilles bribes, de restes dégoûtants doués du parfum de la
marée puante. Ces provisions étaient, accompagnées d'un quart de fromage de
Toulouse, d'un chapelet de pouliot, que quatre années au moins avaient noirci,
et d'une guirlande d'oignons, d'ail et de poireaux. Une autre portait à
l'épaule un filet rempli de pain, et la troisième tenait entre ses bras deux
corbeilles de jonc, dans lesquelles le peuple met ordinairement son blé.
Enfin,, un vieux pot rempli d'une résine malpropre destinée à servir de
remède épilatoire, achevait de donner à ce déménagement un air tout à fait
minable.
En rentrant je contai mon espèce de mésaventure à Mamurra. - « Si j'avais
connu vos intentions, me répondit-il, je vous aurais détourné d'aller dans ce
quartier, où vous ne pouviez rencontrer rien de convenable. - On m'a cependant
assuré que Jules César y avait occupé une petite maison. - Qu'il habita même
jusqu'à l'époque où il fut élu Pontife Maxime, c'est vrai ; et l'on aurait
pu vous dire encore que l'un des Gracchus quitta le mont Palatin pour venir y
loger aussi, afin de se rendre plus populaire ; mais ce qui détermina Gracchus,
qui voulait se fourrer au milieu de la plèbe dont il avait besoin chaque jour,
dont il faisait sa milice, devait au contraire vous détourner de cette rue. -
Elle ne m'éloignait point trop de vous, voilà ce qui me poussa de ce côté. -
La meilleure manière serait de rester ici ; mais puisque je ne puis gagner
cela, laissons passer huit ou dix jours, et nous chercherons ailleurs. -Est-ce
que les Calendes n'arrivent pas après-demain ?- Justement. Vous savez que
l'empressement général fait alors monter les prix ; plus tard ils diminueront.
Cette baisse est tellement infaillible et ordinaire, que beaucoup de gens, qui
déménagent au terme, vont habiter provisoirement dans des jardins pour laisser
passer les Calendes. Je ne vous parlerai pas d'aller demeurer à la campagne,
où, pour le prix que coûte ici un logement ténébreux, vous auriez une maison
tout entière avec un petit jardin, car pour n'avoir dans la ville qu'un local
assez modeste, et encore à un étage supérieur, il vous y faudra mettre au
moins deux mille sesterces, et trois mille si vous voulez demeurer en bas. »
Au jour dit, je rappelai à Mamurra sa promesse, et nous partîmes en nous
dirigeant vers la région transtibérine, habitée aussi par beaucoup de petit
peuple, mais que je préférai parce qu'elle se trouve sur la route de notre
patrie. Chemin faisant nous entrâmes, par curiosité, dans toutes les maisons
portant écriteau, même dans celles dont la somptuosité annonçait ne pas
devoir nous convenir. Ainsi nous vîmes des logements de six mille sesterces un
entre autres qu'un sénateur venait de quitter, nous dit-on, et qui nous parut
bien modestes pour « un habitant propres, » terme, usuel signifiant un
locataire distingué. Nous en visitâmes d'autres de dix mille, qui n'avaient
rien d'extraordinaire ; plusieurs de trente mille, mais fort beaux, et
convenables pour des magistrats ou des aspirants. aux magistratures. En
général, le taux moyen de la plupart des loyers est de deux mille sesterces
environ, à trois mille.
Nous trouvâmes au sommet du Janicule une petite maison isolée, modeste et
jolie tout à la fois, à laquelle sa situation dans un quartier tranquille, et
sa position admirable me déterminèrent à m'arrêter. Elle est située tout
près d'une antique forteresse, bâtie par le roi Ancus ; pour protéger la
navigation du Tibre. De là, je vois Rome à près de trois cents pieds
au-dessous de moi : vers la droite c'est le Capitole, quelques-uns des grands
édifices du Forum romain, et tout le mont Palatin. Au milieu de cet amas de
constructions vraiment prodigieux, quelques touffes de verdure, indiquant les
maisons des riches, rompent la monotonie du tableau et récréent la vue. A
gauche s'étend le Champ de Mars. Je vois entrer le Tibre dans Rome, et je l'en
vois sortir à replis sinueux, comme s'il quittait à regret la belle reine de
l'univers. Cette vue est bornée par un immense hémicycle de montagnes
verdoyantes, dont les plus éloignées apparaissent environnées d'une légère
brume bleuâtre, qui les harmonise avec l'horizon : c'est la chaîne des
Apennins. Leurs dernières cimes étalent de place en place des tapis de neige
qui brillent sous les rayons du soleil, et bravent jusqu'aux chaleurs du
printemps. Tout me plaît dans ma nouvelle demeure, même son isolement. Là, du
moins, on est vraiment chez soi, tandis que dans ces hautes maisons des
quartiers du centre, les bruits de ceux qui demeurent au-dessus ou au-dessous de
vous troublent souvent votre repos, et de plus, les vis-à-vis voient les uns
chez les autres, et peuvent, de leurs fenêtres, se parler, et souvent se donner
la main. Je serai bien logé, mais il m'en coûtera un peu plus cher : mon loyer
est de dix mille sesterces.
Enfin me voilà chez moi, avec un mobilier un peu plus nombreux que je n'aurais
voulu ; c'est une magnificence obligée, réglée par l'importance de la
location, attendu que les meubles doivent servir de caution au propriétaire,
qui a droit de s'en emparer si on ne le paye pas, petit accident encore assez
fréquent. Dans l'endroit le plus apparent de nia demeure, brille la coupe de
corne, garnie en argent sur les bords, seul objet que j'aie emporté de Lutèce.
Ce fut toi qui en ravis la matière au front d'un Urus, dans une de ces chasses
auxquelles s'endurcit la jeunesse gauloise ; je la conserve comme un souvenir et
de ton amitié, et de notre patrie.
Hier, je pris congé de Mamurra. - « Mon cher hôte, lui dis-je, il existe dans
notre pays un usage ou plutôt un droit de l'hospitalité que vous connaissez
sans doute : lorsqu'on quitte un toit hospitalier, si vous demandez quelque
chose à celui qui vous a reçu, il ne vous le refuse jamais. En même temps
cette demande lui donne les mêmes droits sur vous. Voici un anneau d'or qui m'a
été légué par mon aïeul, voudriez-vous l'accepter en échange du vôtre ? -
Volontiers , me répondit-il ; cela m'est d'autant plus agréable que cette
bague m'a appartenu autrefois. Je l'avais donnée moi-même à votre vénérable
aïeul dans une circonstance semblable, lorsque je traversai le pays des
Aulerciens. Qu'elle soit désormais notre tessère hospitalière, qu'elle
achève de serrer les noeuds de l'amitié que nous venons de former. J'espère,
jeune homme, que, malgré la distance du Janicule au Coelius, vous nous
dédommagerez, par vos fréquentes visites, du trop court séjour que vous avez
fait au milieu de nous. Je veux qu'avec le temps nous devenions « amicissimes ,
» - Que la vie m'échappe, repartis-je, si je ne le désire autant que vous. »
Cette formule toute romaine fit sourire Mamurra, mais il parut touché lorsque
je le pressai dans mes bras, suivant notre manière cordiale. Il m'embrassa à
son tour d'un air content et satisfait, comme un ami, et me reconduisit jusque
sur le vestibule de sa maison. Là, il me serra la main droite, et en me
quittant, me laissa, suivant l'usage des Romains, un souhait impératif de bonne
santé.
DU DROIT DE CITÉ ROMAINE
Il ne suffit pas de
vivre à Rome pour être citoyen romain ; il faut encore avoir ce qu'on appelle
la cité romaine, c'est-à-dire la jouissance d'une douzaine de droits
particuliers qui sont : le droit de race et de famille, ceux de milice, de
suffrage, d'honneurs, de liberté, de cens, de mariage, de testament,
d'héritage ; le droit paternel, celui dé propriété légitime, et celui de
tutelle.
Le droit de race et de famille est comme la base et le résumé de tous les
autres. Il date de l'origine de la ville et formait jadis deux droits très
distincts : le droit de race appartenait aux seuls fondateurs de Rome. Ceux-qui
en jouissaient concouraient à l'élection des magistrats, pouvaient occuper les
magistratures, être chargés du culte public des Dieux, et même avoir ou
fonder des sacrifices particuliers, transmissibles de génération en
génération. Chez eux, ils avaient le pouvoir conjugal et le pouvoir paternel ;
mais le premier n'était point absolu, et le second s'évanouissait pour les
fils à un certain âge, et pour les tilles quand on les mariait.
Le droit de famille fut créé pour la deuxième population de Rome, pour les
fugitifs qui vinrent peupler l'Asyle et le bas du Palatin. Ils ne reçurent
qu'une partie de la cité romaine, le droit de concourir à l'élection des
magistrats, sans pouvoir devenir magistrats eux-mêmes. Leurs mariages, ou
plutôt leurs unions, produit du rapt et de la violence, n'eurent aucun
caractère légitime. Leurs femmes, vrai butin de guerre, n'étaient que des
esclaves, et, par suite, leurs enfants naissaient esclaves. Enfin, dans la haute
ville, liberté pour tous, filiation reconnue et consacrée par le nom même de
patriciens, pris par ces citadins exclusivement, et qui signifiait alors que
ceux qui le portaient pouvaient nommer leurs pères, ou peut-être jouissaient
seuls du véritable pouvoir paternel. Dans la ville basse, au contraire,
esclavage pour tous ou presque tous ; un maître dans chaque maison, et des
esclaves, famuli : en termes plus précis, une famille et un père de
famille. L'ensemble de cette population, ramas d'individus sans parenté, sans
père qu'ils pussent nommer, est appelé plèbe, et plébéiens.
Cette séparation de Rome en deux peuples et comme en deux cités ne dura pas
longtemps ; Romulus lui-même l'abolit, soit parce que les moins favorisés
étaient les plus nombreux et les plus forts, soit plutôt parce que
l'inégalité des droits privait son petit État de l'unité qui devait en faire
la force. Alors le droit de race fut communiqué aux familles, et celui de
famille aux races. Les patriciens gagnèrent le pouvoir paternel absolu et la
tutelle complète de leurs épouses ; les plébéiens le droit d'admission aux
magistratures, et une sorte de légitimité pour leurs unions conjugales.
Désormais les deux droits n'en formèrent plus qu'un seul.
Cependant l'égalité juridique ne put faire oublier l'inégalité des origines
; les gens de race maintinrent les noms de patriciens et de plébéiens, dont
peu à peu la signification primitive s'oublia ; mais ils en acquirent une
autre, inspirée encore par l'esprit de distinction, c'est celle dont j'ai
déjà parlé, c'est-à-dire que les patriciens sont les membres du Sénat ou
des familles sénatoriales, et les plébéiens le reste du peuple. Le temps a
introduit aussi une légère modification dans les termes de race et de famille,
que le décret de Romulus avait rendus parfaitement synonymes : aucune idée
d'infériorité réelle ne s'attache à l'un ou à l'autre ; mais on se sert
volontiers aujourd'hui du mot famille pour désigner une branche de la race. Le
mot race s'emploie toujours de préférence pour indiquer une origine libre, et
l'on dit d'un citoyen d'une naissance obscure ou ignoble : « C'est un homme
sans race. » Le vieux mot aristocratique a survécu à la chose ; il se montre
encore dans le nom qui désigne tous les membres des familles issus d'un auteur
commun, qui sont appelés gentils, de gens, race. Néanmoins, le nom de
pères de famille s'applique aussi bien aux patriciens qu'aux plébéiens.
Depuis dix-sept ans jusqu'à quarante-cinq, tout citoyen romain peut être
appelé à faire partie des légions : c'est là le droit de milice ; je dis des
légions, car il n'y a pas de milice pour la marine : tous ceux qui font ce
service sont levés parmi les affranchis romains ou chez les alliés, qui n'ont
que le droit d'affranchis romains.
L'âge est aussi requis pour le droit de suffrage et pour celui d'honneurs :
c'est encore dix-sept ans pour le premier, et vingt ans pour le second, dans les
magistratures inférieures; il faut pour les hautes magistratures un âge plus
élevé, gradué suivant leur importance. Par une exception unique, il est aussi
un âge où ces deux droits se perdent, parce que la République romaine fut
organisée pour être toujours jeune, et vigoureuse : ses magistratures, presque
toutes annuelles, donnent une énergie singulière au gouvernement ; les
citoyens qui ne font que passer au pouvoir, sont empressés de se signaler pour
mériter d'y rentrer un jour, et il n'y a pas un moment de perdu pour
l'ambition. Afin que rien ne périclite dans un aussi beau système, tout
citoyen âgé de quarante-cinq ans accomplis est regardé comme trop peu valide
pour combattre à l'armée, et à soixante ans trop vieux pour voter dans les
comices ; le législateur a craint l'engourdissement de l'âge, même pour cette
milice pacifique.
Le droit de liberté consiste dans l'inviolabilité de la personne. Un Romain ne
doit jamais être battu de verges, jamais réduit en servitude, jamais mis à
mort, en principe du moins. Je dis en principe, parce que les délits ou les
crimes ne pouvant être réprimés ou punis que par une atteinte à la liberté
ou par la privation de la vie, l'inviolabilité absolue du citoyen n'est que
fictive. En effet, dès qu'un Romain s'est rendu coupable d'un crime digne de
mort, on suppose que par là même il devient serf de la peine, et c'est comme
tel qu'il subit le châtiment qu'il a mérité. S'est-il refusé à servir dans
la milice, il est vendu comme serf, parce que celui qui n'a pas voulu s'exposer
au péril pour conserver sa liberté n'est point réputé libre.
S'agit-il de l'exil, une autre fiction rend encore l'inviolabilité illusoire :
on interdit au coupable le feu et l'eau dans sa patrie et on le force ainsi à
s'expatrier. La seule inviolabilité bien véritable est celle de la vie, parce
que tout citoyen mis en jugement, et tant que sa sentence n'est pas prononcée,
peut, en s'exilant lui-même, éviter une condamnation à mort. L'exil lui est
proprement un port, un asile pour se dérober au supplice.
Le droit de liberté n'est complètement respecté que dans le peuple en masse :
tout ce qui peut porter atteinte à la liberté publique est soigneusement
évité, jusque-là qu'une armée ne peut entrer dans Rome à moins d'une
autorisation expresse des comices, et que cette interdiction existe même pour
un seul citoyen, s'il est revêtu d'un commandement militaire.
La cité romaine est une chose si recherchée, qu'une foule de gens essayent de
l'usurper ; mais afin d'obvier autant que possible à ces larcins politiques,
des listes publiques sont ouvertes ou les Romains de condition libre ont droit
de se faire inscrire. Cette inscription, contrôlée par des magistrats, donne
la jouissance de tous les autres droits, elle est la constatation légale de
l'état de citoyen. C'est là ce qu'on appelle le droit de cens.
Depuis que le droit de mariage appartient aux plébéiens comme aux patriciens,
à tout le peuple en un mot, il a été soumis à certaines restrictions ;
ainsi, un citoyen romain ne doit épouser qu'une Romaine libre : il ne peut se
marier ni avec une esclaves, ni avec une affranchie, ni avec une étrangère ;
toute union avec une autre qu'une Romaine n'a aucun caractère légitime, et
n'est considérée que comme une simple cohabitation.
Il fut un temps où les alliances entre les patriciens et les plébéiens
étaient défendues; mais cette prohibition, établie par la loi des XII Tables,
ne dura guère que six ou sept ans, et fut abolie par une loi du tribun du
peuple Canuléius.
Le droit de testament consiste à pouvoir disposer de ses biens après soi ;
celui d'héritage rend apte à recueillir toute sorte de successions.
Le droit paternel, que Romulus rendit commun aux patriciens et aux plébéiens,
permettait aux pères de mettre leurs enfants en prison, de les faire battre de
verges, de les charger de fers, de les reléguer à la campagne pour y
travailler à la terre, et de leur ôter la vie quand même ils seraient
revêtus des premières charges quand même ils auraient rendu à la République
les services les plus signalés. Ce fut en vertu de cette loi que d'illustrés
personnages, haranguant sur la tribune en faveur du peuple contre le Sénat, en
ont été arrachés par leurs pères, dans le temps même qu'on applaudissait à
leurs discours, pour subir la punition à laquelle ils jugeaient à propos de
les condamner. Ils les conduisaient à travers le Forum, sans que personne pût
les arracher de leurs mains, ni consul, ni tribun, pas même le peuple, en
faveur duquel ils avaient parlé, et qui, dans toute autre occasion, ne
connaissait aucune autorité égale à la sienne.
Romulus permit encore aux pères de vendre leurs enfants comme des esclaves,
qu'ils fussent mariés ou non mariés. Numa modifia cette dernière loi en
établissant que les citoyens mariés avec le consentement de leurs parents ne
pourraient plus être vendus ; mais les autres dispositions du fondateur de
Rome, confirmées depuis par la loi des XII Tables sont encore toutes en
vigueur, jusqu'à ce terrible droit de vie et de mort, qu'un père. peut
toujours exercer, même pour punir des crimes contre l'État, et en réclamant
l'horrible privilège, de se faire l'agent de la justice publique. Ce fut comme
père, et non comme consul, que le premier Brutus fit mourir ses fils ; l'auteur
de la première loi agraire, Cassius, fut mis à mort par son père pour avoir
proposé cette loi ; et dans des temps moins éloignés, plusieurs complices de
Catilina subirent cette peine par suite de semblables con-damnations
domestiques.
Aujourd'hui, cependant, l'odieux d'une pareille justice doit être adouci par
des circonstances qui commandent d'en user, et l'opinion publique se soulève
contre ceux qui en font abus ; j'ai vu le peuple percer à coups de stylet un
chevalier romain qui avait fait périr son fils sous le fouet ; l'autorité de
l'Empereur ne put l'arracher qu'avec peine aux mains acharnées des pères et
des enfants.
Le droit paternel s'étend, sur tous les descendants, non seulement enfants,
mais petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il ne se perd que par la libre
renonciation, ou par suite d'une condamnation, soit du père, soit du fils, à
l'interdiction du feu et de l'eau, à la déportation ou à la peine de mort.
Pour les citoyens âgés de moins de vingt-cinq ans, le pouvoir paternel survit
à ses auteurs sous le nom de tutelle, au moins dans tous ses effets civils.
La tutelle est la force et l'autorité sur une tête libre pour protéger la
personne qui, à raison de son âge ou de sa légèreté d'esprit, ne peut se
défendre soi-même. Par la raison que la puissance paternelle est absolue et ne
peut se prescrire, un père a le droit de la léguer par testament à un autre
citoyen. C'est presque un devoir pour lui d'en agir ainsi, s'il a des enfants en
bas âge ; néanmoins, lorsque, par impossible, ou par tout autre motif, il n'a
rien disposé à cet égard, la tutelle des mineurs ne périclite pas, et des
tuteurs leur sont donnés soit par la majorité des tribuns du peuple, soit par
le Préteur urbain, magistrat justicier dont je parlerai plus tard. Les
personnes en tutelle sont les privilégiées de la loi, et l'usucapion,
autrement la prescription, ne prévaut jamais contre elles. Un fils de famille
majeur de vingt-cinq ans est affranchi de la tutelle par la mort de ses
ascendants directs ; il n'en est pas de même d'une fille ou d'une femme mariée
: pour elles, ainsi que je l'ai déjà dit, la tutelle est à perpétuité. Mais
la tutelle de la femme mariée est très mitigée par la manière dont est
choisi son tuteur : souvent le mari laisse par testament à sa femme non
seulement la faculté de le choisir elle-même, mais aussi d'en changer une
fois, si le premier qu'elle a pris ne lui convient pas. Certains maris vont
encore plus loin : ils ne fixent aucune limite à ce changement, de sorte que la
femme, pouvant toujours quitter un tuteur qui la gêne ou qui lui déplaît,
n'est, en réalité, sous la tutelle de personne.
Il n'y a que les gens libres qui puissent posséder légitimement, jouir du
droit de propriété. Et par libres je n'entends pas seulement ceux qui sont
nés hors des liens de l'esclavage, mais ceux qui ne dépendent de personne,
qu'aucun pouvoir domestique ne domine. Ainsi un citoyen sous la puissance
paternelle n'a pas le droit de propriété légitime, parce que sa condition
l'assimile aux esclaves pour tous les actes de la vie civile, que la propriété
qu'il acquiert est de même nature que celle acquise par les esclaves, et que
son père peut en disposer comme de la sienne propre et particulière.
Le Droit de Cité romaine est exclusif de tout autre droit de cité : le citoyen
romain est trop élevé pour pouvoir obéir à d'autres lois qu'à celles de son
pays. Il demeure libre de choisir une autre patrie s'il veut, mais en renonçant
à la première, et dès qu'il a été reçu citoyen d'une ville étrangère, il
perd sa cité romaine : il ne doit plus même porter la toge.
Ce droit ne peut cependant être enlevé à un citoyen malgré lui, aucune
puissance ne saurait l'en priver, hors les cas de condamnations judiciaires
rapportés plus haut. On a plusieurs fois tenté de le faire, et toujours
inutilement. Une des plus formidables puissances qui aient pesé sur le peuple
romain y échoua comme les autres : sur la proposition de Sylla, dictateur, les
grands Comices du peuple avaient ôté à quelques villes d'Italie le droit de
cité romaine dont elles jouissaient, et leur avaient confisqué une partie de
leur territoire. Cette dernière disposition est restée : le pouvoir du peuple
s'étendait jusque-là ; mais la première ne dura pas même autant que la
dictature de Sylla, et ce général ne put, quoique appuyé par les Comices,
ravir le droit de cité aux Volaterrans, qui avaient encore les armes à la main
contre Rome.
Quand un citoyen a perdu sa cité romaine par un cas de force majeure non
légale, telle que l'absence, suite d'un esclavage comme prisonnier de guerre,
il peut la récupérer au moyen d'un autre droit appelé de Postliminie, que
l'on conserve toujours, et qui n'est autre que le retour dans la patrie
naturelle, où l'on vient reprendre son domicile, ou même sur le territoire
d'une ville ou d'un roi allié ou ami du peuple romain. Un citoyen ne peut user
du droit de Postliminie que dans le cas où il n'a pas été banni ou déporté
juridiquement. Sont exclus aussi de ce droit, et celui qui, vaincu par les
armes, s'est rendu à l'ennemi ; et le transfuge, parce qu'il abandonna sa
patrie.
Si le peuple romain ne peut enlever à quelqu'un son droit de cité, en
revanche, il est tout puissant pour l'accorder, et il l'accorde en effet à ceux
qui lui rendent des services publics importants. Ses généraux peuvent aussi
faire un tel octroi en son nom, et jamais aucun des peuples ou des individus qui
ont ainsi reçu ce bienfait ne fut inquiété comme rie le possédant pas bien
légitimement. Il est vrai que pour constater la légitimité de la concession,
on la fait ratifier d'une manière solennelle sous la forme d'une loi votée
clans les Comices par tribus. Les noms des gratifiés sont ensuite inscrits sur
la liste des citoyens romains, tenue par le Préteur de la ville ; cette
inscription forme leur titre véritable, en cas de contestation. Les tables
censoriales n'ont point la même valeur légale ; elles prouvent seulement que
ceux qui y sont portés se donnaient alors pour citoyens romains, mais non pas
qu'ils l'étaient réellement.
L'Empereur, tout puissant dans la République, concède aussi la cité romaine,
mais il n'use de son pouvoir à cet égard qu'avec infiniment de retenue, afin
de conserver le peuple pur de tout mélange de sang étranger ou esclave.
Tibère son fils sollicitant un jour ce droit pour un Grec son client : «Je ne
vous accorderai votre demande, répondit-il, qu'autant que vous m'en aurez
démontré la justice. » Il refusa également à Livie sa femme, qui jouit
cependant d'un grand empire sur lui, le même droit pour un Gaulois tributaire ;
il offrit de le décharger de son tribut, affirmant qu'il souffrirait plus
volontiers que l'on fit perdre quelque chose au fisc, que de prodiguer le droit
de cité romaine.
La législation a veillé avec un soin extrême à maintenir la pureté du sang
romain ; ainsi, dans l'état de mariage légitime, les enfants naissent dans la
condition du père ; s'il n'y a que concubinage, ils suivent la condition de
leur mère : l'enfant d'une Romaine et d'un étranger est étranger ; celui d'un
citoyen romain et d'une Latine est Latin ; celui d'un citoyen romain et d'une
esclave est esclave.
Le Droit de Cité romaine est la faveur la plus insigne que des étrangers
puissent recevoir. Le peuple en a une si haute idée, qu'il forme à ses yeux
une sorte de royauté qui rend le citoyen romain respectable à tous les peuples
de la terre. La simple exclamation « Je suis citoyen romain ! » doit arrêter
toute persécution, tout attentat contre l'inviolabilité personnelle. C'était
le cri des victimes du fameux Verrès, qui porta la peine d'avoir, en leur
personne, attenté à la majesté romaine ; et avec ces pirates que Pompée fut
chargé de détruire, c'était encore ainsi que les citoyens capturés
réclamaient hautement la liberté qu'on leur ravissait, cherchaient à se faire
respecter et croyaient sauver leurs jours. En vérité, il n'y a qu'un très
grand peuple qui puisse avoir une pareille foi en lui-même ; je ne sais rien de
plus imposant : et cette hauteur, cette intrépidité d'orgueil que les plus
terribles périls n'abaissent jamais, doit être un des secrets de l'omnipotence
romaine.
LES PROMENADES DE LA VILLE.
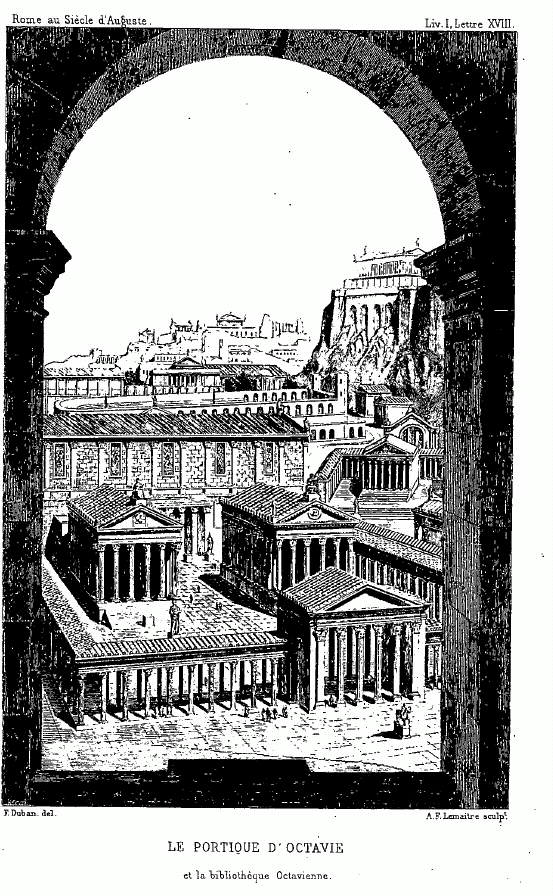
Il y a un quartier de Rome que je préfère à tous les autres, pour lequel j'ai une prédilection qui date du premier jour où je l'ai vu, c'est le Champ de Mars. J'y vais très souvent, j'y vais presque tous les jours. Mon admiration, et l'habitude générale d'aller s'y promener l'agrès-midi pendant une heure ou deux, m'y attirent constamment. Les Romains sont grands promeneurs ; ils font de la promenade un délassement et un spectacle; ils vont se promener pour voir et pour être vus : aussi, au lieu de se disséminer, de chercher les endroits les plus vastes, les plus spacieux, ils se pressent tous dans les mêmes points. La partie bâtie du Champ de Mars est leur rendez-vous ordinaire, parce qu'ils trouvent là de beaux portiques où ils se promènent à l'ombre. Il faut sentir l'ardeur du soleil comme on la sent ici, seulement quatre ou cinq heures après le lever de cet astre, pour comprendre tout le charme qu'il peut y avoir à se trouver à l'ombre. Les promenades couvertes sont d'ailleurs un besoin dans cette ville : pendant six mois, le soleil y donne la fièvre, et les pluies d'orage sont si subites et si violentes, qu'en très peu d'instants on peut être mouillé comme si l'on sortait du Tibre. Aussi depuis longtemps, les puissants courtisans du peuple romain se sont efforcés de lui bâtir de beaux portiques pour la promenade, pour l'agrément, et même d'établir, pendant les étés les plus enflammés, un ombrage temporaire sur le Forum ; César, étant dictateur, fit couvrir de voiles cette place tout entière, y compris la voie Sacrée, depuis la Regia, jusque sur le Clivus capitolin. Tout récemment, Marcellus, neveu de l'Empereur, étant édile, répéta la même magnificence pendant tout le mois de Sextilis, afin que les plaideurs fussent plus à leur aise. Mais la véritable magnificence, parce qu'elle est durable, ce sont les portiques-promenades en maçonnerie.
 |
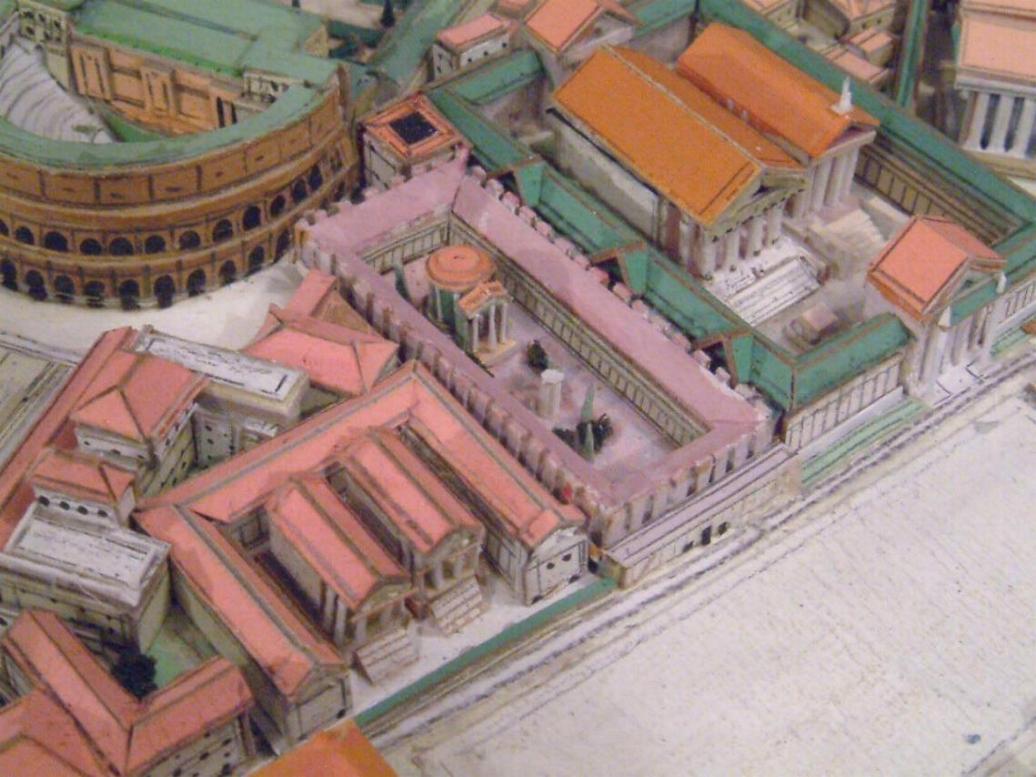 |
Voici quels sont, au Champ de Mars, ceux de ces beaux édifices offerts à
l'empressement des promeneurs. En sortant par la porte Carmentale ou la porte
Ratumène, au bas des deux extrémités du mont Capitolin, on trouve d'abord le
portique d'Octavie ; celui de Philippe, en parallèle ; un peu plus avant, celui
d'Octavius dit aussi portique Corinthien ; sur la droite, le magnifique portique
de Pompée, derrière la scène du Théâtre de Pompée ; puis, faisant corps
avec ce portique, sur son flanc septentrional, l'Hécatonstylon.
Ces cinq portiques sont les plus beaux et les plus fréquentés. Groupés dans
un même quartier, et très rapprochés, ils forment, pour ainsi dire, presque
comme une seule promenade. En second ordre, il y a encore le portique de
Minucius, devant ceux de Philippe et d'Octavie ; et les portiques du Bon
Événement plus vers le septentrion, et de Neptune ou des Argonautes, près de
la voie Flaminia.
Je ne compte ici ni les Septa Julia, qui ont plus de 1500 pieds de long, ni les
Septa Agrippiana, très longs aussi, parce qu'ils n'ont pas été bâtis
spécialement pour servir de promenades.
Je vais essayer maintenant de te donner une légère idée de la magnificence de
ces ouvrages.
Le Portique d'Octavie est un grand parallélogramme de trois cent
soixante-dix-huit pieds de long, sur deux cent soixante-dix-sept de large,
composé de quatre galeries en double colonnade à jour, de 200 colonnes
environ. Elles enveloppent deux temples dédiés l'un à Jupiter, l'autre à
Junon, situés au milieu de cette belle enceinte, et séparés par une voie de
soixante-douze pieds de large. Cette voie répond à une espèce de pronaos ou
de porche composé d'une double file de six grandes colonnes surmontées d'un
fronton, et formant l'entrée du Portique du côté du théâtre de Marcellus.
Elle aboutit, par son autre extrémité, à un autre édifice situé en dehors
des galeries, et qu'on nomme la Curie Octavienne , monument destiné aux
réunions du Sénat. Les temples de Jupiter et de Junon, ainsi que tout le
porche, sont en marbre blanc. Le toit et la partie supérieure des portiques
sont aussi du même marbre, mais les colonnes sont alternativement en granit
rose, et en marbre phrygien, blanc veiné de vert, avec des chapiteaux
corinthiens et des bases en marbre blanc. Un hémicycle, adossé à la partie
postérieure des temples, forme devant la Curie une petite place appelée
l'École des Portiques, parce qu'elle ressemble, par sa forme demi-circulaire,
à l'École d'un bain.
C'est l'Empereur qui a bâti, il y a une dizaine d'années, ce magnifique
portique auquel il a donné le nom de sa sœur Octavie. Les temples de Jupiter
et de Junon sont beaucoup plus anciens : on les doit à Métellus le
Macédonique ; mais Auguste, en les enclavant dans sa construction nouvelle,
leur a donné une plus grande splendeur. Le portique est décoré de statues, et
l'École, de superbes tableaux peints par des artistes grecs.
Le Portique bâti par Philippe, dont il porte le nom, présente à peu près la
même disposition et la même étendue. Il y a au centre un temple consacré à
Hercule Musagète.
Le Portique de Minucius est peu important ; il accompagne de grandes
constructions servant de magasins à blé. Mais celui d'Octavius, dit aussi
Portique Corinthien, mérite plus d'attention : c'est un dés plus anciens
monuments de ce genre, et le premier qui fut fait à double colonnade. Octavius,
personnage consulaire, le construisit vers la fin du sixième siècle. Il le
disposa de manière à en faire une promenade d'été et d'hiver tout à la
fois, en orientant les deux grands côtés de son monument au midi et au
septentrion, et le coupant, dans le sens de sa longueur, par un massif qui
intercepte les rayons solaires vers le septentrion, et les retient vers le midi.
Le massif est décoré de niches, de pilastres, et contient cinq salles
circulaires. Rien de mieux entendu que ce portique, l'un des plus agréables de
Rome, bien que son heureuse disposition soit maintenant en partie annulée par
le théâtre de Corn. Balbus, qu'on vient d'élever sur son côté méridional.
Les colonnes sont d'ordre corinthien, avec des chapiteaux en airain, si beaux
qu'ils ont valu au monument le surnom de Portique Corinthien.
On donne ordinairement la forme d'un carré allongé, comme la plus favorable,
aux. galeries destinées à la promenade ; c'est aussi celle du Portique de
Pompée, le plus vaste de tous en même temps que le plus agréable. Il se
développe autour d'une aire de cinq cent quatre-vingt-quinze pieds de long sur
trois cent quarante pieds de large, avec deux rangs de galerie en colonnades sur
chaque face. Une troisième galerie, également en colonnade, divise dans sa
longueur l'aire centrale, qui est très vaste, et en forme comme deux cours,
chacune ombragée par une avenue de platanes, ornée de statues d'animaux, et
rafraîchie par des fontaines jaillissantes. Des murs, dans lesquels on trouve
de place en place de petits renfoncements, tantôt quadrangulaires, tantôt
demi-circulaires, ferment les galeries de ceinture. Ils sont garnis de bancs où
les promeneurs fatigués jouissent, en se reposant, du spectacle toujours animé
et changeant que présente la promenade. Quand je suis seul, j'aime à me placer
en observateur dans un de ces réduits, plus encore qu'à circuler en me
promenant. Les parties droites de cette clôture sont enrichies de tableaux des
plus fameux peintres de la Grèce. Des voiles en étoffes attaliques, tissus de
laine peints à l'aiguille et brochés d'or, se tirent à volonté dans les
entrecolonnements pour garantir les promeneurs des feux du soleil. Toutes les
colonnes, au nombre de plus de trois cents, sont en granit rose.
Ce portique déjà si grand est mitoyen avec l'Hécatonstylon, galerie étroite
et longue, qui en fait presque partie, et n'a pas moins de cent colonnes, ainsi
que l'indique son nom d'Hécatonstylon.
La première fois que j'allai au Portique de Pompée, je voulus voir la Curie
Pompéia, qui y tient du côté du midi, et dans laquelle César tomba sous les
coups des assassins ; mais ma curiosité fut trompée, car depuis ce meurtre, la
porte en a été murée, comme pour condamner à l'oubli ce lieu funeste.
Le Portique du Bon Événement et celui de Neptune ou des Argonautes sont encore
autour de temples, comme celui de Philippe. Ils se trouvent situés à peu près
sur la lisière de la partie bâtie du Champ de Mars, de sorte qu'on peut faire
le tour de ce quartier en passant d'un portique à l'autre, et franchissant
seulement de petits intervalles : du portique d'Octavie on passe au portique de
Philippe ; de celui-ci au portique Corinthien ; du portique Corinthien au
portique de Pompée et à l'Hécatonstylon ; puis, longeant, les Jardins
d'Agrippa, au portique du Bon Événement ; de là enfin, après avoir traversé
la place du Panthéon, au portique de Neptune. En ne comptant que l'espace
parcouru sous les galeries, on peut faire ainsi une promenade de deux milles
environ.
Presque en face du portique de Neptune, de l'autre côté de la voie Lata,
Agrippa a commencé, sous le nom de Pola sa soeur, un nouveau Portique, qui
allongera encore cette merveilleuse promenade, sans en déranger la symétrie
presque circulaire.
Ces galeries, vraiment dignes de la majesté romaine, et qui sont toutes pavées
en beaux marbres de couleur ou en granit, deviennent des lieux d'intrigues, à
l'heure de la promenade, à cause de l'affluence de promeneurs et de promeneuses
qui s'y portent. Un homme recherche-t-il l'affection d' une femme, il commence
par s'informer des Portiques qu'elle fréquente, et il l'y suit assidûment. Les
amants sont-ils déjà d'accord, c'est aux Portiques qu'ils viennent se
rencontrer : tous accourent dans ces beaux endroits pour y briller, pour y faire
assaut d'élégance et de grâces. Les petites ruses de l'amour ou de la
jalousie ; les manèges de la coquetterie la plus ingénieuse, la plus timide,
et quelquefois aussi la moins déguisée, sont constamment mises en oeuvre. Là,
c'est une femme qui, dans sa démarche, dessine les contours d'une taille
élégante ; qui, pour montrer une peau blanche comme la neige, permet au
zéphire de se jouer dans sa tunique, de découvrir de temps en temps son
épaule et une partie de son bras. Plus loin, une autre, vêtue de manière à
laisser entrevoir une poitrine d'albâtre, s'avance entourée de servantes
vieilles ou laides, ou d'une blonde, si elle-même est brune. Ce cortège parait
tout naturel, car les femmes ne sortent jamais seules, et se font accompagner
assez volontiers par des esclaves ou des affranchies qui les ont allaitées dans
leur enfance. D'un autre côté, c'est un jeune homme qui se presse sur les pas
d'une dame jusqu'alors insensible à son amour : tantôt il la devance pour
attirer ses regards ; tantôt il quitte la file des promeneurs, qui marche
toujours lentement, et vient la reprendre auprès d'elle. Cette petite manoeuvre
est d'autant plus facile, que les galeries des Portiques sont fort larges ; par
exemple, au Portique d'Octavie, neuf ou dix personnes circulent de front ; au
Portique de Pompée, dix-huit personnes dans les galeries de ceinture, et
vingt-trois dans les trois galeries centrales.
Les femmes qui, dans les promenades, se font remarquer par leurs agaceries sont
des courtisanes ; les matrones, plus sages ou plus retenues, ne viennent aux
Portiques que pour le plaisir de la promenade. A l'exception de la figure, elles
sont presque invisibles : une longue Stole leur descend jusque sur les pieds,
chaussés du soccus de peau blanche, qui les couvre entièrement et en outre une
Palla, ample manteau qui est la toge des femmes, les enveloppe et ne permet
point de voir leur taille, leur cache même une partie de la tête, car jamais
elles ne se montrent en public tête nue. Une troupe de gardiens et de femmes
les suit et les entoure, de manière à empêcher la foule d'approcher d'elles.
C'est tout au plus si dans les gestes multipliés dont les personnes de leur
sexe accompagnent toujours la conversation, elles se permettent l'innocente
coquetterie de montrer une jolie main, de laisser voir des doigts gracieux,
brillants d'ongles rosés.
La plupart des femmes portent des voiles qui leur cachent à moitié le visage,
moins pour se conformer à l'ancienne coutume qui défendait aux Romaines de
sortir la figure découverte, que pour irriter la curiosité, et prêter à leur
beauté le charme d'un demi-mystère. Beaucoup, par une recherche toute
voluptueuse, tiennent dans les mains, pour se les entretenir fraîches, des
boules soit de cristal, espèce de glace naturelle infusible, soit d'ambre
jaune, matière qui donne d'abord une fraîcheur douce, remplacée par un parfum
des plus suaves quand elle et échauffée. Il y en a qui s'enlacent autour du
col des petits serpents privés, qu'elles laissent flotter sur leur sein comme
des colliers, pour se rafraîchir par le contact de ces animaux à sang glacial.
C'est encore aux Portiques, et particulièrement à celui de Pompée,
affectionné par la plus brillante société de la ville, qu'il faut se rendre
pour rencontrer des hommes non moins curieux de leur parure et de leur beauté
que des femmes. On les appelle des Beaux. Vous reconnaissez un Beau à ses
doigts ornés de bagues ; presque toutes les articulations en sont chargées ;
il y en a quelquefois six à chaque doigt, et au plus long doigt, ils dépassent
la première phalange. En hiver, ces anneaux ont relativement un grand poids
(certains pèsent jusqu'à une once), en été, ils sont d'une extrême
légèreté. Vous reconnaissez encore un Beau à ses mains, à ses bras et à
ses jambes polis à la pierre ponce, et dont pas un seul poil n'altère la
blancheur ; à sa chevelure soigneusement peignée, et parfumée de nard, de
baume ou de cinnamome ; à son menton imberbe, ou couvert d'une barbe touffue,
à la longueur de sa tunique et aux manches qui descendent jusque sur ses mains
; enfin à l'éclat de la pourpre et à la finesse du tissu de sa toge,
remarquable. par son ampleur exagérée. Quelquefois il se drape dans une
lacerna brune, vêtement militaire qu'un reste d'habitude des guerres civiles a
mis en usage. Enfin un Beau considéré dans sa parure est, suivant l'expression
romaine, « un homme fait à l'ongle, » c'est-à-dire parfait.
Barrus est le type de cette espèce : dès qu'il paraît, les regards des jeunes
filles se dirigent sur lui. Barrus parle d'un ton mol et languissant, grasseye
en parlant, et affecte de ne pas prononcer toutes les syllabes, exagération
d'un usage qui permet de retrancher les lettres dures de certains mots, par
exemple, de dire apè midi pour « après midi. » Aussi à son aise en public
que chez lui, il fredonne les voluptueuses chansons de Cadix et du Nil. Ses
gestes semblent réglés par la musique. Assis et désoeuvré pendant tout le
jour au milieu d'un cercle de femmes, il a toujours quelques mots à leur dire
à l'oreille. Il reçoit, il écrit, il expédie de tous côtés de tendres
missives. Il court les soupers, et récite de mémoire la généalogie des plus
fameux coursiers du Cirque. Barrus a toujours une chaussure dont la peau lui
serre bien le pied. Il change plusieurs fois de laticlave dans la même
journée, et se croirait presque déshonoré si sa toge n'était pas bien
lustrée par le foulon. Jamais il ne sort sans l'avoir arrangée devant un
miroir, sans en avoir drapé largement le sinus, partie croisant sur la
poitrine, et chaque soir ce précieux manteau est remis en presse pour lui
conserver des plis si savamment étudiés.
Dehors, il évite avec soin le coude importun des passants. Un jour ayant eu la
structure laborieuse de sa toge dérangée par quelqu'un qui le heurta dans un
passage étroit, il en fut si irrité qu'il lui intenta une action d'injure.
On donne encore un autre nom aux Beaux, on les appelle Trossules de
Trossula, ville d'Étrurie que les chevaliers romains, lorsqu'ils servaient dans
les légions, emportèrent d'assaut sans le secours de l'infanterie, ce qui leur
valut le glorieux surnom de Trossules. Tant qu'ils n'abandonnèrent point la
milice, cette dénomination leur fut appliquée dans ce sens ; mais dès que
quantité de chevaliers vieillirent à Rome sans voir les armées, on ne prit
plus l'expression que dans un sens ironique, comme une contre-vérité, et c'est
ainsi qu'on l'emploie toujours maintenant.
Ces chevaliers Trossules ne sont pas moins ridicules que les Beaux : Rufus se
farde, et marche gravement à pas mesurés, afin d'étaler sa beauté comme un
paon qui fait la roue. Cotilus, au contraire, guindé dans sa démarche, se
promène sur la pointe des orteils, afin de se donner une taille avantageuse.
Mécène (le ministre de l'Empereur) ne se montre qu'avec un Pallium, petit
manteau grec qu'il ramène sur sa tête, jusqu'aux oreilles, pour cacher la
calvitie presque complète qui l'afflige.
A peine habillé, en tunique traînante et sans ceinture, comme tous les
efféminés ou les débauchés (on ne quitte jamais la ceinture que chez soi, et
l'on dit d'un homme énergique qu'il se ceint haut, il se fait accompagner
partout de deux eunuques, assurément plus hommes que lui, et cherche à attirer
les regards.
Sabellus se montre avec une barbe coupée par parties : la lèvre supérieure
rasée, et tout le reste dans l'état naturel. Ses habits sont d'une couleur
bizarre, et il porte une toge transparente. Qu'on le ridiculise, qu'on le
blâme, Sabellus sera content si on le regarde.
Malgré la liberté qui règne ici, les rangs ne s'y confondent jamais en
public, et l'on ne voit guère que les classes privilégiées aux belles
promenades des Portiques ; la plèbe n'y vient pas, soit par cette sorte de
propension que l'individu a de n'aller qu'où vont ses semblables, soit
peut-être que quelque édit lui en défende l'accès.
Le Champ de Mars est le rendez-vous général des promeneurs à pied ; les
promeneurs à cheval, en char ou en litière, vont sur la voie Appia, en dehors
de la porte Capène. Ce lieu situé au midi de la ville est séparé du Champ de
Mars par la onzième région. On traverse le quartier des Vélabres, tout le
Cirque Maxime, et, à deux ou trois cents pas de ce monument, on trouve la porte
Capène qui débouche immédiatement sur la voie Appia. C'est là, sur cette
belle route, que les Trossules viennent montrer leurs brillants équipages
attelés de mules luisantes d'embonpoint, bien appareillées pour la taille
ainsi que pour la couleur, parées de riches housses de pourpre et de harnais
couverts d'o r; leurs voitures garnies de tapis précieux, ornées d'ivoire,
d'airain, quelquefois même d'argent ciselé, et dont les noms sont aussi
variés que les formes : ce sont des Petorrita, chars à quatre roues, et
à deux chevaux, imités de ceux de notre pays ; des Cisia, équipages
légers auxquels cependant on attelle trois mules ; des Covini, voitures
entièrement couvertes, que l'on conduit soi-même ; des Rhedae, autres
chars à quatre roues, où l'on tient deux personnes ; des Carruccae,
voitures élevées ; des Esseda, chars légers, des Vehicula ;
d'autres encore dont j'ignore les noms, et qui presque toutes sont dirigées par
un conducteur à face noire. Les plus belles voitures sont attelées de quatre
chevaux.
Beaucoup de ces beaux promeneurs sont si fiers de leurs équipages, que prenant
la place de leur esclave, ils les conduisent eux-mêmes en grandes guides, et le
fouet à la main, se montrent ainsi comme dans le char de triomphe de leur
vanité ; ils regardent à droite et à gauche si on les admire, et dès qu'ils
aperçoivent une simple connaissance, se signalent à son attention en
s'empressant de la saluer par un mouvement abaissé de leur fouet .
La plupart se font précéder par une troupe de cavaliers numides ou libyens,
qui soulèvent des flots de poussière, et font écarter brutalement la foule
sur leur passage. On croirait qu'ils courent à quelque affaire pressée, ou
qu'ils volent à la conquête d'une province. Les plus modestes se contentent de
lancer devant leurs chars rapides un seul coureur à tunique courte, ou bien
quelques gros chiens molosses parés de colliers.
Les élégants qui se montrent en litière sont élevés sur les épaules de six
et huit lecticaires ou porteurs de haute taille, qu'ils appellent Calones,
noms de certains esclaves qui, dans les armées, servent les officiers et les
soldats. Les Trossules sont bien aises de se donner ainsi quelque air militaire
: les uns ont leurs Numides, cavalerie africaine renommée ; les autres, leurs Calones,
comme s'ils étaient tribuns des soldats, ou tout au moins centurions. Ils
habillent ces esclaves, cavaliers ou porteurs, de magnifiques Penulae de
laine blanche ou rousse, espèce de tunique fermée de toutes parts. C'est un
habit porté par les citoyens en voyage, et les Trossules ne craignent pas de le
prostituer à des esclaves. Rien ne leur coûte pour flatter leur vanité : ces
magnifiques marcheraient volontiers sur la face de leurs concitoyens.
Les femmes viennent également embellir cette promenade ; mais les conditions
sont fort mêlées ; il n'est pas rare d'y rencontrer des femmes galantes, des
courtisanes, qui dans tout l'éclat de la jeunesse ou de la beauté, et
couchées à demi sur une litière découverte, ou montées sur des chars garnis
de soie, dont elles-mêmes, penchées sur le timon, dirigent les rapides
coursiers, semblent conduire en triomphe l'amant qu'elles sont en train de
ruiner. On ne se douterait pas en voyant de pareilles scènes, qu'il existait
jadis une loi qui défendait aux femmes de se servir de chars, quand elles ne
s'éloignaient pas à plus d'un mille de la ville, à moins que ce ne fût pour
aller à un sacrifice ; ni qu'il y a moins de quarante ans, Jules César,
Dictateur, interdit les litières à celles qui n'étaient pas mariées ou
n'avaient pas d'enfants, à moins qu'elles ne fussent âgées de quarante-cinq
ans.
L'équipage des Matrones a quelque chose de plus majestueux, et, sans faire
autant de fracas, annonce cependant le train d'une grande maison. Une matrone se
fait promener soit dans un Carpentum, char à deux roues dont les femmes
de son rang ont seules droit de se servir ; ou bien dans une chaise découverte,
où elle est étendue, le corps un peu relevé sur le bras gauche qui foule un
coussin de soie rempli du plus moelleux duvet. Dans le cortège qui
l'accompagne, il y a deux esclaves qui ne quittent pas ses côtés : l'une, la
suivante, porte une ombrelle ronde de toiles tendues sur de légers bâtons, à
l'extrémité d'un long roseau des Indes ; au moindre signe, elle dirige sur sa
maîtresse l'ombre du mobile abri. La seconde, la porteuse d'éventail, tient
une espèce de palme en plumes de paon, qu'elle agite devant la dame, afin de
lui procurer de la fraîcheur et d'écarter les mouches importunes. Quatre
coureurs noirs, indiens ou africains, précèdent la litière. Un tissu de la
toile la plus fine et la plus blanche d'Égypte leur entoure les reins. Deux
esclaves blancs, ordinairement des Liburniens, marchent derrière la chaise,
tout prêts, quand elle s'arrête, à placer de chaque côté un petit
marchepied, afin que la dame n'ait pas même besoin de faire un signe pour
indiquer de quel côté elle veut descendre. Quelquefois c'est un ami de la dame
qui tient son ombrelle.
L'éclat de ce tableau si animé est encore augmenté par les départs ou les
arrivées des gouverneurs de provinces, souvent en habit militaire. La voie
Appia aboutissant à Brindes, point de communication avec la Sicile, la Grèce
et beaucoup de pays d'outre-mer , est très fréquentée par ces nobles
envoyés. Une nombreuse suite les accompagne, et se trouve grossie par la foule
des citoyens accourus au-devant d'eux s'ils rentrent à Rome, ou sortis pour les
conduire à quelque distance s'ils partent. Les licteurs marchent en avant de
ces groupes. Cependant, excepté cette espèce de voyageurs ou de promeneurs, il
ne faudrait pas juger par l'apparence de tous ceux qui brillent sur la voie
Appia : on risquerait fort de se tromper ; souvent les personnages qui font le
plus de bruit, étalent le luxe le plus élégant ou le plus insolent, sont de
misérables affranchis tout cicatrisés de coups, et dont l'opulence est un
scandale public.
Hier je fus témoin de la mésaventure d'un de ces beaux promeneurs : il avait
un équipage presque royal ; sa main brillait de l'éclat d'une sardoine ; rien
n'égalait la blancheur de sa toge, et par-dessus, il portait une lacerna,
espèce de manteau s'agrafant sur l'épaule gauche et qui était en pourpre
tyrienne. Les plus suaves parfums embaumaient sa chevelure ; ses bras étaient
soigneusement polis et épilés ; sa haute chaussure était ornée d'un
croissant, comme celle des sénateurs, et une forme couleur d'écarlate
enveloppait son pied. Enfin, pour compléter sa parure, il avait collé sur son
visage de petites mouches, avec lesquelles les élégants croient ajouter à la
grâce de leur figure. Quelques-unes lui tombèrent du front : que vit-on ? le
honteux stigmate dont on marque les esclaves fugitifs !
J'ai dit en commençant que les Romains font de la promenade un délassement et
un spectacle ; les plus graves en font aussi une affaire. Dans cette ville où
l'on ne peut être quelque chose qu'à force de se mettre en avant, qu'en
ouvrant sa maison à tout le monde, qu'en descendant tous les jours au Forum, la
promenade devient le complément et l'auxiliaire de cette vie de fracas,
d'importance et de brigue. Un homme qu'on ne verrait pas dans les endroits de
délassement où se rend toute fa société, serait à demi oublié : une partie
de la ville ignorerait qu'il existe, car les femmes ne vont ni aux salutations,
ni au Forum, et cependant elles n'en jouissent pas moins d'une très grande
influence. Il faut donc que le citoyen politique, si je puis ainsi parler, se
montre dans ces lieux d'oisiveté, pour lui lieux d'affaires, parce qu'en s'y
promenant il pratique, de fait, une sorte de petite candidature générale
auprès des oisifs et des futiles, partie notable, de ce peuple, sans lequel on
n'arrive à rien. Les promenades sont un terrain neutre, où, par la raison
qu'on y rencontre toute la ville, on peut, sous les apparences de simples
politesses, préparer de sérieuses candidatures, habituer tout le monde à soi,
et soi à tout le monde. Le temps que beaucoup d'hommes sérieux paraissent y
perdre est donc mieux employé qu'on ne croirait.
Il m'a fallu bien des petites observations, bien des révélations indiscrètes
ou malignes de mes amis avant que je sois arrivé à comprendre cela. Mamurra me
racontait un jour que dans la campagne qu'il fit en Espagne avec César, des
Vettons, nation voisine de la Celtibérie, étant venus pour la première fois
au camp des Romains, et voyant des tribuns qui allaient et revenaient sur leurs
pas pour le plaisir de la promenade, les prirent pour des insensés, et
offrirent de les reconduire à leurs tentes. En vérité, avant de connaître
les moeurs romaines, j'aurais volontiers fait comme les Vettons, car j'avais
comme eux quelque peine à m'imaginer que, dès qu'il ne s'agissait plus de
combattre, on pouvait mieux faire que de rester en repos.