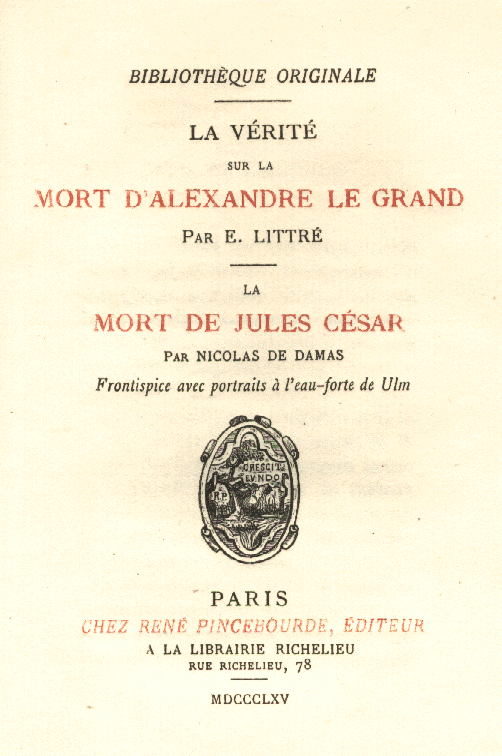La mort de César
Nicolas de Damas
Avertissement
Avant la découverte, faite il a peu
d’années[i],
du fragment de la Vie d’Auguste, par Nicolas de Damas, dont nous
réimprimons une traduction remarquable[ii],
les savants étaient indécis sur la nature de cette composition
littéraire.
Hugo Grotius, d’après le seul passage de ce livre connu de son temps,
relatif à l’éducation d’Auguste, avait conjecturé que c’était un roman,
l’utopie du tyran, si l’on veut, et son hypothèse a été reprise et
défendue de notre temps par M. Egger, qui a cru pouvoir rapprocher cette
production perdue de la Cyropédie de Xénophon[iii].
Grotius et M. Egger se trompaient. La Vie
de César est un livre d’histoire, ainsi que l’abbé Sevin l’avait affirmé
pour de bonnes raisons, et, on peut le dire aujourd’hui, un livre dont
la perte est regrettable entre toutes.
Nicolas de Damas se montre, dans le long
fragment naguère retrouvé, non seulement narrateur excellent, mais
encore et surtout moraliste d’une remarquable perspicacité. Au travers
les écrivains de l’antiquité qui l’ont copié, il a excité l’esprit de
Montesquieu. Peut-être même a-t-il cet avantage sur les historiens
philosophes anciens ou modernes qui se sont rencontrés avec lui dans
leurs réflexions sur les événements dont il a parlé avant eux, qu’il est
sans affectation et sans insistance dans ses jugements, comme un homme
qui, pensant de première nain, n’a pas à s’efforcer de paraître penser
avec plus de profondeur que personne, et se contente de le faire avec
justesse.
La mort de César n’entre que pour un tiers
dans ce fragment devenu presque célèbre, et encore à titre d’événement
rétrospectif.
On y voit d’abord Octave quitter Apollonie
à la nouvelle de l’assassinat de son grand-oncle ; il débarque en
Calabre ; on le suit clans ses étapes jusqu’à Rome, en passant par
Lupies et Brundusium.
Le récit de la conspiration contre le
dictateur perpétuel de la république vient ensuite ; après lequel
l’historien, raconte les premiers démêlés entre Octave et Antoine.
Nicolas de Damas, quant à l’action dont la
postérité se plaît à faire honneur surtout à Brutus et à Cassius,
n’ajoute que fort peu à Velleius Paterculus, Plutarque, Suétone, Dion
Cassius et Appien, et se trouve rarement en contradiction avec eux ;
mais il a su présenter les faits essentiels son récit avec plus d’ordre
et plus d’art qu’aucun de ces écrivains. Sa Mort de César est,
comme on l’a déjà dit, la page d’histoire sinon la plus complète, du
moins la plus approchant de la perfection littéraire, que l’antiquité
nous ait laissée sur un événement impérieusement mémorable ; c’est celle
qui nous fait le mieux assister.
Il ne reste presque rien de Nicolas, et il
avait beaucoup écrit. Homme politique, diplomate, secrétaire et
conseiller d’Hérode le Grand, mêlé aux complications extérieures et
domestiques d’un règne agité, chargé de missions publiques et
confidentielles, il trouvait le temps de s’exercer assidûment à des
travaux littéraires. Outre la Vie d’Auguste, œuvre de sa
vieillesse, on cite de lui une Vie d’Hérode ; une Histoire universelle,
compilation énorme, divisée en cent quarante-quatre livres, une Histoire
d’Assyrie ; un Recueil des coutumes singulières en usage chez différents
peuples ; de nombreux traités de philosophie, et des Mémoires personnels[iv].
Sa biographie est plus connue que ses
ouvrages. L’abbé Sevin en a réuni au XVIIIe siècle les éléments[v],
depuis rectifiés et complétés par M. Müller[vi].
La voici en abrégé.
Nicolas de Damas naquit l’an 64 avant
J.-C. Son père Antipater tenait à Damas un rang distingué et fut
plusieurs fois chargé par ses concitoyens de fonctions diplomatiques.
Nicolas, dans sa jeunesse, étudia la
grammaire, la poétique, les mathématiques et la philosophie. Il composa
des comédies dont les titres sont perdus ; Stobée nous a conservé un
fragment de cinquante vers de l’une d’elles. En philosophie, il tenait
pour Aristote.
Sa liaison avec Hérode le Grand, dont il
devint le secrétaire et l’ami, semble dater de l’année où celui-ci,
préfet de Galilée, accusé par les Juifs, se réfugia à Damas, sur les
conseils d’Hyrcan.
L’an 20 avant J.-C., Nicolas se trouvait à
Antioche, où il rencontra les envoyés des Indes à Auguste.
Quatre ans après, il accompagna Hérode
dans le Pont, et ensuite à Rome. Il paraît avant ce voyage avoir
entretenu une correspondance avec Auguste, auquel il envoyait des dattes
de la vallée de Jéricho. Auguste leur avait donné gracieusement le
surnom de l’expéditeur.
Il retourna à Rome, en l’an 8 avant J.-C.,
pour combattre la mauvaise impression que les plaintes de Syllæus contre
Hérode avaient faite sur l’esprit de l’empereur.
On lui a reproché de ne pas s’être opposé
assez énergiquement au supplice des deux fils légitimes d’Hérode,
Alexandre et Aristobule, que leur père fit condamner par l’assemblée de
Béryte pour conspiration contre sa vie. Toujours est-il que Nicolas, qui
avait rejoint à Tyr, peu de jours après le jugement, ce maître ombrageux
et violent, lui conseilla de ne rien précipiter dans un cas aussi grave.
Antipater, fils d’une concubine d’Hérode,
et auteur du complot pour lequel Alexandre et Aristobule avaient été
condamnés, quoique innocents, fut mis à mort dans sa prison, à la suite
d’un discours de Nicolas contre lui.
Nicolas fit son troisième et dernier
voyage à Rome, à l’âge de soixante ans, pour défendre devant Auguste le
testament d’Hérode en faveur d’Archelaüs contre les prétentions
d’Antipas et des députés juifs. Il réussit à le faire maintenir.
On conjecture qu’il ne revint pas en
Judée, et qu’il passa la fin de sa vie soit à Rome, soit à Apollonie.
Plutarque a laissé de notre auteur, dans
les Symposiaques, un portrait physique assez peu agréable : « Il
avait le visage rougeaud, et sa taille était élevée et mince. » Autant
dire que son teint était en contradiction avec son élégance corporelle.
En revanche, Nicolas a laissé de lui-même,
dans un fragment de ses Mémoires cité par Constantin Porphyrogénète, un
portrait moral vraiment aimable. On y voit qu’il était simple, frugal,
sans souci des richesses. Il savait au besoin représenter, mais il
aimait par-dessus tout la liberté et la familiarité dans les rapports
sociaux, ce qui lui fit souvent reprocher ses habitudes avec des gens du
commun. L’esprit de justice et d’impartialité était la règle de sa
conduite.
Il se trouve que Nicolas a presque tracé
d’après lui-même le portrait du philosophe homme d’esprit.
La mort de César
Depuis trois mois le jeune César, qui
avait quitté Rome, séjournait à Apollonie[vii].
Objet d’émulation pour ses compagnons et ses amis, il était admiré de
tous les citoyens de la ville ; ses maîtres en faisaient le plus grand
éloge. Le quatrième mais, sa mère lui envoya un affranchi qui, plein de
trouble et de tristesse, lui remit une lettre. Elle lui annonçait que
César venait d’être tué dans le sénat par Cassius et Brutus et par leurs
complices. Sa mère l’invitait à revenir dans sa patrie, ne pouvant,
disait-elle, prévoir l’avenir. Elle l’exhortait à se montrer homme par
la pensée et par l’action, tout en se laissant guider par la fortune et
les circonstances.
Voilà ce que contenait la lettre de sa
mère. L’affranchi qui l’avait apportée lui donna les mêmes nouvelles, et
ajouta qu’aussitôt après l’assassinat de César il était parti sans
s’arrêter nulle part, afin qu’instruit au plus vite, sers jeune maître
fût à même de prendre un parti. Il lui dit que le danger était grand
pour les parents de la victime, et qu’il fallait tout d’abord songer à
l’éviter ; car le parti des meurtriers, qui était très considérable, ne
manquerait pas sans doute de persécuter et de mettre à mort tous ceux
qui tenaient à César.
Cette lettre, que le jeune homme et ses
amis reçurent au moment de se mettre à table, les plongea dans une
profonde consternation.
Aussitôt cette nouvelle transpire au
dehors et parcourt toute la ville. Sans rien savoir de certain, on
pressentait quelque grand malheur. Aussi, quoique la soirée fût avancée,
la plupart des principaux citoyens d’Apollonie sortirent avec des
torches, afin, par intérêt pour le jeune César, de s’informer de ce
qu’on venait de lui annoncer. César, après avoir consulté ses amis,
jugea propos d’en instruire les plus notables parmi les citoyens de la
ville r mais de congédier la multitude. Ce ne fut pas cependant sans
peine que les chefs purent persuader au peuple de se retirer. Mais
enfin, bien avant dans la nuit, César eut le temps de délibérer avec ses
amis sur ce qu’il avait à faire et sur les moyens à prendre.
Après mille considérations, quelques-uns
d’entre eux lui conseillèrent de se rendre erg macédoine, au milieu de
l’armée destinée marcher contre les Parthes sous le commandement de
Marcus Emilius, et de rentrer à Rome sous la protection de cette armée
pour tirer vengeance des meurtriers. Sans doute, disaient-ils, les
soldats si dévoués à César seront irrités contre ses assassins, et ce
sentiment s’ajoutera l’intérêt qu’éprouvera l’armée à la vue du fils de
César, Mais ce parti semblait être trop difficile pour un homme encore
tout jeune, et exiger une expérience au-dessus de son âge. D’ailleurs,
il ne pouvait pas connaître encore les dispositions du peuple en sa
faveur, tandis que ses ennemis étaient menaçants et en grand nombre.
Cette proposition fut donc rejetée. Ors espérait que la mort de César
serait vengée par tous ceux qui, de son vivant, avaient partagé sa
fortune, par ceux qu’il avait poussés aux honneurs et aux richesses, et
qu’il avait comblés de plus de bienfaits qu’ils n’en avaient pu espérer
même dans leurs rêves.
Chacun donnant un avis différent, comme il
arrive dans les cas subits et imprévus, César pensa que le mieux faire,
pour prendre une résolution, serait d’attendre qu’il pût consulter des
amis dont l’e et la prudence lut serviraient de guide. Pour le moment,
s’abstenant de tonte entreprise, il crut devoir se rendre tranquillement
Rome, mais s’informer d’abord en traversant l’Italie des événements
survenus après la mort de César, et se concerter avec les amis qu’il
rencontrerait.
On se disposa donc pour mettre à la voile.
S’excusant sur son âge et sa faible santé, Apollodore se retira Pergame,
sa patrie.
Les habitants d’Apollonie, s’étant réunis
erg grand nombre, supplièrent d’abord César, par attachement pour lui,
de rester avec eux. Ils mettaient leur ville entièrement à sa
disposition, autant par piété pour la mémoire du grand César, que par
amour gour son fils : car, menacé par une foule d’ennemis, il valait
mieux, disaient-ils, qu’il attendit l’avenir dans une ville dévouée.
Mais César, qui voulait être sur le théâtre des événements pour mieux
épier l’occasion, loin de changer d’opinion, soutint au contraire qu’il
fallait partir. Pour le moment il remercia, en termes polis, les
habitants d’Apollonie ; mais plus tard, arrivé au souverain pouvoir, il
leur accorda la liberté, l’exemption des impôts, et plusieurs autres
avantages qui firent de cette ville unie des plus heureuses de l’empire.
Lorsqu’il fallut la quitter, le peuple
l’accompagna les larmes aux yeux, pénétré d’admiration pour la sagesse
et la modestie dont il avait fait preuve pendant son séjour à Apollonie,
et touché en même temps de son infortune. Un grand nombre de cavaliers
et de fantassins se rendirent auprès de lui. Con vit encore se presser,
pour lui faire leur cour, une foule innombrable et quelques individus
amenés par leurs propres intérêts. Tous l’engageaient à recourir aux
armes, lui offrant leurs services, et promettant d’attirer dans son
parti d’autres personnes disposées à venger la mort de César. il les
remercia en leur disant que pour le moment il n’avait besoin d’aucun
secours ; mais il les pria de se tenir pats, et de répondre avec
empressement au premier appel qu’il leur ferait pour punir les
meurtriers : ils y consentirent.
César partit alors avec sa suite sur les
premiers vaisseaux qu’il trouva dans le port. L’hiver n’étant pas
entièrement fini, la navigation était dangereuse. César cependant
réussit travers la mer ionienne, non sans péril, et gagna la pointe la
plus proche de la Calabre ; là les habitants n’avaient encore reçu
aucune nouvelle certaine de la révolution survenue à Rome.
Du lieu où il avait débarqué, il se rendit
par terre à Lupies, où il rencontra des personnes qui avaient assisté
aux funérailles de César. Elles lui annoncèrent entre autres choses que
Césars dans son testament[viii],
l’avait adopté pour ils et pour héritier des trois quarts de sa fortune
; que pour le reste il en avait disposé en faveur d’autres, en léguant
au peuple soixante-quinze drachmes par tête ; qu’il avait chargé Atia,
mère de son fils adoptif, du sont de ses funérailles ; et qu’enfin le
peuple avait M user de force pour brûler son corps au milieu du’ forum
et lui rendre les derniers honneurs. Elles l’informèrent en outre que
les meurtriers complices de Brutus et Cassius s’étaient établis au
Capitole et appelaient à eux les esclaves, en leur promettant la
liberté. D’après leur récit, le premier et le second jour, les amis de
César étant encore sous le coup de la terreur, bien des gens s’étaient
rangés du coté des meurtriers. Mais lorsque, des champs voisins où César
les avait établis en les imposant aux villes, les colons furent accourus
en grand nombre auprès de Lépide, maître de la cavalerie, et d’Antoine,
collègue de César au consulat, qui promettaient tous deux de venger sa
mort, la plupart de ceux qui s’étaient joints aux meurtriers s’étaient
dispersé. Alors, lui dirent-ils, les conjurés, abandonnés de leurs
compagnons, avaient réuni quelques gladiateurs et tous ceux qui, bien
qu’étrangers à la conspiration, portaient César une haine implacable.
Peu de temps après ils étaient même tous descendus du Capitole, sur la
garantie d’Antoine, qui, malgré les forces considérables dont il
disposait alors, renonçait pour le moment à poursuivre les auteurs du
crime. C’est ainsi qu’ils purent se sauver de Rome, et se rendre en
toute sûreté à Antium. Du reste, le peuple avait assiégé leurs demeures
; aucun chef ne le dirigeait : seulement le meurtre de César, qu’il
adorait, l’avait rempli d’indignation, surtout lorsqu’il vit, à la
cérémonie funèbre, sa robe ensanglantée, et son corps portant les traces
récentes des coups dont il avait été percé. C’est alors qu’employant la
violence, il lui avait rendu les derniers honneurs au milieu du forum.
A ce récit, le jeune César, ému de
tendresse et de pitié pour la mémoire de ce grand homme, versa des
larmes et sentit renaître sa douleur. Enfin, s’étant calmé, il attendit
impatiemment d’autres lettres de sa mère et des amis qu’il avait à Rome,
bien qu’il n’eût aucune méfiance pour ceux qui lui avaient donné ces
nouvelles. Il ne voyait pas en effet pourquoi ils lui en auraient
imposé.
Il partit ensuite pour Brundusium, après
s’être assuré qu’il n’y rencontrerait pas d’ennemis. D’abord, dans le
doute où il était que la ville ne fût occupée déjà par ses adversaires,
il avait évité de s’y rendre directement par mer.
Il reçut alors une lettre d’Atia, qui le
suppliait instamment de venir à Rome, où le réclamaient les vœux de sa
mère et de toute sa famille ; car on craignait qu’en restant hors de
Rome l’adoption de César ne l’exposât aux coups de ses ennemis. Du
reste, les nouvelles qu’Atia lui donnait ne différaient pas de celles
qu’il avait déjà reçues. Elle lui disait aussi que tout le peuple,
indigné du méfait de Brutus et de Cassius, s’était soulevé contre eux.
Son beau-père Philippe lui écrivit en même temps pour le prier de ne
point accepter l’héritage de César et de se garder même d’en prendre le
nom, en songeant au sort de celui qui le portait, mais de vivre
tranquillement loin des affaires.
César ne doutait pas que ces avis ne
fussent dictés par une bienveillance sincère pour lui ; mais il était
d’un sentiment tout opposé. Plein de confiance en lui-même, il formait
déjà de grands projets, et bravait les dangers, les fatigues et
l’inimitié de ses adversaires. Sûr de mériter cette haine, il était bien
décidé ne point se départir, en faveur de qui que ce fût, d’un si beau
nom et d’un si grand empire, au moment surtout où la patrie se déclarait
pour lui et l’invitait se saisir, en vertu de ses titres incontestables,
des honneurs paternels. En effet, dans son opinion, le pouvoir lui
appartenait autant par le droit naturel que par l’autorité de la loi,
puisqu’il était le proche parent de César et son fils adoptif.
Tels étaient les sentiments qu’il exposait
et les objections qu’il faisait dans sa réponse Philippe, sans toutefois
réussir le persuader. Quant à Atia, sa mère, elle voyait avec joie
passer son fils une fortune si brillante et une puissance si
considérable ; mais, connaissant les dangers et les périls qui entourent
cette haute position, témoin aussi de la triste fin de César, son oncle,
elle se sentait découragée, et. son esprit flottait entre l’opinion de
Philippe, son mari, et celle de son fils. Livrée en proie d’innombrables
soucis, tantôt elle s’affligeait quand elle énumérait tous les dangers
suspendus sur la tête de celui qui aspire au souverain pouvoir, tantôt
elle était transportée de joie quand elle songeait à la puissance
entourée d’immenses honneurs, et promise à son fils. Elle n’osait donc
pas le détourner des grandes entreprises et de la juste vengeance qu’il
méditait ; mais elle ne l’excitait pas non plus, sachant l’inconstance
de la fortune.
Elle lui permit cependant de prendre le
nom de César, et fut la première à applaudir à cette résolution.
Enfin, César, après avoir demandé à tous
ses amis leurs opinions ce sujet, n’hésita pas plus longtemps ; et, se
confiant à sa bonne fortune et aux heureux présages, il accepta le nom
et l’adoption de César, Cette résolution fut une source de bonheur pour
lui et pour l’humanité tout entière, ruais surtout pour sa patrie et
pour le peuple romain.
Il envoya aussitôt chercher en Asie les
approvisionnements de guerre et l’argent que son père y avait envoyés
pour servir à l’expédition contre les Parthes. Lorsqu’ils furent
rapportés, ainsi que le tribut annuel des peuples de l’Asie, César, se
contentant des biens de son père, fit verser dans le trésor de la ville
les deniers publics.
Quelques-uns de ses amis lui renouvelèrent
alors le conseil qu’on lui avait déjà donné à Apollonie, de se rendre
dans les colonies de vétérans que son père avait fondées, afin d’
organiser une armée. Eux-mêmes étaient prêts marcher pour venger la mort
de César. Ce nom, disaient-ils, était d’un excellent augure, et les
soldats, charmés d’être commandés par le fils de César, le suivraient
partout, dociles à toutes ses volontés. Ils avaient en effet pour ce
grand homme un amour et une confiance merveilleuse. Ils conservaient
précieusement le souvenir de toutes les grandes choses qu’ils avaient
accomplies sous lui, et désiraient, sous les auspices du même nom,
reconnaître et saluer cet empire qu-ils avaient donné au grand César.
Mais le moment n’était pas encore arrivé
pour l’exécution de ce grand dessein. En attendant, il prenait soin, en
sollicitant légitimement du sénat les honneurs de son père, d’éviter
tout ce qui pouvait lui donner les apparences d’un ambitieux plutôt que
d’un ami des lois. Aussi suivait-il de préférence les conseils de ses
amis les plus avancés en âge comme en expérience. Dans cette
disposition, il quitta Brundusium pour se rendre Rome.
La suite du récit veut que j’expose
comment fut ourdie la conjuration des meurtriers de César, comment
s’accomplit le crime, le désordre général qui en fut le résultat et les
événements qui s’ensuivirent. Je vais raconter en détail les
circonstances et les motifs du complot ainsi que ses funestes
conséquences. Je parlerai ensuite de cet autre César, sujet principal de
cette histoire ; je raconterai comment il parvint à la souveraine
puissance, et quelles furent ses actions pendant la guerre comme pendant
la paix lorsqu’il eut remplacé son prédécesseur.
La conjuration, qui d’abord n’était
composée que d’un petit nombre de chefs, prit ensuite une extension plus
considérable qu’aucune de celles qui, d’après le témoignage de
l’histoire, se soient jamais formées contre un potentat. On assure que
le nombre de ceux qui étaient dans le secret dépassa quatre-vingts[ix].
Parmi les plus influents on distinguait D. Brutus, l’un des plus intimes
amis de César, C. Cassius, et ce même Marcus Brutus qui passait à Rome
pour un homme des plus vertueux.
Tous auparavant, partisans de Pompée,
avaient combattu contre César. Après la défaite de leur chef, tombés au
pouvoir de son rival, ils passaient leur vie dans une sécurité complète,
car nul plus que lui ne sut gagner les cœurs par la bienveillance, et y
faire succéder l’espoir la crainte. Il avait un caractère plein de
douceur, qui ne savait pas garder rancune aux vaincus.
Abusant de la confiance dans laquelle
s’endormait César, ils s’en servaient contre lui et l’entouraient, pour
mieux cacher leurs complots, de séduisantes caresses et d’hypocrites
adulations. Parmi les motifs qui poussèrent les conjures, les uns
étaient personnels, d’autres leur étaient commun ; mais tous provenaient
d’intérêts majeurs. En effet, les uns espéraient, après avoir renversé
César, le remplacer au pouvoir ; des autres étaient encore exaspérés des
défaites qu’ils avaient éprouvées dans la guerre, de la perte de leur
patrimoine ou de leurs richesses, ou même des charges qu’ils exerçaient
à Rome. Mais, cachant leur colère sous des prétextes plus spécieux, ils
prétendaient ne pouvoir souffrir la domination d’un seul et ne vouloir
être gouvernés que par des lois égales pour tous.
Enfin, des griefs accumulés par des motifs
quelconques poussèrent d’abord les plus puissants former le complot ;
plus tard, d’autres y furent attirés par des ressentiments personnels ou
par esprit de parti, offrant ainsi leurs amis une alliance et une
fidélité à toute épreuve. il en avait enfin qui, sans aucun de ces
motifs, mais entraînés seulement par l’autorité de ces hommes illustres,
s’étaient rangés de leur côté. Indignés de voir le pouvoir d’un seul
remplacer la république, ils n’auraient pas cependant commencé une
révolution ; mais une fois l’impulsion donnée par d’autres, ils étaient
tout prêts seconder ces hommes courageux et à partager même, s’il le
fallait, leurs dangers.
Un autre puissant stimulant, c’était le
concours de cette antique famille de Brutus, si fière de la gloire de
ses ancêtres, premiers fondateurs de la république après avoir renversé
la royauté établie par Romulus.
D’ailleurs, les anciens amis de César
n’étaient plus aussi bien disposés pour lui, du moment qu’ils l’avaient
vu honorer l’égal d’eux-mêmes ceux,qui autrefois avaient été ses ennemis
et à qui il avait fait don de la vie. Les sentiments de ces derniers
étaient loin d’être aussi bienveillants, leur ancienne haine, étouffant
en eux tout sentiment de gratitude, leur rappelait sans cesse non pas
les bienfaits dont César les avait comblés après leur avoir sauvé la
vie, maïs tous les biens qu’ils avaient perdus après leur défaite, et ce
souvenir excitait leur colère. Beaucoup même, malgré les soins de César
à ne jamais blesser l’amour-propre de personne, lui en voulaient de ce
qu’ils lui devaient la vie. Lui devoir comme un bienfait tout ce qu’ils
auraient pu se donner sans peine s’ils avaient été vainqueurs, c’était
là une idée qui, présente sans relâche à leur esprit, ne cessait de les
affliger.
En outre, même dans les diverses classes
de militaires, on était loin d’être content. En effet, la plupart, après
tant de campagnes, étaient rentrés dans la vie privée ; et quant aux
chefs, ils se croyaient frustrés des honneurs qui leur étaient dus,
depuis que les vaincus avaient été incorporés dans les rangs des
vétérans et recevaient les mêmes récompenses. Aussi les amis de César ne
pouvaient-ils souffrir d’être mis de pair avec leurs anciens
prisonniers, dont ils voyaient même quelques-uns obtenir des récompenses
leurs dépens.
Plusieurs aussi de ceux qui auraient été
favorisés dans les distributions d’argent ou de places étaient
profondément affligés de voir que César seul avait un si grand pouvoir,
tandis qu’on dédaignait tous les autres comme des gens ayant perdu toute
valeur et toute influence. Enfin César lui-même, que ses nombreuses et
brillantes victoires, dont il était glorieux à bon droit, autorisaient à
s’estimer plus qu’un homme, s’il faisait l’admiration du peuple, était
pour les grands de Rome, et pour ceux qui aspiraient au pouvoir, un
objet de haine et d’envie.
C’est ainsi que se liguèrent contre lui
des hommes de toute condition, grands et petits, amis et ennemis,
soldats et citoyens. Chacun alléguait des prétextes particuliers pour
entrer dans la conspiration, et s’autorisait de ses griefs personnels
pour ajouter foi aux accusations d’autrui. Ils s’excitaient à l’envi
entre eux, et leur confiance était réciproque en ce que chacun avait à
se plaindre particulièrement de César. Voilà comment, dans une
conspiration qui comptait tant d’adhérents, personne n’osa commettre une
seule trahison.
On prétend cependant que, peu d’instants
avant sa mort, il fut remis à César un billet qui contenait le récit de
la conspiration[x].
Il le tenait la main, saris avoir pu le lire, lorsqu’il fut assassiné.
Plus tard on le retrouva parmi d’autres écrits.
Ces détails ne furent appris que plus
tard. Mais à l’époque dont nous parlons, les uns, pour plaire à César,
lui décernaient honneurs sur honneurs, tandis que les autres, dans leur
perfidie, n’approuvaient ces faveurs exagérées et ne les proclamaient
partout qu’afin que l’envie et les soupçons rendissent César odieux aux
Romains.
Quant lui, d’un caractère naturellement
simple, étranger d’ailleurs aux machinations politiques par suite de ses
expéditions lointaines, il se laissait facilement prendre ces artifices.
Il ne soupçonnait pas en effet que sous ces louanges, dans lesquelles il
ne voyait qu’un juste tribut de l’admiration publique, se cachassent au
fond de perfides desseins. Enfin, parmi tous les privilèges qui alors
lui furent accordés, celui qui blessa le plus les hommes revêtus de
quelque autorité, ce fut le décret rendu peu de temps auparavant, qui
enlevait au peuple le droit de nommer les magistrats, pour transférer
César le pouvoir de donner ces charges à qui bon lui semblait.
En outre, raille bruits circulaient dans
le peuple, chacun fabriquant sa nouvelle. Ainsi, les uns assuraient que
César avait résolu de faire de l’Égypte le siège de cet empire qui
s’étendait sur l’universalité des mers et des terres, et cela sous
prétexte qu’il aurait eu de la reine Cléopâtre un fils nommé Césarion.
Ce bruit se trouva plus tard formellement démenti dans le testament de
César. Selon d’autre, il aurait choisi pour e but la ville d’Ilium, où
l’appelait son ancienne parenté avec la famille de Dardanus.
Enfin, il arriva un dernier événement qui,
plus que tout autre, exaspéra ses ennemis. On trouva un jour, couronnée
d’un diadème, la statue d’or qu’en vertu d’un décret on avait élevée à
César sur les rostres. Ce diadème parut, aux esprits soupçonneux des
Romains, un emblème de servitude. Aussi les tribuns qui survinrent,
Lucius et Caïus, ordonnèrent-ils à un de leurs serviteurs de monter sur
les rostres, d’arracher le diadème de la statue, et de le jeter au loin.
A peine César est-il informé de ce qui
vient de se passer, qu’il convoque le sénat dans le temple de la
Concorde, et met les tribuns en accusation. Il leur reproche d’avoir
eux-mêmes couronné sa statue d’un diadème, pour lui faire un affront
public et se donner les apparences d’hommes courageux en bravant tout à
la fois et le sénat et César. D’après lui, cet acte est l’indice d’un
dessein prémédité, et rien moins qu’un complot dans le but de le
calomnier aux yeux du peuple comme aspirant à un pouvoir illégal, afin
de provoquer ensuite une révolution et le mettre mort.
A peine a-t-il achevé de parler, que, d’un
consentement unanime, le sénat condamne les tribuns à l’exil. Ils
s’enfuirent donc, et furent remplacés par d’autres.
Cependant le peuple s’écriait qu’il
fallait que César fût roi et qu’il ceignit sans délai le diadème,
puisque la fortune elle-même avait couronné sa statue.
César dit alors qu’il était prêt à
satisfaire en tout le peuple, à cause de l’amour qu’il lui portait ;
mais qu’il ne pouvait cependant pas lui accorder cette demande. Il
s’excusa d’être obligé, pour conserver les antiques usages de la patrie,
de s’opposer à ses désirs ; il préférait, disait-il, être consul en
observant les lois, plutôt que de devenir roi en les violant.
Voilà ce qui se disait alors. Quelque
temps après, arriva avec l’hiver la fête des Lupercales[xi].
Pendant cette fête, les vieillards comme les jeunes gens, le corps oint
d’huile, et n’ayant d’autre vêtement qu’une ceinture, poursuivent de
leurs plaisanteries les personnes qu’ils rencontrent, et les frappent
même avec des peaux de bouc.
Ce jour étant arrivé, on choisit
Marc-Antoine pour conduire la pompe. Suivant l’usage, il s’avança dans
le forum, escorté de la foule du peuple. César, revêtu d’une robe de
pourpre, occupait un siège d’or sur la tribune aux rostres.
D’abord Licinius, tenant à la main une
couronne de laurier sous laquelle on entrevoyait un diadème, monta,
soulevé par les bras de ses collègues, auprès de César — car l’endroit
d’où ce dernier haranguait était assez levé — ; il déposa la couronne à
ses pieds, mais, encouragé ensuite par les clameurs du peuple, il la lui
mit sur la tête.
César, pour se débarrasser des entreprises
de Licinius, appelle à son secours Lépide, maître de la cavalerie. Mais,
tandis que celui-ci hésite, Cassius Longinus, un des conjurés, voulant
cacher ses mauvais desseins sous une apparence de dévouement à César,
s’empresse de lui ôter la couronne de la tête pour la déposer sur ses
genoux. Avec lui était Publius Casca.
César ayant repoussé le diadème aux
applaudissements du peuple, Marc-Antoine accourt en toute hâte, le corps
nu, oint d’huile, tel enfin qu’il était en conduisant la pompe. Prenant
la couronne, il la remet sur la tête de César, qui, l’arrachant de
nouveau, la jette au milieu du peuple. A la vue de cet acte, ceux qui
étaient au loin se mirent à applaudir ; mais ceux qui se trouvaient plus
près de César lui criaient d’accepter, et de ne point rejeter le don du
peuple. Les opinions sur ce point étaient diversement partagées. En
effet, les uns voyaient avec indignation la marque d’un pouvoir plus
grand que ne le comportait la république, tandis que les autres, pour
être agréables à César, travaillaient avec zèle à la lui faire accepter.
Quelques-uns assuraient que la volonté de César n’était pas étrangère à
la conduite d’Antoine. Beaucoup de citoyens même auraient voulu voir
César s’emparer franchement de la royauté. Enfin les bruits les plus
divers circulaient clans la foule.
Le fait est que, lorsque pour la seconde
fois Antoine approcha la couronne de la tête César, tout le peuple
s’écria : « Salut, ô roi ! » Mais César, la refusant encore, ordonna de
la déposer dans le temple de Jupiter, disant qu’elle y serait mieux
placée[xii].
À ces mots, ceux qui l’avaient déjà applaudi se mirent de nouveau battre
des mains.
Il y a encore une autre version, d’après
laquelle Antoine n’aurait agi ainsi que dans la persuasion où il était
de plaire à César, et dans l’espérance de devenir ainsi son fils
adoptif. Enfin Antoine embrassa César, et donna la couronne à
quelques-uns de ceux qui l’entouraient, pour la poser sur la statue de
César ; ce qu’ils firent. Au milieu de tous ces événements, cette
dernière circonstance contribua plus que toute autre à précipiter les
coups des conjurés, car ils voyaient avec la dernière évidence se
réaliser les soupçons qu’ils nourrissaient.
Peu de temps après, le préteur Cinna,
ayant fléchi César par ses prières, lui fît rendre un décret qui
rappelait les tribuns chassés et leur permettait, par la volonté du
peuple, de vivre en simples particuliers, destitués il est vrai de leur
puissance tribunitienne, mais pouvant cependant aspirer aux fonctions
publiques. César ne s’étant point opposé leur retour, les tribuns purent
revenir Rome.
Bientôt il eut à présider les comices
annuels pour la création des magistrats — car un décret lui en avait
accordé le pouvoir —. Il donna le consulat pour l’année suivante à
Vibius Pansa et Aulus Hirtius, et pour la troisième année à Décimus
Brutus, un des conjurés, ainsi qu’à Munatius Plancus.
Survint ensuite un autre événement, qui
ajouta encore à l’irritation des conjurés.
César faisait construire un forum d’une
grandeur imposante. Pendant qu’il adjugeait les travaux aux artistes
réunis, les premiers personnages de Rome s’avancèrent vers lui pour lui
annoncer les honneurs que d’un consentement unanime le sénat venait de
lui décerner ; à leur tête le consul — Antoine —, alors son collègue,
portait les nouveaux décrets. Précédé de licteurs chargés d’écarter le
peuple, il était escorté des préteurs, des tribuns, des questeurs et de
tous les autres magistrats de Rome. Venait ensuite le sénat dans toute
sa majesté, puis une immense multitude, telle qu’on n’en avait jamais vu
jusqu’alors. On était étonné de voir ces hommes les premiers en dignité,
et qui réunissaient en eux la toute-puissance, rendre hommage à un
supérieur.
Pendant qu’ils approchaient, César, assis,
continuait de s’entretenir d’affaires avec ceux qui se trouvaient à côté
de lui, sans faire aucune attention au sénat, ni même sans se tourner
vers lui.
Ce ne fut que lorsqu’un de ses amis lui
eut dit : « Mais regarde donc ceux qui se présentent devant toi, » que
César déposa ses tablettes et se tourna vers les patriciens pour écouter
le motif qui les amenait.
Les conjurés, partageant leur ressentiment
de cet affront, envenimèrent la haine même de ceux qui, en dehors du
sénat, étaient déjà irrités contre César. Ils brûlaient aussi d’attenter
aux jours de ce héros, ces hommes nés pour la ruine de tous, et non pas
pour la liberté. Ils se flattaient de venir facilement à bout d’un homme
qui aux yeux de tous passait pour invincible, puisque dans trois cent
deux combats qu’il avait livrés soit en Asie, soit en Europe, il n’avait
jusqu’alors jamais éprouvé de défaite. Comme ils le voyaient souvent
sortir seul, ils espéraient pouvoir le faire périr dans un guet-apens.
Ils cherchaient donc tous les moyens pour écarter de sa personne son
escorte. Ils le flattaient dans leurs paroles, lui disant qu’il devait
être regardé par tout le monde comme un homme sacré, et être appelé le
père de la patrie. Ils faisaient même porter des décrets en ce sens,
dans l’espoir que, séduit par leurs paroles, il ajouterait foi à leurs
protestations de dévouement et renverrait ses gardes, se croyant
suffisamment protégé par l’amour publie. Ce point une fois obtenu, mille
occasions se présentaient aux conjurés d’accomplir facilement leur
entreprise.
Jamais, pour délibérer, ils ne se
réunissaient ouvertement ; mais c’était en petit nombre qu’ils se
rendaient les uns chez les autres furtivement, et dans ces entrevues
mille projets étaient proposés et discutés, ainsi que les moyens et le
lieu où ils accompliraient une telle entreprise.
Les uns proposaient de se précipiter sur
lui lorsqu’il traverserait la voie sacrée, où il passait souvent ; les
autres étaient d’avis qu’on attendit les comices, pendant lesquels César
devait nommer les magistrats dans le champ situé devant la ville. Pour
s’y rendre, César était obligé de traverser un pont. À cet effet les
conjurés se partageraient les rôles, et, après que les uns l’auraient
précipité du pont, les autres seraient accourus pour l’achever.
Quelques-uns assignaient l’exécution de leurs desseins au jour où
devaient avoir lieu les jeux des gladiateurs, fête rapprochée, et qui
permettait aux conjurés de paraître avec des armes sans exciter le
moindre soupçon. Mais le plus grand nombre proposait de l’attaquer au
sénat tandis qu’il serait tout seul, et que les conjurés au contraire
seraient en grand nombre et pourraient cacher leurs poignards sous leurs
robes. On ne laissait en effet entrer dans le sénat que ceux qui en
faisaient partie.
Du reste, la fortune contribua aussi à la
perte de César, puisqu’elle lui fit désigner ce jour pour la convocation
du sénat, afin de soumettre aux délibérations de cette assemblée les
projets qu’il avait à lui proposer.
Dès qu’arriva le jour fixé, les conjurés
se réunirent tout préparés sous le portique de Pompée, lieu où plus
d’une fois on les avait convoqués. La Divinité montra ainsi combien tout
ici-bas est incertain et sujet au caprice du sort. Ce fut elle qui amena
César sous ce portique, où bientôt il devait être étendu sans vie devant
la statue de ce même Pompée qui, vivant, avait succombé dans sa lutte
avec lui ; le vainqueur va tomber assassiné près de d’image de ce rival
maintenant inanimé.
La fatalité aussi est bien puissante, si
toutefois il faut reconnaître sa main dans tous ces événements. En ce
jour, en effet, les amis de César, influencés par quelques mauvais
présages, voulurent l’empêcher de se rendre au sénat ; ses médecins,
inquiets des vertiges dont il était quelquefois tourmenté, et qui
venaient de le saisir de nouveau, l’en dissuadaient de leur côté ; et
enfin plus que tout autre sa propre femme Calpurnie, épouvantée d’une
vision qu’elle avait eue la nuit, s’attacha son époux et s’écria qu’elle
ne le laisserait point sortir de la journée[xiii].
Brutus se trouvait présent. Il faisait partie, du complot, mais alors il
passait pour un des amis les plus dévoués de César. Il lui parla en ces
termes : « Eh quoi, César, un homme tel que toi se laisser arrêter par
les songes d’une femme et les futiles pressentiments de quelques
hommes ! Oserais-tu faire à ce sénat qui t’a comblé d’honneurs, et que
tu as toi-même convoqué, l’affront de rester chez toi ? Non, certes, tu
ne le feras pas, César, pour peu que tu m’écoutes. Laisse donc là tous
ces songes, et viens à la curie, où le sénat réuni depuis ce matin
attend avec impatience ton arrivée. » Entraîné par ces paroles, César
sortit de chez lui.
Pendant ce temps les meurtriers se
groupaient, les uns auprès du siège de César, les autres en face, et le
reste par derrière. Avant l’entrée de César au sénat, les prêtres
offrirent un sacrifice qui pour lui devait être le dernier. Mais il
était évident que ce sacrifice ne s’accomplissait pas sous d’heureux
auspices, car les devins eurent beau immoler victimes sur victimes dans
l’espoir trouver quelques meilleurs présages, ils se virent à la fin
forcés d’avouer que les dieux ne se montraient point favorables, et que
dans les entrailles des victimes on lisait un malheur caché[xiv].
César, attristé, s’étant tourné alors du côté du soleil couchant, ce fut
aux yeux des devins un présage encore plus funeste.
Les meurtriers, qui assistaient à ce
sacrifice, se réjouissaient au fond du cœur.
S’appuyant sur ce que venaient de dire les
devins, les amis de César recommencèrent leurs instances pour lui faire
remettre l’assemblée à un autre jour. César finit par y consentir.
Mais au même moment les appariteurs se
présentèrent à lui pour l’inviter à se rendre au sénat, disant que
l’assemblée était complète.
César consultait du regard ses amis,
lorsque Brutus ; pour la seconde fois, s’approcha de lui et lui dit «
Allons, César, laisse là ces rêveries ; ne prends pour conseil et pour
augure que ta propre vertu, et, sans tarder davantage, viens traiter des
affaires digne de toi et de ce grand empire. »
Après avoir prononcé ces paroles
astucieuses ; il lui saisit la main et l’entraîne vers la curie, qui
était tout proche.
César suivait en silence.
A peine les sénateurs le virent-ils
entrer, qu’ils se levèrent tous en signe d’honneur. Déjà ceux qui
allaient le frapper se pressaient autour de lui. Avant tous Tillius
Cimber, dont César avait exilé le frère, s’avance vers lui. Arrivé près
de César, qui tenait ses mains sous sa toge, il le saisit par ses
vêtements, et, avec une audace toujours croissante, il l’empêchait de se
servir de ses bras et d’être maître de ses mouvements. César s’irritant
de plus en plus, les conjurés se hâtent de tirer leurs poignards et se
précipitent tous sur lui. Servilius Casca le premier le frappe, en
levant son fer, à l’épaule gauche, un peu au dessus de la clavicule, il
avait voulu le frapper au cou, mais dans son trouble sa main s’égara.
César se lève pour se défendre contre lui. Casca, dans son agitation,
appelle son frère en langue grecque. Docile à sa voix, celui-ci enfonce
son fer dans le côté de César. Mais, plus rapide que lui, déjà Cassius
l’avait frappé à travers la figure[xv].
Decimus Brutus lui porte un coup qui lui traverse le flanc, tandis que
Cassius Longinus, dans a précipitation joindre ses coups à ceux des
autres, manque César, et va frapper la main de Marcus Brutus. Ainsi que
lui, Minutius Basilus, en voulant atteindre César, blesse Rubrius Rufus
à la cuisse. On eût dit qu’ils se disputaient leur victime. Enfin César,
accablé de coups, va tomber devant la statue de Pompée ; et il n’y eut
pas un seul conjuré qui, pour paraître avoir participé au meurtre,
n’enfonçât son fer dans ce corps inanimé, jusqu’à ce que César eût rendu
l’âme par ses trente-cinq blessures[xvi].
Alors s’éleva une immense clameur. Les
sénateurs qui n’étaient point au fait du complot, frappés de terreur, se
sauvaient de la curie, et croyaient déjà voir cette tempête fondre sur
eux-mêmes.
Les amis qui avaient accompagné César et
étaient restés dehors pensaient que tort le sénat était du complot et
devait avoir urge armée toute prête pour l’appuyer.
Enfin, ceux qui étaient dans une ignorance
absolue couraient çà et là, effrayés de ce tumulte subit et du spectacle
qui se présentait à leurs yeux ; car les meurtriers étaient aussitôt
sortis de la curie, agitant leurs poignards ensanglanté.
Partout on ne voyait que des hommes qui
fuyaient, on n’entendait que des cris. En même temps le peuple, qui
assistait oint jeux des gladiateurs, s’élança du théâtre en fuyant en
désordre, Il ne savait pas encore exactement ce qui venait de se passer,
mais il était ému des cris qu’il entendait de tous côtés.
Les uns diaient que les gladiateurs
avaient égorgé tout le sénat ; les autres assuraient que César avait été
tué, et que l’armée se livrait au pillage de la ville. Chacun enfin
avait sa version. On ne pouvait rien savoir de précis, tant la terreur
et l’incertitude avaient répandu le trouble dans tous les esprits.
Enfin parurent les conspirateurs, à leur
tête Marcus Brutus, qui apaisait le tumulte, et rassurait le peuple en
lui disant qu’il n’était rien arrivé de funeste. Le sens général de ses
discours était qu’on avait tué un tyran. Telles étaient aussi les
prétentions dont se glorifiaient les autres meurtriers.
Quelques-uns proposèrent de mettre à mort
ceux qu’ils croyaient disposés à se lever contre eux et à leur disputer
de nouveau le pouvoir. Mais on assure que Marcus Brutus s’opposa cette
résolution, disant qu’il n’était pas juste que, pour quelques obscurs
soupçons, on fit périr au grand jour des hommes contre qui ne s’élevait
aucune charge évidente. Cet avis prévalut.
Alors, s’élançant hors de la curie, les
meurtriers s’enfuirent à travers le forum pour se rendre au Capitole,
tenant toujours à la main leurs poignards nus, et criant qu’ils
n’avaient agi ainsi que pour la liberté publique. Ils étaient suivis
d’une foule d’esclaves et de gladiateurs qui, d’après leurs ordres, se
tenaient là tout prêts à les servir.
Le bruit s’étant déjà répandu que César
avait été assassiné, on voyait des flots de peuple s’agiter dans le
forum et dans les rues. Rome ressemblait une ville prise d’assaut.
Après être montés au Capitole, les
conjurés se divisèrent pour garder les lieux tout à l’entour, de crainte
d’être attaqués par les soldats de César.
Cependant, à l’endroit où il était tombé,
gisait encore tout souillé de sang le corps de cet homme qui en Occident
avait porté ses armes victorieuses jusqu’à la Bretagne et à l’Océan, et
qui en Orient se préparait à marcher contre les Indiens et les Parthes,
afin qu’après avoir soumis ces peuples, l’empire des mers et des terres
fût concentré entre les mains d’un seul chef. IL restait là, étendu,
sans que personne osât s’arrêter auprès de lui ni enlever son cadavre.
Ceux de ses amis qui l’avaient accompagné
à la curie s’étaient enfuis, et ceux qu’il avait dans la ville restaient
cachés au fond de leurs demeures. quelques-uns même, après s’être
déguisés, avaient quitté Rome pour se sauver dans les champs et les
lieux voisins. Parmi tant d’amis, aucun n’accourut auprès de lui ni
alors qu’on l’assassinait, ni après le meurtre accompli, excepté
toutefois Sabinus Calvisius et Censorinus ; et encore ceux-là, après
avoir opposé quelque résistance aux compagnons de Brutus et de Cassius,
s’enfuirent-ils bientôt à la vue du nombre de leurs adversaires. Les
autres ne songeaient qu’à leur propre sûreté. Il en avait même qui se
réjouissaient de la mort de César et l’on dit qu’un de ces derniers
prononça ces mots après l’assassinat : « Dieu merci, on n’aura plus sa
cour à faire à un tyran ! »
Enfin, trois esclaves de César qui se
trouvaient près de là placèrent sur une litière le corps de leur maître,
et le portèrent chez lui en le faisant traverser le forum. Les rideaux
de la litière étant levés, les bras de César pendaient hors de la
portière, et l’on pouvait voir son visage couvert de blessures.
Personne ne put alors retenir ses larmes,
à la vue de cet homme qui naguère était honoré à l’égal d’un dieu. Des
gémissements et des sanglots l’accompagnaient partout où passait le
corps. Sur les toits, dans les rues, dans les vestibules, on n’entendait
que des plaintes lugubres.
Lorsque enfin on approcha de la maison de
César, la désolation devint encore plus forte ; car sa femme s’était
élancée hors de chez elle, suivie de la foule de ses femmes et de ses
esclaves, appelant son mari par son nom, et déplorant ses vains
pressentiments et l’inutilité des efforts qu’elle avait tentés pour
l’empêcher de sortir ce jour-là. Mais déjà il était victime d’une
fatalité plus terrible que toutes ses prévisions. On n’avait plus qu’à
préparer la tombe de César.
De leur côté, les meurtriers avaient réuni
un grand nombre de gladiateurs, qu’au moment de l’exécution du crime ils
avaient placés tout armés entre la curie et le théâtre du portique de
Pompée. C’était Decimus Brutus qui les avait rassemblés sous un autre
prétexte, dans le but, disait-il, de s’emparer d’un gladiateur de
théâtre, qui, moyennant une somme, s’était engagé à lui. — On célébrait
en effet les jeux des gladiateurs ; et comme Brutus avait aussi
l’intention d’en donner, il prétendait vouloir rivaliser avec
l’agonothète d’alors[xvii]
—. Mais, au fond, c’était au meurtre de César que se rapportaient tous
ces préparatifs, afin que les conjurés eussent à leur portée un renfort
tout prêt, dans le cas où les amis de César opposeraient quelque
résistance. C’est donc à la tête de ces gladiateurs et d’une foule
d’esclaves qu’ils descendirent du Capitole.
Ils convoquèrent le peuple, dans le but de
sonder ses dispositions et de connaître l’opinion des magistrats à leur
égard : étaient-ils à leurs yeux des destructeurs de la tyrannie, ou
bien des assassins?
La plupart croiraient que bientôt
éclateraient des malheurs plus terribles encore ; car une telle action
supposait nécessairement de grands desseins et de grandes forces du côté
de ceux qui l’avaient conçue et du côté de leurs adversaires. En effet,
les armées de César étaient immenses, et dans les grands chefs qui se
trouvaient à leur tête il laissait des héritiers de sa pensée.
Il se fit donc alors un profond silence.
La nouveauté de la situation ayant ému tous les esprits, chacun
attendait quelle serait la première tentative et le prélude du nouvel
État des choses. Ce fut donc au milieu de l’attente calme qui régnait
parmi le peuple, que parla Marcus Brutus, honoré de tous cause de sa vie
vertueuse, de la gloire de ses ancêtres, et enfin de la loyauté qu’on
lui attribuait.
Après ce discours, les conjurés se
retirèrent de nouveau au Capitole pour délibérer sur ce qu’il avait à
faire dans la circonstance. Ils jugèrent à propos d’envoyer des députés
à Lépide et Antoine pour les engager venir se joindre à eux dans le
temple de Jupiter, et délibérer en commun sur les intérêts de la
république. Ils leur promettaient de confirmer, comme justement acquis,
tout ce qu’ils tenaient de la générosité de César, afin de n’avoir aucun
différend avec eux sur ce point.
Lépide et Antoine promirent ceux qu’on
leur avait envoyés une réponse pour le lendemain.
Sur ces entrefaites, le soir étant arrivé,
le trouble des citoyens ne fit qu’augmenter. Chacun, abandonnant le
salut de l’État, veillait ses propres intérêts ; car chacun craignait
des attaques et des perfidies soudaines. En effet, les chefs étaient
sous les armes dans les deux camps opposés, et il était impossible de
prévoir encore qui s’établirait solidement à la tête des affaires.
Dès que la nuit fut arrivée, chacun se
retira. Mais le lendemain le consul Antoine avait pris les armes, tandis
que Lépide, ayant rassemblé une foule assez nombreuse d’auxiliaires,
traversait le forum, décidé à venger la mort de César.
A cette vue, ceux qui jusqu’alors avaient
montré de l’hésitation accoururent armés chacun avec son parti, et, se
joignant à ces deux chefs, formèrent bientôt une troupe considérable.
Il en avait qui n’agissaient que par
crainte, pour ne pas paraître se réjouir de la mort de César. Par cette
adhésion ils se ménageaient, en cas de succès, des chances dans ce
parti.
On avait aussi envoyé un grand nombre de
messages à tous ceux qui avaient reçu quelques bienfaits de César, soit
en concession de propriétés dans les villes, soit en partage des champs,
soit en dons pécuniaires. On leur disait que tout serait bouleversé,
s’ils ne faisaient une démonstration énergique. Enfin, c’étaient des
prières et d’instantes supplications adressées aux amis de César,
surtout ceux qui avaient servi sous lui, et à qui on rappelait les
vertus de ce grand homme et sa fin tragique lorsque ses amis étaient
loin de lui.
On voyait déjà les citoyens accourir en
grand nombre, les uns mus par compassion et attachement, d’autres dans
des vues intéressées, quelques-uns enfin par amour du changement : mais
surtout parce que l’on voyait que la faiblesse des conjurés démentait la
première idée que l’on avait conçue de leurs forces. On proclamait déjà
hautement qu’il fallait venger la mort de César et ne pas laisser le
crime impuni.
Les réunions se multipliaient., les avis
se partageaient ; les uns parlaient en faveur de ceux-ci, les autres en
faveur de ceux-là.
Les partisans de la république, tout en se
réjouissant de cette révolution, reprochaient aux meurtriers de César de
ne pas avoir tué un plus grand nombre de ceux qui étaient alors
suspects, et de ne pas avoir ainsi assuré la liberté. Maintenant ceux
qu’ils avaient épargnes allaient leur susciter de grands embarras.
Il y en avait aussi qui, supérieurs aux
autres en prévoyance, et d’ailleurs instruits par l’expérience de ce qui
s’était passé du temps de Sylla, ne cessaient de conseiller aux autres
de garder un juste milieu entre les deux partis. En effet, à cette
époque, ceux qui paraissaient perdus s’étaient relevés pour chasser
leurs vainqueurs. Ils soutenaient donc que César, quoique mort,
donnerait beaucoup à faire à ses meurtriers, ainsi qu’à leur parti ; car
déjà ils voyaient accourir les armées menaçantes, et leur tête les
hommes les plus énergiques.
Cependant Antoine et son parti, qui, avant
de se préparer au combat, avaient des pourparlers et des négociations
avec les conjurés réfugiés au Capitole, aussitôt qu’ils purent se
confier dans le nombre et la force de leurs armes, se mirent à gouverner
la ville et à calmer le trouble des esprits. Ils réunirent d’abord leurs
amis, et délibérèrent sur la conduite qu’il leur faudrait tenir avec les
meurtriers, Lépide fut d’avis de leur faire une guerre ouverte, et de
venger la mort de César. Hirtius proposait de transiger avec eux, et de
devenir leurs amis. Un autre, au contraire, se rangeant de l’opinion de
Lépide, ajouta que ce serait une impiété de laisser sans vengeance le
meurtre de César, et que d’ailleurs c’était compromettre la sûreté de
tous ceux qui étaient ses amis. Car, dit-il, si à présent les meurtriers
se tiennent en repos, aussitôt qu’ils verront s’augmenter leurs forces,
ils reprendront de l’audace. Antoine se rangea de l’opinion d’Hirtius,
et fut d’avis de leur laisser la vie. Plusieurs enfin proposaient de
leur offrir une capitulation, à condition qu’ils quitteraient Rome.
Après la mort et les funérailles du grand
César, les amis de son fils adoptif lui conseillaient de gagner l’amitié
d’Antoine et de lui confier ses propres intérêts. Cependant plusieurs
causes contribuèrent à les diviser, entre autres Critonius, adversaire
de César et partisan d’Antoine. C’était lui surtout qui semblait exciter
leur inimitié mutuelle. Mais César, que sa grandeur d’âme rendait
inaccessible la crainte, n’en prépara pas moins les jeux pour la fête
que son père avait instituée en l’honneur de Vénus, et dont le jour
approchait. Puis, escorté d’un plus grand nombre d’amis, il se rendit de
nouveau auprès d’Antoine, pour lui demander l’autorisation d’exposer au
théâtre le trône et la couronne d’or consacrés à son père. Mais Antoine,
le menacent comme auparavant, lui enjoignit de renoncer à ce projet et
de se tenir tranquille. César se retira, sans montrer aucune opposition
à la défense du consul. Mais lorsqu’il entra au théâtre, il fut reçu par
les nombreux applaudissements du peuple et des soldats de son père,
indignés de voir qu’on l’empêchait de renouveler les honneurs dus à
César. Ces applaudissements répétés pendant toute la durée du spectacle
manifestaient clairement les bonnes dispositions du public à son égard.
Pour lui, il fit distribuer de l’argent au peuple, dont l’affection n’en
devint que plus vive. A partir de ce jour, l’inimitié d’Antoine contre
César se manifesta davantage, car il voyait dans cet amour du peuple
pour son rival un obstacle de plus à ses projets. De son côté, d’après
l’état des choses, César comprit clairement qu’il avait besoin de
l’appui du public.
Il voyait aussi une opposition ouverte de
la part des consuls, qui, déjà maîtres d’une grande puissance,
s’efforçaient de l’augmenter encore. En effet, dans les deux mois qui
s’étaient écoulés depuis la mort de César, ils avaient épuisé le trésor
de la ville, que son père avait rempli d’immenses richesses, et, sous le
premier prétexte venu, ils profitaient de la confusion qui régnait dans
toutes choses pour dissiper l’argent ; enfin ils étaient bien avec les
meurtriers.
César restait donc tout seul pour venger
la mort de son père, puisque Antoine en abandonnait complètement le
projet, et s’en tenait à l’amnistie accordée aux conjurés.
Beaucoup, sans doute, accouraient aux
côtés de César ; mais ceux qui se rangeaient autour d’Antoine et de
Dolabella n’étaient pas non plus en petit nombre.
Il y en avait enfin qui s’étudiaient à
souffler la haine entre eux, et y travaillaient sans cesse. Ces derniers
avaient pour chefs Publius, Vibius, Lucius, et principalement Cicéron.
César n’ignorait pas les intentions de ceux qui se réunissaient autour
de lui et l’irritaient contre Antoine. Il ne refusa pas cependant leurs
services, afin de se donner un appui considérable et constituer autour
de lui une garde plus forte. Il savait fort bien que ce dont ils se
souciaient le moins, c’était l’intérêt public, tandis qu’ils ne visaient
chacun qu’à s’emparer de l’autorité et du pouvoir. Jules César en était
revêtu, et ils s’en étaient débarrassés ; quant à son fils, vu son
excessive jeunesse, ils le jugeaient incapable de tenir tête à un pareil
désordre. Chacun donc se livrait à ses espérances, et, en attendant,
s’appropriait tout ce qu’il pouvait saisir.
En effet, toute pensée de salut public
était écartée ; les hommes influents se divisaient en un grand nombre de
partis, et prétendaient chacun dominer, ou arracher pour son compte le
plus d’autorité qu’il pourrait ; en sorte que le pouvoir était un
composé étrange, un monstre plusieurs têtes. Ainsi Lépide ayant détaché
une partie considérable de l’armée de César, prétendait aussi à la
domination. Il était maître de l’Espagne citérieure et de la partie de
la Celtique qui regarde la mer du Nord. D’un autre côté, Lucius Plancus,
nommé lui-même consul, occupait avec une autre armée le pays des
Comates. C. Asinius, autre chef d’armée, tenait sous ses ordres l’Ibérie
ultérieure. Decimus Brutus commandait la Gaule cisalpine avec deux
légions ; Antoine allait bientôt marcher contre lui. Caïus Brutus enfin
couvait de l’œil la Macédoine, quoiqu’il n’eût pas encore quitté
l’Italie pour se rendre dans cette province, tandis que Cassius Longin,
qui était préteur en Illyrie, convoitait la. Syrie.
Il y avait alors autant d’armées que de
chefs, chacun de ces généraux prétendait se rendre maître de la
souveraine puissance. Plus de lois, plus de justice : la force décidait
de tout. César seul n’aurait aucune puissance, lui à qui de droit
revenait le souverain pouvoir, d’après la volonté de celui qui l’avait
exercé le premier, et d’après sa parenté avec cet homme. Il était
errant, exposé à l’envie et à l’avidité de ceux qui guettaient le moment
de l’écraser et d’usurper le gouvernement. Plus tard, la volonté des
dieux et la fortune eu disposèrent mieux ; mais, pour lors, César était
réduit à craindre même pour sa vie, car les sentiments hostiles
d’Antoine n’étaient plus pour lui un secret. Désespérant de les changer,
il resta chez lui et attendit l’occasion d’agir.
Le premier mouvement qui se fit remarquer
à Rome vint de la part des compagnons d’armes du père du jeune César.
Indignés de l’arrogance d’Antoine, ils commencèrent à murmurer entre
eux, s’accusant d’avoir oublié César et de laisser accabler d’outrages
son fils, à qui ils devraient tous servir de tuteurs, si l’on avait
quelque respect pour la justice ou la piété.
Les reproches qu’ils se faisaient
devinrent ensuite plus vifs lorsque, munis en corps, ils se rendaient à
la maison d’Antoine. — Car lui-même ne pouvait s’appuyer que sur eux —.
Sans plus se cacher, ils lui firent entendre qu’il eût à traiter César
avec plus de modération, et à se mieux souvenir des dernières volontés
de son père. Ils regardaient, disaient-ils, comme un devoir religieux de
respecter non seulement ses volontés, mais d’observer encore même ses
moindres recommandations laissées par écrit, et plus forte raison ce qui
concernait son fils et successeur. Rien, d’ailleurs, ne pouvait être
plus utile à l’un et à l’autre que leur unions dans ce moment surtout où
ils étaient entourés d’un si grand nombre d’ennemis.
A ces mots, Antoine, qui avait besoin de
ses soldats, pour ne pas paraître s’opposer à leurs désirs, dit qu’il
était tout disposé à agir ainsi, pourvu que César se montrât de son côté
modéré et lui accordât les honneurs qui lui étaient dus. A cette
condition, il était prêt à entrer en conférence avec César, en leur
présence même.
Les soldats applaudirent à ces
dispositions, et convinrent de le conduire au Capitole, s’offrant
d’intervertir ensuite, s’il le voulait, comme conciliateurs entre les
deux chefs.
Antoine y consentit, se leva aussitôt pour
se rendre au temple de Jupiter, et envoya les soldats à César. Ceux-ci,
ravis, coururent chez lui en grand nombre, au point que César tomba dans
une grande inquiétude lorsqu’on vint lui annoncer qu’une foule de
soldats était rassemblée devant les portes de sa demeure, tandis que
d’autres le cherchaient à l’intérieur. Plein de trouble, il s’enfuit
dans la partie supérieure de la maison, accompagné des amis qui se
trouvaient auprès de lui, puis de là, avançant la tête, il demanda à la
foule ce qu’elle voulait et quel sujet l’amenait. Il reconnut alors ces
soldats pour avoir été ceux de son père.
Ils lui répondirent qu’ils étaient venus
pour son bien et celui de son parti, pourvu qu’il oubliât tous les torts
d’Antoine à son égard, torts qu’ils n’avaient vus eux-mêmes qu’avec
peine. Il fallait, lui dirent-ils, déposer tout ressentiment et se
réconcilier tous deux franchement et sans arrière-pensée. L’un d’eux,
élevant la voix, dit à César de prendre confiance et de les regarder
tous comme son héritage, car ils avaient pour la mémoire de son père un
culte vraiment religieux, et étaient prêts à tout faire, à tout souffrir
pour son successeur. Un autre, d’une voix qui dominait celle de ses
compagnons, s’écria qu’il tuerait Antoine de sa propre main, s’il
n’obéissait aux dernières volontés de César et s’il ne restait pas
fidèle au sénat.
César, déjà rassuré, descendit alors
auprès d’eux, et, charmé de leur dévouement et de leur zèle, il les
combla d’amitiés.
Les soldats l’emmenèrent et le
conduisirent en grande pompe au Capitole. Ils rivalisaient entre eux
d’empressement, les uns par haine pour le despotisme d’Antoine, les
autres par respect pour le grand César et son successeur, quelques-uns
dans l’espérance des grands avantages qu’ils étaient en droit d’attendre
de César, plusieurs enfin conduits par le désir impatient de voir la
vengeance atteindre les meurtriers, vengeance qui, dans leur opinion,
serait exercée par son fils mieux que par tout autre, surtout s’il était
secondé par le consul. Tous, par intérêt pour le jeune César,
s’approchaient de lui, et lui conseillaient d’éviter toute contestation
avec Antoine, afin de pourvoir à la sécurité de son parti et aux moyens
de s’attacher le plus d’auxiliaires qu’il pourrait, en se rappelant
combien la mort de César avait trompé tous les calculs.
Témoin de cet empressement, d’ailleurs
légitime, le jeune César arriva au Capitole. Il y trouva, en plus grand
nombre encore, des soldats de son père sur lesquels s’appuyait Antoine.
Ils étaient cependant beaucoup plus dévoués César, et pats à repousser
toute attaque qui lui viendrait de son rival.
Ensuite la plupart se retirèrent, laissant
les deux chefs et leurs amis s’entretenir entre eux.
A peine César, après cette réconciliation,
s’en retournait-il chez lui, qu’Antoine, resté seul, sentit renaître sa
colère en voyant les cœurs de tous les soldats se porter vers son rival.
Ceux-ci étaient en effet persuadés que c’était lui qui était le fils de
César, le successeur désigné dans son testament. Il portait,
disaient-ils, le même nom, donnait de belles espérances et laissait
entrevoir un caractère plein d’énergie. Cette considération, non moins
que les liens du sang, avait, à leur avis, décidé César à l’adopter pour
fils, comme le seul capable de conserver l’empire et de maintenir la
dignité de sa maison. Ces idées, qui frappaient alors l’esprit
d’Antoine, changèrent ses dispositions ; il se repentit de ce qu’il
avait fait, surtout quand de ses propres yeux il vit les soldats de
César l’abandonner pour accompagner en foule son rival sa sortie du
temple. Quelques-uns même pensaient qu’il n’aurait pas manqué de lui
faire un mauvais parti s’il n’avait craint que les soldats ne se
précipitassent sur lui pour le punir, et n’entraînassent facilement tout
son parti du côté de César. En effet, il restait chacun d’eux une arme
qui n’attendait que les circonstances pour se décider. Ces réflexions
faisaient hésiter Antoine et arrêtaient ses projets, bien que ses
dispositions fussent entièrement changées.
Cependant César, qui croyait à la
sincérité de cette réconciliation, allait chaque jour visiter Antoine
chez lui, comme il était naturel, puisque celui-ci était consul, plus
âgé que lui, et ancien ami de son père. D’ailleurs, fidèle sa
promesse, il lui rendait toutes sortes d’honneurs, jusqu’au moment où
Antoine renouvela ses attaques, comme nous allons le voir.
Voici comment. Ayant échangé la province
de Gaule pour la Macédoine, il en fit passer les troupes en Italie. Dès
qu’elles arrivèrent, il quitta Rome pour aller leur rencontre jusqu’à
Brundusiurn. Croyant alors le moment propice pour les entreprises qu’il
méditait, il fit répandre le bruit qu’on lui avait tendu des embûches ;
puis, saisissant quelques soldats, il les fit jeter dans les fers, sous
prétexte qu’ils avaient été envoyés exprès pour le tuer. Bien qu’il
n’accusât pas ouvertement César d’être l’auteur de ce complot, il le
faisait entendre cependant.
Aussitôt le bruit se répand à Rome qu’on a
attenté aux jours du consul ; et que l’on a saisi ceux qui étaient venus
pour le tuer. Des conciliabules d’amis se tenaient dans la maison
d’Antoine, où il avait soin de faire venir des soldats tout armés.
Enfin, vers le soir, César apprit que peu s’en était fallu qu’Antoine ne
fût assassiné, et qu’il s’entourait de gardes pour la nuit.
Aussitôt il envoie dire à Antoine qu’il
était prêt à accourir avec toute sa suite auprès de son lit, pour
veiller à sa sûreté. Il croirait en effet que Brutus et Cassius étaient
les auteurs d’un pareil coup.
Tels étaient les procédés généreux de
César ; car il était loin d’avoir aucun soupçon des propos et des
machinations d’Antoine. Ce dernier cependant ne voulut pas même laisser
entrer chez lui le messager de César, mais le fit chasser
ignominieusement. Le messager, qui avait saisi quelques mots, revenu
auprès de son maître, lui raconta ce qu’il venait d’entendre. D’après
son récit, on affectait de répéter le nom de César devant la porte
d’Antoine ; on assurait que c’était lui qui avait envoyé contre Antoine
les assassins, qui du reste étaient arrêtés.
D’abord César se refusait croire à une
nouvelle si imprévue ; mais bientôt, pénétrant jusqu’au fond les
desseins de son adversaire, et convaincu que toute cette machination
était dirigée contre lui, il délibéra avec ses amis sur ce qu’il avait
faire.
Philippe et Atia, mère de César,
arrivèrent sur ces entrefaites, tout étonnés d’un événement si étrange.
Ils voulaient savoir à quoi s’en tenir sur le bruit qui courait et sur
la pensée d’Antoine, ils conseillèrent César de céder à l’orage en se
retirant pendant quelques jours, jusqu’au moment où, après examen, tout
serait éclairci. Mais César, qui n’avait rien se reprocher, pensa qu’il
ne devait point se soustraire aux regards des hommes, et par là se
reconnaître en quelque sorte coupable.
Selon lui, il n’y aurait aucun avantage
pour sa sûreté à s’éloigner de Rome, tandis qu’au contraire le départ ne
ferait peut-être que l’exposer à être tué secrètement. Telles étaient
les considérations qui occupaient alors son esprit.
Mais le lendemain il s’assit suivant sa
coutume, entouré de ses amis, et fit ouvrir les portes à tous ceux qui
avaient l’habitude de venir le visiter et le saluer, citoyens, étrangers
et soldats. Il causa selon son usage avec eux, sans rien changer à ses
habitudes journalières.
Quant à Antoine, ayant rassemblé ses amis
en conseil, il leur dit à haute voix qu’il n’ignorait pas que déjà
auparavant César avait formé de mauvais desseins contre lui ; que
maintenant, lorsque lui Antoine allait à la rencontre de l’armée de la
Macédoine, son ennemi avait saisi cette occasion pour attenter ses
jours. Mais il était parvenu, disait-il, à force de récompenses, à
obtenir d’un des assassins envoyés contre lui une révélation complète.
C’est pour cela qu’il avait saisi les meurtriers et rassemblé ses amis
en conseil, afin de connaître leur opinion et le parti prendre.
Lorsque Antoine eut fini de parler, ceux
qui faisaient partie du conseil lui demandèrent où étaient les hommes
arrêtés, pour que l’on pût les interroger. Antoine allégua que cette
mesure était pour le moment tout à fait inutile, puisque les coupables
étaient tous convenus de leur crime ; et pour donner le change il se mit
à parler d’autre chose. Il attendait surtout avec impatience que
quelqu’un donnât le conseil de se venger de César, sans lui laisser ni
trêve ni repos. Mais l’assemblée, ne lui voyant produire aucune preuve,
gardait le silence, dans une attitude pensive. Enfin quelqu’un, pour
donner Antoine un prétexte plausible de lever la séance d’une manière
convenable, lui dit qu’il devait, en sa qualité de consul, user en tout
de modération, et éviter toute occasion de troubles.
A ces mots Anoine renvoya son conseil ;
puis trois ou quatre jours après il partit pour Brundusium, afin de
prendre le commandement de l’armée qui venait d’arriver.
Il ne fut plus ensuite question de ce
prétendu complot de César, car, après le départ d’Antoine, les amis
qu’il avait laissés à Rome eurent soin d’étouffer cette intrigue ; et
quant aux meurtriers qu’on disait avoir été saisis, personne ne les vit
jamais.
César, bien que disculpé de cette
accusation, en était cependant fort indigné. Il y voyait une preuve
d’une hostilité acharnée. Il pensait qu’Antoine n’avait nullement besoin
d’être provoqué ; que si cet homme trouvait sous sa main une armée
gagnée par ses largesses, il n’hésiterait plus l’attaquer, afin d’avoir
le champ libre à ses espérances. Il était évident pour César que celui
qui avait ourdi contre lui une telle intrigue ne l’aurait pas épargné
dès le commencement même, s’il n’avait été retenu par la crainte de
l’armée. Il était donc justement irrité contre Antoine et se tenait sur
ses gardes, depuis qu’il connaissait, à n’en pas douter, les intentions
du consul.
Tournant ses regards de tous côtés, César
jugeait que ce n’était pas le moment de restez dans une inaction
dangereuse, maïs qu’il fallait absolument chercher quelques auxiliaires
capables de contrebalancer les forces et les manœuvres d’Antoine.
Ces réflexions le décidèrent se réfugier
auprès des colons auxquels son père avait distribué des terres, et dans
les villes qu’il avait fondées pour eux. Il comptait rappeler aux colons
les bienfaits de César, et, en gémissant sur la triste fin de ce grand
homme ainsi que star son propre sort, trouver des auxiliaires chez eux
et se les gagner en leur distribuant de l’argent. C’était là,
pensait-il, le seul moyen d’acquérir de la sécurité et une gloire
éclatante, en même temps que de conserver la puissance de sa maison. Il
était plus juste et plus avantageux de s’exposer combattre les armes à
la main, que de se laisser dépouiller des honneurs qui appartenaient son
père par des gens qui n’y avaient aucun droit, et même de périr, comme
le grand César, victime d’un criminel attentat.
Après avoir délibéré avec ses amis et fait
aux dieux un sacrifice, sous d’heureux auspices, pour qu’ils vinssent
son secours dans la noble et juste espérance qu’il avait conçue il entra
d’abord en Campanie, emportant avec lui une somme considérable d’argent.
C’était là que se trouvaient les septième et huitième légions — c’est le
nom que les Romains donnent un corps militaire —. Il fallait sonder
d’abord les esprits de la septième légion, car c’était elle qui avait le
plus d’importance. Cette légion une fois gagnée, le concours d’autres
auxiliaires...
Les amis qu’il consultait furent aussi de
cette opinion. Après l’avoir accompagné dans cette expédition, ils
s’associèrent ensuite à toute sa politique. C’étaient Marcus Agrippa,
Lucius Mæcenas, Quintus Juventius, Marcus Mædialus, et Lucius. Il était
aussi suivi de généraux, de soldats, de centurions ; puis venaient les
serviteurs, et les voitures qui portaient l’argent ainsi que les
bagages. Il ne jugea pas à propos de faire part de sa résolution à sa
mère, de peur que son amour et sa faiblesse de mère et de femme ne
devinssent un obstacle à ce grand projet. Il disait ouvertement qu’il
n’allait en Campanie que pour vendre des biens de son père, afin d’en
consacrer le produit à l’exécution des volontés de César.
Il partit enfin, sans laisser sa mère trop
persuadée.
Marcus Brutus et C. Cassius étaient alors
à Dicarchie — Puzzoles —. Ayant été informés du nombre considérable de
personnes qui accompagnaient César, nombre augmenté en outre et comme
toujours par les bruits qui couraient, ils furent frappés de trouble et
de crainte, car ils pensaient que cette expédition était dirigée contre
eux. Aussi passèrent-ils l’Adriatique, et se sauvèrent-ils, Brutus en
Achaïe, Cassius en Syrie.
César se rendit à Callatie, ville de
Campanie, où il fut reçu et traité avec de grands honneurs, comme fils
du bienfaiteur de la ville. Le lendemain il s’ouvrit franchement aux
habitants, et engagea à sa cause les soldats en leur exposant
l’injustice de la mort de son père et toutes les embûches auxquelles
lui-même était exposé.
Pendant qu’il parlait, les sénateurs
présents ne prêtaient qu’une faible attention à son discours ; mais le
peuple lui témoignait un empressement et une bienveillance extrêmes. Ému
de pitié, il engagea César, par ses cris répétés, à avoir bon courage,
et lui promit de le seconder et de ne rien négliger pour lui faire
rendre les honneurs paternels.
César les rassembla alors chez lui, et fit
donner à chacun cinq cents drachmes. Le lendemain, convoquant les
sénateurs, il les engage à ne pas se laisser vaincre par le peuple en
bienveillance, de se souvenir de César, qui ils doivent leur colonie et
les honneurs dont ils sont chargés ; enfin il leur promet des avantages
non moins considérables que ceux qu’ils avaient reçus de son père. Ce
n’est pas à Antoine, dit-il, mais à lui à profiter de leur secours et se
servir de la force de leurs armes.
A ce discours chacun sentit augmenter son
empressement le servir. Tous étaient prêts à partager avec lui les
fatigues et même, s’il le fallait, les dangers.
César les remercia de leur zèle et les
pria, pour plus de sûreté, de lui servir d’escorte jusqu’aux colonies
voisines. Le peuple, charmé de sa personne, consentit avec joie et
l’accompagna tout armé jusqu’à la seconde colonie. Là, dans une nouvelle
assemblée, il tient le même langage ; enfin il persuade aux deux légions
de le ramener à Rome en passant par les autres colonies, et de repousser
par la force, s’il le faut, toute entreprise violente de la part
d’Antoine. Il rassembla encore d’autres soldats en leur offrant une
solde élevée ; et, quant aux conscrits, tout en s’avançant vers Rome, il
les exerçait à manœuvrer tantôt à part, tantôt en commun, répétant
partout qu’il allait marcher contre Antoine.
Il envoya aussi Brundusium quelques-uns de
ses compagnons, qui savaient unir la prudence à l’audace, pour chercher
à gagner à son parti les soldats nouvellement arrivés de Macédoine, et
pour les engager, en leur rappelant le grand César, à ne point trahir
son fils en aucune manière. César leur avait recommandé, s’ils ne
pouvaient parvenir à parler ouvertement aux soldats, de répandre partout
des écrits pour que les soldats pussent les ramasser et les lire. Il fit
aussi des promesses brillantes aux autres pour les attirer à son parti,
et leur fit espérer de grands avantages pour le jour où il arriverait au
pouvoir. Ce fut dans ces sentiments qu’ils se séparèrent.
FIN
[i] L’honneur de
la première découverte revient à M. E. Miller, bibliothécaire du
Corps législatif. Plus tard, M. C. Müller est allé copier à
l’Escurial, aux frais de M. Didot, ce précieux reste de
l’antiquité, et l’a publié dans le troisième volume des
Fragmenta historicorum Græcorum.
[ii] La
traduction de M. Alfred Didot a paru pour la première fois en
1850, in-8, avec le texte en regard. Elle a eu une seconde
édition en 1861, dans la Bibliothèque singulière,
commencée par M. P.-Malassis.
[iii] Examen
critique des historiens anciens de la vie et du règne d’Auguste.
In-8, 1844.
[iv] Constantin
Porphyrogénète est le dernier auteur qui semble avoir eu entre
les mains au moins une grande partie de l’Histoire universelle
de Nicolas de Damas. Il possédait aussi ses Mémoires, dont il a
cité de longs fragments.
Photius (IXe siècle) parle dans sa
Bibliothèque de l’Histoire d’Assyrie, comme d’un travail
considérable. Il fait aussi mention du Traité des Coutumes
singulières.
Simplicius (VIe siècle) paraît
avoir connu tous les traités de philosophie composés par
Nicolas. L’un d’eux, le Livre des Principes, existait
encore au XIIe siècle, et a été critiqué pas Averroës.
[v] T. VI des
Mémoires de l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres.
[vi] T. III des
Fragmenta historicorurn Græcorum, de la collection Didot.
[vii] D’après un
passage d’Appien, Octave était depuis six mois à Apollonie. Il
s’agit d’Apollonie d’Illyrie.
[viii] « César
avait fait son testament aux dernières mies de septembre, dans
sa terre de Lavicum, et l’avait confié à la première des
vestales. Q. Tubéron rapporte que depuis son premier consulat
jusqu’au commencement de la guerre civile, il avait coutume de
porter sur son testament Cn. Pompée pour son héritier, et que
même il avait la cette clause dans une harangue à ses soldats.
Mais par ses dernières dispositions, il nommait trois héritiers.
c’étaient les petits-fils de sa sœur, savoir : C. Octavius, pour
les trois quarts ; Lucius Pinarius et Quintus Pédius pour le
dernier quart. A la fin de son testament, il adoptait C.
Octavius et lui donnait son nom. Il déclarait plusieurs de ses
meurtriers tuteurs de son fils, dans le cas où il lui en
naîtrait un. Il plaçait Décimus Brutus parmi ses héritiers de
seconde ligne. Il léguait aupeuple romain ses jardins près du
Tibre, et toris cents sesterces (61.3 5) par tête. » Suétone,
traduction de La Harpe.
[ix] Salluste
dit seulement « plus de soixante ».
[x] Plutarque
dit que ce billet fut remis à César ou par un affidé
d’Artémidore de Cnide, qui enseignait à Rome les belles-lettres
grecques, ou par Artémidore lui-même, avec la recommandation de
le lire seul et promptement. Mais César en fut toujours empêché
par la foule de ceux qui voulaient lui parler. (Vie de César.)
[xi] Durant ces
fêtes en l’honneur de Pan, qui se célébraient au mois de
février, les jeunes gens des familles nobles couraient nus par
la ville, armés de lanières de cuir avec leur poil, dont ils
frappaient les passants. Les femmes tendaient la main à leurs
coups, persuadées que c’était un moyen sûr pour les femmes
grosses d’accoucher heureusement, et pour les stériles d’avoir
des enfants. (Voir, sur l’origine de cette fête, Plutarque,
Vie de Romulus.)
[xii] Cicéron
dit qu’Antoine ordonna qu’on écrivit dans les Fastes qu’à J.
César, dictateur perpétuel, M. Antoine, consul, a, par la
volonté du peuple, déféré la royauté, et que César n’a pas
accepté. (Voir Seconde Philippique.)
[xiii] Il faut
compléter ici Nicolas de Damas par Suétone et par Plutarque. La
solennité de la situation est rendue plus sensible dans ces deux
historiens par la citation des inscriptions mises au bas des
statues de Brutus l’ancien et de César, des billets par lesquels
on excitait D. Brutus à accomplir la fatalité de sa famille, et
des prodiges de toute sorte qui annoncèrent la fin prochaine du
dictateur.
« Quelques personnes écrivirent au
bas de la statue du vieux Brutus : « Oh ! si tu vivais ! »
Et au bas de celle de César :
De Brutus à César la différence
est forte :
Le premier fut consul par un royal
renvoi ;
Le second, en menant les consuls à
la porte,
A conquis le pouvoir et le titre
de roi.
« Des prodiges frappants
annoncèrent à César sa fin prochaine. Quelques mois auparavant,
des colons conduits en Capoue, en vertu de la loi Julia, se
disposaient à y élever des maisons de campagne. En fouillant le
terrain, ils dispersèrent d’antiques sépultures... On trouva,
dans un endroit où l’on disait que Capys, fondateur de Capone,
était enseveli, une table d’airain avec une inscription grecque
dont le sens était que, lorsqu’on découvrirait les restes de
Capys, un descendant de Jules périrait de la main de ses proches
et serait bientôt vengé par les désastres de l’Italie.... Les
jours suivants, César apprit que des chevaux qu’il avait
consacrés en passant le Rubicon, et qu’il avait laissés paître
en liberté, versaient d’abondantes larmes. Tandis qu’il immolait
une victime, l’augure Spurinna l’avertit de prendre garde à un
danger auquel il serait exposé avant les ides de mars. La veille
de ces mêmes ides, des oiseaux de différentes espèces, sortis
d’un bois voisin, poursuivirent et mirent en pièces un roitelet
qui se dirigeait vers la salle de Pompée avec un rameau de
laurier. La nuit même du jour où César fut égorgé, il lui
sembla, pendant son sommeil, qu’il volait de temps en temps
au-dessus des nues, et une autre fois qu’il serrait la main de
Jupiter. Sa femme Calpurnia rêva que le faite de sa maison
s’écroulait, et que son mari était percé de coups dans ses bras.
Au même instant, les portes de sa chambre s’ouvrirent
d’elles-mêmes. » (Suétone, Jules César, traduction de La
Harpe.)
« Ceux qui devinaient un
changement, et qui avaient les yeux sur Brutus seul, ou du moins
sur lui plutôt que sur tout autre, n’osaient pas, à la vérité,
lui en parler ouvertement, mais, la nuit, ils couvraient le
tribunal et le siège où il rendait la justice comme préteur, de
billets conçus la plupart en ces termes : « Tu dors, Brutus ! -
Tu n’es pas Brutus...»
« Il est bien plus facile, ce
semble, de prévoir sa destinée que de l’éviter, car celle de
César fut annoncée, dit-on, par des présages extraordinaires et
des apparitions.... Au rapport de Strabon le philosophe, on vit
en l’air des hommes de feu marcher les uns contre les autres. Le
valet d’un soldat fit jaillir de sa main une flamme très vive ;
on eût dit que la main brûlait, mais quand la flamme fut éteinte
l’homme n’avait aucune trace de brûlure. Dans un sacrifice que
César offrait, on ne trouva point de cœur à la victime, et
c’était un prodige effrayant, car il est contre nature qu’un
animal puisse exister sans cœur... La veille des ides de mars,
César soupait chez Lepidus, et, suivant sa coutume, il signait
des lettres à table. On proposa, dans la conversation, la
question : « Quelle mort est la meilleure ? » César, prévenant
toutes les réponses, dit tout haut : « C’est la moins
attendue... » Plutarque, Vie de César.
[xiv] À ce
moment, suivant Suétone, César interpella l’augure Spurinna, qui
l’avait averti de prendre garde à un danger auquel il serait
exposé avant les ides de mars, et taxa sa prédiction de fausseté
: « Elles sont arrivées, dit l’augure, mais elles ne sont pas
passées. »
[xv] C. Cassius
avait médité de tuer César à lui seul. Il eût exécuté son projet
en Cilicie, aux bouches du Cydnus, si César n’avait pas changé
brusquement son itinéraire. Voir la Seconde Philippique.
Plutarque nous montre ce grand conjuré, au moment de mettre la
main à l’œuvre, portant les yeux sur la statue de Pompée et
invoquant en silence l’adversaire de César, quoiqu’il fût dans
les sentiments d’Épicure ; mais la vue du danger présent avait
pénétré son cœur d’un vif enthousiasme.
[xvi] Récit de
Suétone, traduction de La Harpe : « Dès que César eut pris
place, les conjurés l’entourèrent dans le dessein apparent de
lui rendre leurs devoirs. Aussitôt Tullius Cimber, qui s’était
chargé du premier rôle, s’approcha pour lui demander quelque
chose. Mais César ayant refusé de l’entendre, et lui ayant fait
signe de remettre l’affaire à un autre moment, Cimber saisit sa
toge aux deux épaules. “ C’est de la violence ! ” s’écria César.
Alors l’un des deux Cassius, auquel il tournait le dos, le
blessa, un peu au-dessous de la gorge. César arrêta le bras de
Cassius et le perça de son stylet. Il voulut s’élancer, mais une
autre blessure l’en empêcha. Quand il vit, de tous côtés, les
poignards levés sur lui, il s’enveloppa la tête de sa toge, et
de la main gauche en abaissa les plis jusqu’au bas de ses
jambes, pour voiler la partie inférieure de son corps et tomber
plus décemment. Il fut percé de vingt-trois coups. Au premier,
il poussa un gémissement sans proférer aucune parole. Cependant
quelques historiens racontent qu’il dit à Brutus, qui s’élançait
pour le frapper. « Et toi a aussi, mon fils ! »
Suétone est le seul historien qui
rapporte cette apostrophe à Brutus. Brutus passait pour fils de
César, étant venu au monde lorsque César était l’amant de sa
mère Servilie, soeur de Caton.
On comprendra que dans une action
aussi tumultueuse aucun conjuré ne se soit rendu un compte bien
exact de la part qu’il prenait au meurtre, et que les
spectateurs de cette scène de confusion n’y aient rien démêlé
avec certitude. Aussi la série de ses épisodes est-elle
présentée diversement par les historiens, après le premier coup,
qui fut certainement porté par Casca. Appien est d’accord avec
Suétone sur la direction de ce premier coup vers la jugulaire,
mais ajoute qu’il fut détourné par César, et l’atteignit au
bas-ventre.
Nicolas de Damas compte
trente-cinq blessures. Les autres historiens vingt-trois.
Suivant Suétone, de tant de
blessures, la seule que le médecin Antistius trouva mortelle fut
la seconde, reçue dans la poitrine. Suivant Appien, cette
seconde blessure avait été portée dans le flanc.
L’acharnement avec lequel
frappèrent les conjurés fut tel que quelques-uns se blessèrent
les uns les autres. Brutus fut blessé à la main.
Le récit d’Appien fait croire à
une résistance beaucoup plus énergique et plus longue de la part
de César, que ceux de Suétone, de Nicolas et de Plutarque.
C’est sans cloute après que les
conjurés eurent tous enfoncé leur fer dans le corps qu’il faut
placer l’exclamation de Brutus à Cicéron absent, rapportée par
ce dernier dans la Seconde Philippique. Il s’écria : « O Cicéron
! » rapprochant dans sa pensée l’exécution de César de la
conduite de Cicéron, lors de la conspiration de Catilina.
[xvii] Président
de Jeux publics. C’était toujours un personnage éminent. Sa
fonction était de terminer les discussions, de proclamer les
vainqueurs et de décerner les prix.
|