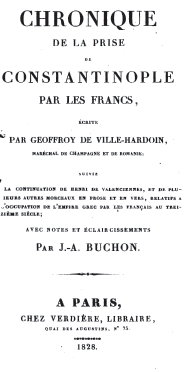
NICETAS
LES MONUMENTS DÉTRUITS OU MUTILÉS PAR LES CROISÉS EN 1204.
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
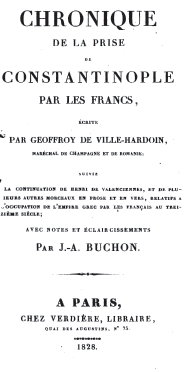
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
DISCOURS DE
Nicétas Choniatès a écrit en 21 livres l'histoire de l'empire Byzantin, depuis la mort d'Alexis Comnène, en 1118, jusqu'au règne de Baudouin. Outre la traduction du président Cousin, il existe une traduction du troisième livre de Nicétas,[1] qui comprend la prise et la destruction de la ville de Constantinople par les Latins. Sa narration a d'autant plus de prix qu'il y assista et y combattit. Il raconta d'une manière fort intéressante les accidents de sa sortie de Constantinople, sans domestiques, à pied, au milieu de l'hiver, avec sa femme enceinte et sa fille qui avaient couvert leurs visages de terre pour en déguiser la beauté et échapper aux insultes des Latins.
On a encore de Nicétas un fragment précieux sur les monuments détruits ou mutilés par les Croisés, publié dans la troisième partie de l’Imperium orientale de Banduri, et dans la Bibliothèque de Fabricius (t. VI, p. 405-18). La traduction que j'en publie est de M. le comte d'Hauterive, qui m'a permis de la reproduire ici.[2]
****************************
Les brigands qui se rendirent maîtres de Constantinople, affamés d'or, comme tous les peuples barbares, se livrèrent à des excès inouïs de pillage et de désolation. Ils ouvrirent les tombeaux des empereurs qui décoraient l'hiéron du grand temple ; ils enlevèrent les richesses qui s'y trouvaient, les perles, les pierres précieuses, les diamants, trésors respectés depuis tant de siècles, et dont ils s'emparèrent avec une avidité effrénée. Ils outragèrent le corps de l'empereur Justinien, que l'injure des temps avait épargné : ils admirèrent ce prodige, mais ils n'en dépouillèrent pas moins le cadavre de ses vêtements funèbres. On peut dire que ces conquérants féroces n'ont fait grâce ni aux vivants ni aux morts : ils ont insulté Dieu ; ils ont outragé ses ministres ; ils ont épuisé tous les genres d'impiété. Enfin, ils ont déchiré en lambeaux ce magnifique voile du grand temple, tissu d'or et d'argent pur, estimé plusieurs millions de mines, et beaucoup plus beau que celui qu'on voit à présent.
A ce brigandage en succédèrent bientôt de nouveaux. Le besoin d'argent (car l'avarice des Barbares n'est-elle pas insatiable?) les fit recourir aux statues de bronze, qu'ils jetèrent au feu. Cette Junon d'airain massif, colossale, qui ornait le forum de Constantin, brisée en morceaux, fut fondue la première. Un chariot, attelé de quatre chevaux, put à peine traîner la tête jusqu'au palais. Le beau Paris fut aussi renversé de sa base ; il était auprès de Vénus, et lui présentait la pomme, source d'une discorde fatale. Qui n'admira pas les reliefs de cette pyramide élevée, qui dominait sur toutes les colonnes, dispersées dans la ville? Tous les oiseaux, dont les chants célèbrent le printemps y étaient représentés. On y voyait les travaux de l'homme des champs, les instruments du labourage, les meubles de la ferme, les brebis bêlantes, les agneaux bondissants. Une immense mer s'étendait au loin : elle était peuplée d'une foule innombrable de poissons, dont les uns tombaient dans les filets des pécheurs, d'autres échappaient de leurs mains, et, recouvrant leur liberté, se précipitaient dans les flots. Des amours, deux à deux, trois à trois, nus, se défiant, exprimaient leur folâtre joie, en luttant ou en se jetant des pommes. Sur le sommet aigu de la pyramide était une statue de femme que les vents faisaient tourner dans tous les sens, et qu'on appelait pour cette raison Anemodulion. Cet ouvrage prodigieux fut condamné aux fourneaux, ainsi que la statue équestre, héroïque et colossale du Taurum, placée sur une base en forme de table, et que quelques-uns croyaient être celle de Jésus, fils de Marie, parce que le cavalier, étendant la main vers le soleil couchant, semblait montrer Gabaon. La plupart disent cependant que c'était Bellérophon ; car le cheval volait sans frein dans la plaine, indépendant, comme Pégase, du cavalier qu'il portait, et battant l'air de ses ailes en même temps qu'il frappait la terre de ses pieds. Une fable répandue alors rapportait que, sous l'ongle du pied gauche intérieur, était cachée la figure d'un homme de la faction verte, ou d'un Romain des pays occidentaux, ou peut- être d'un Bulgare. Du reste, cet ongle était inséparablement attaché à la base, pour qu'on ne pût avoir la figure qu'il recelait; mais quand on eut mis le cheval en pièces pour le jeter dans le creuset, on ne trouva qu'un cachet enveloppé d'un drap de laine. Les Latins, peu curieux du sens des caractères dont il portait l'empreinte, le mirent au feu avec les autres débris de la statue.
Les Barbares, ennemis de tout ce qui est beau, n'épargnèrent pas davantage les autres statues de l'Hippodrome ; ils anéantirent tous les monuments de l'antiquité. Les médailles, chargées d'inscriptions intéressantes, furent vendues, sans égard à leur valeur; on les changea pour rien, et ces pièces rares, qu'on avait recueillies à grands frais, devinrent dans leurs mains une vile monnaie. Ainsi périt l'Hercule Tri-Hespérus, ce grand et magnifique chef-d'œuvre de sculpture qu'on voyait dans le Cophius. Il était couvert de la peau du lion; l'immobilité de l'airain n'empêchait pas qu'on ne vît ses yeux se rouler avec fureur ; il ne portait point de carquois ; son arc n'était point dans ses mains; il n'était plus armé de sa massue; mais, roidissant la main et la jambe droite avec effort, et fléchissant le pied gauche jusqu'aux genoux, appuyant sur son coude sa main gauche qu'il tenait élevée, et sur laquelle sa tête, opprimée par la douleur, était à demi soutenue, il déplorait sa destinée; il maudissait les travaux qu'Eurysthée, jaloux de sa gloire, lui imposait sans besoin, abusant insolemment des faveurs de la fortune. Sa large poitrine, ses larges épaules, sa chevelure épaisse, ses bras nerveux, les muscles robustes qui dessinaient ses reins, et sa stature enfin, étaient faits, comme je le présume, sur la vraie mesure attribuée à Hercule par Lysimaque, dont cette statue de bronze fut le premier et le dernier ouvrage de ce genre. Sa forme colossale était telle qu'un fil, qui mesurait la circonférence d'un de ses pouces, pouvait ceindre un homme, et que la dimension de sa cuisse égalait la taille des hommes les plus grands. Ces destructeurs qui mettent la vengeance au-dessus de toutes les vertus et s'en attribuent la prérogative, ne respectèrent pas ce symbole de la force humaine.
On fit fondre encore l'âne chargé, marchant en ruant contre l'ânier qui le suivait. Auguste avait fait placer ce groupe dans la ville d'Actium, que les Grecs appellent Nicopolis, en mémoire de la rencontre qu'il avait faite d'un âne et de son conducteur, une nuit qu'il allait à la découverte de l'armée d'Antoine, dont ce villageois lui indiqua le camp, en lui répondant qu'il s'appelait Nicou (heureux), et son âne Nicandre (vainqueur), et qu'ils portaient des provisions à l'armée dé César. La truie et la louve qui allaitèrent Romulus et Rémus eurent le même sort, et pour des monnaies de la plus médiocre valeur. Ainsi furent sacrifiés les plus vénérables monuments de notre antiquité. Il en est de même de l'homme qui combattait un lion, de l'Hippopotame, dont le train de derrière se termine en queue écailleuse ; de l'éléphant qui agitait sa trompe; des sphynx, femmes charmantes par la partie antérieure de leur corps, terminées ensuite en monstre horrible : les plus extraordinaires étaient celles qui paraissaient marcher, déployant leurs ailes et défiant les plus agiles oiseaux; et le cheval indompté, dont l'oreille inflexible, la bouche frémissante et les bonds, signes de sa joie et de sa fierté, annonçaient l'indépendance. J'ajouterai l'horrible Scylla, femme depuis la tête jusqu'à la ceinture, femme gigantesque, dont l'attitude exprimait la force et la férocité ; ses flancs vomissaient les monstres qui se précipitèrent sur le vaisseau d'Ulysse pour dévorer ses malheureux compagnons. On voyait encore, dans l'Hippodrome, un aigle d'airain, ouvrage d'Apollonius de Thyane, et le plus bel instrument de ses prestiges. Quand ce philosophe vint à Constantinople, les Byzantins, dont le séjour était infecté par des serpents, le conjurèrent de les garantir de ce fléau. Le magicien, ayant évoqué dans une orgie secrète les plus puissants démons, après la célébration de ses coupables mystères, fit placer sur une colonne un aigle, dont la vue, semblable au chant des syrènes, avait tant de charme, qu'elle enchaînait les spectateurs. Comme il déployait ses ailes pour s'envoler, un serpent, qu'il tenait sous ses pieds, s'efforçait d'arrêter son essor, en l'enveloppant des replis de son corps tortueux, s'élançant lui-même pour saisir ses ailes; mais le monstre, gonflé de venin, faisait d'inutiles tentatives. Serré dans les griffes de l'oiseau, il semblait moins lutter contre lui que s'assoupir de lassitude; il retenait ses poisons impuissants; tandis que l'aigle, avant de signaler sa victoire par des cris de triomphe, faisait un dernier effort pour enlever avec lui son ennemi dans les airs, comme la joie de ses yeux et l'agonie du monstre le faisaient augurer. En voyant le serpent ainsi abattu, on ne pouvait s'empêcher d'espérer que le vainqueur, dédaignant de se repaître de cette vile proie, laisserait tomber ce cadavre et ses poisons; qu'il effraierait, par cet exemple, ceux qui désolaient Byzance, et leur persuaderait de fuir dans leurs asiles.
Un prodige de plus dans cet ouvrage admirable était le cadran, dessiné sur les plumes des ailes, qui indiquait les heures du jour à ceux qui connaissent ces caractères, quand le ciel n'était pas couvert de nuages.
Que dirai-je d'Hélène, de la blancheur de ses bras, de sa jambe parfaite, de sa taille divine, de cette Hélène qui conduisit toute la Grèce sous les murs de Troie, et causa la ruine de cette superbe ville? Elle s'enfuit en Egypte, et ce ne fut que dans un âge avancé qu'elle désira de rentrer dans la Laconie. N'adoucit-elle pas la férocité de ces barbares habitants? N'amollit-elle pas ces âmes de fer? Tout était possible à celle dont les regards enchaînaient ceux qui considéraient ses attraits. Son image semblait pouvoir opérer les mêmes prodiges. Quoique vêtue sans dignité, elle laissait éclater aux yeux avides toute la fraîcheur de ses charmes mal voilés par une tunique légère, par son voile, sa couronne, et les tresses de ses cheveux, plus déliés que les fils invisibles de l'araignée. Sa chevelure, attachée seulement à la hauteur du col, flottait au gré des vents, et retombait jusqu'aux pieds en tresses ondoyantes. Sa belle bouche, entr'ouverte comme le calice d'une jeune fleur, semblait offrir un passage à sa voix; et le plus doux sourire, se plaçant aussitôt sur ses lèvres, en faisait passer toute la joie dans l'âme de ceux qui la voyaient. Aucune langue ne peut peindre, et la postérité ne sentira jamais tout ce qu'il y avait de grâce répandue dans ses yeux, dans le contour de ses sourcils, et sur tous les autres charmes de ce corps divin. Mais, ô fille de Tindare ! modèle de beauté, triomphe des amours, émule de Vénus, chef-d'œuvre de la nature, digne prix d'une interminable guerre ! qu'as-tu fait de ce Nepenthès, don inestimable de la femme de Thonis? Où est la toute-puissance de tes charmes? Pourquoi n'en fais-tu pas aujourd'hui, sur le cœur de ces barbares, l'usage que tu en faisais autrefois? Peut-être les destins ont-ils voulu que le fer dont tu embrasas tant de cœurs servît à te consumer un jour; et les descendants d'Enée ont-ils voulu, peut- être par ressentiment, te condamner aux flammes que ta beauté alluma dans Ilion? Mais non; la soif de l'or ne permet pas de recourir à d'autres motifs, soif barbare, qui seule a ravagé la terre et détruit les rares et sublimes ouvrages des arts. Ces Barbares, d'ailleurs insensibles au pouvoir de la beauté, vendent leurs femmes pour quelques oboles, ne se passionnent que pour ce vil métal, passent les jours entiers à jouer, et finissent leurs jeux forcenés par des combats féroces, établissant, pour prix de la victoire, leurs biens, leurs femmes, ces femmes qui les ont rendus pères, et tout ce qu'ils possèdent, enfin jusqu'à ce trésor, dont la conservation est la plus vive passion de tous les hommes, la liberté ! Ne nous étonnons pas (je cite ces vers en parlant d'hommes sans culture et sans lettres, parce qu'ils regardent Hélène) :
Ne nous étonnons pas que tant de maux affreux
Affligent à la fois Ilion et la Grèce;
Sa beauté dans le ciel eût divisé les Dieux,
Et donné de l'alarme à plus d'une Déesse.
sur le piédestal on voyait une jeune femme, d'une taille admirable, dont la chevelure, relevée sur le front, était tressée en arrière avec beaucoup de grâce; elle était placée de manière qu'on pouvait y atteindre avec la main. La sienne, qui n'était appuyée sur rien, soutenait un cheval par un de ses pieds avec autant d'aisance que si c'eût été un fuseau. Le cavalier était robuste et armé ; ses jambes étaient couvertes d'une espèce de bottine, et il avait l'attitude guerrière. Le cheval dressait les oreilles comme s'il eût entendu le son de la trompette; le col élevé, l'œil plein de feu, il semblait se précipiter en avant avec fureur; ses pieds de devant, suspendus en l'air, annonçaient l'ardeur des batailles.
Au-delà de cette statue, proche de la borne occidentale des courses, qu'on appelait de Ribio, on voyait des statues, trophées de ceux qui avaient vaincu dans les jeux. D'un signe de la main, ils ordonnaient aux conducteurs de ne pas abandonner les rênes auprès de la borne, mais de faire tourner les chevaux en les retirant à soi et les aiguillonnant plus vivement, afin que, se trouvant plutôt au-delà du terme, ils obligeassent leurs rivaux de prendre un plus grand détour, et de se laisser vaincre malgré la supériorité de leurs coursiers.
Il est difficile d'exprimer tout ce qu'on pourrait dire sur ce sujet, qu'il n'est pas d'ailleurs dans mon but de traiter plus longuement. Un spectacle, plus intéressant, et le plus curieux de tous par la perfection de l'ouvrage, était celui d'une espèce de bœuf, placé sur une base en pierre ; il n'avait ni la queue ni le col aussi longs que ceux d'Egypte, et il est difficile d'assigner positivement le genre de cet animal ; il en étouffait entre ses dents un autre, dont le corps était garni d'écaillés si aiguës qu'on ne pouvait le toucher impunément. On croyait communément que le premier de ces monstres était un basilic, et l'autre un aspic. Quelques-uns pensaient que c'était un hippopotame, et d'autres un crocodile. Peu m'importe la diversité de ces opinions, je ne veux parler que du nouveau genre de combat qu'on voyait entre ces deux animaux, victimes l'un et l'autre de leurs fureurs, tous les deux vaincus et vainqueurs, recevant et se donnant mutuellement la mort. Le plus grand, infecté des venins de son adversaire, couvert de pustules de la tête aux pieds, était d'un vert livide, couleur que son sang extravasé contractait de la fermentation des poisons dont il était saturé ; ses genoux fléchissaient, et l'on voyait bien qu'il serait étendu par terre si les jambes, qui lui servaient de base, ne l'appuyaient par leur masse. L'autre animal, brisé par les dents de son ennemi, remuant à peine sa queue venimeuse, ouvrait sa gueule et marquait les efforts qu'il faisait pour s'échapper de cette horrible prison ; mais il ne le pouvait : ses pieds, son dos, et la partie de son corps à laquelle sa queue tenait, étaient absolument renfermés dans la mâchoire de son vainqueur; l'avantage était donc égal de part et d'autre : ils combattaient avec autant de succès, et périssaient aussi malheureusement. J'ose dire que cette issue commune de guerres mortelles n'est pas le sort particulier de ces animaux furieux, et qu'elle menace également les hommes, les nations ; celles, par exemple, qui ont détruit notre empire : car, luttant ensuite les uns contre les autres, ces peuples barbares se détruisent enfin, se ravagent et s'anéantissent par la volonté de ce Dieu suprême, ennemi des nations avides de guerre ou de carnage, de ce Dieu qui veut que le juste seul marche en paix sur les monstres des déserts et les foule à ses pieds.
[1] Cette traduction est insérée à la suite d'une édition in-fol. de Villehardouin, donnée à Lyon, en 1601, par les héritiers de Guillaume Rouille.
[2] Elle a déjà été publiée dans l'Histoire du Bas-Empire, tom. XII, p. 678 et suiv.