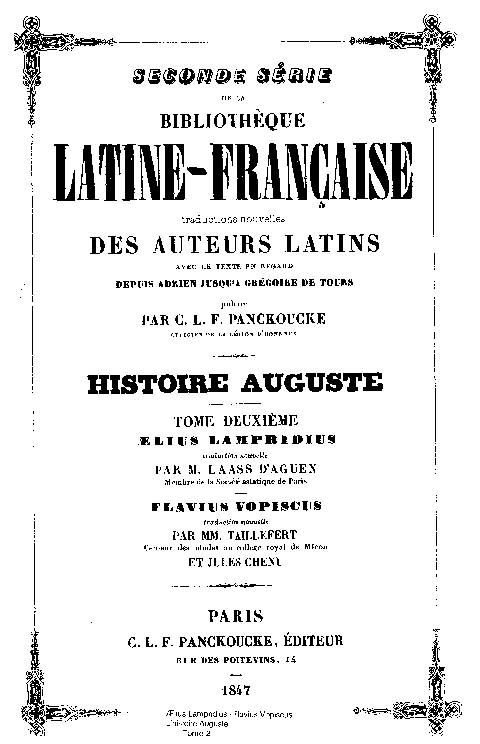|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE L'HISTOIRE AUGUSTE
HISTOIRE AUGUSTE
Vies de Carus, de Numérien et de Carin
282-284 I. C’est le destin qui régit la république, et qui tantôt I’élève au faîte de la puissance, et tantôt la réduit aux dernières extrémités : la mort de Probus l’a suffisamment prouvé. Après avoir traversé les temps, florissante ou affligée, suivant les phases diverses par lesquelles elle avait passé, aujourd’hui agitée par la tempête, demain au comble de la félicité, après avoir été soumise à tous les événements auxquels la vie de l’homme est exposée, elle semblait, après une longue série de malheurs, se raffermir et commencer une suite durable de jours prospères sous Probus, entre les mains duquel le sénat et le peuple avaient remis les lois et les rênes de l’empire, depuis qu’Aurélien, ce prince fougueux, n’était plus ; mais, par une catastrophe épouvantable, aussi désastreuse qu’un naufrage ou qu’un incendie, des soldats furieux, qui semblaient être les instruments du destin, enlevèrent à la république cet excellent prince, et la replongèrent ainsi dans le désespoir, chacun craignant de voir surgir des Domitiens, des Vitellius et des Nérons : car on est plutôt porté à croire méchants que bons les princes dont on ne connaît pas le caractère ; ce qui devait être, surtout dans un État dont les plaies saignaient encore, et qui déplorait les perplexités où l’avaient jeté la captivité de Valérien, les dérèglements de Gallien, et [la violence] de trente tyrans qui avaient morcelé l’empire pour s’en approprier les débris. II. Si nous voulons récapituler les diverses révolutions subies par la république romaine depuis la fondation de Rome, nous trouverons que nul État ne peut se glorifier ou se plaindre d’avoir eu un plus grand nombre de bons ou de mauvais princes. Et, pour commencer par Romulus, qui est le véritable père et le créateur de la république, de quel bonheur ne jouit-elle pas sous lui, qui, après l’avoir fondée, l’ordonna et affermit sa puissance, et qui, parmi tous les fondateurs, est le seul qui ait laissé une ville parfaite ? Parlerai-je ensuite de Numa, qui fortifia par la religion cette ville belliqueuse et grosse de triomphes ? Notre république fut ainsi florissante jusqu’au règne de Tarquin le Superbe ; mais si elle eut à souffrir de la tyrannie de ce prince, elle sut le punir, à quelque prix qu’ait été la vengeance. Elle s’agrandit ensuite jusqu’à l’époque de la guerre contre les Gaulois ; mais, submergée comme par un naufrage, Rome étant prise, à l’exception de la citadelle, elle ressentit peut-être alors plus de maux que jusque-là elle n’avait eu de bonheur. Par la suite elle recouvra toute sa splendeur ; mais les guerres puniques, et la terreur que lui inspira Pyrrhus, l’affectèrent tellement, que son découragement la réduisit aux dernières extrémités. III. Carthage vaincue, elle s’accrut encore et étendit son empire au delà des mers ; mais, affaiblie par la guerre Sociale, ayant perdu jusqu’au sentiment du bien-être, épuisée par les guerres civiles jusqu’au règne d’Auguste, elle ne fut plus qu’un corps usé par la vieillesse. Auguste cependant la rétablit, si l’on peut dire qu’il la rétablit en lui enlevant sa liberté. Quoi qu’il en soit, bien qu’affligée au dedans, elle devint florissante au dehors. Elle eut bientôt à souffrir de la cruauté de tous ses Nérons, et ce n’est que sous Vespasien qu’elle releva la tête. Avant qu’elle eût pu jouir de toute la félicité que semblait lui promettre Titus, le féroce Domitien lui fit de profondes blessures ; elle traversa ensuite, sous Nerva, Trajan et jusqu’à Marc Aurèle, des temps meilleurs, puis fut déchirée par le lâche et cruel Commode. De cette époque jusqu’à Alexandre, fils de Mammée, si l’on en excepte le règne du belliqueux Sévère, elle ne goûta plus aucun bonheur. Pour ne point consigner ici tous les événements qui suivirent, qu’il nous suffise de dire qu’elle ne put jouir du gouvernement de Valérien, et qu’elle eut à gémir pendant quinze années sous celui de Gallien. La fortune inconstante et toujours ennemie de la justice, ne permit pas à Claude de gouverner longtemps l’empire, et, par le meurtre d’Aurélien, par la mort de Tacite, par la fin tragique de Probus, elle a voulu montrer que rien ne lui est plus agréable que les changements incessants dans les affaires publiques. Mais pourquoi ces plaintes ? pourquoi nous occuper des vicissitudes des temps ? Parlons de Carus, qui tient le milieu, pour ainsi dire, entre les bons et les mauvais princes, mais qui pourtant doit plutôt être rangé parmi les premiers, et qui même devrait y occuper une place distinguée, s’il n’avait point laissé l’empire à Carin. CARUS 282-283 IV. Le plus grand nombre des historiens émettent des opinions si peu fondées sur la patrie de Carus que je ne saurais sans hésiter dire à laquelle on doit accorder confiance. Onésime, qui a écrit avec beaucoup de soin la vie de Probus, prétend qu’il naquit à Rome et qu’il y étudia les belles-lettres, mais que ses parents étaient Illyriens. D’un autre côté, Fabius Cerilianus, auteur d’une histoire fort estimable des temps de Carus, de Carin et de Numérien, affirme qu’il naquit non à Rome, mais dans l’lllyrique, et que ses parents n’étaient point Pannoniens, mais Carthaginois. Je me souviens d’avoir lu dans les éphémérides, que Carus était de Milan, mais que son aïeul l’avait inscrit au nombre des citoyens d’Aquilée. Ce qu’il y a de certain (et la lettre qu’il écrivit, étant proconsul, à son lieutenant pour l’exhorter à lui accorder ses bons offices, en est une preuve), c’est qu’il voulait qu’on le crût Romain. Lettre de Carus : « Carus Manlius Aurélien, proconsul de Cilicie, à Junius son lieutenant. — Les princes romains nos ancêtres avaient la coutume, quand ils nommaient des lieutenants, de ne confier les intérêts de la république qu’à des hommes qui pouvaient donner une idée de leur propre caractère. Certes, je n’eusse pas agi autrement qu’eux, quand même je n’aurais point eu à me prévaloir de leur exemple. Je pense que votre zèle ne me fera point repentir d’avoir suivi leurs principes. Faites donc en sorte que nous ne démentions point les Romains nos ancêtres. » Comme on le voit, Carus, dans toute cette lettre, tend à persuader que ses ancêtres étaient Romains. V. Dans sa harangue au sénat, il affecte aussi de se donner la même origine : car dès qu’il fut créé empereur, il écrivit entre autres choses à cet ordre illustre : « Il faut se réjouir, pères conscrits, de ce qu’un des membres de votre ordre, un Romain comme vous, vient d’être appelé à l’empire. Nos efforts, n’en doutez pas, tendront toujours à ce qu’on ne puisse croire que les princes étrangers sont meilleurs que les vôtres. » On voit aussi clairement, par ce passage, qu’il voulait se faire passer pour Romain, c’est-à-dire pour être né à Rome. Comme les inscriptions de ses statues I’indiquent, Carus passa par les grades civils et militaires ; élevé par Probus à la dignité de préfet du prétoire, il sut si bien conquérir l’affection des soldats, qu’après la mort de ce grand prince, il parut seul digne de l’empire. VI. Je n’ignore pas que la plupart des écrivains ont pensé, et même consigné dans leurs histoires, que Probus avait été tué par la faction de Carus ; mais les bienfaits de Probus envers Carus, et la conduite de ce dernier, qui punit sévèrement, et sans distinction de personnes, les meurtriers de son prédécesseur, ne permettent guère que l’on ajoute foi à cette assertion. La lettre que Probus écrivit au sénat relativement aux honneurs à accorder à Carus, montre quelle était son opinion sur lui. « À son très affectueux sénat, Probus auguste, salut. — Notre république serait heureuse (dit Probus entre autres choses), si je pouvais confier les charges de l’État à un grand nombre de sujets aussi distingués que Carus ou que la plupart d’entre vous. Aussi je pense, sénateurs, et je crois ne point trouver d’opposition parmi vous, qu’il convient de décerner une statue équestre à cet homme de moeurs vraiment antiques, et, de plus, de lui construire aux frais du trésor public une maison pour laquelle je fournirai les marbres : car il est de notre dignité de récompenser l’intégrité d’un homme aussi recommandable, » etc. VII. Pour ne pas entrer dans des détails trop minutieux, et ne pas répéter ce qu’on peut trouver dans les autres auteurs, je me bornerai à dire que, dès qu’il fut parvenu à I’empire, il commença, avec l’assentiment de tous les soldats, la guerre contre les Perses, dont Probus faisait les préparatifs, et conféra à ses fils la dignité de Césars. Il désigna donc Carin pour défendre les Gaules avec des hommes d’élite, et emmena avec lui Numérien, jeune homme aussi distingué qu’éloquent. On rapporte qu’il témoignait souvent ses regrets de ce qu’il lui fallait envoyer Carin dans les Gaules, l’âge de Numérien ne lui permettant pas de confier à ce dernier le gouvernement de ce pays, qui réclamait un prince de la plus grande fermeté. Mais je reviendrai sur ce sujet. Il nous est parvenu une lettre de Carus adressée à son préfet, dans laquelle il se plaint de la conduite de Carin, ce qui confirme l’opinion émise par Onésime, que Carus se proposait de retirer le titre de césar à ce fils. Mais, comme nous venons de le dire, ces détails trouveront place plus loin dans la Vie de Carin. Revenons donc à notre sujet. VIII. La guerre des Sarmates, que Carus conduisait, étant en grande partie terminée, il marcha avec un appareil extraordinaire et toutes les forces de Probus contre les Perses, qui, étant alors occupés par une dissension domestique, le laissèrent s’emparer sans résistance de la Mésopotamie, et parvenir jusqu’à Ctésiphon. Ces succès lui méritèrent le titre d’empereur Persique. Mais, avide de gloire, et à l’instigation de son préfet, qui, visant au pouvoir, cherchait sa perte et celle de son fils, il s’avança trop loin, et mourut, selon les uns, de maladie, selon les autres, frappé par la foudre. Il est certain qu’a l’époque de sa mort, le tonnerre se fit entendre avec tant de fracas, que plusieurs personnes périrent, dit-on, de frayeur. L’empereur était donc malade et couché dans sa tente, lorsqu’il s’éleva un violent orage : un éclair terrible brilla, un coup de tonnerre plus terrible se fit entendre, et Carus avait cessé de vivre. Junius Calpurnius, historiographe du prince, adressa sur sa mort la lettre suivante au préfet de Rome (je n’en cite qu’une partie) : « Carus, notre empereur, dont le nom rappelle si bien l’amitié que nous avions pour lui, était malade lorsqu’il s’éleva subitement une furieuse tempête accompagnée d’une obscurité telle, qu’il n’était plus possible de distinguer personne ; bientôt des éclairs qui faisaient paraître le ciel tout en feu, et les coups répétés du tonnerre nous ôtèrent à tous le sang-froid nécessaire pour savoir ce qui se passa alors. Mais soudain part un cri, qui se fit surtout entendre après un grand éclat de tonnerre qui avait partout répandu l’effroi : « L’empereur est mort ! » Joignez à cela que les officiers de la chambre du prince, désespérés de sa perte, brûlèrent sa tente. De là s’est répandu le bruit que Carus avait été frappé par la foudre, tandis que, autant que nous pouvons le savoir, il est certain qu’il a succombé à sa maladie. » IX. Ce qui m’a engagé à rapporter cette lettre, c’est la croyance généralement répandue que, par l’ordre du sort, un prince romain ne peut aller au-delà de Ctésiphon, et que Carus fut foudroyé parce qu’il avait voulu passer les bornes qu’avait posées le destin. Mais laissons à la timidité ses superstitions, que l’homme de courage doit fouler sous ses pieds. Le très vénérable césar Maximien peut, quand il le voudra, marcher en vainqueur sur la Perse, et porter ses armes plus loin encore ; ce qui arrivera, je l’espère, si les, nôtres ne dédaignent point la protection que les dieux nous ont promise. Carus était un prince habile : plusieurs indices le prouvent et entre autres la conduite qu’il tint envers les Sarmates dès qu’il fut parvenu à l’empire. Ces peuples, à la mort de Probus, se montraient arrogants à tel point, qu’ils menaçaient d’envahir non seulement l’Illyrique, mais encore les Thraces et l’Italie. Carus leur fit une guerre si opiniâtre, qu’en peu de jours il leur tua seize mille combattants, leur fit vingt mille prisonniers des deux sexes, et rendit ainsi la sécurité aux Pannoniens. En voilà, je pense, assez sur Carus. X. Passons à Numérien, dont l’histoire, qui se rattache plus intimement à celle de son père, est rendue plus intéressante encore par le crime de son beau-père. Quoique Carin fût l’aîné, et eût reçu le premier le titre de césar, il nous a paru convenable de parler d’abord de Numérien, qui suivit le premier son père au tombeau, nous réservant de revenir ensuite à Carin, que fit périr Dioclétien auguste, ce prince si nécessaire à la république, contre lequel il avait plusieurs fois combattu. NUMÉRIEN 282-284 XI. Numérien, fils de Carus, était doué d’un heureux naturel, et vraiment digne de l’empire ; il était aussi éloquent, au point qu’il prononça des harangues en public. Quelque estime que l’on ait pour ceux de ses écrits qui sont venus jusqu’à nous, il faut convenir cependant qu’ils se rapprochent plus du style déclamatoire que du style cicéronien. Il faisait, dit-on, si bien les vers, qu’il l’emportait sur tous les poètes de son temps : il disputa même la palme à Olympius Némésien, auteur de poèmes didactiques sur la pêche, sur la chasse et sur la navigation, et que son talent avait rendu célèbre dans toutes les colonies. Semblable au soleil, dont l’éclat fait pâlir les autres astres, il éclipsa Aurelius Apollinaire, poète ïambique, qui avait célébré les actions de Carus, son père, en publiant un poème sur le même sujet. On dit que sa harangue adressée au sénat était si éloquente, qu’on décréta en son honneur, non en sa qualité de césar, mais en sa qualité de rhéteur, l’érection d’une statue dans la bibliothèque Ulpienne, avec cette inscription : À NUMÉRIEN CÉSAR, L’ORATEUR LE PLUS DISTINGUÉ DE SON TEMPS. XII. Il accompagna son père à la guerre contre les Perses. Quand il le perdit, les pleurs abondants qu’il versa, lui ayant causé une ophthalmie, genre d’affection auquel l’excès des veilles l’avait rendu fort sujet, il se faisait porter dans une litière. Ce fut alors qu’il fut assassiné par la faction d’Arrius Aper, son beau-père, qui était dévoré de la soif de régner. Pendant plusieurs jours, lorsque les soldats s’informaient de l’état de la santé de l’empereur, Aper leur répondait qu’on ne pouvait le voir, parce qu’il craignait l’irritation que pouvait produire sur ses yeux le vent et le soleil. Toutefois, l’odeur du cadavre dévoila l’affreuse vérité. La faction d’Aper ne put rester longtemps cachée ; tous se jetèrent sur son chef et le traînèrent devant les drapeaux et la place d’armes du camp. Alors se tint une grande assemblée, et l’on dressa un tribunal. XIII. On se demandait quel était celui qui se chargerait de la juste vengeance de Numérien, quel était le prince qui serait donné à la république, quand, par une inspiration divine, toutes les voix proclament auguste Dioclétien, que déjà, dit-on, plusieurs présages avaient désigné pour l’empire. Dioclétien, qui commandait alors la garde du prince, était un homme remarquable, expérimenté, dévoué à la république et aux siens, toujours prêt a satisfaire aux exigences du moment, d’une perspicacité que rien ne mettait en défaut ; quelquefois cependant il affectait de l’effronterie, mais ce n’était que par prudence et pour cacher, sous les dehors d’une fermeté excessive, les chagrins d’un esprit en proie à l’inquiétude. Quand Dioclétien fut monté sur son tribunal et qu’on l’eut salué auguste, on s’informait comment Numérien avait été tué. Tirant alors son glaive, il montra le préfet du prétoire, Aper, et frappa le traître en disant : « Voilà l’auteur de la mort de Numérien ! » Ainsi Aper, après s’être souillé d’un crime auquel l’avait poussé sa coupable ambition, eut une fin digne de son caractère. Mon aïeul m’a rapporté qu’il assistait à l’assemblée lorsque Aper périt par la main de Dioclétien. Le nouveau césar, en frappant le meurtrier, me disait-il, prononça ces paroles : « Félicite-toi, Aper, ce qui me surprend de la part d’un homme de guerre, quoique je n’ignore pas qu’un fort grand nombre de guerriers ont cité des passages, soit grecs, soit latins, tirés d’auteurs comiques et d’autres poètes, et que les auteurs comiques eux-mêmes se plaisent souvent à mettre d’anciens proverbes dans la bouche des soldats. On peut citer comme exemple ce mot de Livius Andronicus : «
Tu cherches bien loin ce que tu as sous la main ; » XIV. Je pense piquer la curiosité du lecteur en rapportant ici, comme y trouvant naturellement sa place, une histoire peu connue sur Dioclétien auguste, et qui fut pour lui le présage de l’empire. Mon aïeul m’a assuré qu’il la tenait de Dioclétien lui-même. Ce prince (me dit-il), encore dans un des plus bas grades militaires, se trouvait dans une hôtellerie de Tongres, ville des Gaules. Un jour qu’il réglait avec une druidesse le compte de sa dépense journalière, cette femme lui dit : « Vous êtes trop avare, Dioclétien ; vous êtes trop économe. — Je serai prodigue quand je serai empereur, » répliqua Dioclétien en riant et en badinant. « Ne plaisantez pas, Dioclétien, reprit alors la druidesse : car vous serez empereur quand vous aurez tué un sanglier[1]. » XV. Depuis lors Dioclétien nourrissait dans son esprit le désir de régner, ce que n’ignorait point Maximien, non plus que mon aïeul, à qui il avait rapporté le mot de la druidesse ; mais il finit par dissimuler, rire et se taire. Cependant, quand il allait à la chasse, jamais il ne laissait échapper l’occasion de tuer des sangliers. Enfin, après avoir vu Aurélien, Probus, Tacite et Carus lui- même successivement appelés à l’empire, Dioclétien dit : « Je tue toujours les sangliers, mais toujours un autre les mange. » Tout le monde connaît, et il n’est pas permis d’ignorer les paroles que prononça Dioclétien en immolant le préfet Aper : « Je l’ai enfin tué, ce sanglier que m’avait désigné l’oracle ! » Mon aïeul m’a encore rapporté que Dioclétien lui avait dit qu’en tuant Aper de sa main, il n’avait eu d’autre but que d’accomplir la prédiction de la druidesse, et que d’affermir son empire : car il n’aurait pas voulu paraître si cruel, surtout dans les premiers jours de son règne, si la nécessité ne l’eût poussé à commettre ce meurtre. Après avoir parlé de Carus, puis de Numérien, nous allons terminer par l’histoire de Carin. CARIN 282-284 XVI. Carin, souillé de tous les crimes plus qu’aucun homme du monde, adultère, corrupteur assidu de la jeunesse (j’ai honte de dire ce qu’Onésime en rapporte), poussa l’infamie jusqu’à se prêter à des débauches que son sexe semblait rendre impossibles. Son père, en partant pour la guerre, lui ayant confié le gouvernement des Gaules, de l’Italie, de I’Illyrique, de l’Espagne, de la Grande-Bretagne et de l’Afrique, à condition qu’il aurait, quoique césar seulement, toutes les prérogatives d’un auguste, il se souilla des vices les plus dégradants et des turpitudes les plus incroyables. II éloigna tous ceux de ses amis qui étaient hommes de bien, et ne retint près de lui ou ne rechercha que ceux qui avaient le caractère le plus méprisable : il nomma préfet de la ville un de ses huissiers, dont la dépravation était au-dessus de tout ce qu’on peut penser et dire. Il fit tuer son préfet du prétoire et le remplaça par un nommé Matronianus, ancien entremetteur de ses débauches. Malgré son père, il déféra le consulat à un de ses secrétaires qu’il avait toujours eu pour confident et pour complice de ses infamies et de ses débordements. Il écrivit au sénat des lettres arrogantes. Il promit à la populace de Rome, qu’il regardait comme le peuple romain, les biens des sénateurs. Il épousa et répudia successivement neuf femmes, qu’il renvoya enceintes pour la plupart. Il remplit le palais de mimes, de courtisanes, de pantomimes, de chanteurs et de corrupteurs de la jeunesse. Il lui répugnait tant de donner sa signature, qu’il avait préposé, pour signer à sa place, un homme de moeurs impures, avec lequel il avait coutume de jouer tous les jours à midi. Il lui arrivait souvent de le gronder de ce qu’il imitait trop bien son écriture. XVII. Il portait des pierres précieuses sur ses souliers ; il ne se servait d’aucune fibule qui ne fût ornée de pierreries, et souvent même son baudrier en était enrichi ; enfin, la plupart des Illyriens l’appelaient roi. II n’alla jamais au-devant des préfets ni des consuls. Il montrait beaucoup de déférence pour les hommes pervers, et les invitait fréquemment à sa table, où souvent, dans un seul repas, on servait cent livres d’oiseaux, cent livres de poisson et mille livres de viandes diverses ; le vin y était versé avec profusion. Il nageait parmi les pommes et les melons. Il jonchait ses salles à manger et ses chambres à coucher de roses de Milan. Il prenait comme tièdes les bains froids, et ces derniers pour lui devaient toujours être à la température de la neige. On rapporte qu’étant venu en hiver dans un endroit où se trouvait une fontaine dont l’eau était très tiède, comme cela est naturel dans cette saison, il dit, aux gens de service, après s’être baigné dans cette eau : « Vous me donnez de l’eau de femme ; » plaisanterie qui passe pour la meilleure qu’il ait faite. Son père, en apprenant quelle était sa conduite, s’écria : « Ce n’est point là mon fils. » Carus avait enfin pris la résolution de le faire mourir (si l’on en croit Onésime) et de lui substituer Constance (qui plus tard fut fait césar, et qui alors était préside de Dalmatie), l’homme le meilleur qu’il connût alors. Il serait trop long de parler davantage de la luxure de Carin ; les personnes qui voudront connaître en détail ses turpitudes, pourront lire Fulvius Asprianus, qui les expose toutes jusqu’à provoquer le dégoût. XVIII. Dès qu’il eut appris que son père avait été frappé de la foudre, que son frère était mort assassiné par son beau-père, et que Dioclétien avait été salué auguste, comme s’il eût été affranchi, par la mort des siens, des entraves que lui imposaient ses devoirs de famille, il se montra plus dissolu et plus criminel que jamais. Toutefois, il ne manqua pas de coeur pour conquérir l’empire qu’on lui disputait : il combattit plusieurs fois contre Dioclétien ; mais il fut défait dans un dernier combat qui fut livré près de Murtium, et y perdit la vie. Ainsi finirent les trois princes Carus, Numérien et Carin, après lesquels les dieux nous donnèrent Dioclétien et Maximien, ces grands hommes auxquels ils joignirent Galérien et Constance, dont l’un est né pour laver l’ignominie de la captivité de Valérien, l’autre pour remettre les Gaules sous les lois romaines. Ces quatre maîtres du monde furent courageux, sages, bienveillants, généreux, animés du même désir de faire prospérer la république, modérés envers le sénat, amis du peuple, pénétrés des devoirs que leur imposait leur puissance, tels, en un mot, que nous avons toujours demandé des empereurs aux dieux. Claudius Eusthenius, secrétaire de Dioclétien, a publié séparément leur biographie. Je mentionne ce fait, pour m’excuser à l’avance de ne pas entreprendre un travail aussi difficile : car on est toujours exposé à la critique, surtout lorsqu'on écrit l’histoire de princes vivants. XIX. Carin et Numérien rendirent surtout leur règne remarquable en donnant au peuple romain des jeux embellis de nouveaux spectacles qu’on voit encore représentés en peinture dans le palais situé près du portique de I’Étable. On y offrit à la curiosité du public un acrobate chaussé de cothurnes, qui semblait suspendu dans les airs ; un tichobate qui, pour éviter un ours, courait sur un mur ; des ours qui jouaient la pantomime ; des concerts de cent trompettes, de cent cors, de cent flûtes, de cent cornemuses ; mille pantomimes et gymniques ; en outre, une machine de théâtre dont les flammes consumèrent la scène, que Dioclétien, par la suite, fit reconstruire avec plus de magnificence encore qu’auparavant. On fit venir aussi de toutes parts des mimes ; on exécuta, de plus, des exercices sarmates, la chose du monde la plus agréable à voir ; on montra un cyclope. Les artistes grecs, les gymniques, les histrions et les musiciens reçurent en présent de l’or, de l’argent et des vêtements de soie. XX. Je ne sais combien toutes ces choses peuvent plaire au peuple, mais il est bien certain que les bons princes n’y attachent aucune importance. On rapporte qu’un des préposés aux menus plaisirs de Dioclétien, lui vantait un jour les spectacles donnés par Carus, disant que ces princes s’étaient rendus fort populaires par les représentations théâtrales et les jeux du Cirque. « Carus a donc bien ri [ou on a donc bien ri aux dépens de Carus] pendant son règne, » reprit l’empereur. Enfin Dioclétien ayant donné lui-même des jeux où il avait convoqué toutes les nations, et n’ayant pas fait preuve dans cette occasion d’une grande libéralité, dit : « II faut de la réserve dans les jeux quand le censeur y assiste. » J’engage Junius Messalla, que j’ose ici blâmer sans crainte, à lire ce passage, lui qui priva ses héritiers de son patrimoine pour l’offrir à des histrions, lui qui donna la tunique de sa mère à une comédienne, et la Iacerne de son père à un comédien : je l’excuserais encore s’il avait couvert quelque acteur tragique du manteau de pourpre rehaussé d’or de son aïeul, pour lui tenir lieu de robe traînante. On voit encore brodé sur un manteau de couleur pourpre violette d’un joueur de flûte, dont celui-ci s’enorgueillit comme d’un noble trophée, le nom de Messalla et celui de son épouse. Que dirai-je maintenant du lin tiré d’Égypte ? des étoffes de Tyr et de Sidon, si fines que l’oeil pénètre leur tissu, si brillantes de pourpre, et que le travail difficile de la broderie rend plus précieuses encore ? On y donna aussi des soies tirées du pays des Atrébates, des mantelets de Canusium, et de riches tuniques d’Afrique qu’on n’avait point encore vues sur la scène. XXI. Je consigne ici ces faits, afin d’exciter, chez ceux qui, à l’avenir, donneront des jeux, un sentiment honnête qui les empêche de dissiper pour des histrions et des bateleurs un patrimoine qui doit passer à de légitimes héritiers. Acceptez, mon cher ami, cet ouvrage : je ne le publie point, je vous l’ai souvent dit, comme un modèle d’éloquence, mais parce qu’il me semble propre à piquer la curiosité du lecteur, et que j’ai surtout à coeur d’épargner des recherches à ceux qui voudraient écrire l’histoire des empereurs en l’ornant des agréments du style : ils trouveront dans ce petit volume des matériaux qui n’attendent que leur talent. Soyez donc assez indulgent pour ne pas dédaigner mon offrande, et persuadez-vous bien que si ce livre n’est pas mieux écrit, c’est qu’il n’a pas été en mon pouvoir de mieux faire.
-------------------------------------------------------------------------------- [1] Allusion à Aper, nom propre et nom commun signifiant sanglier.
|