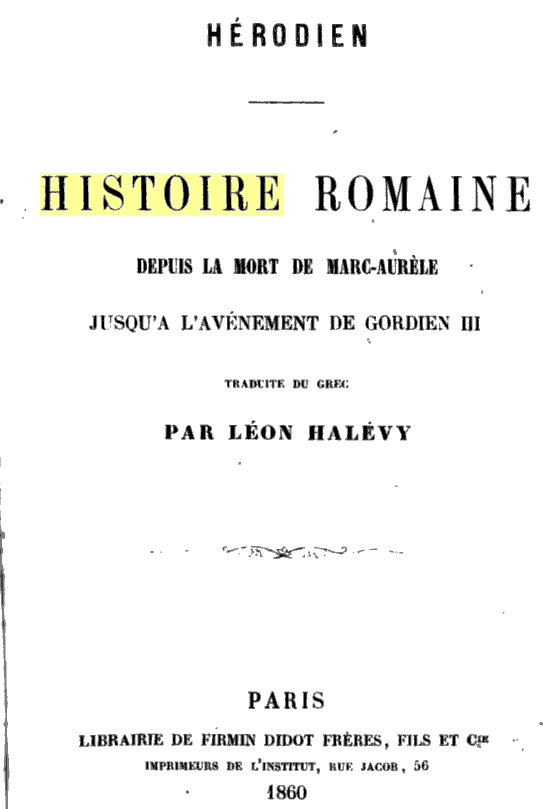
HÉRODIEN
HISTOIRE ROMAINE.
INTRODUCTION
Traduction française : Léon HALEVY.
INTRODUCTION.
I.
Nous ne connaissons rien de la vie d'Hérodien ; tout ce que nous en savons d'après lui-même, c'est qu'il a vécu sous le règne des empereurs dont il a écrit l'histoire; et qu'il a rempli quelques fonctions soit près du prince, soit dans l'État. Son histoire, écrite en grec, d'un style élégant, pur et souvent énergique, embrasse une période de soixante années environ, depuis la mort de Marc-Aurèle, l'an de l'ère chrétienne 180, jusqu'à l'avènement du jeune Gordien, l'an 238.
L'époque de sa vie est déterminée par son propre témoignage: « Pour moi, dit-il (01), j'ai assisté à l'histoire que j'entreprends d'écrire; elle n'est ni inconnue, ni sans témoins; elle vit toute récente dans la mémoire de mes lecteurs; je veux l'écrire avec un respect religieux pour le vrai (02)
Le grand nombre de princes qui « dans le court intervalle de soixante années, passèrent sur le trône, a rendu cette époque fertile en faits neufs et originaux. » Dans un autre passage, il s'exprime ainsi : « Je bornerai ma tache aux faits postérieurs à la mort de Marc-Aurèle; ils forment les souvenirs de ma vie entière; je les ai vus, je les ai entendus; j'y ai pris part dans mes fonctions auprès du prince ou de l'État (03). » Enfin, dans une partie un peu plus avancée de son histoire, il tient un langage différent sur la période de temps qu'elle embrasse, et il semble avoir agrandi son cadre de quelques années : « Le seul but, dit-il, que je me sois proposé, c'est de réunir dans un seul tableau les faits importants dont j'ai été le témoin sous le règne de plusieurs princes et dans une période de soixante-dix ans (04). » Il faudrait donc supposer que cette dernière partie de son histoire, s'il l'a écrite, comprenait les règnes de Gordien III et de Philippe jusqu'à l'empereur Dèce (l'an de j-C. 249), et qu'elle n'est point parvenue jusqu'à nous; s'il n'était plus naturel de penser qu'il s'en est tenu au terme qu'il s'était primitivement assigné, ou que la mort l'a empêché de poursuivre. Il ne s'agit, du reste, que de deux règnes peu importants (le second surtout ), et n'embrassant qu'un espace de onze années.
Hérodien commence ses récits à la mort de Marc-Aurèle. L'éclat de cette vertu si pure, de cette noble vie, de ce beau caractère, illumine les premières pages de son histoire, qui n'offrira plus guère ensuite qu'un triste tableau de dégradation et d'abaissement. Il est, en général, sobre de réflexions ; mais son récit est animé, coloré ; c'est un narrateur et un peintre, plutôt qu'un historien dans l'acception philosophique du mot. On voit cependant que des sentiments généreux l'inspirent, et il flétrit avec une noble indépendance les honteux excès des princes dont il nous raconte la vie. Il semble comprendre que la douloureuse vérité qui ressort de ses récits s'y manifeste assez d'elle-même, sans qu'il soit nécessaire d'y arrêter la pensée de ses lecteurs. Quelquefois cependant la décadence de l'empire, l'avilissement du peuple romain, la basse avidité des soldats lui arrachent d'éloquentes paroles. Quand il montre Didius Julianus conduit au palais par les prétoriens qui lui ont vendu l'empire, au milieu du silence du peuple qui se contente de l'injurier de loin, il ajoute : « C'est à cette époque surtout que commença la corruption des soldats. Depuis ce temps, ils montrèrent une insatiable et hideuse cupidité, et affichèrent le plus grand mépris pour le souverain. Ils avaient vu triompher leur audace et Pertinax mourir sans vengeur; l'empire avait été mis à l'encan, et acheté sans que personne s'opposât à une pareille infamie; cotte impunité les encouragea, fit naître leurs honteux excès et fomenta leur indiscipline (05). » Ailleurs, quand Septime Sévère, traversant la Pannonie, arrive aux frontières de l'Italie pour s'emparer de l'empire : « La vue d'une si nombreuse armée, dit l'historien, épouvante les villes d'Italie. Les habitants de cette contrée, depuis longtemps étrangers à la guerre et aux armes, ne songeaient plus qu'à cultiver en paix leurs champs. Du temps do la république, lorsque le sénat nommait les généraux, tous les habitants de l'Italie portaient les armes; ce sont eux qui soumirent la terre et les mers, triomphèrent des Grecs, des Barbares, et ne laissèrent aucun pays, aucun climat sans y étendre leur domination. Mais lorsqur Auguste devint le seul maître de l'empire, il habitua son peuple au repos, le désarma, prit à sa solde des étrangers mercenaires, auxquels il confia la défense de ses frontières, déjà protégées d'ailleurs par deo vastes fleuves, des précipices et d'impraticables déserts (06). »
Le premier traducteur d' Hérodien fut
Ange Politien, dont la version latine parut en 1493, et la première
édition grecque de cette histoire fut publiée par les Aldes en 1503:
l'original ne fut donc imprimé que dix années après la traduction.
L'oeuvre de Politien est renommée pour son élégante latinité; mais
on peut lui reprocher avec raison d'avoir souvent altéré le sens, et
d'en avoir usé avec son modèle plus librement qu'il n'est nécessaire
dans une version latine, où un calque presque rigoureux est permis :
l'écrivain grec, en un mot, ne se retrouve pas toujours, avec sa
physionomie véritable, sous la plume habile de Politien. La première
traduction française d'Hérodien, qui puisse mériter à peu près ce
titre, est celle de Bois-Guillebert, qui parut en 1675. Ce
traducteur dit naïvement dans sa préface, en parlant d'Hérodien : «
Quoique son histoire ne comprenne que ce qui s'est passé durant
soixante-dix ans ou environ, elle raconte des accidents et des
révolutions si extraordinaires, que le récit n'en parait pas
désagréable, vu que de treize ou quatorze (07)
empereurs dont il décrit le règne, Sévère est le seul qui soit mort
dans son lit. » Entre cette traduction et celle de l'abbé Mongault,
de l'Académie française, qui fut publiée en 1700 (08),
il semble qu'un siècle se soit écoulé, tant dans ce court espace de
vingt-cinq années la langue a changé de physionomie. Mongault a
commencé la série de ces traducteurs incolores, dont la prose sans
mouvement et sans vie fut à la langue de Fénelon ce que la poésie de
Campistron fut à la poésie de Racine. Dans le langage incorrect et
rude de Bois-Guillebert, il y a au moins une certaine énergie, un
certain relief, où revit de temps à autre l'aspect du modèle.
Mongault a tout effacé. C'est un de ces traducteurs qu'on a
longtemps appelés élégants, auxquels la plupart des biographes
conservent ce titre traditionnellement et de confiance, mais qui
sont mis aujourd'hui à leur véritable place par ceux qui les lisent.
Son plus grand défaut n'est pas l'infidélité; mais il travestit
constamment à la française l'écrivain grec, et il justifie son
système de traduction dans une préface et dans des remarques qui
sont un curieux monument de la critique et de l'esprit littéraires
du temps. Citons-en quelques exemples.
En parlant de Festus, l'affranchi favori de Caracalla et son secrétaire, Hérodien dit : « Le préposé aux souvenirs de l'empereur (09). » Mongault traduit : « Qui tenait l'agenda du prince. » Il est vrai qu'à la même époque, l'abbé d'Olivet, également do l'Académie française, dans le Traité de la Nature des Dieux, de Cicéron, traduisait forum par l'hôtel de ville (10). Dans le récit de l'assassinat de Caracalla par le centurion Martial, qui avait saisi pour l'exécution de son projet une occasion où l'empereur était obligé de s'arrêter solitairement dans un endroit écarté, Hérodien dit : « qu'au moment où le « prince avait le dos tourné et détachait ses vêtements (11), Martial le frappe à la gorge... » L'abbé Mongault dit qu'il a supprimé ici une circonstance (celle des vêtements détachés) que la politesse de notre langue ne lui a pas permis de laisser dans sa traduction : « M. de B. G. (12), ajoute-t-il, n'a pas cru ses lecteurs si difficiles; il leur dit tout crûment que Caracalla fut tué comme il renouait son aiguillette; et il les avait préparés à cette grossièreté par une autre qui la valait bien. » Ainsi, ce qu'il trouve de répréhensible dans ce détail, c'est sa grossièreté, et non pas l'étrangeté de la traduction qui réunit le plus ridicule anachronisme au contresens. L'autre détail non moins grossier qu'il relève, et par lequel , dit-il, Bois-Guillebert avait « préparé » ses lecteurs, c'est que ce traducteur, suivant Hérodien jusque dans cet endroit écarté où il nous le montre obligé de s'éloigner sans témoins, pousse le scrupule de la traduction jusqu'à une fidélité tout à fait cruelle pour cette « politesse de la langue française » dont parle l'abbé Mongault, ce qui n'empêche pas ce digne abbé de reproduire textuellement les expressions par trop réalistes de Bois-Guillebert (13).
Pour le dire en passant, la traduction
de ce vieil écrivain est, en général, beaucoup plus fidèle que celle
de l'abbé Mongault, quoique ce dernier l'accuse d'une manière assez
peu courtoise, avec une évidente injustice, et, à coup sûr, sans
preuves, d'avoir traduit sur la version latine de Politien.
Rien de plus curieux, nous l'avons dit, que les Remarques dont
l'abbé Mongault a accompagné sa traduction. Tantôt il dit que « pour
empêcher une équivoque, il transpose une période, afin d'empêcher le
lecteur de prendre à gauche. » Il ajoute que de M. Bois-Guillebert
n'a pas été si habile à se garer de cette maudite équivoque, et
qu'il a donné tout au travers. Tantôt il supprime une expression,
disant « qu'elle n'est pas assez de nos manières pour la faire
passer dans notre langue. » Il aurait retranché tel autre passage, «
s'il n'avait consulté que son goût; mais il a été bien aise que Ie
lecteur pût voir quel était celui de son auteur. » Il dit de
quelques autres détails qu'il supprime : « que ce sont des
circonstances qui ne sont bonnes qu'à embarrasser le style. »
Ailleurs il prétend que « les Grecs aiment à parler en lieux communs
et que les Français vont d'abord à l'application, ce qui donne au
style plus de force et de justesse. » Quand Hérodien, racontant la
bataille livrée par Maximin aux Germains sur les bords du Rhin, dit
: « Le marais fut rempli de cadavres, et le lac rougi de sang
offrait l'image d'un combat naval au milieu d'une armée de terre (14)
» ; Mongault traduit : « Il se fit alors un si grand carnage que le
marais devint rouge de sang et fut comblé de corps morts. » Et il
met on note : « La pensée d'Hérodien m'a paru si puérile (l'image du
combat naval), que j'en ai eu honte pour lui, et par charité je l'ai
cachée dans les Remarques. Ceux qui aiment les concetti à
l'italienne m'en feront peut-être une affaire; mais il faut qu'ils
me pardonnent en faveur de quelques autres petits traits du même
goût auxquels je n'ai point touché, sans compter plusieurs
hyperboles un peu difficiles à digérer. On verra dans les remarques
qui me restent à faire quelques figures que j'ai laissées, quoique
j'appréhende qu'elles ne trouveront pas grâce auprès des lecteurs
qui aiment et apprécient la nature. »
Dans sa Préface, où il expose ses principes de traduction avec un laisser-aller et une légèreté de style sans exemple, il annonce qu'il tâchera de justifier dans ses Remarques les principales libertés qu'il a prises. On vient de voir et on peut juger de quelle manière il s'en acquitte : « Pour les autres libertés moins considérables, ajoute-t-il (15), il faut s'en rapporter à un traducteur. On doit être persuadé qu'on ne chicane point son auteur, et qu'on ne se chicane point soi-même à plaisir; et je confesse en mon particulier que je suis fort d'humeur à m'épargner toute peine inutile. » C'est dans ce style qui semble une réminiscence des précieuses, et qui tient à la fois des abbés de ruelle et des marquis de Molière que le grave écrivain présente un système de traduction auquel il ne s'est montré que trop fidèle (16).
Je trouve dans l'ouvrage peu connu d'un ingénieux et savant bénédictin de la fin du siècle dernier (17), cette définition naïve de l'art de traduire : « La fidélité de la traduction consiste à faire dire à un auteur tout ce qu'il dit, à ne lui faire dire que ce qu'il dit, et à le lui faire dire comme il le dit. » Le précepte est bon; mais il est plus facile de le donner que d'indiquer les moyens de s'y conformer; le brave bénédictin l'a tenté. C'est aussi ce que Rollin a essayé de faire dans son Traité des Études, modeste et précieux monument du goût traditionnel des études françaises, en ajoutant à quelques règles pleines de sens l'autorité des exemples (18). Il choisit avec raison quelques lettres de Pline le jeune, traduites par de Sacy; puis il arrive à l'abbé Mongault, dont nous venons de parler, qui a traduit aussi les Lettres de Cicéron à Atticus. On sait que Saint-Réal a publié la traduction de deux lettres de ce célèbre recueil : Rollin les met en regard des deux mêmes épîtres choisies dans la version de l'abbé Mongault. Les deux versions sont médiocres, pour ne pas dire plus. Rollin les compare, fait remarquer les différences, relève les imperfections, les inexactitudes; il signale aussi, avec une rare indulgence, les mérites divers. Il semble voir le digne professeur faire sa classe de seconde au collège Duplessis. C'est presque toujours sous une forme dubitative qu'il émet ses critiques. Il a toutes sortes d'égards pour l'abbé de Saint-Réal, et les plus délicats ménagements pour l'abbé Mongault, « qui a été autrefois, dit-il, son disciple en rhétorique; » et « je nie souviens encore, ajoute-t-il, que dès lors il se distinguait par un goût particulier et une étude exacte de la langue française. » Mais peu après, l'embarras du sage critique devient très grand, car l'écolier semble avoir perdu ces bonnes habitudes de sa jeunesse, et le maître se voit condamné à relever une faute grossière dans la version de son cher disciple, devenu, pour cette traduction des Lettres à Atticus, membre de l'Académie française (19) : « Je me promettais ou plutôt je ne doutais point que cette entrevue ne suffit pour raccommoder tout. (20). » « Je ne sais, dit avec une bonhomie charmante l'excellent Rollin, devenu tout à coup, par la volonté de l'abbé Mongault, professeur de sixième, si notre langue souffre qu'on joigne ainsi deux verbes avec un régime qui ne convient qu'à l'un d'eux, car on ne peut pas dire : « Je me promettais que cette entrevue ne suffît... Mais c'est de M. Mongault, devenu en cela mon maître comme en bien d'autres choses, que je dois recevoir des leçons sur ce qui regarde les délicatesses de la langue française. » Ici personne ne sera de l'avis du bon Rollin.
Du reste, cet abbé Mongault, très faible écrivain, fut un honnête homme et un caractère droit. Il avait été chargé en 1710 de l'éducation du fils aillé du duc d'Orléans, plus tard régent du royaume. Il fut payé de ses soins par la concession de plusieurs bénéfices et par la place de secrétaire général de l'infanterie dont le duc de Chartres était colonel. L'abbé Dubois, devenu premier ministre, le priait un jour d'engager le prince à venir travailler avec lui : « Je n'abuserai jamais, répondit-il, de la confiance du prince pour l'engager à s'avilir. » Ce qui n'a pas empêché Voltaire d'affirmer, nous ne savons sur quels témoignages, que l'abbé Mongault mourut de chagrin de n'avoir pu faire auprès de son élève la même fortune que l'abbé Dubois. La vie laborieuse, quoique mondaine, de l'abbé Mongault, l'âge avancé auquel il mourut (72 ans), et une maladie cruelle dont il souffrit pendant les dernières années de sa vie, laissent à cette accusation peu de vraisemblance.
II.
C'est surtout, nous l'avons dit, par le mouvement et la variété du récit que se distingue Hérodien. Son langage est quelquefois trop fleuri; il abuse des harangues, qu'il place en trop grand nombre peut-être dans la bouche des princes et des généraux, défaut qui lui est commun avec la plupart des historiens de l'antiquité; mais il rachète ces imperfections par le soin qu'il apporte à la peinture des moeurs, des coutumes locales et à la vérité de ses tableaux. Nous en citerons pour exemple son récit des honneurs funèbres rendus à Septime Sévère, et sa description si détaillée des cérémonies de l'apothéose, au milieu desquelles s'accomplissait la divinisation des empereurs, l'une des pages les plus précieuses que nous ait laissées l'antiquité (21). Témoin sincère et véridique, on voit qu'il ne cherche pas à pénétrer le secret de l'histoire, et qu'il semble plutôt croire, comme la plupart des anciens, qu'elle n'en a qu'un seul, les passions de l'homme. S'il n'est pas, dans toute l'acception du mot, un conteur anecdotique, comme Suétone, s'il sait peindre autant que raconter, et s'élève presque toujours jusqu'à toute la gravité de l'histoire, il n'en appartient pas moins, par la nature descriptive et tempérée de ses récits, à la classe des annalistes et des narrateurs, et il contribue à remplir une des lacunes de la littérature ancienne, plus riche en grandes pages, en imposants tableaux, qu'en curieuses esquisses des usages et de la vie intérieure des peuples. Qui ne préfère les Douze Césars de Suétone, si abondants en détails sur la vie intime et secrète des empereurs, à des productions d'un ordre plus élevé, et qui ne donnerait les Notices de cet écrivain sur les rhéteurs, les grammairiens et les poètes, pour ceux de ses ouvrages qui no sont pas parvenus jusqu'à nous, ses livres sur les gymnases des Grecs, sur l'année romaine, sur les spectacles, sur les lois et les coutumes, ses traités des noms propres, des augures, son livre de la république et ses mélanges (de rebus varuii), où il devait nous montrer la vie romaine sous tous ses aspects? Ne donnerions-nous même pas volontiers quelques beaux chapitres de Tacite pour le récit perdu de son voyage à la colonie d'Agrippa?
Lenain de Tillemont juge et apprécie en ces termes Hérodien (22) : C'est un complet hommage rendu à l'écrivain et en même temps une curieuse page d'histoire et de critique au dix-septième siècle :
« Il faut mettre aussi sous ce règne (celui de Gordien III) Hérodien, fort connu par les huit livres grecs qu'il nous a donnés de l'Histoire des Empereurs, depuis la mort de Marc-Aurèle jusqu'à celle de Maxime et de Balbin. Car il nous assure lui-même que l'histoire de ces soixante-huit ou soixante-dix années est celle de son temps et de ce qu'il avait vu; de sorte qu'il devait être extrêmement âgé dès le commencement de Gordien. Il était à Rome à la fin du règne de Commode, et il paraît qu'il avait déjà quelque âge. Il nous assure qu'il avait été employé en divers ministères de la cour et de la police (23), ce qui lui avait donné moyen de prendre part pour lui-même à quelques-unes des choses qu'il rapporte. C'est tout ce que nous pouvons dire de sa vie, car nous avons déjà montré autre part qu'il ne le faut pas confondre avec Hérodien, grammairien d'Alexandrie, qui vivait sous Marc-Aurèle (24).
Pour son histoire, Photius en fait un jugement fort avantageux, car il dit « que son style est clair, élevé et agréable; que sa diction est tempérée, tenant le milieu entre l'élégance affectée de ceux qui dédaignent toute la beauté des expressions communes et naturelles, et le discours bas et sans vigueur de ceux qui se font honneur d'ignorer les règles de l'art; qu'il ne recherche point un faux agrément par des discours inutiles et qu'il n'omet aussi rien de nécessaire; qu'en un mot il cède à peu d'auteurs dans toutes les beautés de l'histoire. » Capitolin, qui en beaucoup d'endroits ne fait que le traduire et l'abréger, et qui le cite assez souvent, lui donne encore un grand éloge, en disant qu'il suit la vérité; mais il ajoute que c'est seulement en la plupart des choses (25). Il le combat en effet en quelques endroits, et nous nous sommes encore cru obligés de l'abandonner en d'autres. Capitolin l'accuse aussi d'avoir été trop favorable à Maximin, pour ne pas l'avoir été assez à Alexandre (Sévère); et cette censure est confirmée par Vossius et par d'autres. Nous n'oserions non plus dire avec Photius qu'il n'omet rien de nécessaire, si on ne l'entend de ce qui regarde la beauté et l'ornement de l'histoire. Car il omet et les dates et beaucoup d'autres choses qui auraient pu éclaircir de grandes difficultés. Il semble avoir plus donné à l'agrément qu'à l'exactitude; je pense qu'il savait peu la géographie. »
Ce reproche fait à Hérodien d'avoir favorisé Maximin aux dépens d'Alexandre Sévère a été plusieurs fois répété sur la foi de Jules Capitolin et de quelques autres écrivains de l'histoire Auguste (26). Il est dénué de tout fondement : il suffit de se reporter au début du septième livre de l'histoire d'Hérodien : « Nous avons consacré, dit-il, le livre précédent à la vie d'Alexandre, et nous avons raconté sa mort après un règne de quatorze ans. Maximin, parvenu à l'empire, changea totalement la face des choses : il usa de son pouvoir avec violence, avec une rigueur qui inspira l'effroi. Il s'efforça do faire succéder partout au gouvernement le plus doux et le plus modéré toutes les cruautés de la tyrannie (27). » Peut-on présenter d'une manière plus saisissante le contraste des deux règnes? Il est vrai qu'Hérodien ne cache aucune des fautes commises par Alexandre Sévère sous l'empire et sous l'influence de sa mère Mammée; il est vrai aussi qu'il trace de l'expédition d'Alexandre contre les Perses un tableau tout contraire aux brilIants récits de Lampride (28). Mais, malgré le surnom de Persique décerné par le sénat à Alexandre et les médailles frappées en l'honneur de ses victoires, l'impartialité connue d'Hérodien, les détails précis dans lesquels il entre sur la négligence et les fausses manoeuvres d'Alexandre, qui amenèrent la déroute de l'armée romaine et sa retraite désastreuse sur Antioche, montrent assez de quel côté se trouve la vérité. Sans doute l'Alexandre Sévère d'Hérodien ne ressemble pas au portrait de fantaisie tracé par Gibbon et d'autres historiens, qui font de ce prince un Louis XII accessible à tous, rendant la justice sous les portiques de son palais, vivant en sage, ayant sous les yeux l'image de Jésus-Christ, en compagnie de celles d'Abraham, d'Orphée et d'Apollonius de Thyanes. Un peu plus, et Gibbon en ferait un lord-maire, un alderman de la cité de Londres. Il vaut mieux, je pense, nous en tenir au récit et au jugement d'Hérodien, son contemporain. Quant à l'omission des dates dont l'accuse Lenain de Tillemont, c'est un reproche très mérité, mais qui peut s'appliquer à un grand nombre des historiens de l'antiquité. Pour ce qui est de la géographie, Hérodien savait celle de son temps; nous trouvons même qu'il trace souvent à grands traits la physionomie des peuples et celle des climats. Nous ajouterons que Lenain de Tillemont et les écrivains de son époque seraient aujourd'hui des géographes très distancés, ce qui n'ôte rien au respect qui leur est dû.
Nous revenons, et à dessein, sur le passage de Photius que cite Lenain do Tillemont, et qui renferme le jugement porté sur Hérodien par le savant patriarche de Constantinople. Rétablissons d'abord cette citation dans sa vérité, car de Tillemont ne nous semble pas avoir traduit Photius avec toute l'exactitude désirable :
« Le style de cet écrivain, dit Photius, est clair, plein de limpidité et d'agrément; il se sert d'expressions tempérées; il n'exagère pas l'élégance attique, qui trop souvent défigure la grâce native du langage vulgaire; il ne tombe point non plus dans la trivialité qui semble fuir tout l'attrait de l'art. En outre, il ne s'enfle jamais d'ornements superflus et n'omet point le nécessaire. Pour le peindre d'un mot, il ne le cède qu'à un petit nombre pour la réunion de toutes les qualités de l'historien (29). »
Dans ce jugement sommaire où les mérites de l'écrivain sont appréciés par le juge le plus compétent, un mot surtout nous a frappé : « Hérodien n'omet point le nécessaire. » Mais cependant une grave pensée s'offre à l'esprit. Hérodien ne dit pas un mot des persécutions des chrétiens, qui occupent une si grande place dans les historiens de l'Église au troisième siècle; il n'en parle pas, et le savant patriarche trouve « qu'il n'omet point le nécessaire. » Hérodien, l'historien si exact et si consciencieux de Septime Sévère, passe sous silence la terrible persécution des chrétiens placée sous ce règne. Il est difficile de comprendre comment il s'abstient de toute mention des martyrs de la religion nouvelle; comment lui, le conteur disert et habile, il ne nomme pas le pape Zéphirin, son contemporain, ni ces fameux sectaires, Praxéas et Natalis, condamnés comme hérétiques, le premier parce qu'il n'admettait qu'une personne en Dieu le second parce qu'il ne voyait dans Jésus-Christ qu'un philosophe et un sage; comment ses yeux ne sont pas frappés des progrès de cette religion naissant, de cette foi, de cette discipline, de cette splendeur que, selon les historiens de l'Église, Zéphirin maintenait dans son clergé. Et le savant Photius, le pieux patriarche (car on peut lui donner ce nom, malgré ses démêlés avec le pape Nicolas Ier et leur excommunication mutuelle), trouve qu'Hérodien « n'omet rien de nécessaire. » Il ne parle pas de l'édit de Sévère défendant qu'on se fit juif ou chrétien. Quand il raconte les crimes et les folies d'Héliogabale, introduisant à Rome le culte du soleil, y déployant les pompes de la religion phénicienne, forçant les sénateurs et les chevaliers de prendre part à ses orgies saintes, mariant le soleil et la lune, dérobant les statues des dieux et pillant les temples; quand il montre la religion romaine s'en allant pièce à pièce au milieu de l'indifférence du peuple, pour qui ces extravagances sont un amusement et un spectacle, comme les combats de gladiateurs et les jeux du Cirque; il ne dit rien, lui, le païen sceptique ou indifférent, de cette religion nouvelle, ayant déjà des prêtres, un culte, des martyrs; et Photius, le patriarche chrétien, dit « qu'il n'omet rien de nécessaire. » Ce silence d'un écrivain contemporain, qui n'est l'objet d'aucun étonnement, ni d'aucun blâme de la part d'un illustre prélat du neuvième siècle; la perpétuelle confusion qui se faisait, aux premiers siècles, de la religion juive et de la religion chrétienne, des juifs et des chrétiens eux-mêmes; le vague, le désaccord et le peu d'autorité des témoignages opposés aux relations contemporaines; la fable continuellement mêlée à l'histoire dans le récit des persécutions et des martyres, doivent faire apporter la plus grande circonspection et la plus scrupuleuse réserve dans l'appréciation des faits relatifs à l'histoire de l'Église au troisième siècle. Il ne faut pas oublier que Suétone (Règne de Claude, ch. 25) dit que cet empereur chassa de Rome les juifs, « qui, à l'instigation d'un certain Chrest (impulsore Chresto), y suscitaient des troubles fréquents ; » et que l'un des principaux faits de la persécution des chrétiens sous Domitien, c'est l'exil de la femme de Flavius Clemens, cousin germain de l'empereur, parce qu'elle avait embrassé le judaïsme. Ce qui frappera donc le plus vivement l'esprit de tout juge impartial, c'est qu'à cette époque la religion chrétienne ne se dégageait pas encore du judaïsme; que la résistance héroïque du peuple juif aux armes qui avaient soumis le monde, sa dispersion, sa constance, l'admirable défense de Coziba dans les murs de Bither sous Adrien, ses disciples liés à leurs livres et jetés ainsi dans les flammes, la population de la ville égorgée, et par-dessus tout, dans le principe, l'immolation de Jésus par le supplice romain de la croix, ordonnée par un proconsul romain contre l'aveu et malgré la résistance du grand prêtre Éléazar qui voulait surseoir à l'exécution du jugement, avaient donné à la race juive et à ses dogmes le prestige de la persécution et du martyre, et propagé sourdement dans l'empire la foi judaïque. Les savants commentaires d'Origène sur les livres saints, ceux de Clément d'Alexandrie, les fortes et religieuses impressions qu'il avait rapportées de Jérusalem, le dogme de l'unité de Dieu hautement proclamé par Tertullien, et jusqu'à son Traité contre les Juifs; les beaux écrits de Philon, le Platon juif, malheureusement perdus pour la plupart, si estimés d'Eusèbe et de saint Jérôme, et si souvent traduits par saint Ambroise; son livre de la Justice et de la Constitution des princes, où il prouve que l'élection des rois doit se faire, non par le droit d'hérédité, mais par le choix libre des peuples, avaient ouvert à la conscience humaine des horizons nouveaux, et popularisé dans les écoles la morale des saintes Écritures, en la rapprochant des idées platoniciennes.
Enfin, cette parole irritée de Caligula aux envoyés de Jérusalem venant conjurer ce prince d'enlever de leur temple les attributs de Jupiter : « C'est donc vous qui adorez un seul Dieu et un Dieu qui n'a pas de nom! » avait révélé d'un seul mot aux philosophes comme au peuple l'élévation des croyances juives; et Photius était peut-être dans son rôle de patriarche chrétien, en disant qu'Hérodien, qui se taisait sur ce mouvement des esprits, a n'avait rien omis de nécessaire.
III.
Il y a dans Mercier, le peintre fidèle et énergique de Paris, tel qu'il existait peu de temps avant la révolution française, un passage qui m'a toujours vivement impressionné :
« C'est un jour de fête, dit-il (30), qu'il faut voir l'aftluence du peuple aux Champs-Élysées, aux boulevards, et considérer ces phalanges bigarrées de promeneurs, qui offrent une variété bizarre de physionomies et d'accoutrements. Là vous pourrez lire sur le front du Parisien si ce que j'ai écrit de son air soucieux, gêné ou compassé n'est pas vrai, et si l'étranger qui lui attribuait, il y a soixante ans, un air riant, ouvert, libre, dégagé, n'est pas autorisé à prononcer aujourd'hui qu'il y a dans ses manières quelque chose de contraint et de triste.
« Je parle de la petite bourgeoisie, la classe assurément la plus nombreuse, et dont l'attitude et le regard me paraissent exprimer un caractère souffrant, indice d'une vie contentieuse et pénible. Le peuple, quand il travaille, me paraît plus gai que lorsqu'il se promène.
« Rien ne doit plus étonner que de le voir s'amonceler dans un jardin public, et là ne faire autre chose pendant une après-dînée entière, que de parcourir les allées et s'asseoir sur des bancs ou des chaises. On voit qu'il ne sait se créer aucun amusement, et qu'un jour de fête est encore pour la petite bourgeoisie un jour où il ne faut rien dépenser; car l'avertissement pressant de la capitation, envoyé par le terrible receveur, et qui menace de poursuivre, semble écrit sur toutes les physionomies. »
Ces lignes me serrent le coeur; elles sont grosses de tempêtes et d'expiations : celte tristesse du peuple contient en elle la révolution française. Mazarin dans son temps avait prévu juste. Le sol tremblait, car le peuple de Paris ne chantait plus.
Ce n'est pas ainsi que je me représente le peuple de Rome sous les empereurs dont Hérodien nous a raconté l'histoire. Le sens moral et presque le sentiment de lui-même l'avaient abandonné. Ce n'est pas une révolution qui s'approchait; c'était la dissolution qui gagnait le corps tout entier, grands et petits, sénateurs et plébéiens, peuple et soldats. Rome s'en allait par lambeaux, et ne vivait plus que de deux choses, la vie militaire, cet anéantissement de la vie morale des nations, et la curiosité que lui inspirait la tyrannie fantasque de ses empereurs d'un jour. Rome n'était pas triste; elle avait le cirque à toute heure; elle avait le pain presque toujours, les jeux sanglants et infâmes des gladiateurs, des spectacles bizarres et atroces, des supplices, des spoliations imprévues, des vengeances populaires ou impériales, des catastrophes de palais ayant tout l'imprévu du roman, des scandales de cour et des rentrées triomphales.
Il faut le dire aussi : le peuple romain, à cette époque, était tout à fait digne de ses empereurs, et la férocité semblait avoir remonté de la nation à ses chefs. Citons ici une page de la Préface placée par Dureau de la Malle en tête de sa traduction de Tacite (31), ouvrage si remarquable, et, selon nous, le premier monument sérieux de l'art de traduire, en France (nous ne parlons pas des temps antérieurs à la fixation de la langue, ni, par conséquent, d'Amyot) : « Sept cents ans de guerres continuelles, à peine interrompues par deux ou trois intervalles de paix très courts, en faisant des Romains le peuple le plus intrépide de la terre, en avaient fait un peuple cruel. Leur droit de la guerre et des gens, qui était horrible, l'esclavage domestique, cette foule de nations sauvages qui bordaient leur empire de tous côtés, le pouvoir atroce que les lois donnaient aux pères et aux maris sur les femmes et les enfants, surtout ces combats de gladiateurs, si fréquents dans la capitale et dans les provinces, perpétuels dans les camps, tout contribuait à leur endurcir le coeur et à leur former un caractère de fer et de sang. Comme ils recevaient la mort sans peine, ils la donnaient sans remords; ils voyaient couler le sang comme l'eau... Quel peuple que celui où les gladiateurs pleuraient de douleur de ce que, cette sorte de spectacle étant devenue plus rare sous Tibère, ils n'avaient plus si souvent le plaisir de tuer et de se faire tuer, où malgré l'opprobre attaché à ce vil métier de gladiateur, des chevaliers, des sénateurs, des femmes même, jusqu'à des empereurs, s'empressèrent de descendre dans l'arène, comme si ce peuple féroce eût trouvé dans le meurtre, dans le spectacle de la mort, dans la vue du sang et des blessures, je ne sais quel inconcevable raffinement de volupté, qu'il ne balançait pas d'acheter, même au prix du déshonneur. »
Si la férocité était alors dans les moeurs et dans les instincts de la nation, elle était pour les empereurs presque une nécessité de leur situation, et de la monstrueuse constitution romaine qui, les soumettant à un sénat tour à tour esclave et maître (32), les obligeait de subvenir aux besoins et aux caprices d'une multitude qu'il fallait amuser et nourrir, comme aux exigences d'une soldatesque sans frein et toujours insatiable. Dès le temps de l'empereur Claude, on comptait déjà six millions d'hommes exempts de toute imposition, et qui dévoraient eux-mêmes la plus forte partie des ressources de l'empire. La suppression imprudente de quelques impôts par Pertinax hâta vraisemblablement la fin de ce malheureux prince, en le mettant dans l'impuissance de satisfaire à l'avidité des prétoriens. De cette situation précaire et besogneuse des empereurs, obligés d'assouvir le peuple et l'armée par d'incessantes largesses, par les distributions de blé et d'argent que prescrivaient les lois, et les spectacles du Cirque dont toute la dépense leur incombait, naissaient les sanglants expédients, les confiscations, les condamnations sans motif, les massacres des chevaliers et des sénateurs opulents. Caligula revoyait tous les mois la liste de ses accusés, choisissait ceux qu'il fallait envoyer au supplice pour combler les vides de ses finances, et appelait cela apurer ses comptes.
On connaît le mot de cet empereur, après l'exécution du préteur Junius qu'il croyait fort riche : « Junius m'a trompé; il n'est pas si riche que je le croyais : j'aurais pu le laisser vivre. »
La loi de lèse-majesté, cette loi si vague et d'une si effrayante élasticité, et qui se pliait à tout, embrassant les paroles, les gestes, les intentions et jusqu'à la pensée la plus secrète, était pour les empereurs une inépuisable ressource. Drusilla, soeur de Caïus, meurt; elle est divinisée après sa mort. Caïus fit accuser de lèse-majesté ceux qui la pleuraient, disant qu'elle était déesse, et que la pleurer était un crime; il fit mourir en même temps ceux qui ne la pleuraient pas, disant qu'elle était sa soeur et qu'il fallait la pleurer. Drusilla fut d'un bon produit pour l'empereur; la populace riait et laissait faire:
Femmes, filles et jusqu'aux vestales assistaient aux scènes de carnage du Cirque, aux affreux assauts des gladiateurs; elles applaudissaient à leur agonie. Auguste avait essayé en vain de mettre un frein à cette hideuse passion du meurtre; ces horribles combats charmaient les festins, et le sang coulait au milieu du vin, des chansons et des fleurs. Les sacrifices humains qu'Adrien avait passagèrement abolis, reparurent sous les derniers empereurs. Quand un riche était assassiné par un de ses esclaves, tous les autres, sans examen, sans enquête, sans distinction d'âge et de sexe, subissaient le dernier supplice au milieu des plus cruelles tortures. Quatre cents furent immolés ainsi dans un seul jour sous Néron, lors de l'assassinat du préfet de Rome. Chose singulière! le peuple voulut s'y opposer, et il y eut un soulèvement; mais les prétoriens étaient là, et il se trouva d'ailleurs un jurisconsulte, Cassius, dont le nom doit être flétri, qui défendit devant le sénat, au nom du droit, cet atroce usage. Legibus laboramus, s'écriait Tacite; tant il est vrai que les iniquités les plus monstrueuses sont celles que les lois sanctionnent. Tandis que Néron et Caligula tuent pour voler dans les rues de Rome, et que le premier se marie, tantôt comme épouse, tantôt comme époux, à la grande joie de la multitude, des monstres nourrissent des murènes de la chair de leurs esclaves qu'ils jettent vivants dans leurs viviers. Caligula (car c'est toujours à lui qu'il faut revenir, comme au type le plus complet du Romain de ces tristes jours, empereur ou peuple), quand les criminels manquent pour être livrés aux bêtes féroces dans le cirque, fait saisir les premiers venus d'entre les spectateurs; il fait dévorer le peuple pour que le peuple s'amuse. Au milieu de ces horribles scènes de cruauté et d'abaissement, quelques nobles exceptions se présentent et soulagent le coeur. Quand Néron, après le meurtre de sa mère, rentre dans Rome au milieu des acclamations de la multitude, de hardis emblèmes lui reprochent son crime. Si les proches parents des condamnés à mort, sous le même empereur, ornent leurs maisons de branches de laurier, en signe de fête, et vont se jeter aux genoux du prince pour le bénir de leur avoir conservé la vie, on voit au contraire, sous Domitien, la courageuse Fannia partant pour l'exil, montrer à tous qu'elle emporte avec elle l'écrit de Sénécion, la vie de son époux Helvidius Priscus, quoiqu'il fût défendu à tous, sous peine de mort, de lire et de garder ces éloquentes pages où revivait l'esprit de la république. Ainsi, quand le corps est agonisant, tout à coup un sang généreux remonte au coeur et le fait palpiter encore.
Mais les temps de l'irrémissible décadence étaient venus; l'heure. avait sonné; l'impulsion fatale était donnée, elle datait de loin. Marius avait porté le premier coup à la république, en admettant tout le monde sous les drapeaux; Sylla, en corrompant le premier les troupes pour en faire les instruments de son despotisme, avait préparé, sans le prévoir, la chute de l'aristocratie romaine et celle de la nation tout entière. L'hérédité, si difficile à maintenir et si désastreuse dans un gouvernement militaire, eut les conséquences les plus déplorables; les quatre adoptions successives de Trajan, d'Adrien, d'Antonin et de Marc-Aurèle donnèrent seules à Rome dans sa décadence un siècle de gloire, et ravivèrent de nobles souvenirs. Les Romains avaient conquis tout le monde connu; mais les vainqueurs étaient constamment tenus en haleine par les vaincus. De là, la fatale condescendance des empereurs pour l'armée, leur soutien au dehors et au dedans; de là aussi l'indifférence et l'abdication du peuple, détourné de l'attention de son régime intérieur par les dangers du dehors et le prestige et l'intérêt des faits militaires. Enfin la destruction de Jérusalem par les Romains avait amené la dispersion des Juifs dans tout l'empire; cette dispersion y avait répandu les principes d'une morale nouvelle, basée sur la croyance d'un Dieu unique, rémunérateur des bons, effroi des méchants. Le christianisme, sorti des flancs sanglants du judaïsme, devait détruire l'empire romain, qui était la glorification de la force brutale et la négation do la conscience humaine. Si le génie d'un homme avait pu arrêter le monde romain, marchant vers sa dissolution et vers sa ruine, Marc-Aurèle l'aurait fait; mais un mouvement général ne peut être contenu par l'exemple ni par la volonté d'un seul. Quand la tyrannie est dans l'air, aucun souffle opposé ne peut prévaloir. Si, au contraire, un grand courant dirige le monde vers les idées de rénovation et de progrès, l'homme de volonté et de pouvoir le plus énergiquement doué ne pourra rien contre cette invincible tendance; et ce qu'il fera un jour contre la liberté et contre le droit, il le défera plus tard, esclave lui-même de la conscience universelle.
Depuis le règne de Gordien III, où s'arrête Hérodien, l'histoire romaine se traînera encore pendant un siècle environ dans cette fange et dans ce sang; l'imposante figure de Dioclétien apparaîtra seule pour rompre cette monotonie de crimes et d'abaissement, pour couper cette fièvre de sanguinaire délire, jusqu'au grand coup de Constantin, le déplacement de l'empire, Byzance transformée en Rome nouvelle. Ambitieux, grand politique, effrayé de cette rapide succession d'empereurs moissonnés tour à tour, Constantin voulut satisfaire ce besoin de nouveauté qui travaille les peuples vieillis, et assurer son règne en le renouvelant. Il entendait d'ailleurs le craquement du vieil édifice romain, menacé de toutes parts par l'irruption prochaine des barbares. Il désespérait de ce peuple à la fois amolli et sanguinaire, s'endormant dans les délices d'un luxe insensé, et dévoré de l'ambition des fonctions publiques; il comprenait qu'une commotion violente pouvait seule Io réveiller de sa torpeur séculaire. Ceux qui ont supposé que, d'une part, l'attachement de Rome pour le paganisme, de l'autre, le souvenir de ses malheurs et de ses crimes de famille, lui avaient fait prendre en aversion le séjour de cette capitale, oublient que Rome n'avait à cette époque ni foi morale, ni foi religieuse, et que lui-même ne se laissait pas déterminer par des motifs de cette nature. Une grande pensée politique l'inspirait seule. La croix de feu qu'il avait vu briller dans le ciel avait pu parler à son imagination et à celle de ses peuples, mais elle avait moins illuminé et purifié son âme que le noble foyer allumé au coeur d'un Marc-Aurèle. Entre Mahomet Il (le destructeur de son empire onze siècles plus tard) accordant à ses soldats victorieux trois jours de carnage dans Constantinople, leur permettant tout excepté le feu; faisant scier par le milieu du corps entre des planches le provéditeur Erizzo et ses principaux officiers, lors de la prise de Négrepont, sous le prétexte que, leur ayant promis la vie sauve, il n'avait garanti que leur tête et non leurs flancs; et Constantin le Grand, mettant à mort Licinius, son beau-frère, au mépris de sa parole, faisant trancher la tête à son fils Crispus, sur l'accusation de Fausta, sa belle-mère, ne témoignant plus tard l'horreur que ce crime lui inspire qu'en faisant étouffer sa femme dans une étuve, où est la différence du sens moral? L'oeuvre de Constantin fut une grande oeuvre politique, rien de plus : mais peut-être s'y mêla-t-il aussi une fantaisie d'artiste. Constantin aimait les arts, et il s'enflammait à l'idée de construire une magnifique cité dans le plus bel emplacement du monde, d'y semer à profusion les palais, les cirques et les temples, loin de cette Rome dégénérée où, lors de ses premières victoires en Italie, il lui avait fallu dépouiller de leurs bas-reliefs des monuments antiques, faute de sculpteurs capables de décorer son arc triomphal. Les grands édificateurs politiques aiment d'ailleurs à remuer la pierre et le marbre qui consacrent les grandes époques. Constantin, par cette translation et celte rénovation de l'empire, fondait aussi son despotisme sur des bases solides; les empereurs, qui jusque-là n'avaient eu en réalité d'autres pouvoirs que ceux des magistratures diverses dont ils étaient revêtus, dédaignèrent désormais d'en prendre les titres, qui amoindrissaient leur omnipotence, et qui furent effacés de leurs monnaies, comme ils cessèrent d'être rappelés en tête des lois. Ce qui distingua surtout le labarum, auquel on a voulu donner un caractère religieux, c'est que les quatre lettres républicaines qui désignaient le sénat et le peuple romain en disparurent. Tout fut concentré dans les mêmes mains; les provinces du sénat devinrent les départements des deux Césars; l'Italie ne fut plus qu'une province, et Rome une cité d'un nouvel empire qui eut onze siècles de durée : il fut emporté à son tour par l'un de ces violents orages qui aujourd'hui ne font qu'ébranler les États, et qui autrefois les faisaient sombrer.
IV.
L'empire de Constantin s'écroule. Quelle misérable cause ou quel futile prétexte d'une si grande, d'une si mémorable catastrophe qui devait bouleverser le monde! Constantin Dracosès, le dernier des Paléologues, réclame de Mahomet II l'acquittement de la pension annuelle que paye le sultan pour son oncle Orcan, retiré à la cour de l'empereur. Que de voix s'élèveraient aujourd'hui des conseils de l'Europe, dans une semblable occurrence, pour calmer le créancier impatient, pour ramener le débiteur à l'accomplissement de sa promesse ! Que d'épargnes royales, que de bourses privées s'ouvriraient au besoin ! Menacé par le terrible voisin qu'il a bravé, qu'il a provoqué, et contre lequel il ne peut soutenir qu'une lutte impuissante et désespérée, Constantin supplie le pape Nicolas V d'appeler à sa défense les peuples de l'Occident, lui promettant de renoncer au schisme et d'entrer avec son peuple dans le giron de l'Église romaine. Le pape n'a pas confiance en cette promesse, parce qu'il la sait contraire au voeu des sujets; il dénie donc son appui au suppliant; il refuse cette pieuse et puissante intercession qui aurait sauvé tant de chrétiens; il préfère le Turc au schismatique. Un pape aujourd'hui (nous le supposons du moins) comprendrait mieux les devoirs de sa mission spirituelle : il n'accepterait pas, fût-elle réelle, la conversion d'un monarque en péril, d'un peuple aux abois; il ne verrait que des frères, et il emploierait toutes les forces matérielles ou morales dont il dispose pour les sauver, ralliés ou non à sa foi.
Si l'empire grec eût pu survivre à cette crise; si le pape Nicolas V l'eût voulu; si l'Europe se fût levée, à sa voix, sous la conduite d'un Jean Huniade, les deux bras de l'Église d'Occident et de son églises soeur d'Orient eussent étouffé dans les plaines d'Andrinople le monstre ottoman; l'empire grec eût traversé les quatre derniers siècles, et sa durée aujourd'hui, malgré toutes les causes possibles d'affaiblissement et de dissolution, serait éternelle.
Les rapports de nations à nations, comme ceux des gouvernants et des gouvernés, ont complètement changé de face. Cette pondération d'intérêts politiques, moraux et religieux, qui, sous le nom d'équilibre européen, maîtrise aujourd'hui les événements et les enchaîne, a modifié de la manière la plus curieuse et la plus profonde l'ensemble des faits qui forme l'histoire, et elle prévient la chute des empires. Les grands battements du coeur des nations, qui produisaient autrefois les actes héroïques et les effrayants cataclysmes, sont aujourd'hui modérés ou comprimés, et l'histoire contemporaine a aussi son diapason normal qui s'impose aux peuples comme aux souverains.
Ce respect de l'équilibre européen, qui éterniserait aujourd'hui l'empire grec, s'il eût survécu, maintient aussi, depuis près d'un siècle, le chancelant édifice de la puissance ottomane, élevé sur ses ruines. La brillante royauté des califes d'Espagne et d'Asie, qu'entourait le prestige de la civilisation et des arts, a depuis longtemps disparu; l'antique et poétique esprit de l'islamisme dort maintenant sous la tente de l'Arabe pasteur, ou chevauche sur les coursiers du kabyle; et l'Europe, reculant devant le danger d'une succession ouverte, maintient debout sur ses rivages cet empire turc qui ne laissera guère dans l'histoire qu'une traînée de sang. Si l'esprit politique de Constantin le Grand pouvait revivre un jour dans l'un des sultans de Constantinople; si, à l'exemple de cet aventureux novateur, il voulait recourir à un héroïque expédient, à un déplacement grandiose; s'il méditait la transplantation de l'empire turc aux lieux où fut son berceau; il n'aurait pas besoin de chercher l'emplacement d'une cité nouvelle, ni de faire sortir de terre une capitale. Il n'aurait que le choix entre les grandes cités orientales, Damas, Alep ou la Mecque, et relèverait la monarchie des Ommiades au milieu des féeries des mille et une nuits. Chose singulière, cette fuite volontaire d'une royauté mourante, essayant de revivre sous un autre ciel , cette abdication et cette renaissance simultanée, auraient besoin d'être sanctionnées par le concert européen. Le suicide de l'empire turc en Europe ne lui serait pas même permis. Au temps où nous sommes, les empires n'ont pas plus le droit de se détruire eux-mêmes, qu'ils n'ont celui de se constituer sans l'assentiment des autres. Terrible et grave responsabilité que prennent les chefs des nations et leurs conseillers, qui se substituent à la Providence, et deviennent ainsi solidaires des destinées bonnes ou mauvaises de l'humanité.
Car nous ne savons pas si le monde moral n'a pas besoin d'être vivifié de temps à autre par l'engrais des empires détruits, des races proscrites et des civilisations éteintes. La destruction de l'empire grec, et la dissémination de tous ses éléments civilisateurs, a été, dans l'ordre. intellectuel et littéraire, ce qu'ont été, dans l'ordre moral et religieux, la dispersion des Juifs, leur laborieux et patient exil, leur foi dans l'avenir et la propagation de leur croyance unitaire : nous acceptons ces deux faits comme également providentiels. Tout en applaudissant à cette puissance des influences morales qui tend à se substituer de plus en plus à l'irrésistible et brutal empire de la force, on se demande avec effroi si la force qui comprime n'exerce pas à la longue d'aussi profonds ravages que la force qui détruit; s'il n'est pas de saines perturbations nécessaires au corps social, et le purifiant comme l'orage purifie l'air; et si, travaillé par une lente décomposition sous la main de plomb qui l'enserre, il ne regrettera pas la main de fer qui lui a fait si souvent de sanglantes et profondes blessures.
On ne peut nier cependant que ce haut protectorat européen, qui s'oppose à l'absorption des États et à la disparition des monarchies, ne soit une puissante garantie de paix et de civilisation relative. Ce conseil permanent, et dont l'action est incessante, même lorsqu'il n'est pas réuni, réalise la pensée fondamentale de l'abbé de Saint-Pierre, et nous conduit, à travers tous les perfectionnements de l'art de détruire, et par une route qu'il n'avait pas prévue, puisqu'elle est semée des plus formidables engins do ruine, à son rêve favori, la paix perpétuelle. Ce comité de vigilance, toujours à l'oeuvre, cette surveillance mutuelle et jalouse des grands États qui s'observent et se contiennent les uns les autres, paralyse ou châtie au besoin les appétits brutaux, réminiscence de l'ancien monde, flatte les ambitions secrètes, détourne les convoitises ardentes, et par un système hardiment combiné et opiniâtrement suivi, d'actes de rigueur,de mesures préservatrices et de laborieux étayement, maintient à l'état de ruines vivantes les empires qui tombent, spectres galvanisés, tristes fantômes, soutiens cachés des florissantes monarchies qui les éternisent.
Grâce à la force d'initiation de deux peuples civilisateurs, quelque chose est laissé d'ailleurs au libre développement des croyances et des instincts de race; et ce qui s'épargne de désastres matériels et de sang humain compense et au delà, pour le présent, la lenteur et la restriction des conquêtes morales. Nous disons pour le présent, car nul ne peut pressentir le rôle réservé plus tard à tant de questions qui s'ajournent : c'est le secret de l'avenir, puisqu'on les lui renvoie avec tout ce qu'elles recèlent d'agitations et de tempêtes.
Parmi ces questions léguées à l'avenir, la question de Rome, de cette Rome qui a été notre point de départ et où nous revenons, sera peut-être la plus difficile, la plus orageuse, la plus insoluble. Quand il s'est agi, à l'éternel honneur de ce siècle, de réédifier la Grèce, cette oeuvre glorieuse a pu s'accomplir, imparfaitement sans doute, et malgré de regrettables mutilations ; mais enfin elle s'est faite aux applaudissements de tous les esprits éclairés, de tous les coeurs généreux; et elle s'est faite en vue de l'unité. C'est qu'on pouvait rompre franchement avec le passé : les ruines qui s'appelaient encore Athènes, Sparte, Thèbes, Argos, pouvaient prétendre sans doute à redevenir le siége d'une république ou d'un État séparé; on a eu la sagesse et le courage de répudier ces traditions funestes, et Athè¬nes, la capitale morale et intellectuelle de l'ancienne Grèce, a été acclamée tout d'une voix la capitale nouvelle de l'État nouveau. Rome, au contraire, sera l'éternel obstacle à la reconstruction, si désirable, d'une Italie unitaire, dont elle est la seule capitale possible, et la seule impossible, grâce à ce pouvoir complexe, à la fois religieux et politique, spirituel et temporel, que, contrairement au véritable esprit du christianisme, y ont installé les siècles. La Rome païenne, qui avait détruit Jérusalem pour avoir fermé le temple du vrai Dieu à ses aigles et à ses idoles; qui l'avait frappée, par la main de son proconsul Pilate, dans sa représentation la plus philosophique et la plus haute; qui avait jeté aux quatre coins du monde ses membres épars, et inventé déjà, au temps de Tibère, l'odieux ghetto d'Alexandrie (tradition recueillie plus tard), où 80,000 juifs mouraient entassés dans un espace pouvant à peine en contenir 10,000; et la Rome chrétienne, qui a accepté ce legs de proscription, et persécuté pendant tant de siècles ce peuple de croyants et de martyrs, véritable initiateur de la foi nouvelle; ces deux Rome, sur ce point soeurs, comme elles le sont par la majesté des ruines et des souvenirs, deviendraient-elles, en effet, la ville de l'expiation et de la prière ? C'est ce que décidera sans doute dans un avenir prochain ce conseil intime et souverain d'empires ennemis, de religions diverses, de croyances contraires, d'intérêts rivaux, qui règle aujourd'hui les destins du monde, et d'où doit sortir l'harmonie générale.
Quoi qu'il en soit, le signe distinctif du temps présent, et ce qui définit nettement le caractère de l'histoire contemporaine, c'est l'empire des intérêts matériels, imposant silence aux passions politiques et religieuses; c'est l'intervention violente et oppressive de la raison, devenue loi souveraine, excluant le hasard et l'imprévu du règlement des questions humaines, et ne laissant, même aux instincts les plus généreux, qu'une place secondaire et subordonnée. Quand on se sera placé à ce point de vue, et qu'on se sera bien rendu compte de cette différence radicale des temps, on ne s'attachera plus à signaler dans l'histoire quelques similitudes éloignées et des rapprochements apparents, pour en tirer des conséquences ou des déductions forcément trompeuses. L'histoire, et en particulier celle qui va se dérouler devant nous sous la plume véridique d'Hérodien, ne nous présentera plus (et ce sera là son enseignement) que l'intérêt du roman. La tyrannie des empereurs, leur succession si rapide, les excès de l'oppression militaire, l'avilissement du sénat, l'abaissement des caractères, la férocité des moeurs et de monstrueuses catastrophes, nous montreront le triomphe de la force brutale, qu'aucun sens moral ne vient modérer ni régler, et n'offriront aucun similaire dans le temps présent. Mais l'on sera frappé par l'analogie de quelques détails secondaires. Ainsi, pour n'en citer qu'un seul, il y a dix-sept siècles environ, Italiens et Germains se heurtaient, ennemis éternels, aux abords de ces riantes plaines, constant objet de l'appétence des peuples du Nord; les Maures, auxiliaires de Rome, comme ils sont aujourd'hui les nôtres, brisaient déjà par leur irrésistible élan les phalanges germaines; et si la guerre ensanglantait encore les rives du Rhin, nous les verrions de nouveau, sous d'autres aigles, renouveler contre les Pannoniens d'aujourd'hui leurs exploits du temps de Maximin. Mais ce sont là des faits accessoires où il ne faut s'arrêter qu'un instant. Dans le monde physique, les choses essentielles restent immuables; les choses secondaires seules sont variables. On pourrait dire que le contraire arrive dans le monde moral : les lois essentielles qui le régissent se modifient selon les progrès de la liberté et de la raison; et il n'y a d'immuable que ce qui est accessoire et secondaire.
Mars 1860.
(01) Voyez livre Ier (préambule), page 2.
(02) J'ai cru devoir traduire ainsi l'expression remarquable d'Hérodien, qui porte le caractère d'une sévère conviction : μετὰ πάσης ἀληθοῦς ἀκριβείας, avec toute la minutieuse précision de la vérité.
(03) Livre 1er, ch. IV, page 4.
(04) Livre II, ch. XLIX, page 90.
(05) Livre ll, ch. XXIV, page 66.
(06) Livre II, ch. XXXVIII, page 79.
(07) Bois-Guillebert se trompe dans son énumération. L'histoire d'Hérodien renferme en réalité dans un espace de soixante années dix-sept empereurs, savoir : Commode, Pertinax, Didius Julianus, Niger, Albinus, Septime Sévère, Géta, Caracalla, Macrin, Héliogabale, Alexandre Sévère, Maximin, Gordien, Gordien le fils, Maxime, Balbin, Gordien III.
(08) Une seconde édition a paru en 1745. Elle porte ce titre : Histoire romaine d'Hérodien, traduite du grec en français, avec des Remarques sur la traductions, par M l'abbé Mongault, de l'Académie française, ci-devant précepteur de monseigneur le duc d'Orléans; Paris, in-12, 1745
(10) « Ut si quis in domum aliquam, aut in gymnasium, aut in forum venerit... » « Comme quand on entre dans une maison, traduit d'Olivet, dans un collège, dans un hôtel de ville... » CICÉR0N, de Natura Deorum, livre II, trad. de l'abbé d'Olivet.
(11) Τὰς ἔσθητας καθέλκοντι; traduction latine littérale: Vestimenta crurium demittenti. (Livre IV, ch. XXIV. Voyez page 164.)
(12) Son véritable nom était Pierre le Pesant, sieur de BOIS-GUILLEBERT Il était lieutenant général du bailliage de Normandie, et mourut en 1714. Ou lui doit encore une traduction de l'Histoire de Dion Cassius de Nicée, abrégée par Xiphilin. Il avait été élevé à Port•Royal, et était neveu, à la mode de Bretagne, du maréchal de Vauban. C'est à tort que la Biographie universelle dit que sa traduction d'Hérodien a paru sous les initiales B. G. J'ai sous les yeux l'édition originale, dont voici le titre : Histoire romaine, escrite par Hérodien, traduite du grec en français par Monsieur de Boisguilbert (qui n'est pas l'orthographe véritable du nom), 1 vol. in-I2 ; Paris, chez Guillaume de Luyne, au Palais, dans la gallerie (sic) des Merciers, 1676.
(13) Les amateurs de curiosités littéraires peuvent consulter (page 248) la traduction de Bois-Guillebert que nous avons indiquée plus haut.
(14) Voyez livre VII, ch. VI, page 229.
(15) L'ABBÉ MONGAULT, Préface de sa Traduction d'Hérodien,
(16) Voyez notes du livre VII, page 304. Nous y citons encore une curieuse remarque de l'abbé Mongault sur le récit que fait Hérodien de l'assassinat de Vitalien, préfet du prétoire à Rome, par les émissaires de Gordien.
(17) De la traduction considérée comme moyen d'apprendre une langue, et comme moyen de former le goût, par dom François-Philippe GOURDIN, religieux bénédictin do la congrégation de Saint-Maur, ancien professeur de rhétorique, etc., 1 vol. in-12; à Rouen, de l'imprimerie privilégiée, 1789.
(18) Traité des Études, tome ler, pag. 112 et suiv., in-12, édit. stéréot.; Paris, 1825. — Voyez aussi l'édition des Oeuvres de Rollin, in-8°, publiée par M. Letronne, et précédée du remarquable Éloge de Rollin, par M. Saint-Albin Berville, que l'Académie française a couronné en 1818.
(19) Déjà membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour sa traduction d'Hérodien, l'abbé Mongault fut nommé à l'Académie française en 1718, et eut pour successeur Duclos en 1746. Fréret a prononcé son Éloge à l'Académie des inscriptions. Rollin, qui avait pris part aux querelles religieuses du temps et s'était montré fervent janséniste, ne put obtenir le même honneur, et il ne fut permis à de Boze, son confrère, de faire son éloge qu'à condition de ne louer en lui que l'écrivain.
(20) « Quod cum accidisset, confidebam ac mihi persuaseram fore ut omnia placarentur inter vos... » Lettres de Cicéron à Atticus, XVII, livre I ; trad. de l'abbé MONTGAULT.
(21) Voyez livre IV, ch. III, pages 138 et suiv.
(22) Histoire des Empereurs et des autres princes qui ont régné pendant les six premiers siècles de l'Église, par Levain de Tillemont, tonie III, page 298 ; Paris, 1691, in-4°.
(23) Lenain de Tillemont traduit ici Hérodien à sa façon. Notre historien dit : « Ayant été dans les charges de cour ou dans les fonctions civiles. » Ἐν νασιλικαῖς ἣ δημοσίαις ὑπηρεσίαις γενόμενος.
(24) Les uns l'ont cru fils de ce grammairien d'Alexandrie, surnommé Dyscole (le difficile) ; les autres l'ont regardé comme le grammairien lui-même. Cette confusion a été souvent faite; de Tillemont l'a combattue, tome II, page 418 de son Histoire des Empereurs. A des raisons puisées dans le rapprochement des dates et qui semblent concluantes, il ajoute : « L'esprit noble et élevé que l'on voit dans son histoire paraît aussi fort différent de cette basse exactitude ordinaire aux grammairiens et qu'on remarque surtout dans Hérodien d'Alexandrie. » On voit que Lenain de Tillemont qualifie durement et injustement l'esprit de critique et d'examen qui distingue les travaux des scoliastes. Mais la valeur des mots a changé depuis, et par « basse exactitude » le savant écrivain ne croyait pas désigner d'une manière injurieuse une nature de recherches peu élevées et s'attachant à de minutieux détails.
(25) J. CAULESPITOLIN, Vie d'Albinus, page 84. L'expression de Jules Capitolin est celle-ci: Ad fidem pleraque dixit. On voit donc combien l'interprétation du savant écrivain est inexacte et forcée. La traduction véritable serait : « Véridique presque en tout point; » ce qui est, selon nous, le plus bel éloge et le plus rare qu'on puisse faire d'un historien.
(26) On sait que les écrivains de l'histoire Auguste (Spartianus, Ulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Jules Capitolin, Lampride et Vopiscus) embrassent la période comprise entre Marc-Aurèle et Dioclétien; s'étendant ainsi un demi-siècle environ de plus que l'histoire laissée par Hérodien. Lamothe-Levayer (Jugement des principaux historiens, tome Ier, in-folio, 1656) appelle Jules Capitolin le pire de tous, et, de son côté, Lenain de Tillemont, généralisant une critique plus sévère encore, n'hésite pas de dire : « Lampride et les autres qui ont fait l'histoire Auguste au commencement du quatrième siècle, ne méritent pas le nom d'historiens. » (Histoire des Empereurs, tome III.)
(27) Livre VII, ch. I, page 223.
(28) « Le plus fautif et le plus négligent des écrivains de l'histoire Auguste, » au jugement de Lamothe-Levayer. (Jugement des principaux historiens, ibid.)
(29) PHOTIUS, Bibliotheca Graeca, Cod. 99, page 276, in-fol.
(30) Tableau de Paris, par Mercier; tome VII, page 114 (Amsterdam, 1783).
(31) TACITE, traduction nouvelle par Dureau de la Malle, première édition, 3 vol. in-8°, 1790.
(32) Le
sénat avait toute l'administration civile, le droit de jugement dans
toutes les causes importantes, et la moitié des provinces de
l'empire. L'empereur avait les armées, la puissance tribunitienne,
le grand pontificat, le pouvoir consulaire à Rome, proconsulaire
dans les provinces, presque tous les attributs du gouvernement,
moins les ressources.évolte