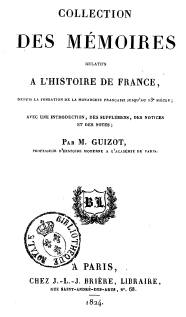 GUILLAUME DE POITIERS
GUILLAUME DE POITIERS
VIE DE GUILLAUME LE CONQUERANT
Œuvre mise en page par Patrick Hoffman
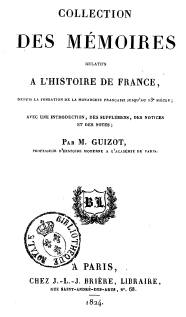 GUILLAUME DE POITIERS
GUILLAUME DE POITIERS
VIE DE GUILLAUME LE CONQUERANT
Œuvre mise en page par Patrick Hoffman
COLLECTION
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE.
HISTOIRE DES NORMANDS, PAR GUILLAUME DE JUMIÈGE. — VIE DE GUILLAUME-LE-CONQUÉRANT, PAR GUILLAUME DE POITIERS.
VIE
DE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT,
Par GUILLAUME DE POITIERS.
Notice
SUR
GUILLAUME DE POITIERS
Guillaume de Poitiers n'était point originaire de Poitou, comme son nom semble l'indiquer; il naquit vers l'an 1020, à Préaux, près de Pont-Audemer en Normandie, mais il étudia à Poitiers, école alors célèbre, et en reçut le nom qui lui est resté. Sa famille était probablement riche et distinguée, car l'une de ses sœurs fut abbesse du monastère de filles qui existait déjà à Préaux. De retour de Poitiers, Guillaume suivit d'abord la carrière des armes, et se trouva à plusieurs des batailles qu'il a racontées; mais il s'en dégoûta bientôt, et entra dans l'Eglise, seule situation qui convint aux esprits que préoccupait le besoin de l'étude et du savoir. Devenu chapelain du duc Guillaume, depuis roi d'Angleterre, il forma le projet d'écrire son histoire, et probablement commença dès lors à s'en occuper. Il passait, et à bon droit, pour l'un des hommes les plus savans et les plus spirituels de son temps. Aussi Hugues, évêque de Lisieux, et Gilbert Maminot, son successeur, tous deux grands amateurs et protecteurs de la science, prirent-ils beaucoup de soin pour l'attirer et le fixer auprès d'eux; ils y réussirent, et Guillaume quitta son royal patron pour vivre paisiblement, en qualité d'archidiacre, dans le diocèse de Lisieux. On ignore à quelle époque il mourut; seulement il est certain qu'il survécut au roi conquérant dont il a écrit l'histoire; dom Rivet a même affirmé qu'il n'avait commencé son ouvrage qu'après la mort de ce prince1; mais son assertion est réfutée par une phrase de l'historien lui-même, qui dit, en parlant d'Eudes ou Odon, évêque de Bayeux, frère du roi Guillaume: «Il fut toujours et très-constamment fidèle au roi, dont il était le frère utérin.» Les querelles d'Eudes avec Guillaume, qui le fit jeter en prison, n'avaient donc pas encore éclaté au moment où il écrivait2.
Guillaume de Poitiers est, à coup sûr, un des plus distingués de nos anciens historiens; il ne manque ni de sagacité pour démêler les causes morales des événemens et le caractère des acteurs, ni de talent pour les peindre. Il connaissait les historiens Latins, et s'est évidemment appliqué à les imiter; aussi Orderic Vital et plusieurs de ses contemporains l'ont-ils comparé à Salluste; il en reproduit quelquefois en effet, avec assez de bonheur, la précision et l'énergie; mais il tombe bien plus souvent dans l'affectation et l'obscurité.
Ce n'en est pas moins une grande perte que celle du commencement et de la fin de son ouvrage; les premières et les dernières années de la vie du roi Guillaume manquent absolument dans tous les manuscrits. Celui de la bibliothéque Cottonienne, qui est le plus complet et sur lequel Duchesne a publié son édition, commence en 1035 et s'arrête en 1070.
F. G.
NOTES
1 Histoire littéraire de la France, tom. VIII, pag. 194.
2 Recueil des historiens Français, tom. XI, pag. 79 et 189.
DE GUILLAUME
LE CONQUÉRANT.
Canut perdit avec la vie1 le royaume d'Angleterre, qu'il n'avait dû qu'aux armes de son père et aux siennes. Hérald son fils, qui ne l'imita point dans son amour pour la tyrannie, prit possession de cette couronne avec le trône. Edouard et Alfred, qui, pour éviter d'être égorgés, s'étaient autrefois réfugiés en Normandie, auprès de leurs oncles, étaient encore exilés à la cour de leur proche parent, le prince Guillaume. Ils avaient pour mère Emma, fille de Richard Ier, et pour père Edelred, roi d'Angleterre. Quant à la généalogie de ces frères et à l'usurpation de leur héritage par l'invasion des Danois, assez d'autres en ont parlé dans leurs écrits. Aussitôt qu'ils apprirent la mort de Canut, Edouard, parcourant la mer, navigua avec quarante vaisseaux bien munis de troupes, vers Southampton2, où il attaqua une grande multitude d'Anglais, qui l'attendaient pour le tuer; car les Anglais ne voulaient pas, ou, ce qui est plus croyable, n'osaient pas abandonner Hérald, craignant que les Danois ne vinssent promptement le secourir ou le venger, et n'oubliant pas surtout que les plus nobles de leur nation avaient été mis à mort par la cruauté des Danois. Edouard les vainquit en un combat avec un grand carnage. Mais considérant le grand nombre des forces ennemies, et le petit nombre de celles qu'il avait amenées, il tourna la proue de ses navires, et revint en Normandie avec un très grand butin. Il savait qu'il y trouverait un asile sûr, un accueil généreux et bienveillant. Après un espace de temps peu considérable, Alfred partant du port d'Etaples, vint à Cantorbéry, mieux préparé que ne l'avait été son frère contre les forces de l'ennemi. Il réclamait le sceptre paternel. Lorsqu'il eut pénétré dans l'intérieur, le comte Godwin, le recevant avec une ruse criminelle, commit envers lui la plus perfide trahison; car il vint de lui-même au devant de lui, comme pour lui faire honneur, lui promit ses services avec bienveillance, et l'embrassa en lui donnant la main pour témoignage de sa foi: en outre, il se mit familièrement à table avec lui, et lui donna des conseils. Mais au milieu de la nuit suivante, comme, plongé dans le sommeil, Alfred était sans armes et sans force, il lui attacha les mains derrière le dos. Après s'être ainsi rendu maître de lui par des caresses, il l'envoya à Londres au roi Hérald, avec quelques autres du comté, pareillement enchaînés: quant au reste, il en envoya une partie dans les prisons, les séparant cruellement les uns des autres, et fit mourir les autres par une terrible mort, les faisant horriblement éventrer. Hérald, transporté de joie à la vue d'Alfred dans les fers, fit décapiter en sa présence ses excellens guerriers, lui fit crever les yeux, et ordonna qu'on le mît honteusement tout nu, et qu'on le menât vers la mer, les pieds attachas sous un cheval, afin qu'il fût tourmenté, dans l'île d'Ely, par l'exil et la pauvreté. Hérald se réjouissait de voir la vie de son ennemi plus pénible que la mort, et tâchait en même temps de détourner entièrement Edouard de toute entreprise, en l'effrayant par les calamités de son frère. Ainsi périt le plus beau jeune homme, le plus digne d'éloges par sa bonté, fils et neveu de roi. Il ne put survivre long-temps à ce supplice; car pendant qu'on lui crevait les yeux, la pointe du couteau lui avait entamé la cervelle.
Nous t'adressons donc une courte apostrophe, Godwin, dont le nom, après ta mort, te survit infâme et odieux. Si cela se pouvait, nous voudrions t'effrayer du crime que tu as si méchamment commis. Quelle exécrable furie t'agite? De quel cœur as-tu pu méditer, contre le droit et la justice, un si abominable forfait? Pourquoi, le plus cruel des homicides, commets-tu pour la perte de toi et des tiens la plus infâme trahison? Tu te félicites d'avoir fait ce qu'abhorrent les lois et les coutumes des nations les plus éloignées du christianisme; les outrages et les maux d'Alfred excitent ta joie, ô le plus méchant des hommes, et font couler les larmes des gens de bien. De telles choses sont lugubres à rapporter. Mais le très-glorieux duc Guillaume, dont, soutenu par le secours divin, nous apprendrons les actions aux âges futurs, frappera d'un glaive vengeur la gorge d'Hérald, si semblable à toi par la cruauté et la perfidie. Tu répands par ta trahison le sang innocent des Normands; mais à son tour le fer des Normands fera couler le sang des tiens. Nous aurions mieux aimé ensevelir dans un silence perpétuel ce crime inhumain; mais nous ne croyons pas que les actions même mauvaises, nécessaires à la suite de l'histoire, doivent être écartées de nos écrits, comme nous devons nous en interdire limitation.
Hérald mourut peu de temps après. Il eut pour successeur son frère, Hardi-Canut, né d'Emma, mère d'Edouard, et qui revint du Danemarck. Plus semblable à la race maternelle, il ne régna pas avec la même cruauté que son père ou son frère, et ne voulut point la mort d'Edouard, mais son élévation. A cause des fréquentes maladies dont il était attaqué, il eut plus souvent devant les yeux Dieu et la courte durée de la vie humaine. Au reste, pour ne pas trop nous éloigner du sujet que nous nous sommes proposé, nous laisserons à d'autres le soin d'écrire son règne ou sa vie.
La joie la plus éclatante brilla enfin pour tous ceux qui desiraient la paix et la justice long-temps attendues. Notre duc, mûr par l'intelligence de tout ce qui est honnête et par la force du corps plutôt que par l'âge, commença à revêtir les armes de chevalier. Cette nouvelle répandit la terreur par toute la France. La Gaule n'avait pas un autre chevalier ni homme d'armes si renommé que lui. C'était un spectacle à la fois agréable et terrible que de le voir dirigeant la course de son cheval, brillant par son épée, éclatant par son bouclier, et menaçant par son casque et ses javelots. Car de même qu'il excellait en beauté sous les habits de prince ou les vêtemens de la paix, de même il recevait un avantage singulier des habits qu'on revêt contre l'ennemi; son mâle courage et ses vertus brillaient d'un éclat supérieur. Il commenta avec le zèle le plus ardent à protéger les églises de Dieu, à défendre la cause des faibles, à établir des lois équitables, à rendre des jugemens qui ne s'écartaient pas de l'équité ou de la modération, et surtout à empêcher les meurtres, les incendies, les pillages; car, comme nous l'avons dit plus haut, les choses illicites jouissaient alors d'une extrême licence. Enfin, il commença à éloigner de sa familiarité ceux qu'il savait inhabiles ou pervers, à user des conseils des plus sages et des meilleurs, à résister fortement aux ennemis du dehors, et à exiger puissamment des siens l'obéissance qui lui était due.
Ces commencemens rendaient déjà à la Normandie la splendeur et la tranquillité dont elle avait joui autrefois, et promettaient pour la suite un ordre de choses encore meilleur; mais tandis que les bons aidaient avec soumission leur souverain, quelques-uns, pour jouir de la liberté accoutumée, aimaient mieux à leur volonté retenir ce qu'ils possédaient, et enlever les biens des autres. Celui qui leva l'étendard fut Gui, fils de Renaud, comte de Bourgogne, qui possédait les châteaux très-forts de Brionne et de Vernon par le présent du duc, avec qui il avait été depuis son enfance élevé familièrement. Il ambitionnait ou la principauté ou une très-grande portion de la Normandie. C'est pourquoi il associa à son exécrable conspiration Nigel, gouverneur du pays de Coutances, Ranulphe, vicomte de Bayeux, Haimon surnommé Dentat, et d'autres hommes puissans. Ni la parenté, ni la générosité qui l'avait accablé de tant de bienfaits, ni enfin la sincère affection et l'extrême bonté du duc envers lui, ne purent arrêter le dessein de cet homme perfide. Ils firent périr un grand nombre d'innocens, qu'ils essayèrent en vain d'attirer dans leur parti, ou qu'ils prévoyaient devoir être de très-grands obstacles à l'accomplissement de leurs desirs. Mettant de côté toute justice, ils ne s'embarrassaient d'aucun crime, pourvu qu'ils parvinssent à une plus grande puissance. Tel est quelquefois l'aveuglement de l'ambition. Peu à peu donc l'entreprise de cette parjure association prit une telle consistance, que s'étant rassemblés en guerre ouverte, au Val-Dun3, contre leurs seigneurs, ils répandaient au loin le trouble dans tous les lieux d'alentour. La plus grande partie des Normands suivaient la bannière de l'iniquité; mais Guillaume, chef du parti vengeur, ne s'effraya nullement de tant de glaives. Se précipitant sur ses ennemis, il les épouvanta par le carnage, en sorte qu'il ruina presque ses adversaires de cœur et de bras. Il ne leur restait plus que l'esprit qui les excitait à fuir. Il les poursuivit pendant quelques milles, les châtiant durement. La plupart d'entre eux succombèrent dans des lieux impraticables ou de difficile passage. Dans les plaines, quelques-uns périrent, tombant sous les pieds de ceux qui fuyaient, ou mortellement pressés dans la foule. Un grand nombre de chevaliers avec leurs chevaux furent submergés dans le fleuve de l'Orne. A ce combat assista Henri, roi de France, combattant pour le parti victorieux. Cette guerre d'un seul jour fut certes très avantageuse et remarquable pour tous les siècles, en ce qu'elle établit un exemple terrible, abattit par le fer des têtes trop élevées, renversa par la main de la victoire beaucoup de repaires de crimes, et assoupit pour long-temps chez nous les guerres civiles. S'étant honteusement échappé, Gui gagna Brionne, avec un grand nombre de chevaliers. Cette ville, et par la nature du lieu et par des fortifications de l'art, paraissait inexpugnable; car, outre les autres remparts que la nécessité de la guerre a accoutumé à construire, elle a une enceinte de pierre, dont les combattans se servent comme de citadelle, et est entourée de tous côtés par le fleuve de la Rille, qui n'est guéable nulle part. Le vainqueur, ayant promptement poursuivi Gui, pressa étroitement cette ville par le siége, et fit élever des tours sur les rives du fleuve séparé là en deux parties. Ensuite, effrayant les ennemis par des attaques journalières, il leur interdit entièrement les moyens de sortir. Enfin, le Bourguignon, succombant à la disette de vivres, envoya des intercesseurs pour implorer la clémence du duc, qui, touché par la parenté, les supplications et le malheur du vaincu, ne voulut pas exercer une vengeance plus sévère. Ayant reçu de lui le château, il lui permit de demeurer à sa cour. Pour des motifs raisonnables il aima mieux remettre le supplice à ses associés, qui auraient bien mérité la peine capitale. Je vois que, dans un autre temps, il punit par l'exil Nigel, qui l'offensait méchamment. Gui, pour se dérober au chagrin de la honte, retourna de lui-même en Bourgogne. Il souffrait avec peine chez les Normands d'être humilié aux yeux de tous, et odieux à un grand nombre. C'était malgré elle que la Bourgogne le supportait. Si son pouvoir eût répondu à ses efforts, il eût privé de la puissance et de la vie Guillaume son frère, comte de cette province. Pendant dix ans et plus, il se consuma sous les armes, cherchant à répandre dans le combat un sang auquel il tenait de si près. Mais pourquoi me travailler à donner de nouvelles preuves de sa méchanceté? Les Normands, une fois vaincus, soumirent leurs têtes an pouvoir de leur seigneur, et un grand nombre lui donnèrent des otages. Ensuite par son ordre on détruisit de fond en comble les remparts, construits avec un art nouveau. Les citoyens de Rouen abaissèrent jusqu'à terre l'insolence qu'ils avaient montrée contre le jeune comte. Les églises se réjouirent de ce qu'il leur était permis de célébrer en paix le divin mystère, et le négociant de pouvoir aller en sûreté où il voulait: le cultivateur fut rempli de joie de ce qu'il pouvait tranquillement labourer les terres et semer l'espoir des fruits, et n'était plus obligé de se cacher à la vue des hommes d'armes. Tous les hommes, de quelque classe, de quelque rang qu'ils fussent, élevaient jusqu'aux cieux la gloire du duc, et lui souhaitaient par toute sorte de vœux une longue vie et une heureuse santé.
Ensuite, avec la plus exacte fidélité, il rendit à son tour le même service au roi, qui le pria de lui prêter secours contre quelques gens très-puissans, ses ennemis déclarés. Le roi Henri, irrité des paroles injurieuses de Gcoffroi Martel, fit marcher une armée contre lui, assiégea avec une forte troupe et prit son château appelé Moulinières, et situé dans le pays d'Angers. Les Français voyaient ce que l'envie voulait vainement cacher, que l'armée amenée de Normandie était plus considérable que l'armée royale, y compris tout ce qu'avaient amené ou envoyé un grand nombre de comtes. La renommée que le comte normand acquit dans cette expédition, et dont les nôtres rendent témoignage, se répandit dans l'Aquitaine pendant que j'étais en exil à Poitiers. On disait qu'il avait surpassé tons les autres par son génie, son adresse et sa force. Le roi le consultait très-volontiers, et agissait la plupart du temps par son avis, le mettant au dessus de tous pour sa perspicacité à démêler le meilleur conseil. Il ne lui reprochait que sa témérité à s'offrir à de grands et de fréquens dangers; car le duc cherchait partout les combats, et faisait ouvertement des excursions avec dix chevaliers, ou un plus petit nombre encore. Aussi le roi priait les chefs normands de ne pas engager le combat, même le plus léger, devant les postes des villes, craignant de voir périr par cet empressement à montrer son courage celui en qui était placé le secours le plus ferme et l'ornement le plus brillant de son royaume. Au reste, ce que le roi blâmait en lui et dont il tâchait de le dissuader comme d'une ostentation immodérée de courage, nous l'attribuons à l'ardeur bouillante de son âge, ou à son devoir. En examinant ce qui se cache sous de telles causes, on trouve quelquefois des qualités rares et précieuses. Quelquefois il est utile de se garder des nombreux bataillons; d'autres fois cela peut être très-nuisible.
Voici une action de celui que nous excusons, et dont nous avons le plus grand plaisir à nous rappeler exactement l'admirable apprentissage. Voulant comme se dérober à ses familiers, il s'était séparé de l'armée, emmenant avec lui, pour quelque temps, trois cents chevaliers. Il quitte ceux-ci, accompagné seulement de quatre d'entre eux, et court çà et là. Voilà qu'il se présente à sa rencontre quinze chevaliers ennemis, orgueilleusement montés sur leurs chevaux et bien armés; fondant aussitôt sur eux, il les attaque, la lance en arrêt; et ayant soin de frapper le plus audacieux, il lui rompt la cuisse, et le renverse à terre. Il poursuivit les autres jusqu'à quatre milles. Pendant ce temps les trois cents hommes qu'il avait laissés le suivaient et le cherchaient, car ils redoutaient sa témérité. Ils aperçurent soudain le comte Thibaut à la tête de cinq cents chevaliers. La pensée la plus triste se présenta à eux. Ils les prirent pour des ennemis, et crurent qu'ils tenaient leur seigneur prisonnier. S'étant donc animés à l'envi, ils s'avancèrent contre eux dans l'espérance incertaine de l'arracher de leurs mains; mais dès qu'ils les reconnurent pour une armée alliée, ils poussèrent leurs recherches plus avant, et trouvèrent étendu à terre celui des quinze ennemis que sa cuisse cassée empêchait de remuer. Bientôt après s'étant encore avancés plus loin, leur seigneur vint tout joyeux au devant d'eux, amenant avec lui sept chevaliers qu'il avait pris.
Depuis ce temps Geoffroi Martel avait coutume de dire, comme il le pensait, qu'il n'existait sous le ciel aucun chevalier ou homme d'armes qui égalât le comte des Normands. Les puissans de la Gascogne et de l'Auvergne lui envoyaient ou lui amenaient des chevaux célèbres, et généralement connus par leur nom. De même aussi les rois d'Espagne cherchaient à captiver son amitié par de semblables présens et d'autres. Cette amitié méritait en effet d'être recherchée et cultivée par les plus grands et les plus puissans hommes; car il y avait en lui de quoi le faire chérir de ses serviteurs, de ses voisins et de ceux dont il était séparé par de longs espaces. En outre, comme il était pour ses amis un honneur et un appui, il s'efforçait et tâchait, toujours autant qu'il pouvait, de faire en sorte que ses amis lui eussent de très-grandes obligations. En l'année 1045 il était dans la fleur de sa jeunesse, ne gouvernant encore qu'une province et pas de royaume.
Si vous connaissiez sa conduite depuis cet âge jusqu'à présent, ou plutôt depuis son enfance, vous affirmeriez avec assurance, comme vous pouvez véritablement le faire, que jamais il ne viola le droit de l'alliance ou de l'amitié. Il demeurait constant dans ses paroles et ses traités, comme pour apprendre par ses actions ce qu'enseignent les philosophes, que la foi est le fondement de la justice. S'il était forcé, par les motifs les plus graves, de renoncer à l'amitié de quelqu'un, il aimait mieux la défaire peu à peu que de la rompre tout d'un coup, coutume que nous voyons conforme aux préceptes des sages. L'inique roi Henri, entraîné par les instances des hommes les plus pervers, se brouilla avec lui, et conçut contre lui la haine la plus terrible. Comme il attaquait la Normandie par des outrages difficiles à supporter, Guillaume, à qui appartenait la défense de ce pays, s'avança contre lui, témoignant cependant beaucoup d'égards à leur ancienne amitié et à la dignité royale. Ayant toujours cela présent devant les yeux, il évitait, autant que le lui permettait l'extrême nécessité, d'en venir aux mains avec l'armée du roi, et retenait souvent, par ses ordres et par ses prières, les Normands, très-avides de faire subir à la dignité royale la honte d'une défaite. Un jour on connaîtra mieux quelques-unes de ses actions; on saura avec quel courage magnanime il méprisait les épées des Français et de tous ceux que l'édit du roi avait rassemblés contre lui.
Ce fut par sa puissance et par ses conseils qu'à la mort de Hardi-Canut, Edouard s'assit enfin sur le trône paternel, gloire dont il était digne par sa sagesse, l'éminente honnêteté de ses mœurs et l'antiquité de sa race. En effet, les Anglais, en contestation sur le choix, se déterminèrent par les conseils de Guillaume au parti le plus avantageux, et aimèrent mieux consentir aux justes demandes de ses envoyés que d'avoir à éprouver la force des Normands. Ils marquèrent avec empressement à Edouard de revenir avec une suite peu considérable de chevaliers normands, de peur que si le comte des Normands venait avec lui, ils ne fussent soumis par ses puissantes armes, car la renommée leur avait assez fait connaître sa valeur dans les combats. Edouard, dans son affectueuse reconnaissance, réfléchissant avec quelle somptueuse libéralité, quels singuliers honneurs et quelle intime amitié il avait été reçu en Normandie par le prince Guillaume, auquel il était beaucoup plus uni par les bienfaits qu'il en avait reçus que par la parenté, considérant en outre qu'il devait à ses généreux secours la fin de son exil et la couronne, voulut, en homme de bien, le récompenser par le don le meilleur et le plus agréable, et résolut, par une donation en forme, de l'instituer héritier de la couronne qu'il devait à ses secours. Du consentement de ses grands, il envoya donc vers lui, avec Robert, archevêque de Cantorbéry, chef de cette légation, des otages d'une très-puissante famille, à savoir, le fils et le neveu du comte Godwin.
Chez nous déjà tous les troubles intérieurs avaient fait place à la tranquillité; mais un ennemi voisin ne se tenait pas encore tout-à-fait en repos. Geoffroi-Martel levait contre nous un bras qui lui fit à lui-même une grave blessure. La victoire était difficile à espérer, quand, sous les bannières de cet homme si expérimenté dans l'art de la guerre, étaient rangés les Angevins, les Tourangeaux, les Poitevins, les Bordelais, et une grande quantité de pays et de villes. Il s'était emparé par la force des armes de son seigneur le comte de Poitou, et de la ville de Bordeaux; et le tenant renfermé dans une indigne prison, ne lui avait permis de se retirer qu'après lui avoir arraché une somme très-considérable d'or et d'argent, de très-riches domaines, et le serment de demeurer en paix avec lui. Le comte étant mort quatre jours après s'être racheté, Geoffroi associa à son lit la belle-mère du défunt, femme d'une haute noblesse, se chargea de la tutelle de ses frères, et s'appropria ses trésors, en même temps que tous ses honneurs et ses biens. Son pouvoir, qui se terminait aux frontières du comté d'Anjou, lui semblait borné d'une manière misérable et honteuse. Rougissant de se voir renfermé, son immense cupidité l'entraînait au loin dans les territoires des autres. C'est pourquoi, enrichi par ses acquisitions, il fit beaucoup de choses remarquables, secondé autant par son astuce que par ses richesses. Entre autres hauts faits, après avoir abattu le pouvoir du comte Thibaut, il soumit la ville de Tours, si fameuse par son opulence et son courage. En effet, comme Thibaut se hâtait de venir au secours de sa ville chérie, qui lui avait fait savoir qu'elle gémissait sous les coups terribles de Martel, et qu'elle était à la dernière extrémité, Martel marcha promptement à sa rencontre et le vainquit: l'ayant pris, il le chargea de chaînes, avec les principaux des siens, et ne le mit en liberté qu'à des conditions aussi onéreuses que celles qu'il avait imposées auparavant à Guillaume de Poitou. Ensuite s'étant emparé de la ville de Tours, il se souleva contre le roi de France, et infesta tout son royaume. Enorgueilli par ses succès à la guerre, il s'empara d'un château de Normandie, et garda avec grand soin Alençon. Il avait trouvé les habitans de cette ville bien disposés en sa faveur. Il regardait comme une superbe augmentation de renom pour lui une conquête qui diminuait la force du seigneur de la Normandie. Mais Guillaume, capable de défendre et d'étendre même le droit de ses ancêtres, marcha avec son armée vers le territoire d'Anjou, afin de punir Geoffroi, en lui enlevant d'abord Domfront, et recouvrant ensuite Alençon. Cependant la trahison d'un de ses chevaliers faillit faire périr celui qui ne redoutait pas les vastes Etats de son ennemi. Car comme on approchait de Domfront, le duc fit une incursion avec cinquante cavaliers, qui voulaient augmenter la solde qu'ils avaient reçue. Un des principaux des Normands le trahissant, indiqua la proie aux châtelains, auxquels il apprit dans quel lieu, pour quel but, et avec quelle suite peu nombreuse le duc était allé, disant qu'il était homme à préférer la mort à la fuite On envoya sur-le-champ trois cents chevaliers, et sept cents hommes de pied qui l'attaquèrent à l'improviste par derrière. Mais lui se retournant avec intrépidité, il renversa à terre celui qu'une plus grande audace avait poussé le premier contre lui. Les autres aussitôt perdant leur impétuosité se réfugièrent vers les remparts. Un chemin plus court, qu'ils connaissaient, facilita leur fuite. Mais le duc ne cessa de poursuivre les fuyards, que lorsque les portes des remparts les lui eurent dérobés. Il retint un d'entre eux prisonnier. Cette circonstance l'ayant excité davantage au siége, il fit dresser quatre tours. La situation de la ville la défendait contre tout assaut, tenté soit de force soit par ruse; car l'aspérité des rochers ne permettait pas même aux gens de pied de les gravir, et ils n'avaient pour arriver que deux chemins étroits et escarpés. Geoffroi avait donné pour secours aux habitans des hommes d'élite. Cependant les Normands livraient des assauts très-fréquens et très-impétueux. Le duc était le premier et le plus terrible à presser les assiégés. Quelquefois chevauchant nuit et jour ou caché dans des lieux retirés, il allait à la découverte pour rencontrer des convois, ou des messages, ou déjouer les embûches tendues à ses fourrageurs. Pour vous faire voir dans quelle sécurité il vivait sur un territoire ennemi, il allait quelquefois à la chasse. Cet pays est hérissé de forêts qui abondent en gibier: souvent il se donnait le plaisir de la chasse au faucon, et plus souvent encore à l'épervier. Ni les difficultés du lieu, ni la rigueur de l'hiver, ni d'autres obstacles ne purent déterminer son inébranlable courage à lever le siége. Les assiégés attendaient le secours de Martel, qu'ils appelaient par leurs messages. Ils ne voulaient point quitter un maître sous lequel il leur était permis de s'enrichir de brigandages; c'étaient aussi ces motifs qui avaient séduit les habitans d'Alençon. Ils n'ignoraient pas quelle haine on portait en Normandie aux voleurs ou aux brigands, l'habitude régulière qu'on y avait de leur faire à tous subir le supplice, et de ne leur point faire la plus petite grâce. Leurs méfaits leur faisaient craindre la justice de cette loi. Geoffroi amena au secours des assiégés un grand nombre de troupes à pied et à cheval. Dès que Guillaume en fut instruit, laissant la poursuite du siége à des chevaliers éprouvés, il s'avança promptement à sa rencontre. Il envoya à la découverte Roger de Mont-Gomeri, et Guillaume, fils d'Osbern, tous deux jeunes et braves, afin qu'ils apprissent les arrogans desseins de l'ennemi en conférant avec lui. Geoffroi leur fit savoir par son trompette que le lendemain au point du jour il irait réveiller les sentinelles de Guillaume à Domfront. Il leur désigna le cheval qu'il aurait dans le combat, quel bouclier et quels habits. Ils lui répondirent qu'il n'avait pas besoin de se fatiguer plus long-temps en continuant la route qu'il avait commencée, car il allait voir arriver sur-le-champ celui contre lequel il marchait. A leur tour ils lui firent connaître le cheval, les armes et les habits de leur seigneur. Ce rapport augmenta beaucoup l'ardeur des Normands. Mais plus ardent que tous le duc pressait encore ceux qui montrent le plus d'empressement. Le pieux jeune homme desirait abattre le tyran; fait que, parmi les hauts faits, le sénat de Rome et d'Athènes a jugé le plus beau. Mais Geoffroi, frappé d'une terreur subite, chercha, ainsi que toute son armée, son salut dans la fuite avant d'avoir vu l'armée ennemie. Par là un libre chemin s'ouvrit au duc de Normandie pour ravager les domaines, et ternir d'une ignominie éternelle la gloire de son ennemi. Mais il savait qu'il est de la sagesse de se modérer dans la victoire, et que celui qui ne peut se contenir lorsqu'il a le pouvoir de la vengeance n'est pas assez puissant. Il résolut donc de quitter la route où il n'avait rencontré que des succès. Il arriva promptement à Alençon, et termina presque sans combat une expédition si difficile. En effet, cette ville si forte par sa position naturelle, ses remparts et sa garnison, il la prit comme en courant, en sorte qu'il eût pu se glorifier de ces mots: «Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu.» La nouvelle de la prise d'Alençon frappa bientôt les habitans de Domfront. Désespérant, après la fuite de ce fameux guerrier Geoffroi Martel, d'être délivré par les armes d'aucun autre, ils se rendirent aussi très-promptement, aussitôt qu'ils virent le prince des Normands de retour pour les assiéger. Des hommes de longue mémoire assurent que ces deux châteaux avaient été, par la permission du comte Richard, construits, l'un près de l'autre, sur les frontières de Normandie, et qu'ils avaient coutume d'obéir à ses ordres, et à ceux des comtes ses successeurs. Le vainqueur s'en retourna ensuite dans sa patrie, qu'il couvrait ainsi de nouveaux honneurs, et il répandit dans les pays lointains l'amour et la terreur de son nom.
Ce prince a fait dans le même temps d'autres choses dignes d'être insérées dans les annales, et que nous passons sous silence ainsi qu'un grand nombre d'actions qu'il accomplit dans d'autres temps, de peur qu'un livre trop étendu ne puisse déplaire à quelques-uns, et parce que nous avons reconnu la chose trop au dessus des forces de l'historien. En outre, nous voulons réserver, pour la narration des faits les plus fameux, notre faible talent. Nous aurions pu imaginer des combats propres à être traités par la plume des poètes, et amplifier les événemens connus en errant partout dans le champ des fictions. Mais nous louerons avec sincérité, sans nous écarter jamais d'un seul pas des limites de la vérité, le duc ou roi qui jamais ne s'attribua faussement la gloire d'aucune belle action.
Les grands de la Normandie commençaient à l'environner d'un incroyable respect; en sorte que de même qu'au commencement, chacun tentait de s'opposer à lui, maintenant chacun cherchait à lui prouver une ferme fidélité, au point qu'ils se réunirent d'un concert unanime pour le nommer leur seigneur, lui et sa postérité, qui n'était encore qu'en espérance. Tout ce qu'on avait fait pour lui ou ce qu'il avait fait lui-même de bien, dans une humble sagesse, il l'attribuait comme il le devait à la grâce divine, agissant, dès le premier âge de la jeunesse, et se conduisant comme l'homme le plus prudent. Les avis étaient partagés sur son mariage, comme il arrive d'ordinaire selon les opinions et le tour d'esprit des hommes, surtout lorsqu'on délibère dans une cour nombreuse sur une chose importante. Les rois des pays lointains auraient volontiers accordé à ce mari leurs chères filles uniques; maison aimait mieux, par de graves motifs, avoir pour proches des princes plus rapprochés.
Dans ce temps florissait Baudouin, marquis de Flandre, très-illustre par la noblesse de son antique maison, qui touchait par ses Etats à ceux des Teutons et des Français, et l'emportait sur eux par la puissance. Il descendait des chefs des Morins, qu'on appelle maintenant Flamands, ainsi que des rois de la Gaule et de la Germanie, et tenait aussi à l'illustre famille des princes de Constantinople. Les comtes, les marquis, les ducs et les archevêques, placés dans un haut rang, restaient stupéfaits d'admiration lorsque quelquefois le soin du commandement appelait chez eux cet hôte rare. Ses amis et ses alliés consultaient sa sagesse dans la délibération des plus hautes affaires, et s'attiraient sa bienveillance en le comblant de beaucoup de présens et d'honneurs. Il était chevalier de l'empire romain, et de fait l'honneur et la gloire de ses conseils dans une pressante nécessité. Les rois aussi respectaient et craignaient sa grandeur; car les nations les plus éloignées savaient bien de quelles guerres fréquentes et terribles il avait accablé l'orgueil des chefs, et enfin mis la paix à des conditions dictées par sa volonté, après s'être fait dédommager par les seigneurs rois en leur enlevant une partie de leurs terres, tandis qu'exempt d'attaques, ou plutôt infatigable, il conservait les siennes en sûreté; La France avec son monarque enfant tomba ensuite sous la tutelle, la dictature et l'administration de cet homme très-sage.
Le marquis, beaucoup plus illustre par ses dignités et ses titres qu'on ne pourrait brièvement le rapporter, nous présenta lui-même à Ponthieu la très-gracieuse dame sa fille, qu'il conduisit avec honneur à son gendre. Sa sage et sainte mère l'avait élevée de manière à faire fructifier en elle tout ce qu'elle tenait de son père. Si quelqu'un s'informe de l'origine de sa mère, qu'il sache que le père de sa mère était Robert, roi de la Gaule, qui, fils et neveu de rois, engendra des rois, et dont la voix du monde louera les vertus religieuses et la sagesse dans le gouvernement de son royaume. La ville de Rouen s'occupa avec joie de recevoir cette épouse.
La notoriété du fait ne permet pas que, pressés par un sujet qui se précipite vers de plus hauts événemens, nous passions sous silence le comte Guillaume d'Arques, qui, au grand chagrin de la patrie, s'éleva orgueilleusement, autant que le lui permirent ses efforts, contre ce qui était bon et juste. Le frein des lois divines et humaines ne put retenir ce Guillaume, lâche et perfide descendant d'une illustre race, que ne put arrêter non plus, ni la ruine de Gui, ni l'admirable vertu et le bonheur du grand vainqueur, l'invincible Guillaume, ni la fameuse renommée qu'il s'était acquise. Ce qui, dans des ames élevées, doit produire des actions louables, savoir, le grand éclat de la naissance, les enfla d'une audace immodérée et causa la ruine de tous deux. Ils savaient tous deux qu'ils appartenaient et pouvaient être comptés par le côté gauche à la race des ducs de Normandie; le Bourguignon, qu'il était leur neveu par la fille de Richard II; le comte d'Arques, qu'il était frère du troisième, fils du second et neveu du premier. Ledit comte, dès le commencement du gouvernement du jeune duc, se montra parjure envers lui, quoiqu'il lui eût juré fidélité et soumission, et fomenta des guerres, tantôt se révoltant avec témérité et ouvertement, quelquefois employant des ruses secrètes. Le détestable orgueil de cet homme le poussa très-facilement vers l'iniquité. Il fut le chef principal et l'auteur de plusieurs mouvemens de dissension et autres mauvaises actions; il excita, accrut et autorisa presque tous les troubles par ses exemples, ses conseils, sa faveur et son secours. Il fit de nombreux, de grands et de longs efforts pour accroître sa puissance et renverser celle de son seigneur, qu'il osa souvent empêcher d'approcher, non seulement du château d'Arques, mais aussi de la partie de la Normandie voisine de lui, et située en deçà de la Seine. Enfin, au siége de Domfront, que nous avons rapporté plus haut, il s'éloigna furtivement comme déserteur sans en avoir demandé congé, violant ainsi entièrement le devoir de vassal, dont le nom lui avait servi jusqu'alors et auparavant à voiler en quelque sorte son inimitié. A cause donc de ces méfaits et d'autres si nombreux et si grands, le duc prévoyant, comme il en était averti par le fait, que ledit comte formerait encore de plus nombreux et plus grands projets, s'empara tout-à-fait de la forteresse qui lui servait de retraite, et y mit une garde, sans cependant pousser plus loin l'invasion de ses Etats. C'était le comte qui, dans l'origine, avait fondé et construit ce fort avec le plus grand soin sur le sommet de la haute montagne d'Arques. Peu de temps après, les perfides gardes, séduits par des promesses, et fatigués et subjugués par les diverses sollicitations dont on les pressait, remirent le château au pouvoir de son fondateur.
Aussitôt qu'il y fut entré, des furies, plus violentes qu'à l'ordinaire, vinrent l'embraser et pousser à la vengeance, comme si on eût porté atteinte à ses droits. De nombreuses calamités s'élevèrent dans toute l'étendue du pays voisin; on vit fondre les désordres, les rapines, le pillage, Source de la dévastation; le château se remplit d'armes, d'hommes, de bagages et de tout ce qui est propre à la guerre; les remparts, solides auparavant, furent encore plus fortifiés; on ne laissa aucun lieu en paix ni en repos; enfin la révolte la plus terrible se préparait. Aussitôt que le duc Guillaume en fut instruit, il quitta promptement le bourg de Coutances, où il en avait reçu la nouvelle certaine. Il s'avança avec tant de vitesse que les chevaux de ceux qui l'accompagnaient, à l'exception de six, expirèrent de lassitude avant d'être arrivés. C'était surtout la nouvelle des maux qu'endurait sa province qui l'excitait à se hâter de s'opposer à ces outrages. Il s'affligeait de voir lés biens de l'Eglise, les travaux des laboureurs et le gain des marchands devenir injustement là proie des hommes d'armes. Il croyait s'entendre appeler par les déplorables gémissemens du menu peuple qui ont coutume de s'élever en grand nombre dans le temps des guerres ou des séditions. Dans le chemin, non loin du château même, il vit venir au devant de lui quelques-uns de ses chevaliers qui lui étaient fidèles et agréables. Ils avaient appris, par un bruit soudain, dans la ville de Rouen, les menées du comte d'Arques, et s'étaient le plus promptement possible approchés d'Arques avec trois cents hommes pour tâcher d'empêcher qu'on n'y apportât du froment et autres choses nécessaires contre le siége. Mais dès qu'ils surent que des troupes très-considérables y étaient rassemblées, craignant en même temps que ceux qui étaient venus avec eux ne passassent vers le parti de Guillaume (ce que les avis de leurs amis leur avaient annoncé secrètement), avant le lever du jour suivant, dans leur défiance, ils s'en retournèrent le plus promptement possible. Ils rapportèrent au duc ces choses, et lui conseillèrent d'attendre l'armée, disant qu'on abandonnait son parti encore plus que la renommée ne l'annonçait, que presque tout le voisinage favorisait son ennemi, et qu'il était dangereux de s'avancer plus loin avec si peu de ressources. Mais ces rapports ne purent ébranler sa fermeté par la peur ni par la défiance; les ayant rassurés par cette réponse que les rebelles n'oseraient rien contre lui en sa présence, aussitôt il s'avança avec autant de vitesse que ses éperons purent en donner à son cheval. Son courage le guidait, la justice de sa cause lui promettait le succès. Et voilà qu'il aperçut sur une très-haute montagne le chef de la révolte avec de nombreuses légions. Etant monté avec effort sur cette montagne, il les contraignit tous à fuir lâchement dans leurs remparts; et si on n'y eût mis obstacle en fermant promptement les portes, emporté par la colère et l'ardeur de son courage, il les eût tués presque tous en les poursuivant.
Nous racontons le fait et les circonstances qui s'y rapportent, mais la postérité les croira difficilement. Voulant ensuite s'emparer des remparts, le duc rassembla promptement son armée, et les assiégea. Il était très-difficile de s'en emparer de vive force, car ils étaient très-bien défendus par la situation. Desirant, selon son excellente coutume, accomplir la chose sans répandre de sang, il renferma ces hommes cruels et rebelles au moyen d'une tour construite auprès de la montagne, et y ayant mis une garnison, il s'appliqua à d'autres affaires qui appelaient son attention. Ainsi il voulait, les épargnant par le fer, les vaincre par la faim.
Le devoir de la vérité m'avertit de transmettre à la mémoire avec quelle pieuse modération il évitait le carnage, à moins que l'impétuosité de la guerre ou quelque autre grave nécessité ne l'y contraignît. Il aimait mieux se venger par l'exil, l'emprisonnement, ou quelque autre châtiment qui n'otât pas la vie; tandis que, selon la coutume et les lois, les autres princes frappent du glaive les prisonniers de guerre, ou pendant la paix, les hommes convaincus de crimes capitaux, il songeait sagement en lui-même que l'arbitre souverain, qui, terrible, regarde les actions des puissans d'ici bas, rend à chacun ce qu'il a mérité par sa clémence miséricordieuse ou ses rigueurs immodérées.
Le roi Henri apprenant que l'homme dont il favorisait et conseillait la méchanceté était étroitement enfermé, se hâta de lui porter secours, et amena une troupe considérable de gens d'armes, et en outre un grand nombre de choses dont manquaient les assiégés. Séduits par l'espoir d'une mémorable action, quelques-uns de ceux que le duc avait laissés en garnison dans la tour, allèrent à la découverte, et s'emparèrent du chemin par où devaient passer les Français. Et voilà qu'ils prirent une grande quantité de ceux qui se tenaient le moins sur leurs gardes. Enguerrand, comte de Ponthieu, fameux par sa noblesse et son courage, et un grand nombre de guerriers furent tués. Hugues Bardoul lui-même, homme illustre, fut fait prisonnier. Cependant le roi, étant arrivé où il avait résolu d'aller, attaqua la garnison avec la plus grande impétuosité et une force extrême, afin d'arracher Guillaume d'Arques de sa fâcheuse position, et de venger en même temps l'échec de son pouvoir et le carnage des siens. Mais il s'aperçut que la chose était difficile, car les remparts de la tour et le courage également ferme des chevaliers soutenaient facilement les assauts des ennemis; alors pour ne pas s'exposer à une mort sanglante ou à une honteuse fuite, il se hâta de s'en aller, sans avoir acquis aucune gloire, à moins que par hasard on ne regarde comme glorieux d'avoir diminué par ses trésors la pauvreté de ceux au secours desquels il était venu, et d'avoir augmenté le nombre de leurs chevaliers. Le duc étant ensuite retourné au siége, et étant resté quelque temps à cette expédition comme s'il n'eût fait que se livrer à un joyeux repos, la violence de la faim pressant les assiégés plus cruellement et plus étroitement que les armes, ils se virent presque vaincus. Le roi, appelé de nouveau par des messages nombreux et de lamentables supplications, refusa de venir, pensant qu'il s'exposerait à une chute plus terrible, et craignant des dangers plus cruels et plus ignominieux. Guillaume d'Arques voit enfin avec angoisse que la cupidité d'enlever les États de son seigneur est une mauvaise conseillère, qu'il est injuste et presque toujours pernicieux de violer son serment ou sa foi, que le nom de la paix est doux et séduisant, et que la paix elle-même est agréable et salutaire. Il condamne alors, outre toute son audacieuse entreprise, ses desseins insensés et son action pernicieuse. Il s'afflige d'être resserré dans un lieu si étroit. Les supplians obtiennent d'être reçus à capituler, en concluant un traité qui, ne leur laissant que la vie, ne leur offrait rien d'honorable ni d'utile. Voilà un triste spectacle, une déplorable honte. Les chevaliers français, auparavant fameux, se hâtent, au-delà de ce que peuvent leurs forces affaiblies, de s'échapper avec les Normands, la tête baissée non moins de honte que d'épuisement, une partie suspendus sur des chevaux affamés qui faisaient à peine sonner la corne de leurs pieds, et pouvaient à peine faire élever de la poussière; d'autres, ornés de bottines et d'éperons, s'avançant dans un ordre inaccoutumé, et plusieurs d'entre eux languissans et courbés sur leurs chevaux, tandis que d'autres, chancelant, se soutiennent à peine. Il fallait voir aussi le déplorable état des troupes qui sortaient, et dont l'aspect était dégoûtant et varié. Ayant pitié des infortunes du comte, comme auparavant de celles de Gui, dans sa louable clémence, le duc ne voulut point accabler d'une plus grande infortune son ennemi exilé et pauvre; il lui accorda avec le pardon, en son pays, quelques possessions étendues et de nombreux revenus, regardant comme plus juste de reconnaître qu'il était son oncle, que de le poursuivre comme son ennemi.
Pendant le temps même du siége, quelques-uns des plus puissans parmi les Normands abandonnèrent le parti du duc pour passer vers le roi. Il était présumable que déjà auparavant ils avaient été les secrets fauteurs de la conspiration des rebelles. Ils n'avaient pas encore dégorgé toute la méchanceté dont ils avaient été gonflés autrefois contre le duc dans son enfance. Dans leur association se trouvaient Guimond, gouverneur d'une place forte appelée Moulins, qu'il remit entre les mains du roi, qui y mit une garnison royale, Gui, frère de Guillaume, comte de Poitou, et de l'impératrice des Romains, et avec lui d'illustres hommes de guerre. Mais ceux-ci, et tous ceux qui, dans d'autres endroits, furent abandonnés par les Français, ayant appris la reddition du repaire d'Arques, se dérobèrent aux nôtres par la fuite. Les Normands, qui auraient dû être punis selon la loi contre les transfuges, se réconcilièrent avec leur seigneur, qui ne leur infligea qu'une peine légère, ou les exempta de toute punition. Ils reconnurent qu'aucun moyen, aucun artifice, ne pouvait réussir contre lui.
Ensuite la France commença à s'enflammer d'une haine plus violente, et à s'agiter par de nouveaux troubles. Tous les grands et le roi, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent ennemis acharnés du prince normand. Dans leurs esprits inquiets et malveillans s'irritait la cruelle blessure que leur avait faite récemment la mort du comte Enguerrand, et de ceux qui périrent dans le même combat. Ils étaient enflammés de fureur au souvenir de ce qui était arrivé à Geoffroi, comte d'Anjou, chassé depuis long-temps, comme nous l'avons rapporté, par le bouclier de Guillaume, et à la mémoire des autres échecs innombrables et des honteuses défaites que leur avait fait éprouver le courage des Normands. Nous expliquerons sincèrement les causes de cette inimitié. Le roi supportait avec une très-grande peine, et regardait comme l'outrage le plus digne de vengeance, que le duc eût pour ami et pour allié l'empereur des Romains, dont aucun autre sur la terre ne surpassait la renommée de puissance et de dignité, et qu'il commandât à un grand nombre de puissantes provinces, dont les seigneurs ou gouverneurs étaient soumis à son service. Il s'indignait de ce qu'il n'avait pas le comte Guillaume pour ami ou pour chevalier, mais pour ennemi; de ce que la Normandie, qui depuis longues années dépendait des rois de France, était presque érigée en royaume, et de ce que des comtes, ses prédécesseurs, quels que fussent leurs emplois, aucun ne s'était jamais élevé à ce point. Mécontens pour les mêmes motifs, Thibaut, le comte du Poitou, Geoffroi, et le reste des grands, outre quelques sujets de courroux particulier, trouvaient insupportable d'avoir à suivre les bannières du roi partout où elles les conduisaient. Ensuite, quelques-uns de ceux qui approchaient plus du roi convoitaient la Normandie, ou une partie de la Normandie et comme des torches ardentes, ils embrasaient le roi et les grands.
C'est pourquoi, après une délibération commune, et qui nous présageait malheur, un édit du roi ayant ordonné la guerre, on leva contre la Normandie des troupes innombrables. On eût vu se hâter, hérissées de fer, la Bourgogne, l'Auvergne et la Gascogne, et tous les guerriers d'un si grand royaume accourant des quatre points cardinaux, et la France et la Bretagne d'autant plus animées contre nous qu'elles nous étaient plus voisines. On peut affirmer que Jules-César ou quelqu'autre plus habile dans la guerre, s'il en exista jamais, fût-il chef d'une armée romaine rassemblée de mille nations, et commandât-il à mille provinces, du temps le plus florissant de Rome, eût pu s'effrayer du terrible aspect de cette armée. Notre pays conçut donc quelque effroi; les églises craignirent de voir troubler le repos de la sainte religion, et piller ses revenus par la fureur des hommes d'armes, quoiqu'elles se confiassent pour leur défense dans le secours de la prière. Le peuple des villes et des campagnes, et tous ceux qui étaient faibles et sans défense tremblaient d'inquiétude et de frayeur: ils craignaient pour eux, pour leurs femmes, leurs enfans et leurs biens, s'exagérant, selon la coutume de la peur, les forces d'un ennemi si puissant. Mais quand ils se rappelaient quel était leur défenseur, comment, encore dans la jeunesse, ou plutôt dans l'enfance, il avait arraché la patrie à de déplorables calamités par sa grande sagesse et son courage encore plus grand, l'espoir adoucissait leur crainte, et la confiance venait consoler leur affliction. Admirable par sa fermeté, le duc Guillaume ne se sentit frapper d'aucune frayeur, et courut s'opposer avec un grand courage au-devant du roi, qui, à la tête d'une force terrible, s'avançait peu à peu du pays d'Evreux sur Rouen. Dès qu'il connut les dispositions de l'ennemi, le duc dirigea vers les rives opposées de la Seine une partie de ses troupes; car on avait adopté une manœuvre dont on espérait beaucoup d'avantage, savoir, que tous les chevaliers des pays compris entre la Seine et la Garonne, et dont les habitans portent le nom de Celti-Gaulois, nous attaqueraient d'un côté sous la conduite du roi lui-même, tandis que ceux des pays compris entre la Seine et le Rhin, qu'on nomme Gaule-Belgique, nous attaqueraient sous le commandement d'Eudes, frère du roi, et de Renaud, un de ses plus familiers. Le roi était aussi accompagné des gens de l'Aquitaine, troisième portion de la Gaule, fort renommée dans le monde par son étendue et la multitude de ses habitans. ll n'était pas étonnant que la témérité et l'orgueil des Français, si bien soutenus, eussent quelque espoir, ou d'accabler notre duc par cette masse de forces, ou de le contraindre à s'échapper par une honteuse fuite, ou de prendre et tuer nos chevaliers, de renverser les villes, d'incendier les villages, de frapper du glaive, et de se livrer au pillage, enfin de faire de tout notre pays un affreux désert.
Mais il en arriva tout autrement; car Eudes et Renaud en étant venus aux mains, dès qu'ils virent leur armée moissonnée par les coups les plus terribles et les plus cruels, ils abandonnèrent le commandement et le secours de leur épée, et s'empressèrent de pourvoir à leur fuite par la vitesse de leurs chevaux. Leurs têtes, qui ne méritaient pas un sort plus doux, étaient pressées par la pointe de l'épée de Robert, grand par sa noble origine aussi bien que par son courage, de Hugues de Gournay, de Hugues de Montfort, de Gautier Giffard, de Guillaume Crispin et d'autres encore des plus valeureux de notre parti. Gui, comte de Ponthieu, trop avide de venger son frère Enguerrand, fut fait prisonnier, ainsi que plusieurs chevaliers distingués par leur naissance et leur fortune. Un grand nombre furent tués, le reste se sauva par la fuite avec ses bannières. Ayant promptement appris ce succès, notre défenseur, le duc Guillaume, envoya pendant le silence de la nuit, avec de sûres instructions, quelqu'un qui, se tenant près du camp du roi, sur le haut d'un arbre, lui annonça en détail cette funeste victoire. Le roi, surpris à cette nouvelle inattendue, fit sans retard éveiller les siens avant le jour, et leur donna le signal de la fuite, pensant qu'il était de la plus haute nécessité de s'éloigner très-promptement des frontières de la Normandie. Ensuite beaucoup d'hostilités eurent lieu de part et d'autre, comme il arrive ordinairement dans la guerre entre des ennemis si puissans. Enfin les Français, desirant avec la plus grande ardeur la fin de ces dissensions si funestes pour eux, firent la paix à cette condition, que les prisonniers faits à Mortemar seraient rendus au roi, avec le consentement et par le don duquel, pour ainsi dire, le duc resterait en possession, par un droit perpétuel, de ce qu'il avait enlevé et pourrait enlever à Geoffroi, comte d'Anjou. Aussitôt, dans cette assemblée même, le duc avertit par un ordre ses principaux chevaliers d'être prêts à se trouver promptement sur les frontières du comte d'Anjou pour construire Ambrières. Il indiqua par des députés à Martel le jour qu'il leur marquait pour cette entreprise. O esprit valeureux, intrépide et noble de cet homme! ô vertu admirable et difficile à louer dignement! Le duc n'ambitionne pas la conquête de la terre de quelque homme faible, mais celle du tyran le plus féroce, et, comme nous l'avons dit plus haut, le plus brave à la guerre, de l'homme que les comtes et les ducs les plus puissans craignaient comme la foudre terrible, et aux forces et aux artifices duquel ses voisins pouvaient à peine échapper. Et, pour que l'admiration soit plus grande, le duc n'attaque pas cet ennemi lorsqu'il est sans précaution et sans défense, mais quarante jours auparavant il lui annonce où, quand, et pourquoi il doit venir. Frappé par la terreur de ce bruit, Geoffroi de Mayenne alla promptement trouver Geoffroi son seigneur, et se plaignit avec tristesse et lamentation que les Normands avaient construit Ambrières pour attaquer à leur gré la terre de leur ennemi, la détruire et la ravager. Le tyran Martel, orgueilleux de cœur, lui répliqua, selon sa coutume de concevoir et de dire présomptueusement de grandes choses: «Secoue ma domination comme celle d'un seigneur vil et infâme si tu me vois laisser patiemment accomplir ce que tu crains.» Au jour marqué, le duc des Normands entra sur le territoire du Maine, et pendant qu'il bâtissait le château dont il avait menacé Geoffroi, la renommée, qui annonce le faux comme le vrai, l'instruisit que Geoffroi Martel allait bientôt arriver. Alors ayant terminé les travaux, le duc attendit avec une grande intrépidité et une grande ardeur l'arrivée de l'ennemi. Voyant qu'il tardait plus qu'il n'avait cru, et que le peuple et les grands se plaignaient déjà du manque de vivres, de peur de trouver ensuite ses hommes d'armes moins prêts à obéir à ses ordres, il résolut de les renvoyer, après avoir fourni le château d'hommes et de vivres; il leur ordonna toutefois de revenir aussitôt qu'ils recevraient un message de lui. Le bruit du départ de notre armée s'étant bientôt répandu, Martel, soutenu par le secours de Guillaume, comte de Poitiers, son seigneur, d'Eudes, comte de Bretagne, et de troupes rassemblées de tous les côtés, marcha vers Ambrières. Après en avoir observé la situation et les fortifications, il se prépara à en faire le siége. Ses hommes s'apprêtent à renverser les remparts, et les gens du château leur résistent vaillamment. Ils s'enflamment, deviennent audacieux, attaquent de plus près et plus vivement: de part et d'autre on combat avec une grande impétuosité. Ceux d'en haut frappent avec les traits, les pierres, les pieux, les lances. La plupart des assiégeans sont tués, les autres sont repoussés. Leurs audacieux efforts ainsi déjoués, ils entreprirent autre chose; ils essayèrent de renverser les murs au moyen du bélier, mais les assiégés frappèrent la poutre et la rompirent.
Pendant ce temps, Guillaume, le fondateur du château, ayant appris la fâcheuse position des siens, sans se permettre le moindre délai, assemble son armée, et se hâte de venir à leur secours avec la plus grande promptitude. Dès que les trois comtes ennemis ci-dessus nommés furent instruits de son approche, eux et leur formidable armée se retirèrent avec une vitesse étonnante, pour ne pas dire qu'ils s'enfuirent en tremblant. Le vainqueur ayant attaqué sur-le-champ Geoffroi de Mayenne, qui, par la plainte dont nous avons parlé, avait enflammé la fureur de son seigneur, en peu de temps il le réduisit si bas, qu'au fond de la Normandie, Geoffroi vint se soumettre à lui, et lui jura la fidélité qu'un vassal doit à son seigneur.
La paix fut rompue de nouveau avec la France, et le roi cherchant à venger sa honte plutôt que les torts qu'on lui avait faits, recommença son expédition, et attaqua la Normandie après avoir rassemblé une armée considérable, à la vérité, mais moins formidable qu'auparavant. La plus grande partie des siens, pleurant leurs pertes et la honteuse fuite des leurs, ou saisis de crainte, étaient moins disposés à revenir nous attaquer, quoiqu'ils desirassent bien ardemment se venger de nous. Martel, comte d'Anjou, que n'avaient pas encore abattu tant de funestes revers, ne manqua pas de s'y trouver, amenant autant de troupes qu'il en put rassembler. A peine la terre de Normandie entièrement détruite et ravagée aurait-elle pu rassasier la haine et la rage de cet ennemi. Ils tinrent leur mouvement aussi secret qu'ils le purent, de peur que dans la route même, notre défenseur qu'ils avaient déjà éprouvé ne vînt au devant d'eux et ne les repoussât. Ils parvinrent par divers chemins à travers le comté d'Exmes jusqu'à la Dive, ravageant tout sur leur passage, avec la cruauté de la guerre. Là, il ne leur plut pas de s'en retourner, et ils ne voulurent pas s'arrêter. Si on les eût laissé s'avancer au delà avec la même facilité que celle qu'ils avaient rencontrée jusque-là, et ensuite se retirer en France sans dommage, ils auraient acquis une illustre renommée, pour avoir ravagé par le fer et le feu, sans que personne s'y opposât ou les poursuivît, la terre de Guillaume de Normandie jusqu'au rivage de la mer; mais cet espoir les trompa, comme celui qu'ils avaient conçu autrefois; car tandis qu'ils étaient arrêtés à un gué de la Dive, survint dans un moment favorable, avec une petite troupe de guerriers, le duc rempli d'ardeur. Déjà une partie de Tannée avait passé le fleuve avec le roi; mais voilà que le très-vaillant vengeur tomba sur le reste, et tailla en pièces les dévastateurs, regardant comme un crime, lorsqu'il s'agissait des intérêts de sa patrie déchirée, d'épargner l'ennemi qui la ravageait, lorsqu'il le trouvait sur son territoire. Surpris en deçà du fleuve, ils furent presque tous tués par le fer aux yeux du roi, excepté ceux qui, poussés par la frayeur, aimèrent mieux se précipiter dans les eaux. Le flux de la mer remplissant le lit de la Dive d'une masse d'eau, que le duc ne pouvait franchir, s'opposait à ce que la juste sévérité de son glaive les poursuivît sur l'autre rive. Le roi plaignant le sort des siens et saisi de crainte, sortit le plus promptement qu'il put de la Normandie avec le tyran d'Anjou; et cet homme courageux et fameux à la guerre vit, d'un esprit consterné, qu'attaquer davantage la Normandie passerait pour de la démence.
Peu de temps après, il entra dans la voie de toute chair, sans s'être jamais illustré par aucun triomphe remporté sur Guillaume, comte de Normandie, et sans avoir joui contre lui des plaisirs de la vengeance. Il eut pour successeur son fils Philippe, encore enfant. Selon le desir et le consentement de toute la France, une paix solide et une amitié pure furent conclues entre lui et notre prince.
Vers le même temps mourut Geoffroi Martel, selon les vœux de beaucoup de gens qu'il avait opprimés ou qui le craignaient. C'est ainsi que la nature met des bornes inévitables au pouvoir terrestre et à l'orgueil humain. Ce malheureux homme se repentit trop tard de son excessive puissance, de sa funeste tyrannie et de sa pernicieuse cupidité. Ses derniers momens lui apprirent une vérité à laquelle il avait auparavant négligé de penser, qu'on doit nécessairement perdre un jour ce qu'on possède en ce monde, même justement. Il laissa pour héritier le fils de sa sœur, qui, semblable à lui par le nom, en fut fort différent par sa vertu, et qui commença à craindre le roi du ciel, et à faire le bien pour s'acquérir les honneurs éternels.
Nous savons que la bouche des hommes est plus disposée à louer la méchanceté que la bonté, la plupart du temps par haine, quelquefois par une autre dépravation, car on a coutume, par une inique perversité, d'interpréter les plus belles actions dans un sens contraire. C'est pourquoi il est certain qu'il arrive quelquefois que les belles actions des rois, des ducs ou de quelque grand, si on ne les transmet pas dans toute leur vérité à la postérité, sont condamnées par le jugement des gens de bien; en sorte que de mauvaises actions qu'on ne devrait jamais imiter, comme l'invasion ou quelque autre aussi injuste, deviennent séduisantes par l'exemple. Nous estimons donc important de dire avec la plus exacte vérité que si Guillaume, dont nous racontons la gloire, ce. qui, nous le souhaitons, ne déplaira nullement, mais sera agréable à tous, tant présens que futurs, s'empara, par la force de ses armes, de la principauté du Mans, ainsi que du royaume d'Angleterre, c'est qu'il dut s'en emparer selon les lois de la justice.
La domination des comtes d'Anjou était depuis long-temps pénible et presque insupportable aux comtes du Mans. Pour passer sous silence beaucoup d'autres choses, tout récemment à notre mémoire, Foulques, comte d'Anjou, avait attiré à Saintes, par la promesse de lui remettre sa ville, Herbert, comte du Mans. Là, l'ayant fait venir, au milieu de leur entrevue, il le fit souscrire, par la prison et les tourmens, aux conditions que desirait sa cupidité.
Dans le temps de Hugues, Geoffroi Martel incendia souvent la ville du Mans, souvent il la livra pour butin à ses avides chevaliers, souvent il arracha les vignes de ses environs, et quelquefois, après avoir chassé son maître légitime, la rangea sous sa seule domination. Hugues légua à Herbert son fils son héritage avec les mêmes inimitiés. Craignant d'être entièrement dépouillé par la tyrannie de Geoffroi, Herbert alla trouver en suppliant Guillaume, duc de Normandie, pour se mettre sous sa protection, se donna à lui de ses propres mains, reçut tout de lui comme un chevalier de son seigneur, et l'institua son seul héritier s'il n'en engendrait pas d'autre. De plus, pour s'allier de plus près, lui et sa postérité, à un si grand homme, il demanda au duc sa fille, qui lui fut fiancée. Mais vers le temps où celle-ci atteignit l'âge nubile, lui-même mourut de maladie, et à son lit de mort il conjura et pria les siens de ne point chercher d'autre seigneur que celui qu'il laissait pour son successeur, leur disant «que s'ils lui obéissaient de leur propre volonté, leur condition serait légère à supporter; mais que peut-être serait-elle pesante s'ils étaient par lui subjugués; qu'ils connaissaient très-bien sa puissance, sa sagesse, sa force, sa gloire et son antique origine; que sous son gouvernement ils n'auraient rien à craindre pour leurs frontières.»
Mais des traîtres reçurent Gautier, comte de Mantes, qui avait pris en mariage la sœur de Hugues, et qui vint attaquer le Mans. Indigné de cette opposition, Guillaume, que des droits multipliés appelaient à la succession d'Herbert, prit les armes pour conquérir ce qu'on lui enlevait ainsi. Autrefois le Mans avait été soumis aux ducs de Normandie. Il aurait pu, d'autant qu'il abondait en moyens et en forces, incendier sur-le-champ ou détruire la ville toute entière, et égorger les audacieux auteurs de cette iniquité; mais il aima mieux, selon sa clémence accoutumée, épargner le sang des hommes quoique coupables, et laisser sur pied cette ville, très-forte capitale et rempart des pays qu'il avait en sa possession.
Voici quel moyen il adopta pour s'en emparer: ce fut de les frapper de crainte par des incursions fréquentes et longues sur leur territoire et leurs demeures, de ravager les vignes, les champs, les maisons de campagne, de cerner les endroits fortifiés, de mettre des garnisons partout où elles étaient nécessaires, et enfin, de les désoler continuellement par une foule de calamités. Il est plus facile de deviner que de rapporter l'inquiétude et la terreur des Manceaux, lorsqu'ils le virent agir ainsi, et combien ils desirèrent éloigner de leur tête ce fardeau accablant. Ayant souvent appelé à leur secours Geoffroi, que leur gouverneur Gautier avait établi son seigneur et son défenseur, ils menacèrent quelquefois de livrer bataille au duc, mais ne l'osèrent jamais. Enfin les châteaux de tout le comté pris et soumis, ils rendirent leur ville au vainqueur; et supplians, ils reçurent avec de grands honneurs celui qu'ils avaient arrêté par une longue rébellion. Grands, moyens, petits, rivalisent de zèle pour apaiser celui qu'ils ont offensé. Ils accourent au devant de lui, le proclament leur seigneur, et s'inclinent devant sa dignité; ils prennent des visages rians, font entendre des voix joyeuses et des applaudissemens de félicitation. Les ordres religieux de toutes les églises qui étaient dans la ville, approuvant l'enthousiasme des laïques, vont à sa rencontre. Les églises et les temples brillent avec éclat, ornés comme en un jour de fête. Les parfums embaument les airs qui retentissent des cantiques sacrés. Le vainqueur trouva qu'il lui suffisait pour leur châtiment qu'ils eussent été domptés par son pouvoir, et que les remparts de leur ville fussent désormais occupés par ses gardes. Gautier consentit volontairement à la cession de cette ville, de peur qu'en défendant les pays envahis, il ne perdît son héritage. La victoire remportée par le Normand lui faisait craindre quelque chose de pis pour Mantes et Chaumont, situés dans le voisinage.
Sage vainqueur et tendre père, Guillaume voulut pourvoir de son mieux et pour toujours aux intérêts de sa race. C'est pourquoi il résolut de marier son fils à la sœur d'Herbert, qui fut amenée du pays des Teutons à ses dépens et à grands frais, afin que par elle, lui, et ceux qu'il engendrerait, possédassent, en qualité de beau-frère et neveux, l'héritage d'Herbert, par un droit qui ne pût leur être ni arraché ni contesté. Comme son fils n'était pas encore en âge d'être marié, il fit garder la jeune fille déjà presque nubile dans un lieu sûr avec de grands honneurs, et la confia aux soins d'hommes et de matrones nobles et sages. Cette vertueuse vierge, nommée Marguerite, était, par sa remarquable beauté, plus gracieuse que la plus belle perle. Mais peu de temps avant le jour où elle devait être unie à son époux mortel, elle fut enlevée aux hommes par le fils de la Vierge, l'époux des vierges, le roi du ciel, dont le saint amour avait embrasé la pieuse jeune fille. Brûlant pour lui de desirs, elle s'appliquait aux oraisons, à l'abstinence, à la miséricorde, à l'humilité, enfin à toute sorte de bonnes œuvres, souhaitant ardemment d'ignorer à jamais tout autre mariage que celui du Seigneur. Elle fut ensevelie dans le cloître de Fécamp qui, avec les autres églises, s'affligea, autant que le permettait la religion, de voir enlevée par une si prompte mort celle à qui tous desiraient sincèrement une longue vie. Son ame, veillant prudemment et attendant avec son flambeau allumé l'arrivée du Christ, avait toujours fréquenté les églises avec respect. Le cilice aussi dont elle s'était servie secrètement pour dompter la chair ayant été trouvé après sa mort, fit voir qu'elle dirigeait son ame vers l'Eternel.
La prise de la ville du Mans montra clairement combien l'esprit léger de Geoffroi de Mayenne était loin de s'unir d'inclination au duc Guillaume; car pour ne pas être témoin de sa glorieuse félicité, il abandonna la ville auparavant, chassé autant par une douleur haineuse que par une inconstante perfidie. Cet audacieux impudent ne voulut point se rappeler comment jadis dompté par le duc, il avait imploré sa clémence; son insolente iniquité ne craignit pas de jurer et de violer sa promesse. Il croyait en harcelant cette valeur invincible, illustrée par des triomphes multipliés, s'acquérir une renommée aussi durable que l'eussent jamais obtenue ses ancêtres, quelque puissans qu'ils fussent. Fréquemment sommé d'obéir par des députés, il n'abaissa point son esprit obstiné. La fuite, l'astuce, des remparts solides accroissaient beaucoup sa témérité. Celui qu'il rejetait pour seigneur résolut dans sa sagesse de lui enlever sa retraite chérie, le château de Mayenne; regardant comme suffisant et plus digne de lui de lui infliger cette punition, que de le poursuivre dans sa fuite, et en le faisant prisonnier d'ajouter une légère victoire à toutes celles dont il pouvait déjà se glorifier. Aucune force, aucun moyen, aucun artifice humain, ne pouvait suffire à attaquer ce château par un de ses flancs baigné par un fleuve rapide et bordé d'écueils; car le château était bâti sur les bords de la Mayenne, sur une montagne escarpée; des remparts de pierres et un abord aussi très-difficile défendaient l'autre côté. Cependant on se prépara à en faire le siége; et notre armée s'étant approchée éprouva combien le lieu était inaccessible par sa nature. Tous s'étonnaient que le duc entreprît avec une si grande témérité la chose la plus difficile. Presque tous pensaient qu'il était inutile de fatiguer tant de troupes de chevaliers et d'hommes de pied; un grand nombre murmuraient; nulle espérance ne les soutenait, si ce n'est celle que dans un an ou plus la famine pourrait forcer les assiégés à se rendre. En effet, on ne pouvait ni n'espérait rien faire avec les épées, les lances et les traits, ni davantage avec le bélier, la baliste ou les autres machines de guerre; car ce lieu était tout-à-fait défavorable aux machines. Mais le magnanime duc Guillaume presse son entreprise, ordonne, exhorte, rassure les moins intrépides, et leur promet un heureux succès Leur doute ne dura pas longtemps. Voilà que par une adroite invention on lance dans le château des flammes qui l'embrasent. Dans le plus court espace de temps elles s'étendent à leur ordinaire, ravageant tout ce qu'elles rencontrent avec plus de fureur que-le fer. Les gardes et les défenseurs, étonnés par une défaite soudaine, abandonnent les portes et les remparts, et courent d'abord en tremblant porter du secours à leurs maisons et à leurs effets enflammés. Ensuite ils s'empressent de se rendre dans les asiles où ils peuvent pourvoir à leur propre salut, craignant encore plus les épées des vainqueurs que l'incendie. Les Normands accourent avec la plus grande célérité, joyeux d'esprit; et poussant à la fois un cri d'allégresse, ils se précipitent à l'envi, et s'emparent de vive force des remparts. Ils trouvent un butin considérable, des chevaux de noble race, des armes de guerre et des meubles de tout genre. Le prince, très-modéré et très-généreux, voulut que ces choses et le reste du butin, en grande partie composé de choses précieuses, demeurassent aux chevaliers plutôt que de lui revenir. Les habitans du château qui s'étaient réfugiés dans la citadelle se rendirent le jour suivant, ne se confiant en aucun rempart contre le génie et la force de Guillaume. Celui-ci, après avoir fait rétablir ce qui avait été consumé par les flammes, et fait porter de prévoyans secours, comme pour remporter sur la nature un triomphe inaccoutumé, s'en retourna chez lui au milieu des transports de joie de son armée. Les voisins de Geoffroi ne s'attristèrent pas de ce qu'il avait subi cet échec, et assurèrent qu'il était glorieux au comte Guillaume d'avoir seul vengé un grand nombre de gens d'un parjure et d'un brigand.
Presque dans le même temps Edouard, roi d'Angleterre, par une garantie plus forte qu'auparavant, assura son héritage à Guillaume, qu'il avait déjà établi son successeur, et qu'il chérissait comme un frère ou un fils. Il voulut prévenir l'inévitable puissance de la mort dont cet homme, qui par une vie sainte aspirait au royaume céleste, pensait que l'heure approchait. Il lui envoya, pour lui confirmer sa foi par le serment, Hérald4, le plus élevé par ses dignités et sa puissance de tous ceux qui étaient soumis à sa domination, et dont le frère et le cousin avaient été auparavant donnés en otage comme garantie de cette même succession. Ce fut avec la plus grande sagesse qu'il le choisit, afin que ses richesses et son autorité contraignissent les Anglais à se soumettre dans le cas où, selon leur perfidie et leur inconstance ordinaire, ils voudraient s'opposer à ce qu'il avait décidé. Comme Hérald s'empressait de venir pour cette affaire, après avoir échappé aux dangers de la traversée, il aborda au rivage du Ponthieu, où il tomba entre les mains du comte Gui. Ayant été fait prisonnier avec les gens de sa suite, on le mit en prison, ce que cet homme regarda comme un malheur plus grand qu'un naufrage. L'avarice ingénieuse a inventé chez quelques nations des Gaules une coutume exécrable, barbare et contraire à toute justice chrétienne. On tend des piéges aux puissans et aux riches, on les renferme dans des prisons, et on les accable d'outrages et de tourmens. Après les avoir ainsi par différentes calamités presque réduits à la mort, on les fait sortir du cachot très-souvent pour les vendre à un grand. Le duc Guillaume ayant appris ce qui était arrivé à Hérald, envoya promptement des députés, et le tira de sa prison par prières autant que par menaces. Etant allé au devant de lui, il le reçut avec honneur. Il rendit de dignes actions de grâces, remit des terres considérables, beaucoup de biens, et de plus de très-forts dons en argent à Gui, qui avait bien mérité de lui, et qui, sans y être forcé ni par récompense ni par violence, lui avait amené lui-même et présenté au château d'Eu un prisonnier qu'il aurait pu à son gré tourmenter, tuer ou vendre. Il fit entrer Hérald avec les plus grands honneurs dans Rouen, ville capitale de sa principauté, où les plaisirs multipliés d'une obligeante hospitalité recréèrent très-agréablement ces hôtes de toutes les fatigues de la route. Le duc se réjouissait de posséder un hôte si illustre, envoyé par le plus chéri de ses proches et de ses amis, et en qui il espérait trouver un très-fidèle médiateur entre lui et les Anglais, parmi lesquels Hérald était le second après le roi. Une assemblée ayant été réunie à Bonneville, Hérald jura fidélité au duc selon la coutume chrétienne; et, ainsi que l'ont rapporté des hommes très-dignes de foi et illustres par de nombreuses dignités, qui en furent alors témoins, il fit entrer de lui-même dans le nombre des articles du serment, qu'aussi long-temps que vivrait encore le roi Edouard, il serait à sa cour le délégué du duc Guillaume; qu'il s'efforcerait autant qu'il pourrait, par ses conseils et ses secours, de lui faire confirmer, après la mort d'Edouard, la possession du trône d'Angleterre; que, jusqu'à ce temps, il remettrait à la garde des chevaliers du duc le château de Douvres, fortifié par ses soins et à ses frais; que de même il remettrait au duc d'autres châteaux et d'autres parties de l'Angleterre, dès qu'il l'ordonnerait, et qu'il fournirait aux gardes d'abondantes provisions. Le duc, après l'avoir reçu pour son vassal, lui remit, sur sa demande et avant le serment, toutes les terres à lui appartenantes. On n'espérait pas voir se prolonger long-temps la vie d'Edouard alors malade.
Ensuite, sachant Hérald brave et avide d'une nouvelle renommée ainsi que les gens de sa suite, le duc les munit d'armes et de chevaux de grand prix, et les mena avec lui à la guerre de Bretagne. Il traita ce député et cet hôte comme un compagnon d'armes, afin, par cet honneur, de se le rendre plus fidèle et plus dévoué. La Bretagne s'était témérairement levée toute en armes contre la Normandie. Le chef de cette audacieuse rébellion était Conan, fils d'Alain. Devenu adulte, il fut l'homme le plus féroce; délivré d'une tutelle à laquelle il avait été long-temps soumis, après avoir pris son oncle Eudes, et l'avoir fait charger de fers et emprisonner, il commença à gouverner avec une grande cruauté la province que lui avait transmise son père. Ensuite, renouvelant la révolte de son père, il voulut être l'ennemi et non le vassal de la Normandie. Celui qu'un antique droit établissait son seigneur, Guillaume, duc de Normandie, lui opposa sur les frontières un château appelé Saint-Jacques, pour empêcher d'avides pillards de causer des dommages, par leurs excursions et leurs brigandages, aux églises sans défense ou au bas peuple de son pays. Le roi de France, Charles, avait acheté la paix et l'amitié de Rollon, premier duc de Normandie, et père de ceux qui lui succédèrent, en lui donnant en mariage sa fille Gisèle, et lui livrant la Bretagne pour lui être perpétuellement soumise. Ce traité avait été imploré par les Français, dont l'épée ne pouvait résister plus long-temps à la hache des Danois. Ce fait est attesté par les annales de l'histoire. Depuis, les comtes de Bretagne ne purent jamais soustraire tout-à-fait leur tête au joug de la domination des Normands, quoiqu'ils eussent souvent déployé tous leurs efforts pour y parvenir. Alain et Conan s'élevèrent contre les ducs de Normandie, avec un esprit d'autant plus orgueilleux qu'ils leur étaient alliés de plus près par la parenté. L'insolence de Conan s'était déjà accrue au point qu'il ne craignait pas d'annoncer quel jour il viendrait attaquer les frontières de la Normandie. Cet homme, d'un caractère violent et dans l'ardeur de l'âge, obtint la plus grande confiance de la part de son pays, qui s'étendait au loin et au large et était incroyablement peuplé d'hommes de guerre; car, dans cette contrée, un chevalier en engendrait cinquante en épousant, à la manière des Barbares, dix femmes ou davantage; ce que l'on rapporte des anciens Maures, qui ignoraient la loi divine et les coutumes de la pudeur. De plus cette nombreuse population s'applique beaucoup aux armes et au maniement des chevaux, et néglige entièrement la culture des champs et la civilisation; ils se nourrissent de très-abondans laitages et fort peu de pain. De vastes territoires, qui ne portèrent presque jamais de moissons, sont pour leurs troupeaux de gras pâturages. Lorsqu'ils n'ont pas de guerre étrangère, ils se nourrissent de rapines et de ravages domestiques, et s'exercent au brigandage. Ils vont au devant des combats avec une joyeuse ardeur, et combattent avec fureur. Accoutumés à repousser, ils cèdent difficilement. Ils exaltent et célèbrent par des réjouissances leurs victoires et la gloire qu'ils se sont acquise dans les combats. Ils prennent plaisir et gloire à enlever la dépouille des morts. Peu troublé de cette férocité, le duc Guillaume, le jour qu'il se souvint lui avoir été annoncé pour l'arrivée de Conan, s'avança lui-même à sa rencontre dans l'intérieur de son pays. Conan, comme s'il eût craint d'être frappé d'un coup de foudre qui le menaçait de près, s'enfuit avec la plus grande promptitude dans des lieux de défense, abandonnant le siége de Dol, château situé sur son territoire, et qui, s'opposant à un rebelle, demeurait fidèle à la cause légitime. Rual, gouverneur de ce château, essaya d'arrêter Conan, le rappela avec dérision, et le pria de demeurer deux jours, disant que ce délai lui suffirait pour se rendre son vassal. Mais cet homme, misérablement épouvanté, écouta plutôt sa frayeur, et continua de fuir. Le chef terrible qui l'avait chassé aurait poursuivi le fuyard s'il n'avait vu un danger évident à conduire une nombreuse armée à travers de vastes contrées stériles et inconnues. S'il restait quelque chose a ce pauvre pays de ce qui avait été recueilli l'année précédente, les habitans l'avaient caché avec leurs troupeaux dans des lieux sûrs. Les blés étaient encore verts ou en épis. De peur donc que, par une sacrilége rapine, on ne pillât les biens des églises, si on en trouvait quelques-uns, le duc ramena son armée épuisée par la disette des vivres qu'on lui distribuait tous les mois, présumant dans sa grande ame que Conan le supplierait bientôt pour obtenir sa grâce et le pardon de son crime. Mais, comme il sortait des frontières de la Bretagne, on lui annonça tout à coup que Geoffroi d'Anjou s'était joint à Conan avec des troupes considérables, et que le jour suivant ils viendraient tous deux lui livrer bataille. C'est pourquoi il se montra d'autant plus avide de combattre qu'il voyait plus de gloire à triompher, dans une seule bataille, de deux ennemis tous deux cruels. Il pensa aussi aux nombreux avantages de cette victoire.
Hual, sur le territoire duquel il campait, se plaignit à lui, lui disant qu'il serait reconnaissant d'avoir été par lui sauvé des mains de son ennemi, si le mal qu'il lui faisait ne surpassait le bien qu'il lui avait fait. Si en effet le duc demeurait pour attendre Conan, le pays, peu fécond et fort épuisé, serait entièrement ravagé; et il revenait au même pour les laboureurs de voir consommer par l'armée des Normands ou par celle des Bretons le fruit des travaux d'une année. Si l'expulsion de Conan avait servi à sa renommée, elle n'avait rien fait à la conservation de leurs biens. Le duc répondit à Rual qu'il devait considérer qu'un départ trop précipité ferait naître de lui une opinion peu honorable, et promit de lui payer en or un très-ample dédommagement des pertes qu'il lui causerait. Aussitôt le duc défendit à ses chevaliers de rien prendre des moissons et des troupeaux de Rual. On obéit à cet ordre avec une telle réserve qu'une seule gerbe de froment aurait suffi abondamment pour payer tout le dommage. Ce fut inutilement que le duc attendit le combat, car son ennemi s'enfuit encore plus loin. De retour chez lui, après que son cher hôte Hérald eut demeuré quelque temps auprès de lui, il le congédia comblé de présens: ce qu'il devait faire à juste titre, en considération à la fois de celui qui l'avait envoyé et de celui dont il venait augmenter les dignités. Bien plus, le jeune frère d'Hérald, autre otage, fut rendu à cause de lui, et s'en retourna avec lui. Nous te parlerons donc en peu de mots, Hérald. De quel cœur as-tu osé ensuite enlever à Guillaume son héritage et lui faire la guerre, lorsque de ta bouche et de ta main tu t'étais soumis à lui, toi et ta nation, par un serment sacré? Tu aurais dû réprimer la révolte, et c'est toi qui l'as pernicieusement excitée. Bien pernicieux furent les vents favorables qui enflèrent tes voiles à ton retour! Ce fut par une funeste bonté que la mer te porta, toi le plus corrompu des hommes, et te laissa aborder au rivage. Il fut malheureux le port tranquille qui te reçut lorsque tu venais exciter dans ta patrie le plus déplorable orage.
Parmi tant d'occupations mondaines, tant de guerres que d'affaires intérieures, cet excellent prince montra pour les choses divines un zèle rare, que nous ne pourrions rapporter assez en détail, ni d'une manière proportionnée à sa grandeur. Il avait appris, en effet, que non seulement la puissance des royaumes du monde finit bientôt par crouler, mais que la figure même de ce monde passe. Il savait qu'il n'existe qu'un royaume immuable, soumis au pouvoir éternel d'un maître ineffable, gouvernant toutes choses par lui créées, avec une providence éternelle comme lui, et pouvant écraser en un moment les tyrans trop adonnés aux voluptés terrestres; d'un maître qui accorde à la persévérance de ses serviteurs des diadêmes et des palmes brillantes d'un éclat inestimable et perpétuel, dans cette glorieuse cité, patrie de la souveraine vérité et du souverain bien. Il savait que son père, le fameux duc Robert, après avoir brillé dans son pays par de mémorables mérites, déposant les marques de sa dignité, avait entrepris un pélerinage rempli de périls, dans le desir de voir et contempler ce maître dans la Sion céleste; que les Richard, ses ancêtres, grands en puissance, illustres en renommée, portant humblement la croix sur leur front, avaient chéri Dieu dans leur cœur et l'avaient honoré dans leurs actions. Il pensait en homme sage au malheur et à la honte qu'il y avait, après avoir été dépouillé des vains honneurs du monde, d'être condamné à un exil de ténèbres, où une flamme inextinguible doit brûler sans consumer, où les gémissemens de la douleur ne trouveront aucune compassion, où on pleurera ses péchés sans en obtenir le pardon; il se représentait au contraire la félicité et l'honneur réservés à ceux qui, après avoir gouverné sur terre, élevés à une glorieuse immortalité, seraient mis au rang des anges, où ils goûteraient des délices infinies, contempleraient Dieu face à face, et se réjouiraient dans sa gloire éternelle.
Cet homme donc, digne de son pieux père et de ses pieux ancêtres, pendant ses expéditions de guerre, avait toujours présente devant les yeux de son esprit la crainte de l'éternelle majesté. Il défendait son peuple, adorateur du Christ, en réprimant les guerres extérieures par la force des armes, en arrêtant les séditions, les rapines et les pillages, afin que plus on jouirait de la paix, moins les lieux saints fussent exposés à l'insulte. On ne pourrait dire avec vérité qu'il ait jamais entrepris de guerre sans une juste cause. C'est ainsi que les rois chrétiens des nations Romaines et Grecques défendent leurs domaines, repoussent les offenses, et prétendent justement à la palme. Qui pourrait dire qu'il est d'un bon prince de souffrir les séditions ou les brigandages? Par les lois et les châtimens du duc, les brigands, les homicides, les malfaiteurs, furent expulsés de la Normandie. On y observait très-religieusement le serment de la paix de Dieu, appelée trève, que viole souvent l'iniquité effrénée des autres nations. Le duc daignait lui-même entendre la cause de la veuve, du malheureux, du pupille, agissait miséricordieusement, et prononçait avec la plus grande équité. Comme sa justice réprimait l'inique cupidité, aucun homme puissant, eût-il été de ses familiers, n'osait changer les limites du champ d'un voisin plus faible que lui, ou usurper sur lui aucune propriété. Par lui les droits et les biens des villages, des châteaux et des villes étaient eu sûreté. On le louait en tous lieux par de joyeux applaudissemens et de douces chansons. Il avait coutume d'écouter avidement les paroles de la sainte Ecriture, et d'y goûter une douceur infinie; il savait, en même temps qu'il se corrigeait et s'instruisait, se délecter en ce banquet spirituel. Il recevait et honorait avec un respect convenable la salutaire hostie, le sang du Seigneur, croyant avec une foi sincère ce que lui avait enseigné la vraie doctrine, que le pain et le vin placés sur l'autel et consacrés par les paroles et la main du prêtre et par le saint canon, sont la vraie chair et le vrai sang du Rédempteur. Aussi l'on sait avec quel zèle il a poursuivi et s'est efforcé d'exterminer de ses Etats les pervers qui pensaient autrement. Depuis sa plus tendre enfance il observait avec dévotion les saintes solennités, et les célébrait très-souvent avec la foule de l'assemblée religieuse du clergé ou des moines. Ce jeune homme fut pour les vieillards un grand et illustre exemple en fréquentant chaque jour avec assiduité les saints mystères: de même sa soigneuse prévoyance enseigna à ses enfans la piété chrétienne. Ils sont à plaindre ceux qui, brillant au faîte de la puissance terrestre, se précipitent d'eux-mêmes vers la perte de leur ame, et dont l'avare méchanceté s'opposant aux généreuses volontés des grands, permet avec peine ou empêche absolument de construire des basiliques dans leurs Etats, ou défend de faire des donations à celles qui sont bâties, et qui ne craignent pas de les dépouiller en accumulant par le sacrilége leurs richesses particulières. Notre peuple au contraire chante les louanges du Seigneur, dans plusieurs églises fondées par la bienveillante protection de son prince Guillaume ou enrichies par ses faciles largesses. Il ne refusait jamais d'autoriser ceux qui voulaient leur faire des dons; jamais il n'offensa les saints par aucune injure, et n'enleva jamais rien de ce qui leur était consacré. De son temps, la Normandie rivalisait avec l'heureuse Egypte par ses assemblées de moines réguliers, dont le duc était le principal protecteur, le patron fidèle, et le maître attentif. Tous obtenaient de lui affection, honneur, égard, mais bien plus cependant ceux que recommandait une plus haute estime de leur zèle religieux. O vigilance honorable, digne d'être imitée et continuée dans tous les siècles! Gouvernant en personne les abbés et les pontifes, il leur donnait d'habiles avertissemens, au sujet de la discipline laïque et ecclésiastique, les exhortait constamment, et les punissait sévèrement. Toutes les fois que, par son ordre ou son avis, les évêques, le métropolitain et ses suffragans s'assemblaient pour traiter de l'étal de la religion, du clergé, des moines et des laïques, il ne voulait jamais manquer d'être l'arbitre de ces synodes, afin d'augmenter, par sa présence, le zèle des fidèles et la prudence des sages, et pour n'avoir pas besoin d'apprendre, par le témoignage d'un autre, de quelle manière avait été fait ce qu'il desirait qu'on fît avec raison, ordre et dévotion. Ayant par hasard entendu parler d'un crime abominable, qu'un évêque ou un archidiacre avait puni plus doucement qu'il n'eût dû faire, il fit emprisonner celui qui s'était rendu coupable envers la majesté divine, et punit à son tour le juge trop mou. Il avait, avec le clerc et le moine, dont il savait que la conduite était conforme à sa profession, d'affectueux entretiens, et soumettait sa volonté à leurs prières. Au contraire, il ne jugeait pas digne d'être regardé avec un œil ami celui qui se déshonorait par une conduite irrégulière.
Il eut querelle pour un certain Lanfranc qu'il honorait d'une intime amitié, et qui méritait plus que personne le respect pour sa singulière habileté dans les lettres mondaines et sacrées, et sa rare exactitude à observer les règles de la vie monastique. Guillaume le respectait comme un père, le vénérait comme un précepteur, et le chérissait comme un frère ou un fils. Il lui faisait part de toutes les résolutions de son esprit, et lui confia le soin de surveiller les ordres ecclésiastiques par toute la Normandie. Le soin vigilant d'un tel homme, qui possédait l'autorité de la science au même degré que les droits de la sainteté, n'était pas une petite assurance pour la très-vertueuse sollicitude de ce prince. Pour l'établir abbé du monastère de Caen, il lui fallut user, pour ainsi dire, d'une pieuse contrainte; car Lanfranc s'y refusait non moins par amour pour l'humilité que par crainte d'un rang trop élevé. Ensuite il enrichit ce monastère de domaines, d'argent, d'or et de divers ornemens; il le fit construire à grands frais, d'une grandeur et d'une beauté admirable, et digne du bienheureux martyr Etienne, parles reliques duquel il devait être honoré et auquel il devait être consacré. Personne ne mettra jamais un plus grand prix aux prières que les moines adressent aux deux. Il demandait et achetait souvent les prières des serviteurs du Christ, surtout lorsqu'il était menacé d'une guerre ou de quelque autre danger.
Au moment où je rappelle ces choses, vient s'offrir à ma pensée le doux souvenir de Théodose Auguste, que les oracles et les réponses du moine Jean, qui habitait la haute Thébaïde, excitaient à marcher au combat contre les tyrans. Parmi tous les moines, celui-ci préférait Jean, dont l'obéissance avait obtenu le don de prophétie; et Guillaume avait choisi Lanfranc, dans les paroles et les actions duquel se sentait le parfum de l'esprit de Dieu.
Beaucoup d'hommes de bien, retenus par l'affection du sang, épargnent les crimes de leurs parens, et ne veulent point les faire descendre de leur haut rang, quand ils se montrent indignes de gouverner. Comme aveuglés par l'affection, ils voient leurs fautes avec la plus grande clémence, tandis que celles des autres les trouvent attentifs et sévères. Mais on doit méditer souvent et admirer comment Guillaume, dont nous rappelons ici l'intègre vertu, connaissant qu'il ne faut aucunement préférer le dommage des choses divines à celui de ses parens, fit, avec sagesse et justice, prévaloir la cause de Dieu contre l'archevêque Mauger, son oncle. Mauger, fils de Richard II, abusait de sa dignité comme d'un droit de naissance. Cependant il ne fut jamais revêtu du pallium, insigne principal et mystique de la dignité des archevêques; car le pontife de Rome, qui a coutume de le leur envoyer, le lui refusa, comme n'en étant pas digne. Ce n'est point que Mauger ne sût lire de l'œil de la science dans les saintes Écritures; mais il ne sut point gouverner sa vie et celle de ses subordonnés d'après les règles qu'elles imposent. Il appauvrit par ses spoliations l'église qu'avait enrichie et ornée la piété de plusieurs; il ne se montra point époux ni père, mais le maître le plus dur, le brigand le plus avide. Il se plaisait à avoir des tables bien fournies, avec une abondance et une richesse extrêmes; il aimait à acheter les louanges par des largesses, et était prodigue sous l'apparence de la libéralité. Souvent repris et puni en particulier et en public par la sage amitié de son seigneur jeune et laïque, il aimait mieux continuer dans les voies de la perversité. Il ne mit fin à ses prodigalités que lorsque le siége métropolitain fut presque entièrement dépouillé d'ornemens et de trésors. Ses largesses étaient souvent suivies de rapines: d'autres crimes encore exhalaient autour de lui une fâcheuse odeur de honte. Mais nous pensons qu'il est contraire à la raison de s'arrêter à publier tant de vices, malséants à rappeler et inutiles à connaître. De plus, Mauger offensa par une grave insulte l'Eglise universelle, dont il n'honora pas l'unique primat et le souverain pontife sur la terre, avec la soumission qu'il lui devait; car ayant été souvent appelé au concile de Rome par un ordre de l'apostole, il refusa de s'y rendre. Rouen et toute la Normandie se plaignaient d'un archevêque qui, lorsqu'il aurait dû surpasser en vertu les plus éminens, s'exposait aux censures et accusations des hommes du dernier rang, et dont le mépris universel prononçait la dégradation.
Le prince voyant qu'il n'y avait plus, dans une affaire d'une si grande importance, à user d'avertissement, pour ne pas attirer contre lui, par une plus longue patience, le courroux du juge céleste, fit déposer publiquement et canoniquement son oncle, dans un saint synode, du consentement unanime du vicaire de l'apostole et de tous les évêques de la Normandie. Il éleva au siége vacant Maurile, qu'il fit venir d'Italie, où il avait brillé éminemment au dessus des autres abbés, et le plus digne de ce rang par le mérite de sa naissance, de sa personne, de ses vertus et de ses connaissances.
Quelques années après, il mit à la tête du monastère de Saint-Wandrégisile, Gerbert, l'égal de Maurile, et son fidèle compagnon dans l'exercice de l'autorité monacale, déjà comme placé au rang des bienheureux par le sentiment et le renom d'une parfaite sainteté. Guillaume voulait rétablir, par un abbé animé de l'esprit saint, cet ordre qui tombait en décadence. Tous deux entièrement dans la fleur de l'âge, méditant sur la divinité et la béatitude qu'elle dispense, avec une pénétration d'esprit bien autre et bien plus perçante que celle de Platon, ils avaient échappé par leur profession aux stériles embarras des choses temporelles, et méprisaient, dans l'ardeur de leur application aux choses de Dieu, et les exercices autrefois chéris de la philosophie mondaine, et le doux sourire de la terre natale, les richesses et la noblesse d'une illustre parenté, et l'espoir des grandeurs. Libres par leur victoire, ils s'exerçaient, tantôt sous le joug des monastères, tantôt dans une lutte solitaire, à des travaux émules de ceux des Macchabées, et aspiraient, pour obtenir un repos et une liberté éternelles, à subir ici bas toutes sortes de misères et d'abaissemens.
Le même prince enrichit un grand nombre d'églises, et s'appliqua à régler sagement l'ordination des évêques et des abbés, surtout de ceux des villes de Lisieux, Baveux et Avranches; il créa, comme éminemment dignes, Hugues évêque de Lisieux, Eudes, son propre frère, évêque de Bayeux, et Jean évêque d'Avranches. Ce furent leurs vertus et non la grandeur de leur naissance, par laquelle il leur était allié, qui décidèrent Guillaume dans ce choix. Jean, fils du comte Raoul, et versé dans les lettres, depuis long-temps déjà qu'il était dans l'ordre laïque, s'était acquis, par sa vie religieuse, l'admiration du clergé et même des chefs du clergé; il ne desira point l'honneur du rang sacerdotal, mais les évêques souhaitèrent de le consacrer leur collègue. Les voix unanimes des gens de bien avaient rangé Eudes, dès son enfance, au nombre des bons. La renommée la plus célèbre a porté son nom jusque chez les nations lointaines; mais elle est encore au dessous de ce que méritent l'habileté et la bonté extrêmes d'un homme si généreux et si humble.
Nous ne craindrons pas de nous étendre un peu plus sur le compte de Hugues, que nous avons connu un peu plus familièrement, ne doutant pas que d'autres ne puissent tirer avantage de cette connaissance. Petit-fils de Richard Ier par son fils Guillaume, comte d'Eu, et non moins bon que généreux, jeune encore, il fut élevé par le prince à la dignité pontificale, et la maturité de son esprit surpassa bientôt la sagesse des vieillards. On ne le vit jamais fier de son antique noblesse, ni enorgueilli par son haut rang ou son âge florissant; jamais il ne se livra aux débauches de la volupté; il soutenait avec une soigneuse sollicitude le difficile emploi qui lui était confié, et dont le fardeau demandait tant de prudence. Il veillait attentivement à la direction de sa propre conduite, et s'appliquait avec un soin perpétuel à la nourriture de son troupeau, manifestant ainsi avec quelle pénétration il voyait qu'il avait reçu un saint ministère, le gouvernement de l'Eglise, et non une domination ou une dignité. Il enrichit sa sainte épouse de terres, de trésors, et la décora d'ornemens précieux. Il l'embellit d'édifices, et l'orna de telle sorte que le spectateur eût douté si on avait fait de nouvelles constructions, ou si l'on avait réparé les anciennes. Mais en sa personne il lui apporta une dot plus précieuse et plus brillante que l'or, l'ambre, les pierreries et les diamans. Cet évêque est respecté et chéri au plus haut degré par les monastères, les synodes et les curies, comme sage autant qu'éloquent, juste autant que prudent. Jamais, soit en jugeant, soit en exprimant son opinion dans les conseils, il n'accorda rien à l'argent ou à la faveur. Lorsque l'archevêque Mauger fut déposé, Hugues fut la voix sonore de la justice, et demeura constamment dans le parti de Dieu, pour lequel il condamna le fils de son oncle. Il se montrait tour à tour, par une alternative bien ménagée, affable et sévère, miséricordieux persécuteur et pieux ennemi, non des hommes mais des vices. Il pourvoyait, avec la plus grande fidélité, aux besoins de ceux qui étaient soumis à ses soins, et on pourrait avec raison le comparer aux pères attentifs, qui ne songent pas tant aux desirs qu'aux vrais intérêts de leurs jeunes enfans. Il accordait avec bienveillance sa faveur et son secours aux champions du Roi des cieux, quel que fût leur rang, honorant ce Roi lui-même par son respect et son amour pour ses guerriers. C'est ainsi qu'il vivait humain et abstinent, au point qu'il faisait sans cesse offrande de son repas à maint homme, qui souvent ne devait pas le lui rendre, et de son jeûne à Dieu. Joyeux de caractère, et prenant plaisir à la société, il croyait pouvoir, sans péché, accepter une table abondante et délicate, aimant à satisfaire le besoin de la nature, et non à banqueter. Il se repaissait surtout des délices que desirent les ames qui ont faim de l'éternité, délices sur lesquelles le céleste Paraclet répand les plus suaves douceurs, les veilles et les oraisons, la pieuse célébration des offices divins, l'étude familière de la bibliothèque sacrée, et enfin un amour infatigable de toute œuvre sainte. Hugues, le meilleur pasteur du troupeau du Seigneur, se nourrissait et se délectait donc surtout de ces choses. Exempt de toute cupidité, il faisait également louer sa constance dans l'adversité, et sa modestie dans le bonheur. Il avait en telle abomination les langues qui aiment à blesser la réputation des autres, qu'il ne voulait jamais prêter l'oreille à leur méchanceté. Il éleva sa grandeur par le pouvoir d'une admirable humilité, et avait placé sa continence sous la sûre garde de ses autres vertus et de toutes ses pieuses œuvres. Il portait sur ses habits le rational, ornement mystique et spirituel qui couvrait la poitrine d'Aaron, et qui lui rappelait continuellement la sainteté du patriarche, dont on y voyait les noms inscrits. Mais, entraîné par le plaisir de raconter une vie si vertueuse, ne prolongeons pas hors de mesure cette digression, et revenons aux actions du prince Guillaume.
Deux frères, rois d'Espagne, instruits de sa grandeur, lui demandèrent avec la plus grande instance sa fille en mariage, afin d'illustrer par cette alliance leur royaume et leur postérité. Il s'éleva à ce sujet entre eux une querelle pleine de haine, non à cause de sa naissance, mais parce que, tout-à-fait digne d'un tel père, elle était ornée de tant de vertus, et si zélée pour l'amour du Christ, que cette jeune fille vivant hors du cloître aurait pu servir d'exemple aux reines et aux nonnes. Guillaume était admiré, loué et respecté au-dessus des autres rois, par le puissant empereur des Romains, le très-glorieux Henri, fils de l'empereur Conrad, lequel avait avec lui, dans sa jeunesse, conclu amitié et alliance comme avec le souverain le plus illustre; car, encore enfant, Guillaume jouissait déjà chez les autres nations du plus fameux renom. Mais j'ai à parler de la grandeur de son âge mûr. La noble et vaste Constantinople, qui commandait à tant de rois, le desirait pour voisin et pour allié, afin de n'avoir plus à craindre, sous sa protection, la redoutable puissance de Babylone. Déjà aucun voisin n'osait plus rien contre la Normandie. Ainsi les orages de la guerre étrangère avaient cessé de gronder, comme ceux de la guerre civile. Les évêques et les comtes de la France, de la Bourgogne, et des pays encore plus éloignés, fréquentaient la cour du seigneur des Normands, les uns pour recevoir des conseils, les autres des bénéfices, la plupart pour être seulement honorés de sa faveur. C'est avec raison qu'on appelait sa bonté un port et un asile secourable pour un grand nombre de gens. Combien de fois les étrangers, à la vue de la tranquillité avec laquelle des chevaliers allaient et venaient sans armes, et de la sûreté qu'offraient tous les chemins à tout voyageur, ne desirèrent-ils pas pour leurs pays une telle félicité! C'étaient les vertus de Guillaume qui avaient procuré à son pays cette paix et cette gloire. Aussi fut-ce bien justement que son pays, incertain de l'issue d'une maladie qui l'avait attaqué, offrit au Ciel des larmes et des prières capables d'obtenir qu'un mort fût rappelé à la vie. Tous suppliaient Dieu de retarder la mort de celui dont la perte prématurée faisait craindre de nouveau les troubles dont ils avaient été tourmentés auparavant. Il n'aurait pas laissé alors de successeur en âge de gouverner. On croit, et c'est avec la plus grande raison, que le juge céleste des pieuses prières rendit la santé à son vertueux serviteur, et le fit jouir de la tranquillité la plus parfaite, en renversant tous ses ennemis, afin que, digne de parvenir au plus haut rang, il pût bientôt, tranquille sur l'état de sa principauté, s'emparer plus facilement du royaume qu'on avait usurpé sur lui.
En effet, tout à coup se répandit la nouvelle certaine que le pays d'Angleterre venait de perdre le roi Edouard, et qu'Hérald était orné de sa couronne. Ce cruel Anglais n'attendit pas que le peuple décidât sur l'élection; mais le jour même où fut enseveli cet excellent roi, quand toute la nation était dans les pleurs, ce traître s'empara du trône royal, aux applaudissemens de quelques iniques partisans. Il obtint un sacre profane de Stigand, que le juste zèle et les anathêmes du pape avaient privé du saint ministère. Le duc Guillaume, ayant tenu conseil avec les siens, résolut de venger son injure par les armes, et de ressaisir par la guerre l'héritage qu'on lui enlevait, quoique beaucoup de grands l'en dissuadassent par de spécieuses raisons, comme de chose trop difficile et bien au-dessus des forces de la Normandie. La Normandie avait alors dans ses assemblées, outre les évêques et les abbés, les hommes de l'ordre laïque les plus éminens, dont quelques-uns étaient la lumière et l'ornement le plus brillant du conseil: Robert, comte de Mortain, Robert, comte d'Eu, père de Hugues, évêque de Lisieux, dont nous avons écrit la vie; Richard, comte d'Evreux, fils de l'archevêque Robert, Roger de Beaumont, Roger de Mont-Gomeri, Guillaume fils d'Osbern, et le vicomte Hugues. De tels hommes pouvaient, par leur sagesse et leur habileté, conserver leur patrie exempte de dangers; et si la république de Rome était encore maintenant aussi puissante qu'autrefois, soutenue par eux, elle n'aurait pas à regretter deux cents sénateurs. Nous voyons néanmoins que, dans toutes les délibérations, tous cédaient toujours à la sagesse du prince, comme si l'Esprit divin lui eût indiqué ce qu'il devait faire ou éviter. Dieu donne la sagesse à ceux qui se conduisent avec piété, a dit un homme habile dans la connaissance des choses divines. Guillaume depuis son enfance agissait pieusement. Tous obéirent au duc, à moins qu'une absolue nécessité ne les en empêchât. Il serait trop long de rapporter en détail par quelles sages dispositions de sa part les vaisseaux furent construits et munis d'armes, d'hommes, de vivres et de tout ce qui est nécessaire à la guerre, et de quel zèle tous les Normands furent animés pour tous ces apprêts. Guillaume ne pourvut pas avec moins de sagesse au gouvernement et à la sûreté de la Normandie, pendant son absence. Il vint à son secours un nombre considérable de chevaliers étrangers, attirés en partie par la générosité très-connue du duc, et surtout par l'assurance qu'ils avaient de la justice de sa cause. Ayant interdit toute espèce de pillage, il nourrit à ses propres frais cinquante mille chevaliers pendant un mois, que des vents contraires les retinrent à l'embouchure de la Dive, tant fut grande sa modération et sa prudence. Il fournissait abondamment aux dépenses des chevaliers et des étrangers, mais ne permettait pas de rien enlever à qui que ce fût. Le bétail ou les troupeaux des habitans du pays paissaient dans les champs avec autant de sûreté que si c'eût été dans des lieux sacrés. Les moissons attendaient intactes la faux du laboureur, sans avoir été ni foulées par la superbe insouciance des chevaliers, ni ravagées par le fourrageur. L'homme faible ou sans armes allait à son gré, chantant sur son cheval, et il apercevait ces troupes guerrières, et n'avait point de peur.
Dans le même temps siégeait sur la chaire de saint Pierre de Rome le pape Alexandre, le plus digne d'être obéi et consulté par l'Eglise universelle; car il donnait des réponses justes et utiles. Evêque de Lucques, il n'avait desiré nullement un rang plus élevé; mais les vœux ardens d'un grand nombre de personnes, dont l'autorité était alors éminente chez les Romains, et l'assentiment d'un grand concile, l'élevèrent au rang où il devait être le chef et le maître des évêques de la terre, et qu'il méritait par sa sainteté et son érudition, qui le firent briller dans la suite de l'orient au couchant. Le soleil ne suit pas les limites de sa course d'une manière plus immuable qu'Alexandre ne dirigeait sa vie selon les droites voies de la vérité; autant qu'il le put, il châtia en ce monde l'iniquité, sans jamais céder sur rien. Le duc ayant sollicité la protection de cet apostole, et lui ayant fait part de l'expédition dont il faisait les apprêts, il reçut de sa bonté la bannière et l'approbation de saint Pierre, afin d'attaquer son ennemi avec plus de confiance et d'assurance.
Il s'était récemment uni d'amitié avec Henri, empereur des Romains, fils de l'empereur Henri, et neveu de l'empereur Conrad, et par un édit duquel l'Allemagne devait, à sa demande, marcher à son secours contre quelque ennemi que ce fût. Suénon, roi des Danois, lui promit aussi, par des députations, de lui être fidèle; mais il se montra ami et allié de ses ennemis, comme on le verra dans la suite en lisant le récit des pertes qu'éprouva ce roi.
Cependant Hérald, tout prêt à livrer combat soit sur mer soit sur terre, couvrit le rivage de lances et d'une innombrable armée, et fit cauteleusement passer des espions sur le continent. L'un d'eux ayant été pris et s'efforçant, selon l'ordre qu'il en avait reçu, de couvrir d'un prétexte le motif de sa venue, le duc manifesta par ces paroles la grandeur de son esprit: «Hérald, dit-il, n'a pas besoin de perdre son or et son argent à acheter la fidélité et l'adresse de toi et de plusieurs autres, pour que vous veniez avec fourberie nous observer: un indice plus certain qu'il ne le voudrait, et plus sur qu'il ne le pense, l'instruira de mes desseins et de mes apprêts; c'est ma présence. Rapportez-lui ce message qu'il n'éprouvera aucun dommage de notre part, et qu'il terminera tranquillement le reste de sa vie, s'il ne me voit, dans l'espace d'un an, dans le lieu où il espère trouver le plus de sûreté pour sa personne.» Les grands de la Normandie furent saisis de surprise à une promesse si hardie, et un grand nombre ne cachèrent pas leur défiance. Ils exagéraient dans des discours dictés par la timidité les forces d'Hérald; et rabaissant les leurs, ils disaient qu'il possédait en abondance des trésors qui lui servaient à gagner à son parti les ducs et de puissans rois, même une flotte nombreuse, et des hommes très-expérimentés dans l'art de la navigation, et très-fréquemment éprouvés par des dangers et des combats maritimes; enfin que son pays l'emportait de beaucoup sur le leur par le nombre des troupes aussi bien que par les richesses. Qui pourrait espérer, disaient-ils, que les vaisseaux seront terminés pour l'époque fixée, ou, s'ils le sont, que dans l'espace d'un an on trouvera assez de rameurs? Qui ne craindra que cette nouvelle expédition ne change en toute sorte de misères l'état si florissant du pays? Qui pourrait affirmer que les forces de l'empereur romain ne succomberaient pas sous de telles difficultés?
Mais le duc releva leur confiance par ces mots: «Nous connaissons, dit-il, la sagesse d'Hérald; il veut nous épouvanter, mais il accroît nos espérances. En effet, il dépensera ses biens, et dissipera son or inutilement et sans affermir son pouvoir. Il n'est pas doué d'une assez grande force d'esprit pour oser promettre la moindre des choses de ce qui m'appartient, tandis que j'ai le droit de promettre et d'accorder également et ce qui est à moi et ce qu'on dit lui appartenir. Sans aucun doute il sera vainqueur celui qui peut donner et ses propres biens et ceux que possède son ennemi. La flotte ne nous embarrassera pas, et nous aurons bientôt le plaisir de la voir en état. Qu'ils aient de l'expérience, je le veux; nous en acquerrons avec plus de bonheur. C'est le courage des guerriers plutôt que leur nombre qui détermine le sort des combats. D'ailleurs, Hérald combattra pour la défense de ce qu'il a usurpé, et nous, nous demandons ce que nous avons reçu en don, ce que nous avons acquis par nos bienfaits. Cette confiance supérieure de notre part, repoussant tous les dangers, nous procurera le plus joyeux triomphe, l'honneur le plus éclatant et la plus glorieuse renommée.»
En effet, cet homme sage et catholique était assuré que la toute-puissance de Dieu, qui ne veut rien d'injuste, ne permettrait pas la ruine de la cause légitime, surtout lorsqu'il considérait qu'il ne s'était pas tant appliqué à étendre sa puissance et sa gloire qu'à purifier la foi chrétienne en ce pays. Déjà toute la flotte soigneusement préparée avait été poussée par le souffle du vent de l'embouchure de la Dive et des ports voisins, où elle avait long-temps attendu un vent favorable pour la traversée, vers le port de Saint-Valéry. Ce prince, que ne pouvaient abattre ni le retard causé par les vents contraires, ni les terribles naufrages, ni la fuite timide d'un grand nombre d'hommes qui lui avaient promis fidélité, plein d'une louable confiance, s'abandonna à la protection céleste en lui adressant des vœux, des dons et des prières. Combattant l'adversité par la prudence, il cacha autant qu'il put la mort de ceux qui avaient péri dans les flots, en les faisant ensevelir secrètement, et soulagea l'indigence en augmentant chaque jour les vivres. C'est ainsi que, par différentes exhortations, il rappela ceux qui étaient épouvantés, et ranima les moins hardis. S'armant de saintes supplications pour obtenir que des vents contraires fissent place aux vents favorables, il fit porter hors de la basilique le corps du confesseur Valéry, très-aimé de Dieu. Tous ceux qui devaient l'accompagner assistèrent à cet acte pieux d'humilité chrétienne.
Enfin souffla le vent si long-temps attendu. Tous rendirent grâce au Ciel de la voix et des mains; et tous en tumulte s'excitant les uns les autres, on quitte la terre avec la plus grande rapidité, et on commence avec la plus vive ardeur le périlleux voyage. Il règne parmi eux un tel mouvement, que l'un appelle un homme d'armes, l'autre son compagnon, et que la plupart, ne se souvenant ni de leurs vassaux, ni de leurs compagnons, ni des choses qui leur sont nécessaires, ne pensent qu'à ne pas être laissés à terre et à se hâter de partir. L'ardent empressement du duc réprimande et presse de monter sur les vaisseaux ceux qu'il voit apporter le moindre retard. Mais de peur qu'atteignant avant le jour le rivage vers lequel ils voguent, ils ne courent le risque d'aborder à un port ennemi ou peu connu, il ordonne par la voix du héraut que lorsque tous les vaisseaux auront gagné la haute mer, ils s'arrêtent un peu dans la nuit, et jettent l'ancre non loin de lui, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une lampe au haut de son mât, et qu'aussitôt alors le son de la trompette donne le signal du départ. L'antique Grèce rapporte qu'Agamemnon, fils d'Atrée, alla avec mille vaisseaux venger l'outrage du lit fraternel; nous pouvons assurer aussi que Guillaume alla conquérir le diadême royal avec une flotte nombreuse. Elle raconte encore, parmi ses fables, que Xerxès joignit par un pont de vaisseaux les villes de Sestos et d'Abydos que séparait la mer; nous publions, et c'est avec vérité, que Guillaume réunit sous le gouvernail de son pouvoir l'étendue du territoire de la Normandie et de l'Angleterre. Nous croyons qu'on peut égaler et même préférer pour la puissance, à Xerxès qui fut vaincu, et dont la flotte fut détruite par le courage d'un petit nombre d'ennemis, Guillaume que ne vainquit jamais personne, qui orna son pays de glorieux trophées, et l'enrichit d'illustres triomphes.
Dans la nuit, après s'être reposés, les vaisseaux levèrent l'ancre. Celui qui portait le duc, voguant avec plus d'ardeur vers la victoire, eut bientôt, par son extrême agilité, laissé derrière lui les autres, obéissant par la promptitude de sa course à la volonté de son chef. Le matin un rameur, ayant reçu ordre de regarder du haut du mât s'il apercevait des navires venir à la suite, annonça qu'il ne s'offrait à sa vue rien autre chose que la mer et les cieux. Aussitôt le duc fit jeter l'ancre, et de peur que ceux qui l'accompagnaient ne se laissassent troubler par la crainte et la tristesse, plein de courage, il prit, avec une mémorable gaîté, et comme dans une salle de sa maison, un repas abondant où ne manquait point le vin parfumé, assurant qu'on verrait bientôt arriver tous les autres, conduits par la main de Dieu, sous la protection de qui il s'était mis. Le chantre de Mantoue, qui mérita le titre de prince des poètes par son éloge du Troyen Enée, le père et la gloire de l'ancienne Rome, n'aurait pas trouvé indigne de lui de rapporter l'habileté et la tranquillité qui présidèrent à ce repas. Le rameur ayant regardé une seconde fois, s'écria qu'il voyait venir quatre vaisseaux, et à la troisième fois il en parut un si grand nombre que la quantité innombrable de mâts, serrés les uns près des autres, leur donnait l'apparence d'une forêt. Nous laissons à deviner à chacun en quelle joie se changea l'espérance du duc, et combien il glorifia du fond du cœur la miséricorde divine. Poussé par un vent favorable, il entra librement avec sa flotte, et sans avoir à combattre aucun obstacle, dans le port de Pévensey. Hérald s'était retiré dans le pays d'York pour faire la guerre à son frère Tostig et à Hérald, roi de Norwège. Il ne faut pas s'étonner que son frère, animé par ses injustices, et jaloux de reconquérir ses biens envahis, eût amené contre Herald des troupes étrangères. Bien différent pour les mœurs de ce frère souillé de luxure, de cet homicide cruel, orgueilleux de ses richesses, fruits du pillage, et ennemi de la justice et du bien, comme Tostig ne l'égalait pas par les armes, il le combattait par ses vœux et ses conseils. Une femme, d'une mâle sagesse, connaissant et pratiquant tout ce qu'il y a d'honnête, voulut voir les Anglais gouvernés par Guillaume, homme prudent, juste et courageux, que le choix du roi Edouard, son mari, avait établi pour son successeur comme s'il eût été son fils.
Les Normands, ayant avec joie abordé au rivage, s'emparèrent d'abord des fortifications de Pévensey, et ensuite de celle d'Hastings, pour en faire un lieu de refuge et de défense pour leurs vaisseaux. Marius et le grand Pompée, qui tous deux se distinguèrent et méritèrent le triomphe par leur courage et leur habileté, l'un pour avoir amené à Rome Jugurtha enchaîné, et l'autre pour avoir forcé Mithridate à s'empoisonner, lorsqu'ils étaient dans un pays ennemi à la tête de toutes leurs forces, craignaient lâchement de s'exposer aux dangers en se séparant du gros de l'armée avec une seule légion. Leur coutume, et c'est celle des généraux, était d'envoyer des espions, et non d'aller eux-mêmes à la découverte, conduits en ceci par le desir de conserver leur vie plutôt que soigneux d'assurer à l'armée la continuation de leurs soins. Guillaume, accompagné seulement de vingt-cinq chevaliers, alla lui-même, plein de courage, reconnaître les lieux et les habitans, et revenant à pied, à cause de la difficulté des chemins, tout en en riant lui-même, et quoique le lecteur en puisse rire aussi, il mérita de sérieuses louanges, en portant sur son épaule, attachée avec la sienne, la cuirasse d'un de ceux qui l'accompagnaient, Guillaume, fils d'Osbern, renommé cependant pour sa force et son courage; le duc le soulagea du poids de ce fer.
Un riche habitant de ce pays, Normand de nation, Robert, fils de la noble dame Guimare, envoya à Hastings, au duc, son seigneur et son parent, un message conçu en ces termes: «Le roi Hérald ayant livré bataille à son propre frère et au roi de Norwège, qui passait pour le plus fort guerrier qu'il y eût sous le ciel, les a tués tous deux dans un combat, et a détruit leurs nombreuses armées. Animé par ce succès, il revient promptement vers toi, à la tête d'une armée innombrable et pleine de force, contre laquelle les tiens ne vaudront pas plus qu'autant de vils chiens. Tu passes pour un homme sage, et jusqu'ici tu as tout fait avec prudence, soit pendant la paix, soit pendant la guerre. Maintenant travaille à aviser et pourvoir à ta sûreté; prends garde que ta témérité ne te précipite dans un danger d'où tu ne puisses sortir. Je te le conseille, reste dans tes retranchemens, et abstiens-toi d'en venir aux mains à présent.»
Le duc répondit à l'envoyé: «Rapporte à ton maître, pour le message par lequel il veut que je sois sur mes gardes, ces paroles et ma reconnaissance, quoiqu'il eût été convenable de m'en avertir sans injure. Je ne voudrais point me mettre à l'abri dans une retraite fortifiée, je combattrai Hérald le plus promptement possible; et je n'hésiterai point, si la volonté divine ne s'y oppose pas, n'eussé-je avec moi que dix mille hommes tels que les soixante mille que j'ai amenés, à aller l'écraser, lui et les siens, avec la force des miens.»
Un certain jour, comme le duc visitait les postes de garde de la flotte, et se promenait près des navires, on lui annonça la présence d'un moine envoyé par Hérald. Aussitôt il se rendit auprès de lui, et lui tint ingénieusement ce discours. «Je tiens de très-près à Guillaume, comte de Normandie, et c'est moi qui lui sers ses repas. Ce n'est que par moi que tu pourras avoir la faculté de lui parler. Raconte-moi le message que tu apportes; je le lui ferai facilement connaître, car personne ne lui est plus cher que moi. Ensuite, par mes soins, tu iras aisément l'entretenir à ta volonté.» Le moine lui ayant révélé le message, le duc le fit aussitôt recevoir dans une maison, et traiter avec une soigneuse humanité. Pendant ce temps, il délibéra en lui-même et avec les siens sur la réponse qu'il devait faire au message.
Le lendemain, assis au milieu de ses grands, il fit appeler le moine, et lui dit: «C'est moi qui suis Guillaume, prince des Normands, par la grâce de Dieu. Répète maintenant en présence de ceux-ci ce que tu m'as rapporté hier.» Le messager parla ainsi: «Voici ce que le roi Hérald vous fait savoir. Vous êtes entré sur son territoire; il ne sait dans quelle confiance et par quelle témérité. Il se souvient bien que le roi Edouard vous établit d'abord héritier du royaume d'Angleterre, et que lui-même en Normandie vous a porté l'assurance de cette succession. Mais il sait aussi que, selon le droit qu'il eu avait, le même roi, son seigneur, lui fit, à ses derniers instans, le don du royaume; et depuis le temps où le bienheureux Augustin vint dans ce pays, ce fut une coutume générale de cette nation de regarder comme valables les donations faites aux derniers momens. C'est pourquoi il vous demande à juste titre que vous vous en retourniez de ce pays avec les vôtres. Autrement il rompra l'amitié et tous les traités qu'il a lui-même conclus avec vous en Normandie, et il vous laisse entièrement le choix.»
Après avoir entendu le message d'Hérald, le duc demanda au moine s'il voulait conduire en sûreté son envoyé auprès de ce prince. Le moine lui promit qu'il prendrait autant de soin de la sûreté de son député que de la sienne propre. Aussitôt le duc chargea un moine de Fécamp de rapporter promptement ces paroles à Hérald. «Ce n'est point avec témérité et injustice, mais délibérément et conduit par la justice, que je suis passé dans ce pays, dont mon seigneur et mon parent, le roi Edouard, à cause des honneurs éclatans et des nombreux bienfaits dont moi et mes grands nous l'avons comblé, ainsi que son frère et ses gens, m'a constitué héritier, comme l'avoue Hérald lui-même. Il me croyait aussi, de tous ceux qui lui étaient alliés par la naissance, le meilleur et le plus capable, ou de le secourir tant qu'il vivrait, ou de gouverner son royaume après sa mort; et ce choix ne fut point fait sans le consentement de ses grands, mais par le conseil de l'archevêque Stigand, du comte Godwin, du comte Lefrie, et du comte Sigard, qui prêtèrent serment de la main de me recevoir pour seigneur après la mort d'Edouard, jurant qu'ils ne chercheraient nullement pendant sa vie à s'emparer de ce pays pour m'en ôter la possession. Il me donna pour otages le fils et le neveu de Godwin. Enfin il envoya vers Hérald lui-même en Normandie, afin que, présent, il fît devant moi le serment qu'en mon absence avaient fait en ma faveur son père et les autres hommes ci-dessus nommés. Comme Hérald se rendait vers moi, il encourut les périls de la captivité, à laquelle l'arrachèrent ma sagesse et ma puissance. Il me fit hommage pour son propre compte, et ses mains dans les miennes m'assurèrent aussi le royaume d'Angleterre. Je suis prêt à plaider ma cause en jugement contre lui, selon les lois de Normandie, ou plutôt celles d'Angleterre, comme il lui plaira, Si les Normands ou les Anglais prononcent, selon l'équité et la vérité, que la possession de ce royaume lui appartient légitimement, qu'il le possède en paix; mais s'ils conviennent que, par le devoir de justice, il doit m'être rendu, qu'il me le laisse. S'il refuse cette proposition, je ne crois pas juste que mes hommes et les siens périssent dans un combat, eux qui ne sont aucunement coupables de notre querelle. Voici donc que je suis prêt à soutenir, au risque de ma tête contre la sienne, que le royaume d'Angleterre m'appartient de droit plutôt qu'à lui.»
Nous avons voulu bien faire connaître à tous ce discours, qui contient les propres paroles du duc et non notre ouvrage, car nous voulons que l'estime publique lui assure une éternelle louange. On en pourra aisément conclure qu'il se montra véritablement sage, juste, pieux et courageux. Le pouvoir de ses raisonnemens, qui, comme on le voit clairement en y réfléchissant, n'auraient pu être affaiblis par Tullius, le plus illustre auteur de l'éloquence romaine, anéantit les argumens d'Hérald. Enfin le duc était prêt à se conformer au jugement que prescrirait le droit des nations. Il ne voulait point que les Anglais ses ennemis périssent à cause de sa querelle, et offrait de la terminer au péril de sa propre tête dans un combat singulier. Dès que le moine eut rapporté ce message à Hérald, qui s'avançait, il pâlit de stupeur, et comme muet, garda long-temps le silence. L'envoyé lui ayant plusieurs fois demandé une réponse, il lui dit la première fois: «Nous marchons sur-le-champ;» et la seconde fois: «Nous marchons au combat.» L'envoyé le pressait de lui donner une autre réponse, lui répétant que le duc de Normandie voulait un combat singulier, et non la destruction des deux armées; car cet homme courageux et bon aimait mieux renoncer à une chose juste et agréable, pour empêcher la ruine d'un grand nombre d'hommes, et espérait abattre la tête d'Hérald, soutenu par une moins grande vigueur, et qui n'avait point l'appui de la justice. Alors Hérald, levant son visage vers le ciel, dit: «Que le Seigneur prononce aujourd'hui, entre Guillaume et moi, à qui appartient le droit.» Aveuglé par le desir de régner, et la frayeur lui faisant oublier l'injustice qu'il avait commise, il court à sa ruine, au jugement de sa propre conscience.
Cependant des chevaliers très-éprouvés, envoyés à la découverte par le duc, revinrent promptement annoncer l'arrivée de l'ennemi. Le roi furieux se hâtait d'autant plus qu'il avait appris que les Normands avaient dévasté les environs de leur camp. Il voulait tâcher de les surprendre au dépourvu, en fondant sur eux pendant la nuit ou à l'improviste. Pour qu'ils ne pussent fuir dans aucune retraite, il avait envoyé une flotte armée sur mer, pour dresser des embûches aux soixante vaisseaux. Le duc aussitôt ordonna à tous ceux qui se trouvaient dans le camp de prendre les armes (car ce jour-là la plus grande partie de ses compagnons étaient allés fourrager); lui-même, assistant avec la plus grande dévotion au mystère de la -messe, fortifia son corps et son ame de la communion du corps et du sang du Seigneur. Il suspendit humblement à son cou des reliques, de la protection desquelles Hérald s'était privé en violant la foi qu'il avait jurée sur elles. Le duc avait avec lui deux évêques, qui l'avaient accompagné de Normandie, Eudes, évêque de Bayeux, et Geoffroi Constantin, un nombreux clergé, et plusieurs moines. Cette assemblée se disposa à combattre par ses prières. Tout autre que le duc eût été épouvanté en voyant sa cuirasse se retourner à gauche pendant qu'il la mettait; mais il en rit comme d'un hasard, et ne s'en effraya pas comme d'un funeste pronostic.
Nous ne doutons pas de la beauté de la courte exhortation par laquelle il augmenta le courage et l'intrépidité de ses guerriers, quoiqu'on ne nous l'ait pas rapportée dans toute sa majesté. Il rappela aux Normands que, sous sa conduite, ils étaient toujours sortis vainqueurs de périls grands et nombreux. Il leur rappela à tous leur patrie, leurs nobles exploits et leur illustre renom. «C'est maintenant, leur dit-il, que vos bras doivent prouver de quelle force vous êtes doués, quel courage vous anime. Il ne s'agit plus seulement de vivre en maîtres, mais d'échapper vivans d'un péril imminent. Si vous combattez comme des hommes, vous obtiendrez la victoire, de l'honneur et des richesses. Autrement vous serez égorgés promptement, ou captifs vous servirez de jouet aux plus cruels ennemis. De plus, vous serez couverts d'une ignominie éternelle. Aucun chemin ne s'ouvre à la retraite; d'un côté, des armes et un pays ennemi et inconnu ferment le passage; de l'autre, la mer et des armes encore s'opposent à la fuite. Il ne convient pas à des hommes de se laisser effrayer par le grand nombre. Les Anglais ont souvent succombé sous le fer ennemi; souvent vaincus, ils sont tombés sous le joug étranger, et jamais ils ne se sont illustrés par de glorieux faits d'armes. Le courage d'un petit nombre de guerriers peut facilement abattre un grand nombre d'hommes inhabiles dans les combats, surtout lorsque la cause de la justice est protégée par le secours du Ciel. Osez seulement, que rien ne puisse vous faire reculer, et bientôt le triomphe réjouira vos cœurs.»
Il s'avança dans un ordre avantageux, faisant porter en avant la bannière que lui avait envoyée l'apostole; il plaça en tête des gens de pied armés de flèches et d'arbalètes, et au second rang d'autres gens de pied, dont il était plus sûr, et qui portaient des cuirasses: le dernier rang fut composé des bataillons de chevaliers, au milieu desquels il se plaça avec son inébranlable force, pour donner de là ses ordres de tous côtés, de la voix et du geste. Si quelque ancien eût décrit l'armée d'Hérald, il aurait dit qu'à son passage les fleuves se desséchaient, les forêts se réduisaient en plaines. En effet, de tous les pays des troupes innombrables s'étaient jointes aux Anglais. Une partie étaient animés par leur attachement pour Hérald, et tous par leur amour pour la patrie, qu'ils voulaient, quoique injustement, défendre contre des étrangers. Le pays des Danois, qui leur était allié, leur avait envoyé de nombreux secours. Cependant, n'osant combattre Guillaume sur un terrain égal, ils se postèrent sur un lieu plus élevé, sur une montagne voisine de la forêt par laquelle ils étaient venus. Alors les chevaux ne pouvant plus servir à rien, tous les gens de pied se tinrent fortement serrés. Le duc et les siens, nullement effrayés par la difficulté du lieu, montèrent peu à peu la colline escarpée. Le terrible son des clairons fit entendre le signal du combat, et de toutes parts l'ardente audace des Normands entama la bataille. Ainsi, dans la discussion d'un procès où il s'agit d'un vol, celui qui poursuit le crime parle le premier. Les gens de pied des Normands, s'approchant donc, provoquèrent les Anglais, et leur envoyèrent des traits et avec eux les blessures et la mort. Ceux-ci leur résistent vaillamment, chacun selon son pouvoir. Ils leur lancent des épieus et des traits de diverses sortes, des haches terribles et des pierres appliquées à des morceaux de bois. Vous auriez cru voir aussitôt les nôtres écrasés, comme sous un poids mortel. Les chevaliers viennent après, et de derniers qu'ils étaient passent au premier rang. Honteux de combattre de loin, le courage de ces guerriers les anime à se servir de l'épée. Les cris perçans que poussent les Normands et les barbares est étouffé par le bruit des armes et les gémissemens des mourans. On combat ainsi des deux côtés pendant quelque temps avec la plus grande force; mais les Anglais sont favorisés par l'avantage d'un lieu élevé, qu'ils occupent serrés, sans être obligés de se débander pour y arriver, par leur grand nombre et la masse inébranlable qu'ils présentent, et de plus par leurs armes, qui trouvaient facilement chemin à travers les boucliers et les autres armes défensives. Ils soutiennent donc et repoussent avec la plus grande vigueur ceux qui osent les attaquer l'épée à la main. Ils blessent aussi ceux qui leur lancent des traits de loin. Voilà qu'effrayés par cette férocité, les gens de pied et les chevaliers bretons tournent le dos, ainsi que tous les auxiliaires qui étaient à l'aile gauche; presque toute l'armée du duc recule: ceci soit dit sans offenser les Normands, la nation la plus invincible. L'armée de l'empereur romain, où combattaient les soldats des rois habitués à vaincre sur terre et sur mer, a fui plus d'une fois, à la nouvelle vraie ou fausse du trépas de son chef. Les Normands crurent que leur duc et seigneur avait succombé. Ils ne se retirèrent donc point par une fuite honteuse, mais tristes, car leur chef était pour eux un grand appui.
Le prince, voyant qu'une grande partie de l'armée ennemie s'était jetée à la poursuite des siens en déroute, se précipita au-devant des fuyards, et les arrêta en les frappant ou les menaçant de sa lance. La tête nue et ayant ôté son casque, il leur cria: «Voyez-moi tous. Je vis et je vaincrai, Dieu aidant. Quelle démence vous pousse à la fuite? Quel chemin s'ouvrira à votre retraite? Vous vous laissez repousser et tuer par ceux que vous pouvez égorger comme des troupeaux. Vous abandonnez la victoire et une gloire éternelle, pour courir à votre perte, et à une perpétuelle infamie. Si vous fuyez, aucun de vous n'échappera à la mort.» Ces paroles ranimèrent leur courage. Il s'avança lui-même à leur tête, frappant de sa foudroyante épée, et délit la nation ennemie, qui méritait la mort par sa rébellion contre lui, son roi. Les Normands, enflammés d'ardeur, enveloppèrent plusieurs mille hommes qui les avaient poursuivis, et les taillèrent en pièces en un moment, en sorte que pas un n'échappa. Vivement encouragés par ce succès, ils attaquèrent la masse de l'armée, qui, pour avoir éprouvé une grande perte, n'en paraissait pas diminuée. Les Anglais combattaient avec courage et de toutes leurs forces, tâchant surtout de ne point ouvrir de passage à ceux qui voulaient fondre sur eux pour les entamer. L'énorme épaisseur de leurs rangs empêchait presque les morts de tomber: cependant le fer des plus intrépides guerriers s'ouvrit bientôt un chemin dans différens endroits. Ils furent suivis des Manceaux, des Français, des Bretons, des Aquitains, et des Normands, qui l'emportaient par leur courage.
Un Normand, jeune guerrier, Robert, fils de Roger de Beaumont, neveu et héritier, par sa sœur Adeline, de Hugues comte de Meulan, se trouvant ce jour-là, pour la première fois, à une bataille, fit des exploits dignes d'être éternisés par la louange. A la tête d'une légion qu'il commandait à l'aile droite, il fondit sur les ennemis avec une impétueuse audace et les renversa. Il n'est pas en notre pouvoir, et l'objet que nous nous sommes proposé ne nous permet pas de raconter, comme elles le méritent, les actions de courage de chacun en particulier. Celui qui excellerait par sa facilité à décrire, et qui aurait été témoin de ce combat par ses propres yeux, trouverait beaucoup de difficulté à entrer dans tous les détails. Nous nous hâtons d'arriver au moment où terminant l'éloge du comte Guillaume, nous raconterons la gloire du roi Guillaume.
Les Normands et les auxiliaires, réfléchissant qu'ils ne pourraient vaincre, sans essuyer de très-grandes pertes, une armée peu étendue et qui résistait en masse, tournèrent le dos, feignant adroitement de fuir. Ils se rappelaient comment, peu auparavant, leur fuite avait été l'occasion de leur victoire. Les barbares, avec l'espoir du succès, éprouvèrent une vive joie: s'excitant à l'envi, ils poussent des cris d'allégresse, accablent les nôtres d'injures, et les menacent de fondre tout aussitôt sur eux. Quelques mille d'entre eux osèrent, comme auparavant, courir, comme s'ils eussent volé, à la poursuite de ceux qu'ils croyaient en fuite. Tout à coup les Normands, tournant leurs, chevaux, les cernèrent et les enveloppèrent de toutes parts, et les taillèrent en pièces sans en épargner aucun. S'étant deux fois servis de cette ruse avec le même succès, ils attaquèrent le reste avec une plus grande impétuosité. Cette armée était encore effrayante et très-difficile à envelopper. Il s'engage un combat d'un nouveau genre; l'un des partis attaque par des courses et divers mouvemens, l'autre comme fixé sur la terre ne fait que supporter les coups. Les Anglais faiblissent, et comme avouant leur crime par leur défaite, en subissent le châtiment. Les Normands lancent des traits, frappent et percent. Le mouvement des morts qui tombent paraît plus vif que celui des vivans. Ceux qui sont blessés légèrement ne peuvent s'échapper à cause du grand nombre de leurs compagnons, et meurent étouffés dans la foule. Ainsi concourut la fortune au triomphe de Guillaume!
A ce combat se trouvèrent Eustache, comte de Boulogne; Guillaume, fils de Richard, comte d'Evreux; Geoffroi, fils de Rotrou, comte de Mortain; Guillaume, fils d'Osbern; Aimeri, gouverneur de Thouars; Gautier Giffard, Hugues de Montfort, Raoul de Toëni, Hugues de Grandménil, Guillaume de Warenne, et un grand nombre d'autres guerriers, les plus fameux par leur courage à la guerre, et dont les noms devraient être rangés dans les annales de l'histoire parmi ceux des plus valeureux. Guillaume, leur chef, les surpassait tellement en force comme en sagesse, qu'on pourrait, a juste titre, le préférer ou le comparer aux anciens généraux de la Grèce et de Rome, tant vantés dans les livres. Il conduisit supérieurement cette bataille, arrêtant les siens dans leur fuite, ranimant leur vaillance, et partageant leurs dangers; il les appela pour qu'ils le suivissent, plus souvent qu'il ne leur ordonna d'aller en avant; d'où l'on doit comprendre clairement que sa valeur les devançait toujours dans la route en même temps qu'elle leur donnait le courage. A la vue seule de cet admirable et terrible chevalier, une grande partie des ennemis perdirent le cœur sans avoir reçu de blessures. Trois chevaux tombèrent percés sous lui, trois fois il sauta hardiment à terre, et ne laissa pas long-temps sans vengeance la mort de son coursier. C'est alors qu'on put voir son agilité et sa force de corps et d'ame. Son glaive rapide traverse avec fureur les écus, les casques et les cuirasses; il frappe plusieurs guerriers de son bouclier. Ses chevaliers, le voyant ainsi combattre à pied, sont saisis d'admiration, et la plupart, accablés de blessures, reprennent courage. Quelques-uns, perdant leurs forces avec leur sang, appuyés sur leur bouclier, combattent encore vaillamment; et plusieurs ne pouvant faire davantage, animent de la voix et du geste leurs compagnons à suivre hardiment le duc, et à ne pas laisser échapper la victoire d'entre leurs mains. Guillaume en secourut et sauva lui-même un grand nombre.
Guillaume n'aurait pas craint de se battre en combat singulier avec Herald, que les poètes comparent à Hector ou à Turnus, pas plus qu'Achille ne craignit de se battre avec Hector, ou Enée avec Turnus. Tydée eut recours à un rocher contre cinquante hommes qui lui dressaient des embûches; Guillaume, son égal, et non d'une race inférieure, seul en affronta mille. Les auteurs de la Thébaïde ou de l'Enéide, qui selon les règles de la poésie exagèrent encore dans leurs livres les grandes actions qu'ils chantent, feraient sur les exploits de cet homme un plus digne ouvrage, dans lequel les éloges seraient véridiques et justement grands. Certes, si leurs vers répondaient à la dignité du sujet, dans la beauté de leur style, ils l'élèveraient au rang des dieux. Mais notre modeste prose, dont le but est d'exposer humblement aux yeux des rois sa piété pour le culte du vrai Dieu, qui seul est Dieu depuis l'éternité jusqu'à la fin des siècles et au delà, doit terminer le vrai et court récit de ce combat, dans lequel le duc vainquit avec autant de force que de justice.
Le jour étant déjà sur son déclin, les Anglais virent bien qu'ils ne pouvaient tenir plus long-temps contre les Normands. Ils savaient qu'ils avaient perdu un grand nombre de leurs troupes, que le roi, deux de ses frères, et plusieurs grands du royaume avaient péri, que tous ceux qui restaient étaient presque épuisés, et qu'ils n'avaient aucun secours à attendre. Ils virent les Normands, dont le nombre n'était pas fort diminué, les presser avec plus de violence qu'au commencement, comme s'ils eussent pris en combattant de nouvelles forces. Effrayés aussi par l'implacable valeur du duc qui n'épargnait rien de ce qui lui résistait, et de ce courage qui ne savait se reposer qu'après la victoire, ils s'enfuirent le plus vite qu'ils purent, les uns à cheval, quelques-uns à pied, une partie par les chemins, presque tous par des lieux impraticables; quelques-uns, baignés dans leur sang, essayèrent en vain de se relever, d'autres se relevèrent, mais furent incapables de fuir. Le desir ardent de se sauver donna à quelques-uns la force d'y parvenir. Un grand nombre expirèrent dans le fond des forêts, et ceux qui les poursuivaient en trouvèrent plusieurs étendus sur les chemins. Les Normands, quoique sans aucune connaissance du pays, les poursuivaient avec ardeur, et, frappant les rebelles dans le dos, mettaient la dernière main à cette heureuse victoire. Plusieurs d'entre eux, renversés à terre, reçurent la mort sous les pieds des chevaux.
Cependant le courage revint aux fuyards, qui avaient trouvé pour renouveler le combat le lieu le plus favorable: c'était une vallée escarpée et remplie de fossés. Cette nation, qui descendait des antiques Saxons, les hommes les plus féroces, fut toujours naturellement disposée aux combats; et ils n'avaient pu reculer que sous le poids d'une très-grande valeur. Ils avaient récemment vaincu avec une grande facilité le roi de Norwège, soutenu par une vaillante et nombreuse armée.
Le duc, qui conduisait les étendards vainqueurs, voyant ces cohortes rassemblées en un moment, ne se détourna pas de son chemin, et tint ferme, quoiqu'il s'imaginât que c'était un nouveau secours qui arrivait à ses ennemis; et plus terrible armé seulement d'un débris de sa lance que ceux qui dardent de longs javelots, il rappela d'une voix mâle le comte Eustache, qui prenait la fuite avec cinquante chevaliers, et voulait donner le signal de la retraite. Celui-ci revenant se pencha familièrement à l'oreille du duc, et le pressa de s'en retourner, lui prédisant une mort prochaine s'il allait plus loin. Pendant qu'il lui parlait, Eustache fut frappé entre les épaules d'un coup dont la violence fut aussitôt prouvée par le sang qui lui sortit du nez et de la bouche, et il s'échappa à demi-mort avec l'aide de ses compagnons. Le duc, au dessus de toute crainte et de toute lâcheté, attaqua et renversa ses ennemis. Dans ce combat périrent quelques-uns des plus nobles Normands à qui la difficulté du lieu ne permit pas de déployer toute leur valeur. La victoire ainsi remportée, le duc retourna vers le champ de bataille, où témoin du carnage il ne put le voir sans pitié, quoique les victimes fussent des impies, et qu'il soit beau, glorieux et avantageux de tuer un tyran. La terre était couverte au loin de la fleur de la noblesse et de la jeunesse anglaise souillée de sang. Les deux frères du roi furent trouvés auprès de lui. Lui-même, dépouillé de toute marque d'honneur, fut reconnu, non à sa figure mais à quelques signes, et porté dans le camp du duc, qui confia sa sépulture à Guillaume surnommé Mallet, et non à sa mère, qui offrait pour le corps de son cher fils un égal poids d'or. Le duc savait, en effet, qu'il ne convenait pas de recevoir de l'or par un tel commerce. Il jugea indigne d'être enseveli selon le vœu de sa mère celui dont l'excessive cupidité était cause qu'une quantité innombrable de gens gisaient sans sépulture. On dit par raillerie qu'il fallait enterrer Herald en un lieu où il pût garder la mer et le rivage dont en sa fureur il avait voulu fermer l'accès.
Quant à nous, Hérald, nous ne t'insultons pas, mais avec le pieux vainqueur qui pleura ta ruine, nous avons pitié de toi, et nous pleurons sur ton sort. Un juste succès t'a abattu; tu as été, comme tu le méritais, étendu dans ton sang; tu as pour tombeau le rivage, et tu seras en abomination aux générations futures et des Anglais et des Normands. Ainsi ont coutume de crouler ceux qui croient à un souverain pouvoir, à un souverain bonheur dans le monde. Pour être souverainement heureux ils s'emparent de la puissance, et s'efforcent de retenir par la guerre ce qu'ils ont usurpé. Tu t'es souillé du sang de ton frère, dans la crainte que sa grandeur ne diminuât ta puissance. Ensuite tu t'es précipité en furieux vers une autre guerre fatale à ta patrie, que tu sacrifiais à la conservation de la dignité royale. Tu as donc été entraîné dans la ruine par toi-même préparée. Voilà, tu ne brilles plus de la couronne que tu avais traîtreusement usurpée; tu ne sièges plus sur le trône où tu étais monté avec orgueil. La fin que tu as subie montre s'il est vrai que tu fus élevé au trône par Edouard dans les derniers momens de sa vie. Une comète, la terreur des rois, brillant après le commencement de ta grandeur, fut le présage de ta perte.
Mais laissons ces funestes présages, et parlons du bonheur que prédit la même étoile. Agamemnon, roi des Grecs, aidé du secours d'un grand nombre de chefs et de rois, parvint avec peine, par la ruse, à détruire, la dixième année du siége, la seule ville de Priam. Les poètes cependant attestent les talens et la bravoure de ses guerriers. De même Rome, arrivée à sa plus haute puissance et voulant commander au monde entier, mit plusieurs années à subjuguer des villes. Le duc Guillaume, avec les troupes de la Normandie et sans de nombreux secours étrangers, soumit en un seul jour, de la troisième heure au soir, toutes les villes de l'Angleterre. Si elles avaient été défendues par les remparts de Troie, le bras et l'habileté d'un tel homme les eussent bientôt renversées. Le vainqueur eût pu sur-le-champ marcher vers le trône royal, se poser la couronne sur la tête, accorder comme butin à ses chevaliers les richesses du pays, égorger les puissans, ou les envoyer en exil. Il aima mieux agir avec modération, et commander avec clémence; car tout jeune encore il s'était accoutumé à donner à ses triomphes l'ornement de la modération.
Il eût été juste que les loups et les vautours dévorassent les chairs de ces Anglais, qui, par une telle injustice, s'étaient précipités dans la mort, et que les champs demeurassent ensevelis sous leurs os sans sépulture; mais un tel supplice lui parut trop cruel. Il accorda à ceux qui voulaient les relever pour les enterrer la liberté de le faire. Ayant, fait ensevelir les siens, et ayant laissé une garde à Hastings avec un brave commandant, il s'approcha de Romney, et punit à son gré la perte de ses gens qui, égarés de ce côté, avaient été attaqués et défaits par ce peuple féroce avec beaucoup de dommages de part et d'autre.
De là il marcha vers Douvres, où il avait appris qu'une innombrable quantité de peuple s'était réunie. Ce lieu paraissait inexpugnable; mais les Anglais, frappés de terreur à son approche, n'eurent plus de confiance ni dans les fortifications de l'art ou de la nature, ni dans le nombre de leurs troupes. Ce château est situé sur un rocher voisin de la mer, et qui, naturellement escarpé de toutes parts et taillé à pic encore par les travaux des hommes, s'élève comme un mur perpendiculaire à la hauteur d'une portée de flèche. Ce côté est baigné par les flots de la mer. Comme les habitans se préparaient à se rendre humblement, des hommes d'armes de notre armée, poussés par le desir du butin, mirent le feu au château. La flamme volant avec la légèreté qui lui est propre, eut bientôt envahi presque tout. Le duc ne voulut point voir souffrir de dommages à ceux qui avaient commencé à traiter avec lui pour se rendre; il donna une somme pour faire rétablir les édifices, et dédommagea des autres pertes. Il eût ordonné de punir sévèrement les auteurs de cet incendie, si la bassesse de leur condition et leur grand nombre ne les eussent dérobés à ses yeux. Le château lui ayant été remis, il y fit ajouter pendant huit jours les fortifications qui manquaient. L'usage de l'eau et des viandes fraîches donnèrent aux chevaliers une dysenterie dont plusieurs moururent, et dont beaucoup furent extrêmement affaiblis et coururent grand risque de perdre la vie; mais ces malheurs n'abattirent pas le courage du duc. Il laissa aussi dans ce château une garnison, avec ceux qui étaient malades de la dysenterie, et marcha pour dompter les ennemis qu'il avait vaincus. Les habitans de Cantorbéry vinrent d'eux-mêmes au devant de lui non loin de Douvres, lui jurèrent fidélité, et lui donnèrent des otages. La puissante métropole trembla de frayeur, et de peur que sa résistance ne fût suivie d'une ruine entière, elle se hâta de se soumettre pour obtenir sa conservation. Le jour suivant, étant arrivé à la Tour rompue, le duc y campa, et dans ce lieu une très-grave indisposition de son corps frappa d'une égale maladie l'ame de ses compagnons. Occupé du bien public, et dans la crainte que l'armée ne manquât des choses nécessaires, il ne voulut point s'arrêter à se soigner, quoique le retour de cet excellent duc à la santé fût l'avantage comme le très-grand desir de tous.
Cependant Stigand, archevêque de Cantorbéry, qui, élevé par ses richesses et sa dignité, avait aussi par ses conseils beaucoup de puissance auprès des Anglais, uni aux fils d'Algard et d'autres grands, menacait de livrer bataille à Guillaume. Ils avaient établi roi Edgar Adelin, jeune enfant, de la noble race du roi Edouard, car leur principal desir était de n'avoir point pour souverain un étranger. Mais celui qui devait être leur maître, s'approchant hardiment, s'arrêta non loin de Londres, dans un endroit où il apprit qu'ils s'assemblaient le plus souvent. Cette ville est arrosée par le fleuve de la Tamise, qui en forme un port de mer, où arrivent les richesses des pays étrangers. Ses seuls citoyens suffisent pour fournir une nombreuse et fameuse milice. En ce moment des troupes d'hommes de guerre arrivaient en foule, et, quoique d'une très-grande étendue, à peine les pouvait-elle contenir. Cinq cents chevaliers normands envoyés en avant forcèrent courageusement à tourner le dos et à se réfugier dans les murs des troupes qui avaient fait une sortie contre eux. Ce nombreux carnage fut suivi d'un incendie: car ils brûlèrent tous les édifices qu'ils trouvèrent en deçà du fleuve, afin de frapper à la fois d'une double calamité l'orgueilleuse férocité de leurs ennemis. Le duc s'étant ensuite avancé sans opposition, et ayant passé la Tamise, à un gué et sur un pont en même temps, arriva à Wallingford.
Le pontife métropolitain, Stigand, s'étant rendu vers lui, se remit entre ses mains, lui jura fidélité, et déposa Adelin, qu'il avait élu sans réflexion. Ayant poursuivi sa route, aussitôt que le duc fut en vue de Londres, les grands de la ville allèrent au devant de lui, se remirent en son pouvoir, eux et toute la ville, comme l'avaient fait auparavant les habitans de Cantorbéry, et lui amenèrent des otages en aussi grand nombre et de telle qualité qu'il voulut. Ensuite les évêques et les autres grands le prièrent d'accepter la couronne, disant qu'ils étaient habitués à obéir à un roi, et qu'ils voulaient avoir un roi pour maître. Le duc consultant ceux des Normands de sa suite dont il avait éprouvé la sagesse aussi bien que la fidélité, leur découvrit les principales raisons qui le dissuadaient de céder aux prières des Anglais. Les affaires étaient encore dans le trouble, quelques gens se soulevaient, et il desirait la tranquillité du royaume plutôt que la couronne. D'ailleurs si Dieu lui accordait cet honneur, il voulait que sa femme fût couronnée avec lui; et enfin il ne faut jamais se trop hâter lorsqu'on veut arriver jusqu'au faîte. Il n'était certainement pas dominé du desir de régner; il connaissait la sainteté des engagemens du mariage, et les chérissait saintement. Ses familiers lui conseillèrent au contraire d'accepter la couronne, sachant que c'était le vœu unanime de toute l'armée, quoique cependant ils trouvassent ses raisons très-louables, et reconnussent qu'elles découlaient d'une profonde sagesse.
A ce conseil était présent Aimeri d'Aquitaine, seigneur de Thouars, aussi fameux par son éloquence que par sa bravoure. Admirant et célébrant par ses louanges la modestie du duc, qui consultait les chevaliers pour savoir s'ils voulaient que leur seigneur devînt roi: «Jamais, dit-il, ou du moins rarement, des chevaliers n'ont été appelés à pareille discussion. Il ne faut pas différer par la longueur de notre délibération ce dont nous desirons le plus prompt accomplissement.» Les hommes les plus sages et les meilleurs n'auraient point ainsi souhaité de voir le duc élevé à cette monarchie s'ils n'eussent connu sa très-grande aptitude à la gouverner, quoique cependant ils voulussent aussi par sa puissance augmenter leurs biens et leurs dignités. Le duc, après de nouvelles réflexions à ce sujet, céda à tant de vœux, à tant de conseils, dans l'espérance surtout que, dès qu'il aurait commencé à régner, les rebelles oseraient moins contre lui, ou seraient plus facilement domptés. Il envoya donc à Londres des gens pour construire une forteresse dans la ville, et faire la plupart des préparatifs qui convenaient à la magnificence royale, voulant pendant ce temps demeurer dans les environs. Il fut si loin de trouver aucun ennemi qu'il eût pu, s'il l'eût voulu, se livrer en sûreté à la chasse à l'oiseau.
Le jour fixé pour le couronnement, l'archevêque d'York, homme zélé pour la justice, d'un esprit mûri par l'âge, sage, bon, éloquent, adressa aux Anglais un discours convenable, dans lequel il leur demanda s'ils consentaient à ce que Guillaume fût couronné leur seigneur. Tous, sans la moindre hésitation, et comme si par miracle ils se fussent trouvé tous une même pensée et une même voix, ils l'assurèrent de leur joyeux consentement. Les Normands n'eurent pas de peine à s'accorder au desir des Anglais; l'évêque de Coutances leur avait parlé, et avait pris leur avis. Cependant ceux qui avaient été postés en armes et à cheval autour des monastères pour porter du secours en cas de besoin, ignorant que le tumulte provenait des acclamations de consentement, l'attribuèrent à une cause funeste, et mirent imprudemment le feu à la cité. Guillaume ainsi élu, fut consacré par ledit archevêque d'York, également chéri pour sa sainte vie et son inviolable réputation, qui lui mit sur la tête la couronne royale, et le plaça sur le trône, du consentement et en présence d'un grand nombre d'évêques et d'abbés, dans la basilique de Saint-Pierre l'Apôtre, joyeuse de posséder le tombeau du roi Edouard, le jour de la sainte solennité de la Nativité du Seigneur, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1066. Guillaume refusa d'être couronné par Stigand, archevêque de Cantorbéry, parce qu'il avait appris que le juste zèle de l'apostole l'avait frappé d'anathême. Les insignes des rois ne convenaient pas moins bien à sa personne que ses qualités au gouvernement. Ses enfans et ses neveux commanderont, par une légitime succession, à la terre d'Angleterre, qu'il posséda lui-même par un legs héréditaire, appuyé des sermens des Anglais, et par le droit de la guerre. Il fut donc ainsi couronné par le consentement des Anglais, ou plutôt par le desir des grands de cette nation. Que si on demande des titres de parenté, on doit savoir la proche consanguinité qui existait entre le roi Edouard et le fils du duc Robert, dont la tante paternelle, sœur de Richard II, fille de Richard Ier, Emma, fut mère d'Edouard.
Après la célébration du couronnement, le trèsdigne roi (car maintenant, dans notre récit, nous lui donnerons volontiers le nom de roi à la place de celui de duc); le roi, dis-je, ne commença pas à faire le bien avec moins de zèle, comme il arrive ordinairement après un surcroît d'honneurs, mais il fut enflammé pour les grandes et honorables actions d'une nouvelle et admirable ardeur. Il s'appliquait avec une grande attention aux affaires séculières comme aux affaires divines; cependant son cœur avait plus de penchant pour le service du Roi de tous les rois, car il attribuait ses succès à celui malgré la volonté duquel il savait qu'aucun mortel ne peut jouir long-temps du pouvoir ou de la vie, et duquel il attendait une gloire immortelle après la fin de sa gloire temporelle. Il paya donc largement, comme un tribut à cet Empereur, ce que le roi Hérald avait renfermé dans son trésor. Les marchands s'habituèrent à rendre encore plus opulente cette terre, riche par sa fertilité, en y transportant leurs riches marchandises. On avait amassé des trésors précieux, soit pour le nombre, l'espèce ou le travail: mais ils étaient réservés au vain plaisir de l'avarice, ou destinés à être honteusement engloutis par le luxe des Anglais. Le roi en distribua magnifiquement une partie à ceux qui l'avaient servi dans cette guerre, et le plus grand nombre, et les plus précieux, aux pauvres et aux monastères de diverses provinces. Le zèle de sa munificence fut soutenu par un énorme tribut que de toutes parts toutes les villes et tous les hommes riches offrirent à leur nouveau seigneur. Il fit remettre entre les mains du pape Alexandre, pour l'église de Saint-Pierre de Rome, des sommes en or et en argent en quantité incroyable, et des ornemens qui auraient paru précieux même à Bysance. Il lui envoya aussi la fameuse bannière d'Hérald, toute d'un tissu d'or très-pur, et portant l'image d'un homme armé, afin de payer du don de cette dépouille la faveur de l'apostole, et d'annoncer pompeusement un nouveau triomphe sur le tyrannique ennemi de Rome.
Nous allons rapporter sommairement combien d'assemblées de serviteurs du Christ, transportés de joie, chantaient des hymnes de grâces pour le vainqueur, après l'avoir auparavant soutenu par les armes de l'oraison. Mille églises de France, d'Aquitaine, de Bourgogne, d'Auvergne et d'autres pays, célébreront à jamais la mémoire du roi Guillaume. La grandeur du bienfait, qui subsistera toujours, ne laissera pas périr la mémoire du bienfaiteur. Les unes reçurent de grandes croix d'or ornées de pierres précieuses; la plupart, des sommes ou des vases de ce métal; quelques-unes, des palliums on autres choses précieuses. Le moindre des présens dont il gratifia un monastère ornerait avec éclat une basilique métropolitaine. Je voudrais que les ducs et les rois connussent, pour leur exemple et pour leur.modèle, de telles choses, et un grand nombre d'autres rapportées dans cet ouvrage. Les dons les plus agréables furent envoyés à la Normandie par son doux enfant, qui, par une pieuse affection filiale, se hâta de les lui faire parvenir au moment où les temps et la mer sévissaient contre elle avec le plus de rigueur: on était à l'entrée de janvier. Mais elle reçut avec mille fois plus de joie la nouvelle de l'événement dont l'attente l'occupait si vivement; elle n'aurait pas reçu avec tant de plaisir les présens les plus beaux ou les plus doux de l'Arabie, Jamais plus joyeux jour ne brilla pour elle que celui où elle apprit avec certitude que son prince, l'auteur du repos qu'elle goûtait, était devenu roi. Les villes, les châteaux, les villages, les monastères se félicitaient beaucoup de la victoire, et surtout de la couronne qu'il avait obtenue. Un jour d'une sérénité extraordinaire semblait s'être levé tout à coup pour toute la province. Quoique les Normands se regardassent comme privés de leur père commun, puisque sa présence leur manquerait, ils aimaient mieux cependant qu'il en fût ainsi afin qu'il jouît d'une plus haute puissance, et qu'il fût plus en état de les défendre ou de les couvrir de gloire; car la Normandie faisait autant de vœux pour son élévation qu'il en faisait pour l'honneur ou les intérêts de la Normandie. Enfin on ne savait s'il aimait mieux sa patrie qu'il n'en était aimé, comme autrefois un pareil doute s'éleva au sujet de César-Auguste et du peuple romain.
Et toi aussi, terre d'Angleterre, tu le chérirais, tu l'estimerais au dessus de tous, et, pleine de joie, tu te prosternerais à ses pieds, si ta folie et ton injustice ne t'empêchaient de juger avec plus de raison au pouvoir de quel homme tu es soumise. Laisse là tes préventions, apprends à mieux connaître sa grandeur, et tous les maîtres que tu as eus te paraîtront bien petits en comparaison. L'éclat de son honneur t'ornera des couleurs les plus brillantes. Le très-vaillant roi Pyrrhus apprit par son député que presque tous les habitans de Rome étaient semblables à lui. Cette ville, mère des rois du monde, souveraine et maîtresse de la terre, se réjouirait d'avoir donné le jour à celui qui va régner sur toi, d'être défendue par son bras, gouvernée par sa sagesse, et d'obéir à son empire. Les chevaliers de ce Normand possèdent la Pouille, ont soumis la Sicile, font la guerre à Constantinople, et font trembler les Babyloniens. Canut le Danois a, par une excessive cruauté, égorgé les plus nobles de tes fils, vieux et jeunes, afin de te soumettre à lui et à ses enfans. Celui-ci regrette la mort d'Hérald; bien plus, il a voulu augmenter la puissance de Godwin son père, et, selon sa promesse, lui donner en mariage sa fille, digne de partager le lit d'un empereur. Mais si là-dessus tu n'es pas d'accord avec moi, du moins tu ne peux nier qu'il n'ait soustrait ton cou au joug orgueilleux et cruel d'Hérald. Il a tué cet exécrable tyran, qui t'aurait accablée sous une honteuse et misérable servitude: ce service est regardé chez toutes les nations comme digne de reconnaissance et de gloire. Les salutaires bienfaits dont sa domination te va combler, déposeront plus tard contre ta haine. Le roi Guillaume vivra, oui, il vivra long-temps dans les écrits d'on style peu brillant qu'il nous a plu de composer, afin de révéler clairement à beaucoup de gens ses magnifiques actions. D'ailleurs on voit les plus fameux orateurs. ceux qui sont doués d'une grande éloquence, employer un style simple lorsqu'ils écrivent l'histoire.
Après son couronnement, le roi, avec sagesse, justice et clémence, régla à Londres beaucoup de choses, soit pour l'utilité ou l'honneur de cette ville, soit pour l'avantage de toute la nation et pour le bien des églises du pays. Jamais personne ne sollicita de lui en vain un jugement conforme à l'équité. Presque toujours l'iniquité des rois voile leur avarice du prétexte de venger les crimes, et inflige à l'innocent le supplice pour s'emparer de ses biens; mais lui, jamais il ne condamna personne qu'il n'eût été inique de ne pas le faire, car son esprit était inaccessible à l'avarice comme aux autres passions. Il savait qu'il est de la majesté royale et qu'il convient à un pouvoir illustre de ne rien accepter de contraire à la justice. Avec l'autorité qui lui convenait, il ordonna aussi à ses grands l'équité que leur conseillait son amitié, leur disant qu'il fallait continuellement avoir devant les yeux l'éternel souverain dont la protection les avait fait triompher; qu'il ne fallait pas trop opprimer les vaincus, semblables aux vainqueurs pour la foi chrétienne, de peur que les injustices ne contraignissent à la révolte ceux qu'ils avaient justement soumis; qu'en outre il fallait craindre de déshonorer, par de honteuses actions contre des étrangers, le pays de sa naissance ou de son éducation. Il réprima par de très-sages ordonnances les chevaliers de moyenne noblesse et les simples hommes d'armes. Les femmes étaient à l'abri de la violence à laquelle s'emportent souvent contre elles ceux qui les aiment; et même, pour empêcher l'infamie, ces sortes de délits étaient défendus quand même le consentement de femmes impudiques y aurait donné lieu. Il ne permit pas aux chevaliers de boire beaucoup dans les tavernes, parce que l'ivresse enfante ordinairement la dispute, et la dispute le meurtre. Il interdit la sédition, le meurtre et toute espèce de rapine, réprimant les armes par les lois comme les peuples par les armes. Il établit des juges redoutables au commun des chevaliers, et décréta des peines sévères contre les délinquans. Les Normands n'étaient pas plus libres que les Anglais ou les Aquitains de se permettre certaines actions. On propose pour exemple Scipion et d'autres fameux généraux, dont les écrits instruisent sur la discipline militaire; il est facile de trouver dans l'armée du roi Guillaume d'aussi louables, et même de plus glorieux exemples. Mais hâtons-nous de parler d'autre chose, pour ne pas différer long-temps le récit du retour de ce prince attendu avec empressement par la Normandie. Il régla d'une manière peu onéreuse les tributs et tous les revenus qui devaient être versés dans le fisc royal; il ne laissa dans ses Etats aucun refuge aux brigandages, à la violence et aux crimes. Il ordonna que les ports et tous les chemins fussent ouverts aux marchands, et qu'il ne leur fût fait aucune injure. Il n'avait pas approuvé l'élévation de Stigand, qu'il savait n'être pas canonique; mais il jugea plus convenable d'attendre l'avis de l'apostole, que de se hâter de le déposer. D'autres motifs l'engageaient à souffrir et à traiter avec honneur, pour un temps, un homme de si grande autorité parmi les Anglais.
Il méditait d'établir sur le siége métropolitain un homme de sainte vie, de haute renommée, et d'une puissante éloquence dans la parole divine, qui sût prescrire aux évêques suffragans des règles convenables, gouverner le troupeau du Seigneur, et dont le zèle s'appliquât avec vigilance au bien de tous. Il voulait mettre le môme ordre dans les autres églises. Tels furent en toutes choses les vertueux commencemens de son règne.
Etant sorti de Londres, il demeura quelques jours à Bercingan5, ville voisine, jusqu'à ce qu'il eût achevé d'opposer quelques barrières à l'inconstance des nombreux et barbares habitans du pays. Il vit d'abord qu'il était nécessaire de réprimer les habitans de Londres. A Bercingan, Edwin et Morcar, fils du très-fameux Algard, et les premiers de presque tous les Anglais, par leur naissance et leur pouvoir, vinrent lui faire hommage, le prièrent de leur pardonner s'ils lui avaient été contraires en quelque chose, et se remirent, eux et tous leurs biens, à sa clémence. Beaucoup de nobles et gens puissans par leurs richesses en firent autant. Parmi eux était le comte Coxon, que son courage et sa bravoure extraordinaires, comme nous l'avons appris, rendirent agréable au roi et à tout bon Normand. Le roi reçut volontiers leurs sermens, comme ils le demandaient, leur accorda généreusement sa faveur, leur rendit tous leurs biens et les traita avec de grands honneurs. De là il marcha plus avant, et se rendit dans les différentes parties du royaume, faisant partout des réglemens avantageux pour lui et les habitans du pays. Partout où il s'avançait chacun déposait les armes. Aucun chemin ne lui fut fermé; de tous côtés accoururent vers lui des gens qui vinrent lui l'aire soumission ou traiter avec lui. Il avait pour tous des regards clémens, mais plus démens encore pour le commun peuple. Souvent son visage trahissait l'émotion de son ame, et bien des fois il prononça des ordres de miséricorde a la vue des pauvres et des supplians, ou des mères avec leurs Enfans, l'implorant de la voix et du geste.
Il enrichit de terres considérables, et traita comme un de ses plus chers amis Adelin, qu'après la défaite d'Hérald les Anglais s'étaient efforcés d'établir sur le trône, parce qu'il était de la race du roi Edouard; et il prit soin que son jeune âge ne s'affligeât pas trop de ne point posséder le rang auquel il avait été élu. Un grand nombre d'Anglais reçurent de sa libéralité des dons tels qu'ils n'en avaient pas reçu de leurs parens ni de leurs premiers seigneurs. Il confia la garde des châteaux à de vaillans hommes qu'il avait amenés de France, à la fidélité et au courage desquels il se fiait, et y mit avec eux une multitude d'hommes de pied et de cavaliers. Il leur distribua de riches bénéfices, afin qu'ils supportassent avec plus de patience les fatigues et les dangers. Cependant on ne donna rien à aucun Français, qui eût été injustement enlevé à quelque Anglais.
Cantorbéry est une noble et forte ville. Ses habitans et ses voisins sont riches, perfides et audacieux. Eloignée de quatorze mille pas de la mer qui sépare l'Angleterre du Danemarck, elle est à portée de recevoir des Danois de prompts secours. Le roi fit construire une forteresse dans l'intérieur de cette ville, et y laissa Guillaume, fils d'Osbern, le premier de son armée, pour commander à sa place par intérim, dans toute la partie occidentale du royaume. Il l'avait reconnu, entre tous les Normands, fidèle envers lui comme un père, soit en paix, soit en guerre, également fameux par son courage et par sa sagesse dans ce qui regardait la paix comme la guerre, et animé d'une grande et pieuse affection envers le souverain du ciel. Il savait que, chéri des Normands, cet homme était la très-grande terreur des Anglais. Depuis son enfance il l'avait aimé entre ses autres familiers, et l'avait élevé à des honneurs en Normandie.
Il confia à son frère Eudes le château de Douvres, avec le pays méridional adjacent, qu'on nomme le pays de Kent, et qui, situé plus près de la France, est pour cela habité par des hommes moins barbares; car ils avaient coutume de commercer avec les Belges. On assure même, d'après le témoignage de l'histoire ancienne, que cette région maritime a été autrefois possédée par les Français, à qui furent ces plaines fertiles, lorsqu'ils y passèrent pour piller et faire la guerre. Ledit Eudes, évêque de Bayeux, était connu pour être très-habile à gouverner les affaires ecclésiastiques et séculières. Sa bonté et sa sagesse sont d'abord attestées par l'église de Bayeux, qu'il a gouvernée et enrichie supérieurement avec beaucoup de zèle; il était jeune par son âge, mais préférable aux vieillards pour la maturité de son esprit; ensuite il fut utile et honorable pour la Normandie. Son habileté et son éloquence brillaient également dans les synodes, où on traitait du culte du Christ, et dans les discussions sur les affaires du siècle. L'opinion publique s'accorde à dire que jamais la France n'en eut de pareil pour la libéralité; son amour pour la justice ne méritait pas moins de louanges. Jamais il ne porta ni ne voulut porter les armes, et cependant il était redoutable aux gens de guerre; car autant qu'il le pouvait sans offenser la religion, lorsque la nécessité l'exigeait, il aidait les combattans par de très-utiles conseils. Il fut uniquement et constamment fidèle au roi, dont il était frère utérin, et qu'il affectionnait avec une telle amitié qu'il ne voulait pas même s'en séparer à la guerre. Il avait reçu de lui et en attendait de grands honneurs. Les Normands et les Anglais lui obéissaient de bon cœur comme à un maître qui leur était très-agréable. Les Anglais n'étaient pas tellement barbares qu'ils ne comprissent que cet évêque, ce gouverneur, méritait d'être craint, respecté et chéri.
Le roi, après ces dispositions pour le soin du royaume, se rendit à Pevensey, lieu que nous trouvons digne d'être nommé, parce que c'est à son port qu'il était abordé pour la première fois au rivage d'Angleterre. Des vaisseaux tout équipés et très-convenablement ornés de voiles blanches, à la manière des anciens, se tenaient prêts à le passer. Ils allaient ramener le plus glorieux triomphateur, et apporter la joie la plus desirée. En cet endroit se rendirent de nombreux chevaliers anglais, parmi lesquels il avait résolu d'emmener avec lui ceux dont il craignait l'infidélité et la puissance, l'archevêque Stigand, Adelin, parent du roi Edouard, les trois comtes, Edwin, Morcar et Guallèwe, et beaucoup d'autres d'une haute noblesse, afin qu'après son départ ils n'excitassent aucun trouble, et que la nation, privée de ses chefs, fût moins en état de se soulever. Enfin, il pensait qu'il devait, par précaution, les retenir entre tous les autres comme otages, parce que leur autorité et leur salut était d'une très-grande importance auprès de leurs voisins et compatriotes. Ils furent ainsi contraints d'obéir avec la plus grande soumission à ses ordres; car, bien qu'ordinairement il demandât ce qu'il desirait, cette fois ils l'entendirent l'exiger. D'ailleurs, ils n'étaient pas traînés comme des prisonniers, mais ils accompagnaient de très-près le roi leur seigneur, ce qui était pour eux un honneur et une faveur éclatante. Son humanité leur avait fait voir qu'on devait espérer de lui tout le bien, et ne craindre de sa part rien de cruel ni d'injuste. Dans ce même port, d'une main généreuse, il distribua des dons aux chevaliers qui retournaient dans leur pays avec lui, et qui dans une si grande expédition l'avaient si fidèlement servi, afin que tous pussent se réjouir d'avoir recueilli avec lui de riches fruits de la victoire. Les vaisseaux ayant levé l'ancre, au milieu de la joie de tous les esprits, un vent et une mer favorables les portèrent vers la terre natale. Cette traversée rendit la mer pendant long-temps paisible, et tous les pirates furent dispersés au loin. On admire avec raison le succès des entreprises, mais leur rapidité les rend encore plus merveilleuses. C'était vers les calendes d'octobre, le jour où l'Eglise célèbre la mémoire de l'archange Michel, qu'incertain du succès de son expédition, Guillaume était parti pour une terre ennemie; ce fut au mois de mars qu'il revint dans le sein de sa patrie. Ce fait exprime mieux ses exploits que ne le pourraient faire nos écrits.
Jules César, qui, avec mille vaisseaux passa deux fois dans la Bretagne (l'Angleterre se nommait ainsi autrefois), n'y fit pas de si grandes choses la première fois; et quoique, selon la coutume de son pays, il eût fortifié des châteaux, il n'osa pas s'avancer loin du rivage, ni y demeurer long-temps. Il y passa à la fin de l'été, et en revint peu de temps avant l'équinoxe. Ses légions furent saisies d'une grande frayeur, une partie de leurs vaisseaux ayant été brisés par les flots de la mer, et les autres, faute d'agrès, étant devenus inutiles pour la navigation. Quelques villes aimant mieux vivre en repos que de soutenir les attaques du peuple romain, que la renommée rendait redoutable par tout le monde, donnèrent à César des otages. Cependant toutes ces villes, à l'exception de deux, manquèrent à lui envoyer sur le continent les otages qu'il avait demandés, quoiqu'elles sussent qu'il hivernait dans la Belgique avec une armée innombrable. La seconde fois il se transporta dans la Bretagne avec environ cent mille hommes de pied et cavaliers romains, accompagné de beaucoup des principaux des villes de la Gaule avec leur suite. Que fit-il donc cette fois de comparable, pour la gloire, aux actions de celui dont nous écrivons la vie? Les cavaliers et les conducteurs de chariots des Bretons lui ayant livré bataille avec la plus grande intrépidité dans une plaine, lui firent éprouver une grande défaite. Les Anglais, effrayés par Guillaume, se cachaient dans les montagnes. Les Bretons attaquèrent souvent César: Guillaume en un seul jour écrasa tellement les Anglais qu'ensuite ils n'osèrent plus combattre avec lui. Comme ledit César conduisait son armée dans le pays de Cassivellon, qui lui faisait la guerre, arrivé au fleuve de la Tamise, il trouva les ennemis rangés en bataille sur l'autre rive du fleuve, pour lui en disputer le passage. Les soldats romains n'ayant que la tête hors de l'eau passèrent les gués avec beaucoup de peine. Le duc des Normands étant arrivé dans le même pays, les habitans des cités et des villes allèrent au devant de lui pour implorer sa clémence. S'il lui eût plu de l'ordonner, ils eussent sans délai dressé un pont sur le fleuve pour ses chevaliers. César répandit, pour ravager les champs par le fer et le pillage, ses cavaliers, que Cassivellon empêcha de s'étendre au loin en envoyant contre eux des hommes habiles à combattre du haut des chars. Guillaume, ordonnant la paix aux habitans, les conserva pour lui, ainsi que le pays qu'il aurait pu détruire promptement. César défendit, contre les attaques de Cassivellon, Mandtubratius et sa ville, dont il lui rendit le commandement. Guillaume délivra à jamais toute la nation de la tyrannie d'Hérald, et s'empara lui-même du trône, en sorte qu'il gouverna seul des régions soumises autrefois à un grand nombre de rois. Les Romains, parmi les grands de la Bretagne, ne prirent que Cingetorix. Les Normands, s'ils l'eussent voulu, eussent jeté dans les fers mille des plus illustres de cette nation. Autant dans ce pays les Romains ont fait de conquêtes dans l'été, autant en ont fait les Normands en hiver; et l'on sait que cette saison est moins favorable à la guerre que l'été.
C'était assez pour la gloire ou les intérêts de César de livrer bataille aux Bretons comme aux Gaulois par ses ordres seulement; rarement il combattit de sa personne; car c'était là une coutume commune aux généraux de l'antiquité, comme l'attestent les Commentaires écrits par lui-même. Mais le roi Guillaume aurait cru n'agir ni honorablement ni utilement, en ne remplissant, dans ce combat où il défit les Anglais, que l'office de commandant et non le devoir de tout chevalier; et c'était ainsi qu'il avait coutume de se conduire dans tous les combats. Dans chaque bataille où il se trouvait il était ordinairement le premier, ou un des premiers, à combattre de son épée. Si vous examinez avec attention les actions du Romain et celles de notre prince, vous conviendrez avec raison que le premier avait trop de témérité et trop de confiance en la fortune, tandis que le second était un homme plein de prudence qui dut ses succès à sa sagesse supérieure plutôt qu'au hasard. Enfin César, après avoir soumis quelques villes, reçu des otages de Cassivellon, et imposé à la Bretagne l'obligation de payer chaque année un léger tribut au peuple romain, ramena à grand'peine son armée en Belgique en deux traversées; car ses vaisseaux avaient besoin d'être radoubés, et il lui en restait moins qu'il n'en avait amené, des tempêtes en ayant diminué le nombre. Guillaume n'éprouva pas de tels embarras; les habitans à ses ordres lui eussent équipé des navires en aussi grand nombre et de la forme qu'il aurait voulu, ils les eussent même décorés de métaux précieux, ornés de voiles de pourpre, et munis d'habiles rameurs et de pilotes choisis. Combien son retour fut glorieux! Il n'emmenait pas comme les Romains de vulgaires prisonniers; il avait à sa suite et à ses ordres le primat des évêques de toute la Bretagne, de puissans abbés de plusieurs monastères d'outre-mer, et des fils d'Anglais dignes du nom de roi par leur noblesse et leurs richesses. Il remporta d'Angleterre non un léger tribut, et quelque butin, mais de l'or et de l'argent en si grande abondance, qu'on aurait de la peine à en recueillir autant dans les trois Gaules; et il l'avait reçu à très-bon droit, et se proposait de le dépenser honorablement, selon que l'exigerait l'occasion. Ce pays l'emporte de beaucoup sur la terre de France par l'abondance des métaux précieux; car de même qu'il devait être dit grenier de Cérès à cause de l'abondance de ses grains, de même, par l'abondance de son or, il pouvait passer pour le trésor de l'Arabie.
Mais laissons là ce récit sur Jules César qu'on trouvera peut-être déplacé. C'était un excellent général, instruit par la connaissance de la discipline militaire des Grecs; qui, depuis sa jeunesse, commanda avec gloire les armées romaines, et par son courage obtint le consulat de la ville. Il termina avec succès et célérité beaucoup de guerres avec beaucoup de nations belliqueuses, et enfin soumit, par les armes, à sa domination Rome, maîtresse de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie.
Jamais l'Italie n'accueillit avec plus de joie Titus, fils de Vespasien, qui mérita d'être appelé l'amour du monde, tant il aima ardemment la justice, que n'en montra la Normandie à l'arrivée du roi Guillaume son prince. C'était pendant le temps de l'hiver consacré à la rigoureuse pénitence du carême; cependant on passa ces jours comme les jours d'une grande fête. Le soleil brillait avec cette sérénité qui n'appartient d'ordinaire qu'aux jours plus longs de l'été. Les habitans des moindres lieux, des endroits les plus éloignés, accouraient en foule dans les villes ou autres lieux où ils pouvaient voir le roi. Lorsque Guillaume entra dans Rouen, la métropole de ses Etats, il trouva les vieillards, les enfans, les matrones et tous les citoyens s'avançant pour le voir; ils saluaient son retour avec des acclamations, en sorte que toute la ville retentissant d'applaudissemens ressemblait à Rome lorsqu'autrefois elle fit éclater ses transports de joie au retour du grand Pompée. Les monastères et le clergé disputaient à qui montrerait le plus de zèle à l'arrivée de leur très-cher défenseur; on n'omettait rien de ce qu'on a coutume de faire en de telles solennités; et même on ajouta tout ce qu'on put inventer de nouveau. Combien il récompensa sur-le-champ cette piété par d'innombrables dons, gratifiant les autels et les serviteurs du Christ de manteaux d'or et autres magnifiques présens! Nulle part nous ne voyons qu'aucun roi ni aucun empereur eût jamais mis dans ses offrandes une plus grande largesse. Ses dons allèrent visiter les églises qu'il ne put honorer de sa présence. Il apporta à la basilique de Caen, fondée, comme nous l'avons dit plus haut, en l'honneur de saint Etienne, premier martyr, et construite d'une manière et avec des dépenses admirables, divers dons précieux par la matière et le travail, et dont la gloire doit subsister jusqu'à la fin des siècles. Il serait trop long de décrire et même de nommer chacun de ces présens. Leur vue est un délice pour les plus nobles voyageurs qui ont souvent vu les trésors de riches églises. Un Grec et un Arabe, s'ils les visitaient, seraient ravis du même plaisir. Les femmes de l'Angleterre sont très habiles aux travaux d'aiguille et aux tissus d'or, et les hommes se distinguent, dans tous les arts. C'est pour cela que ceux des Allemands qui sont très-habiles dans ces arts ont coutume d'aller habiter parmi eux. Ils ont des marchands qui vont par mer dans des régions lointaines, et en rapportent des ouvrages savamment travaillés.
Il y a des grands qui font aux saints des largesses qu'ils ont acquises injustement, et la plupart augmentent par ces dons leur gloire dans ce monde, et leurs fautes devant Dieu; ils dépouillent des églises pour en enrichir d'autres de ces rapines. Mais le roi Guillaume n'acquit jamais que par sa bonté une légitime renommée, et ne donna jamais que ce qui lui appartenait réellement. Il dirigeait son esprit vers l'espérance d'une récompense infinie, et non vers une gloire méprisable. Les nombreuses églises d'outre-mer lui firent volontiers, pour transporter en France, quelques présens qu'il racheta par beaucoup d'autres dons. Il trouva, dans l'état qu'il desirait, son pays chéri de lui autant que son royaume, surtout parce qu'il connaissait ses habitans comme honnêtes, fidèles à leurs princes terrestres, et très-zélés pour le culte du Christ.
Notre maîtresse Mathilde, déjà appelée du nom de reine, quoiqu'elle ne fût point encore couronnée, s'était très-bien conduite dans le gouvernement de la Normandie. Sa sagesse avait été aidée par des hommes de très-utile conseil, parmi lesquels tenait le premier rang Roger de Beaumont, fils du très-vaillant homme Honfroy, plus propre par son expérience et par son âge aux affaires domestiques. Les fonctions guerrières étaient confiées à son jeune fils, sur le courage duquel nous avons dit quelques mots, dans le combat livré contre Hérald; mais nous pensons aussi que, si les voisins n'osèrent faire aucune incursion dans la Normandie, lorsqu'ils la savaient presque vide de chevaliers, on doit l'attribuer à la crainte du retour du roi.
Il célébra la Pâque du Seigneur dans le monastère de la Sainte-Trinité de Fécamp, fêtant avec un grand respect la résurrection du Rédempteur, au milieu d'une foule de vénérables évêques et abbés. Humblement placé dans les chœurs des ordres religieux, il força la foule des chevaliers et du peuple d'interrompre ses jeux, et de se rendre aux divins offices. A sa cour se trouvait le puissant comte Raoul, beau-père du roi des Français, et un grand nombre de nobles de France. Ils regardaient avec curiosité, ainsi que les Normands, les chevaliers enfans des contrées occidentales: les plus beaux jeunes gens de la Gaule chevelue auraient envié leur beauté, qui ne le cédait pas à celle des jeunes filles. A la vue des vêtemens couverts et chamarrés d'or du roi et de ses compagnons, tout ce qu'ils avaient vu auparavant leur parut vil. Ils admiraient aussi les vases d'argent ou d'or, sur le nombre et l'éclat desquels on pourrait rapporter des choses vraiment incroyables. Dans un grand repas donné aux Français, on ne but que dans des vases de cette sorte, ou dans des cornes de bœuf ornées aux deux extrémités des mêmes métaux. Enfin ils remarquèrent beaucoup de choses de cette sorte, convenables à la magnificence royale, et dont à leur retour chez eux ils firent le récit à cause de la rareté de ces objets. En outre, ils trouvèrent l'honnêteté du roi beaucoup plus remarquable et plus mémorable que tout cela. Guillaume passa tout cet été, tout l'automne et une partie de l'hiver en deçà de la mer, accordant tout ce temps à son affection pour la patrie, qui n'eut pas à se plaindre que ses richesses eussent souffert de son absence, ni de l'expédition de l'année précédente: car telle était la modération et la sagesse de Guillaume qu'il fournissait abondamment aux dépenses des chevaliers et des étrangers; mais il ne permettait à personne de rien enlever. Dans les provinces, les bêtes et troupeaux paissaient en sûreté, soit dans les champs, soit dans les étables; les moissons intactes attendaient la faux du laboureur; elles n'avaient pas été foulées aux pieds par l'orgueilleuse prodigalité des chevaliers, ni coupées par les fourrageurs. L'homme faible ou sans armes, monté sur son cheval, allait chantant où il lui plaisait, sans trembler à la vue des bataillons des chevaliers.
Pendant ce temps Eudes, évêque de Bayeux, et Guillaume, fils d'Osbern, administraient l'un et l'autre d'une manière digne d'éloges les parties du royaume confiées à leur gouvernement, agissant tantôt ensemble, tantôt séparément. Lorsque la nécessité l'exigeait, l'un portait à l'autre un prompt secours. Leur sage vigilance fut soutenue par l'accord amical et sincère qui régna entre leurs volontés. Ils s'aimaient mutuellement, et chérissaient également le roi; ils étaient animés d'un semblable zèle pour maintenir en paix le peuple Chrétien, et déféraient volontiers à leurs mutuels avis. Selon la recommandation du roi, ils agissaient avec beaucoup de justice, afin de corriger par là et d'adoucir des hommes barbares et ennemis. De même, chacun des commandans d'un rang inférieur gouvernait avec vigilance la forteresse où il avait été placé. Mais les Anglais ne pouvaient être contraints, ni par les bienfaits, ni par la crainte, à préférer un paisible repos aux changemens et aux troubles. Ils n'osaient prendre ouvertement les armes, mais ils tramaient d'exécrables conspirations, et s'efforçaient de nuire parla ruse. Ils envoyèrent des députés vers les Danois ou d'autres peuples dont ils espéraient quelque secours. Quelques-uns s'exilèrent d'eux-mêmes, afin d'échapper par la fuite au pouvoir des Normands, ou de revenir contre eux appuyés de secours étrangers.
Dans ce temps, Eustache, comte de Boulogne, se montrait ennemi du roi; il avait, avant cette guerre, remis son fils en Normandie comme otage de sa foi. Les habitans de la province de Kent lui conseillèrent d'attaquer le château de Douvres, lui promettant leur secours, et disant que, s'il s'emparait de ce château très-fortifié et de son port, sa puissance s'étendrait plus loin, et qu'ainsi celle des Normands irait en diminuant; car comme ils haïssaient les Normands, ils furent bientôt d'accord avec Eustache, leur ennemi acharné. D'ailleurs ils connaissaient par expérience son habileté et ses succès à la guerre. Ils aimaient mieux, s'il devaient ne pas obéir à un compatriote, être soumis à un homme connu d'eux et leur voisin. Il arriva que les circonstances leur firent espérer le succès qu'ils desiraient. Les premiers gardiens de ladite forteresse, l'évêque de Bayeux et Hugues de Montfort, étaient allés au delà de la Tamise, et avaient emmené avec eux la plus grande partie des chevaliers. Eustache, en ayant été instruit par les Anglais, passa vers eux avec les siens pendant le calme de la nuit, afin de surprendre la garnison qui ne se tenait pas sur ses gardes. Il amena une flotte munie de chevaliers d'élite, qui, à l'exception d'un petit nombre, avaient quitté leurs chevaux. Tout le voisinage était en armes, et le nombre des troupes aurait été augmenté de ceux qui habitaient plus avant, si les hommes d'Eustache se fussent arrêtés au siége pendant deux jours. Mais ils trouvèrent la garnison moins tranquille et plus en état de se défendre qu'ils ne l'espéraient. Ils échappèrent par la rapidité de leurs chevaux, la connaissance des sentiers, et au moyen d'un navire tout prêt à les recevoir. Un très noble jeune homme, neveu d'Eustache, et qui faisait ses premières armes, fut fait prisonnier. Les Anglais s'échappèrent d'autant plus facilement par plusieurs sentiers détournés, qu'il n'était pas facile pour les gens du château, vu leur petit nombre, de les poursuivre de différens côtés. Ce fut avec justice que ce déshonneur et cet échec arrivèrent à Eustache. Si je lui exposais les motifs qui auraient dû l'empêcher de se révolter, je le convaincrais qu'il a bien mérité de perdre la faveur du roi, et les bienfaits dont il avait été comblé. Ce fut à juste titre que les Anglais et les Français s'accordèrent à le déclarer grandement coupable; mais je sens qu'il faut épargner un homme illustre, un comte fameux qui, maintenant réconcilié avec le roi, est honoré comme un de ses plus familiers.
Vers le même temps, le comte Coxon, aimé des Normands, comme nous l'avons dit, succomba par une mort qu'il ne méritait pas, et qui doit être transmise à la mémoire. Pour que sa gloire vive éternellement, et que son innocence soit pour la postérité un exemple, je juge à propos de rapporter ici cette mort. Anglais élevé par sa naissance et son pouvoir, Coxon fut plus grand par l'honnêteté et la sagesse singulières de son esprit. Il favorisait beaucoup le roi et son parti; mais ses hommes ne partageaient pas ses sentimens; c'étaient les plus exécrables fauteurs et complices des factions. Essayant de le détourner de son devoir, ils l'avertissaient souvent, comme par zèle pour son honneur, de défendre la liberté que lui avaient transmise ses ancêtres, et le priaient et suppliaient, au nom de la chose publique, d'abandonner le parti des étrangers, et de suivre les projets des meilleurs hommes de sa nation et de sa famille. Pendant long-temps ils lui donnèrent ces conseils, et d'autres de cette sorte, employant pour le décider diverses ruses; mais ne pouvant ébranler son esprit, fermement attaché au bien, ils excitèrent contre lui la haine de sa province, afin de le forcer à abandonner le parti du roi. Leur méchanceté croissant de jour en jour, comme Coxon aimait mieux souffrir la haine et tous les outrages du peuple que de violer sa foi, ils le firent périr par des embûches. Ainsi cet excellent homme témoigna par sa mort que la domination de son seigneur devait être respectée.
Quelques évêques étaient pleins de zèle pour le service du roi, surtout Edelred, primat d'York.........6
FIN DE LA VIE DE GUILLAUME-LE-CONQUERAND
NOTES
1 En 1035.
2 En 1036.
3 En 1046.
4 Harold.
5 Barking.
6 Ici s'arrête le manuscrit.