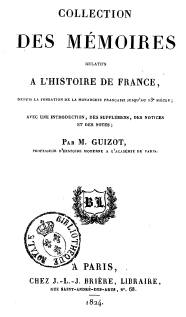
ADALBÉRON DE LAON
POEME SUR ROBERT, ROI DES FRANCS
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
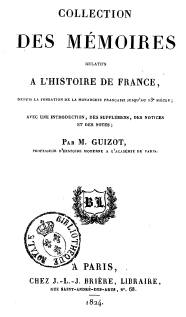
POEME SUR ROBERT, ROI DES FRANCS
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Si Adalbéron n'avait fait qu'écrire la courte satire dont nous publions ici la traduction, sa vie nous serait probablement aussi obscure que son ouvrage; mais il fut intrigant, brouillon, de mœurs peu réglées, et son activité mondaine a donné à son nom une place que ne lui auraient point value ses vers. Né en Lorraine, d'une famille qui possédait de grandes richesses, il étudia à Reims sous le célèbre Gerbert, et passa bientôt pour l'un des plus savants hommes du siècle. Il paraît que ses contemporains étaient surtout frappés de son éloquence, car « Dieu lui avait donné, disent-ils, un incomparable talent de persuader. » Il en profita pour pousser sa fortune, et gagna si bien les bonnes grâces du roi Lothaire, qu'en 977, malgré sa jeunesse, il fut nommé évêque de Laon, la principale des villes où régnait encore le petit seigneur qui s'appelait le roi des Français. Adalbéron apporta à son église des trésors immenses qui lui appartenaient en propre, et qu'il sut très habilement accroître. Ses richesses ne l'occupaient pas seules; tout donne lieu de croire qu'il était encore mieux avec Emma, femme de Lothaire, qu'avec le roi son mari. A la mort de Louis V, Arnoul, fils naturel de Lothaire et chanoine de Laon, livra cette ville au prince Charles son oncle, et Adalbéron, qui sans doute avait déjà embrassé le parti de Hugues Capet, fut mis en prison. Il s'échappa et se réfugia près de Hugues. A cette occasion la reine Emma écrivit à l'impératrice Adélaïde sa mère : « Ma douleur est au comble, ô ma souveraine, ma mère chérie; j'ai perdu mon mari; j'espérais en mon fils, il est devenu mon ennemi ; des hommes qui naguère m'étaient chers m'ont abandonnée, pour ma perte et celle de toute ma race. Ils ont répandu contre l'évêque de Laon d'odieux mensonges; ils le poursuivent et veulent le dépouiller de son rang pour m'imprimer à moi-même une ignominie qui me fasse justement perdre le mien. » Adalbéron de son côté écrivit à tous les évêques pour leur dénoncer ses ennemis et menacer d'une accusation quiconque entreprendrait d'exercer les fonctions épiscopales dans son diocèse. Il y rentra bientôt, se réconcilia avec Arnoul, et fit même recouvrer à ce dernier la faveur de Hugues Capet, qui le nomma archevêque de Reims. Lorsqu'à la suite d'événements que nous ne rappellerons pas ici, car ils appartiennent à l'histoire générale, Reims eut été livré à Charles par son archevêque, ils s'établirent l'un et l'autre à Laon ; mais, en 991, Adalbéron les trahit tous deux, et les fit tomber, ainsi que la ville, aux mains de leur ennemi. A dater de cette époque, la vie de l'évêque de Laon devint, ce semble, plus étrangère aux affaires politiques ; mais on ne le voit pas moins toujours tracassier, avide, opiniâtre, et engagé dans une multitude de querelles, tantôt avec Gerbert, devenu archevêque de Reims, et son métropolitain, tantôt avec le bon roi Robert lui-même, qui s'irrita au point de l'accuser devant le Saint-Siège, en envoyant à Rome l'exposé de ses griefs. Adalbéron parvint pourtant à se réconcilier avec Robert, et ce fut, à ce qu'il paraît, vers l'an 1006 qu'il lui adressa ce poème en forme de dialogue, satire bizarre des mœurs des moines, de la cour, et même de la conduite personnelle du roi. Telle est du moins l'opinion des savants Bénédictins. Je serais plus enclin à penser que ce poème appartient au temps où Adalbéron était brouillé avec le roi Robert, et peut-être même ne fut pas étranger à sa disgrâce momentanée. A travers la censure générale des vices du temps, on démêle sans peine que l'auteur dirige surtout ses attaques contre Odilon, abbé de Cluny, à qui Robert portait une affection particulière ; et malgré les éloges qu'il donne au roi, il est difficile de croire que Robert n'en ait pas pris quelque humeur. Quoi qu'il en soit, ce petit ouvrage, dont l'obscurité a désespéré les plus habiles érudits, nous donne sur l'état de la société, du gouvernement et des ordres monastiques au xie siècle, quelques renseignements curieux. Adrien de Valois le publia le premier, en 1663, en y joignant un grand nombre de notes qui expliquent en général assez bien les passages auxquels elles se rapportent; mais Valois, comme la plupart des commentateurs, s'est souvent résigné à ne point entendre, et à ne rien dire de ce qu'il n'entendait pas. Forcé de tout entendre pour traduire, ou du moins de chercher dans chaque phrase un sens raisonnable, nous avons plus d'une fois recouru aux conjectures, suppléé des mots, introduit même dans le texte quelques transitions ou quelques incises, travail aussi ingrat que difficile, quand il s'applique à un ouvrage de si mince valeur. Nous ne nous flattons pas d'avoir démêlé toutes les allusions, toutes les intentions de l'évêque de Laon, et sa métaphysique, que nous avons probablement rendue plus claire qu'elle ne l'était pour lui-même, demeure encore étrangement obscure.
Adalbéron mourut le 19 juillet 1030, après un épiscopat de cinquante-trois ans, dont la fin ne fut pas moins agitée que tout le cours de sa vie. Il prétendait choisir lui-même son successeur et l'avait déjà désigné ; mais, sur les représentations de quelques évêques, l'archevêque de Reims, Ebble, son métropolitain, s'y opposa, et Adalbéron vit, en mourant, échouer son dernier dessein. Deux autres ouvrages qui portent son nom, un poème sur la sainte Trinité et un Traité de dialectique, n'ont jamais été publiés.
|
ADALBERO LAUDUNENSIS CARMEN AD ROTBERTUM REGEM FRANCORUM. PRAESUL.
Regi Rotberto sic
praesul Adalbero scribo, REX.
Regibus et ducibus
bona laus est, nobilis ortus. P.
Dicendi spatium
petimus, modo, nilque reponas.
|
ADALBÉRON
POEME SUR ROBERT, ROI DES FRANCS
L'Evêque. — C'est moi, Adalbéron, évêque, et déjà dans ma vieillesse, qui écris ceci au roi Robert.[1] Tout le corps des clercs de l'église de Laon, tant ceux en qui brille la fleur de la jeunesse que ceux qui déjà portent les fruits de l'âge mûr, te saluent de cœur. Retrace en détail sur les tablettes de ton cœur combien Dieu a fait pour toi, et de quels dons il t'a comblé; examine en toi-même s'il t'a traité selon tes mérites, et recherche en cela la vérité, en te pesant à une juste balance. Tes ancêtres sont comptés depuis longtemps au nombre des rois et des souverains. C'est une reine puissante qui elle-même t'a nourri de son lait; tu étais encore enfant, que l'univers se réjouissait de ta naissance, voyait en toi son maître, t'applaudissait, se félicitait, te souhaitait pour son roi, et d'une voix unanime te décernait la couronne. On voyait en toi le gage du temps d'une douce paix. A peine as-tu passé l'âge si dangereux de l'adolescence, que la fleur de la jeunesse brille sur ta figure ; tes belles formes semblent t'élever au dessus de tous les autres hommes ; dans aucun de tes membres on ne remarque la moindre faiblesse ; quoiqu'un peu gros, tu es leste et fort ; le vulgaire s'en réjouit, et les sages même le voient avec plaisir. Dieu enfin a mis sous tes pieds plusieurs puissants royaumes. Est-il quelque chose dont tu puisses te plaindre? Que t'a refusé le Seigneur ? De quoi oserais-tu murmurer? Nulle volonté ne peut t'enlever ce que tu tiens de ta naissance; tout ce qu'il y a de noble descend du noble sang des rois, et c'est pour les monarques et pour les grands un vrai titre d'éloges qu'une noble origine. Le Roi. — C'est assez parler de mon extérieur et de ma force ; les qualités de l'âme sont bien préférables à tous les avantages du corps. L'Evêque. — Je t'en conjure, laisse-moi le temps de m'expliquer, et veuille bien ne pas m'interrompre. Pieux roi, ne méprise pas ce que j'ai à te dire ; je t'en supplie, fais-moi cette grâce. Mes entrailles se sont émues de ton dédain; mon cœur qu'il afflige verse des torrents de larmes, ma bouche tremblante ne laisse échapper que des soupirs; ton front crispé de colère ne me permet pas de parler ; et ni ton visage, ni ta voix, ni l'attitude de ton corps ne décèlent la modération. N'importe, j'essaierai d'exprimer dans mes faibles vers le vif chagrin qui m'inspire. Les écrits que nous ont transmis les plus célèbres Crotoniates ne sont-ils pas ouverts à tout le monde? N'y voit-on pas inscrite pour épigraphe, cette antique loi du monde qui nous dit : Ravissons par la force ce que la bonne volonté nous refuse? Eh! bien donc, que tout dans l'ordre du clergé change au gré des caprices du prince. Que ce rustre grossier, paresseux, difforme, abreuvé de honte, soit, puisqu'on le veut, comblé de richesses, couvert de pierres précieuses et coiffé de la plus belle mitre.[2] De telles gens, dira-t-on, contraignent les gardiens même des lois à porter le capuchon ; eh bien ! que ceux-ci prient, s'inclinent, se taisent et abaissent leur visage devant eux; que les évêques, dépouillés de tout bien, en soient réduits à suivre la charrue, un aiguillon à la main, et à chanter la triste complainte de notre premier père, chassé du paradis terrestre[3] ; et s'il vient à vaquer quelque siège épiscopal, qu'on y élève des gardeurs de troupeaux ou des mariniers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ayons soin cependant de couvrir de tels choix de quelque prétexte adroit et plausible. Ne souffrons pas qu'un homme instruit dans la loi divine aspire à l'épiscopat ; cette dignité appartient de droit à ceux qui ignorent les saintes Écritures, n'ont jamais consacré un seul jour à l'étude, et savent seulement compter sur leurs doigts le nombre des lettres de l'alphabet. Voilà quels doivent être les puissants du royaume; voilà les précepteurs qu'il faut que le monde adore, et devant qui les monarques, les plus fameux ne sont pas dispensés de s'humilier en public. Ces gens nous dictent leurs ordres, mais en secret ils se moquent perfidement de nous. Si cet ordre de choses[4] qu'ont établi les pouvoirs d'ici-bas, dure et se perpétue, la discipline, la force, la vertu, l'honneur et l'éclat de l'Église s'amortiront tout-à-fait et en peu de temps. Il en sera de même de l'Étal; il est manifestement dirigé de la même manière. Aussi les lois une fois mises en oubli, le royaume demeurera enseveli dans le repos et la paix du tombeau ; et alors le luxe, l'inceste, le vol, tous les autres vices lèveront audacieusement leur tête ; la liberté de manquer à tout devoir et les crimes de tout genre domineront sans obstacle. Mais qu'importe encore? ce qu'il faut, c'est exclure de tout emploi ceux qui n'ont d'autre appui que leur sagesse, se montrent vrais serviteurs du Christ, se nourrissent de science, et en qui l'on remarque les éléments de la saine doctrine; celle-ci n'est qu'une plaie honteuse qui doit les faire écarter. S'il s'élève quelque grande hérésie, dangereuse pour la sainte foi, de tels hommes doivent rester étrangers à toute assemblée réunie pour censurer l'erreur. Qu'on se garde surtout de ne pas les éloigner de tout conseil du roi. C'est derrière la porte de la chambre de ce conseil qu'il faut les tenir, quand tous les autres y seront entrés.[5] Le seul précepte écrit aujourd'hui en lettres brillantes d'or, le voici : « Que l'intendant des domaines du roi soit paresseux, fainéant, et doué d'une médiocre vertu ; qu'il cherche à usurper les biens d'autrui, les revendique comme siens propres, sans même rien donner en retour ; que jamais il ne se soumette à subir le joug d'un mariage légitime, et qu'il fonde toutes ses espérances de gain sur les héritages que le roi peut réclamer, comme revenant à son domaine. » L'antique et ordinaire volonté de nos pères était, comme on le rapporte, que les gardiens de la chambre royale fussent chastes et sobres ; mais malgré cela, que celui qui se montre le plus incapable soit pour cet emploi le plus agréable au prince. Une loi d'un grand empereur ordonne encore mieux que tout cela. Elle veut que les hommes engagés dans un saint ordre monastique épousent de belles femmes et se précipitent au milieu des combats.[6] Effrayé de cet édit, je médite sur ce que je pourrai faire; je crois sage d'en appeler aux conseils de ceux qui doivent me diriger,[7] je repasse tous ces ordres dans ma tête, au milieu de sanglots qui me suffoquent, et je les crois entièrement contraires aux lois de nos pères, parce que jamais on n'en a entendu parler dans les temps anciens. Les procureurs du couvent, gens capables, examinent les usages. On propose d'envoyer sur-le-champ consulter le maître en fait de règle.[8] La Gaule possède encore, se dit-on, des moines nourris dans la discipline des Pères de l'Église. Qu'un de nos frères soit envoyé à ces hommes pieux……. Celui qu'on choisit est sage, adroit, fidèle observateur de ce qu'on lui prescrit, accoutumé à se montrer soumis aux lois de nos pères, et sait par sa prudence amener à la pitié les âmes les plus féroces. Cette mesure habilement calculée est exécutée sans aucun retard. L'envoyé part le soir, revient le lendemain matin, et descend en toute hâte de son coursier couvert d'écume. Holà! valet, s'écrie-t-il, où est le maître de la maison, sa bonne ménagère, sa femme?[9] Il a quitté son habit de moine, et se présente dans un désordre complet. Un haut bonnet, fait de la peau d'un ours de Libye, couvre sa tête ; sa longue robe est écourtée, et tombe à peine jusqu'aux jambes ; il l'a fendue par devant et par derrière ; ses flancs sont ceints d'un baudrier étroit et peint ; une foule de choses de toute espèce pendent à sa ceinture ; on y voit un arc et son carquois, des tenailles, un marteau, une épée, une pierre à feu, le fer pour la frapper, et la feuille de chêne sèche pour recevoir l'étincelle.[10] Des bandelettes étendues sur le bas de ses jambes en recouvrent toute la surface.[11] Il ne marche qu'en sautant; ses éperons piquent la terre, et il porte en avant ses pieds enfermés dans des souliers élevés, et que termine un bec recourbé.[12] Il entre; les frères qui le connaissent le mieux ont peine à le reconnaître ; les citoyens accourent et remplissent le vaste palais des moines. Dans cet accoutrement, qui le rend méconnaissable, il se présente fièrement devant son abbé. Est-ce mon moine? dit celui-ci; est-ce bien toi que j'ai fait partir récemment? L'autre baisse les poignets, étend et relève ses coudes, fronce le sourcil, tourne tout à la fois les yeux et le cou, et répond : Aujourd'hui je suis soldat, dans d'autres circonstances je, redeviendrai moine; maintenant je ne le suis plus; mais je guerroie par l'ordre de mon roi ; car mon seigneur et roi c'est Odilon, abbé de Cluny. |
|
R.
Tunc cata to
siopomenon causam meditaris ? P.
Non tua praepediat
nos indignatio fervens. R.
Crede mihi, non me
tua verba minantia terrent. P.
Per partes scindunt
vestem quam quisque tenebat. R. Si Musas celebres, clament musarde sacerdos. P.
Persius indignans
promet tum lusca sacerdos, R.
Scire meum nihil
est, semper sed Numinis almi P.
Assiduus lector sibi
plurima nosse peroptat, R.
Inco, precor, mihi
dic, praesul, qui sint ibi latus: |
Le Roi. — As-tu donc pensé que je garderais le silence à de tels propos? Moi aussi je me rappelle avoir appris pendant mes études les figures de rhétorique et les formes du langage.[13] L'Evêque. — Que ta brûlante indignation, prince, ne vienne pas me troubler; permets que je te rapporte tranquillement les préceptes de ce grand maître[14] (Odilon). La race des Sarrasins, toujours trop prête à frapper de rudes coups, occupe, le fer à la main, le royaume des Français, et le tient courbé sous son joug ; de toutes parts, le sang humecte et rougit la terre; les torrents sont gonflés par le sang qu'a fait couler un horrible carnage; les reliques des saints, que l'Église s'est procurées avec tant de peine, et qui font sa gloire et son ornement intérieur, volent maintenant dispersées dans les airs, et sont devenues la proie des oiseaux et des loups; l'évêché de Tours est dévasté par le pillage; saint Martin en pleure, et réclame hautement un défenseur.[15] Odilon, accablé de maux semblables,[16] compatit au sort de saint Martin, et s'apprête à courir à Rome solliciter des secours pour les moines. Les religieux de Cluny frémissent, crient, élèvent leur voix jusqu'aux cieux, et s'animent les uns les autres. Maître, disent-ils, ordonne aux tiens u de prendre leurs armes; indique-leur celles qu'ils doivent choisir, quelles il faut qu'ils portent par dessous leurs vêtements, et quelles ils ont à mettre par dessus. — Avant tout, répond l'abbé, suspendez à votre cou vos boucliers échancrés ; attachez par dessus vos habits une cuirasse formée d'un triple tissu ; que les ceintures polies qui serrent vos reins soutiennent votre casque ; que votre poignard repose en guise de couronne sur votre tête serrée par des courroies; portez vos javelots derrière le dos, et tenez votre épée dans les dents. Odilon prescrit encore aux jeunes gens de se placer sur des chars à marche lente, et à la foule des vieillards de monter de rapides coursiers. Deux doivent être portés par un âne, d'autres enfin par un chameau ; et si cela ne suffit pas, vous autres trois, dit-il, grimpez sur un buffle. Des milliers de mille hommes se présentent devant ces braves soldats. On combat avec le fer; l'action se prolonge pendant trois grands jours. C'est moi, dit l'un, qui portais l'étendard ; j'étais au centre de ma troupe, et plein d'ardeur, je ne pensais pas à ronfler, mes mâchoires s'étant distendues. Je laissai tout en combattant échapper un vent terrible. Par les dieux, combien de milliers d'ennemis j'ai couchés par terre de ma propre main, je ne le sais pas. Jupiter peut certes marquer d'une pierre blanche les deux premiers jours de ce combat, mais le troisième n'a pas été si heureusement consacré au a dieu Mars. Renversé de cheval par un coup de javeline, il m'a fallu abandonner honteusement mon drapeau ; et fuyant avec ce qui restait des miens, j'ai regagné le pays qui m'a vu naître. Ces choses, tu le sais, grand roi, se sont passées le 1er de décembre, et nous tenterons un nouvel effort avant les calendes de mars. Voilà, prince, ce qu'Odilon, le chef de notre armée, nous envoie te dire : l'Ordre belliqueux des moines te salue, seigneur, t'invite et t'exhorte à préparer tes bataillons pour la guerre ; hâte-toi de t'entourer de tes troupes, et de faire ce que te demande Odilon; il te sera plus glorieux de mourir les armes à la main, qu'en cultivant tes champs. L'Europe, bien qu'elle ne soit que la troisième partie du monde, se vante de te fournir plus de soldats que l'Asie ne voit de feuilles sur ses arbres, et la noire Afrique de grains de sable sur le rivage de ses mers.» Roi, que veut donc de toi la rage, digne des plus noirs cachots, que montrent ces moines?[17] Le Roi. — Que dit-il? Moines, enfoncez vos ongles dans le corps de cet envieux; qu'il ne vous échappe pas…..[18] Va, crois-moi, tes paroles ne m'épouvantent pas, j'en ai appris beaucoup du maître du fameux Neptanabus à Reims, où tombe maintenant en ruine cette magnifique basilique où brillent tant de coupoles dorées.[19] L'Evêque. — Au surplus, chacun des envoyés d'Odilon déchire, en signe de douleur, le vêtement qui le couvre. Crois-le bien, roi, je n'ai raconté sur eux que des choses vraies, et où il n'y a rien de faux. Le saint Ordre des religieux a, dans tout le royaume, changé de mœurs, ainsi que je le rapporte. Chacun de nous peut sans doute s'adonner à des choses diverses; ce que la nature nous refuse, la science nous le donne. Mais dans la jeunesse, on ne veut rien apprendre, et l'on remet à le faire à un jour à venir. Dans la vieillesse, on est réduit à déplorer, sans espérance, le mauvais emploi de la jeunesse ; c'est ce qui m'arrive. Si j'avais été laborieux, je saurais tout sur toutes choses; mais hélas! malheureux ignorant que je suis, je me sens maintenant pressé d'un repentir trop tardif. Je n'ai jamais su manier la bêche, ni vu de tristes combats. Pour mon malheur, ce que je sais, on défend de l'apprendre; ce que j'ignore, on exige qu'on le sache. Puisqu'il en est ainsi, il me faudra donc, comme un être inutile, balayer le foyer, ou me livrer à de vains chants, et célébrer les cendres du feu roi. Le Roi. — Mais si tu t'occupes à cultiver les Muses, on t'appellera prêtre musard.[20] L'Evêque. — Perse indigné répondra : Gens à préjugés, une prêtresse borgne vous fait peur. Celui qui étudie s'initie aux travaux des Muses, sans pour cela cultiver lui-même les Muses. Quant à moi, vouloir le bien, me plaire aux saintes Ecritures, voilà le constant objet de mes désirs, voilà le but que je ne perds jamais de vue; c'est ainsi que je serai trouvé semblable aux justes, du moins je l'ai toujours pensé. Connaître Dieu, c'est ce que je préfère ; le mettre avant toutes choses, c'est où tendent mes vœux. Prince, si toutes choses te sont prospères, ne rougis pas de te souvenir de quels honneurs t'a comblé le Roi des rois. Il nous a, dans sa miséricorde, accordé un présent plus précieux que tous les autres, une partie de lui-même, la véritable science. A l'aide de ce don, prince, tu pourras connaître ce que sont de toute éternité les choses célestes. Ton devoir est de savoir ce qu'est la Jérusalem céleste, ce que sont ses pierres, ses murs, ses portes, quelle est sa structure, et pour quels habitants a été créée cette cité éternelle. Elle est gouvernée par un corps de prêtres séparés de tout le reste, et compte de nombreux chevaliers; mais la sage puissance qui l'a organisée place l'un de ces corps avant l'autre. J'ai, par l'étude éclairée, appris ce que sont chacune de ces deux classes, mais ce détail te paraîtrait trop long et fastidieux. Le Roi. — Savoir ne m'appartient pas, c'est un don de la sublime Divinité ; l'intelligence humaine paraît toujours tenir de près à Dieu, et celui-là ne peut se connaître lui-même, qui ne s'efforce pas de s'instruire de ce qui est au-dessus de soi. Cette puissante Jérusalem dont tu parles est, ce me semble, un emblème de la paix éternelle. Le Roi des rois gouverne cette cité; c'est le Seigneur qui lui dicte la loi. Tout en séparant, comme il l'a entendu, les rangs que chacun doit y tenir, c'est toujours lui qui domine cet ordre de choses. Nul métal ne ferme aucune des portes éclatantes de cette cité. Ses murs ne sont pas faits de pierres, et ses pierres ne sauraient entrer dans des murs; elles sont vivantes, ainsi que l'or qui pave les rues, et paraît plus brillant que celui qui sur la terre est le mieux raffiné. Cette cité est construite pour la demeure des anges et d'une foule d'hommes ; enfin, de ses habitants, une classe règne, et l'autre espère. Voilà tout ce que je sais; mais sur un tel sujet, je désire vivement être plus instruit. L'Evêque. — Je le crois, le lecteur laborieux souhaite connaître une foule de choses; mais l'homme lent et paresseux a coutume d'oublier promptement celles qu'il a précédemment apprises. Cher prince, aie sans cesse dans les mains les livres d'Augustin ; il a dévoilé, c'est un fait reconnu, ce qu'est l'illustre cité de Dieu. Le Roi. — Évêque, dis-moi, je t'en conjure, quels sont les habitants de cette cité, s'il y a des principautés égales entre elles, ou quel est leur rang. |
|
P.
Quaere Dionysium,
qui dicitur Areopagita : R.
Hoc genus afflictum,
nil possidet absque labore. P.
Thesaurus, vestis,
cunctis sunt pascua servi. R. Servorum lacrymae, gemitus non terminus ullus. P.
Triplex ergo Dei
domus est, quae creditur una. R.
Jam caput ecce tuum
candens imitatur olorem P. Altera me stimulat, senio non deficit illa.
R. R.
Sed tamen his, quas
multiplices scis esse, duabus P. Qui parvum meminit, non obliviscitur omnis R. Ejus qui stimulat, senio nescis reminisci, |
L'Evêque. — Demande-le à Denis, surnommé l'Aréopagite, qui s'est laborieusement occupé d'écrire deux livres sur cette matière ; depuis, le saint pontife Grégoire, recherchant les principes moraux de l'étonnante foi que montra dans le Seigneur l'illustre Job, a traité le même sujet. Ce pape a de plus, dans un lucide commentaire, expliqué complètement ce qu'Ézéchiel a dit sur l'objet qui t'occupe. Ces écrits, la Gaule les a reçus de ce pontife, et c'est le plus beau don qu'il ait pu lui faire. Il n'appartient pas à des yeux humains de pénétrer des choses si élevées. Nous allons au surplus exposer quelle idée mystique nous attachons à cette Jérusalem. Dans cette cité céleste on distingue deux ordres d'habitants. C'est, dit-on, d'après ce modèle que sont réglés les rangs parmi les habitants de la terre. Le Seigneur s'est servi de Moïse pour instituer, classer et diriger, au moyen de la loi donnée à l'ancien peuple qu'il avait choisi, les ministres de son Église, appelée alors synagogue, nom exprimant la nature et les fonctions de cette Eglise. Les histoires sacrées racontent comment étaient organisés ces ministres. L'Église, telle que nous la voyons maintenant coordonnée, est ce qu'on appelle le royaume des cieux; c'est Dieu lui-même qui a classé dans cette Église ses ministres exempts de souillures; la nouvelle loi est celle qu'elle observe sous le Christ son chef, et les papes, organes de la foi, ont fixé par leurs décisions ce que sont ces ministres, par qui et comment ils doivent être établis. Pour que l'Église jouisse d'une tranquille paix, il est nécessaire que sa constitution soit en rapport avec les deux lois établies par la sagesse suprême, la loi divine et la loi humaine. La première n'admet aucune distinction de nature parmi ses ministres ; tous elle les rend de condition égale, quelque inégaux d'ailleurs que les aient faits le rang et la naissance; à ses yeux le fils de l'artisan n'est pas inférieur à l'héritier du monarque. Cette pieuse loi les exempte de toute tâche vile et mondaine. Ce n'est point à eux à ouvrir péniblement le sein de la terre et à marcher derrière les bœufs pour les faire avancer. A peine doivent-ils donner leurs soins à la culture des vignes, des arbres et des jardins. Ils ne s'abaissent pas jusqu'à être bourreaux, aubergistes, gardeurs de cochons, conducteurs de boucs, ou bergers. Cribler le blé, ou s'échauffer autour de chaudières grasses et brûlantes, n'est point leur rôle. Attacher des porcs sur le dos des bœufs et les transporter ainsi sur les marchés, est indigne d'eux; blanchir les étoffes ou les faire bouillir pour les passer au foulon, sont des choses qu'ils ne daignent pas faire. Leur seul devoir est de tenir leur corps et leur âme nets de toute souillure, d'avoir des mœurs recommandables et de veiller sur celles des autres. L'éternelle loi de Dieu ordonne à ses ministres de se maintenir toujours purs, mais elle veut aussi qu'ils soient affranchis de toute fonction servile. Le Seigneur les a choisis pour ses esclaves à lui seul ; lui seul aussi les juge et leur crie du haut des cieux de se montrer constamment sobres et chastes. Quant à tout le reste des hommes, quelle que soit leur naissance, Dieu les a par ses commandements soumis à ses ministres, et cette loi, quand elle dit tous les hommes, n'excepte même aucun prince. C'est à ses ministres que le Tout-Puissant ordonne d'enseigner à conserver la foi dans toute sa pureté, et de plonger ensuite dans les eaux de la fontaine sainte du baptême ceux qu'ils ont instruits. Ce sont ses ministres qu'il a établis médecins des âmes, et chargés d'employer le cautère de leurs discours à guérir les plaies gangrenées du cœur. Le Christ a réglé que le sacrifice mystérieux de son corps et de son sang fût offert par le prêtre seul et avec les solennités prescrites, et c'est aux prêtres qu'il a confié ce que la religion a de plus sublime, puisque c'est de leurs mains qu'il veut être immolé. Ce privilège que la parole de Dieu même leur accorde, il n'est refusé, nous le savons et le croyons fermement, qu'à ceux qui s'en sont rendus indignes par leurs crimes. A eux appartient donc de s'asseoir aux premières places du royaume des cieux, mais ils doivent aussi veiller sans cesse sur leur troupeau, ne point se livrer aux excès de la table, et implorer à toute heure la miséricorde divine, tant pour les péchés du peuple que pour les leurs propres. J'ai dit bien peu de choses et j'en omets beaucoup d'autres sur les ministres des autels. Tous sont donc d'une condition égale, car la famille du Seigneur est une, ainsi le règle la loi qui est une aussi. La foi est donc une chose simple, mais ceux qui la professent se divisent en trois classes. Outre celle des prêtres, la loi humaine en établit en effet deux bien distinctes. Le noble et le serf ne sont pas régis par la même loi. Parmi les nobles, deux sont les premiers, l'un celui qui gouverne comme roi, l'autre celui qui commande au nom du premier ; ce sont eux dont les ordres affermissent l'État. Quant aux autres nobles, nul pouvoir ne restreint leur liberté, s'ils ne commettent aucun de ces crimes qu'il appartient au sceptre des rois de punir; ceux-là sont appelés à porter les armes, protéger les églises, défendre ce qu'il y a de plus bas et de plus élevé parmi le vulgaire, et mettre également et tous et eux-mêmes à l'abri des dangers. La seconde classe contient tous les gens de condition servile. Le Roi. — Cette classe malheureuse ne possède rien qu'elle ne l'achète par un dur travail. Qui pourrait, en les multipliant par eux-mêmes autant de fois qu'un damier contient de cases, compter les peines, les courses, les fatigues qu'ont à supporter les serfs infortunés? L'Evêque. — Fournir à tous l'or, la nourriture et le vêtement, est la condition du serf; et en effet, nul homme libre ne peut vivre sans le secours du serf. Se présente-t-il quelque travail à faire, veut-on se procurer de quoi satisfaire à quelque dépense? les rois et les pontifes eux-mêmes sont alors les véritables esclaves des serfs. Le Roi. — Hélas! il n'y a aucun terme aux larmes et aux gémissements des serfs. L'Evêque. —La famille du Seigneur, qui paraît une, est donc dans le fait divisée en trois classes. Les uns prient, les autres combattent, les derniers travaillent. Ces trois classes ne forment qu'un seul tout, et ne sauraient être séparées ; ce qui fait leur force, c'est que, si l'une d'elles travaille pour les deux autres, celles-ci à leur tour en font de même pour celle-là; c'est ainsi que toutes trois se soulagent l'une l'autre. Cette réunion, quoique composée de trois éléments, est donc une et simple en elle-même. C'est ainsi que la loi de Dieu domine le monde, et que par elle le monde jouit d'une douce paix. Mais aujourd'hui les lois sont sans force, la tranquillité fuit de partout, les mœurs des hommes se corrompent, et tout ordre s'intervertit. Roi, tu tiens la balance par le droit de ta naissance, c'est donc à toi de veiller au bonheur du monde et de réprimer, à l'aide du frein des lois, ceux qui se montrent enclins au crime. Le Roi. — Allons, prélat, voici que ta tête blanchie le fait déjà ressembler au cygne ; ce que tu viens de dire est, on le voit, l'effet de la vieillesse, et notre nature est telle que ton grand âge me force à penser que tu n'as plus la tête bien saine. L'Evêque. — Ce qui me pousse à parler, c'est une nature autre que notre nature mortelle, et sur celle-là la vieillesse n'a point de prise. Le Roi. — Combien est-il donc donné à l'homme d'avoir de natures? L'Evêque. — Deux, à ce que je crois. Le Roi. — Mais de ces natures que tu dis être au nombre de deux, quelle est celle dont tu parles? à laquelle se rapportent tes discours? Réponds, tu n'es qu'un simple grammairien, et complètement étranger aux lois de la dialectique ; tu n'as conservé que bien peu de souvenir de tes premières études. L'Evêque. — Qui se souvient d'un peu n'a pas tout oublié. Le Roi. — La vieillesse t'empêche au moins de te rappeler ce qui est dit pour te piquer. |
|
P.
Dicere quae nollem
rex, infestando perurges. R. Cuncta necessariis argumentantur ab istis? P.
Malleus alter adest,
qui causa probabilis hic est. R.
Quod non est verum,
non est fas dicere verum, P.
En dixi verum. Scis
non excedere verum R.
Judicium duplex
sequitur correptio triplex. P.
Causa nec est
individuis, tamen est specialis. R.
Gratia nunc Summo,
per quem regnare peropto.
P. R. Judicet Omnipotens; mecum divina sit illa, P.
Undique pax bona
post certamina, postque labores: R.
Haec sit permissio
Patris,
|
L'Evêque. — En me tourmentant, prince, tu me pousses à dire ce que je devrais taire. C'est l'esprit qui parle en moi, et non la folie qui m'agite. Si c'est conformément aux lois de la nature que la vieillesse m'accable, tu m'en blâmes à tort. Les plus habiles philosophes n'expliquent pas l'essence et le but de la nature. Quelques-uns d'entre eux soutiennent que le feu est le souverain artisan de toutes choses ; pour d'autres, l'auguste volonté de Dieu est la nature. La nature de Dieu est Dieu même ; mais il n'en est pas de même des hommes. Si Dieu existe véritablement, il est immuable. Ne pas changer est son essence, et ne pas cesser d'être ce qu'il est, telle est la nature de notre souverain Père. Quant aux êtres créés, chacun d'eux, au moment même où il reçoit la naissance, prend la nature qui lui est propre. De ces natures diverses, certaines sont jointes à des corps et ont à souffrir quelque altération de la part des sens; mais il est d'autres de ces natures qui ne sont pas sujettes à ces altérations. Les premières changent si les corps viennent à changer; elles périssent si ceux-ci meurent, et ne subsistent qu'autant que les corps vivent. Les secondes de ces natures sont unies à des êtres incorporels; celles-ci ne périssent point, parce qu'elles ne sont point associées à des corps ; la nature de l'homme est double, et elle présente à la fois ces deux sortes de natures. Toutes deux sont réunies dans le corps de l'homme, mais y existent d'une façon distincte et séparée. L'une se joint à ce qu'il y a de corporel dans l'homme, et l'autre s'unit à ce qu'il y a de spirituel. Ce qui sera en opposition avec toutes deux n'atteindra ni celle-ci ni celle-là. Une ânesse effrayée a parlé, dira-t-on, quoique ce fût cantre la loi de sa nature. Ce n'est ni le sentiment de la crainte, ni aucune condition de sa nature corporelle qui ait su et pu la faire parler ; de sa nature elle n'a jamais pu avoir la perception d'aucune connaissance autre que la connaissance qui tient uniquement à sa nature corporelle. Cependant on assure que cette ânesse a su ce qu'elle n'a pu connaître. Oui, mais ces choses ne peuvent se comprendre qu'à l'aide des facultés intellectuelles; elles sont du ressort de l'entendement, et c'est avec son seul secours qu'on arrive à concilier ces deux faits contradictoires. J'appelle, au surplus, nécessité, ce qu'exige l'une ou l'autre de ces deux natures; et tous les arguments que je viens de te développer sont appelés arguments a necessario. Le Roi. — En toute occasion ne se sert-on que de ces arguments tirés de la nécessité des choses? L'Evêque. —Il existe encore une autre arme, qu'on emploie dans la discussion, c'est l'argumentation fondée sur les probabilités. Ce que je viens de te présenter dans un certain ordre logique, je l'ai appris, et ne l'ai point oublié, comme tu vois. Je reviens au surplus au sujet qui m'occupe actuellement, et, crois-le, tout ce que je t'ai dit est vrai. Le Roi. — II ne saurait être permis d'affirmer vrai ce qui ne l'est pas. Une fable ne ressemble en rien à la vérité, et ne peut être donnée pour telle. L'Evêque. — J'ai dit la vérité, et, tu le sais, je n'ai point été au-delà des bornes de la vérité. Les fadaises et les fables ne me plaisent en aucune manière. Sache bien que, si toutes choses ne se sont pas passées positivement comme je l'ai dit, toutes du moins ont pu se passer ainsi. J'aurais voulu me renfermer complètement dans mon véritable sujet; cependant, il est vrai, je m'en suis écarté dans la digression que je viens de faire. Celle-ci, toutefois, quoique hors de ce sujet, s'y rattache jusqu'à un certain point, et ne lui est pas, ce semble, complètement étrangère, quant au fond et au sens propre des choses. Connaître et atteindre le but pour lequel on est créé, savoir et remplir ses devoirs, voilà la vraie sagesse. Ceci n'est point une fable, mais une chose vraie. Au surplus, j'ai dit ce que je devais dire; puisse la persuasion s'attacher ensuite à mes paroles! Puissent les hommes sages et modérés combattre en toutes choses pour la loi de Dieu le père, et n'attendre des peines et des récompenses que de la justice suprême, source de salut! Puissent les grands supporter raisonnablement ce qu'il leur arrive d'avoir à souffrir de juste ou même d'injuste! que ne mettant pas en doute les choses certaines, ils ne se querellent que pour celles qui sont vraiment douteuses, répriment le mal et s'en abstiennent eux-mêmes! Au surplus, roi, le ciel t'a départi les talents d'orateur ; c'est à toi qu'il appartient d'exposer dans l'assemblée de la nation l'état du royaume. L'ordre des grands en délibérera ensuite, discutera et déterminera avec des juges religieux, par qui tout ce que j'ai dit peut être nié. Le Roi. — S'il faut le concours de deux pouvoirs pour te juger, sois-en sûr, la peine sera triple. Mais avant tout, il faut que je discerne clairement ce que sont les choses que tu dis, quelle est la vérité de ton rapport, dans quel but tu l'as fait, et ce qu'il a de vraisemblable. Cette affaire, quoique toute particulière à toi, ne regarde pas cependant de simples individus, mais l'État tout entier. L'Evêque. — Ces quatre bases de jugement que tu cherches, tu ne les trouveras pas ici. Les lois humaines, tout en ne formant qu'un seul tout, admettent cependant les choses les plus opposées. La cause dont il s'agit ici, et la moindre partie de cette cause, sont, je le crois, au dessus de telles lois. En tout ceci, ma marche a été régulière; je n'ai levé un pied que quand je sentais l'autre appuyé sur un terrain solide. Dans tous les sujets que j'ai touchés je ne crois pas m'être écarté des voies de la raison ; une nature défaillante, je le répète, ne m'a point poussé à mettre an grand jour de telles vérités ; on me le reproche injustement; c'est une force supérieure qui m'a contraint de parler. Quel crime, prince, ai-je commis envers toi ? qu'ai-je fait autre chose qu'accomplir les lois de ma nature? ton orgueil s'afflige de ce que j'ai dit que, roi, tu es contraint de servir, et de ce que je t'ai appelé serf, toi, le premier des Français, et le premier dans l'ordre des rois. Mais, crois-moi, celui-là se trouble mal à propos, qui se laisse effrayer par les paroles d'autrui. Les miennes n'empêchent pas que du temps de nos pères, le royaume des Français n'ait subjugué les rois des autres États ; que toujours il ne soit puissant et ne brille d'un sublime éclat} qu'aucun sceptre ne puisse donner la loi au sceptre de nos pères; que quiconque porte des vertus sur le trône ne commande à juste titre, et que nous ne sachions bien que l'empereur lui-même a été mis en fuite par nos rois. Le Roi. — Grâces soient rendues de tous ces succès au Tout-Puissant, par qui seul je souhaite régner. Loin de moi l'idée de les attribuer à mes propres mérites; c'est à celui qui régit tout, qui est la source de toute vertu, et que nous devons célébrer éternellement, qu'en appartiennent la gloire, l'honneur et la louange. Sans cesse je l'adore et le supplie, en fléchissant humblement les genoux, qu'il m'accorde la grâce de me montrer constamment fidèle aux lois que m'ont transmises mes pères. L'Evêque. — Prends-y garde, la loi divine défend les choses qu'elle blâme dans les lois humaines; celles-ci sont de deux sortes; les unes permettent, les autres ordonnent ; mais ces lois sont d'un ordre inférieur. Celle que je juge la plus importante est la loi divine, que les lois humaines ne placent qu'au dernier rang; c'est en elle seule que nous trouvons tout ce qui nous est utile et nécessaire; quelque nombreuses que soient les obligations que cette loi nous impose, quelque fort et pesant que soit son joug, mettons toujours notre gloire à l'observer. Le Roi. — Que le Tout-Puissant soit mon juge, et m'accorde de garder constamment sa loi divine ! L'Evêque. — Puisse donc une paix solide succéder partout aux peines et aux combats, et l'Église alors recouvrera d'elle-même tous ses droits ! Que l'État soit régi par des lois écrites, et non par d'autres; que les moines de Saint-Basile et de Saint-Benoît soient fidèles à leurs règles, et obéissent à tout ce qu'elles leur prescrivent; que les prélats ne passent pas leur temps à jouir des plaisirs de la campagne; quand ils s'occuperont moins de leurs terres, ils rempliront mieux leurs devoirs. Que notre Ordre, celui du clergé, néglige avec moins d'audace les préceptes de la justice; qu'il s'applique au contraire à les suivre de tous ses efforts; qu'il ne donne enfin pour pères et directeurs, aux pauvres, aux malheureux et aux veuves, que des hommes justes, et non des hommes avides, comme on le fait d'ordinaire. Que personne ne se permette d'entrer dans les églises qu'une seule fois pendant la nuit, mais qu'il soit libre à tous d'y prier tout le long du jour. Que dans les jugements, les évêques aient toujours devant les yeux non seulement leurs contemporains, mais la postérité. Qu'excepté moi seul, si tu le veux ainsi, prince, tous les hommes qui te sont vraiment fidèles reçoivent de toi des récompenses proportionnées à leurs mérites. Que les clercs puissent réciter aux heures fixes les sept offices établis en l'honneur de Dieu, et que surtout les vœux de la piété accompagnent toujours le sacrifice de la victime sainte. Le Roi. — Si Dieu le Père permet jamais que la Loire essaie de baigner les champs calabrais, que le Tibre fougueux couvre les campagnes espagnoles, et qu'il éclose des roses sur l'Etna, et des lis sur un étang ; oui, si de telles choses arrivent, espère alors, évêque, voir s'accomplir tous les vœux que tu viens de former. Au surplus, Adalbéron, puissent les grâces du Christ t'accompagner constamment comme le feront les nôtres ! tu mérites à juste titre les récompenses de ton roi; et, je le reconnais, tu ne parles pas en insensé, mais, sous le voile de l'allégorie, tu nous donnes de sages conseils. Fin Du Poème D'Adalbéron. |
|
[1] Adalbéron devait avoir vers cette époque environ soixante ans, et Robert trente-six. [2] Le texte porte corona; Adrien de Valois entend par ce mot la mitre épiscopale ou abbatiale, que l'auteur appelle par ironie couronne. Ce sens paraît d'autant plus exact qu'il ne s'agit ici que de prêtres et de moines. [3] Cette addition, chassé du paradis, que ne porte point le texte, est d'Adrien de Valois, et paraît nécessaire au sens. [4] Le texte porte : regula divum : regula, d'après ce qui précède, n'était point une règle, mais un ordre de choses. Par divum, c'est Robert lui-même que désigne le poète, suivant Adrien de Valois, cl au fait cela ne peut être autrement. [5] Omnibus egressis thalamum post ostia servent. — Les Bénédictins et Adrien de Valois pensent qu'il faut ingressis et non egressis. En admettant cette correction, qui paraît juste, le sens littéral est : Tous étant entrés dans la chambre, que ces hommes demeurent derrière les portes. [6] Allusion à plusieurs lois des empereurs romains, qui ordonnaient aux moines de servir comme soldats. [7] Rectores rerum placet accersire mearum. Il me plaît d'appeler les directeurs de mes affaires— Dans les notes d'Adrien de Valois, on regarde ce vers comme inintelligible, coupant le sens, et interpolé. En admettant qu'Adalbéron feint d'être un moine effrayé de cet ordre de servir comme soldat et de se marier, il semble que ce vers ne peut avoir que le sens qu'on lui donne ici. [8] Ce maître est, suivant Adrien de Valois, et d'après ce qui soit, l'abbé de Cluny, qu'Adalbéron tourne en ridicule et appelle ironiquement maître. [9] Quoquo quo prœsul, bona nutrix, heus puer, uxor?— Ce vers, terminé par un point d'interrogation, a paru ne pouvoir être qu'un propos de soldat arrivant dans un gîte, propos qu'Adalbéron prête à ce moine qui revient habillé en soldat, et qui demande le maître du logis, sa femme ou sa ménagère, pour avoir de quoi manger. On n'a pu y trouver un autre sens plausible. [10] Le texte porte seulement ilex, le chêne. — Adrien de Valois dit qu'il faut entendre par ce mot une feuille de chêne pour recevoir le feu qui jaillit de la pierre; et on n'a pu qu'admettre ce sens qui explique un usage du temps. [11] Ossa superficiem, etc., etc. — Par ce mot ossa, les écrivains du moyen âge désignent quelquefois, selon Ducange, des bandelettes enveloppant les jambes. Les Bénédictins adoptent ce sens, qui paraît d'autant plus juste que ces bandelettes faisaient partie de l'habillement militaire. [12] Espèce de souliers connus sous le nom de souliers à la poulaine, et qui furent longtemps à la mode. [13] L'auteur feint Robert en colère, et le menaçant de se rappeler ses anciennes études pour lui répondre. Odilon était fort aimé de Robert. [14] Praeceptum domini liceat cum pace referre. — II semblerait, d'après les notes d'Adrien de Valois, que par Jomini il entend Dieu. Mais, d'après ce qui précède et ce qui sait, ce mol domini vent dire le maître Odilon. En effet, d'une part, le moine soldat vient de dire qu’il guerroyait par l’ordre de son seigneur et roi Odilon; de l'autre, Odilon ordonne plus bas à ses moines de s'armer. De plus, toute cette partie du poème est dirigée contre les moines de Cluny et leur abbé. Enfin, si domini voulait ici dire Dieu, il n'y aurait aucune liaison dans les idées; tout ce qui précède et suit n'a aucun rapport avec les préceptes de Dieu. [15] Adrien de Valois croit que, par les Sarrasins, Adalbéron entend des seigneurs qui, profitant de la faiblesse de Robert, dévastaient le royaume, pillaient les églises, et s'étaient, entre autres, emparés des biens de l'église de Tours et de l'abbaye de Cluny, ce qui explique pourquoi il est dit ensuite, Odilo simili qui jure tenetur. [16] Comme ou l'a vu dans la note précédente, c'est le sens qu'Adrien de Valois donne à ces mots : simili qui jure tenetur. [17] Quid tibi vultis rabies tetris dignissima claustris? Le sens adopté est celui qu'indique Adrien de Valois, qui pense que ce vers est une réflexion d'Adalbéron contre les moines de Cluny. [18] Figite per corpus, fugiat ne lividus, ungues. — Selon Adrien de Valois, le roi Robert, qui aimait les moines de Cluny, et particulièrement Odilon, leur donne l'ordre de se saisir d'Adalbéron et de lui enfoncer les ongles dans la peau. C'est donc à ce vers que doit commencer la réponse du roi, et non au vers suivant ainsi que le marque le texte. On a adopté ce changement qui seul donne un sens au vers, Figite per corpus, etc. [19] Suivant Adrien de Valois, ce Neptanabus est Gerbert qui instruisit Robert. Adalbéron l'appelle maure parce qu'il savait l'astronomie et la magie. Il enseignait à Reims, dont la riche cathédrale tombait, ainsi que l'indique la fin de la réponse de Robert. [20] Clament musarde sacerdos. — On t'appellera prêtre musard, qui perd son temps à cultiver les Muses. — Musarde, d'après Adrien de Valois et Ducange, n'a pas d'autre sens, et de là peut-être celui que nous attribuons nu même mot. |
|