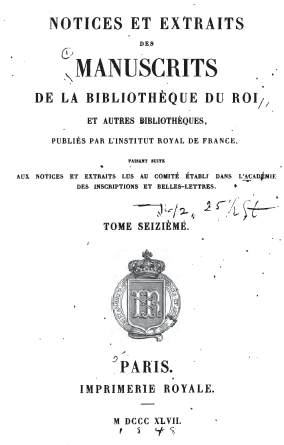
PACHYMERE
INTRODUCTION AU TRAITÉ DES QUATRE SCIENCES MATHÉMATIQUES [OU QVADRIVIVM]
Traduction française : M. J.-H. VINCENT.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
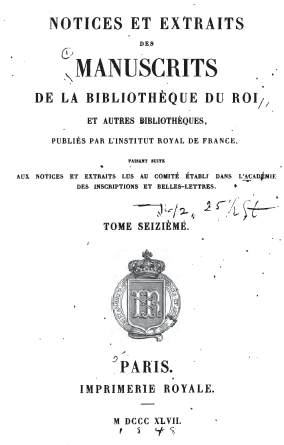
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
NOTICES ET EXTRAITS
DES
MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI
ET AUTRES BIBLIOTHÈQUES,
PUBLIÉS PAR L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE,
FAISANT SUITE
AUX NOTICES ET EXTRAITS LUS AU COMITE ÉTABLI DANS
L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.
TOME SEIZIÈME.

PARIS.
IMPRIMERIE ROYALE.
Avant de donner le texte du Traité de musique de G. Pachymère, qui composera la quatrième partie de ce travail, j'ai cru devoir placer ici, à la suite des fragments, l'Introduction générale de son ouvrage dans laquelle on verra le lien que, d'après Platon, les anciens établissaient entre les quatre sciences considérées par eux comme mathématiques.
Le commencement ne subsiste dans aucun manuscrit; mais on s'aperçoit facilement que l'auteur cite, à la cinquième ou sixième ligne, la fin de l'Épinomis de Platon, et, de plus, qu'il suit les traces de Nicomaque (Αριθμ. εἰσαγωγῆς κεφ γ'). D'après cette remarque, j'ai pu, en empruntant une phrase de ce dernier auteur, donner au Traité un commencement très logique, je pourrais même presque dire authentique.
Le texte de cette Introduction est fourni par cinq manuscrits de la Bibliothèque royale, savoir : 2338=B, 2339,=C, 2340=D, 2341=E, et enfin 2438=F.[1]
Le manuscrit B, noté comme étant du xvie siècle, me paraîtrait cependant remonter au xve; il a porté successivement les n°* 792, 859, 2170, et enfin 2338.
Le manuscrit C, de l'écriture d'Ange Vergèce, ancien fonds Colbert, a porté autrefois les nos 1540, 2639, et en dernier lieu 2339. Il commence ainsi : Γεωργίου Παχυμερίου μαθηματικά ἀριθμητικὰ, μουσικά γεωμετρικὰ καὶ ἀστρονομικά. Λείπει ἡ ἀρχή.... καὶ διορίζεται...
Le manuscrit D, qui parait être de la main de Paléocappa, a porté autre fois les nos 35o, 381, 2168, et aujourd'hui 2340. Il commence ainsi : Τοῦ βιβλίον τούτου τῶν τεσσάρων μαθηματικῶν λείπει ἡ ἀρχὴ, ἴσως φυλλον ἑ–ν μόνον καὶ οὐ πλεῖον (il me paraît même vraisemblable qu'il manque seulement quelques lignes, détruites par le frottement dans le manuscrit original). Οὔκ ἔχομεν δὲ, continue-t-il, καὶ τοὔνομα τοῦ δισδασκάλου τίνος ἐστὶν ὅμως, κατάπερ ἐν ἄλλοις ἐμάθομεν, ὑπολαμβάνομεν εἶναι Γεωργίου τοῦ Παχυμερίου... καὶ διορίζεται…
Le manuscrit E=2341 ne contient que l'Arithmétique (y compris l'introduction), et la Géométrie; il est intitulé : Παχυμέοη μεγίστου δισδασκάλου περὶ Αριθμ. : il est signé Νικόλεως ὁ Ναγκήλιος, et daté de Paris, 1557.
Enfin, le manuscrit F = 2438, in-fol., du xvie siècle (olim Teller. Rem.), présente cette bizarre circonstance, de donner jusqu'à cinq copies différentes des premiers chapitres de l'ouvrage, lesquelles s'arrêtent ensuite, celles-ci à un endroit, celles-là à un autre. Il eût été aussi fastidieux qu'inutile de signaler une multitude de variantes sans valeur que donnent ces diverses copies ; je me suis borné aux principales.
Platon, à la fin du xiiie livre des Lois, livre que quelques-uns intitulent le Philosophe par la raison que l'auteur y examine et explique quelles conditions doit remplir celui qui prétend être réellement philosophe ; Platon, dis-je, récapitulant en cet endroit tout ce qu'il a précédemment traité et discuté dans de longs détails, s'exprime ainsi : « Toutes les figures de géométrie, les combinaisons de nombres, les systèmes harmoniques, les mouvements des astres, tout cela est lié par un rapport commun qui doit être évident pour celui qui aura appris suivant la méthode que nous avons indiquée. Et la vérité de cette assertion sera clairement démontrée à quiconque voudra s'assurer qu'il est impossible de porter ses regards vers un seul de ces divers objets sans apercevoir en même temps tous les autres : dès lors, en effet, il devient impossible de méconnaître l'unité du lien qui les assemble. Veut-on entreprendre la philosophie par une autre méthode? autant vaut prendre le hasard[2] pour guide; le seul moyen est celui que je prescris; nulle autre voie ne saurait conduire au but. Que les sciences soient faciles, qu'elles soient difficiles, il faut les acquérir; il n'est pas permis de les négliger ; et celui qui les prendra par le côté que je lui ai montré, celui-là, je le proclame le sage des sages, et je suis prêt à le célébrer comme tel, soit en vers, soit en prose.[3] »
Il est clair en effet, que les mathématiques sont comme des échelles ou des ponts dont notre esprit se sert pour franchir l'intervalle qui sépare les choses sensibles et incertaines des choses intellectuelles et positives,[4] pour passer des choses qui sont nées avec nous, avec lesquelles nous avons été nourris, des choses habituelles, matérielles, corporelles, aux choses inaccoutumées et encore étrangères pour notre intelligence, bien que plus conformes, par leur nature immatérielle et éternelle, à l'essence de notre âme, aux spéculations les plus pures de la pensée. Or pourquoi les mathématiques sont-elles ainsi comme des ponts et des échelles pour passer des choses sensibles aux choses intellectuelles, des choses incertaines aux choses positives, si ce n'est absolument parce qu'elles occupent le milieu entre les unes et les autres? En effet, c'est sur des objets matériels qu'on les étudie; et cependant on peut, par une abstraction, les dégager de toute considération matérielle. Prenons, si vous voulez, pour exemple, le cercle que l'on décrit avec un compas sur un tableau noir, ou le nombre quatre que l'on rencontre à chaque instant dans les calculs de négoce : ne peut-on pas les dégager des objets matériels auxquels ils s'appliquent, et considérer, d'une part le cercle comme immatériel, d'autre part, le nombre quatre, soit uniquement comme un nombre pair, c'est-à-dire décomposable en deux moitiés exactes, soit comme le premier des nombres carrés, etc. ?
Aussi la sagesse n'est-elle que la science de la vérité considérée dans tous les êtres: car la fin de toute étude, c'est la vérité. Or les êtres par excellence sont les choses intellectuelles, parce que, existant éternellement par elles-mêmes, elles persistent éternellement dans le même état. Quant aux choses qui n'existent que par rapport à nous, si on les nomme aussi êtres, ce n'est que par extension, et en les assimilant aux premières. C'est ce dont Platon rend témoignage dans son Timée, lorsqu'il dit : « Ce qui existe éternellement n'a pas eu de naissance, et ce qui naît éternellement n'existe jamais; » et il porte là-dessus un jugement parfait lorsqu'il ajoute : « La première de ces deux choses peut être saisie par l'intelligence aidée de la raison, puisqu'elle existe éternellement, et toujours de la même manière; l'autre ne peut être que conjecturée par l'opinion accompagnée de la sensation irraisonnable, puisqu'elle ne fait que naître et périr, mais en réalité n'existe jamais.» Ce sont donc les êtres par excellence qui sont l'objet de la science, puisque ce qui existe essentiellement peut seul être saisi par l'intelligence aidée de la raison. Quant aux choses qui naissent et changent, elles ne sauraient être l'objet de la science proprement dite, si ce n'est en tant qu'elles participent de la nature des êtres réels.[5]
Puis donc que la science a pour but de nous élever à la connaissance des choses intellectuelles, et que nous ne pouvons passer des choses sensibles aux choses intellectuelles qu'en franchissant l'abîme qui les sépare, voici nos ponts et nos échelles : ce sont les mathématiques. A la vérité, c'est sous une enveloppe matérielle qu'elles nous apparaissent; mais dépouillons-les de cette enveloppe, et réduisons-les à l'état de sciences abstraites, comme on les appelle encore. Ce sont là les intermédiaires entre les choses sensibles dont nous avons été nourris, et les choses intellectuelles auxquelles nous voulons parvenir. Il s'en faut d'ailleurs que les choses intellectuelles nous soient complètement étrangères ; et nous ne sommes point dans le cas de les regretter, puisque nous possédons une âme raisonnable, ainsi qu'une intelligence pour la gouverner.[6] Mais cette intelligence étant comme enveloppée et obscurcie par les choses du monde sensible, nous ne pouvons la dégager et l'élever à la conception des choses intellectuelles, autrement que par l'intermédiaire des mathématiques, étudiées à la vérité sur les objets matériels, mais susceptibles néanmoins d'être isolées de la matière. « Il faut, dit Plotin, mettre les jeunes gens en possession des sciences mathématiques, pour les familiariser avec les choses incorporelles. » En effet, sans les sciences, il est impossible de saisir exactement l'être sous toutes ses faces, de découvrir la vérité qui se trouve dans les êtres, vérité dont la connaissance constitue la sagesse.
Il me paraît, toutefois, que cette manière de raisonner n'a pas tout le degré de justesse désirable; et que le pythagoricien Androcide est beaucoup plus exact quand il dit : « Les avantages que les arts mécaniques retirent de la science du dessin pour le perfectionnement de leurs procédés, ces mêmes secours se retrouvent, pour ce qui tient à l'intelligence des rapports exacts des choses, dans la considération des figures, des nombres, des intervalles harmoniques, des révolutions des corps célestes. » Puis il ajoute à peu près ceci : « Nous commandons, dit-il, à un forgeron, de nous fabriquer, une épée de telle et telle façon, en airain par exemple; l'artiste a de la peine à comprendre parfaitement ce que nous lui demandons; alors nous lui dessinons l'objet; et, par cette description, nous le lui faisons, pour ainsi dire, toucher au doigt ; et il en serait de même de toute autre chose. » Eh bien, on peut appliquer cela aux mathématiques: car c'est en étudiant les objets matériels, que nous nous habituons, par des abstractions, à considérer les choses intellectuelles. Ainsi, dans le cas actuel, l’épée commandée est l'objet que l'esprit doit saisir; l'artiste ne peut d'abord le comprendre : cependant il y parvient par le secours du dessin; et, concevant alors l'idée de l'objet comme il le ferait sur l'objet lui-même, il dégage, par une abstraction, cette forme idéale, des moyens matériels employés pour la lui inculquer, et finit ainsi par fabriquer l'objet commandé. C'est donc de cette manière que les mathématiques sont les ponts qui s'offrent à nous pour passer des choses sensibles à la connaissance des choses immatérielles, connaissance que nous devons revendiquer comme notre propriété, comme l'apanage de notre âme intelligente.
Maintenant tirons les conséquences. D'abord la philosophie est la science de la vérité considérée dans les êtres. Ensuite, toute science est la conception sûre et certaine d'un objet donné. Mais une conception ne peut être sûre et certaine, si les divers objets qu’elle embrasse ne sont toujours les mêmes et ne persistent invariablement dans le même état. Or de pareils objets sont les êtres par excellence; et, si d'autres objets différents de ceux-là sont aussi nommés êtres, c'est à cause de la participation qu'ils ont à la nature des premiers, et en cela seulement. De plus, ces objets sont les choses immatérielles; car les choses de la matière sont changeantes et variables, conformément à la nature entièrement variable qu'elles tiennent de leur origine. (En effet, la matière embrasse tout; elle est tout en puissance ; elle se transforme en tout. Mais à côté d'elle sont les choses incorruptibles et immatérielles, invariables par cela même, et existant toujours de la même manière, telles que les quantités, les qualités, les figures, les grandeurs, et tout ce qui y ressemble. Ainsi un corps blanc varie et s'altère, mais la blancheur, considérée en elle-même, est invariable et inaltérable. Un cube d'airain peut être transformé en pyramide; mais le cube, en tant que figure, ne saurait se changer en une autre figure. Il en est de même de l'être ou de l'essence : l'être est essentiellement immuable ; jamais la forme d'une tête de cheval ne se changera en guêpes; mais la matière de la tête peut très bien se changer en guêpes.[7] De même, les passions et les affections, considérées en elles-mêmes, sont immuables et invariables; cependant elles participent de la nature des corps qui leur servent de substratum.) Tels sont donc avant tout les objets dont la science constitue la philosophie, objets auxquels il faut joindre secondairement ceux qui participent des propriétés des premiers, c'est-à-dire les corps. De sorte que, pour le philosophe et l'homme instruit, l'accident, la manière d'être, est une chose plus importante à analyser que la substance : parce que c'est dans la manière d'être que réside l’être. Ainsi ne demandez pas au philosophe ce que c'est, par exemple, que dix colonnes, ce que c'est que quatre éléments ; mais demandez-lui ce que c'est que dix, ce que c'est que quatre : car les colonnes, les éléments, sont la substance; tandis que l'accident réside dans le nombre dix, dans le nombre quatre : le nombre des choses est précisément leur manière d'être. C'est donc parce que nous ne pouvons connaître certaines choses par elles-mêmes, et à moins de les avoir étudiées sur quelque substance où elles se rencontrent, que nous appelons les unes êtres par excellence, et que nous ne donnons le même titre aux autres que par extension.
Parmi les êtres ainsi nommés, soit par excellence, soit par extension, c'est-à-dire parmi les objets, soit intellectuels, soit sensibles, les uns forment un seul tout unique et continu, et on les nomme proprement grandeurs; les autres sont composés d'objets distincts et simplement rapprochés, et on les appelle nombres[8] : ce sont donc là deux aspects sous lesquels la philosophie doit considérer la science des êtres. Mais toute grandeur et tout nombre est infini de sa nature : car le nombre commence par une valeur bornée, et s'étend à l'infini; et la grandeur, présentant toujours un tout limité, peut cependant être partagée indéfiniment sans jamais cesser d'être entière. Mais les sciences s'appliquent aux choses finies, et nullement aux choses infinies; une science traitant de la grandeur absolue ou du nombre absolu serait impossible : d'un côté comme de l'autre, il faut que l'objet soit limité: ce sera, du côté du nombre, la quotité; du côté de la grandeur, la quantité.
Ainsi donc, parmi les grandeurs, les unes sont continues, les autres discontinues. Or la quantité discontinue fournit la matière de deux sciences, l'arithmétique, et l'harmonique ou musique; et la quantité continue en produit deux autres, la géométrie et l'astronomie. En effet, la quantité discontinue peut être considérée, soit en elle-même, et elle donne lieu à l'arithmétique, soit par son rapport à une autre quantité, et il en résulte l'harmonique. Car c'est en eux-mêmes que l'on considère le nombre trois, le nombre dix, le pair, l’impair; et c'est par rapport à un autre nombre que l'on considère le double, le triple, etc. La quantité continue, de son côté, tantôt se trouve dans un corps immobile, et elle produit la géométrie (car la terre est immobile comme centre de l'univers) ; tantôt elle réside dans un corps en mouvement, et elle forme le sujet de l'astronomie (car le ciel se meut, il se meut éternellement, ainsi que tout ce qu'il embrasse). C'est pourquoi Archytas de Tarente, commençant à traiter de l'harmonique, s'exprime à peu près ainsi : « Ceux-là me paraissent avoir eu sur les mathématiques une opinion également belle et juste, qui, les appliquant à tout ce qui existe, ont pensé que leur emploi était d'établir les principes exacts de chaque chose : car ils ont dû alors, pour être conséquents, non seulement considérer chaque objet dans son entier, mais encore l'étudier à fond dans toutes ses parties; et c'est ainsi qu'ils nous ont dotés de belles connaissances sur la géométrie et l'astronomie, sur l'arithmétique, et encore plus sur la musique. Ces sciences, en effet, sont comme deux couples de sœurs jumelles, semblables à ces organes que nous possédons en double : les deux faces principales de l'être semblent s'y refléter de l'une à l'autre. » Telles sont les paroles d'Archytas, paroles par lesquelles il fait voir que les quatre sciences mathématiques forment un tout unique et identique : car ce qu'il nomme les deux faces principales de l'être n'est autre chose que la continuité et la discontinuité, deux branches issues d'un même tronc, de la quantité; il les nomme principales, parce que toutes les autres qualités en dérivent: car de la discontinuité naissent tous les nombres, et de la continuité toutes les grandeurs.
Maintenant, que la première des sciences mathématiques soit l'arithmétique, c'est ce que l'on va voir bien clairement. Car, en premier lieu, Pythagore dit que l'essence est un nombre, un nombre qui, dans la pensée de l’Artiste-Dieu, préexistant à tous les autres, est comme la raison universelle et exemplaire, le paradigme et l'archétype, où cet artisan de l'univers prenant son terme de comparaison et son modèle, imprime à la matière toutes les qualités qui résultent d'une fabrication accomplie, lui communiquant ainsi quelque chose de ses propres perfections, quelques traits de sa propre image. Aussi Platon dit-il que les idées sont des nombres; et telles seraient, en effet, suivant un religieux langage, les pensées d'après lesquelles le grand Architecte, en donnant l'être à chacune de ses créatures, en a établi le fondement et modelé la forme.
En second lieu, l'arithmétique est, par sa nature, antérieure aux autres sciences, parce que, supposons-la détruite, les autres s'écroulent avec elle, tandis que, les autres étant détruites, elle, au contraire, pourra subsister encore. Ainsi, que l'on supprime le nombre trois, qui appartient à l'arithmétique, on n'aura plus le triangle, qui appartient à la géométrie. Que l'on supprime le rapport épitrite, qui appartient à l'arithmétique, on n'aura plus la quarte qui appartient à la musique. Que l'on supprime tel ou tel nombre, il n'y aura plus moyen de calculer, ni le mouvement du ciel, ni celui du soleil ou de tout autre astre.
Ainsi, l'arithmétique marchant avant les autres sciences, nous avons raison de la considérer et de la traiter comme la première de toutes.
Maintenant donc, l’arithmétique est la science théorique des propriétés des nombres, tant pour ce qui regarde leurs grandeurs, leurs formes, et les rapports qu'ils ont entre eux, que pour leur composition et leur décomposition.
Le nombre est une quantité discontinue, ou plutôt une quotité de choses distinctes, ou enfin un assemblage de monades ou unités.
La monade est ce par quoi chacun des êtres est dit un, même quand il fait partie d'un assemblage. C'est en partant d'elle comme d'une semence ou d'une racine éternelle, que, suivant deux directions opposées, la quotité va en augmentant, tandis que réciproquement la quantité va en diminuant.[9] On la nomme monade, parce que les nombres qui résultent de sa multiplicité ne changent pas et restent les mêmes (manent)[10] : ainsi une fois cinq fait cinq, et dix fois un font dix. La monade est une identité; car elle ne fait que s'identifier, soit en elle-même, soit dans les autres nombres : c'est ainsi que une fois un fait un, et que une fois quatre fait quatre. La dyade, au contraire (le nombre deux) est hétérogène; car elle se change elle-même, comme elle change tout nombre, en un nombre différent : car deux fois deux ne font pas derechef deux, mais bien quatre; et deux fois trois ne font pas de nouveau le nombre trois, mais le nombre six. .. Etc., etc.
[1] La lettre A est affectée au ms. 2536 qui ne contient que la Musique.
[2] Le mot τύχν; est pris, chez Platon, dans un tout autre sens; mais on serait tenté de croire que, dans Pachymère, et même dans Nicomaque, le texte du passage ait été altéré à dessein.
[3] Mot à mot : « en style badin comme en style sérieux ». — Nous avons en français la locution analogue : « à pied et à cheval.»
[4] Aristot. Métaph. XI, i; — Cf. XIII, vi). —Plat. Républ. VI, p. 509 et suiv.
[5] Cf. H. Martin, Études sur le Timée, t. I, p. 83 et 350.
[6] Id. ibid., p. 356.
[7] Je n'ai point à m'occuper ici de ce préjugé.
[8] Ce sont les quantités proprement dites, et les quotités; ou, en d'autres termes, les quantités concrètes et les quantités discrètes.
[9] Cf. Aristote, Métaph. X, vi.
[10] Il y a ici une subtilité fondée sur un jeu de mots que l'on ne peut reproduire en français.