![]()
CELSE
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
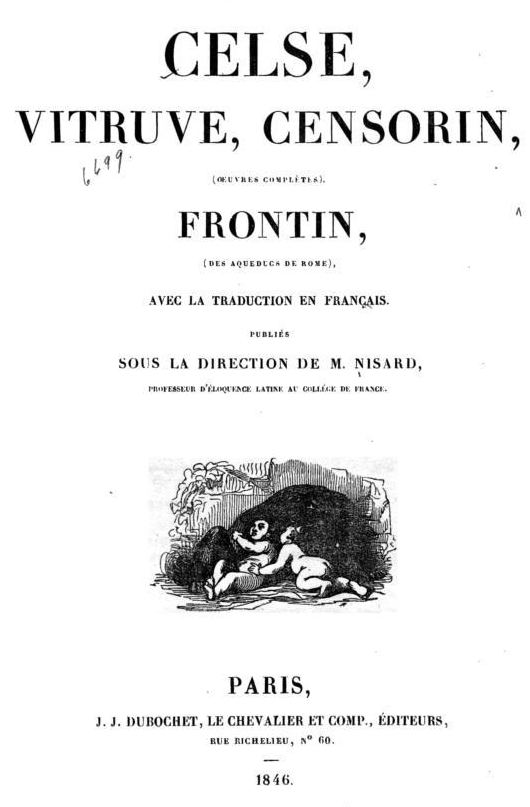
CELSE.
TRAITÉ DE LA MÉDECINE.
INTRODUCTION.Lorsqu'on s'est imposé la tâche de reproduire dans une langue moderne une œuvre médicale de l'antiquité grecque ou latine, et que l'on veut d'abord en pénétrer l'esprit pour lui assigner un rang dans l'histoire de l'art, on se trouve arrêté bientôt par de sérieuses difficultés qu'on avait à peine entrevues, et qui remplissent de doutes et d'hésitations cette première partie du travail. Peu habitués en effet à remonter vers le passé, ou, ce qui revient au même, à franchir le cercle d'idées qui nous est tracé par l'enseignement des écoles; également convaincus d'ailleurs de l'excellence de nos méthodes et de la supériorité des lumières actuelles, il nous paraît pour le moins inutile d'avoir à subir encore l'étude et l'interprétation des anciennes données scientifiques. A ces causes d'éloignement vient s'ajouter l'obscurité particulière aux vieux textes, c'est-à-dire aux langues mortes; obscurité que des altérations diverses et des lacunes plus ou moins graves augmentent infailliblement, et que certains commentaires ont parfois même le privilège de rendre impénétrable. Sont-ce là pourtant de légitimes motifs pour reculer devant toute exploration lointaine, et, de parti pris, rester indifférent au mouvement intellectuel des générations antérieures? La science moderne est-elle bien en droit de dire à la science antique, Je ne vous connais pas? et peut-il y avoir honneur et profit à renier l'héritage de ses ancêtres ? Poser la question ainsi, c'est la résoudre ; car tout s'enchaîne dans l'étude de l'homme ; et si nous éclairons du flambeau de l'histoire ce vaste champ de douleurs qui constitue le domaine de l'art, nous y reconnaîtrons l'empreinte de longs et profonds sillons, où le travail des siècles est venu s'ensevelir, et que nous avons à creuser encore. Ces efforts incessants et cette progression si lente s'expliquent suffisamment par l'objet même de nos recherches ; et la médecine, à laquelle nous demandons sans cesse les secrets de l'organisme, la raison de tout état morbide, la connaissance enfin des lois qui nous font vivre et mourir, la médecine, en ne répondant point à d'éternels problèmes, a par cela seul établi entre nous et l'antiquité un fonds commun de vérités et d'erreurs, où se trahit la faiblesse de l'esprit humain, mais où se révèle aussi sa puissance. La filiation d'idées que l'on cherche à suivre à travers les âges a donc cela d'imposant qu'elle reporte avec certitude la tradition médicale au delà des temps hippocratiques. En voulez-vous un témoignage solennel ? consultez Hippocrate lui-même, et vous serez saisi d'un recueillement involontaire, en songeant que le vieillard de Cos, à vingt-deux siècles de nous, écrivait déjà sur l'ancienne médecine. Loin de s'en dire le père, il déclare, avec son habituelle candeur, que dès longtemps elle est en possession d'un principe et d'une méthode qu'elle a trouvés ; il nous invite au respect du passé, et tout le premier s'incline devant les découvertes excellentes et nombreuses qui se sont produites dans le long cours des ans ; puis, jetant un regard sur les destinées de la science, il ajoute que le reste se découvrira, si des hommes capables, instruits des découvertes anciennes, les prennent pour point de départ de leurs recherches. Ainsi, sans le perdre dans les ténèbres où s'évanouit l'origine des choses, et sans qu'il soit besoin d'interroger ici les sources diverses de la médecine grecque, on peut tenir pour certain qu'Hippocrate et son école n'ont fait que suivre, en l'agrandissant, le chemin frayé devant eux par d'autres écoles et des travaux antérieurs. Cette vérité d'ailleurs a été mise hors de doute par un écrivain dont l'autorité n'est pas contestable en pareille matière; et c'est encore lui qu'il faut citer, si d'une vue générale on veut apprécier l'esprit d'observation et les tendances médicales de ces époques reculées. « Il fut naturel aux premiers médecins, dit M. Littré, et entre autres à Hippocrate, de comprendre et de noter d'abord la grande et universelle influence des agents du monde extérieur : climat, saisons, genre de vie, alimentation, toutes ces influences furent signalées à grands traits. Voir les choses d'ensemble est le propre de l'antique médecine ; c'est ce qui en fait le caractère distinctif, et ce qui lui donne sa grandeur, quand l'ensemble qu'elle a choisi est véritable; voir les choses en détail, et remonter par cette voie aux généralités, est le propre de la médecine moderne. En d'autres termes, faire prévaloir l'observation de tout l'organisme sur l'observation d'un organe, l'étude des symptômes généraux sur l'étude des symptômes locaux, l'idée des communautés des maladies sur l'idée de leurs particularités, telle est la médecine des temps anciens, et surtout celle d'Hippocrate. » Du médecin grec à l'auteur latin qui fait l'objet de cette notice, il ne s'est pas écoulé moins de quatre cents ans ; et, durant cette période, on voit les sciences et les lettres, abandonnant le sol natal qu'elles avaient si glorieusement fécondé, adopter pour seconde patrie la ville fondée par Alexandre en Égypte. C'est qu'en effet, par un hasard merveilleux, depuis Ptolémée Lagus, lieutenant du Macédonien, il s'était rencontré une longue suite de rois également jaloux d'assurer le sceptre de l'intelligence à la capitale de leur empire. Avec eux avait ainsi commencé une ère nouvelle, où l'inépuisable activité de l'esprit grec trouvait à s'alimenter sans relâche. Les livres, jusque-là si rares, si difficiles à connaître, si faciles à dénaturer, se multipliaient à prix d'or, et prenaient une forme certaine et définitive. Grâce à la protection de ces rois, la médecine entre autres n'avait plus à redouter les préjugés du vulgaire, et pouvait substituer à la dissection des animaux celle des corps humains. On connaît les découvertes d'Hérophile et d'Érasistrate, ces deux créateurs de l’anatomie ; et l'on sait aussi que les recherches purement empiriques des adversaires du dogmatisme servirent du moins à constater les propriétés d'un nombre infini de substances médicamenteuses. Le malheur fut que la médecine, alors égarée par le goût de la controverse et des subtilités théoriques, ne sut pas rattacher les faits nouveaux aux vérités anciennes; et l'on vit naître une foule de doctrines contradictoires qui, tout en s'éloignant des préceptes posés par Hippocrate, ne manquaient pas cependant de revendiquer pour elles, et chacune à l'exclusion des autres, l'autorité de ce grand nom. Quoi qu'il en soit, tous les écrits de cette époque, enveloppés dans de communs désastres, ont disparu depuis des siècles ; et, dans l'ordre des temps, Celse est le premier qui nous rende témoignage, comme l'ont fait plus tard Coelius Aurelianus et Galien, du mouvement scientifique qui animait l'école d'Alexandrie. Ces livres que nous n'avons plus, ils les ont lus et médités ; mais, pour Celse, on peut l'affirmer d'avance, ce n'est pas vers les dialecticiens et les controversistes de cette école fameuse qu'il est porté par son penchant naturel et la rectitude de son esprit; on sent bientôt que le génie d'Hippocrate l'attire, et qu'il reconnaîtra le pouvoir de cette profonde sagesse. Si maintenant nous passons à Rome, c'est de l'écrivain latin que nous recueillons aussi nos premières notions sur les doctrines célèbres d'Asclépiade et de Thémison, dont les ouvrages ont été de même livrés de bonne heure à la destruction; de sorte que, prenant la science au berceau, il la conduit jusqu'au méthodisme, dernier système qu'il ait pu connaître, et qui devait être dans toute sa splendeur quand il composa son traité de médecine. C'est, du reste, ici le lieu d'aborder avec réserve les douteuses particularités qui se rattachent au nom, au pays ainsi qu'à la profession de notre historien. Des trois noms, Aurelius, Cornélius, Celsus, que les manuscrits et les éditions imprimées s'accordent à lui donner, il en est un, c'est le premier, qu'il n'est pas inutile de rectifier. Daniel Leclerc et Bianconi font observer à ce sujet que les savants doivent être choqués de voir transformer, contre toutes les règles et au mépris du génie de l'antiquité romaine, le nom de famille Aurelius en simple prénom. A l'appui des raisons qu'ils font valoir, il faut dire que le plus ancien manuscrit (Codex Vaticanus VIII), en désaccord sur ce point avec tous les autres, porte en effet, en lettres très bien formées, Aulus Cornelius Celsus. Parmi les éditions imprimées, celle d'Alde Manuce (1528) présente aussi (mais c'est la seule) le mot Aulus écrit de la main d'un annotateur inconnu. Cornélius est sans doute le véritable nom ; mais il ne suit pas de là qu'on soit en mesure de prouver que Celse appartenait réellement à la famille Cornelia. L'histoire nous laisse à cet égard dans une ignorance complète ; et, pour se livrer à de pareilles recherches, il faudrait oublier d'abord avec quelle étrange prodigalité cette famille illustre livrait elle-même son nom à tous ceux qu'elle tenait à compter parmi ses clients ou ses affranchis. Le dictateur Sylla nous en offre un curieux exemple, puisque dix mille hommes obtinrent de lui la faveur de s'appeler Cornélius. Ainsi ce nom, pris isolément, n'a pas en lui le pouvoir d'attester la haute origine de l'écrivain qui nous occupe; mais il peut aider au besoin à constater son identité. Daniel Leclerc, Sprengel, et le Dictionnaire historique de médecine d'Éloy, placent en effet vers la même époque un autre Celse, Apuleius Celsus, médecin fameux, en grande estime sous Tibère. Scribonius Largus dit avoir étudié sous lui en même temps que Vettius Valens, qui s'acquit aussi de la célébrité comme médecin, et se fit de plus connaître par son commerce avec Messaline. Or, le Celse dont il est ici question avait de même laissé des écrits sur la médecine ; et, ce qui est plus digne de remarque, on lui attribue, comme au premier, un ouvrage sur l'agriculture ; enfin, pour compléter la ressemblance, le temps où il a vécu répond exactement à celui que les auteurs assignent pour la plupart à l'encyclopédiste latin. Si l'opinion du plus grand nombre est fondée voilà donc deux écrivains vivant à la même époque, portant le même nom, composant des ouvrages sur les mêmes sujets, et cultivant tous deux' l'art de guérir; car on verra plus loin que Celse était médecin. Il est vrai que le surnom qu'ils ont en commun est précédé chez l'un du nom d'Apuleius, et de celui de Cornélius chez l'autre : il convient d'ajouter aussi qu'on fait naître cet Apuleius en Sicile, et qu'on se borne à conjecturer que Cornélius était de Rome ; mais les rapports qu'on vient de signaler entre eux n'en subsistent pas moins ; et ces rapports sont tellement étroits, qu'ils éveillent au premier abord le vague soupçon d'une méprise. Sans refuser en aucune façon d'admettre qu'il y a là deux personnes distinctes, on dira simplement qu'on serait moins tenté de les confondre, si l'on pouvait tenir pour réelles les conjectures de Bianconi, parce que déjà la concordance des temps ne serait plus la même. Dans sa dissertation latine sur l'époque où Celse a vécu, cet érudit a voulu prouver, contrairement à l'opinion admise par les meilleurs critiques, que l'encyclopédie dont il n'est resté que le traité de médecine, au lieu d'appartenir au règne de Tibère, a vu le jour au commencement même du siècle d'Auguste. Presque victorieux sur ce point, il part de là pour se donner carrière; et, recueillant les éléments épars d'une biographie impossible, il arrive par mille ingénieux détours, et sans trop blesser la vraisemblance, à nous représenter son auteur non seulement comme l'ami d'Horace et d'Ovide, mais aussi comme le secrétaire et le compagnon de Tibère, chef suprême, sous l'empereur Auguste, de l'expédition militaire en Orient. Il peut être utile, on le conçoit, de se tenir en garde contre cette ferveur d'érudition qui l'entraîne à chercher au loin une certitude qui se dérobe à tout son savoir, et qu'il eût pu trouver parfois dans la lecture attentive de l'ouvrage, s'il n'eut quitté la réalité pour une ombre. C'est notamment ce qu'il fait quand il refuse à Celse la qualité de médecin. Déterminer la profession de cet écrivain d'après l'habileté dont il fait preuve en médecine, c'est, selon Bianconi, s'obliger en même temps à reconnaître en lui un agriculteur, un rhéteur et un homme de guerre, puisqu'on sait qu'il avait écrit, avec une égale connaissance du sujet, sur l'agriculture, la rhétorique et l'art militaire, il suffirait d'ailleurs de se rappeler que, chez les anciens, les études embrassaient la presqu'universalité des connaissances humaines. Que d'objets Caton n'avait-il pas traités dans ses écrits, outre la médecine, l'agriculture et la guerre? Et Varron, profondément instruit en tout genre de littérature, n'avait-il pas renfermé dans les siens presque tout ce qu'on pouvait savoir alors? Ajoutons encore, dit Bianconi, qu'autrefois la médecine était précisément la science que chacun était le plus désireux de connaître, et dont l'étude se traduisait en excellents préceptes qu'on retrouve dans les écrits des anciens. Lucrèce, Cicéron et Horace n'en parlent jamais qu'en parfaite connaissance de cause; il en est de même enfin de Virgile et d'Ovide. Ces raisons toutefois, pins spécieuses que solides, ne sauraient prévaloir contre le texte; et ce que l'auteur de la dissertation a le mieux établi, c'est qu'il était étranger lui-même aux études médicales. Il eut reconnu sans cela que, dans une foule d'endroits, Celse intervient personnellement, discute les difficultés qui se présentent, et les tranche souvent avec le coup d'œil et la décision de l'homme de l'art. Voici du reste quelques citations à l'appui : Neque ignoro quosdam dicere... quod non ita se habet, II, 14. Ego tum hoc puto tentandum, etc., III, 11. Ego autem medicamentorum dari potiones, et alvum duci non nisi raro debere, concedo, III,4. Quod Asclepiades recte praeterit; est enim anceps, III, 14. Tutius tamen est, etc., ibid. Ego utique, si satis virium est, validiora ; si parum imbecilliora auxilla praefero, III, 34. Ego sic restitutum esse neminem memini, VII, 7. In omni fisso fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferrameuta veniebant, quibus id exciderent; sed multo metius est ante emplastra experiri, VIII, 4. Assurément ce n'est pas là le langage d'un simple compilateur qui se contente d'enregistrer les faits, sans se réserver jamais le droit de remontrance et de critique. Mais à ces passages déjà cités on en peut joindre un autre beaucoup plus décisif encore, et qu'on a mal à propos laissé dans l'oubli, puisque, s'il est permis de s'exprimer ainsi, on y surprend l'auteur en flagrant délit de pratique médicale. Il est question dans ce passage de déterminer le moment où il convient d'accorder des aliments aux malades atteints de fièvre continue. « Les uns, dit Celse, III, 5, pensent qu'il faut préférer le matin, heure où les malades sont généralement plus calmes. Si en effet l'amélioration existe, c'est ce moment qu'on doit saisir, non parce que c'est le matin, mais parce qu'il y a rémission. Si à cette heure même, au contraire, le malade est sans repos, il est d'autant moins opportun de le nourrir que c'est la gravité du mal qui le prive du bénéfice ordinaire de la matinée ; et cela doit faire craindre que le milieu de la journée, où presque toujours l'état des malades s'exaspère, ne devienne plus alarmant encore. Aussi, d'autres médecins réservent dans ce cas les aliments pour le soir ; mais c'est précisément alors que la plupart des malades sont le plus accablés : il y a donc lieu d'appréhender que l'excitation produite par la nourriture n'ajoute à l'intensité du mal. Pour ces divers motifs, j’attends jusqu'au milieu de la nuit. Ob haec ad mediam noctem decurro. » Il parait difficile de rien trouver de plus formel; et l'on conviendra sans doute que Celse pouvait être à la fois encyclopédiste et médecin, par la raison que cette: même universalité de connaissances n'empêchait pas de retrouver dans Varron l'homme de guerre, et dans Caton l'austère censeur de la république. Mais, en pratiquant la médecine, Celse ne l'envisageait pas seulement comme un moyen de parvenir à la fortune ; et, quelques lignes plus loin, nous avons la preuve qu'il obéissait avant tout aux devoirs que cette profession nous impose. On comprend, dit-il (III, ibid.), que le même médecin ne saurait soigner à la fois un grand nombre de personnes, et que le meilleur praticien est celui qui ne perd pas de vue son malade. Mais ceux qui n'exercent que par intérêt, trouvant plus de profit à faire la médecine du peuple, embrassent volontiers des préceptes qui n'exigent aucune assiduité. Quant aux doctrines médicales de l'auteur, il a fallu, pour les interpréter dans le sens du méthodisme, faire subir au texte une violence inouïe, ou plutôt fermer volontairement les yeux à tous les passages qui résistent à cette explication. Après avoir lu la profession de foi qui se trouve en tête du traité de médecine, on a peine à s'expliquer l'erreur où sont tombés la plupart des historiens en rangeant Celse parmi les méthodistes, puisqu'il semble précisément avoir réservé pour eux toute la sévérité de ses jugements. Il développe d'abord, dans sa préface, les principales raisons sur lesquelles reposent le dogmatisme, l'empirisme et le méthodisme; puis, amené par cette exposition à manifester son opinion personnelle, il s'exprima ainsi : « On a tant écrit sur ces questions, qui, parmi les médecins, ont été souvent et sont encore l'objet des plus vives controverses, qu'il devient utile d'exposer les idées qui, selon nous, se rapprochent le plus de la vérité. Dans cette manière de voir, on n'adopte exclusivement aucune opinion, de même qu'on n'en rejette aucune d'une manière absolue ; mais on conserve un moyen terme entre ces sentiments contraires, et c'est en général le parti que doivent prendre, dans les discussions, ceux qui recherchent la vérité sans prétention, comme dans le cas présent. » Fidèle à cet esprit d'éclectisme, on le voit se préserver de l'entraînement des systèmes, et maintenir son indépendance envers les plus grandes renommées. Ainsi, malgré sa vénération pour Hippocrate, qu'il proclame le plus grand médecin de l'antiquité et le père de toute la médecine, il n'hésite pas à se ranger contre lui du parti d'Asclépiade, qui raille le vieillard de Cos sur ses jours critiques et ses nombres pythagoriciens. Mais le tour d'Asclépiade ne se fait pas attendre; et Celse, qui le prend aussi pour modèle en beaucoup d'endroits, ne craint pas néanmoins de lui reprocher des opinions inconséquentes et mensongères. Le médecin de Pruse se vantait, comme on sait, de guérir toutes les maladies tuto, celeriter et jucunde. Or, d'après lui, le meilleur remède contre la lièvre étant la fièvre même, il pensait que, pour abattre les forces du malade, il fallait l'exposer à la lumière, le fatiguer par l'insomnie, et lui faire endurer la soif, à ce point que, les premiers jours, il ne permettait pas même qu'on se rinçât la bouche. » Cela, dit Celse, prouve d'autant mieux l'erreur de ceux qui s'imaginent que sa méthode est agréable en toutes choses ; car si plus tard il cédait aux malades jusqu'à les livrer à leur intempérance, il n'est pas moins vrai qu'au début il se conduisait en bourreau. » S'agit-il des méthodistes? il fait vivement ressortir l'insuffisance de leur principe, et les déclare même inférieurs aux empiriques, attendu que ceux-ci embrassent du moins beaucoup de choses dans leur examen, tandis que les disciples de Thémison se bornent à l'observation la plus facile et la plus vulgaire, en ne considérant dans les maladies que l'état général de resserrement et de relâchement. « Ils agissent en cela (c’est toujours Celse qui parle) comme les vétérinaires, qui, ne pouvant apprendre d'animaux muets ce qui est relatif à chacun d'eux, insistent seulement sur les caractères généraux. C’est ce que font aussi les nations étrangères, qui, dans leur ignorance de toute médecine rationnelle, ne vont pas au delà de quelques données générales. Ainsi font encore les infirmiers, qui, se trouvant hors d'état de prescrire à chaque malade un régime convenable, les soumettent tous au régime commun. » Ces paroles, à coup sûr, n'accusent pas une partialité bien grande pour les méthodistes; mais il ne se montre pas moins dégagé de toute influence systématique, soit qu'il signale les écarts des dogmatiques ou des empiriques, soit qu'il ait à juger les idées d'Hérophile et d'Érasistrate ou les opinions contemporaines d'un certain nombre de praticiens, qui alors avaient un nom dans la science. Il résume enfin, de la manière suivante, sa profession de foi médicale : « Je pense que la médecine doit être rationnelle, en ne puisant cependant ses indications que dans les causes évidentes ; la recherche des causes occultes pouvant exercer l'esprit du médecin, mais devant être bannie de la pratique de l'art. Je pense aussi qu'il est à la fois inutile et cruel d'ouvrir des corps vivants, mais qu'il est nécessaire à ceux qui cultivent la science de se livrer à la dissection des cadavres ; car ils doivent connaître le siège et la disposition des organes, objets que les cadavres nous représentent plus exactement que l'homme vivant et blessé. » Après avoir fait connaître la voie qu'il veut suivre, il nous présente méthodiquement les préceptes diététiques d'Hippocrate et aussi ceux d'Asclépiade, insiste sur la promenade, les diverses sortes de gestation, les exercices du corps, les bains, les onctions, la lecture à haute voix ; prescrit des règles suivant les âges, les saisons, les tempéraments, les infirmités ; nous donne également l'histoire de la chirurgie depuis Hippocrate; ce qui seul le rendrait précieux; décrit le premier, pour nous du moins, un grand nombre d'opérations, et la taille bilatérale entre autres ; conseille aussi le premier la version par les pieds, mais seulement quand le fœtus est mort ; reconnaît quelque différence entre le bassin de l'homme et celui de la femme ; apprend à dilater l'orifice de l'utérus en engageant d'abord l'index, puis successivement toute la main, et, dans certains cas, les deux mains ; opère la délivrance de la femme en faisant des tractions ménagées sur le cordon ombilical pour éviter de le rompre, taudis que, de la main droite, il accompagne ce cordon jusqu'au placenta, qu'il détache. On arriverait sans peine à multiplier les exemples qui témoignent du bon sens pratique de l'auteur; mais ce qui est presque un sujet d'étonnement, c'est de rencontrer à la fois dans un livre de l'antiquité ce talent d'analyse qui tient compte des moindres détails, et ce jugement exercé qui sait placer les faits dans leur jour véritable, et donnera chacun sa valeur réelle. Il est vrai que cet esprit critique, venant ensuite à juger la science dans son ensemble, conduit souvent l'écrivain au doute ou même à l'incrédulité. Aussi le voyons-nous déclarer nettement que la médecine est un art conjectural, qui, dans bien des cas, est trahi non seulement par la théorie, mais encore par la pratique (liv. I, préf.). Dans un autre endroit il rappelle qu'au milieu de toutes les ressources de l'art, c'est encore le pouvoir de la nature qui se fait le plus sentir. A l'occasion des maladies des yeux, il exprime ainsi son peu de créance en des médicaments trop vantés : « En résumé, lorsqu'on a passé en revue tout ce que les médecins ont écrit à ce sujet, il est facile de reconnaître que, parmi les affections dont nous avons parlé, il n'en est pas une peut-être qu'on ne puisse guérir aussi bien par des remèdes très simples, et qui se trouvent pour ainsi dire sous la main. » (VI, 6, 39.) Ailleurs encore il lui échappe cette exclamation : « Tant il est vrai qu'en médecine les résultats ne sont pas toujours conformes aux règles les plus constantes! » Néanmoins, on a compris déjà que ce n'est pas là le scepticisme aveugle des gens du monde, esprits forts que la maladie rend si faibles, mais bien le doute philosophique d'un homme éclairé qui a le droit de douter, parce qu'il sait beaucoup, et qu'il n'en poursuit pas avec moins d'ardeur la recherche de la vérité. Le principal objet de cette rapide esquisse est sans doute de signaler l'importance historique et médicale du traité de médecine ; mais, il n'en résulte pas moins pour le traducteur l'obligation spéciale d'apprécier comme écrivain l'auteur qu'il a traduit. Cette obligation au surplus deviendrait facile à remplir, s'il suffisait pour cela de s'associer aux éloges que les anciens et les modernes ont prodigués tour à tour à l'encyclopédiste latin. Mais il faut l'avouer, il a des admirateurs passionnés, et qui sont par cela même suspects d'exagération. Son éditeur Targa ne craint pas de le placer bien au-dessus d'Hippocrate, avec cette restriction cependant qu'il n'entend parler que de sa supériorité dans l'art d'écrire. Boërhave, jugeant en même temps l'écrivain et le médecin, commence par établir qu'on donne chaque jour pour nouvelles quantité de choses qui sont dans les, ouvrages de Celse; puis il l'appelle le premier de tous les anciens et même des modernes en fait de chirurgie. Voici ce qu'en dit Fabrice d'Aquapendente dans la première partie de ses œuvres chirurgicales: Admirabilis Celsus in omnibus, quem nocturna versate manu, versare diurna consulo. Le savant Casaubon en fait un dieu, medicorum deus ; et d'autres érudits enfin le surnomment avec moins d'emphase le Cicéron des médecins. Depuis Columelle et Quintilien jusqu'à nous, les suffrages n'ont donc pas manqué ; et bien que pour la plupart ils s'adressent non moins au fond qu'à la forme ; et ne séparent pas la valeur scientifique du livre de sa valeur littéraire, on pourrait toujours, en s'occupant seulement de cette dernière appréciation, résumer tous ces éloges en trois mots : concision, clarté, élégance. Ces expressions, consacrées pour ainsi dire à l'œuvre de Celse, n'ont de vérité toutefois qu'autant que les sujets qu'il traite n'excèdent pas le pouvoir de la langue latine; car partout où se fait sentir la nécessité d'un langage technique, l'habileté de l'auteur, si grande qu'elle puisse être, ne saurait lutter contre l'insuffisance absolue du latin ; et de là vient qu'il est souvent difficile à comprendre, et plus difficile encore à traduire. En mettant ainsi l'écrivain hors de cause pour n'accuser que l'instrument dont il s'est servi, il faut dire pourquoi la médecine, ou, ce qui est également vrai, pourquoi les sciences, les arts et la philosophie ne rencontraient à Rome qu'une langue inhospitalière. On en trouve la raison suprême dans l'ignorance profonde où les Romains ont vécu pendant six cents ans. Adonnés uniquement au métier des armes, ils avaient pour tout le reste un mépris farouche ; et l'art de construire de grandes routes militaires est le seul qu'on puisse revendiquer pour le peuple-roi. Aussi, lorsqu'ils s'emparèrent des merveilles de la Grèce pour les transporter dans la ville éternelle, les conquérants obéirent plutôt à leurs instincts de rapine qu'à leur admiration pour des chefs-d'œuvre dont ils ignoraient le prix. Et pourtant ces déprédations eurent l'heureux effet d'attirer à Rome les philosophes, les savants, les gens de lettres, les artistes les plus célèbres de ce beau pays, qui, comme le dit Cabanis, ne pouvaient plus retrouver que dans la capitale du monde, les objets nécessaires à la culture de leur esprit et chers encore à leur imagination. Les vaincus devinrent alors les précepteurs de leurs maîtres ; et les Romains, frappés enfin de ces clartés nouvelles, se livrèrent avec ardeur à l'étude du grec. Avant l'avènement d'Auguste, cette étude était déjà si familière aux plus grands personnages de la république, que Lucullus tira au sort pour savoir en quelle langue il écrirait la guerre des Marses, et que Cicéron fit en grec une histoire de son consulat. En nous apprenant ailleurs que ses concitoyens avaient jusqu'à lui méprisé la philosophie, il se vante d'avoir su transporter en latin les termes delà langue grecque nécessaires à l'exposition de sa doctrine. Caton lui-même, implacable ennemi comme censeur des sciences et des lettres, qu'il cultivait avec passion dans la vie privée, Caton apprit le grec à quatre-vingts ans.[1] A la faveur des arts et de la philosophie, qui avaient acquis droit de cité, la médecine se vit à son tour relevée de l'interdiction qui pesait sur elle. Six siècles s'étaient écoulés, au rapport de Pline, avant qu'il fût permis aux médecins de s'établir à Rome ; mais du jour où les barrières qui leur fermaient l'entrée de la ville souveraine s'abaissèrent devant eux, ils accoururent en foule, tous fiers de leur origine grecque, et tous jaloux de conserver cette belle langue médicale à laquelle Hippocrate avait donné tant de puissance. Les choses d'ailleurs en étaient venues à ce point, qu'aux yeux mêmes des Romains consentir à parler latin était le plus sûr moyen d'enlever à l'art tout son prestige, et de faire perdre au médecin toute considération auprès des malades. Ce passage de Pline en fait foi : Solam hanc artium graecarurn nondum exercet romana gravitas in tanto fructu paucissimi Quiritium attigere, et ipsi statim ad Graecos transfugae : immo vero auctoritas aliter quam graece eam tractantibus, etiam apud imperilos expertesque linguae non est. (XXIX, 8.) A l'honneur de Celse, il faut dire qu'il est le seul écrivain d'origine italique qui ait entrepris de façonner sa langue maternelle au joug de la science médicale.[2] Mais aussi quels efforts ! comme il en sent l'impuissance, et quels aveux humiliants pour l’orgueil romain! Toujours privé de l'expression technique, il est obligé de définir ce qui n'a pas de nom dans sa langue; et le plus souvent, convaincu lui-même du vague et de l'insuffisance de sa définition, il appelle à son aide le quod Graeci vocant, c'est-à-dire, le mot propre qui n'a pas d'équivalent en latin, et qui peut seul donner l'idée de ce qu'il veut décrire. Nostris occabulis non est, dit-il ; et ce n'est que trop vrai. Vient-il, en effet, à parler de la situation des organes et des rapports qu'ils ont entre eux, il lui arrivera plus d'une fois de nous dire, ne pouvant mieux faire, que tel organe est voisin des autres parties, caeterae partes, ou, plus brièvement encore, et caetera. Le latin dans les mots brave l'honnêteté : c'est là du moins ce que dit le poète; mais rien n'était plus éloigné de la vérité au temps où Celse écrivait ; et c'est le grec qui seul avait alors le privilège de tout dire. Écoutez-le plutôt, s'excusant d'avoir à parler des maladies des parties honteuses : « Les Grecs ont, pour traiter un pareil sujet, des expressions convenables et consacrées d'ailleurs par l'usage, puisqu'elles reviennent sans cesse dans les écrits et le langage ordinaire des médecins. Les mots latins, au contraire, nous blessent davantage, et ils n'ont pas même en leur faveur de se trouver parfois dans la bouche de ceux qui parlent avec décence : c'est donc une difficile entreprise de respecter la bienséance, tout en maintenant les préceptes de l'art. » (VI, 18.) Que le latin nous ait laissé d'inimitables modèles en éloquence, en histoire, en poésie, cela ne fait pas question ; que plus tard il soit devenu la langue universelle du droit, alors qu'il ne s'agissait plus que de régler par des lois communes les intérêts de tant de nations asservies, on l'accordera sans peine : mais cela prouve-t-il qu'au siècle même où il jetait le plus vif éclat, le latin ait eu le magique pouvoir de créer spontanément, à la volonté de l'écrivain, le vocabulaire d'une science que les Romains ne voulaient pas connaître? N'est-il donc pas évident que ce n'est qu'à force de néologismes qu'on est parvenu, dans la suite des temps, à donner une valeur scientifique à la langue de Cicéron, de Tite-Live et d'Horace? De cette indigence du latin au point de vue médical, il résulte encore que le traducteur, continuellement aux prises avec les difficultés du sujet (puisqu'en effet il n'est pas facile de lire dans des théories oubliées), est de plus obligé d'errer, pour ainsi dire, à travers une cohue de mots impropres et de termes obscurs, ou tout à fait inintelligibles. Que sera-ce donc maintenant, si l'on tient compte des injures du temps, de l'ignorance des premiers copistes, des notes marginales admises dans le texte par intrusion, des erreurs typographiques, et des embûches enfin qui vous sont dressées par de mauvais commentaires? C'est avec raison que Choulant fait remarquer que Celse est de tous les auteurs de l'antiquité latine celui qui a le plus souffert de l'incurie des moines et des copistes. Il est à présumer que cet ouvrage étant pour eux moins facile à comprendre, leur paraissait aussi moins digne de leur attention. Mais ce qui ne saurait laisser aucun doute, c'est que les manuscrits actuellement connus nous sont venus d'une source unique, et qu'ils doivent tous émaner d'un autre manuscrit beaucoup plus ancien, qui serait depuis des siècles égaré ou détruit. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que tous en effet présentent une lacune semblable au chapitre XX du quatrième livre. Malheureusement, indépendamment de cette mutilation, il s'y rencontre bien d'autres fautes qui ont grandement exercé la patience et le savoir des éditeurs anciens et modernes. Quelles que soient encore aujourd'hui les imperfections du texte, il reste peu d'espoir de les faire disparaître ; car on semble avoir épuisé tous les moyens de révision que peuvent fournir l'histoire, la médecine et la philologie, venant en aide à la collation la plus attentive des manuscrits et des éditions imprimées. Qui songerait maintenant à refaire l'immense travail de Léonard Targa? Sur une vie de quatre-vingt-quatre ans, cet infatigable ouvrier de la science s'est senti le merveilleux courage d'en consacrer près de soixante à l'étude de Celse ; et deux éditions, publiées à quarante années de distance, attestent cette continuité d'efforts et cette préoccupation constante. Sa persévérance et ses lumières sont au surplus appréciées d'une manière convenable dans une édition française très ignorée du public, mais dont il sera nécessaire de parler tout à l'heure. « Ce savant éditeur, dit l'auteur de la préface, a prouvé que nul n'était plus capable de remplir la tâche qu'il s'était imposée. Connaissance approfondie du sujet et de la langue ; sage retenue envers le texte, pour peu qu'il fût intelligible ; sagacité exquise pour choisir parmi les variantes celles qui devaient remplacer les endroits manifestement corrompus, ou pour proposer des corrections supplétives lorsqu'elles devenaient indispensables ; exactitude et patience soutenues jusque dans les plus petits détails : telles sont les qualités qu'il a montrées dans cette œuvre de longue haleine, et qui l'ont placé parmi les critiques les plus estimables. Nous ne pouvions donc mieux faire que de reproduire un texte épuré avec tant de précaution et de discernement. » Ces éloges très mérités ne s'appliquent toutefois qu'à la première édition de Padoue (1769, in-4°), faite d'après la collation de Quatorze manuscrits et de toutes les meilleures éditions, depuis celle de 1478, la première en date, jusqu'à celle de Vulpi en 1750. Mais, comme on vient de le dire, quarante ans plus tard il fit paraître à Vérone (1810) une seconde édition in-4°, devenue rare aujourd'hui, et dans laquelle le texte, soumis à une révision sévère, subit encore de notables modifications. Pour ce nouveau travail il eut le secours d'un quinzième manuscrit dont il ignorait l'existence, et que Bianconi lui fit connaître. Ce manuscrite plus ancien de tous (xe siècle), est connu sous le nom de Codex Vaticanus VIII. Il put s'aider en outre de toutes les éditions qui avaient paru de 1769 à 1810; et comme complément du volume il donna le Lexicon Celsianum, qu'il annonçait depuis longues années. Malgré ces avantages réels, la première édition ayant prévalu dans l'estime des savants, l'hésitation n'était pas permise; mais on ne s'est pas cru dispensé pour cela de prendre en très sérieuse considération cette seconde publication d'un homme qui, à deux époques de sa vie si distantes l’une de l'autre, n'a pas craint, lui vieillard, de recommencer en quelque sorte l'œuvre si laborieuse de sa jeunesse et de sa virilité. On s'est donc imposé le devoir, tout en adoptant le texte de 1769, de le confronter rigoureusement à celui de 1810, afin de pouvoir, le cas échéant, corriger Targa par Targa lui-même. Il y a eu quelquefois nécessité de choisir entre deux ou plusieurs leçons, et l'on trouvera dans les notes les raisons déterminantes du choix auquel on a dû s'arrêter. Cet examen comparatif, qui n'avait été fait jusqu'ici pour aucune édition française, a réellement permis d'assurer le texte en divers endroits, et par suite d'éclaircir le sens de ces passages, troublé par des altérations manifestes. Toutefois, il y a ça et là telle partie du Traité de médecine où le désordre est si grand, que nul ne peut marquer la route qu'il faut suivre ; aussi, le traducteur sera-t-il moins que personne tenté d'accuser Targa d'exagération, lorsque, dans une lettre à Morgagni, il se plaint, notamment pour le huitième livre, de rencontrer un obstacle à chaque ligne. Il n'est pas hors de propos de faire remarquer ici que, pour les difficultés de ce genre, l'index de Targa, celui d'André Mathié, le dictionnaire de Forcellini, et autres, n'étant jamais d'un utile secours, il devient superflu de demander à ces vastes collections de mots les éclaircissements qu'on se croit d'abord en droit d'en attendre. Mais, sans insister plus longuement sur ce sujet, si par une transition naturelle on arrive à rechercher quels ont été jusqu'à ce jour les efforts tentés pour rendre l'auteur latin en français, on se trouve bientôt en présence de la seule traduction que nous ayons eue jamais, et qui, sous le nom de Henri Ninnin, parut en 1754. A ce médecin retient donc l'honneur de l'initiative; c'est là, sans aucun doute, un titre réel que personne ne peut songer à lui contester, et qui lui demeure légitimement acquis. Mais pour le petit nombre de ceux qui par devoir ou par inclination auront scrupuleusement rapproché l'auteur ancien de cette première version, il n'en sera pas moins évident que Celse, à bien des égards, restait encore à traduire. Henri Ninnin n'a pas joint d'édition latine à sa traduction, et dit avoir suivi celles de Vander Linden et d'Almeloveen, et s'être aidé beaucoup du manuscrit de la bibliothèque du Roi, ainsi que des observations de Morgagni. Qu'il ait fait en cela preuve de zèle, de patience et de discernement, on le reconnaîtra volontiers; mais toujours est-il que le texte qu'il s'est ainsi constitué pour son usage personnel est resté très inférieur à celui de Targa; de sorte que l'exactitude de la version française a dû nécessairement se ressentir en beaucoup d'endroits de cette infériorité manifeste. Ce n'est pas tout : à part les erreurs nombreuses dont on s'empressera de renvoyer la responsabilité à l'incorrection du texte, il en est d'autres, trop fréquentes encore, qu'il faut bien laisser au compte du traducteur. Quand le latin dit simplement, laevitas intestinorum quae leienteria vocatur, pourquoi Ninnin traduit-il ainsi : La lienterie qui dépend de la trop grande lubricité des intestins, (II, 1)? Pourquoi fait-il commettre à Celse d'énormes erreurs anatomiques, aux endroits mêmes où par hasard il est dans le vrai (VIII)? La partie chirurgicale surtout fourmille, on peut le dire, de fautes grossières, et qu'on ne devait guère attendre d'un médecin. Au livre VIII, 4, Celse, à l'occasion de la carie des os du crâne, traitée par la cautérisation avec le feu, dit qu'il se détache une petite portion d'os mince et étroite, que pour cette raison les Grecs appellent λεπίς, c'est-à-dire écaille. Ninnin transforme gravement ces esquilles en bourgeons charnus; et comme ces chairs (textuel) ont ordinairement la figure d'une esquille mince et étroite, les Grecs les appellent lépis. S'agit-il des ligaments des vertèbres? Celse, faisant toujours appel au quod Graeci vocant, ajoute que ces ligaments se nomment en grec τένοντες; (tendons). Au lieu de τένοντες, le texte suivi par Ninnin porte, à la vérité, καρότας; mais, sans s'embarrasser de la valeur du mot, il le traduit ingénument par karote. Ces exemples ne sont pas les seuls, et ce ne sont pas même les plus saillants. Quant au style, il suffit de feuilleter cette traduction au hasard, pour demeurer convaincu qu'il s'éloigne autant de la langue littéraire que de la langue scientifique; et de là naît un pénible contraste avec la précision élégante de l'auteur latin. Il doit être permis d'en fournir deux ou trois preuves, entre mille. Celse reproduit en ces termes un aphorisme d'Hippocrate : Cui vero sano subitus dolor capitis ortus est, ac somnus oppressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, injra septimum diem pereundum est. (II, 8.) Voici probablement comment tout le monde aurait rendu ce passage : « L'homme surpris en santé par un mal de tête subit, et qui tombe ensuite dans un sommeil profond et stertoreux dont on ne peut le tirer, doit périr vers le septième jour. » Mais laissons parler Ninnin : « Celui qui, étant en santé, est tout à coup attaqué d'une douleur de tête, et tombe ensuite dans un sommeil si profond qu'il ronfle et qu'on ne peut l'éveiller, périt au bout de sept jours. » Ailleurs, Celse signale comme un danger de passer brusquement de l'abstinence à la satiété : Neque enim convenit juxta inediam protinus satietatem esse. Le traducteur remplace la phrase latine si nette et si précise parcelle-ci : « Il n'est nullement à propos de se trop remplir, immédiatement après avoir souffert de la faim et de la soif. » (II, 16.) Ces tournures traînantes et ces locutions vulgaires, dont le traducteur ne se fait point faute, n'ont rien assurément qui puisse éblouir les lecteurs ; mais on sait du moins ce qu'il veut dire ; et s'il pèche contre l'élégance, il respecte encore les règles les plus essentielles de la langue. Or, c'est une limite dans laquelle Ninnin n'a pas toujours su se maintenir; et, s'il faut parler sans détour, il y aurait plus d'une page à citer où, parmi d'autres incorrections, les qui et les que sont prodigués avec une telle insouciance du régime de la phrase, que, sans l'assistance du latin, la traduction ne serait pas comprise. En dépit de ces imperfections qu'on ne signale ici qu'à regret et seulement parce que le sujet l'exige, le travail de H. Ninnin, si consciencieux du reste, aura toujours l'insigne mérite d'être le premier et, jusqu'à ce jour, le seul qui ait eu pour but de répandre parmi nous la connaissance du Traité de médecine. En 1821, le libraire Delalain, voulant publier une nouvelle édition de Celse, la remit aux soins d'un docteur en médecine, qui s'empressa d'adopter le texte de la première édition de Targa, et reproduisit en même temps la traduction de H. Ninnin. Ce médecin, dont on a cité plus haut le jugement éclairé sur le savant éditeur de Celse, eut, il est vrai, l'intention de rajeunir le français quelque peu gaulois de son prédécesseur ; mais, restant complètement asservi aux mêmes tours de phrase, il crut faire assez en remplaçant des expressions vieillies par d'autres moins surannées. Puis, cette tâche accomplie, il ne s'aperçut pas, ou ne voulut pas voir, qu'une traduction conforme aux éditions de Van der Linden et d'Almeloveen, ne pouvait que très imparfaitement répondre au texte de Targa ; or, ce défaut de correspondance devient d'autant plus sensible qu'il a mis le latin en regard. Il entreprit toutefois de traduire lui-même la dissertation de Bianconi, et la joignit à cette édition in-12. Ce médecin, au surplus, ne s'est point abusé sur la valeur de son travail, et n'a jamais voulu donner le change au public, puisqu'il nomme en toutes lettres Henri Ninnin, et se contente, pour lui, de l'initiale L…. On serait tenté néanmoins de le blâmer de cette réserve ; car elle n'a servi qu'à favoriser une troisième publication, dont il faut bien dire quelques mots en terminant cette notice. Comment, en effet, se soustraire à l'obligation d'avertir le lecteur qu'une certaine traduction du Traité de médecine, qui parut en 1824, et nous fut donnée comme entièrement nouvelle, n'est pourtant (bien que sous d'autres noms[3] et dans un format différent) que la reproduction de H. Ninnin, modifié par M. L...? C'est là ce que le plus simple examen fait voir avec une telle évidence, qu'il est peut-être inutile d'ajouter que toutes les erreurs de sens qu'on a cru reconnaître dans ces deux premières éditions ont été relevées en marge de la traduction que M. le docteur Ratier n'a pas cru devoir désavouer. « Quand ceux de Rhodes, dit un vieux livre, voulaient honorer la mémoire de quelqu'un, ils se contentaient de mettre une nouvelle tête sur une ancienne statue de leur ville. » C'est par un artifice à peu près semblable que le médecin dont il s'agit, désireux, à ce qu'il parait, de s'honorer lui-même, s'est contenté de placer sa tête sur les discrètes épaules de MM. L… et Ninnin, qui déjà ne font qu'un. Or, il suit de là que nous avons trois noms pour la même traduction ; ou, si l'on veut revenir à la comparaison, il y aura, d'après ce procédé bizarre, trois têtes pour un seul buste ; et bien des gens, alors, pourront s'imaginer que c'est beaucoup.
[1] Ce très court fragment d'une lettre adressée par Caton à son fils, qui étudiait alors à Athènes, pourra donner l'idée de la haine sauvage que cet esprit violent et borné portait a tous les Grecs, et notamment à ceux qui exerçaient la médecine : Nequissimum et indocile genus illorum ; et hoc puta vatem dixisse : Quandocumque ista gens suas litterat dabit, omnia corrumpet : tum etiam magis, si medicos suos huc mittet. Jurarunt inter se barbaros necare omnes medicina;et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit, et facile dispendant. Nos quoque dictitant barbaros, et spurcius nos quam alios opicos appellatione foedant. Intcrdixi libi de medicis. Voy. Pline, XXIX, 7.) [2] Il ne peut être question ici du latin africain de Coelius Aurelianus, qui n'est, comme ou sait que le traducteur du Grec Soranus. [3] Ceux qui connaissent la bienveillance naturelle de M. Fouquier n'hésiteront pas à le croire complètement désintéressé dans la question. Il n'est guère permis de douter ' qu'il aura voulu seulement appuyer de l'autorité de son nom les premiers essais d'un Jeune médecin. On a d'ailleurs une raison plus concluante de ne voir ici que M. Ratier : c'est que lui-même, dans l'Encyclopédie des gens du monde (article Celse), ne parle qu'en son propre et privé nom, et sans y joindre celui de M. Fouquier, de sa traduction nouvelle.
|