

OEUVRES D'HIPPOCRATE
DE L'
ART
Pour avoir le texte grec d'un chapitre, cliquer sur le chapitre
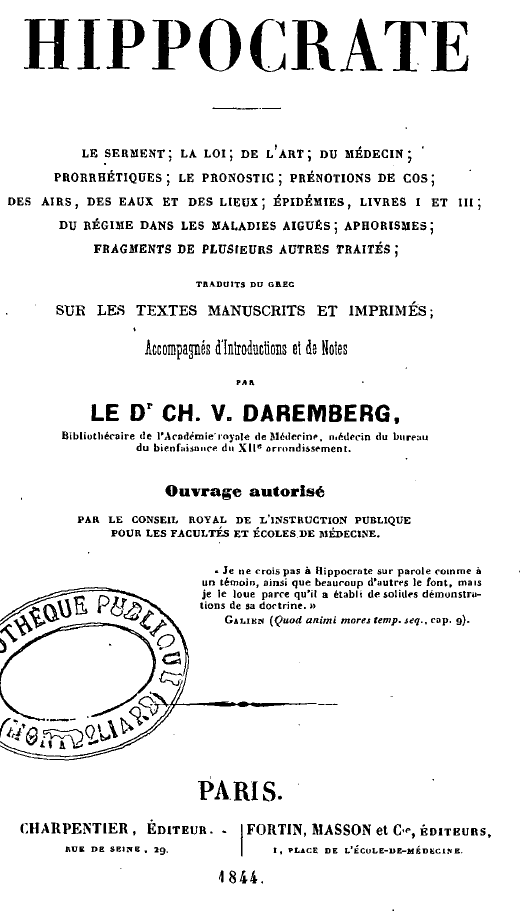
|
INTRODUCTION
De
tout temps il s'est trouvé des ignorants pour nier l'existence de l'art, et des
ingrats pour en déprécier les mérites, comme aussi de tout temps il s'est
trouvé de mauvais médecins pour le compromettre alors qu'ils devaient le
soutenir. L'école hippocratique s'est élevée souvent et avec force contre les
uns et contre les autres. Après ces plaidoyers antiques, beaucoup d'autres ont
été écrits en faveur de la médecine ; et de ces derniers le plus célèbre
est peut-être celui de Cabanis intitulé : du Degré de certitude en médecine.
Toutefois entre l'auteur du traité de l'Art et Cabanis, il y à cette différence
immense que le premier prouve l'existence de la médecine par les principes les
plus généraux et par une sorte d'abstraction , c'est-à-dire en posant l'art
en dehors de son application et de celui qui l'exerce ; tandis que le second,
raisonnant a posteriori, cherche d’établir que la médecine a un degré
positif de certitude, c'est-à-dire une existence réelle, en démontrant que
ses éléments reposent sur des bases certaines, que sa méthode est
rationnelle, et que ses dogmes ne sont pas si variables qu'on affecte de le
proclamer. 2°. Des malades ont été guéris en suivant un traitement médical, cela est incontestable ; mais, objecte-t-on, tous ne l'ont pas été ; donc le salut de ceux qui l'ont été doit être rapporté à la fortune. - Comment peut-on raisonnablement attribuer la toute puissance à la fortune quand on n'a pas voulu l'invoquer toute seule à son secours, quand on a fait intervenir un autre élément véritablement actif, la médecine ? 3°. C'est l'argument le plus complet et le plus probant. - Il y a des gens qui ont été guéris sans médecin. Cela est vrai : mais comment se sont-ils guéris, si ce n'est en évitant ou en faisant telle ou telle chose : or éviter ou faire telle ou telle chose, n'est-ce pas faire réellement de la médecine ? - Voilà donc l'existence de la médecine prouvée en dehors de son application méthodique. Mais ajoute notre auteur, pour établir la nécessité d'un art médical, comme le malade ne connaît pas la nature de son mal, comme le trouble de son esprit, comme l'affaiblissement de son corps ne lui permettent pas de diriger son traitement avec sûreté, il est indispensable qu'il se remette entre les mains d'un homme qui a spécialement étudié, et qui de plus a expérimenté ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter dans telle ou telle maladie. - Du reste, dit-il plus loin, s'il n'est pas indifférent d'appliquer plutôt un remède qu'un autre, de suivre tel ou tel régime ; si dans la médecine le bien et le mal ont leurs limites tracées, comment cela ne constitue-t-il pas un art ? Je dis qu'il n'y a pas d'art là où il n'y a rien de bien ni rien de mal ; mais quand ces deux choses se rencontrent à la fois, il n'est pas possible que ce soit le produit de l'absence de l'art. 4°. On nie l'existence de la médecine parce qu'elle n'entreprend rien pour les maladies incurables ; mais cette objection est absurde, car la médecine n'est pas toute puissante, elle ne saurait aller au-delà des limites qui lui sont assignées par la nature ; autant vaudrait dire que l'art du forgeron n'existe pas, parce qu'il ne peut plus s'exercer quand le feu vient à manquer. L'auteur, poursuivant toujours la suite de son raisonnement, divise les maladies en maladies apparentes et en maladies cachées ; ces dernières sont les plus nombreuses ; l'obscurité de leur diagnostic tient tout à la fois à leur siège, à leur nature, et au peu de renseignements que le malade peut fournir sur son état. Telles sont les causes qui expliquent, d'une part, la circonspection du médecin, son embarras ; et d'une autre, le progrès que fait le mal, sans qu'on puisse l'entraver, faute de le bien connaître, et partant de pouvoir lui opposer les remèdes convenables. Celui donc qui est assez habile pour triompher de ces maladies, mérite bien plus d'honneur que celui qui s'attaque aux maladies incurables. Ces considérations sur les maladies cachées montrent encore quelle importance l'auteur donne au diagnostic ; car il soutient que si l'art est capable de découvrir le mal, il est aussi capable de le guérir. Ce principe est un pas immense dans l'étude et dans l'application de l'art ; il marque un très grand progrès sur la véritable médecine de l'école de Cos, qui, tout attachée à la contemplation et à la description des symptômes ainsi qu'à l'étiologie générale, s'occupait bien plus de prévoir et d'annoncer l'issue d'une maladie que de reconnaître les désordres qu'elle produisait dans l'organisme. Je ne terminerai pas cette analyse sans faire ressortir tout ce qu'il y a d'ingénieux et de véritablement pratique dans la méthode artificielle de diagnostic que l'auteur propose pour forcer la nature à révéler les signes qui semblent vouloir se dérober aux investigations du médecin. Le principe de celte méthode explorative est demeuré dans la pratique de la médecine et de la chirurgie ; son application seule a été modifiée par les progrès de la science. Comme on le voit par ce qui précède, le traité de l'Art est l'un des plus profonds et des plus curieux de la collection hippocratique. Il est l’œuvre d'un philosophe et d'un médecin distingué ; il serait donc très intéressant pour l'histoire de la science d'en déterminer la date. Cette date ne doit pas être très récente ; cependant elle me semble de beaucoup postérieure à celle des écrits qu'on peut légitimement attribuer à Hippocrate ; je ne puis qu'indiquer ici les raisons sur lesquelles je me fonde. J'ai déjà montré que l'importance donnée au diagnostic détachait franchement ce traité de la véritable doctrine hippocratique ; j'ai fait ressortir dans mes notes quelques particularités anatomiques qui prouvent des connaissances avancées ; je vais m'arrêter un instant sur les doctrines philosophiques que l'auteur a mises en avant pour soutenir son argumentation ; elles rattachent évidemment le traité de l'Art à l'école d'Aristote ; et si cet opuscule ne reproduit pas dans toute son intégrité la pure doctrine du maître, il retrace certainement celle de ses élèves immédiats. L'auteur hippocratique rattache à εἶδος ( la forme, l'objet générique), à οὐσία (la substance ), à peu près les mêmes idées que le chef du péripatétisme ; comme lui, il nie que la spontanéité soit autre chose qu'un nom ; il n'accorde à la fortune, c'est-à-dire au hasard, qu'une part tout à fait secondaire dans la production des phénomènes; enfin, il regarde le pourquoi (τὸ διὰ τί) d'une chose, c'est-à-dire la cause qui fait qu'une chose arrive et qui la contient en réalité, comme ta source première de sa démonstration (01). Ces doctrines se sont légèrement altérées en passant du maître aux disciples ; mais il est impossible de méconnaître leur identité et leur véritable origine, car on ne les retrouve pas dans la science philosophique avant Aristote. Le traité de l'Art, dont Héraclide de Tarente avait commenté un mot (ὕποφρον) (02), est admis par Érotien (03) dans la collection hippocratique ; Galien n'y fait aucune allusion ; Suidas l'attribue, sans aucun fondement, â Hippocrate fils de Gnosidicus ; car il est très certainement postérieur à notre Hippocrate, et n'a aucun rapport direct avec les ouvrages universellement reconnus comme authentiques ; en sorte qu'on ne peut guère le rattacher positivement à ceux qui sont sortis de l'école de Cos. Toutefois je ne pense pas qu'on puisse, avec Spreugel (Apol. des Hipp., p. 84). le regarder comme appartenant à l'école médicale d'Alexandrie ; car Héraclide, qui vivait précisément â cette époque, ne l'aurait assurément pas commenté. M. Littré (t. ler, p. 356) a cherché à établir quelques rapprochements entre le traité de l'Art et ceux du Régime en trois livres, du Pronostic et des Airs. Ces rapprochements me paraissent un peu forcés pour ce qui regarde le traité du Régime, et inexacts pour ce qui est des deux autres. Je ne m'arrête qu'à ce dernier point. M. Littré dit : "Il (l'auteur du traité de l'Art) recommande aux médecins de ne pas donner leurs soins aux malades incurables, et cette recommandation se lit aussi dans le Pronostic. » Je n'ai rien trouvé dans ce traité qui justifiât cette assertion ; on lit seulement dans le préambule: « Il est impossible de rendre la santé à tous les malades; » proposition exprimée plus laconiquement par l'auteur du traité de l'Art, qui soutient (p. 13) "que la médecine ne peut pas tout." Mais cette analogie de pensée est bien banale et bien insignifiante. M. Littré dit encore : « Vers la fin (du traité de l'Art) il se trouve, sur le souffle vital, des idées fort analogues à celles qu'on lit dans le traité des Airs (Περὶ φυσῶν). L'auteur du traité de l'Art dit (p. 18) que les interstices laissées dans les chairs, sont remplies de pneuma dans l'état de santé, et d'ichor dans l'état de maladie, tandis que l'auteur du traité des Airs regarde comme anormale la présence de l'air dans les chairs, et lui attribue toutes sortes de désordres ; et cet air intérieur il l'appelle φύση et non πνεῦμα, mot dont il se sert pour désigner l'air en général. Toutefois, le traité des Airs a avec celui de l'Art un rapport de doctrine assez important qui a échappé aux minutieuses et infatigables explorations de M. Littré. On lit en effet au commencement du premier opuscule : « Celui qui connaîtrait les causes des maladies serait très capable d'y porter remède; » ce que l'auteur du traité de l'Art exprime en ces termes : « La même science qui fait découvrir les causes des maladies, enseigne aussi quels sont tous les traitements qui en arrêtent les progrès » (p. 20). Mais c'est surtout avec un passage qui semble égaré dans le traité des Régions dans l'homme, que celui de l'Art m'a paru avoir des rapports directs et curieux ; ce passage est trop intéressant pour que je ne le traduise pas ici : « Il me semble que la médecine, j'entends celle qui est arrivée à ce point d'apprendre [à connaître] le caractère [des maladies] et [à saisir] l'occasion, est inventée tout entière; en effet, celui qui sait ainsi la médecine n'attend rien du tout de la fortune, mais il réussira, qu'il ait ou non la fortune avec lui. La médecine tout entière est fortement assise, et les plus belles découvertes dont elle peut disposer ne paraissent pas avoir besoin de la fortune, car la fortune est indépendante, et ne se laisse pas commander ; elle ne se rend pas au désir de l'homme ; la science, au contraire, se laisse commander ; elle mène à d'heureux résultats, lorsque celui qui sait s'en servir, le veut ; après cela, quel besoin la médecine a-t-elle de la fortune ? S'il existe des remèdes qui aient une action évidente contre les maladies, ainsi que je le pense, les remèdes n'ont rien à attendre de la fortune pour procurer la santé, puisqu'ils sont remèdes. Mais s'il est utile d'avoir le concours de la fortune quand on les administre, ils n'ont pas plus d'action que ce qui n'est pas remède, et c'est grâce à la fortune qu'ils rendent la santé, quand on les oppose aux maladies. D'un autre côté (04) , celui qui bannit de la médecine et de tous les autres arts la fortune, en disant que ce ne sont pas ceux qui font bien une chose qui sont secondés par elle, me paraît être en opposition avec la vérité ; il me semble, au contraire, que ceux là seulement sont favorisés ou abandonnés par la fortune qui font bien ou mal une chose : être favorisé de la fortune, c'est bien faire, et c'est ce que font les gens habiles dans une science. Ne point être favorisé par elle, c'est ne pas bien faire ce qu'on ne sait pas ; et celui qui ne sait pas, comment en serait-il favorisé ? En supposant même qu'il le fût en quelque chose, ce succès ne vaudrait pas la peine qu'on en parlât ; car celui qui fait mal, ne saurait réussir complètement, puisqu'il manque dans d'autres choses qui sont convenables. DE L'ART.
1.
IL est des hommes qui se font un art de vilipender les arts. Qu'ils arrivent au
résultat qu'ils s'imaginent : ce n'est pas ce que je dis
; mais ils font étalage de leur propre savoir. Pour moi, découvrir
quelqu'une des choses qui n'ont pas été découvertes, et qui, découverte,
vaut mieux que si elle ne l'était pas, comme aussi porter à son dernier terme
une découverte qui n'est qu'ébauchée, me semble un but et une couvre
d'intelligence. Au contraire, s'attacher par un honteux artifice de paroles à
flétrir les découvertes d'autrui, non pour y corriger quelque chose, mais bien
pour dénigrer les travaux des savants auprès des ignorants, cela ne me paraît
être ni un but, ni une oeuvre d'intelligence ; mais bien plutôt une preuve de
mauvaise nature, ou d'impéritie, car c'est aux ignorants seuls que convient une
semblable occupation ; ce sont eux qui s'efforcent (mais leur puissance ne répond
pas à leur méchanceté) (de calomnier les ouvrages des autres s'ils sont bons,
et de s'en moquer s'ils sont mauvais. Que ceux qui en ont le pouvoir, que ce
soin peut toucher et qui y ont quelque intérêt, repoussent les individus qui
attaquent de cette manière les autres arts ; mon discours est dirigé seulement
contre ceux qui attaquent la médecine ; il sera violent à cause de ceux qui
veulent ainsi censurer, étendu à cause de l'art qu'il défend,
puissant à cause de la sagesse qui a présidé à la formation de cet
art.
9.
Pour ce qui est des autres arts, j'en
parlerai dans un autre temps et dans un autre discours. Quant aux choses qui
regardent la médecine, ce qu'elles sont, comment il faut les juger, on l'a déjà
appris par ce qui précède, ou on l'apprendra par ce qui suit. 10. Ainsi, pour les maladies externes, l'art doit être riche en ressources; cependant dans celles qui sont moins évidentes il ne doit pas en manquer complètement ; ces dernières maladies sont celles qui ont rapport aux os et aux cavités, et le corps n'en a pas seulement une, mais plusieurs. Deux de ces cavités reçoivent et rendent les aliments. Un plus grand nombre d'autres ne sont connues que de ceux qui en ont fait un objet d'études spéciales. Tout membre entouré de chair arrondie, appelée muscle, renferme une cavité. Toute partie qui n'est pas d'adhérence naturelle, qu'elle soit recouverte de chair ou de peau, est creuse et remplie de pneuma dans l'état de santé, d'ichor dans l'état de maladie. Les bras ont une chair semblable, les jambes en ont également, et les cuisses aussi. On démontre l'existence de ces interstices aussi bien sur les parties dépourvues de chair que sur les parties charnues. Tels sont le thorax, qui recouvre le foie ; le globe de la tête, où réside l'encéphale ; le dos, qui répond au poumon. Il n'est pas une seule de ces parties qui n'ait un vide, divisé par une multitude de cloisons presque semblables à des vaisseaux et contenant des matières utiles ou nuisibles. Il y a d'ailleurs une infinité de vaisseaux et de nerfs qui n'étant point au milieu des chairs, mais étendus le long des os, forment les ligaments des articulations. Or les articulations [sont des espaces] dans lesquels se meuvent des têtes d'os jointes ensemble ; il n'en est aucune qui n'offre une apparence écumeuse, qui ne présente dans son intérieur des anfractuosités que l'ichor (synovie) rend évidentes ; lorsque ces articulations sont ouvertes, l'ichor s'échappe avec abondance et en causant de vives douleurs. 11. Aucune de ces parties dont je viens de parler ne peut être perçue par la vue : aussi j'appelle les maladies [qui les attaquent] des maladies cachées, et l'art les juge ainsi ; il ne peut pas en triompher complètement, parce que ces parties sont cachées, mais il en triomphe autant que possible ; cela est possible autant que la nature du malade se prête à être pénétrée, et que l'investigateur apporte dans ses recherches des dispositions naturelles. Il faut en effet beaucoup plus de peine et de temps pour connaître ces maladies, que si elles étaient perçues par les yeux ; ce qui se dérobe à la pénétration des yeux du corps n'échappe pas à la vue de l'esprit. Toutes les souffrances que le malade éprouve, parce que son mal n'est pas promptement découvert, il ne faut pas les attribuer au médecin, mais à la nature du malade ou de la maladie. En effet, comme le médecin ne peut voir de ses propres yeux le point souffrant, ni le connaître par les détails qu'on lui donne, il le cherche par le raisonnement; car celui qui est atteint d'une maladie cachée, quand il essaie de la faire connaître aux médecins, en parle plutôt par opinion que de science certaine ; car s'il connaissait sa maladie il ne se mettrait pas entre les mains des médecins ; en effet, la même science qui fait découvrir les causes des maladies enseigne aussi quels sont tous les traitements qui en arrêtent les progrès : ne pouvant donc tirer des paroles du malade rien de clair et de certain, il faut bien que le médecin tourne ses vues ailleurs ; ainsi ces retards, ce n'est pas l'art qui les cause, mais la nature même du corps. Éclairé sur le mal, l'art entreprend de le traiter et s'applique à user plutôt de prudence que de témérité, de douceur que de force : et l'art, s'il est capable de découvrir le mal, sera également capable de rendre la santé au malade. Si le malade succombe dans une maladie connue, c'est qu'il a fait venir trop tard le médecin, ou que la rapidité du mal l'a tué. Car si la maladie et le remède marchent de front, la maladie ne marche pas plus vite [que le remède] ; si le mal devance le remède, il gagne de vitesse sur lui ; et le mal gagne de vitesse à cause du resserrement des organes au milieu desquels les maladies ne se développent pas à découvert ; elles s'aggravent à cause de la négligence des malades ; car ce n'est pas quand le mal commence, mais quand il est tout à fait formé qu'ils veulent être guéris. Aussi je regarde la puissance de l’art comme plus admirable lorsqu'il guérit quelques unes de ces maladies cachées, que lorsqu'il entreprend ce qu'il ne peut exécuter ; or, rien de semblable ne se voit dans aucun des arts mécaniques inventés jusqu'ici. En effet tout art mécanique qui s'exerce avec le feu est suspendu si le feu vient à manquer ; mais on le reprend aussitôt que le feu est rallumé. Il en est de même des arts qui s'exercent sur des matières faciles à retoucher : de ceux par exemple qui mettent en oeuvre le bois ou le cuir, qui s'exercent par le dessin sur le fer ou sur l'airain, et de beaucoup d'autres semblables : les ouvrages faits avec ou à l'aide de ces substances, bien qu'il soit facile de les retoucher, ne doivent pas être confectionnés plus vite qu'il ne convient pour l'être artistement ; et si un des instruments vient à manquer, on est obligé de suspendre le travail ; et bien que cette interruption ne soit pas favorable aux arts, néanmoins on la préfère. 12. Quant à la médecine, dans les empyèmes, dans les maladies du foie ou dans celles des reins et dans toutes celles des cavités, ne pouvant faire d'observations directes (et cela est très évident pour tous), elle appelle en aide d'autres ressources ; elle interroge la clarté et la rudesse de la parole, la lenteur ou la célérité de la respiration, la nature des flux qui sont habituels à chacun et qui s'échappent par telle ou telle voie ; elle les étudie par l'odeur, la couleur, la ténuité, la consistance ; elle pèse la valeur de ces signes qui lui font reconnaître les parties déjà lésées et deviner celles qui pourront le devenir. Quand ces signes ne se montrent pas et due la nature ne les manifeste pas d'elle-même, le médecin a trouvé des moyens de contrainte à l'aide desquels la nature innocemment violentée produit ces signes. Ainsi excitée, elle montre au médecin habile dans son art ce qu'il doit faire. Tantôt, par l'acrimonie des aliments solides et des boissons, il force la chaleur innée à dissiper au dehors une humeur phlegmatique, en sorte qu'il distingue quelqu'une des choses qu'il s'efforçait de reconnaître ; tantôt, par des marches dans des chemins escarpés ou par des courses, il force la respiration de lui fournir des indices certains des maladies ; enfin en provoquant la sueur il jutera la nature de la maladie par celle des humeurs chaudes exhalées. Les matières excrétées par la vessie donnent plus de lumières sur les maladies que les matières excrétées par les chairs. La médecine a aussi découvert certains aliments et certaines boissons qui développant plus de chaleur que les matières dont le corps est échauffé, en déterminent la fonte et l'écoulement, ce qui n'aurait pas lieu si elles n'étaient pas soumises à l'action [de ces aliments et de ces boissons]. Toutes ces choses, qui réagissent les unes sur les autres et les unes par les autres, traversent le corps et dévoilent la maladie. Ne vous étonnez donc pas que le médecin apporte tant de lenteur à asseoir son jugement sur une maladie, tant de circonspection pour en entreprendre le traitement, puisqu'il n'arrive que par des voies si éloignées et si étrangères à la connaissance parfaite de la thérapeutique. 13. Que la médecine trouve facilement en elle les moyens de porter des secours efficaces, qu'elle ait raison de refuser le traitement des maladies incurables, et qu'elle soigne avec un succès infaillible celles qu'elle entreprend, c'est ce que l'on peut voir dans ce traité, c'est ce que les médecins habiles démontrent encore mieux par des faits que par des paroles. Ne s'étudiant pas à bien discourir, ils pensent en effet inspirer une confiance plus solide en parlant plutôt aux yeux qu'aux oreilles.
(01) Cf. sur ce dernier point, Aristote : Dern. analyt.,
I, 13 ; II, 11, 12, dans l'éd. de M. B. Saint-Hilaire, 1. III, p. 78, 234 et
241. On verra que le διὰ τί de l'auteur hippocratique
est une corruption du τὸ διότι d'Aristote. L'élève avait
conservé la doctrine ; il avait oublié la formule
|