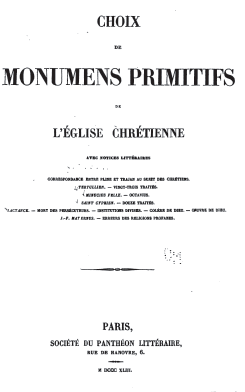
LACTANCE - LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
INSTITUTIONS DIVINES - DIVINAE INSTITUTIONES
LIVRE VI - LIBER SEXTUS.
DU VRAI CULTE - DE VERO CULTU.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
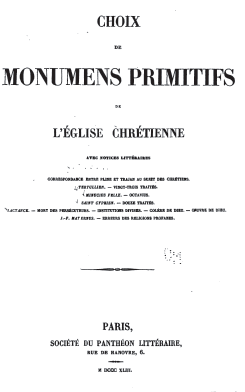
LIVRE VI - LIBER SEXTUS.
DU VRAI CULTE - DE VERO CULTU.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS
DIVINAE INSTITUTIONES
|
LIBER SEXTUS. DE VERO CULTU. CAPUT PRIMUM. De Dei veri cultu et innocentia, atque de cultu falsorum deorum. Quod erat officium suscepti muneris, divino Spiritu instruente, ac suffragante ipsa veritate, complevimus: cujus asserendae atque illustrandae causam mihi et conscientia, et fides, et ipse Dominus noster imposuit; sine quo nec sciri quidquam potest, nec explicari. Venio nunc ad id quod est summum operis hujus et maximum, ut doceam quo ritu, quove sacrificio Deum coli oporteat. Id enim est hominis officium, in eoque solo summa rerum, et omnis beatae vitae ratio consistit: quandoquidem propterea ficti et inspirati ab eo sumus, non ut coelum videremus et solem (quod Anaxagoras putavit), sed ut artificem solis et coeli Deum pura et integra mente coleremus. Quamvis autem praecedentibus libris, pro ingenii mediocritate defenderim veritatem; tamen ex ritu quoque ipso elucere vel maxime potest. Nihil enim sancta et singularis illa majestas aliud ab homine desiderat, quam solam innocentiam: quam si quis obtulerit Deo, satis pie, satis religiose litavit. Homines autem, neglecta justitia, cum sint omnibus flagitiis ac sceleribus inquinati, religiosos se putant, si templa et aras hostiarum sanguine cruentaverint, si focos odorati ac veteris vini profusione madefecerint. Quin etiam sacras dapes apparant, et exquisitas epulas, quasi aliquid inde libaturis offerunt. Quidquid aspectu rarum, quidquid opere aut odore pretiosum est, id gratum esse diis suis, non ex aliqua divinitatis ratione, quam nesciunt, sed ex suis cupiditatibus judicant; nec intelligunt terrenis opibus Deum non indigere. Nihil enim sapiunt, nisi terram; bonaque et mala solius corporis sensu et voluptate perpendunt. Hujus arbitrio, ut religionem ponderant, sic totius vitae suae acta disponunt. Et quoniam se semel a coeli contemplatione averterunt, sensumque illum coelestem corpori mancipaverunt, libidinibus fraena permittunt; tanquam secum ablaturi voluptatem, quam momentis omnibus capere festinant, cum animus ministerio corporis, non corpus ministerio animi uti debeat. Iidem maximum bonum judicant opes. Quas si bonis artibus assequi non possunt, malis assequuntur; fraudant, rapiunt, spoliant, insidiantur, abjurant. Nihil denique moderati aut pensi habent, dummodo auro coruscent, argento, gemmis, vestibus fulgeant, avidissimo ventrio pes ingerant, stipati familiarum gregibus per dimotum populum semper incedant. Sic addicti et servientes voluptatibus, vim vigoremque mentis extinguunt; et cum vivere se maxime putant, ad mortem concitatissime properant. Nam, sicut in secundo libro docuimus, coeli ratio in animo, terrae autem in corpore est. Qui bona negligunt animi, et corporis appetunt, in tenebris ac morte versantur, quae sunt terrae atque corporis; quia vita et lumen a coelo est: cujus quoniam expertes sunt, corpori serviendo, longe absunt ab intellectu rerum divinarum. Eadem miseros ubique caecitas premit: sicut enim qui sit verus Deus, ita qui sit verus cultus, ignorant. CAPUT II. De falsorum deorum et veri Dei cultu.
Mactant igitur opimas ac pingues
hostias Deo, quasi esurienti; profundunt vina, tanquam sitienti;
accendunt lumina, velut in tenebris agenti. Quod si suspicari, aut
percipere animo possent quae sint bona illa coelestia, quorum
magnitudinem, terreno adhuc corpore obvoluti, sensu capere non
possumus, jam se cum his officiis inanibus stultissimos esse
cognoscant. Vel si coeleste lumen, quod dicimus solem, contemplari
velint, jam sentient quam non indigeat lucernis eorum Deus, qui ipse
in usum hominis tam claram, tam candidam lucem dedit. Et tamen cum
in tam parvo circulo, qui propter longinquitatem non amplius quam
humani capitis videtur habere mensuram, tantum sit fulgoris, ut eum
mortalium luminum acies non queat contueri; et si paulisper
intenderis, hebetatos oculos caligo ac tenebrae consequantur: quid
tandem luminis, quid claritatis apud ipsum Deum, penes quem nulla
nox est, esse arbitremur? qui hanc ipsam lucem sic moderatus est, ut
neque nimio fulgore, neque calore vehementi noceret animantibus;
tantumque istarum rerum dedit ei, quantum aut mortalia corpora pati
possent, aut frugum maturitas postularet. Num igitur mentis suae
compos putandus est, qui auctori et datori luminis candelarum ac
cerarum lumen offert pro munere? Aliud vero ille a nobis exigit
lumen, et quidem non fumidum, sed (ut ait poeta) liquidum atque
clarum, mentis scilicet, propter quod a poetis φῶτες nuncupamur,
quod exhibere non potest, nisi qui Deum agnoverit. Illorum autem dii,
quia terreni sunt, egent luminibus, ne in tenebris sint: quorum
cultores, quia coeleste nihil sapiunt, etiam religiones, quibus
deserviunt, ad terram revocant. In ea enim lumine opus est quia
ratio ejus, et natura tenebrosa est. Itaque diis non coelestem
sensum, sed humanum potius attribuunt. Ideoque illis necessaria et
grata credunt esse, quae nobis; quibus aut esurientibus opus est
cibo, aut sitientibus, potu, aut veste algentibus, aut cum sol
decesserit, lumine, ut videre possimus.
Qua tu (inquit) mercede deorum Sentiebat videlicet non carne opus esse ad placandam coelestem majestatem, sed mente sancta, et justo animo, et pectore (ut ipse ait) quod naturali sit honestate generosum. Haec est religio coelestis, non quae constat ex rebus corruptis, sed quae virtutibus animi, qui oritur e coelo. Hic verus est cultus, in quo mens colentis seipsam Deo immaculatam victimam sistit. Id autem ipsum quomodo consequendum, quomodo praestandum sit, docebit hujus libri disputatio. Nihil enim tam praeclarum, hominique conveniens potest esse, quam erudire homines ad justitiam. Apud Ciceronem Catulus in Hortensio philosophiam rebus omnibus praeferens, malle se dicit vel unum parvum de Officio libellum, quam longam orationem pro seditioso homine Cornelio. Quae sententia non utique Catuli, qui fortasse illud non dixit, sed Ciceronis est putanda, qui scripsit. Credo, ut libros, quos de Officiis erat scripturus, commendaret: in quibus ipsis, nihil esse testatur in omni philosophia melius et fructuosius, quam praecepta vitae dare. Quod si hoc illi faciunt, quibus non est veritas cognita; quanto magis nos facere debemus, qui a Deo eruditi et illuminati possumus vera praecipere? Nec tamen sic docebimus, ut quasi prima virtutis elementa tradamus, quod est infinitum: sed tanquam docendum susceperimus eum, qui apud illos jam perfectus esse videatur. Manentibus enim praeceptis eorum, quae solent ad probitatem recte dare, ignota illis superstruemus, ad perficiendam consummandamque justitiam, quam non tenent. Ea vero, quae possunt cum illis esse communia, praetermittam; ne quid ab iis videar mutuari, quorum errores coarguere atque aperire decreverim. CAPUT III. De viis, et de vitiis et virtutibus; ac de coeli praemiis et infernorum poenis.
Duae sunt viae (Constantine imperator)
per quas humanam vitam progredi necesse est: una, quae in coelum
ferat; altera, quae ad inferos deprimat; quas et poetae in
carminibus, et philosophi in disputationibus suis induxerunt. Et
quidem philosophi alteram virtutum esse voluerunt, alteram vitiorum:
eamque quae sit assignata virtutibus, primo aditu esse et arduam, et
confragosam; in qua si quis, difficultate superata, in summum ejus
evaserit, habere eum de caetero planum iter, lucidum amoenumque
campum, et omnes laborum suorum capere fructus uberes atque jucundos.
Quos autem primi aditus difficultas deterruerit, eos in eam vitiorum
viam labi atque deflectere, quae primo ingressu sit quasi amoena,
multoque tritior, deinde cum in eam paulo ulterius processerint,
amoenitatis ejus speciem repente subduci: exoriri autem viam
praecipitem, nunc saxis asperam, nunc obductam sentibus, nunc
gurgitibus intercisam, vel torrentibus rapidam, ut laborare, haerere,
labi, cadere sit necesse. Quae omnia eo proferuntur, ut appareat in
virtutibus capiendis labores esse maximos, in perceptis autem
maximos fructus, et solidas atque incorruptas voluptates: vitia vero
quibusdam delinimentis naturalibus illicere animos hominum, et
inanium jucunditatum specie captos ad acerbas amaritudines
miseriasque perducere. Sapiens prorsus disputatio, si virtutum
ipsarum formas atque terminos scirent. Non enim didicerant, vel quae
sint, vel quid eas mercedis a Deo maneat; quod nos his duobus libris
docebimus. Quomodo autem hae viae vel in coelum tollant, vel ad inferna praecipitent, explicabo: aperiam quae sint virtutes quas philosophi nescierunt; tum earum quae sint praemia, simul etiam quae sint vitia, quaeve eorum supplicia, monstrabo. Nam fortasse aliquis expectet, ut separatim de vitiis ac virtutibus dicam, cum de bono aut malo disserentibus nobis, etiam quod est contrarium possit intelligi. Sive enim virtutes inseras, vitia sua sponte decedent: sive vitia eximas, virtutes ultro subibunt. Sic bonorum ac malorum constituta natura est, ut se invicem semper oppugnent, semper expellant: ita fit, ut neque vitia detrahi sine virtutibus possint, nec virtutes inseri sine detractione vitiorum. Has igitur vias longe aliter inducimus, quam a philosophis induci solent. Primum, quod utrique praepositum esse dicimus ducem, utrumque immortalem: sed alterum honoratum, qui virtutibus ac bonis praesit, alterum damnatum, qui vitiis ac malis. Illi autem in dexteteriore tantum via ducem ponunt, neque unum, neque perpetuum. Siquidem quemlibet doctorem bonae artis inducunt, qui a desidia revocet homines, et frugi esse doceat. Sed neque ingredi faciunt in eam viam, nisi pueros et adolescentes; videlicet quod artes discantur in his aetatibus. Nos autem omnis sexus, et generis, et aetatis, in hoc coeleste iter inducimus; quia Deus, qui ejus viae dux est, immortalitatem nulli homini nato negat. Forma quoque ipsarum viarum non ita est, ut illi putaverunt. Quid enim opus est Y littera in rebus contrariis atque diversis? Sed altera illa melior conversa est ad solis ortum, altera illa deterior, ad occasum; quoniam qui veritatem ac justitiam sequitur, is, accepto immortalitatis praemio, perenni luce potietur: qui autem ab illo malo duce illectus praetulerit vitia virtutibus, mendacium veritati, necesse est ad occasum et tenebras deferatur. Describam igitur utramque, et earum proprietates habitusque monstrabo. CAPUT IV. De viis vitae, de voluptatibus, necnon de incommodis Christianorum. Una est itaque virtutis ac bonorum via, quae fert, non in Elysios campos (ut poetae loquuntur), sed ad ipsam mundi arcem:
At laeva malorum Est enim criminatoris illius qui, pravis religionibus institutis, avertit homines ab itinere coelesti, et in viam perditionis inducit. Cujus viae species et figura sic est composita in aspectu, ut plana et patens, omni genere florum atque fructuum delectabilis esse videatur. In ea enim posita sunt omnia quae pro bonis habentur in terra: opulentiam dico, honorem, quietem, voluptatem, illecebras omnes; sed cum his pariter injustitiam, crudelitatem, superbiam, perfidiam, libidinem, cupiditatem, discordiam, ignorantiam, mendacium, stultitiam, caeteraque vitia. Exitus autem hujus viae talis est. Cum ventum fuerit ad extremum, unde jam regredi non licet, cum omni sua pulchritudine tam subito praeciditur, ut non ante quis fraudem prospicere possit, quam praecipitatus in altitudinem profundam cadat. Quisquis enim praesentium bonorum specie captus, et in his consequendis ac fruendis occupatus, non praeviderit ea quae post mortem secutura sunt, seque a Deo averterit: is vero ad inferos dejectus, in aeternam damnabitur poenam. Via vero illa coelestis, difficilis et clivosa proposita est, vel spinis horrentibus aspera, vel saxis extantibus impedita; ut cum summo labore ac pedum tritu, cumque magna cadendi sollicitudine sit cuique gradiendum. In hac posuit justitiam, temperantiam, patientiam, fidem, castitatem, abstinentiam, concordiam, scientiam, veritatem, sapientiam, caeterasque virtutes; sed simul cum his paupertatem, ignominiam, laborem, dolorem, amaritudines omnes. Quisquis enim spem suam porrexerit longius, et meliora maluerit, carebit his terrae bonis, ut expeditus ac levis difficultatem viae superet. Nec enim potest, qui se apparatu regio circumdederit, aut divitiis oneraverit, angustias illas vel ingredi, vel tenere. Unde intelligitur, idcirco malis et injustis facilius provenire quae cupiant, quia prona et declivis est eorum via: bonis autem, quae optent, difficile procedere, quia difficili et arduo itinere gradiuntur. Justus ergo, quoniam durum asperumque iter ingressus est, contemptui, derisui, odio sit necesse est. Omnes enim quos cupiditas, aut voluptas praecipites trahit, invident ei qui virtutem capere potuit; et inique ferunt id habere aliquem, quod ipsi non habent. Erit itaque pauper, humilis, ignobilis, subjectus injuriae; et tamen omnia, quae amara sunt, perferens. Et si patientiam jugem ad summum illum gradum finemque perduxerit, dabitur ei corona virtutis; et a Deo pro laboribus, quos in vita propter justitiam pertulit, immortalitate donabitur. Hae sunt viae quas Deus humanae vitae assignavit, in quibus singulis, et bona ostendit, et mala, sed ordine praepostero atque converso. In una enim monstravit temporalia prius mala cum aeternis bonis, qui est ordo melior: in altera, temporalia prius bona cum aeternis malis, qui est ordo deterior; ut quicumque praesentia mala cum justitia delegerit, majora et certiora consequatur bona, quam fuerunt illa, quae sprevit: quisquis autem praesentia bona praeposuerit justitiae, in majora et longiora incidat mala, quam fuerunt illa, quae fugit. Haec enim vita corporalis, quia brevis est, idcircò et bona ejus, et mala, brevia sint necesse est. Illa vero spiritalis, quae huic terrenae contraria est, quoniam sempiterna est, idcirco et bona ejus, et mala, sempiterna sunt. Ita fit, ut et bonis brevibus mala aeterna, et malis brevibus bona aeterna succedant. Itaque cum simul proposita sint homini bona, et mala, considerare unumquemque secum decet, quanto satius sit, perpetuis bonis mala brevia pensare, quam pro brevibus et caducis bonis mala perpetua sustinere. Nam sicut in hoc saeculo, cum est propositum cum hoste certamen, prius laborandum est, ut sis postmo-dum in otio; esuriendum, sitiendum, aestus, frigora perferenda, humi quiescendum, vigilandum, periclitandum est ut, salvis pignoribus, et domo, et re familiari, et omnibus pacis ac victoriae bonis perfrui possis: sin autem praesens otium malueris, quam laborem, malum tibi maximum facias necesse est; praeoccupabit enim adversarius non resistentem; vastabuntur agri, diripietur domus, in praedam uxor ac liberi venient, et tu ipse interficiere, aut capiere: quae omnia ne accidant, praesens commodum differendum est, ut majus longiusque pariatur. Sic in omni hac vita, quia nobis adversarium Deus reservavit, ut possemus capere virtutem, omittenda est praesens voluptas, ne hostis opprimat: vigilandum, stationes agendae, militares expeditiones obeundae, fundendus ad ultimum cruor, omnia denique amara et gravia patienter ferenda; eo quidem promptius, quo nobis imperator noster Deus praemia pro laboribus aeterna constituit. Et cum in hac terrena militia tantum homines laboris exhauriant, ut ea sibi pariant, quae possunt eodem modo perire, quo parta sunt: certe nobis nullus labor est recusandus, quibus id acquiritur, quod nullo modo possit amitti. Voluit enim Deus, qui homines ad hanc militiam genuit, expeditos in acie stare, et intentis acriter animis, ad unius hostis insidias vel apertos impetus vigilare; qui nos, sicut periti et exercitati duces solent, variis artibus captat, pro cujusque natura et moribus saeviens. Aliis enim cupiditatem insatiabilem immittit, ut opibus suis tanquam compedibus illigatos a via veritatis excutiat. Alios inflammat irae stimulis, ut ad nocendum potius intentos, a Dei contemplatione detorqueat. Alios immoderatis libidinibus immergit, ut voluptati et corpori servientes, ad virtutem respicere non possint. Aliis vero inspirat invidiam, ut suis ipsi tormentis occupati, nihil cogitent aliud nisi eorum, quos oderint, felicitatem? Alios inflat ambitionibus. Ii sunt, qui ad gerendos magistratus omnem vitae suae operam curamque convertunt, ut fastos signent, et annis nomen imponant. Quorumdam cupiditas tendit altius, non ut provincias temporali gladio regant: sed ut infinita et perpetua potestate dominos se dici velint universi generis humani. Quos autem pios viderit, variis implicat religionibus, ut impios faciat. Iis vero, qui sapientiam quaerunt, philosophiam in oculos impingit; uti specie lucis excaecet, ne quis comprehendat ac teneat veritatem. Sic hominibus obstruxit aditus omnes, et obsepsit vias, publicis laetus erroribus: quos ut discutere possemus, ipsumque auctorem malorum vincere, illuminavit nos Deus, et armavit vera coelestique virtute; de qua nunc mihi disserendum est. CAPUT V. De falsa virtute, et eadem vera; ac de scientia. Sed priusquam singulas virtutes exponere incipio, determinanda est ipsa virtus, quam non recte philosophi definierunt, quid esset, aut in quibus rebus; quid operis, quid habeat officii. Nomen itaque solum retinuerunt, vim vero, et rationem, et effectum perdiderunt. Quaecumque autem in definitione virtutis solent dicere, paucis versibus colligit et enarrat Lucilius, quos malo equidem ponere; ne, dum multorum sententias refello, sim longior quam necesse est.
Virtus, Albine, est, pretium
persolvere verum; Ab iis definitionibus, quas poeta breviter comprehendit, M. Tullius traxit officia vivendi, Panaetium Stoicum secutus, eaque tribus voluminibus inclusit. Haec autem quam falsa sint, mox videbimus, ut appareat quantum in nos dignatio divina contulerit, quae nobis aperuit veritatem. Virtutem esse dixit, scire quid sit bonum et malum; quid turpe, quid honestum, quid utile, quid minus. Brevius facere potuit, si tantum bonum ac malum diceret, quia nihil potest esse utile vel honestum, quod non idem bonum sit, nihil inutile ac turpe, quod non idem malum. Quod et philosophis videtur, et idem Cicero in tertio supradicti operis libro ostendit. Verum scientia non potest esse virtus, quia non est intus in nobis, sed ad nos extrinsecus venit. Quod autem transire ab altero ad alterum potest, virtus non est, quia virtus sua cuique est. Scientia igitur alieni beneficii est, quia posita est in audiendo. Virtus tota nostra est, quia posita est in voluntate faciendi boni. Sicut ergo in itinere celebrando nihil prodest viam nosse, nisi conatus ac vires suppetant ambulandi: ita vero scientia nihil prodest, si virtus propria deficiat. Nam fere etiam ii qui peccant, et si non perfecte, tamen quid sit bonum et malum sentiunt; et quoties aliquid improbe faciunt, peccare se sciunt et ideo celare nituntur. Sed cum eos boni et mali natura non fallat, cupiditate mala vincuntur ut peccent, quia deest illis virtus, id est cupiditas recta et honesta faciendi. Ex hoc igitur apparet, aliud esse scientiam boni malique, aliud virtutem, quod potest esse scientia sine virtute, sicut in plurimis philosophorum fuit. In quo, quoniam recte ad culpam pertinet, non fecisse quae scieris, recte voluntas prava, et vitiosus animus, quem excusare ignoratio non potest, punietur. Ergo sicut virtus non est bonum ac malum scire: ita virtus est bonum facere, malum non facere. Et tamen scientia sic cum virtute conjuncta est, ut scientia praecedat virtutem, virtus sequatur scientiam; quia nihil prodest cognitio, nisi et actio subsequatur. Horatius igitur paulo melius; Virtus est, vitium fugere; et sapientia prima, Stultitia caruisse. Sed inepte, quod eam contrario terminavit; ut si diceret: Bonum est, quod malum non est. Cum enim quid sit virtus, nescio, ne vitium quidem quid sit, scio. Utrumque igitur indiget definitione, quia natura rei talis est, ut utrumque aut intelligi, aut non intelligi sit necesse. Verum nos faciamus, quod ille debuit. Virtus est, iram cohibere, cupiditatem compescere, libidinem refrenare; id est enim, vitium fugere. Nam fere omnia, quae fiunt injuste atque improbe, ab his oriuntur affectibus. Si enim commotionis hujus, quae ira dicitur, impetus retundatur, omnes hominum contentiones malae sopientur; nemo insidiabitur, nemo prosiliet ad nocendum. Item si cupiditas temperetur, nemo terra marique grassabitur, nemo exercitum ducet, ut rapiat et vastet aliena. Item si ardor libidinum comprimatur, omnis aetas et sexus retinebit suam sanctitatem; nemo quidquam pudendum aut patietur, aut faciet. Ergo universa scelera et flagitia, his commotionibus virtute sedatis, ex hominum vita moribusque tollentur. Quae sedatio commotionum et affectuum hanc habet rationem, ut omnia recta faciamus. Omne igitur virtutis officium est, non peccare. Quo profecto fungi non potest, qui Deum nescit: quoniam ignoratio ejus, a quo bona oriuntur, imprudentem impingat in vitia necesse est. Itaque ut brevius et significantius utriusque rei summa officia determinem, scientia est, Deum nosse, virtus, colere: in illo sapientia, in hoc justitia continetur. |
LIVRE VI. DU VRAI CULTE. I. J'ai achevé, avec l'aide de l'Esprit-Saint, l'ouvrage que j'avais entrepris pour l'éclaircissement et pour la défense de la vérité. Le Seigneur, sans le secours duquel nous ne saurions ni la connaître, ni trouver des paroles propres à l'exprimer, m'ayant inspiré ce dessein, m'a aussi fait la grâce de me permettre de l'exécuter. Je viens maintenant au principal point de cette matière, qui consiste à montrer par quelles cérémonies et par quelle sorte de sacrifice Dieu veut être honoré. C'est le plus important devoir de l'homme, et d'où dépend sa souveraine félicité. Il a été créé non pour regarder le ciel et le soleil, comme Anaxagore se l'était faussement persuadé, mais pour adorer, avec une conscience pure, celui qui a fait le ciel et le soleil. Ce que je dirai ici du culte que nous devons rendre à notre maître, servira à la confirmation des vérités que j'ai déjà établies aussi solidement que mon peu de suffisance me l'a pu permettre. Cette majesté unique et sainte ne nous demande que l'innocence de nos mœurs. C'est le plus agréable sacrifice que nous puissions jamais lui offrir. Il y a des hommes qui s'imaginent avoir beaucoup de piété quand, après s'être souillés de toutes sortes de crimes, ils rougissent les temples du sang des victimes, ils allument du feu sur un autel, ils répandent du vin vieux en la présence de leurs dieux. Ils leur préparent aussi des festins, comme s'ils pouvaient manger. Ils jugent, non par l'idée qu'ils ont de la nature divine, car ils n'en ont aucune qui soit raisonnable, mais par la corruption de leurs passions, que tout ce qui est excellent et rare est agréable à leurs dieux, et ne font pas réflexion que ces dieux n'ont pas besoin de biens périssables. Ils n'ont de goût que pour les choses de la terre, et ne jugent du bien et du mal que par les sens extérieurs. Ils font dépendre leur religion, aussi bien que toute la suite de leur vie, du plaisir qu'ils y prennent. Depuis qu'ils ont détourné leur esprit du ciel, et qu'ils l'ont assujetti à leur corps, ils ne recherchent plus que la volupté, et la goûtent à tout moment, comme s'ils en pouvaient toujours jouir, et qu'ils ne dussent pas même en être privés quand ils seront privés de la vie. Ils considèrent les richesses comme un très grand avantage; et, quand ils ne les peuvent acquérir par de bonnes voies, ils les acquièrent par de mauvaises, par les fraudes, par les rapines, par les violences. Enfin, ils dressent des pièges pour tromper; ils se parjurent, et ils violent tout ce qu'il y a de plus inviolable, pourvu que l'or, l'argent et les pierreries reluisent sur leurs vêtements, que leur luxe entretienne abondamment leur intempérance, qu'une foule de gardes et de flatteurs les environnent sans cesse, et fendent la presse pour leur donner le moyen de passer comme en triomphe au milieu du peuple. Voilà comment la lâcheté avec laquelle ils se rendent esclaves du plaisir abat toute la vigueur de leur esprit, et les précipite à la mort dans le temps qu'ils croient jouir des douceurs de la vie avec une grande sécurité. L'âme se doit élever au ciel, comme je l'ai fait voir dans le second livre, au lieu que le corps est attaché à la terre. La lumière et la vie viennent du ciel. Ceux qui négligent les biens de l'esprit, et qui ne recherchent que ceux du corps, sont dans les ténèbres et dans la mort. Ils sont couverts d'un nuage obscur qui les empêche de voir le vrai Dieu, et de savoir quel culte il faut lui rendre. II. Ils immolent à Dieu de grasses victimes, comme s'il était pressé de la faim. Ils lui versent du vin, comme s'il était tourmenté de la soif. Ils allument des flambeaux devant lui, comme s'il était dans les ténèbres. S'ils avaient la moindre vue des biens célestes, dont la masse grossière et terrestre qui nous environne nous empêche de découvrir la grandeur, ils reconnaîtraient combien leur extravagance est extrême, quand ils s'imaginent pouvoir se rendre les dieux favorables par ces sortes de devoirs. S'ils regardaient le soleil avec quelque attention, ils jugeraient aisément que Dieu, qui a fait une si éclatante lumière pour l'usage de l'homme, n'a pas besoin de celle d'un cierge. Que si ce cercle qui, à cause de son grand éloignement, ne paraît pas beaucoup plus grand que la tête d'un homme, renferme un si vif éclat que nos yeux ne le sauraient supporter, quelle est la splendeur du jour qui environne ce Dieu qui n'a point de nuit? Il a tempéré la lumière et la chaleur du soleil, et les a mis au degré nécessaire pour mûrir les fruits et pour ne rien gâter des corps inférieurs. Peut-on croire qu'un homme, qui fait présent de cierges et de bougies à l'auteur et au dispensateur de la lumière, ait l'usage de la raison ? Il nous demande une lumière qui n'ait point de fumée, qui soit pure et claire, comme dit le poète : c'est la lumière de l'esprit, qui ne se trouve qu'en ceux qui connaissent Dieu. Les dieux des païens étant des dieux de la terre, ils ont besoin qu'on leur allume des cierges, afin qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Ceux qui les révèrent, n'ayant aucun goût pour les choses du ciel, leur rendent des devoirs qui ne s'élèvent jamais au-dessus de la terre. Sur la terre on a besoin de lumière, parce que, de sa nature, elle est sombre et ténébreuse. Les païens attribuent à leurs dieux un goût humain, au lieu de leur en attribuer un divin. Ils s'imaginent qu'ils aiment tout ce que nous aimons, et qu'ils ont les mêmes désire que nous, qui avons besoin de manger quand nous avons faim, de boire quand nous avons soif, de nous vêtir pour nous garantir du froid, et d'allumer des flambeaux pour nous éclairer quand le soleil nous a retiré sa lumière. Cette manière toute terrestre d'honorer les dieux est un des plus forts arguments par lesquels on prouve qu'ils ont autrefois vécu, et qu'ils sont morts ; car que peut-on s'imaginer de céleste dans le sang des victimes dont les païens infectent les autels? Se persuadent-ils que les dieux se repaissent de ce sang auquel les hommes auraient honte de loucher? Quiconque les en aura repus deviendra à l'heure même heureux, bien que ce soit un voleur, un adultère, un empoisonneur, un homicide. Il sera chéri et protégé des dieux, et il recevra de leurs mains libérales tout ce qu'il pourra souhaiter. Perse a eu grande raison de se railler de l'extravagance de ces superstitions, en demandant à ceux qui y étaient attachés: A quel prix prétendez-vous acheter l'attention des dieux et leurs augures favorables ? et espérez-vous l'obtenir en leur présentant les entrailles d'une victime avec du lait et de l'huile. Il voyait fort bien que, pour se rendre les dieux propices, il n'est point nécessaire de leur offrir la chair des animaux, mais une âme sainte et pure, un esprit juste et équitable, un cœur chaste et généreux. C'est là une religion toute céleste, qui consiste dans des vertus spirituelles, et qui n'a rien de la corruption de la terre. C'est là le culte sincère par lequel l'âme s'immole elle-même comme une victime. J'expliquerai, dans la suite de ce livre, de quelle sorte cette immolation doit être faite ; car il n'y a rien de si excellent ni de si conforme au devoir d'un homme que d'apprendre aux autres le moyen d'acquérir la vertu. Catulus préfère, dans un dialogue de Cicéron, intitulé Hortensias, la philosophie à toutes choses, et témoigne qu'il aimerait mieux avoir composé le petit livre sur les devoirs de la vie civile, qu'une longue oraison pour un séditieux comme Cornélius. Je me persuade que c'était là le sentiment de Cicéron plutôt que de Catulus, qui n'a peut-être jamais rien dit d'approchant, et qu'il avait dessein de donner, comme par avance, une haute idée des livres des Offices qu'il méditait de composer, et dans lequel il a témoigné depuis que, dans toute l'étendue de la philosophie. Il n'y a rien de si utile que la morale et les préceptes qui règlent la vie. Si des hommes, à qui la vérité était cachée, ont entrepris d'instruire les autres, n'avons-nous pas plus de droit de l'entreprendre, nous qui avons été instruits et éclairés par Dieu même. Nous ne commencerons pas néanmoins par les premières leçons que l'on donne à ceux qui n'ont jamais entendu parler de la vertu; ce serait un travail infini. Nous supposerons les notions que les païens donnent à ceux qu'ils reçoivent dans leur école, et sur les fondements qu'ils ont posés nous élèverons l'édifice de la justice chrétienne à laquelle ils n'ont aucune part. Je passerai sous silence les règles qui leur peuvent être communes avec nous, de peur d'être accusé d'emprunter des preuves à ceux dont je réfute les erreurs. III. Il y a deux chemins, très grand empereur, par l'un ou par l'autre desquels il faut indispensablement que les hommes passent. Par l'un on monte au ciel : par l'autre on descend dans l'enfer. Les poètes et les philosophes ont fort célébré l'un et l'autre par leurs vers et par leurs disputes. Les philosophes ont prétendu que l'un était le chemin de la vertu et l'autre le chemin du vice; que l'entrée du premier est difficile et embarrassée; mais que, dès que l'on a surmonté cette difficulté, on trouve tout le reste aisé et on entre dans une agréable plaine où l’on trouve de quoi se récompenser de son travail. Ceux qui épouvantés de cette première difficulté quittent ce chemin, en prennent un autre dont rentrée paraît beaucoup plus agréable et qui est frayé par un plus grand nombre de personnes ; mais dès que l’on est un peu avancé, toute la beauté de l'entrée disparaît et on n'y rencontre plus que des roches, des précipices, des buissons, « les ravins et des torrents, et l'on n'y peut aller sans avoir de la peine, sans échouer souvent, sans glisser et sans tomber. Cette description ne tend qu'à montrer qu'il est difficile d'acquérir la vertu, mais que quand on la possède, on en tire des plaisirs solides et durables, au lieu que l'on ne trouve dans le vice que de l'amertume et du déplaisir, bien qu'il n'ait que trop d'attrait pour nous charmer et pour nous surprendre. Cette leçon serait sans doute fort utile si ceux qui la donnent savaient en quoi consiste la vertu, et où elle se termine. Mais ils n'ont jamais appris ni ce que c'est que la vertu, ni quelle récompense Dieu lui a promise, et c'est ce que j'ai dessein de montrer dans ce livre-ci. Comme ils ne savaient pas que les âmes sont immortelles, ou qu'au moins ils en doutaient, ils n'ont attribué ni au vice ni à la vertu que des peines et des récompenses temporelles. Tout le discours qu'ils font sur les deux chemins se réduit ou à la Frugalité ou à la débauche. Ils disent que le cours de la vie humaine est semblable à un Y; que quand les jeunes gens sont arrivés à l'endroit où le chemin se divise en deux, ils échouent et doutent dans le quel ils doivent s'engager. S'ils trouvent un guide sage et fidèle qui les délivre de leur doute, et qui leur montre le bon chemin, c'est-à-dire que s'ils ont étudié ou la philosophie, ou l'éloquence, ou les belles-lettres. Ils s'adonneront à l'honnêteté et à la vertu; ce qui ne se peut faire sans une peine Incroyable. Que s'ils ne trouvent point de guides, ils s'engagent dans le chemin qui est à main gauche et qui paraît le plus beau, c'est-à-dire qu'ils s'abandonnent à l'oisiveté et à la débauche qui leur semblent d'abord fort agréables; et quand ils ont perdu leurs biens et leur réputation, ils vivent dans l'infamie et dans la misère. Voilà comment les deux chemins dont nous parlons n'aboutissent qu'au corps et à la vie présente selon les descriptions que les philosophes nous en ont laissées. Peut-être que les poètes en auront parlé plus raisonnablement. Au lieu de tracer ces routes-là sur la terre, comme ont fait les philosophes, ils ont feint qu'elles étaient en enfer et se sont trompés en ce qu'ils ont proposé des chemins aux morts qui ne marchent plus. Les uns et les autres ont dit quelque chose de bien et de mal, et ont sans doute manqué, en ce qu'ils n'ont pas tous mis ces deux chemins dans la vie et ne les « ni pas terminés à la mort. Nous les expliquons mieux quand nous assurons que l'un de ces chemins mène au ciel et l'autre en enfer; c'est-à-dire qu'il y a une vie éternelle promise aux justes et une peine éternelle réservée aux méchants. Je dirai comment ces deux chemins mènent l'un au ciel et l'autre à l'enfer. Je montrerai ces vertus quêtes philosophes n'ont point connues, et -je proposerai leurs récompenses. Je parlerai aussi des vices et des châtiments qu'ils méritent. Quelqu'un souhaiterait peut-être que je traitasse séparément des vérins et des vices; mais ce sont des contraires qui ne se connaissent jamais mieux que par leur opposition mutuelle. Ils se suivent et paraissent tour à tour : quand la vertu entre, le vice se retire; quand le vice revient la vertu s'évanouit. Les biens et les maux sont comme dans un combat perpétuel et se chassent réciproquement. Oh ne saurait éloigner le vice sans introduire la vertu, ni bannir la vertu sans rappeler le vice. La description que nous faisons de ces deux chemins est donc fort différente de celle qu'en font les philosophes. Nous mettons en tête de chaque chemin un guide immortel, avec cette différence que l'un préside aux vertus et est dans la gloire, au lieu que l'autre préside aux vices et est condamné aux supplices. Les philosophes ne mettent un guide qu'au chemin qui est à main droite; encore n'est-ce pas toujours le même ! C'est le premier qui se présente pour enseigner quelque art louable, pour détourner de l'oisiveté et pour exciter à la vertu. Ce guide ne montre le chemin qu'à des jeunes gens, parce que l'on n'apprend les arts que dans la jeunesse. Nous ouvrons au contraire le chemin du ciel à des personnes de tout âge, de tout sexe et de toute condition; parce que Dieu qui est à la tête de ce chemin ne refuse l'immortalité à personne. Les chemins ne sont pas disposés de la manière que les philosophes les ont décrits; car étant directement opposés ils ne sont point fidèlement représentés par la figure de l'Y. Le bon chemin regarde l'orient et le mauvais l'occident. Quiconque aura suivi la vérité et la justice jouira de la lumière de l'immortalité, au lieu que ceux qui, trompés par le guide infidèle, auront préféré le vice à la vertu et le mensonge à la vérité, tomberont dans l'obscurité et dans les ténèbres. Je décrirai ici les propriétés de ces deux chemins. IV.
Il n'y a qu'un chemin que les gens de bien puissent tenir ; ce
chemin mène non aux Champs Elysées, comme l'ont dit les poètes ; mais à la
région la plus élevée de l'univers. Il y a un autre chemin, à main gauche, qui
mène au lieu destiné pour le châtiment des crimes et aux enfers. C'est le chemin
du ca-lomniateur qui par les superstitions qu'il a inventées détourne les hommes
du salut et les engage dans la damnation. Ce chemin paraît d'abord large, uni,
paré de fleurs et de fruits. Dieu a mis à l'entrée tout ce que le monde prend
pour des biens : les richesses, les honneurs, le repos, les plaisirs; mais il y
a mis aussi l'injustice, la cruauté, l'orgueil, la perfidie, la débauche, la
discorde, l'ignorance, le mensonge, la folie et les autres vices. L'issue est
disposée de telle sorte que, quand on approche de la fin, on ne peut plus
retourner sur ses pas, on perd de vue les beautés dont on avait été charmée
d'abord, et on ne reconnaît que l'on a été trompé qu'au moment où l'on tombe au
fond d'un précipice. Cela veut dire que quiconque, s'étant laissé enchanter par
la beauté des créatures, s'arrête à en jouir et se détourne du créateur, sans
prévoir ce qui doit arriver après la mort, tombera dans l'enfer où il souffrira
un châtiment éternel. Voilà les deux chemins que Dieu a tracés aux hommes. Il a mis dans l'un et dans l'autre des biens et des maux ; mais il ne les y a pas mis selon le même ordre. Il a fait voir dans l'un des maux temporels et ensuite des biens éternels, et cet ordre est sans doute le meilleur. Il a fait voir dans l'autre des biens temporels et ensuite des maux éternels, et cet ordre est le plus misérable et le plus funeste qu'on se puisse imaginer. Qui-conque choisira des maux présents avec la justice possédera des biens plus stables et plus solides que ceux qu'il aura méprisés, au lieu que celui qui aura préféré les biens présents à la justice tombera dans des maux plus dangereux et plus terribles que ceux qu'il aura tâché d'éviter. Une vie aussi courte que celle que nous menons ici-bas ne saurait avoir de biens ni de maux qui soient de longue durée. Mais l'autre vie ne finissant point, les biens ou les maux qu'elle renferme ne peuvent finir non plus qu'elle. Les biens de courte durée sont suivis de maux qui n'ont point de fin, et les maux de courte durée de biens qui n'ont point de fin non plus. C'est pourquoi chacun, ayant la liberté de choisir ou les biens ou les maux qui sont proposés, doit considérer mûrement s'il ne lui est pas beaucoup plus avantageux de souffrir des maux de peu de durée pour acquérir des biens qui n'ont point de fin, que de s'attirer des maux qui n'ont point de fin, pour avoir voulu jouir de biens de peu de durée. Lorsque l'on est engagé dans une guerre, il en faut supporter les fatigues, dans l'espérance de goûter un jour les fruits de la paix. Il faut souffrir la faim et la soif, le froid et le chaud. Il faut veiller, coucher sur la terre, essuyer toutes sortes de dangers pour défendre sa famille, sa maison et ses proches, et pour pouvoir jouir ensuite de quelque repos. Ceux qui préfèrent en ces rencontres l'oisiveté au travail s'exposent à de grands malheurs. L'ennemi survient et les surprend hors d'état de se défendre; il porte le ravage sur leurs terres ; il pille leurs maisons ; il emmène leurs femmes et leurs enfants, et il les tue ou les prend eux-mêmes. Pour éviter ces malheurs, il faut se priver de commodités passagères. Il en faut user à peu près de la même sorte durant cette vie. Dieu a voulu qu'elle fût pleine de combats, et nous a suscité des ennemis pour exercer notre valeur. Il faut renoncer au repos et au plaisir de peur d'être surpris ; il faut être perpétuellement sur ses gardes, répandre son sang, et supporter les plus grandes fatigues avec d'autant plus de joie que notre général nous en promet une récompense éternelle. Puisque les soldats qui combattent sous les enseignes des princes qui ne sont que des hommes entreprennent d'extrêmes travaux pour gagner des biens qu'il est plus aisé de perdre que de gagner, nous ne devons refuser aucun travail pour gagner un bien que nous ne pouvons plus perdre dès que nous l'avons obtenu. Dieu qui nous a destinés à la guerre, veut que nous soyons toujours sous les armes, et que nous veillions sans cesse, et pour éviter les pièges de notre ennemi et pour repousser ses efforts. Il nous attaque comme un expérimenté capitaine par divers moyens, selon la connaissance qu'il a de nos inclinations et de nos mœurs. Il excite dans le cœur des uns un désir insatiable des richesses, qui sont comme des liens qui les embarrassent; il allume en d'autres le feu de la colère, pour les détourner du service de Dieu et pour les porter à la vengeance. Il en plonge d'autres dans les voluptés, afin qu'ils ne songent plus à la vertu. Il inspire l'envie à d'autres, afin qu'étant rongés par cette malheureuse passion, ils fussent leur tourment du bonheur de ceux qu'ils haïssent. Il en remplit d'autres d'ambition, afin qu'étant élevés aux dignités ils donnent toutes leurs pensées aux fonctions publiques, et ambitionnent de voir les années marquées de leur nom? Il y en a quelques-uns qui forment de plus vastes projets, qui méditent de rendre leur autorité perpétuelle et d'opprimer la liberté de leurs concitoyens. Quand Dieu trouve des personnes qui se jettent dans la piété, il les jette dans la superstition. Il éblouit par le vain éclat d'une fausse philosophie ceux qui recherchent la sagesse, et les aveugle de telle sorte qu'ils ne peuvent jamais voir la vérité. Voilà comment il ferme tous les passages par où l'homme pourrait arriver au salut ; voilà comment il se réjouit de nos erreurs et de nos égarements. Cependant comme Dieu souhaite que nous le puissions vaincre, il nous éclaire d'un rayon de sa lumière et nous fortifie d'une vertu céleste dont je me trouve obligé de parler en cet endroit. V. Avant que de faire le dénombrement des vertus, il en faut donner une définition plus exacte que celle des philosophes, et marquer précisément quelle est la fonction et l'emploi de la vertu. Les hommes n'en ont gardé que le nom et en ont perdu toute la force. Lucilius a renfermé en peu de vers tout ce qu'ils ont coutume d'en dire. J'aime mieux les donner ici, que d'être aussi long et aussi verbeux que je le serais, si je voulais rapporter les opinions diverses et les réfuter. Voici donc comment il parle: La vertu, mon cher Albin, consiste à connaître le juste prix de chaque chose, a savoir ce qui est propre a l'homme ou ce qui lui est contraire, ce qui lui est utile et honnête, ou ce qui lui est pernicieux et honteux. La vertu consiste à se régler soi-même et à mettre des bornes a ses désirs et à ses richesses. Elle consiste à rendre des honneurs et des res-pects à ceux qui lei méritent. Elle consiste à se déclarer ennemi îles médians et ami des gens de bien. Elle consiste à servir sa pairie et ses proches, et ensuite à prendre soin de soi-même. Cicéron, suivant Panétius, stoïcien, a tiré de ces définitions de Lucilius tous les devoirs de la vie civile, et les a renfermés en trois livres. Nous en découvrirons incontinent toute la fausseté, et ferons voir en même temps combien nous sommes obligés à Dieu de la bonté qu'il a eue de nous révéler la vérité. Il dit que la vertu consiste à savoir ce qui est bien ou mal, honnête ou honteux, utile ou inutile. Il pouvait épargner quelques paroles, et se contenter de dire: que la vertu consiste à savoir le bien et le mal, puisque rien ne peut être utile ni honnête qu'il ne soit bon, comme rien ne peut être inutile au bonheur qu'il ne soit mauvais, ainsi que les philosophes en conviennent, et que Cicéron le prouve dans le troisième livre du même ouvrage. La science ne peut être une vertu, puisque ce que nous savons nous vient de dehors, au lieu que la vertu est au dedans de celui qui la possède. La science est une faveur que nous fait celui qui nous enseigne, et que nous recevons en l'écoutant. La vertu nous est propre, et consiste dans la volonté que nous avons de faire le bien. Comme il ne servirait de rien dans un voyage de savoir le chemin si l'on n'avait la force de marcher, il ne sert de rien dans la morale de connaître le bien si l’on n'a la vertu de le pratiquer. La plupart de ceux qui pèchent tint une connaissance, quoiqu’imparfaite, du bien et du mal; ils reconnaissent leurs fautes, et c'est pour cela qu'ils lâchent de les cacher. Ils ne se trompent pas en prenant le mal pour le bien ; mais ils sont emportés par le mouvement déréglé de leurs désirs, auxquels ils n'ont pas la vertu de résister. Ainsi il est clair que la science du bien et du mal est différente de la vertu. L'une peut souvent être sans l'autre, comme la science a été sans la vertu dans la plupart des philosophes. Puisque c'est une faute de ne pas faire le bien que l'on connaît, le dérèglement de la volonté qui s'est opposé aux lumières de l'esprit sera puni avec très grande justice, La vertu ne consiste donc pas à savoir le bien et le mal, mais à faire le bien et à ne pas faire le mal. On ne doit pas séparer pour cela la science de la vertu ; il faut que la science précède, et que la vertu suive. La connaissance ne sert de rien si elle n'est suivie de l'action. Horace a mieux défini la vertu quand il dit : Elle consiste à éviter le vice, et le premier degré de la sagesse est de s'éloigner de la folie.
La faute qu'il a faite est de ne l'avoir expliquée que par
opposition à son contraire, comme si, pour faire entendre ce que c'est que le
bien, il avait dit : le bien est ce qui n'est pas mal. Si j'ignore ce que c'est
que la vertu, j'ignore aussi ce que c'est que le vice. J'ai besoin que l'on
m'explique l'un et l'autre. Faisons donc ce que ce poète n'a pas fait, et disons
que: « être vertueux, c'est réprimer sa colère, modérer ses désirs, dompter ses
passions; et cela même c'est éviter le vice, n'y ayant presque aucune action
vicieuse qui ne procède de quelques unes de ces causes. » En effet, si on avait
arrêté tous les mouvements de cette passion impétueuse que l'on appelle la
colère, on aurait prévenu en même temps les querelles et les différends, parce
que nul n'aurait la pensée de nuire ni de tendre des pièges à un autre ; si les
désirs injustes étaient réprimés, on n'exercerait plus de brigandages sur mer ni
sur terre, on ne lèverait plus de troupes pour piller et pour enlever le bien
d'autrui : si le feu de la volupté était assoupi, tout sexe et tout âge
garderait la chasteté, et personne ne ferait ni ne souffrirait d'infamie : ainsi
la vie humaine serait exemple de crimes, si la vertu avait réglé les passions.
Le principal devoir de la vertu consiste à s'abstenir de pécher. Pour s'en
abstenir, il est nécessaire de connaître Dieu, parce que, faute de connaître le
principe des vertus, on tombe insensiblement, dans le vice et sans s'en
apercevoir. Pour exprimer plus distinctement les caractères particuliers de la
science et de la vertu, nous pouvons dire : que le propre de la science est de
connaître Dieu, et le propre de la vertu de l'honorer ; et c'est aussi d'où la
sagesse et la justice dépendent. |
|
CAPUT VI. De summo bono et virtute; deque scientia ac justitia. Dixi, quod erat primum, scientiam boni non esse virtutem; deinde quid sit virtus, et in quo sit. Sequitur, ut id quoque ipsum, quid sit bonum et malum nescisse philosophos, breviter ostendam, quia pene declaratum est libro tertio, cum de Summo Bono disputarem. Quia autem quid esset summum nescierunt, et in caeteris bonis malisve, quae summa non sunt, erraverint necesse est; quae non potest vero judicio examinare, qui fontem ipsum non tenet, unde illa descendunt. Fons autem bonorum Deus est, malorum vero ille, scilicet divini nominis semper inimicus, de quo saepe diximus. Ab his duobus principiis bona malaque oriuntur. Quae veniunt a Deo, hanc habent rationem, ut immortalitatem parent, quod est Summum Bonum: quae autem ab illo altero, id habent officium, ut a coelestibus avocatum, terrenisque demersum, ad poenam interficiant sempiternam, quod est summum malum. Num igitur dubium est, quin illi omnes quid esset bonum et malum ignoraverint, qui nec Deum, nec adversarium Dei scierint? Itaque finem bonorum ad corpus, et ad hanc brevem vitam retulerunt, quam scilicet solvi et occidere necesse est: non sunt progressi ulterius. Sed omnia eorum praecepta, et omnia quae inducunt bona, terrae inhaerent, et humi jacent, quoniam simul cum corpore, quod est terra, moriuntur; pertinent enim non ad vitam homini comparandam, sed ad quaerendas vel augendas opes, honores, gloriam, potentiam; quae sunt universa mortalia, tam scilicet, quam ille qui, ut ea sibi contingerent, laboravit. Hinc est illud: Virtus, quaerendae finem rei scire modumque. Praecipiunt enim quibus modis, et quibus artibus res familiaris quaerenda sit, quia vident male quaeri solere: sed hujusmodi virtus non est proposita sapienti. Nec enim virtus est, opes quaerere, quarum neque inventio, neque possessio in nostra potestate est. Itaque et quaestu, et obtentu faciliores sunt malis, quam bonis. Non potest ergo virtus esse in iis rebus quaerendis, in quarum contemptu vis ac ratio virtutis apparet; nec ad ea ipsa transfugiet, quae magno ac excelso animo calcare ac proterere gestit: neque fas est, animam coelestibus intentam bonis, ut haec fragilia sibi comparet, ab immortalibus suis operibus avocari. Sed potissimum in iis rebus comparandis virtutis ratio consistit, quas nobis nec homo ullus, nec mors ipsa possit auferre. Cum haec ita se habeant, illud quod sequitur verum est: Virtus, divitiis pretium persolvere posse. Qui versus idem fere significat, quod primi duo. Sed neque ipse, neque quisquam philosophorum scire potuit pretium ipsum, vel quale, vel quod sit. Id enim poeta, et illi omnes, quos secutus est, putaverunt, recte opibus uti, hoc est, frugi esse; non instruere convivia sumptuose; nec largiri temere; non effundere in res supervacuas, aut turpes, rem familiarem. Dicet aliquis fortasse: Quid tu? negas ne hanc esse virtutem? Non equidem nego; contraria enim videar probare, si negem. Sed veram nego; quia non sit illa coelestis, sed tota terrena, quandoquidem nihil efficit, nisi quod remaneat in terra. Quid sit autem recte opibus uti, et qui sit ex divitiis fructus petendus, declarabo apertius, cum de pietatis officio loqui coepero. Jam caetera, quae sequuntur, nullo modo vera sunt. Nam improbis inimicitias aut indicere, bonorum defensionem suscipere, potest cum malis esse commune. Quidam enim probitate ficta viam sibi ad potentiam muniunt, faciuntque multa, quae boni solent, eo quidem promptius, quod fallendi gratia faciunt. Utinamque tam facile esset praestare, quam facile est simulare bonitatem. Sed ii, cum esse coeperint propositi ac voti sui compotes, et summum potentiae gradum ceperint, tum vero simulatione deposita, mores suos detegunt: rapiunt omnia, et violant, et vexant; eosque ipsos bonos, quorum causam susceperant, insequuntur, et gradus per quos ascenderunt amputant, ne quis illos contra ipsos possit imitari. Verumtamen putemus, hoc officium non nisi boni esse, ut bonos defendat. At id suscipere, facile est, implere, difficile; quia cum te certamini congressionique commiseris, in arbitrio Dei, non tuo, posita victoria est. Et plerumque improbi, et numero, et conspiratione sunt potentiores, quam boni; ut ad eos superandos, non tam virtus sit, quam felicitas necessaria. An aliquis ignorat, quoties melior justiorque pars victa sit? Hinc semper dominationes acerbae in cives extiterunt. Plena est exemplis omnis historia: sed nos contenti erimus uno. Cneius Pompeius bonorum voluit esse defensor; siquidem pro republica, pro Senatu, pro libertate arma suscepit. Idem tamen victus cum ipsa libertate occidit, et a spadonibus Aegyptiis detruncatus, insepultus abjectus est.
Non est igitur virtus, aut hostem
malorum esse, aut defensorem bonorum, quia virtus incertis casibus
non potest esse subjecta. Haec itaque (ut ipsi appellant) bona quisquis patriae acquisierit, hoc est, qui eversis civitatibus, gentibusque deletis, aerarium pecunia referserit, agros ceperit, cives suos locupletiores fecerit; hic laudibus fertur in coelum, in hoc putatur summa et perfecta esse virtus. Qui error non modo populi et imperitorum, sed etiam philosophorum est; qui praecepta quoque dant ad injustitiam, ne stultitiae ac malitiae disciplinae auctoritas desit. Itaque cum de officiis ad rem militarem pertinentibus disputant, neque ad justitiam, neque ad veram virtutem accommodatur illa omnis oratio, sed ad hanc vitam moremque civilem, quem non esse justitiam, et res indicat, et ipse Cicero testatus est. « Sed nos, inquit, veri juris, germanaequae justitiae, solidam et expressam effigiem nullam tenemus. Umbra et imaginibus utimur; easque ipsas utinam sequeremur! Feruntur enim ab optimis naturae ac veritatis exemplis. » Umbra est igitur et imago justitiae, quam illi justitiam putaverunt. Quid sapientiam? nonne idem confitetur in phisosophis esse nullam? « Aut cum Fabricius, inquit, aut Aristides justus nominatur, aut ab illis fortitudinis, aut ab his justitiae petitur tanquam a sapiente exemplum. Nemo enim horum sic sapiens, ut sapientem volumus intelligi. Nec ii qui sapientes habiti et nominati, M. Cato et C. Laelius, sapientes fuerunt, ne illi quidem septem: sed ex mediorum officiorum frequentia similitudinem quamdam gerebant speciemque sapientium. » Si ergo et philosophis ipsorum confessione adempta sapientia est, et iis qui justi habiti sunt, adempta justitia est, omnes igitur illae virtutis descriptiones falsae sint necesse est; quia quae sit virtus vera, scire non potest, nisi justus ac sapiens. Justus autem ac sapiens nemo est, nisi quem Deus praeceptis coelestibus erudivit. CAPUT VII. De via erroris ac veritatis; quod ea simplex sit, angusta et ardua, atque Deum habeat ducem. Nam illi omnes, qui per aliorum confessam stultitiam sapientes existimantur, specie virtutis inducti umbras et imagines apprehendunt, nihil verum. Quod ea fit ratione, quoniam via illa mendax, quae fert ad occasum, multos tramites habet, propter studiorum et disciplinarum varietatem, quae sunt in vita hominum dissimiles atque diversae. Nam sicut via illa sapientiae habet aliquid simile stultitiae, quod libro praecedente monstravimus: ita haec, cum sit tota stultitiae, habet aliquid simile sapientiae, quod arripiant ii, qui stultitiam publicam intelligunt; et ut habet vitia manifesta: sic habet aliquid, quod simile esse videatur virtuti; ut habet apertum scelus: sic imaginem quamdam speciemque justitiae. Quomodo enim praecursor ejus viae, cujus vis et potestas omnis in fallendo est, universos in fraudem posset inducere, nisi verisimilia hominibus ostentaret? Deus enim, ut immortale illud arcanum ejus in operto esset, posuit in via sua, quae homines pro malis et turpibus aspernarentur, ut aversi a sapientia et veritate, quam sine ullo duce requirebant, in id ipsum inciderent, quod vitare ac fugere cupiebant. Itaque illam perditionis ac mortis viam multiplicem ostendit, vel quod multa sunt genera vitae, vel quod dii multi qui coluntur. Hujus dux praevaricator ac subdolus, ut videatur esse discrimen aliquod falsi et veri, mali ac boni, alia ducit luxuriosos, alia eos qui frugi appellantur; alia imperitos, alia doctos; alia inertes, alia strenuos; alia stultos, alia philosophos; et eos quidem non uno tramite. Illos enim, qui aut voluptates, aut divitias non refugiunt, ab hac publica et celebri via modice segregat: eos autem, qui aut virtutem sequi volunt, aut contemptum rerum profitentur, per fragosa quaedam praecipitia trahit. Sed tamen illa omnia itinera, quae speciem bonorum operum ostentant, non sunt aliae viae, sed diverticula et semitae; quae videntur quidem ab illa communi dextroversum separari, ad eamdem tamen, et ad unum omnes exitum sub ipso fine referuntur. Ibi enim dux, ille conjungit omnes, ubi opus fuerat, bonos a malis, fortes ab inertibus, sapientes a stultis separari; in deorum scilicet cultu, in quo ille universos, quia sine ullo discrimine stulti fuerunt, uno mucrone jugulat, et praecipitat in mortem. Haec autem via, quae est veritatis, et sapientiae, et virtutis, et justitiae, quorum omnium fons unus est, una vis, una sedes; et simplex est, quod paribus animis, summaque concordia unum sequamur, et colamus Deum; et angusta, quoniam paucioribus virtus data est; et ardua, quoniam ad bonum, quod summum atque sublime est, nisi cum summa difficulate ac labore non potest perveniri. CAPUT VIII. De erroribus Philosophorum, ac varietate Legum. Haec est via, quam philosophi quaerunt: sed ideo non inveniunt, quia in terra potius, ubi apparere non potest, quaerunt. Errant ergo velut in mari magno, nec quo ferantur intelligunt, quia nec viam cernunt, nec ducem sequuntur ullum. Eadem namque ratione hanc vitae viam quaeri oportet, qua in alto iter navibus quaeritur; quae nisi aliquod coeli lumen observent, incertis cursibus vagantur. Quisquis autem rectum iter viae tenere nititur, non terram debet aspicere, sed coelum: et (ut apertius loquar) non hominem sequi debet, sed Deum; non his terrestribus simulacris, sed Deo servire coelesti; non ad corpus referre omnia, sed ad mentem; non huic vitae dare operam, sed aeternae. Itaque si oculos in coelum semper intendas, et solem, quo oritur, observes, eumque habeas vitae quasi navigii ducem, sua sponte in viam pedes dirigentur; et illud coeleste lumen, quod sanis mentibus multo clarior sol est, quam hic quem carne mortali videmus, sic reget, sic gubernabit, ut ad summum sapientiae, virtutisque portum sine ullo errore perducat. Suscipienda igitur Dei lex est, quae nos ad hoc iter dirigat: illa sancta, illa coelestis, quam Marcus Tullius in libro de Republica tertio pene divina voce depinxit; cujus ego, ne plura dicerem, verba subjeci: « Est quidem vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna; quae vocet ad officium, jubendo; vetando, a fraude deterreat: quae tamen neque probos frustra jubet, aut vetat; nec improbos jubendo, aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Nec vero aut per Senatum, aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quaerendus explanator, aut interpres ejus alius. Nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac: sed et omnes gentes, et omni tempore una lex, et sempiterna, et immutabilis continebit; unusque erit communis quasi magister, et imperator omnium Deus, ille legis hujus inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi caetera supplicia quae putantur effugerit. » Quis sacramentum Dei sciens, tam significanter enarrare legem Dei posset, quam illam homo longe a veritatis notitia remotus expressit? Ego vero eos, qui vera imprudentes loquuntur, sic habendos puto, tanquam divinent spiritu aliquo instincti. Quod si, ut legis sanctae vim rationemque pervidit, ita illud quoque scisset aut explicasset, in quibus praeceptis lex ipsa consisteret: non philosophi functus fuisset officio, sed prophetae. Quod quia facere ille non poterat, nobis faciendum est, quibus ipsa lex tradita est ab illo uno magistro et imperatore omnium Deo. CAPUT IX. De Lege et Praecepto Dei; de Misericordia, atque errore Philosophorum. Hujus legis caput primum est, ipsum Deum nosse, soli obtemperare, solum colere. Non potest enim rationem hominis obtinere, qui parentem animae suae Deum nescit; quod est summum nefas. Quae ignoratio facit, ut diis alienis serviat, quo nihil sceleratius committi potest. Hinc jam proclivis est ad malitiam gradus per ignorantiam veri ac singularis boni; quia Deus, quem nosse refugit, fons est ipse bonitatis. Vel si justitiam sequi volet Dei, divini tamen juris ignarus, gentis suae leges tanquam verum jus amplectitur; quas non utique justitia, sed utilitas reperit. Cur enim per omnes populos diversa et varia jura sunt condita, nisi quod unaquaeque gens id sibi sanxit, quod putavit rebus suis utile? Quantum autem a justitia recedat utilitas, populus ipse Romanus docet, qui per Feciales bella indicendo, et legitime injurias faciendo, semper aliena cupiendo, atque rapiendo, et possessionem sibi totius orbis comparavit. Verum hi justos se putant, si contra leges suas nihil faciant; quod etiam timori adscribi potest, si praesentium poenarum metu sceleribus abstineant. Sed concedamus sane, ut id natura, vel (ut ait philosophus) sua sponte faciant, quod legibus facere coguntur. Num idcirco justi erunt, quia parent institutis hominum, qui et ipsi aut errare, aut injusti esse potuerunt! Sicut illi duodecim Tabularum conditores, qui certe publicae utilitati pro conditione temporum servierunt. Aliud est igitur civile jus, quod pro moribus ubique variatur: aliud est vera justitia, quam uniformem ac simplicem proposuit omnibus Deus; quem qui ignorat, et ipsam justitiam ignoret necesse est. Sed putemus fieri posse, ut aliquis naturali et ingenito bono veras virtutes capiat, qualem fuisse Cimonem Athenis accepimus, qui et egentibus stipem dedit, et pauperes invitavit, et nudos induit. Tamen cum illud unum quod est maximum deest, agnitio Dei, jam illa bona omnia supervacua sunt et inania, ut frustra in his assequendis laboraverit. Omnis enim justitia ejus similis erit humano corpori caput non habenti; in quo tametsi membra omnia, et locis suis constent, et figura, et habitudine, tamen quoniam deest id, quod est omnium principale, et vita, et omni sensu caret. Itaque membra illa formam tantummodo membrorum habent, usum non habent, tam scilicet, quam caput sine corpore. Cui similis est, qui cum Deum non ignoret, vivit injuste. Id enim solum habet, quod est summum: sed frustra, quoniam virtutibus tanquam membris eget. Itaque ut sit vivum ac sensibile corpus, et agnitio Dei necessaria est, quasi caput; et omnes virtutes, quasi corpus. Ita fiet homo perfectus, ac vivus: sed tamen summa omnis in capite est; quamvis constare non possit sine omnibus, sine quibusdam tamen potest. Et erit quidem animal vitiosum ac debile; sed tamen vivet, sicut is qui et Deum novit, et in aliqua re peccat. Dat enim veniam peccatis Deus. Itaque sine membris aliquibus vivi potest, sine capite nullo modo. Haec res efficit, ut philosophi, etiamsi natura sint boni, tamen nihil sciant, nihil sapiant. Omnis doctrina et virtus eorum sine capite est; quia Deum nesciunt, qui est virtutis ac doctrinae caput: quem qui non agnoscit, licet videat, caecus est; licet audiat surdus; licet loquatur, elinguis est. Cum vero conditorem rerum parentemque cognoverit, tunc et videbit, et audiet, et loquetur. Habere enim caput coepit, in quo sunt sensus omnes collocati, hoc est oculi, aures, et lingua. Nam profecto is videt, qui veritatem in qua Deus est, vel Deum in quo veritas est, oculis cordis aspexerit: is audit, qui divinas voces ac praecepta vitalia pectori suo affigit: is loquitur, qui coelestia disserens, virtutem ac majestatem Dei singularis enarrat. Quare non est dubium, quin impius sit, quisquis Deum non agnoverit; omnesque virtutes ejus, quas habere aut tenere se putat, in illa mortifera via reperiuntur, quae est tota tenebrarum. Quapropter nihil est quod aliquis sibi gratuletur, si has inanes virtutes adeptus est; quia non tantum miser, qui bonis praesentibus careat, sed etiam stultus sit necesse est, qui labores in vita sua maximos suscipiat incassum. Nam dempta spe immortalitatis, quam Deus pollicetur in sua Religione versantibus, cujus assequendae gratia virtus appetenda est, et quidquid malorum acciderit perferendum, maxima erit profecto vanitas, obsequi velle virtutibus, quae frustra homini calamitates afferunt et labores. Nam si virtus est, egestatem, exilium, dolorem, mortem, quae timentur a caeteris, pati fortiter ac subire; quid tandem in se boni habet, cur eam propter seipsam philosophi dicant expetendam? Nimirum supervacuis et inanibus poenis delectantur, quibus licet agere tranquille. Si enim mortales sunt animae, si virtus dissoluto corpore nihil futura est, quid fugimus attributa nobis bona, quasi aut ingrati, aut indigni qui divinis muneribus perfruamur? Quae bona ut habeamus, scelerate impieque vivendum est; quia virtutem, id est, justitiam paupertas sequitur. Sanus igitur non est, qui nulla spe majore proposita, iis bonis, quibus caeteri utuntur in vita, labores, et cruciatus, et miserias anteponat. Si autem virtus (ut ab his rectissime dicitur) capessenda est, quia constet ad eam nasci hominem, subesse debet spes aliqua major, quae malorum et laborum, quos perferre virtutis est, magnum afferat praeclarumque solatium. Nec aliter virtus, cum per se dura sit, haberi pro bono potest quam si acerbitatem suam maximo bono penset. Aeque non aliter his bonis praesentibus abstinendum est, quam si sunt alia majora, propter quae tanti sit, et voluptates omittere, et mala omnia sustinere. Ea vero nulla sunt alia (ut in tertio docui) nisi perpetuae vitae. Hanc autem praestare quis potest, nisi Deus, qui virtutem ipsam proposuit? Ergo in Dei agnitione et cultu rerum summa versatur: in hoc est spes omnis ac salus hominis; hic est sapientiae gradus primus, ut sciamus quis sit nobis verus pater, eumque solum pietate debita prosequamur, huic pareamus, huic devotissime serviamus; in eo promerendo actus omnis, et cura, et opera collocetur. CAPUT X. De Religione erga Deum, et Misericordia erga homines; atque de Mundi principio. Dixi, quid debeatur Deo: dicam nunc, quid homini tribuendum sit; quanquam id ipsum quod homini tribueris, Deo tribuitur, quia homo Dei simulacrum est. Sed tamen primum officium justitiae est, conjungi cum Deo; secundum, cum homine. Sed illud primum, Religio dicitur; hoc secundum, misericordia vel humanitas nominatur. Quae virtus propria est justorum et cultorum Dei; quod ea sola vitae communis continet rationem. Deus enim, qui caeteris animalibus sapientiam non dedit, naturalibus ea munimentis ab incursu et periculo tutiora generavit. Hominem vero quia nudum fragilemque formavit, ut eum sapientia potius instrueret, dedit ei praeter caetera hunc pietatis affectum ut homo hominem tueatur, diligat, foveat, contraque omnia pericula et accipiat, et praestet auxilium. Summum igitur inter se hominum vinculum est humanitas: quod qui disrupit, nefarius et parricida existimandus est. Nam si ab uno homine, quem Deus finxit, omnes orimur, certe consanguinei sumus; et ideo maximum scelus putandum est, odisse hominem, vel nocentem. Propterea Deus praecepit inimicitias per nos nunquam faciendas, semper esse tollendas; scilicet ut eos, qui sint nobis inimici, necessitudinis admonitos mitigemus. Item si ab uno Deo inspirati omnes et animati sumus, quid aliud quam fratres sumus? Et quidem conjunctiores, quod animis, quam quod corporibus. Itaque non errat Lucretius, cum dicit:
Denique, coelesti sumus omnes semine
oriundi: Ergo pro belluis immanibus sunt habendi, qui homini nocent, qui contra jus humanitatis et fas omne spoliant, cruciant, occidunt, exterminant. Ob hanc necessitudinem germanitatis docet nos Deus, malum nunquam facere, semper bonum. Id autem ipsum bene facere quid sit, idem ipse praescribit: praestare auxilium depressis et laborantibus; impertiri victum non habentibus. Deus enim, quoniam pius est, animal nos voluit esse sociale. Itaque in aliis hominibus nos ipsos cogitare debemus. Non meremur in periculo liberari si non succurrimus: non meremur auxilium, si negamus. Ad hanc partem Philosophorum nulla praecepta sunt; quippe qui falsae virtutis specie capti, misericordiam de homine sustulerunt, et dum volunt sanare, vitiaverunt. Et cum iidem plerumque fateantur, societatis humanae communionem esse retinendam, ab ea plane seipsos inhumanae suae virtutis rigore dissociant. Convincendus ergo etiam hic error illorum est, qui nihil cuiquam impertiendum putant. Urbis condendae originem atque causam non unam intulerunt: sed alii eos homines, qui sint ex terra primitus nati, cum per silvas et campos erraticam degerent vitam, nec ullo inter se sermonis aut juris vinculo cohaererent, sed frondes et herbam pro cubilibus, speluncas et antra pro domibus haberent, bestiis et fortioribus animalibus praedae fuisse commemorant. Tum eos, qui aut laniati effugerant, aut laniari proximos viderant, admonitos periculi sui ad alios homines decurrisse, praesidium implorasse, et primo nutibus voluntatem suam significasse; deinde sermonis initia tentasse, ac singulis quibusque rebus nomina imprimendo, paulatim loquendi perfecisse rationem. Cum autem nec multitudinem ipsam viderent contra bestias esse tutam, oppida etiam coepisse munire; vel ut quietem noctis tutam sibi facerent, vel ut incursiones atque impetus bestiarum non pugnando, sed objectis aggeribus arcerent. O ingenia hominibus indigna quae has ineptias protulerunt! miseros, atque miserabiles, qui stultitiam suam litteris memoriaeque mandaverunt! Qui cum viderent mutis quoque animalibus ingenitam esse rationem, vel conveniendi, vel invicem appetendi, vel periculi fugiendi, vel mali cavendi, vel cubilia sibi et latibula parandi; homines autem ipsos existimaverint non nisi exemplis admoneri ac discere potuisse, quid metuere, quid cavere, quid facere deberent; aut nunquam conventuros inter se fuisse, nec loquendi rationem reperturos, nisi eos bestiae comedissent. Haec aliis delira visa sunt (ut fuerunt) dixeruntque, non ferarum laniatus causam fuisse coeundi, sed ipsam potius humanitatem: itaque inter se congregatos, quod natura hominum solitudinis fugiens, et communionis ac societatis appetens esset. Non magna inter eos disceptatio est. Siquidem causae dispares sunt, res eadem est. Potuit igitur utrumque, quia non repugnat: sed tamen utrumque nullo modo verum est; quia non per omnem terram nati sunt homines e terra, tanquam ex draconis alicujus dentibus proseminati (ut poetae ferunt) sed unus homo à Deo fictus est, ab eoque uno omnis terra humano genere completa est, eadem scilicet ratione, qua rursus post diluvium: quod certe negare non possunt. Nulla igitur in principio facta est ejusmodi congregatio; nec unquam fuisse homines in terra, qui praeter infantiam non loquerentur, intelliget cui ratio non deest. Fingamus tamen illa vera esse, quae otiosi et inepti senes fabulantur, ut eos suis potissimum sensibus et suis rationibus refellamus.
Si hac de causa sunt homines
congregati, ut mutuis auxiliis imbecillitatem suam tuerentur;
succurrendum est igitur homini, qui egeat auxilio. Cum enim
praesidii causa homines societatem cum hominibus inierint et
sanxerint, foedus illud inter homines a principio ortus sui ictum
aut violare, aut non conservare, summum nefas putandum est. Nam qui
se a praestando auxilio removet, etiam ab accipiendo se removeat
necesse est; quia nullius opera indigere se putat, qui alteri suam
denegat. Huic vero, qui se ipse dissociat ac secernit a corpore, non
ritu hominis, sed ferarum more vivendum est. Quod si fieri non
potest, retinendum est igitur omni modo vinculum societatis humanae,
quia homo sine homine nullo modo potest vivere. Retentio autem
societatis est communitas, id est auxilium praestare, ut possimus
accipere. Sin vero (ut illi alii disputant) humanitatis ipsius causa
facta est hominum congregatio, homo certe hominem debet agnoscere.
Quod si fecerunt illi rudes et adhuc feri homines, et fecerunt
nondum constituta loquendi ratione, quid putemus hominibus expolitis,
et sermonis rerumque omnium commercio inter se copulatis esse
faciendum, qui assueti hominibus solitudinem ferre non possunt? |
VI. J'ai fait voir, si je ne me trompe, que la vertu ne consiste pas à connaître le bien; j'ai montré ensuite ce que c'est que la vertu, et en quoi elle consiste. Il ne me reste plus qu'à prouver en peu de paroles que les philosophes n'ont point su ce que c'est que le bien ni le mal, quoique je l'aie déjà prouvé en quelque sorte dans le troisième livre, lorsque j'ai parlé du souverain bien. Il est certain que ceux qui n'ont pas connu le souverain bien, n'ont pu connaître ni les autres biens ni les maux. Comment auraient-ils vu de faibles ruisseaux, puisqu'ils n'ont pas vu la source? Dieu est la source des biens, au lieu que l'ennemi de son nom est la source des maux. Voilà les deux principes d'où les biens et les maux procèdent. Les biens, qui procèdent de Dieu, ont cela de propre, qu'ils peuvent procurer l'immortalité, qui est le souverain bien. Les maux, qui procèdent de l'autre principe, ont cela de propre, qu'ils détournent l'âme du ciel, qu'ils l'attachent à la terre, et lui font mériter un supplice éternel, qui est le souverain mal. Il est donc clair que ces philosophes, qui ne connaissaient ni Dieu ni son ennemi, ont ignoré ce que c'est que le bien et le mal ; ils ont rapporté tous les biens au service du corps qui est sujet à la mort, et à l'usage de cette vie qui est si courte, et n'ont jamais été plus avant. Les préceptes qu'ils donnent se terminent à la terre et au corps qui est tiré de la terre et qui sert de proie à la corruption ; ils ne contiennent que les moyens d'acquérir des richesses on de les accroître, de parvenir aux honneurs, aux dignités, de se mettre en crédit, et d'usurper l'autorité et le pouvoir, ce qui ne regarde que le temps. Voilà pourquoi le poète a dit : que la vertu consiste à savoir de quelle manière on doit acquérir du bien, et comment on en doit user quand on en a acquis. Les hommes prescrivent des règles par où l'on peut augmenter son bien, parce qu'ils voient que plusieurs manquent en ce point, et font fort mal leurs affaires; mais ce n'est pas là la vertu dont la pratique est proposée au sage. La vertu ne consiste point à amasser des richesses, puisque ni leur acquisition, ni leur possession ne dépendent de notre liberté, et que les méchants y réussissent mieux que les gens de bien. La vertu n'a garde de s'abaisser jusqu'à poursuivre des choses qu'elle méprise ; elle ne quittera pas les trésors incomparables du ciel, auxquels elle, est attachée par ses pensées et par ses affections, pour courir après l'ombre du siècle. Elle s'occupe principalement à rechercher des richesses que l'injustice des hommes ni la rigueur de la mort ne nous peuvent ravir. C'est pourquoi ce qui suit dans le discours de Lucilius est véritable : que la vertu consiste à connaître quel est le juste prix des richesses. Le sens de ces vers est presque le même que celui des précédents; mais ni Lucilius, ni aucun philosophe n'a pu savoir quel est ce prix. Ce poète et tous ceux qu'il a imités ont cru que, pour faire un bon usage des richesses que l'on possède, il n'y a qu'à avoir de la modération, ne point faire de festins trop magnifiques, et ne point dissiper son bien en dépenses superflues ou honteuses. Quelqu'un me demandera peut-être si je nie que ce soit une vertu que d'en user de la sorte. Je ne le nie pas, car si je le niais, il semblerait que j'approuve le désordre; mais je nie que ce soit là la véritable vertu. C'est une vertu qui n'a rien de céleste, qui rampe toujours sur la terre, et qui ne s'élève jamais au-dessus. Lorsque j'expliquerai les devoirs de la piété, je ferai voir quel est l'usage légitime des richesses. Ce que Lucilius ajoute n'est nullement conforme à la vérité ; car se déclarer l'ennemi des méchants ou le protecteur des gens de bien, est quelque chose de commun aux gens de bien et aux méchants. Il y en a plusieurs qui, par le désir de parvenir aux grandes charges, affectent de se mettre en réputation d'une rare probité; ils font pour cela quantité d'actions que font aussi les personnes de vertu, et les font avec d'autant plus d'ardeur et d'autant plus d'éclat, qu'ils ne les font qu'à dessein de tromper. Plût à Dieu qu'il fût aussi aisé d'être homme de bien qu'il est aise de faire semblant de l'être. Lorsque ces personnes-là sont arrivées au comble des honneurs où elles aspiraient, elles cessent de se contraindre et de se déguiser, et laissent paraître toute la corruption de leur cœur ; elles violent les plus saintes lois avec la dernière impudence ; elles enlèvent le bien d'autrui et persécutent les gens de bien, dont elles se vantaient auparavant d'entreprendre la protection ; elles rompent les degrés par où elles sont montées aux dignités, afin que les autres ne puissent les suivre. Supposons néanmoins ici qu'il n'appartient qu'à un homme de bien d'entreprendre de protéger les gens de bien. Il est moins facile à exécuter qu'à entreprendre ; car quand on est engagé une fois dans le combat, on n'a pas entre les mains la victoire, qui n'est qu'en celles de Dieu. Les méchants sont quelquefois en plus grand nombre et en meilleure intelligence que les gens-de bien, de sorte qu'il ne faut pas mains de bonheur et de force pour les vaincre. Qui ne sait que la victoire ne s'est pas toujours déclarée pour la justice? Le mauvais parti a souvent été le plus fort, et c'est de là qu'est venue l'oppression de la liberté publique et l'établissement de la tyrannie. L'histoire est toute remplie d'exemples de ce que je dis. Je me contenterai d'en rapporter un : Pompée voulut défendre les gens de bien et prit les armes pour la république, pour le sénat et pour la liberté; mais ayant été vaincu avec la liberté qu'il défendait, il eut la tête tranchée par la perfidie des eunuques de la cour d'Egypte, et fut jeté sans sépulture. La vertu ne consiste donc ni à se déclarer l'ennemi des méchants ou le protecteur des gens de bien, puisqu'elle ne peut être exposée à l'incertitude des événements. La vertu consiste à regarder les avantages de notre patrie comme nos propres avantages. En effet, si l'on avait ôté la bonne intelligence d'entre les hommes, il n'y aurait plus de vertu. Les avantages de notre pays ne tendent-ils pas au dommage de nos voisins ? Pouvons-nous étendre nos frontières sans les chasser de leurs terres ou sans les assujettir à notre domination P Ce n'est pas là une vertu, c'est le renversement de toute vertu; c'est briser la société humaine, bannir l'innocence et la justice qui ne peut demeurer au milieu des armes et qui se retire au bruit de la guerre. C'est avec grande raison que Cicéron a dit: que ceux qui avouent qu'il faut avoir égard à ses concitoyens et ne point se soucier des étrangers, rompent la société du genre humain et anéantissent en même temps la bonté, la libéralité et la justice. Garde-t-on la justice dans le temps que l'on nuit à quelqu'un, qu'on le hait, qu'on le dépouille, qu'on le tue? C'est cependant ce que font ceux qui s'efforcent de procurer les avantages de leur pays. Ils ne savent pas seulement ce que c'est qu'un avantage; ils s'imaginent qu'il n'y a rien d'avantageux, d'utile ni de commode que ce que l'on peut tenir entre les mains, si toutefois on y peut tenir ce que l'on en peut arracher. On élève jusqu'au ciel, par des louanges excessives, ceux qui procurent ces avantages à leur patrie, c'est-à-dire ceux qui remplissent le trésor public des richesses des villes mises à feu et à sang et des dépouilles des nations vaincues, et on se persuade qu'ils sont montés au comble de la vertu. Cette erreur n'est pas seulement soutenue par la multitude, elle est autorisée par les philosophes. Lorsqu'ils traitent des devoirs des personnes qui sont engagées dans la profession des armes, ils ne règlent pas leurs sentiments sur la justice ou sur la vertu ; ils les rapportent à l'usage de la vie présente, qui est fort différent de la vertu, comme tout le monde peut le reconnaître et comme Cicéron le déclare en termes exprès. « Nous ne concevons, dit-il, aucune image fidèle et sincère du droit et de la justice ; nous n'en avons que l'ombre, ou pas même l'ombre : il serait à souhaiter que nous eussions du moins cette ombre qui nous représenterait quelque trait de la vérité. » Ce n'est donc que l'image de l'ombre que les philosophes ont prise pour la justice. S'ils n'ont pas la justice, ont-ils la sagesse? Cicéron avoue sincèrement qu'ils ne l'ont point. « Lorsque, dit-il, on appelle Fabricius généreux, ou Aristide juste, on cherche des exemples, et on propose l'un de ces anciens comme un modèle de courage et l'autre comme un modèle d'équité; car aucun d'eux n'a possédé en effet la sagesse dans la perfection dont nous tâchons de former ici l'exemple. Caton et Laelius n'ont pas été sages, bien qu'on leur en ait donné le nom. Les sept, tant vantés par la Grèce, ne l'ont pas été non plus. Ils n'ont eu qu'une vaine apparence de sagesse, fondée seulement sur l'habitude qu'ils avaient de s'acquitter plus exactement que le peuple des devoirs ordinaires de la vie civile. » Voilà donc des philosophes sans sagesse, et ceux qui paraissent justes sans justice; mais les descriptions que l'on fait de ces vertus nous imposent, parce que, pour connaître la vertu, il faut avoir la justice et la sagesse. Or nul ne les a s'il ne les a reçus de Dieu même. VII.
Ceux qui n'ont été mis au nombre des sages que par une erreur et
une surprise qui est maintenant reconnue et avouée de tout le monde, ont été
trompés par des fausses apparences et n'ont embrassé que des ombres et des
fantômes. La voie trompeuse qu'ils ont suivie a divers détours qui sont formés
comme par les caprices des opinions et des sectes dans lesquelles ils se sont
égarés. Car, comme le chemin de la sagesse a quelque apparence de folie, ainsi
que je l'ai fait voir dans le livre précédent, le chemin de la folie a aussi
quelque apparence de sagesse, qui est conservée par ceux qui ont assez de
lumières pour découvrir la folie du peuple. Si ce chemin a des vices manifestes,
il a aussi quelque image de la vertu ; s'il a des injustices que l'on ne saurait
déguiser, il a aussi une ombre de justice que l'on ne saurait s'empêcher
d'apercevoir. Comment le guide infidèle qui est à la tête pourrait-il y engager
une si prodigieuse multitude, s'il n'y semait des attraits capables de la
tromper? Dieu ne désirant pas découvrir les mystères, a placé à l'entrée de son
chemin des choses que les hommes ont méprisées, à cause de quelque sorte de
bassesse ou d'infamie dont elles leur paraissaient mêlées, afin que s'éloignant
de la sagesse et de la vérité qu'ils cherchaient sans aucun guide, ils
tombassent dans les maux qu'ils auraient bien voulu éviter. Le guide trompeur
qui est à l'entrée du chemin de la mort montre plusieurs détours à ceux qu'il
veut perdre, soit à dessein de leur persuader qu'il sait faire la différence du
bien et du mal, de la vérité et du mensonge, ou en effet par la seule raison que
les mêmes vertus ne sont pas propres indifféremment à toutes sortes de
personnes, et que comme il y a plusieurs dieux, il y a aussi plusieurs moyens de
se perdre en les honorant. Ce guide ne mène pas les débauchés par le même chemin
par où il mène ceux qui semblent conserver quelque sorte de retenue et
d'humilité. Il mène les ignorants par un autre chemin que les sa vans, les
lâches par un autre que les courageux, le peuple par un autre que les
philosophes. Le chemin par où il mène les philosophes est encore divise par des
routes particulières ; car il détourne un peu du grand chemin ceux qui n'ont pas
d'aversion des voluptés et des richesses, et il traîne à travers les précipices
ceux qui font profession de mépriser les biens de la terre et de ne chercher que
la vertu. Ces sentiers-là semblent un peu plus écartés que le grand chemin; mais
il n'y en a aucun qui n'y ramène. Le guide qui avait séparé les philosophes
d'avec le peuple et les savants d'avec les ignorants, les rassemble tous à la
fuis et les réunit dans le culte des faux dieux pour les égorger du même fer, et
pour les faire périr du même genre de mort. VIII. Les philosophes cherchent ce chemin sans le trouver, parce qu'il n'y a sur la terre aucun vestige par lequel on le puisse reconnaître. Ils s'égarent comme sur une vaste mer où ils n'ont point de pilote. Il faut chercher ce chemin sur la terre de la même sorte que les pilotes cherchent le leur sur la mer, en regardant le ciel et en observant les astres ; c'est-à-dire, pour parler plus clairement, que ceux qui désirent marcher dans le chemin de la vie doivent suivre Dieu et non les hommes, l'adorer lui seul et non les idoles, rapporter toutes leurs actions à leur âme et non à leur corps, tendre à la vie éternelle et non à cette vie passagère. Si vous levez les yeux au ciel et que vous preniez le soleil pour le guide de votre navigation, cette lumière spirituelle qui remplit l'esprit d'une plus vive splendeur que celle dont le soleil visible éclaire l'univers, vous conduira sûrement au port de la vertu et de la sagesse. Il faut pour cela recevoir la loi de Dieu que Cicéron a décrite dans le troisième livre Des Lois, dans des termes si excellents que j'aime mieux les lui emprunter que d'en chercher d'autres qui seraient peut-être trop diffus et n'auraient pas la même force. « La véritable loi c'est la raison droite et conforme à la nature, qui est répandue dans le cœur de tous les hommes, qui est uniforme, stable et éternelle, qui commande le bien et qui défend le mal. On ne peut ni s'y opposer, ni y déroger, ni l'abolir. Ni le sénat ni le peuple n'en peuvent accorder aucune dispense. Il n'en faut point chercher d'explication ni de commentaires. Il n'y en a point une pour Rome et une autre pour Athènes, une pour le temps présent et une autre pour le temps avenir. Elle sera toujours la même, et dans tous les temps elle gouvernera tous les peuples. Celui qui l'a inventée et publiée est un législateur, un seigneur et un Dieu éternel, duquel on ne peut s'éloigner sans se perdre et auquel on ne saurait désobéir sans renoncer à sa propre nature, ce qui serait un châtiment fort terrible quand même on pourrait éviter les autres. » Y a-t-il quelqu'un, quelque bien informé qu'il soit des mystères de notre religion, qui pût trouver des termes plus propres à parler de la loi de Dieu que ceux que cet auteur a employés, bien qu'il fût fort éloigné de la vérité? Pour moi, je me persuade que ceux qui la publient de cette sorte sans la connaître sont inspirés de Dieu. Si Cicéron avait aussi bien expliqué les préceptes de cette loi qu'il en a découvert l'origine et le pouvoir, il aurait rempli le devoir non d'un philosophe, mais d'un prophète. Puisqu'il ne l'a pas fait, c'est à nous, qui avons reçu cette loi de la main du Seigneur souverain, de la puissance duquel relèvent tous les peuples de l'univers; c'est à nous, dis-je, à tâcher de le faire. IX. Le premier commandement de cette loi est de connaître Dieu et de n'adorer que lui. En effet, quiconque ne connaît pas son créateur et l'auteur de son âme, ne mérite pas le nom d'homme. Ne connaissant pas Dieu, il s'abaisse jusqu'au service des idoles, qui est le plus grand de tous les crimes. Cet éloignement de la source de la vérité et de la justice ne peut porter qu'au mensonge et au péché ; car quand ceux qui ne savent pas la loi de Dieu auraient de bonnes intentions, ils prendraient les lois de leur pays pour des lois véritables, bien qu'elles ne soient point établies sur le fondement de la justice. Car d'où vient la diversité si prodigieuse des lois qui se rencontrent par tout le monde, si ce n'est de ce que chaque nation a établi celles qu'elle a jugé être les plus avantageuses à ses intérêts. Or on sait combien l'intérêt est contraire à lu justice, et on ne le reconnaît que trop par la pratique des Romains qui, en déclarant la guerre à leurs voisins, et en leur faisant les dernières violences avec quelque formalité de justice, ont enlevé leurs biens et usurpé l'empire de l'univers. Tous ces peuples s'imaginent observer la justice quand ils ne font rien qui soit contraire à la disposition de leurs lois, bien que pour l'ordinaire ils ne se tiennent dans les bornes du devoir que par l'appréhension du châtiment. Supposons néanmoins qu'ils obéissent aux lois par leur inclination et par un pur mouvement de leur liberté, montrent-ils le titre d'exacts observateurs de la justice, pour avoir déféré à des lois inventées par des hommes qui ont pu se tromper, et qui ont peut-être été fort injustes? On doit mettre en ce rang-là les auteurs des lois des Douze Tables, qui se sont accommodés au temps, et qui ont travaillé pour le bien public. Il y a donc une grande différence entre le droit civil, qui change selon le génie des peuples, et la justice, qui est simple, unique et uniforme, et qui ne peut plus être ignorée que par ceux qui ignorent Dieu d'où elle procède comme de son principe. Demeurons d'accord que quelqu'un peut acquérir de véritables vertus par les forces de sa nature, tel que l'on dit que fut autrefois Cimon l'Athénien, qui distribuait de l'argent à ceux qui en avaient besoin, qui invitait les pauvres à manger avec lui, et qui donnait des habits à ceux qui étaient nus. Il faut pourtant avouer que si la connaissance de Dieu, qui est le premier et le plus nécessaire de tous les biens, lui manque, ses vertus seront inutiles, et la peine qu'il aura prise pour les acquérir ne lui servira de rien. Sa justice ressemblera à un corps qui, bien qu'il ait tous ses membres dans la disposition où ils doivent être, n'a point de vie ni de sentiment, parce qu'il n'a point de tête. Ces membres-là n'ont que la figure extérieure et n'ont aucun usage, comme la tête n'a aussi aucun usage quand elle est séparée des membres. Celui qui ayant la connaissance de Dieu vit dans le crime, ressemble à une tête qui n'a point de corps : il a le principal et le plus nécessaire, mais il n'en tire aucun fruit, parce qu'il n'a pas les vertus qui sont comme les membres et les organes sans lesquels il ne peut faire de fonction. Pour donner au corps spirituel dont nous parlons la vie et le sentiment, et pour mettre la dernière main à l’homme intérieur, il faut que les vertus, qui sont comme autant de membres, soient jointes à la connaissance de Dieu, qui est comme la tête qui leur communique la vie. La tête est le principe des sentiments et du mouvement. Bien qu'elle ne puisse vivre quand elle est séparée de ses membres, elle peut se passer de plusieurs. C'est un défaut que de manquer de quelques-uns : mais avec ce défaut on ne cesse pas de vivre. C'est une image de l'état où se trouvent oui qui, bien qu'ils connaissent Dieu, ne laissât pas de commettre quelque péché. Dieu pardonne ces péchés-là ; mais il ne pardonne point l'infidélité de ceux qui ne connaissent pas son nom. On peut vivre lorsqu'on a perdu quelques membres, mais on ne peut vivre lorsqu'on n'a plus de tête. Ainsi, quelque vertu que semblent avait les philosophes, il est certain qu'ils ne savent rien. Leur vertu et leur doctrine n'ont point de principe, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, qui est l'unique principe de toute doctrine et de toute vertu. Quiconque ne le connaît point est aveugle quoiqu'il voie, et sourd quoiqu'il entende, et muet quoiqu'il parle; mais dès qu'il commencera à le connaître, il commencera aussi à voir, à entendre et à parler. Il commence alors à avoir une tête qui est le siège des sens, et où sont les yeux, les oreilles et la langue. Celui-là voit, qui reconnaît par les yeux de l'esprit la vérité, qui est Dieu même; celui-là entend, qui reçoit les commandements de Dieu au fond de son cœur; celui-là parle, qui publie la grandeur et la majesté de Dieu. Ainsi celui qui ne connaît point Dieu est sans doute un impie ; et toutes les vertus qu'il croit avoir st trouvent ensevelies sous les ténèbres dont le chemin funeste où il marche est couvert. Ces! pourquoi personne ne doit se glorifier de ses en vaines ou inutiles, parce qu'il est non seulement misérable, puisqu'il se prive des avantages de la vie présente, mais encore extravagant, puisqu'il entreprend en vain de grands travaux. En effet, sans l'espérance de l'immortalité que Dieu procure à ceux qui le servent dans notre religion, et que nous attendons comme la seule récompense de la vertu, c'est une occupation déplorable de travailler pour acquérir des vertus qui ne produisent que des peines et des misères. Si la vertu consiste à supporter courageusement la pauvreté, le bannissement, la douleur et la mort, que le peuple prend pour des maux insupportables, pourquoi les philosophes assurent-ils qu'elle ne doit être recherchée que pour elle-même? Est-ce qu'au lieu de mener une vie tranquille et commode, ils prennent plaisir à souffrir des agitations et des traverses qui ne leur servent de rien ? Si les âmes sont sujettes à la mort, et si les vertus s'évanouissent en même temps que le corps se résout en pourriture, pourquoi refuserions-nous de jouir des biens que Dieu nous présente en cette vie, et pourquoi nous déclarerions-nous nous-mêmes méconnaissants de sa bonté ou indignes de sa faveur? Il est vrai que pour posséder ces biens-là, il faut commettre des crimes ; car quand on demeure dans les bornes de la vertu et de la justice, ou n'a que de la pauvreté. Ce n'est donc pas être sage que de se priver des biens dont les autres jouissent en cette vie, et préférer à ces-biens-là les travaux, les tourments et les misères, sans pouvoir espérer aucun autre avantage plus considérable. Que s'il faut embrasser la vertu par la raison que marquent ces philosophes, qui est que l'homme est né pour l'acquérir, il faut sans doute être consolé par l'espérance de quelque récompense au milieu des fatigues et des misères où engage la poursuite de la vertu. Elle ne passerait jamais pour un bien, si elle n'était suivie de quelque douceur qui tempérât son amertume. On peut dire de la même sorte que, si la privation des biens présents n'était comme compensée par la jouissance de quelques autres biens, il n'y aurait pas de prudence à s'en priver. Or il n'y en a point d'autres que ceux de la vie éternelle, comme je l'ai fait voir dans le troisième livre de cet ouvrage. Il n'y a que Dieu, qui nous a proposé la vertu, qui nous puisse donner cette vie éternelle en récompense. Notre principal devoir est donc de le connaître et de le servir; l'unique espérance de notre salut est fondée sur ce devoir : c'est le premier degré de la sagesse de savoir qui est notre véritable père, de l'honorer et de lui obéir avec tout le soin et toute la soumission dont nous pouvons être capables. X. Après avoir parlé des devoirs qui sont dus à Dieu, je dirai quelque chose de ceux qu'il faut rendre à l'homme, bien que ceux que l'on rend à l'homme retournent en quelque sorte à Dieu, puisque l'homme est son image. Le premier devoir de la justice nous attache à Dieu, et le second nous attache à l'homme : le premier s'appelle religion et le second humanité. Cette première vertu est propre et particulière aux justes et aux serviteurs de Dieu. Il n'a pas donné la sagesse aux bêtes, mais seulement des armes pour leur défense. Au contraire, ayant fait naître l'homme nu et faible, il lui a donné la sagesse pour éviter les peines et pour se garantir des disgrâces; mais il lui a donné en même temps l'humanité pour aimer, pour secourir et pour défendre les autres hommes : c'est le lien de toute société, que nul ne peut rompre sans se rendre coupable d'un parricide. Nous sommes tous unis de parenté, puisque nous sommes tous descendus du premier homme que Dieu avait formé, et ainsi on ne peut sans crime haïr un homme, quand même il serait coupable. C'est pour cela que Dieu nous a défendu d'entretenir ni d'inimitié, ni de haine. De plus, nous sommes tous frères, puisque nos âmes ont été l'œuvre de Dieu. Cette union est plus étroite et plus sainte que celle du corps ; et Lucrèce ne s'est pas trompé quand il a dit que nous sommes tous originaires du ciel et tous descendus du même père. Il faut donc regarder comme des bêtes farouches ceux qui, s'étant dépouillés de tout sentiment d'humanité, volent les hommes, les tourmentent et les font mourir. Dieu veut que nous entretenions si religieusement cette union fraternelle, qu'il nous défend de faire du mal à personne et nous commande de faire du bien à tout le monde. Il explique ce que c'est que de faire du bien, en disant : que c'est assister nos frères dans le besoin et leur donner de quoi vivre quand ils sont dans la pauvreté. C'est pour cela que Dieu a ordonné que nous vécussions en société et que nous considérassions en chaque personne la nature qui nous est commune. Nous ne méritons pas d'être assistés si nous refusons d'assister les autres. Les philosophes n'ont laissé aucuns préceptes sur ce sujet, et ayant été éblouis par l'éclat d'une fausse vertu, ils ont ôté à l'homme la miséricorde, et accru les maladies qu'ils promettaient de guérir. Bien qu'ils demeurent d'accord qu'il faut entretenir le lien de la société civile, ils le rompent par la rigueur inflexible qu'ils attribuent à la vertu. Je réfuterai en cet endroit l'erreur de ceux qui croient qu'il ne faut rien donner à personne. Ils rapprochent plusieurs raisons par lesquelles ils disent que les hommes ont été obligés de bâtir des villes. Ils assurent que ceux qui étaient nés de la terre vécurent dans les forêts sans entretenir aucune société, ni par le discours, ni par les lois; qu'ils n'avaient point d'autres lits que des herbes et des feuillages, d'autres maisons que des antres et des cavernes, et qu'étant exposés aux incursions des bêles, ils servaient souvent de proie à leur cruauté ; que ceux qui étaient échappés d'entre leurs dents, et qui avaient vu dévorer leurs proches, avaient imploré par gestes les secours des autres hommes, et ayant donné des noms à chaque chose, avaient inventé l'usage de la parole; qu'ayant reconnu que, bien qu'ils fussent nés ensemble, ils n'étaient pas pour cela en sûreté contre la violence des bêtes ; ils se fermèrent de murailles, afin que leur repos ne fût plus troublé durant la nuit. Que les esprits qui ont inventé ces bagatelles étaient faibles ! Que ceux qui les ont publiées et qui en ont voulu conserver la mémoire étaient imprudents! Quand ils ont vu que les animaux avaient reçu de la nature l'inclination de s'assembler et de s'attaquer les uns les autres, d'éviter le péril, de se retirer dans des antres, ils se sont imaginé que les hommes avaient appris de leur exemple ce qu'ils devaient craindre et ce qu'ils devaient rechercher, et que jamais ils ne se seraient assemblés, ni n'auraient inventé l'usage de la parole, si quelques-uns d'entre eux n'avaient été mangés auparavant par les bêtes. D'autres ont soutenu que cette imagination est extravagante, comme elle l'est en effet, et ont assuré que les hommes ne se sont point assemblés par le seul désir de s'opposer à la violence des bêtes, mais par un sentiment qui les éloigne de la solitude et leur fait rechercher la compagnie. Leur différend n'est pas fort grand : ils semblent s'accorder au fond, bien qu'ils n'apportent pas la même raison des premières assemblées des hommes. L'une et l'autre était possible; mais ni l'une ni l'autre n'est vraie. Les hommes ne sont pas nés de la terre, ni des dents d'un dragon, comme les poètes l'ont feint. Le premier homme a été formé par les mains de Dieu, et la terre a été peuplée de ses descendants, de la même sorte qu'elle l'a été par les enfants de Noé depuis le déluge. Les hommes n'ont jamais été sur la terre sans avoir l'usage de la parole, comme chacun le reconnaîtra aisément pour peu qu'il ait de lumière. Supposons néanmoins qu'il y ait quelque vérité dans ces fables, que d'impertinents vieillards ont inventées durant un trop grand loisir, et détruisons-les par les mêmes moyens par où ils s'efforcent de les établir. Si les hommes se sont assemblés pour x pouvoir secourir mutuellement, il ne leur faut point refuser le secours qu'on leur peut rendre. Ceux qui refusent l'assistance qu'ils peuvent rendre, se privent de celle qu'ils pourraient recevoir; et il faut même qu'en refusant d'assister les autres, ils se persuadent n'avoir besoin de personne. Quiconque se retranche ainsi de la société humaine ne peut plus vivre d'une autre manière que les bêtes. Ceux qui ne se veulent pas abaisser à ce genre de vie, sont obligés d'entretenir la société, de rendre aux autres tous les secours qu'ils peuvent, et d'en attendre de semblables quand ils en auront besoin.
Que si les hommes ne se sont assemblés que par un mouvement
d'humanité et de tendresse, ils doivent se connaître et s'unir par ce mouvement;
et certes si ceux qui étaient encore si grossiers et si ignorants qu'ils
n'avaient aucun usage de la parole, ont témoigné par leurs gestes l'inclination
qu'ils avaient d'établir entre eux une communauté, ceux qui mènent une vie fort
polie, et qui sont si fort accoutumés à la fréquentation des autres qu'ils ne
pourraient souffrir la solitude, ne doivent-ils pas être encore plutôt dans ce
sentiment ? |
|
CAPUT XI. De personis in quas beneficium sit conferendum. Conservanda est igitur humanitas, si homines recte dici velimus. Id autem ipsum conservare humanitatem, quid aliud est, quam diligere hominem, quia homo sit, et idem quod nos sumus? Discordia igitur atque dissensio non est secundum hominis rationem. Verumque est illud Ciceronis, quod ait, hominem naturae obedientem homini nocere non posse. Ergo si nocere homini contra naturam est, prodesse igitur homini secundum naturam sit necesse est. Quod qui non facit, hominis se appellatione dispoliat; quia humanitatis officium est, necessitati hominis ac periculo subvenire. Quaero igitur ab iis, qui flecti ac misereri non putant esse sapientis: si homo ab aliqua bestia comprehensus, auxilium sibi armati hominis imploret, utrumne succurrendum putent, an minime? Non sunt tam impudentes, ut negent fieri oportere quod flagitat, quod exposcit humanitas. Item si aliquis circumveniatur igni, ruina opprimatur, mergatur mari, flumine rapiatur, num putent hominis esse, non auxiliari? non sunt ipsi homines, si putent. Nemo enim potest ejusmodi periculis non esse subjectus. Imo vero et hominis et fortis viri esse dicent, servare periturum. Si ergo in ejusmodi casibus, qui periculum vitae homini afferunt, succurrere humanitatis esse concedunt, quid causae est, cur, si homo esuriat, sitiat, algeat, succurrendum esse non putent? Quae cum sint paria natura cum illis casibus fortuitis, et unam eamdemque humanitatem desiderent, tamen illa discernunt, quia non re ipsa vera, sed utilitate praesenti omnia metiuntur. Illos enim, quos periculo surripiunt, sperant sibi gratiam relaturos. Egentes autem, quia non sperant, perire arbitrantur quidquid ejusmodi hominibus impertiant. Hinc est illa Plauti detestanda sententia:
Male meretur, qui mendico dat, quod
edat. Et illi producit vitam ad miseriam. Atenim poeta fortasse pro persona locutus est.
Quid Marcus Tullius in suis
Officialibus libris, nonne hoc idem suadet, non esse omnino
largiendum? Sic enim dixit: « Largitio quae fit ex re familiari,
fontem ipsum benignitatis exhaurit; ita benignitate benignitas
tollitur, qua quo in plures usus sis, eo minus in multos uti possis.
» Et idem paulo post: « Quid autem est stultius, quam quod libenter
facias, curare ut id diutius facere non possis? » Videlicet
professor sapientiae refrenat homines ab humanitate, monetque ut rem
familiarem diligenter custodiant; malintque arcam, quam justitiam
conservare. Quod cum intelligeret inhumanum esse, ac nefarium, mox
alio capite, quasi actus poenitentia, sic ait: « Nonnunquam tamen
est largiendum; nec hoc benignitatis genus omnino repudiandum, et
saepe idoneis hominibus egentibus de re familiari impertiendum. »
Quid est idoneis? nempe iis, qui restituere ac referre gratiam
possint. Si nunc Cicero viveret, exclamarem profecto: Hic, hic,
Marce Tulli, aberrasti a vera justitia; eamque uno verbo sustulisti;
cum pietatis et humanitatis officia utilitate metitus es. Non enim
idoneis hominibus largiendum est, sed quantum potest, non idoneis.
Id enim juste, id pie, id humane sit, quod fine spe recipiendi
feceris. Quid enim dicendum est de iis, qui populari levitate ducti, vel magnis urbibus suffecturas opes exhibendis muneribus impendunt? nisi eos dementes atque furiosos, qui praestent id populo, quod et ipsi perdant, et nemo eorum, quibus praestatur, accipiat. Itaque ut est omnis voluptas caduca et brevis, oculorum maxime et aurium, aut obliviscuntur homines, et alterius damna pro ingratis habent; aut etiam offenduntur, si non est libidini vulgi satisfactum: ut etiam homines stultissimi malum sibi malo comparaverint; aut si adeo placuerunt, nihil amplius, quam inanem favorem paucorumque dierum fabulas assequuntur. Sic quotidie levissimorum hominum patrimonia in res supervacuas prodiguntur. Num ergo illi sapientius, qui utiliora et diuturniora civibus suis exhibent munera? ii scilicet, qui publicis operibus extructis, memoriam nomini suo quaerunt? ne isti quidem recte bona sua in terra sepeliunt; quia nec memoria quidquam mortuis confert, nec opera eorum sempiterna sunt: siquidem aut uno tremore terrae dissipantur et corruunt, aut fortuito consumuntur incendio, aut hostili aliquo impetu diruuntur, aut certe vetustate ipsa dissoluta labuntur. « Nihil est enim ut ait orator, opere et manufactum quod non conficiat et consumat vetustas. At haec justitia et lenitas florescit quotidie magis. » Illi ergo melius, qui tribulibus suis aut clientibus largiuntur: aliquid enim praestant hominibus, et prosunt: sed non est illa vera et justa largitio. Beneficentia enim nulla est, ubicumque necessitas non est. Perit ergo quidquid gratiae causa tribuitur non indigentibus; aut cum foenore redit, et beneficentia non erit. Quod et si gratum est iis, quibus datur, justum tamen non est, quia si non fiat, nihil mali sequitur. Unum igitur certum et verum liberalitatis officium est, egentes atque inutiles alere. CAPUT XII. De generibus beneficentiae, et operibus misericordiae. Haec est illa perfecta justitia, quae custodit humanam, de qua philosophi loquuntur, societatem. Hic divitiarum maximus ac verissimus fructus est, non uti opibus ad propriam unius voluptatem, sed ad multorum salutem, non ad praesentem suum fructum, sed ad justitiam, quae sola non interit. Tenendum est igitur omni modo, ut ab officio misericordiae spes recipiendi absit omnino. Hujus enim operis et officii merces a Deo est expectanda solo: nam si ab homine expectes, jam non humanitas erit illa, sed beneficii foeneratio; nec potest videri bene meruisse, qui quod facit, non alteri, sed sibi praestat; et tamen res eodem redit; ut quod alteri quisque praestiterit, nihil ab eo commodi sperans, vere sibi praestet, quia mercedem capiet a Deo. Idem Deus praecepit, ut si quando coenam paraverimus, eos in convictum adhibeamus, qui revocare non possint et vicem reddere; ut omnis actus vitae nostrae non careat misericordiae munere. Nec tamen quisquam interdictum sibi putet, aut communione cum amicis, aut charitate cum proximis. Sed notum nobis Deus fecit, quod sit verum et justum opus, ita nos oportet cum proximis vivere, dummodo sciamus illud ad hominem, hoc ad Deum pertinere. Praecipua igitur virtus est hospitalitas; quod philosophi quoque aiunt: sed eam detorquent a vera justitia, et ad commodum rapiunt. « Recte, inquit Cicero, a Theophrasto est laudata hospitalitas. Est enim (ut mihi quidem videtur) valde decorum, patere domos hominum illustrium hospitibus illustribus. » Eodem modo rursus erravit, quo tum, cum idoneis esse diceret largiendum. Non enim justi et sapientis viri domus illustribus debet patere, sed humilibus et abjectis. Nam illustres illi ac potentes nulla re possunt indigere; quos opulentia sua et munit, et honorat. Nihil autem a viro justo faciendum est, nisi quod sit beneficium. Beneficium autem si refertur, interit, atque finitur; nec enim possumus id habere integrum, cujus pretium nobis persolutum est. In his itaque beneficiis justitiae ratio versatur, quae salva et incorrupta permanserint: permanent autem non aliter, quam si praestentur hominibus iis, qui prodesse nullo modo possunt. At ille in recipiendis illustribus nihil spectavit aliud, nisi utilitatem; nec dissimulavit homo ingeniosus, quid ex eo commodi speraret. Ait enim, qui id faciat, potentem apud exteros futurum per gratiam principum, quos sibi hospitii et amicitiae jure constrinxerit. O quam multis argumentis Ciceronis inconstantia, si id agerem, coargui posset! Nec tam nostris, quam suis verbis refelleretur. Idem quippe ait, ut quisque maxime ad suum commodum referat, quaecumque agit, ita minime esse virum bonum. Idem etiam negat, simplicis et aperti hominis esse, ambire, simulare aliquid, et praetendere, aliud agere videri, cum aliud agat; praestare se alteri fingere, quod sibi praestet: sed malitiosi potius, et astuti, et fallacis, et subdoli. Quomodo ergo defenderet, quominus ambitiosa illa hospitalitas malitia esset? « Tu mihi per omnes portas circumcurses, ut advenientes populorum atque urbium principes domum tuam invites, ut per eos apud cives eorum potentiam consequare; velisque te justum, et humanum, et hospitalem videri, cum studeas utilitati tuae. » Verum hoc ille non potius incaute? Quid enim minus in Ciceronem convenit? Sed ignorantia veri juris, prudens ac sciens in hos se laqueos induit. Quod ut ei possit ignosci, testificatus est non ad veram justitiam, quam non teneat, praecepta se dare; sed ad umbram imaginemque justitiae. Ignoscendum est igitur umbratico et imaginario praeceptori; nec ab eo veritas exigenda est, qui se nescire fateatur. Captivorum redemptio magnum atque praeclarum justitiae munus est: quod idem ipse Tullius approbavit. « Atque haec benignitas, inquit, etiam reipublicae est utilis, redimi e servitute captos, locupletari tenuiores. Hanc ego consuetudinem benignitatis largitioni munerum longe antepono. Haec est gravium hominum, atque magnorum. » Proprium igitur justorum opus est, alere pauperes, ac redimere captivos, cum apud injustos, si qui haec faciant, graves et magni appellentur. Iis enim maximae laudis est benefacere, quos nemo speravit esse facturos. Nam qui bonum facit vel consanguineo, vel proximo, vel amico; aut nullam, aut certe non magnam laudem meretur; quia facere debet, sitque impius ac detestabilis, nisi fecerit id, quod ab eo et natura ipsa, et necessitudo exigit; et si facit, non tam gloriae assequendae, quam reprehensionis vitandae gratia facit. Qui autem fecit alieno, et ignoto, is vero dignus est laude; quoniam, ut faceret, sola ductus est humanitate. Ibi ergo justitia est, ubi ad benefaciendum necessitatis vinculum nullum est. Hoc igitur officium benignitatis ne anteponere quidem largitioni munerum debuit, quod est comparantis, et e duobus bonis id, quod sit melius, eligentis. Illa enim largitio hominum patrimonia sua in mare abjicientium inanis, et levis, et ab omni justitia remotissima est. Itaque ne dici quidem munera oportet, in quibus nemo accipit, nisi qui accipere non meretur. Non minus magnum justitiae opus est, pupillos et viduas destitutos, et auxilio indigentes tueri, atque defendere. Quod adeo universis divina lex illa praescribit; quando quidem boni quique judicesad officium suum judicant pertinere, ut eos naturali humanitate foveant, ac iisdem prodesse nitantur. Verum haec opera proprie nostra sunt, qui legem, qui verba ipsius Dei praecipientis accepimus. Nam illi sentiunt quidem natura esse justum tueri eos, qui tutela carent: sed, cur ita sit, non perspiciunt. Deus enim, cujus perpetua clementia est, idcirco viduas pupillosque defendi ac foveri jubet, ne quis respectu ac miseratione pignorum suorum retardetur, quominus mortem pro justitia fideque suscipiat: sed incunctanter ac fortiter subeat, cum sciat se caros suos Deo relinquere, nec his unquam praesidium defuturum. Aegros quoque, quibus defuerit qui assistat, curandos fovendosque suscipere, summae humanitatis et magnae operationis est: quod qui fecerit, vivam hostiam Deo acquiret; et quod alteri dederit ad tempus, ipse a Deo accipiet in aeternum. Ultimum illud et maximum pietatis officium est, peregrinorum et pauperum sepultura: quod illi virtutis justitiaeque doctores prorsus non attigerunt. Nec enim poterant id videre, qui utilitate omnia officia metiebantur. In caeteris enim, quae supra dicta sunt, quamvis verum limitem non tenuerint; tamen, quoniam commodi aliquid in his deprehenderunt, quasi odore quodam veritatis retenti, propius oberrarunt: hoc autem, quia nihil videre in eo commodi poterant, reliquerunt. Quin etiam non defuerunt, qui supervacaneam facerent sepulturam; nihilque esse dicerent mali, jacere inhumatum atque abjectum: quorum impiam sapientiam, cum omne humanum genus respuit, tum divinae voces, quae id fieri jubent. Verum illi non audent dicere, id non esse faciendum: sed, si forte non fiat, nihil esse incommodi. Itaque in ea re non tam praecipientium, quam consolantium funguntur officio, ut si forte id sapienti evenerit, ne se ob hoc miserum putet. Nos autem non quid sapienti ferendum sit dicimus: sed quid facere ipse debeat. Itaque non quaerimus nunc utrumne tota sepeliendi ratio sit utilis, necne: sed haec, etiamsi sit inanis (ut illi existimant), tamen facienda est, vel ob hoc solum, quod apud homines bene et humane fieri videtur. Animus enim quaeritur, et propositum ponderatur. Non ergo patiemur, figuram et figmentum Dei feris ac volucribus in praedam jacere: sed reddemus id terrae, unde ortum est; et quamvis in homine ignoto necessariorum munus implebimus, in quorum locum, quia de sunt, succedat humanitas, et ubicumque homo desiderabitur, ibi exigi officium nostrum putabimus. In quo autem magis justitiae ratio consistit, quam in eo, ut quod praestamus nostris per affectum, praestemus alienis per humanitatem; quae est multo certior justiorque? Quae cum fit, jam non homini praestatur, qui nihil sentit; sed Deo soli, cui carissimum sacrificium est opus justum. Dicet aliquis fortasse: Si haec omnia fecero, nihil habebo. Quid enim, si magnus hominum numerus egebit, algebit, capietur, morietur, ut haec facientem vel uno die patrimonio exui sit necesse, perdamne rem familiarem, meo, aut majorum labore quaesitam, ut jam ipsi mihi aliena misericordia vivendum sit? Quid tu tam pusillo animo paupertatem times? quam etiam vestri philosophi laudant: nihil hac tutius, nihilque tranquillius esse testantur. Hoc quod times, sollicitudinum portus est. An ignoras, quot periculis, quot casibus cum his malis opibus subjaceas? Quae tecum bene agent, si sine tuo cruore transierint. Tu vero praeda onustus incedis, et spolia geris, quae irritent animos etiam tuorum. Quid ergo dubitas bene collocare id, quod tibi forsan eripiet aut unum latrocinium, aut existens repente proscriptio, aut hostilis aliqua direptio? Quid verere fluxum et fragile bonum facere sempiternum, aut thesauros tuos custodi Deo credere, ubi non furem praedonemque timeas, non rubiginem, non tyrannum? Qui apud Deum dives est, pauper esse nunquam potest. Si justitiam tanti putas, sequere, abjectis oneribus quae te premunt: libera te ipsum compedibus et catenis, ut expeditus ad Deum curras. Magni et excelsi animi est despicere et calcare mortalia. Sed si hanc virtutem non capis, ut divitias tuas in aram Dei conferas, ut fragilibus tibi compares firmiora, liberabo te metu. Omnia ista praecepta non tibi soli dantur, sed omni populo, qui mente conjunctus est, et cohaeret sicut homo unus. Si solus magnis operibus non sufficis, pro virili parte operare justitiam, sic tamen, ut quantum divitiis inter caeteros, tantum opere praecellas. Neque nunc suaderi tibi putes, ut rem familiarem tuam minuas, vel exhaurias: sed quae in supervacua fueras impensurus, ad meliora convertas. Unde bestias emis, hinc captos redime; unde feras pascis, hinc pauperes ale; unde homines ad gladium comparas, hinc innocentes mortuos sepeli. Quid prodest perditae nequitiae bestiarios facere locupletes, et instruere ad flagitia? Transfer ad magnum sacrificium male peritura; ut pro his veris muneribus habeas a Deo munus aeternum. Magna est misericordiae merces, cui Deus pollicetur peccata se omnia remissurum. Si audieris, inquit, preces supplicis tui, et ego audiam tuas. Si misertus laborantium fueris, et ego in tuo labore miserebor. Si autem non respexeris, nec adjuveris, et ego animum tuum contra te geram, tuisque te legibus judicabo. CAPUT XIII. De poenitentia, de misericordia, ac peccatorum venia. Quoties igitur rogaris, tentari te a Deo crede, an sis dignus audiri. Circumspice conscientiam tuam et, quantum potes, medere vulneribus. Nec tamen quia peccata largitione tolluntur, dari tibi licentiam peccandi putes. Abolentur enim, si Deo largiare, quia peccaveris; nam si fiducia largiendi pecces, non abolentur. Deus enim purgari homines a peccatis maxime cupit, ideoque agi poenitentiam jubet. Agere autem poenitentiam, nihil aliud est, quam profiteri et affirmare, se ulterius non peccaturum. Ignoscitur itaque iis qui ad peccatum imprudenter incauteque labuntur: veniam non habet, qui sciens peccat. Nec tamen si aliquis fuerit purificatus ab omni labe peccati, temperandum sibi ab opere largitionis existimet, quia non habeat peccata, quae deleat. Imo vero tum magis justitiam debet operari, cum factus est justus, ut quod ante in medelam vulnerum fecerat, postmodum faciat in laudem gloriamque virtutis. Eo accedit, quod nemo esse sine delicto potest, quandiu indumento carnis oneratus est. Cujus infirmitas triplici modo subjacet dominio peccati, factis, dictis, cogitationibus. Per hos gradus ad summum culmen justitia procedit. Primus est virtutis gradus malis operibus abstinere; secundus, etiam malis verbis; tertius, etiam cogitatione rerum malarum. Qui primum gradum ascendit, satis justus est; qui secundum, jam perfectae virtutis: siquidem neque factis, neque sermone delinquat: qui tertium, is vero similitudinem Dei assecutus videtur. Est enim pene supra humanum modum, ne in cogitationem quidem admittere, quod sit vel factu malum, vel improbum dictu. Itaque etiam justi homines, qui fraenare se possunt ab omni opere injusto, nonnunquam tamen ipsa fragilitate vincuntur, ut vel in ira malum dicant, vel in aspectu rerum delectabilium tacita cogitatione concupiscant. Quod si mortalis conditio non patitur esse hominem ab omni macula purum, debent ergo largitione perpetua peccata carnis aboleri. Unum est enim sapientis, et justi, et vitalis viri opus, divitias suas in sola justitia collocare: qua profecto qui eget, licet ille Craesum, aut Crassum divitiis superet, hic pauper, hic nudus, hic mendicus putandus est. Danda igitur opera, ut indumento justitiae pietatisque velemur, quo nos exuat nemo, quod nobis sempiternum praebeat ornatum. Nam si deorum cultores simulacra insensibilia excolunt, et quidquid pretiosi habent, in ea conferunt, quibus nec uti possunt, nec gratias agere, quod acceperint: quanto justius est, et verius, viventia Dei simulacra excolere, ut promereare viventem? Quae sicut usui habent quidquid acceperint, et gratias agunt: ita Deus, in cujus conspectu bonum feceris, et probabit, et mercedem pietatis exsolvet. CAPUT XIV. De affectibus, ac de iis Stoicorum sententia, et de virtute, vitiis et misericordia. Si ergo in homine praeclarum et excellens est bonum misericordia, idque divinis testimoniis, et bonorum malorumque consensu optimum judicatur: apparet philosophos longe abfuisse ab humano bono qui neque praeceperunt ejusmodi quidquam, neque fecerunt; sed virtutem, quae in homine propemodum singularis est, pro vitio semper habuerunt. Libet hic interponere unum de philosophia locum, ut illorum plenius coarguamus errores, qui misericordiam, cupiditatem, metum, morbos animi appellant. Conantur illi quidem virtutes a vitiis distinguere, quod est sane facillimum. Quis enim non possit liberalem a prodigo separare (ut illi faciunt) aut parcum a sordido, aut quietum ab inerti, aut cautum a timido? quod haec, quae sunt bona, fines suos habeant; quos si excesserint, in vitia labuntur: ita ut constantia, nisi pro veritate suscepta sit, fit impudentia; item fortitudo, si nulla necessitate cogente, aut non pro causa honesta certum periculum subierit, in temeritatem convertitur. Libertas quoque, si alios insectetur, potius quam insectantibus resistat, contumacia est. Severitas etiam, nisi se intra congruentes nocentium poenas coerceat, fit saeva crudelitas. Itaque dicunt, eos, qui mali videantur, non sua sponte peccare, nec mala potius eligere: sed bonorum specie lapsos, incidere in mala, dum bonorum ac malorum discrimen ignorant. Haec quidem falsa non sunt: sed ad corpus cuncta referuntur. Nam parcum esse, aut constantem, aut cautum, aut quietum, aut fortem, aut severum, virtutes sunt quidem, sed hujus temporariae vitae. Nos autem, qui hanc vitam contemnimus, alias nobis virtutes propositas habemus, de quibus philosophi ne suspicari quidem ulla ratione potuerunt. Itaque et virtutes quasdam pro vitiis, et vitia quaedam pro virtutibus habuerunt. Nam Stoici affectus omnes, quorum impulsu animus commovetur, ex homine tollunt; cupiditatem, laetitiam, metum, moestitiam, quorum duo priora ex bonis sunt aut futuris, aut praesentibus, posteriora ex malis. Eodem modo haec quatuor, morbos (ut dixi) vocant, non tam natura insitos, quam prava opinione susceptos. Et idcirco eos censent extirpari posse radicitus, si bonorum malorumque opinio falsa tollatur. Si enim nihil censeat sapiens bonum, nihil malum; nec cupiditate ardescet, nec laetitia gestiet, nec metu terrebitur, nec aegritudine contrahetur. Mox videbimus, an efficiant, quod velint, aut quid efficiant: interim propositum arrogans, ac pene furiosum, qui se putent mederi, et eniti posse contra vim rationemque naturae. CAPUT XV. De affectibus ac de iis Peripateticorum sententia.
Haec enim naturalia esse, non
voluntaria, omnium viventium ratio demonstrat, quae iisdem omnibus
quatitur affectibus. Peripatetici ergo rectius, qui haec omnia
detrahi posse negant, quia nobiscum simul nata sint; et conantur
ostendere, quam providenter, et quam necessario Deus, sive natura
(sic enim dicunt) his nos armarit affectibus: quos tamen, quia
vitiosi plerumque fiunt, si nimii sint, posse ab homine, adhibito
modo, salubriter temperari, ut tantum homini, quantum naturae satis
est, relinquatur. Non insipiens disputatio, si (ut dixi) non ad hanc
vitam omnia referrentur. Stoici ergo furiosi, qui ea non temperant,
sed abscindunt, rebusque a natura insitis castrare hominem
quodammodo volunt. Quod tale est, quale si velint, aut metum
detrahere cervis, aut venenum anguibus, aut iram feris, aut
placiditatem pecudibus. Nam quae singula mutis animalibus data sunt,
ea vero universa homini simul. Quod si, ut medici affirmant,
laetitiae affectus in splene est, irae in felle, libidinis in jecore,
timoris in corde; facilius est interficere animal ipsum, quam ex
corpore aliquid evellere: quod est animantis naturam velle mutare.
Sed homines prudentes non intelligunt, cum vitia ex homine tollunt,
etiam se virtutem tollere, cui soli locum faciunt. Nam si virtus
est, in medio irae impetu seipsum cohibere ac reprimere, quod negare
non possunt; caret ergo virtute, quisquis ira caret. Si virtus est,
libidinem corporis continere; virtute careat necesse est, qui
libidinem quam temperet, non habet. Si virtus est, cupiditatem ab
alieni appetitione fraenare; nullam certe virtutem potest habere,
qui caret eo ad quod cohibendum virtutis usus adhibetur. Ubi ergo
vitia non sunt, nec virtuti quidem locus est: sicut nec victoriae
quidem, ubi adversarius nullus est. Ita fit, ut bonum sine malo esse
in hac vita non possit. Affectus igitur, quasi ubertas est naturalis
animorum. Nam sicut in sentes ager, qui est natura foecundus,
exuberat: sic animus incultus, vitiis sua sponte invalescentibus,
velut spinis obducitur. Sed cum verus cultor accesserit, statim,
cedentibus vitiis, fruges virtutis oriuntur.
Ut enim praesentibus laetamur bonis:
sic malis angimur, ac dolemus. Si ergo laetitiae, quoniam vitiosam
putabant, nomen aliud indiderunt: sic aegritudini, quoniam et ipsam
vitiosam putabant, aliud vocabulum tribui congruebat. Unde apparet
non illis rem defuisse, sed verbum; cujus indigentia eum totum
affectum, qui est vel maximus, contra quam natura pateretur, auferre
voluerunt. Nam illas nominum commutationes poteram coarguere
pluribus, et ostendere, aut sermonis ornandi, augendaeque copiae
gratia, multa nomina iisdem rebus imposita, aut certe non multum
inter se illa distare. Nam et cupiditas a voluntate incipit; et
cautio a metu oritur; et laetitia nihil aliud est, quam professum
gaudium. Sed putemus, ut ipsi volunt, esse diversa. Nempe igitur
cupiditatem esse dicent, perseverantem ac perpetuam voluntatem;
laetitiam vero, insolenter se efferens gaudium; metum autem, nimiam
et excedentem modum cautionem. Ita fit, ut ea, quae tollenda esse
censent, non tollant, sed temperent; siquidem nomina tantummodo
immutant, res ipsae manent. Eo igitur imprudentes revolvuntur, quo
Peripatetici ratione perveniunt; ut vitia, quoniam tolli non possunt,
medie temperanda sint. Ergo errant, quia non efficiunt, quod volunt,
et longo asperoque circuitu in eamdem viam redeunt. |
XI. Il faut avoir des sentiments d'humanité, si nous voulons retenir le titre d'homme. Or qu'est-ce autre chose d'avoir des sentiments d'humanité, si ce n'est d'aimer les hommes parce qu'ils ont la même nature que nous? Il n'y a rien de si contraire à la nature de l'homme que la dissension et la discorde. Cette parole de Cicéron est très véritable, « qu'un homme qui suit les sentiments de la nature ne saurait jamais nuire à un autre homme. » Si c'est une action contraire à la nature que de nuire à un homme, ce sera une action conforme à la nature que de l'assister. Quiconque manque à ce devoir renonce à la qualité d'homme. Je demander volontiers si ceux qui soutiennent qu'un homme sage ne doit point être touché de compassion, s'ils en voyaient un qui aurait des armes, et de qui un autre, qui aurait été enlevé par une bête farouche, implorerait le secours, il le devrait secourir ou l'abandonner. Ils ne sont pas assez impudents pour nier qu'il dût faire ce que l'humanité demande en ces occasions. Si un homme était au milieu d'un incendie ou sous les ruines d'une maison, ou s'il était tombé dans l'eau soit d'un fleuve ou de la mer, n'avoueront-ils pas que l'humanité oblige à le secourir? Ils ne seraient pas hommes s'ils ne l'avouaient ; car il n'y a personne qui ne puisse tomber en quelques-uns de ces dangers, ils demeureront d'accord qu'un homme de cœur fera tout ce qu'il pourra pour sauver celui qu'il verra en danger de périr. Ceux qui n'oseraient disconvenir que l'humanité oblige à sauver ceux qui se rencontrent dans ces périls, ont-ils quelque raison pour prétendre que l'on n'est pas obligé de secourir ceux qui sont pressés de la faim ou de la soif, ceux qui n'ont point d'habits pour se couvrir durant la rigueur du froid. Bien qu'il y ait la même raison pour assister ceux qui tombent dans les hasards extraordinaires d'un embrasement ou d'un naufrage, que ceux qui sont dans la nécessité plus commune de la pauvreté, ils y mettent de la différence, parce qu'ils mesurent toutes choses par leur intérêt, et qu'ils espèrent que ceux qu'ils auront délivrés d'un danger leur en témoigneront de la reconnaissance; au lieu que les pauvres qu'ils auront assistés ne leur en témoigneront jamais, parce qu'ils périront bientôt de misère. C'est de ce sentiment que vient cette exécrable parole de Plaute : « Que celui qui donne l'aumône à un pauvre lui rend un mauvais office ; car outre qu'il perd ce qu'il lui donne, en prolongeant sa vie il prolonge aussi sa misère. » On peut néanmoins excuser Plaute d'avoir mis ces paroles dans la bouche d'une personne à qui elles convenaient. Mais peut-on excuser Cicéron d'avoir conseillé dans les livres des Offices de ne rien donner à personne? Voici comment il parle: » Les largesses que l'on fait de son propre bien en épuisent le fonds, et ainsi la libéralité se détruit en quelque sorte elle-même; car plus on l'a exercée, et moins on est en pouvoir de l'exercer. « Il ajoute un peu après : « Y a-t-il rien de si extravagant que de se mettre en état de ne pouvoir faire longtemps ce que l'on fait avec plaisir? » Voilà comment ce professeur de la sagesse détourne les hommes des devoirs de l'humanité, et comment il les avertit d'avoir un plus grand soin de conserver leur bien, que d'observer la justice. Il a si bien reconnu lui-même que ce conseil est cruel et criminel, qu'il semble l'avoir rétracté en un autre endroit, où il s'explique de cette sorte : « Il faut pourtant donner quelquefois, et faire part de son bien à des personnes capables. » Qui sont les personnes capables, sinon celles qui peuvent reconnaître les bienfaits ? Si Cicéron vivait encore, je m'écrierais, en lui adressant la parole : Vous vous êtes égaré en cet endroit ; vous avez ôté la justice d'entre les hommes, quand vous avez réglé sur l'intérêt les devoirs de l'humanité et de la piété. Ce ne sont pas ceux qui peuvent témoigner de la reconnaissance qu'il faut assister ; ce sont principalement ceux qui n'en peuvent témoigner : car quand vous les aurez soulagés sans espérance d'aucune reconnaissance, vous vous serez alors acquitté des devoirs de la justice, de la piété et de l'humanité. Voilà en quoi consiste la véritable justice dont vous nous accusez de n'avoir pas seulement l'image. Vous dites en plusieurs endroits de vos ouvrages que la vertu n'agit pas par intérêt, et vous avouez dans le livre des Lois que la libéralité est généreuse, et qu'elle ne demande point de récompense. « Il est certain, dites-vous en un endroit, que celui qui est libéral et bienfaisant ne cherche que la gloire de son action, et ne songe point au profit qu'il en peut tirer. » Pourquoi donc dites-vous en un autre endroit que vous n'obligerez que des personnes capables de le reconnaître ? N'est-ce pas que vous en voulez recevoir la récompense ? Selon vos conseils, on laissera mourir un homme de faim et de froid, quand on verra qu'il ne sera jamais en état de reconnaître les secours qu'on lui aurait rendus. Un homme qui sera dans l'abondance et dans le luxe n'en soulagera pas un autre qui sera dans la dernière nécessité? Vous dites que la vertu n'attend point de récompense, et qu'elle mérite d'être recherchée pour elle-même. Jugez donc de la justice qui est la première et comme la mère de toutes les vertus, non par votre intérêt, mais par son propre prix, et mettez vos bienfaits entre les mains de ceux qui ne vous peuvent jamais rien rendre. Pourquoi choisissez-vous les personnes? Vous devez regarder comme des hommes tous ceux qui implorent votre secours dans la croyance que vous avez de l'humanité. Gardez la justice, et défaites-vous de l'ombre et de l'apparence. Donnez aux aveugles, aux boiteux, aux estropiés, à ceux qui sont dépourvus de secours et qui sont en danger de mourir si vous ne les assistez. S'ils sont inutiles aux hommes, ils ne sont pas inutiles à Dieu, puisqu'il leur laisse la jouissance de la vie. Faites ce que vous pourrez pour la conserver. Quiconque pouvant assister un homme qui est en danger de mourir ne l'assiste pas, est la cause de sa mort. Ceux qui ont renoncé aux sentiments de la nature, et qui ne savent pas quelle est la solide récompense dès bonnes actions, perdent leur bien par l'appréhension de le perdre ; ils tombent dans l'inconvénient qu'ils veulent éviter, qui est qu'ils ne tirent aucun profit de ce qu'ils dépensent, ou qu'ils n'en tirent qu'un profit qui ne dure que fort peu de temps. Ils refusent une légère aumône à un pauvre, et aiment mieux perdre l'humanité que la moindre partie de leur bien ; et en d'autres occasions, ils font des dépenses qui sont tout ensemble et immenses et inutiles. Que dirons-nous de ceux qui emploient à des jeux et à des combats des richesses qui suffiraient à nourrir les habitants d'une ville entière, si ce n'est que ce sont des furieux qui prodiguent leur bien sans que personne en tire aucun fruit. Il n'y a point de plaisirs qui soient de longue durée. Ceux qui se prennent par les yeux ou par les oreilles passent plus vite que les autres. Ceux qui en ont joui les oublient aussitôt, et ne se sentent point obligés à ceux qui ont fait de grandes dépenses pour les leur procurer. Ils réussissent quelquefois si mal, qu'ils n'excitent que des plaintes; et quand ils réussissent, ils n'attendent qu'un applaudissement de peu de jours. Voilà comment des hommes vains dissipent leurs biens en de folles dépenses. Ceux qui les emploient à des ouvrages plus solides et à élever de superbes édifices qui puissent conserver à la postérité la mémoire de leur nom, se conduisent-ils avec plus de sagesse? Il est certain qu'ils ne font pas fort bien de cacher leurs trésors sous la terre. Il n'y a point de monuments qui soient éternels. Les louanges ne servent de rien aux morts. Les plus magnifiques bâtiments peuvent être renversés par un tremblement de terre, ou consumés par un embrasement, ou ruinés par l'irruption d'une armée, ou ruinés enfin pur la suite des temps; car, comme dit l'orateur romain : « Il n'y aucun ouvrage de la main des hommes que la longueur du temps ne détruise. » Il n'y a que la justice et la libéralité qui croissent de jour en jour. Ceux qui exercent la libéralité envers leurs concitoyens et leurs amis font mieux sans doute que ceux qui donnent des jeux et des combats au peuple, parce que ce qu'ils donnent n'est pas tout à fait perdu; mais ils ne donnent pas encore de la manière qu'il faut. Pour bien donner, il faut donner à ceux qui sont dans la nécessité. Tout ce que l'on donne à des personnes qui n'en ont pas besoin, ou ce que l'on donne à des personnes qui le pourront rendre, est mal donné. Il n'est pas donné selon la justice, puisque, quand on le retiendrait, elle n'en serait point blessée. L'unique devoir de la justice et de la libéralité est d'employer son bien à nourrir les pauvres qui sont dans un extrême besoin. XII. Voilà quelle est la parfaite justice qui entretient la société civile dont parlent les philosophes. Le véritable usage des richesses est de les employer non pour son plaisir, mais pour la conservation de plusieurs personnes par on motif d'équité, qui est une vertu qui demeure toujours. C'est donc une maxime constante: qu'il faut faire la charité sans intérêt. Il n'en faut attendre la récompense que de Dieu, et quiconque l'attendrait d'un autre, ferait un trafic au lieu de faire une charité. Il n'aurait obligé personne et n'aurait agi que pour son propre avantage. Ce n'est pas que celui qui fait du bien à un autre sans attendre rien de lui, n'y trouve aussi son propre avantage, puisqu'il en reçoit la récompense de Dieu. La miséricorde doit tellement entrer dans toutes les actions de notre vie, que Dieu nous commande d'inviter à un festin ceux qui ne sauraient nous le rendre. Ce n'est pas qu'il nous défende de converser et de manger avec nos proches et avec nos amis, pourvu que nous fassions différence des devoirs de la société et de ceux de l'amitié. L'hospitalité est une vertu fort nécessaire, comme les philosophes en demeurent d'accord. Mais ils détournent le cours que la justice lui donne pour l'appliquer à leur profit. « Théophraste, dit Cicéron, a donné à l'hospitalité les louanges qui lui sont dues, et il n'y a rien en effet de plus glorieux que de voir les maisons des personnes de condition ouvertes aux étrangers qui sont considérables ou par leur naissance ou par leur mérite. » Il s'est trompé ici de la même sorte qu'auparavant quand il a dit qu'il faut faire du bien à des personnes capables de le reconnaître. La maison d'un homme sage et d'un homme juste doit être ouverte non à des personnes illustres et éminentes en dignité, mais aux plus pauvres et aux plus méprisables. Ces personnes illustres n'ont besoin de rien ; leur propre grandeur leur suffit. Toutes les actions d'un homme juste doivent être des bienfaits. Or un bienfait périt quand il est rendu. Il ne nous est plus dû, dès que l'on nous en a payé le prix. La justice veut que les bienfaits soient entiers, et ils ne le sont jamais s'ils ne sont faits à des personnes qui ne les peuvent reconnaître. Cicéron n'a considéré que l'intérêt, quand il a dit qu'il fallait exercer l'hospitalité envers des personnes illustres, et il n'a pas même dissimulé l'avantage que Von en retire. Il a marqué clairement que l'on peut acquérir une grande réputation parmi les étrangers, par le moyen des plus considérables avec lesquels on a contracté amitié. Si j'avais entrepris de le réfuter, il me serait fort aisé de faire voir son inconsistance, et je n'emploierais pour cela que ses paroles. Il dit en un endroit que plus une personne rapporte ses actions à ses intérêts, et moins elle a de probité. Il avoue ailleurs qu'il n'est pas d'un homme sincère et honnête de dissimuler ses sentiments, de cacher ses intentions, de faire paraître par ses actions un autre dessein que celui qu'il a dans le cœur, et que cela n'appartient qu'à un homme rusé, fourbe et trompeur. Comment donc pourrait-il exempter de malice cette hospitalité exercée envers les plus illustres des étrangers avec tant d'ambition et tant de pompe? Vous allez aux portes de la ville pour inviter à loger chez vous les personnes de condition qui arrivent des pays étrangers, et vous n'y allez qu'à dessein d'acquérir, par leur moyen, du crédit et de la puissance parmi leurs concitoyens; et vous prétendez paraître juste, civil et libéral, bien que vous ne suiviez que votre intérêt? Cependant Cicéron est tombé dans cet embarras non par imprudence, car il était moins sujet à ce défaut que nul autre, mais pour n'avoir rien su de la vérité; ce qui lui est d'autant plus pardonnable qu'il a déclaré qu'il ne prétendait pas donner les préceptes de la véritable justice, parce qu'il ne la connaissait pas, mais seulement d'une justice qui eût l'ombre et l'apparence de la véritable. Il faut donc excuser ce docteur d'ombre et d'apparence, et ne lui pas demander la vérité qu'il avoue qu'il ne connaît pas.
Un des plus importants devoirs de la justice est de mettre les
prisonniers en liberté, comme Cicéron en est demeuré d'accord. « La libéralité,
dit-il, de ceux qui retirent des prisonniers, qui payent leur rançon, et qui
soulagent les pauvres, est fort utile à la république. » Celui qui fait du bien à des parents et à des amis ne mérite pas une grande louange, parce qu'il ne s'acquitte que d'un devoir auquel il est obligé par la loi de la nature et de l'amitié, et auquel il ne saurait manquer sans commettre une impiété détestable. En cela, il évite plutôt le blâme qu'il n'acquiert de la gloire. Mais celui qui fait du bien à un étranger et à un inconnu mérite une grande louange, parce qu'il ne le fait que par le principe de l'humanité. On fait le bien par pur motif de justice et de probité, lorsqu'il n'y a aucune nécessité de le faire. Cicéron n'a pas dû préférer la dépense que l'on fait pour racheter des prisonniers à celle que l'on fait pour donner des jeux au peuple; car cette préférence suppose une comparaison et un choix de l'une plutôt que de l'autre. Les largesses que l'on fait en faveur du peuple sont des largesses indiscrètes, et qui approchent fort de l'extravagance de ceux qui jettent leur bien dans la mer. On ne peut pas même donner à ces largesses-là le nom de présent, parce qu'elles ne sont reçues que par ceux qui ne les méritent pas. C'est une autre grande action de justice de prendre la protection des veuves, des pupilles et des personnes qui n'ont aucun appui; elle est recommandée par la loi de Dieu, et tous les bons juges s'y portent comme par une inclination naturelle. Mais ces actions-là n'appartiennent proprement qu'à nous, à qui le commandement en a été fait. Les païens s'aperçoivent bien que c'est une justice à laquelle la nature semble nous obliger que d'assister les faibles ; mais ils ne savent pas sur quoi cette justice est fondée, qui est : que Dieu, qui nous fait perpétuellement sentir les effets de sa clémence, commande de protéger et de défendre les veuves et les pupilles, afin que ceux qui ont des femmes et des enfants n'appréhendent point de les abandonner, quand il est question de mourir pour la foi, et qu'ils souffrent constamment les plus cruels supplices, dans l'assurance que ces personnes, qui leur sont si chères, demeureront après leur mort entre les mains de la Providence qui pourvoira à leurs besoins. C'est encore une grande action de charité d'assister des malades qui sont sans secours : c'est offrir à Dieu une victime vivante. Ceux qui auront employé leur bien dans le temps à un si saint usage, le retrouveront avec avantage dans l'éternité. Le dernier et le plus grand devoir de la piété est d'ensevelir les pauvres et les étrangers. Les païens n'ont donné aucun précepte de ce devoir ; et ils n'avaient garde d'en donner, puisqu'ils ne suivaient point d'autre règle que l'intérêt. Bien qu'ils n'aient pas approché de la vérité, quand ils ont entrepris de traiter des autres devoirs, ils ne s'en sont pas si fort éloignés que quand ils ont traité de celui-ci, parce qu'ils ont été retenus par je ne sais quelle apparence d'utilité qu'ils y ont sentie, au lieu qu'en ce dernier, ils n'en ont trouvé aucune. Il y a eu même des personnes qui ont soutenu que la sépulture est inutile, et que ce n'est pas un mal d'en être privé; mais leur impiété est condamnée par le consentement de tous les peuples qui suivent un usage contraire, et par la loi de Dieu qui l'autorise. Ils ne disent pas aussi ouvertement qu'il faille négliger ce devoir; ils se contentent de dire que, quand on y manque, on ne fait pas un grand mal. Ainsi, ce n'est pas tant un conseil qu'ils donnent d'omettre ce devoir, qu'une consolation lorsqu'il a été omis, pour montrer qu'un homme sage ne doit pas s'en affliger comme d'un fort grand malheur. Je n'examine pas ici ce qu'un homme sage doit supporter avec patience; j'examine ce qu'il doit faire. Je n'agite pas ici cette question : la coutume de donner la sépulture aux morts est utile. Quand elle serait inutile, comme les païens le croient, il ne faudrait pas laisser à l'observer, parce qu'elle paraît civile et honnête. Dans la morale, on considère plus l'intention que l'action. Il ne faut pas souffrir que l'ouvrage et l'image de Dieu serve de proie aux bêtes farouches et aux oiseaux ; il faut le rendre à la terre, d'où il est sorti. Nous nous acquitterons de ce devoir envers un inconnu aussi bien qu'envers nos proches, et nous ne devons le refusera personne. Nous lui rendrons, par sentiment d'une humanité générale, ce que nous rendrions à nos proches par le sentiment d'une amitié particulière. Si l'on ne rend pas ce devoir à un homme, parce qu'il n'a plus de sentiment, on le rend à Dieu, qui le reçoit comme un sacrifice très agréable. « Je n'aurais plus de bien, dira peut-être quelqu'un, si je voulais satisfaire à tous ces devoirs; je dépenserais en un jour tout ce que j'ai, j'entreprenais d'assister tous les pauvres, de vêtir tous les nus, de racheter tous les captifs et d'ensevelir tous les morts. Dissiperais-je le fonds que mes ancêtres ont acquis avec beaucoup de peine, et me réduirais-je à implorer le secours de la compassion et de la charité des autres? » Appréhendez-vous si fort la pauvreté que les philosophes relèvent par des louanges si extraordinaires, et qu'ils appellent un port où l'on est exempt des agitations que donnent les inquiétudes qui accompagnent les richesses. Ignorez-vous la multitude des accidents et des hasards où la possession du bien vous expose ? Vous serez assez heureux, si vous en pouvez échapper sans perdre la vie. Vous marchez chargé de dépouilles qui excitent l'envie et indignation de vos concitoyens. Que ne mettez vous en sûreté un bien que vous êtes en danger de perdre, ou par la violence des voleurs, ou par l'injustice d'une proscription, ou par une irruption d'ennemis? Quelle difficulté faites-vous de rendre éternel et immuable un bien qui n'est que temporel et passager ? Confiez à Dieu vos trésors, et ils ne seront ni consumés par la rouille, ni enlevés par l'injustice des voleurs ou des tyrans. Ceux qui mettent leurs richesses filtre les mains de Dieu ne sauraient jamais être pauvres. Si vous connaissez le prix de la justice, défaites-vous du bagage qui vous charge et vous incommode, pour la suivre plus aisément. Délivrez-vous des chaînes dont la pesanteur vous accable, et courez à Dieu. Il y a de la grandeur de courage à fouler aux pieds les biens de la terre. Que si vous n'êtes pas encore capable de la perfection qui est nécessaire pour mettre vos trésors entre les mains de Dieu, et pour acquérir des biens solides par la perte des biens périssables, je vous délivrerai de cette crainte. Ces commandements-là ne sont pas faits à vous seul ; ils sont faits à tous vos frères qui vous sont si étroitement unis, que vous ne composez tous ensemble qu'un seul corps. Si vous ne pouviez exécuter seul une si grande entreprise, contribuez-y en tout ce qui dépendra de votre pouvoir, et surpassez autant les autres en générosité que vous les surpassez-en richesses. Ne vous imaginez pas que je vous conseille d'épuiser, ou même de diminuer notablement votre bien. Je vous exhorte seulement à faire un bon usage de ce que vous auriez employé à des dépenses inutiles. Rachetez des prisonniers avec ce que vous auriez mis à acheter des bêtes. Nourrissez les pauvres de ce qui n'aurait servi qu'à nourrir des chiens et des chevaux. Consacrez à la sépulture des morts ce que vous perdriez à entretenir et équiper des gladiateurs. Quel gain y a-t-il à enrichir des scélérats et à leur faire apprendre des exercices qui n'ont rien que de criminel? Faites un sacrifice u Dieu de ce bien qui périrait entre vos mains, et vous en recevrez une récompense éternelle. Dieu a proposé un grand prix aux actions de miséricorde, quand il y a attaché la rémission des péchés. « Si vous écoutez, vous dit-il, les prières de celui qui vous demande des soulagements, j'écouterai les vôtres. Si vous avez pitié de ceux qui sont dans l'affliction, j'aurai pitié de vous quand vous y serez. Que si vous ne les regardez point, et que vous leur refusiez votre assistance, je vous traiterai de la même sorte, et je vous jugerai selon la même loi. » XIII. Lorsque quelqu'un implore votre secours, soyez persuadé que c'est une épreuve où Dieu vous met pour voir si vous méritez qu'il exauce vos prières. Examinez l'état de votre conscience, et cherchez des remèdes convenables à ses maladies. Ne vous imaginez pas néanmoins que la force que l'aumône a d'effacer les péchés vous doive donner la licence de les commettre. L'aumône ne les efface que quand elle est accompagnée du regret de les avoir commis et de la résolution de n'en plus commettre de semblables. Dieu souhaite sincèrement de purifier les hommes de leurs péchés, et c'est pour cela qu'il leur ordonne de faire pénitence. Or faire pénitence est protester que l'on ne péchera plus à l'avenir. Dieu pardonne à ceux qui pèchent par indiscret ion, par imprudence et par ignorance. Il ne pardonne point à ceux qui pèchent avec connaissance. Ceux dont les péchés sont remis ne doivent pas se persuader que parce qu'ils n'ont point de taches à laver, ils sont dispensés des œuvres de miséricorde. Depuis qu'ils ont été justifiés, ils sont plus étroitement obligés à l'exercice de la justice, et ils doivent conserver leur santé par la même manière de vivre par où ils l'ont rétablie. De plus, nul n'est exempt de pécher pendant qu'il est revêtu d'un corps mortel. Le péché assujettit par trois moyens la faiblesse humaine à son empire : par les actions, par les paroles et par les pensées. Ces trois moyens sont, selon un autre rapport, comme trois degrés par où la vertu monte à sa perfection. Le premier degré est de s'abstenir des mauvaises actions; le second de s'abstenir des mauvaises paroles, et le troisième de s'abstenir des mauvaises pensées. Celui qui est sur le premier degré est juste ; celui qui est sur le second est parfait, et celui qui est sur le troisième est semblable à Dieu. Il faudrait avoir une vertu qui fût au-dessus de la nature pour ne donner jamais entrée dans son esprit à aucune action mauvaise, ni à aucune parole indiscrète. Les plus justes, qui ont pris un assez grand empire sur eux-mêmes pour s'abstenir de toutes mauvaises actions, n'en ont pas un assez grand pour s'abstenir de toutes mauvaises paroles, ou de toutes mauvaises pensées. La colère et l'impatience arrachent quelquefois de leur bouche des discours injurieux, et les objets agréables excitent en eux des pensées contraires à l'honnêteté. Puisque nous ne saurions jamais être exempts de taches, nous devons les effacer perpétuellement par nos aumônes. Un homme juste et sage fait consister ses richesses dans la vertu. Quiconque n'a point de vertu est pauvre, quand il aurait des trésors plus immenses que Crésus, ni que Crassus. Il faut nous couvrir du précieux vêtement de la piété et de la justice, qui est le plus bel ornement dont nous puissions nous parer, et qui ne nous peut être ravi. Si ceux qui adorent des idoles insensibles leur offrent tout ce qu'ils ont de plus beau et de plus excellent, bien qu'elles ne s'en puissent servir, ni en témoigner de reconnaissance, n'est-il pas plus juste de consacrer notre bien à l'usage des pauvres, qui sont les images vivantes de Dieu, qui en tirent du profit, et qui en rendent des actions de grâces ? Dieu qui aura été le témoin de votre libéralité, en sera la récompense. XIV. Si l'autorité de Dieu et le sentiment des hommes ne permettent pas de douter que la compassion dont on est touché à la vue de la misère ne soit une perfection, il est clair que les philosophes en ont été très éloignés, puisqu'au lieu d'en recommander l'usage ils en ont parlé comme d'un défaut. Je ne puis mieux réfuter leurs œuvres qu'en proposant cette maxime qu'ils soutiennent : que la compassion, le désir et la crainte sont des maladies. Ils tâchent de distinguer les vices et les vertus; ce qui n'est pas fort difficile ; car qui est-ce qui ne distingue fort bien un libéral d'un prodigue, un ménager d'un avare, un laborieux d'un paresseux, un prudent d'un timide? Les vertus ont leurs bornes, et quand elles les passent, elles se changent en vices. La constance devient imprudence, des qu'elle ne soutient plus la vérité. La valeur devient témérité, dès qu'elle s'expose à un péril évident sans nécessité, ou pour un sujet qui n'est pas honnête. La liberté dégénère en insolence quand, au lieu de se contenter de repousser les injures, elle en fait la première. La sévérité se change en cruauté, quand elle ne garde plus la juste proportion qui doit être entre le crime et le châtiment. Voilà pourquoi les philosophes disent : que ceux qui paraissent sages ne le sont pas, le plus souvent par un effet de leur choix ; mais qu'étant trompés par l'apparence, ils prennent le bien pour le mal. On ne peut nier que cela ne soit vrai. Mais les vertus dont ils parlent ne regardent que le corps. La frugalité, la constance, la prudence, la modération, la valeur, la sévérité, sont des vertus qui se terminent à la vie présente. Mais nous qui la méprisons, nous cherchons des vertus que les philosophes n'ont point connues. Ils ont pris des vices pour des vertus, et des vertus pour des vices. Les stoïciens ôtent à l'homme toutes les passions qui ébranlent l'esprit, savoir: le désir, la joie, la crainte et la tristesse, dont les deux premières ont pour objet le bien, soit présent soit à venir, et les deux autres ont le mal. C'est pour cela qu'ils assurent que ce sont des maladies qui procèdent de l'opinion plutôt que de la nature, et que l'on s'en peut délivrer absolument, en se délivrant des fausses opinions; car si le sage est une fois bien persuadé qu'il n'y a ni bien ni mal sur la terre, il ne sera plus touché ni de désir, ni de joie, ni de crainte, ni de tristesse. Nous examinerons incontinent s'ils s'exemptent en effet de passions, comme ils le prétendent. Mais on peut dire par avance que c'est une prétention insolente de prescrire de s'opposer de la sorte à la nature. XV. Les mouvements des passions sont purement naturels, comme il paraît dans tous les animaux qui y sont sujets, bien qu'ils n'aient point de liberté. C'est pourquoi les péripatéticiens en ont mieux jugé que les stoïciens, quand ils ont dit : que l'on ne peut les ôter du cœur de l'homme, qu'ils y ont été comme imprimés dès le moment, de sa création ; que Dieu ou plutôt la nature, car c'est ainsi qu'ils parlent, nous les a donnés comme des armes dont nous avons besoin pour combattre nos ennemis. Ils avouent pourtant que ces mouvements sont souvent vicieux, parce qu'ils sont trop violents, et qu'il les faut modérer pour les rendre innocents. Leur sentiment serait assez conforme à la vérité s'ils ne se trompaient, en rapportant tout au corps, comme je l'ai déjà remarqué.
Pour les stoïciens, ce sont des furieux qui, au lieu de modérer
les passions, les retranchent, et qui entreprennent de prouver l'absence des
mouvements que la nature a imprimés dans notre âme. C'est à peu près la même
chose que s’ils entreprenaient d'ôter la timidité aux cerfs, le poison aux
serpents, la valeur aux lions et la douceur aux brebis ; car, au lieu que chacun
de ces mouvements a été donné à une espèce d'animaux, ils ont été donnés tous
ensemble à l'homme. Que si ce que les médecins assurent est véritable : que la
joie est dans la rate, la colère dans le fiel, le plaisir dans le foie et la
crainte dans le cœur, ne serait-ce pas détruire le corps que d'ôter les parties
qui le composent? Ces philosophes ne s'aperçoivent pas qu'en voulant ôter les
vices à l'homme, ils lui ôtent aussi les vertus. Ils n'oseraient nier que la
vertu ne consiste à réprimer les mouvements de la colère. Ainsi celui qui serait
exempt de colère, ne pourrait plus exercer cette vertu. Si la vertu consiste à
résister aux mouvements de la volupté, celui qui ne sent point ces mouvements
n'a point de vertu. Si la vertu arrête le cours trop vague de nos désirs, celui
qui n'a point de ces vices déréglés, et qui ne souhaite rien du bien d'autrui,
n'a point la vertu. Ainsi il n'y a point de vertu sans vice, comme il n'y a
point de victoire sans combat et sans ennemis, ni généralement de bien sans mal.
Les passions sont comme les superfluités de l'âme. Les terres les plus fertiles
produisent d'elles-mêmes quantité d'épines et de mauvaises herbes. Les esprits
qui n'ont point été cultivés par les livres ne produisent d'eux-mêmes que des
vices. Mais lorsque l'on commence à les cultiver, ils produisent des vertus.
Lorsque Dieu les a créés, il leur a imprimé le mouvement des passions, afin
qu'ils puissent recevoir la vertu de la même façon que la terre reçoit la
culture ; et il a voulu que les passions fussent la matière des vices, et que
les vices fussent la matière de la vertu. S'il n'y avait point de vices, il n'y
aurait point de vertu, ou au moins elle n'aurait aucun exercice. Voyons ce
qu'ont fait les péripatéticiens qui prétendent ôter les vices. Ils n'ont pas
retranché absolument les autres passions, parce qu'ils ont reconnu qu'elles
viennent de la nature, et que sans elles il n'y aurait plus aucun mouvement dans
l'âme. Mais ils mettent les affections en leur place, avoir : la volonté en la
place du désir, comme si c'était quelque chose de mieux de vouloir le bien que
de le désirer. Ils mettent le plaisir en la place de la vanité. M'ayant rien à
mettre en la place de la tristesse, ils l’ont ôtée absolument. Cependant il est
impossible de l'ôter de la vie des hommes, car qui pourrait en être exempt dans
le temps qu'il verrait son pays ou désolé par une maladie contagieuse, ou ruiné
par les armes des étrangers, ou opprimé par la violence des tyrans ? Il faudrait
être stupide et n'avoir plus de sentiment pour voir, sans douleur, la liberté
publique étouffée, ses proches, ses amis, et les plus gens de bien exécutés à
mort. Ainsi ils devaient retrancher toutes les passions, ou en substituer une en
la place de la tristesse; car nous nous fâchons autant du mal présent que nous
nous réjouissons du bien. Ils devaient donc donner un autre nom à la tristesse,
de la même sorte qu'ils en ont donné un autre à la joie, puisqu'il y avait la
même raison. Il est clair que le terme leur a manqué, et que faute de terme, ils
ont ôté, malgré la nature, s'il est permis de parler ainsi, une passion dont
elle ne peut jamais être dépouillée. Il me serait aisé de faire voir que, pour
embellir leurs discours, ils ont donné divers noms à la même chose, et à des
choses qui n'avaient pas entre elles grande différence. Le désir naît de la
volonté; la précaution naît de la crainte; la joie n'est qu'un plaisir qui dure.
Supposons néanmoins que ce soient choses différentes, comme ils le prétendent,
et disons avec eux : que le désir est une volonté persévérante ; que la joie est
un plaisir qui enfle le cœur et qui l'élève; que la crainte est une précaution
excessive. Il s'ensuivra, qu'au lieu d'ôter les passions qu'ils assurent qu'il
faut ôter, ils n'en ôteront que le nom. Ainsi ils retombent, sans y prendre
garde, où les péripatéticiens ont été par raison, et ils demeurent d'accord avec
eux que, puisque l’on ne peut retrancher les vices, il les faut modérer. Il est
donc certain qu'ils se trompent, qu'ils ne font rien de ce qu'ils prétendaient
faire, et qu'après de longs débats, ils se trouvent au lieu d'où ils étaient
partis. |
|
CAPUT XVI. De affectibus, ac de iis Peripateticorum eversa sententia: quis sit verus affectuum, quique eorum malus usus. At ego ne Peripateticos quidem accessisse ad veritatem puto, qui vitia esse concedunt, sed ea mediocriter temperant. Carendum est enim vitiis etiam mediocribus: quin potius efficiendum fuit primum, ne vitia essent. Nec enim quidquam vitiosum nasci potest: sed vitia fieri, si male utamur affectibus; si bene, virtutes. Deinde monstrandum est, non ipsos affectus, sed eorum causas esse moderandas. Non est, inquiunt, laetitia nimia gestiendum; sed modice, ac moderate. Hoc vero tale est, quale si dicerent, non esse currendum concitate, sed gradiendum quiete. At potest et qui graditur, errare; et qui currit, rectam viam tenere. Quid si ostendo esse aliquid, ubi non tantum modicum, sed vel punctum gaudere, vitiosum sit; et aliud contra, in quo vel exultare laetitia minime criminosum? Quid tandem nobis ista mediocritas proderit? Quaero utrumne sapienti laetandum putent, si quid inimico suo mali videat accidere; aut utrumne laetitiam fraenare debeat, si victis hostibus, aut oppresso tyranno, libertas et salus civibus parta sit? Nemo dubitat quin et in illo exiguum laetari, et in hoc parum laetari sit maximum crimen. Eadem de caeteris affectibus dicere licet. Sed, ut dixi, non in his moderandis sapientiae ratio versatur, sed in causis eorum: quoniam extrinsecus commoventur; nec ipsis potissimum fraenos imponi oportuit, quoniam et exigui possunt esse in maximo crimine, et maximi possunt esse sine crimine. Sed assignandi fuerunt certis temporibus, et rebus, et locis; ne vitia sint, quibus uti recte licet. Sicut enim recte ambulare bonum est, errare autem malum: sic moveri affectibus in rectum, bonum est; in pravum, malum. Nam libido, si extra legitimum torum non evagetur, licet sit vehemens, tamen culpa caret. Sin vero appetit alienum, licet sit mediocris, vitium tamen maximum est. Non est itaque morbus irasci, nec cupere, nec libidine commoveri: sed iracundum esse, morbus est, cupidum, libidinosum. Qui enim iracundus est, etiam cui non debet, aut cum non oportet, irascitur. Qui cupidus, etiam quod non opus est, concupiscit. Qui libidinosus, etiam quod legibus vetatur, affectat. Omnis igitur ratio in eo versari debuit, ut quoniam earum rerum impetus inhiberi non potest, nec debet, quia necessario est insitus ad tuenda officia vitae, dirigeretur potius in viam rectam, ubi etiam cursus offensione ac periculo careat. CAPUT XVII. De affectibus ac eorum usu; de patientia et summo bono Christianorum. Sed evectus sum coarguendi studio longius; cum sit mihi propositum, ea, quae vitia philosophi putaverunt, ostendere non tantum vitia non esse, verum etiam magnas esse virtutes. Ex aliis docendi gratia sumam, quae pertinere ad rem maxime puto. Metum, seu timorem in maximo vitio ponunt, summamque imbecillitatem esse animi putant; cui sit contraria fortitudo, quae si sit in homine, locum timori esse nullum. Creditne ergo aliquis, fieri posse, ut idem metus summa sit fortitudo? Minime. Neque enim videtur capere natura, ut aliquid in contrarium recidat. Atqui ego non arguta aliqua conclusione, ut apud Platonem Socrates facit, qui eos, quos contra disputat, cogit ea, quae negaverant, confiteri; sed simpliciter ostendam summum metum summam esse virtutem. Nemo dubitat, quin timidi et imbecilli sit animi, aut dolorem metuere, aut egestatem, aut exilium, aut carcerem, aut mortem: quae omnia quisquis non exhorruerit, fortissimus judicatur. Qui autem Deum metuit, illa universa non metuit. Ad quod probandum argumentis opus non est; spectatae sunt enim semper, spectanturque adhuc per orbem poenae cultorum Dei, in quibus excruciandis nova et inusitata tormenta excogitata sunt. Nam de mortis generibus horret animus recordari; cum immanium bestiarum, ultra ipsam mortem, carnificina saevierit. Has tamen execrabiles corporum lacerationes felix atque invicta patientia sine ullo gemitu pertulit. Haec virtus omnibus populis, atque provinciis, et ipsis tortoribus miraculum maximum praebuit; cum patientia crudelitas vinceretur. Atqui hanc virtutem nihil aliud, quam metus Dei fecit. Itaque (ut dicebam) non evellendus, ut Stoici, neque temperandus timor, ut Peripatetici volunt; sed in veram viam dirigendus est, auferendique sunt metus; sed ita, ut hic solus relinquatur, qui quoniam legitimus ac verus est, solus efficit, ut possint caetera omnia non timeri. Cupiditas quoque inter vitia numeratur: sed si haec quae terrena sunt, concupiscat, vitium est; virtus autem, si coelestia. Qui enim justitiam, qui Deum, qui vitam perpetuam, qui lucem sempiternam, eaque omnia, quae Deus homini pollicetur, consequi cupit, opes istas, et honores, et potentatus, et regna ipsa contemnet. Dicet fortasse Stoicus, voluntate opus esse ad haec consequenda, non cupiditate: imo vero parum est velle. Multi enim volunt: sed cum dolor visceribus accesserit, voluntas cedit, cupiditas perseverat; quae si efficit, ut contemptui sint omnia, quae a caeteris appetuntur, summa virtus est, siquidem continentiae mater est. Ideoque illud potius efficere debemus, ut affectus, quibus prave uti vitium est, dirigamus in rectum. Nam istae concitationes animorum juncto currui similes sunt; in quo recte moderando summum rectoris officium est, ut viam noverit: quam si tenebit, quamlibet concitate ierit, non offendet. Si autem aberraverit, licet placide ac leniter eat, aut per confragosa vexabitur, aut per praecipitia labetur, aut certe, quo non est opus, deferetur. Sic currus ille vitae, qui affectibus, velut equis pernicibus ducitur, si viam rectam teneat, fungetur officio. Metus igitur, et cupiditas, si projiciantur in terram, vitia fient; virtutes autem, si ad divina referantur. Parcimoniam contra virtutis loco habent: quae si studium est habendi, non potest esse virtus; quia in augendis, vel tuendis terrestribus bonis tota versatur. Nos autem summum bonum non referimus ad corpus; sed omne officium solius animae conservatione metimur. Quod si (ut supra docui) patrimonio minime parcendum est, ut humanitatem, justitiamque teneamus; non est virtus frugi esse: quod nomen virtutis specie fallit ac decipit. Est enim frugalitas, abstinentia quidem voluptatum: sed eo vitium, quia ex habendi amore descendit; cum sit et voluptatibus abstinendum, et pecuniae minime temperandum. Nam parce, id est, mediocriter uti pecunia, quasi quaedam pusillitas animi est, aut praetimentis, ne sibi desit; aut desperantis, posse se illam reparare; aut contemptum terrestrium non capientis. Sed illi rursus eum, qui rei familiari suae non parcat, prodigum vocant. Nam ita liberalem distinguunt a prodigo, quod is liberalis sit, qui et bene meritis, et cum oportet, et quantum satis est, largiatur; prodigus vero, qui et non meritis, et cum opus non est, et sine respectu rei familiaris effundat. Quid ergo? Prodigumne dicemus eum, qui misericordiae causa tribuat egentibus victum? Atqui multum refert utrumne scortis propter libidinem largiare, an miseris propter humanitatem: utrum pecuniam tuam perductores, aleatores, lenonesque diripiant; an illam pietati ac Deo praestes: utrumne illam ventri ac gulae ingeras, an in thesauro justitiae reponas. Ut ergo vitium est, effundere in malam partem: sic in bonam, virtus. Si virtus est, non parcere opibus, quae possunt reparari, ut hominis vitam sustentes, quae reparari non potest; vitium igitur parcimonia est. Quare nihil aliud dixerim, quam insanos, qui hominem, mite ac sociale animal, orbant suo nomine; qui evulsis affectibus, quibus omnis constat humanitas, ad immobilem stuporem mentis perducere volunt; dum student animum perturbationibus liberare, et (ut ipsi dicunt) quietum tranquillumque reddere. Quod fieri non tantum non potest, quia vis et ratio ejus in motu est; sed ne oportet quidem. Quia sicut aqua semper jacens et quieta insalubris et magis turbida est: sic animus immotus ac torpens inutilis est etiam sibi; nec vitam ipsam tueri poterit, quia nec faciet quidquam, nec cogitabit: cum cogitatio ipsa nihil aliud sit, quam mentis agitatio. Denique qui hanc immobilitatem animi asserunt, privare animum vita volunt: quia vita actuosa est, mors quieta. Quaedam etiam recte pro virtutibus habent: sed earum modum non tenent. Virtus est constantia: non ut inferentibus injuriam resistamus, his enim cedendum est; quod cur fieri debeat, mox docebo: sed ut jubentibus facere nos contra Dei legem contraque justitiam, nullis minis, aut suppliciis terreamur, quominus Dei jussionem hominis jussioni praeferamus. Item virtus est, mortem contemnere: non ut appetamus, eamque ultro nobis inferamus, sicut philosophorum plurimi et maximi saepe fecerunt; quod est sceleratum ac nefarium: sed ut coacti Deum relinquere, ac fidem prodere, mortem suscipere malimus, libertatemque defendamus adversus impotentium stultam vecordemque violentiam, et omnes saeculi minas atque terrores fortitudine animi provocemus. Sic ea, quae alii timent, excelsa et insuperabili mente dolorem mortemque calcamus. Haec est virtus, haec vera constantia, in hoc tuenda et conservanda solo, ut nullus nos terror, nulla vis a Deo possit avertere. Vera igitur Ciceronis illa sententia est: « Nemo, inquit, justus potest esse, qui mortem, qui dolorem, qui exilium, qui egestatem timet. » Item Senecae in libris moralis Philosophiae dicentis: « Hic est ille homo honestus, non apice, purpurave, non lictorum insignis ministerio, sed nulla re minor, qui cum mortem in vicinia videt, non sic perturbatur, tanquam rem novam viderit; qui, sive toto corpore tormenta patienda sunt, sive flamma ore rapienda est, sive extendendae per patibulum manus, non quaerit quid patiatur, sed quam bene. » Qui autem Deum colit, haec patitur, nec timet. Ergo justus est. His rebus efficitur, ut neque virtutes, neque virtutum exactissimos limites nosse aut tenere possit omnino, quisquis est a Religione Dei singularis alienus. CAPUT XVIII. De quibusdam Dei mandatis et patientia. Sed omittamus philosophos, qui aut omnino nihil sciunt, idque ipsum pro summa scientia praeferunt; aut qui non perspiciunt etiam quae sciunt; aut qui, quoniam se putant scire quae nesciunt, inepte arroganterque desipiunt. Nos ergo (ut ad propositum revertamur) quibus solis a Deo veritas revelata, et coelitus missa sapientia est, faciamus quae jubet illuminator noster Deus: sustineamus invicem, et labores hujus vitae mutuis adjumentis perferamus: nec tamen, si quid boni operis fecerimus, gloriam captemus ex eo. Monet enim Deus, operatorem justitiae non oportere esse jactantem; ne non tam mandatis coelestibus obsequendi, quam studio placendi, humanitatis officio functus esse videatur; habeatque jam pretium gloriae, quod captavit; nec praemium coelestis illius ac divinae mercedis accipiat. Caetera, quae observare cultor Dei debet, facilia sunt, illis virtutibus comprehensis; ut non mentiatur unquam decipiendi aut nocendi causa. Est enim nefas, eum, qui veritati studeat, in aliqua re esse fallacem; atque ab ipsa, quam sequitur, veritate discedere. In hâc justitiae virtutumque omnium via, nullus mendacio locus est. Itaque viator ille verus ac justus non dicet illus Lucilianum: Homini amico ac familiari non est mentiri meum, sed etiam inimico atque ignoto existimabit non esse mentiri suum; nec aliquando committet, ut lingua, interpres animi, a sensu et cogitatione discordet. Pecuniam si quam crediderit, non accipiet usuram, ut et beneficium sit incolume, quod succurrit necessitati, et abstineat se prorsus alieno. In hoc enim genere officii debet suo esse contentus, quem oporteat alias ne proprio quidem parcere, ut bonum faciat; plus autem accipere, quam dederit, injustum est. Quod qui facit, insidiatur quodammodo, ut ex alterius necessitate praedetur. At justus nunquam praetermittet quominus aliquid misericorditer faciat; nec inquinabit se hujusmodi quaestu: sed efficiet, ut sine ullo suo damno, id ipsum, quod commodat, inter bona opera numeretur. Munus non accipiat a paupere; ut si quid ipse praestiterit, eo bonum sit, quo fuerit gratuitum. Maledicenti benedicto respondeat: numquam ipse maledicat; ne verbum malum procedat ex ore hominis, qui colit Verbum bonum. Quin etiam caveat diligenter, ne quando inimicum sua culpa faciat; et si quis extiterit tam protervus, qui bono et justo faciat injuriam, clementer ac moderate ferat, et ultionem suam sibi non assumat, sed judici Deo reservet. Innocentiam semper et ubique custodiat. Quod praeceptum non ad hoc tantum valet, ut ipse injuriam non inferat: sed ut illatam sibi non vindicet. Sedet enim maximus et aequissimus judex, speculator ac testis omnium. Hunc homini praeferat; hunc malit de causa sua pronuntiare, cujus sententiam nemo effugere potest, nec defensione cujusquam, nec gratia. Ita fit, ut homo justus contemptui sit omnibus; et quia putabitur semetipsum defendere non posse, habebitur pro segni et inerte. Qui autem fuerit ultus inimicum, hic fortis, hic strenuus judicatur: hunc colunt, hunc omnes verentur. Bonus vero ille tametsi prodesse pluribus possit, illum tamen suspiciunt, qui nocere, quam qui prodesse possit. Sed justum pravitas hominum depravare non poterit, quominus Deo studeat obtemperare; malitque contemni, dummodo semper boni fungatur officio, mali nunquam. Cicero in iisdem illis Officialibus: « At vero si quis voluerit, inquit, animi sui complicitam notionem evolvere, jam se ipse doceat, eum virum bonum esse, qui prosit quibus possit, noceat nemini, nisi lacessitus injuria. » O quam simplicem veramque sententiam duorum verborum adjectione corrupit! Quid enim opus fuerat adjungere, nisi lacessitus injuria? ut vitium bono viro quasi caudam turpissimam apponeret; patientiaeque, quae omnium virtutum maxima est, faceret expertem. Nociturum esse dixit bonum virum, si fuerit lacessitus: jam ex hoc ipso boni viri nomen amittat necesse est, si nocebit. Non minus enim mali est, referre injuriam, quam inferre. Nam unde certamina inter homines, unde pugnae contentionesque nascuntur, nisi quod improbitati opposita impatientia magnas saepe concitat tempestates? Quod si patientiam, qua virtute nihil verius, nihil homine dignius inveniri potest, improbitati opposueris, extinguetur protinus, tanquam igni aquam superfuderis. Sin autem provocatrix illa improbitas impatientiam sibi comparem nacta est, tanquam perfusa oleo, tantum excitabit incendium, ut id non flumen aliquod, sed effusio cruoris extinguat. Magna itaque patientiae ratio est, quam sapiens homo ademit bono viro. Ut enim nihil malorum fiat, haec sola efficit: quae si detur omnibus, nullum scelus, nulla fraus in rebus humanis erit. Quid igitur bono viro potest esse tam calamitosum, tamque contrarium, quam irae fraena permittere; quae illum non modo boni, sed etiam hominis appellatione dispoliet? Siquidem nocere alteri, ut ipse verissime ait, non est secundum hominis naturam. Nam et pecudes si lacessas, aut calce aut cornu repugnant; et serpentes ac ferae, nisi persequaris ut occidas, negotium non exhibent; et (ut ad hominum exempla redeamus) imperiti quoque et insipientes, si quando accipiunt injuriam, caeco et irrationabili furore ducuntur, et iis, qui sibi nocent, vicem retribuere conantur. In quo igitur sapiens ac bonus vir a malis et insipientibus differt; nisi quod habet invictam patientiam, qua stulti carent; nisi quod regere se ac mitigare iram suam novit, quam illi, quia virtute indigent, refraenare non possunt? Sed videlicet haec illum res fefellit, quod cum de virtute loqueretur, in quacumque contentione vinceret, putavit esse virtutis; nec videre ullo modo potuit hominem dolori et irae succumbentem, et iis affectibus indulgentem, quibus debet potius reluctari, et ruentem quacumque improbitas provocarit, virtutis officium non tenere. Qui enim referre injuriam nititur, eum ipsum, a quo laesus est, gestit imitari. Ita qui malum imitatur, bonus esse nullo pacto potest. Duobus igitur verbis duas virtutes maximas bono et sapienti viro, innocentiam patientiamque detraxit. Sed quia ipse caninam illam facundiam (sicut Sallustius ab Appio dictum refert) exercuit, voluit quoque hominem canino modo vivere, ut remordeat lacessitus. Quae retributio contumeliae quam perniciosa sit et quas edere soleat strages, unde opportunius petetur exemplum, quam ex ipsius praeceptoris tristissimo casu; qui dum his philosophorum praeceptis obtemperare gestit, ipse se perdidit? Quod si lacessitus injuria patientiam tenuisset; si dissimulare, si ferre contumeliam boni viri esse didicisset; nec illas nobiles orationes alieno titulo inscriptas, impatientia, et levitas, et insania profudisset: nunquam capite suo rostra, in quibus ante floruerat, cruentasset; nec rempublicam funditus proscriptio illa delesset. Sapientis ergo ac boni viri non est velle certare, ac se periculo committere: quoniam et vincere non est in nostra potestate, et est anceps omne certamen: sed est sapientis atque optimi viri, non adversarium velle tollere; quod fieri sine scelere ac periculo non potest: sed certamen ipsum, quod fieri et utiliter, et juste potest. Summa igitur virtus habenda patientia est: quam ut caperet homo justus, voluit illum Deus (ut supra dictum est) pro inerte contemni. Nisi enim contumeliis fuerit affectus, quantum habeat fortitudinis in seipso cohibendo, ignorabitur. Si autem lacessitus injuria laedentem persequi coeperit, victus est. Si vero motum illum ratione compresserit, hic plane imperat sibi; hic regere se potest. Quae sustentatio sui, recte patientia nominatur: quae una virtus omnibus est opposita vitiis et affectibus. Haec perturbatum ac fluctuantem animum ad tranquillitatem suam revocat: haec mitigat, haec hominem sibi reddit. Ergo quoniam naturae repugnare impossibile est et inutile, ut non commoveamur omnino; prius tamen, quam commotio illa prosiliat ad nocendum, quoad fieri potest, maturius sopiatur. Praecepit Deus non occidere Solem super iram nostram, ne furoris nostri testis abscedat. Denique Marcus Tullius contra suum praeceptum, de quo paulo ante dixi, oblivionem injuriarum in magnis laudibus posuit. « Spero, inquit, Caesar, qui oblivisci nihil soles, nisi injurias. » Quod si hoc ille faciebat, homo non a coelesti tantum, sed a publica quoque civilique justitia remotissimus; quanto magis id nos facere debemus, qui immortalitatis velut candidati sumus? CAPUT XIX. De affectibus eorumque usu, atque de tribus furiis. Stoicis, cum affectus ex homine, tanquam morbos, conantur evellere, Peripatetici se opponunt; eosque non modo retinent, sed etiam defendunt; nihilque in homine esse dicunt, quod non magna ratione ac providentia sit innatum. Recte id quidem, si singularum rerum veros terminos scirent. Itaque hanc ipsam iram, cotem dicunt esse virtutis, tanquam nemo possit adversus hostes fortiter dimicare, nisi fuerit ira concitatus. Quo plane ostendunt, nec quid sit virtus scire se, nec cur homini tribuerit iram Deus. Quae si nobis ideo data est, ut ea utamur ad occidendos homines, quid immanius homine? quid similius feris belluis existimandum est, quam id animal, quod ad communionem et innocentiam Deus fecit? Tres sunt igitur affectus, qui homines in omnia facinora praecipites agant; ira, cupiditas, libido. Propterea poetae tres Furias esse dixerunt, quae mentes hominum exagitent: ira ultionem desiderat, cupiditas opes, libido voluptates. Sed his omnibus Deus certos limites statuit: quos si transcenderint, majoresque esse coeperint, necesse est naturam suam depravent, et in morbos ac vitia vertantur. Qui autem sint isti limites, non est magni laboris ostendere. Cupiditas ad ea comparanda nobis data est, quae sunt ad vitam necessaria; libido, ad sobolem propagandam; irae affectus, ad coercenda peccata eorum, qui sunt in nostra potestate, id est, ut arctiore disciplina minor aetas ad probitatem justitiamque formetur: quae nisi metu cohibeatur, licentia pariet audaciam, quae ad omne flagitium et facinus evadet. Itaque ut ira uti adversus minores et justum est, et necessarium: sic et adversus pares et perniciosum est, et impium. Impium, quod violatur humanitas; perniciosum, quod, illis repugnantibus, aut perdere necesse est, aut perire. Hanc autem quam dixi esse rationem, cur homini sit irae affectus datus, ex ipsius Dei praeceptis intelligi potest, qui jubet uti maledicis et laedentibus non irascamur; manus autem nostras supra minores semper habeamus; hoc est, ut peccantes eos assiduis verberibus corrigamus; ne amore inutili et indulgentia nimia educentur ad malum, et ad vitia nutriantur. Sed rerum imperiti et rationis ignari, eos affectus, qui sunt homini ad usus bonos dati, exterminaverunt; et latius, quam ratio postulat, evagantur. Inde injuste atque impie vivitur. Utuntur ira contra pares: hinc dissidia, hinc expulsiones, hinc bella contra justitiam nata sunt. Utuntur cupiditate ad congerendas opes: hinc fraudes, hinc latrocinia, hinc omnia scelerum genera exorta sunt. Utuntur libidine ad capiendas tantum voluptates: hinc stupra, hinc adulteria, hinc corruptelae omnes extiterunt. Quicumque igitur illos affectus intra fines suos redegerit (quod ignorantes Deum facere non possunt) hic patiens, hic fortis, hic justus est. CAPUT XX. De sensibus et eorum voluptatibus brutorum et hominis; atque de oculorum voluptate et spectaculis. Restat ut contra quinque sensuum voluptates dicam breviter; nam et ipsius libri mensura jam modum flagitat: quae omnes, quoniam vitiosae ac mortiferae sunt, virtute superari atque opprimi debent; vel (quod paulo ante dicebam de affectibus) ad rationem suam revocari. Caeterae animantes praeter unam voluptatem, quae ad generandum pertinet, nullam sentiunt. Utuntur ergo sensibus ad naturae suae necessitatem: vident, ut appetant ea, quibus opus est ad vitam tuendam: audiunt invicem, seque dignoscunt, ut possint congregari. Quae utilia sunt ad victum, aut ex odore inveniunt, aut ex sapore percipiunt; inutilia respuunt, aut recusant. Edendi ac bibendi officium ventris plenitudine metiuntur. Homini vero solertissimi artificis providentia dedit voluptatem infinitam, et in vitium cadentem; quia proposuit ei virtutem, quae cum voluptate semper, tanquam cum domestico hoste pugnaret. Cicero in Catone majore: « Stupra vero, inquit, et adulteria, et omne flagitium nullis excitari aliis illecebris, nisi voluptatis. Cumque homini sive natura, sive quis Deus nihil mente praestabilius dedisset, huic divino muneri ac dono nihil tam inimicum, quam voluptatem. Nec enim libidine dominante, temperantiae locum esse; neque in voluptatis regno virtutem posse consistere: » sed e contrario Deus idcirco virtutem dedit, ut expugnaret ac vinceret voluptatem; eamque egredientem fines sibi datos intra praescriptum coerceret, ne hominem suavitatibus delinitum atque captum ditioni suae subjiceret, ac sempiterna morte multaret. Voluptas oculorum varia et multiplex est, quae capitur ex aspectu rerum quae sunt in usu hominum, vel natura, vel opere delectabiles. Hanc philosophi rectissime sustulerunt. Aiunt enim multo esse praeclarius et homine dignius, coelum potius, quam caelata intueri: et hoc pulcherrimum opus intermicantibus astrorum luminibus, tanquam floribus adornatum, quam picta, et ficta, et gemmis distincta mirari. Sed cum diserte ad contemptum terrestrium nos exhortati sunt, et ad coeli spectaculum excitaverunt, tamen spectacula haec publica non contemnunt. Itaque his et delectantur, et libenter intersunt. Quae, quoniam maxima sunt irritamenta vitiorum, et ad corrumpendos animos potentissime valent, tollenda sunt nobis, quia non modo ad beatam vitam nihil conferunt, sed etiam nocent plurimum. Nam qui hominem, quamvis ob merita damnatum, in conspectu suo jugulari pro voluptate computat, conscientiam suam polluit, tam scilicet, quam si homicidii, quod fit occulte, spectator et particeps fiat. Hos tamen ludos vocant, in quibus humanus sanguis effunditur. Adeo longe ab hominibus secessit hamanitas; ut cum animas hominum interficiant, ludere se opinentur, nocentiores iis omnibus, quorum sanguinem voluptati habent. Quaero nunc, an possint pii et justi homines esse, qui constitutos sub ictu mortis, ac misericordiam deprecantes, non tantum patiuntur occidi, sed et flagitant, feruntque ad mortem crudelia et inhumana suffragia, nec vulneribus satiati, nec cruore contenti: quin etiam percussos jacentesque repeti jubent, et cadavera ictibus dissipari, ne quis illos simulata morte deludat. Irascuntur etiam pugnantibus, nisi celeriter e duobus alter occisus est; et tanquam humanum sanguinem sitiant, oderunt moras. Alios illis compares dari poscunt recentiores, ut quamprimum oculos suos satient. Hac consuetudine imbuti, humanitatem perdiderunt. Itaque non parcunt etiam innocentibus: sed exercent in omnes, quod in malorum trucidatione didicerunt. Hujus igitur publici homicidii socios et participes esse non convenit eos, qui justitiae viam tenere nituntur. Non enim cum occidere Deus vetat, latrocinari nos tantum prohibet; quod ne per leges quidem publicas licet: sed ea quoque ne fiant monet, quae apud homines pro licitis habentur. Ita neque militare justo licebit, cujus militia est ipsa justitia; neque vero accusare quemquam crimine capitali: quia nihil distat utrumne ferro, an verbo potius occidas; quoniam occisio ipsa prohibetur. Itaque in hoc Dei praecepto nullam prorsus exceptionem fieri oportet, quin occidere hominem sit semper nefas, quem Deus sanctum animal esse voluit. Ergo ne illud quidem concedi aliquis existimet, ut recens natos liceat oblidere, quae vel maxima est impietas; ad vitam enim Deus inspirat animas, non ad mortem. Verum homines, ne quod sit facinus, quo manus suas non polluant, rudibus adhuc et simplicibus animis abnegant lucem non a se datam. Expectet vero aliquis ut alieno sanguini parcant, qui non parcunt suo: sed hi sine ulla controversia scelerati et injusti. Quid illi, quos falsa pietas cogit exponere? Num possunt innocentes existimari, qui viscera sua in praedam canibus objiciunt, et quantum in ipsis est, crudelius necant, quam si strangulassent? Quis dubitet, quin impius sit, qui alienae misericordiae locum tribuit? qui etiamsi contingat ei, quod voluit, ut alatur, addixit certe sanguinem suum, vel ad servitutem, vel ad lupanar. Quae autem possint, vel soleant accidere in utroque sexu per errorem, quis non intelligit? quis ignorat? Quod vel unius Oedipodis declarat exemplum, duplici scelere confusum. Tam igitur nefarium est exponere, quam necare. At enim parricidae facultatum angustias conqueruntur; nec se pluribus liberis educandis sufficere posse praetendunt: quasi vero aut facultates in potestate sint possidentium, aut non quotidie Deus ex divitibus pauperes, et ex pauperibus divites faciat. Quare si quis liberos ob pauperiem non poterit educare, satius est, ut se ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei opera corrumpat. Ergo si homicidium facere nullo modo licet, nec interesse omnino conceditur, ne conscientiam perfundat ullus cruor: siquidem populo sanguis ille praestatur. In scenis quoque nescio an sit corruptela vitiosior. Nam et comicae fabulae de stupris virginum loquuntur, aut amoribus meretricum; et quo magis sunt eloquentes, qui flagitia illa finxerunt, eo magis sententiarum elegantia persuadent, et facilius inhaerent audientium memoriae versus numerosi et ornati. Item tragicae historiae subjiciunt oculis parricidia, et incesta regum malorum, et cothurnata scelera demonstrant. Histrionum quoque impudentissimi motus quid aliud, nisi libidines et docent, et instigant? quorum enervata corpora, et in muliebrem incessum habitumque mollita, impudicas foeminas inhonestis gestibus mentiuntur. Quid de mimis loquar corruptelarum praeferentibus disciplinam? qui docent adulteria, dum fingunt, et simulatis erudiunt ad vera? Quid juvenes aut virgines faciant, cum haec et fieri sine pudore, et spectari libenter ab omnibus cernunt? Admonentur utique quid facere possint, et inflammantur libidine, quae aspectu maxime concitatur; ac se quisque pro sexu in illis imaginibus praefigurat, probantque illa, dum rident, et adhaerentibus vitiis, corruptiores ad cubicula revertuntur; nec pueri modo, quos praematuris vitiis imbui non oportet: sed etiam senes, quos peccare jam non decet.
Circensium quoque ludorum ratio quid
aliud habet, nisi levitatem, vanitatem, insaniam? Tanto namque
impetu concitantur animi in furorem, quanto illic impetu curritur;
ut jam plus spectaculi exhibeant, qui spectandi gratia veniunt, cum
exclamare, et efferri, et exilire coeperint. Vitanda ergo spectacula
omnia, non solum ne quid vitiorum pectoribus insidat, quae sedata et
pacifica esse debent: sed ne cujus nos voluptatis consuetudo
deliniat, et a Deo atque a bonis operibus avertat. Nam ludorum
celebrationes, deorum festa sunt; siquidem ob natales eorum, vel
templorum novorum dedicationes sunt constituti. Et primitus quidem
venationes, quae vocantur munera, Saturno sunt attributae; ludi
autem scenici Libero; circenses vero Neptuno. Paulatim tamen et
caeteris diis idem honos tribui coepit; singulique ludi nominibus
eorum consecrati sunt, sicut Sisinius Capito in libris Spectaculorum
docet. Si quis igitur spectaculis interest, ad quae religionis
gratia convenitur, discessit a Dei cultu, et ad deos se contulit,
quorum natales et festa celebravit. |
XVI. Je ne vois pas que les péripatéticiens aient approché de la vérité, quand, après être demeurés d'accord que ces passions sont vicieuses, ils ont taché de les réduire à quelque sorte de médiocrité ; car enfin il ne faut point souffrir de vices, pour médiocres qu’ils puissent être. Il faut faire en sorte que nous n'en nylons point. Les passions qui naissent avec nous n'ont rien de vicieux, bien que, par le mauvais usage que nous en faisons, elles puissent devenir des vices, comme par le bon usage elles deviennent des vertus. De plus, il est aisé de faire voir que ce ne sont pas les passions qu'il faut modérer, mais les causes des passions. Il ne faut pas, disent les péripatéticiens, s'emporter de joie, il en faut régler les mouvements. C'est comme s'ils disaient: il ne faut pas courir trop vite, il faut marcher modérément. En marchant modérément, on peut s'égarer, et en courant, on peut tenir le bon chemin. Je montrerai peut-être qu'il y a des occasions où le moindre mouvement de joie est vicieux ; et qu'il y en a d'autres où le plus grand est innocent. Si je le montre, de quoi servira la médiocrité ou la modération qu'ils prescrivent ? Je demande donc : s'ils sont persuadés qu'un sage doive sentir de la joie du mal qu'il voit arriver à son ennemi, ou modérer celle qu'il sent du bien qu'il voit arriver à sa patrie, lorsqu'elle assure son salut par la défaite de ses ennemis, ou qu'elle recouvre la liberté par l'oppression des tyrans? Personne ne doute que celui qui aurait de la joie dans la première occasion, ou qui n'en aurait point dans la seconde, ne commît un très grand crime. On peut faire le même jugement des autres passions. Cependant le devoir de la sagesse est non de les modérer, mais de modérer leurs causes, comme je l'ai déjà dit ; car elles viennent de dehors. Il n'est pas besoin de leur mettre un frein, parce que les plus modérées peuvent être fort vicieuses, et les plus immodérées peuvent être fort innocentes. Il n'est pas nécessaire de désigner les lieux, les temps et les occasions où elles sont raisonnables et légitimes. Comme c'est un bien de tenir le droit chemin, et un mal de s'égarer, c'est aussi un bien de se porter à la vertu par les passions, et un mal de se porter par ces mêmes passions au vice. Pour grand que soit le plaisir, il est innocent quand il se contient dans les bornes du mariage. Pour léger qu'il soit, il est vicieux dès qu'il passe ces bornes-là, et qu'il s'étend sur les droits d'un autre. Ce n'est pas une maladie que de se mettre en colère, de désirer, d'être sensible au plaisir; mais c'est une maladie que d'y être sujet ; car quiconque est sujet à se mettre en colère, s'y met au temps auquel il ne s'y doit pas mettre, et contre les personnes contre qui il ne s'y doit pas mettre. Celui qui est sujet à faire des souhaits, désire ce qui ne lui est pas nécessaire. Il fallait donc travailler à faire en sorte que, puisque l'on ne peut et que l'on ne doit pas même arrêter tout à fait les mouvements des passions, parce que la nature nous les a données et qu'elles sont nécessaires pour plusieurs devoirs de la vie, elles se renfermassent dans le droit chemin où il n'y a point de danger. XVII. Le désir de réfuter les œuvres des philosophes m'a poussé plus loin que je n'avais dessein d'aller. Je montrerai que les mouvements qu'ils ont pris pour des vices, bien loin d'être des vices, sont au contraire de grandes vertus. Je ferai entrer dans ma preuve un exemple que je tiens pour très important. Ils soutiennent que la crainte est un vice, que c'est une faiblesse d'esprit, qu'elle est directement opposée au courage, et que jamais elle ne se rencontre avec lui. Quelqu'un pourrait-il jamais croire que ce soit une action de courage que de craindre? Il n'y a point d'apparence. On ne saurait s'imaginer que quoi que ce soit puisse être le même que son contraire. Cependant, sans user des subtilités dont Socrate use dans Platon pour obliger ceux contre lesquels il dispute à confesser ce qu'ils avaient nié, je ferai voir simplement, et sans artifice : que la plus grande de toutes les craintes est la plus grande de toutes les actions de courage. Personne ne doute que la crainte de la douleur, de la pauvreté, du bannissement, de la prison et de la mort, ne soit un effet de faiblesse et de lâcheté. Quiconque n'appréhende aucune de ces choses, passe pour hardi et pour être intrépide. Quiconque craint Dieu, ne craint rien de tout cela. Je n'ai pas besoin de chercher des preuves pour établir cette vérité. On a vu, et on voit tous les jours, les nouveaux genres de supplice que souffrent ceux qui le servent. Je ne saurais retracer sans horreur, la triste image des manières différentes dont on les a fait mourir, et la rage que les bêtes ont exercée sur leurs corps jusqu’après leur mort. Ils ont cependant supporté ces tourments avec une patience invincible et sans jeter un soupir. La victoire que leur courage a remportée sur la cruauté a surpris tous les peuples, et les bourreaux mêmes. Ce courage ne procédait que de la crainte de Dieu. Ainsi il ne faut point arracher la crainte de l'âme, comme les stoïciens le disent; ni la modérer, comme disent les péripatéticiens; mais il la faut tourner vers son véritable objet. Quand elle regardera Dieu, elle ne regardera plus aucune créature, et elle sera unique et légitime. On met le désir au nombre des vices ; mais il n'est vice que quand il s'attache à la terre, au lieu qu'il est vertu quand il s'élève dans le ciel; car quiconque souhaitera, de tout son cœur, de posséder la justice, la vie éternelle et les riches biens que Dieu nous procure, n'aura que du mépris pour les richesses, pour les honneurs, pour la puissance, et même pour les royaumes et pour les empires. Les stoïciens diront peut-être que, pour posséder ces biens-là, il ne faut que le vouloir. Au contraire, c'est peu de le vouloir. Il y a plusieurs personnes qui le veulent; mais dès qu'elles sont pressées par la douleur, elles cessent de le vouloir, et continuent de désirer. Quand le désir des biens du ciel nous fait mépriser les biens de la terre, il mérite d'être mis au nombre des vertus. Ainsi, au lieu d'arracher les passions, il en faut faire un bon usage, et les tourner vers l'objet qui leur est propre. Les passions ressemblent aux chevaux d'un chariot : l'adresse est de les bien conduire. Pour précipitée que soit leur course, elle ne laissera pas d'être heureuse si elle se fait dans le bon chemin. Pour peu qu'elle s'en écarte, elle sera malheureuse quand elle serait lente, et elle se terminera ou à des précipices, ou à un autre lieu qu'à celui où elle tend. La crainte et le désir seront des vices s'ils s'attachent à la terre, au lieu que ce seront des vertus s'ils s'élèvent vers le ciel. Les philosophes dont je parle prennent la parcimonie pour une vertu. Il est certain néanmoins qu'elle n'en est pas une, si elle n'est rien autre chose que le désir d'avoir, parce qu'elle s'occupe à accroître ou à conserver les biens de la terre. Pour nous, nous ne rapportons point ce souverain bien à la commodité du corps, mais au salut de l'âme, étant persuadés, comme nous le sommes, qu'au lieu d'épargner son bien, il le faut employer généreusement aux œuvres de justice et de charité. Nous n'avons garde d'avancer que la frugalité soit une vertu, elle n'en a que le nom et l'apparence. La frugalité, qui ne s'abstient des plaisirs que par le désir d'amasser du bien, est un vice; car on n'est pas moins obligé à mépriser le bien qu'à s'abstenir des plaisirs. L'épargne et le ménage que l'on fait du bien procède d'une bassesse d'esprit, ou qui appréhende de manquer de ce qui lui est nécessaire, ou qui désespère de réparer la dissipation de ce qu'il aurait donné généreusement, ou qui n'a pas assez d'élévation et de force pour mépriser les richesses. Cependant ces philosophes donnent le nom de prodigues à ceux qui n'épargnent pas leurs biens. Ils mettent cette différence entre les libéraux et les prodigues : que les premiers donnent à certaines rencontres, et avec une certaine mesure, à ceux qui les ont obligés ; au lieu que les derniers donnent hors de saison, et plus que leur commodité ne le peut permettre, à ceux auxquels ils n'ont aucune obligation. Dirons-nous que c'est [être prodigue que d'employer son bien, par charité, à nourrir les pauvres ? Il y a grande différence entre ceux qui donnent leur bien par débauche à des femmes perdues, et ceux qui le donnent aux pauvres par charité; entre ceux qui l'abandonnent à des joueurs et à des infâmes, et ceux qui le consacrent au service de Dieu; entre ceux qui l'emploient à des festins et ceux qui le déposent dans le trésor de la justice. C’est un vice d'en faire un mauvais usage et une vertu d'en faire un bon usage. C'est une vertu de ne point épargner son bien que l'on peut réparer, quand il s'agit de conserver à un homme la vie que l'on ne pourrait lui rendre si elle était une fois perdue, et c'est un vice de l'épargner en cette occasion. Je ne pourrais m'empêcher d'accuser de folie ceux qui ôtent à l'homme tous ces senti mens de douceur et de tendresse, et qui, sous prétexte de le rendre tranquille, le rendent insensible, non seulement il n'est pas possible de l'établir dans le profond repos qu'ils prétendent, parce que de soi-même il est toujours dans l'agitation et dans le mouvement; mais quand cela serait possible, cela ne serait pas raisonnable, parce que, comme l'eau qui croupit n'est pas saine, ainsi un esprit qui est immobile n'est utile à rien, et ne pourrait produire la moindre pensée. Enfin, priver l'âme du mouvement, c'est la priver de la vie, qui est un mouvement au lieu que la mort est un repos. Il faut avouer que ces philosophes connaissent quelques vertus ; mais ils n'en savent pas l'usage. La constance est une vertu, mais elle ne consiste pas à repousser les injures qui nous sont faites; car au lieu de les repousser il les faut souffrir, et je rapporterai incontinent les raisons qui nous y obligent. La constance consiste à n'être point ébranlée par les menaces ni par les supplices de ceux qui nous veulent obligera violer les commandements de Dieu. Le mépris de la mort est une vertu, non quand on la recherche et qu'on se la procure, comme ont fait plusieurs philosophes, car alors c'est un crime, mais quand on la souffre généreusement plutôt que d'abandonner Dieu, et de renoncer à la foi, quand on conserve la liberté et la religion au milieu de toutes les menaces du siècle, et que l'on méprise la violence et la rage des tyrans. Ainsi, par une grandeur extraordinaire de courage, nous foulons aux pieds la douleur et la mort que le reste des hommes appréhendent sur toutes choses. C'est en ce point que Consiste la vertu et la constance : d'être tellement attachés à Dieu que rien de ce que te monde a de plus terrible ne nous en puisse séparer. Cicéron a donc eu raison de dire : « Celui qui craint la mort, la douleur, l'exil, la pauvreté, ne peut être homme de bien. » Sénèque n'en a pas eu moins d'écrire, dans ses livres de philosophie morale, les paroles qui suivent : « Voilà le véritable honnête homme qui ne se fait point remarquer par l'éminence de sa dignité, par l'éclat de la pourpre, par la foule des officiers, mais qui n'en vaut de rien moins pour être privé de toutes ces choses. Quand il voit la mort présente, il ne s'étonne point comme s'il voyait quelque chose de nouveau. S'il est obligé de subir les plus cruels supplices, d'avaler des charbons de feu, d'être cloué à un poteau, il se mettra moins en peine de la douleur qu'ils lui causeront, que de la manière dont il les souffre. » Quiconque sert Dieu souffre ces tourments sans les craindre, et partant il est juste. La conséquence que l'on peut tirer de ce discours, est que ceux qui sont éloignés du culte de Dieu ne peuvent avoir aucune vertu, ni même connaître les justes bornes où elle est renfermée. XVIII. Laissons là les philosophes qui, ne sachant rien, s'imaginent tout savoir, ou qui, s'ils savent quelque chose, ne font aucune réflexion sur ce qu'ils savent, ou qui, s'imaginant savoir ce qu'ils ne savent pas, tombent dans une extravagance ridicule. Pour nous, qui sommes les seuls à qui Dieu a révélé sa vérité et découvert sa sagesse, faisons ce qu'il nous ordonne, supportant les défauts des uns et des autres; entraidons-nous dans les travaux de la vie présente, et si nous y faisons quelque bien, n'en tirons point de vanité. Dieu nous avertit que celui qui pratique la justice ne doit jamais s'enfler d'orgueil, de peur que quand il subvient aux besoins des misérables, il semble avoir plutôt cherché à se satisfaire soi-même qu'à accomplir les préceptes de l'aumône, et que jouissant de la louange qu'il a recherchée, il ne soit privé de la récompense éternelle. Les autres commandements que doivent observer ceux qui se sont consacrés au service de Dieu sont fort aisés, comme celui de ne mentir jamais à dessein de tromper ou de nuire. C'est un crime à celui qui fait profession de la vérité de s'en détourner le moins du monde pour surprendre quelqu'un. Le mensonge n'a point de lieu dans le chemin de la justice et des vertus où nous marchons. Nul de ceux qui y marchent avec nous ne prononcera ces paroles de Lucilius: Ce n'est point du tout ma coutume, ni ma manière d'agir, que de déguiser la vérité en parlant à mes amis. Car il sera persuadé qu'il ne lui est jamais permis de la déguiser, non pas même lorsqu'il parle à un ennemi on a un inconnu, et jamais la langue ne trahira le cœur dont elle est l'interprète. S'il prête de l'argent, il n'en tire aucun profit, et il oblige trop généreusement pour attendre aucune récompense de ses bienfaits. Il doit quelquefois même être bien aise de le prendre; mais il ne peut, jamais recevoir plus qu'il n'a prêté. Quiconque cause d'une autre sorte fait son avantage de la misère d'autrui, et cherche à se couvrir des dépouilles des pauvres. Jamais un homme de bien ne perdra une occasion d'exercer la charité; jamais il ni la déshonorera par un gain aussi peu honnête qu'est celui de l'usure, et il fera en sorte de m rien perdre en prêtant, parce que s'il perd àt l'argent, il acquerra de la réputation. Il ne recevra point de présents du pauvre, afin que le secours qu'il lui aura apporté soit d'autant plus grand qu'il aura été gratuit. Il ne répondra que par des paroles obligeantes aux paroles les plus outrageuses. Adorant la parole éternelle, qui est la source de toute bonté, il n'en dira aucune qui soit mauvaise. Il se gardera bien d'exciter par sa faute la haine de qui que ce soit; et a quelqu'un est assez injuste et assez insolent pour lui faire outrage, il le souffrira avec modération et en laissera la vengeance à Dieu, bien loin d'entreprendre de la prendre. Il conservera son innocence en tout temps et en tout lieu, ce qui s'étend plus loin qu'il ne semble ; car cela veut dire qu'il ne fera aucune injure à personne, et que si on lui en fait quelqu'une, il ne la repoussera pas ; il la remettra entre les mains du juge souverain et équitable qui voit toutes les actions et toutes les pensées des hommes. Il ne s'en rapportera qu'à lui, parce qu'il n'y a personne qui puisse éviter l'exécution de son jugement. Cela est cause qu'un homme de bien est généralement méprisé et qu'il passe pour un lâche, dans la créance qu'il ne saurait se défendre. Au contraire, ceux qui vengent leurs injures passent pour des gens de cœur, et attirent l'estime et le respect de tout le monde. Quelque avantage qu'un homme puisse procurer à un grand nombre de personnes, il sera toujours moins considéré que celui qui a le pouvoir de nuire. Il ne se corrompra pas pour cela au milieu de la corruption des autres; il obéira plutôt aux commandements de Dieu qu'il ne suivra leur exemple, et il aimera mieux être méprisé que de manquer à son devoir. « Si quelqu'un, dit Cicéron dans les livres des Offices, veut pénétrer les replis de sa propre conscience, qu'il apprenne de soi-même que l'homme de bien est celui qui sert tous ceux qu'il peut servir et qui ne nuit jamais à personne, si ce n'est qu'il ait été attaqué et qu'il ait reçu quelque injure. » Il a corrompu une vérité très importante par la condition qu'il y a ajoutée, par laquelle il a gâté le portrait de l'homme de bien et lui a ôté ornement de la patience, qui est une des plus belles vertus. Pourquoi ajoutait-il ces paroles : « ce n'est qu'il ait été attaqué, et qu'il ait reçu quelque injure. « L'homme de bien, dit-il, nuira quand il aura été attaqué. » S'il nuit, il ne sera point homme de bien : il y a autant de mal à pousser une injure qu'à la faire. D'où viennent s contestations, les querelles et les guerres, si ce n'est de la résistance que l'impatience fait à l'injustice? Que si l'on n'opposait à l'injustice ne la patience, qui est la vertu la plus propre et la plus nécessaire à l'homme, Oh l'arrêterait l'heure même, comme on arrête le feu en jetant de l'eau dessus. Mais quand on veut la repousser en lui opposant l'impatience, elle excite un incendie qui ne peut être éteint que par le sang. Ainsi Cicéron, qui fait profession de l'étude de la sagesse, a privé l'homme de bien de la patience, qui est une vertu de grand usage dans cette vie : elle arrête seule le coure des crimes, et il n'y en aurait plus aucun sur la terre si elle se trouvait dans le cœur de tous les hommes. Quel plus grand malheur peut-il arriver à un homme de bien, que de lâcher la bride à la colère, qui le rend indigne de ce nom! Cicéron avoue lui-même qu'il n'y a rien de si contraire à la nature de l'homme que de nuire à un autre. Les bêtes se défendent quand on les attaque ; les serpents ne font du mal que quand on les poursuit pour les tuer; et pour passer de l'exemple des bêtes à celui des hommes, les plus grossiers et les plus ignorants se portent à la vengeance avec une fureur aveugle des qu'on leur fait quelque injure. Quelle différence y aura-t-il entre eux et un homme sage, s'il n'a une patience invincible qu'ils n'ont point, s'il ne sait réprimer la colère à laquelle ils s'abandonnent ? Ce qui a trompé Cicéron, c'est qu'en parlant de la vertu et de la force, il a va qu'en toute sorte de combats elle devait remporter la victoire, et n'a pu reconnaître; que celui qui suit les mouvements de la douleur ou de la colère, qui obéit à ses passions, et qui, au lieu de leur résister, reçoit les impressions qu'elles lui donnent, n'est plus dans le chemin de la vertu. Celui qui veut venger l'injure qu'il a reçue, imite celui qui la lui a faite. Or quiconque imite un méchant ne peut pas être homme de bien. Ainsi Cicéron a ôté à son sage deux grandes vertus en deux paroles, l'innocence et la patience. Comme il avait une éloquence de chien, ainsi que disait Appius selon le témoignage de Salluste, il a voulu aussi que les hommes vécussent à la manière des chiens, et qu'ils mordissent, comme eux, quand ils seraient attaqués. On ne saurait trouver d'exemple plus juste, pour faire voir combien la vengeance que l'on recherche des injures que l'on a reçues excite de tempêtes et désordres, que celui de cet orateur même qui la défend, et qui s'est perdu lui-même est l'enseignant comme il l'avait apprise des philosophes. S'il n'avait opposé que la patience aux outrages qu'on lui faisait, s'il les avait dissimulés, au Heu de les repousser par ces oraisons fameuses qu'il fit sous un titre étranger avec une légèreté, un emportement et une extravagance incroyables, jamais sa tête n'aurait ensanglanté la tribune dont elle avait été autrefois le principal ornement, et jamais on n'aurait vu la proscription du triumvirat qui fut si funeste à la république. Ce n'est pas le propre d'un homme de bien ou d'un homme sage de vouloir s'exposer au danger d'une bataille, parce que l'événement en est incertain, et que la victoire n'est pas en notre pouvoir. Le propre d'un homme de bien et d'un homme sage est non de se défaire de son ennemi, ce qui ne se fait ni sans crime, ni sans danger, mais d'ôter tous les sujets de contestation et d'inimitié, ce qui se fait avec justice et avec avantage. Il faut donc considérer la patience comme une grande vertu. Dieu a mieux aimé permettre que l'homme de bien passât pour un lâche, que de permettre qu'il fût privé d'une vertu si nécessaire; car s'il ne souffrait jamais aucune injure, on ne pourrait reconnaître la force qu'il a de réprimer les mouvements de la colère et de la vengeance. Que si, quand il en a souffert quelqu'une, il tâchait de la repousser, il serait vaincu ; au lieu que s'il la souffre, il est maître de soi-même et victorieux. Cette vertu, qui le rend maître de soi-même, s'appelle patience, et on peut dire qu'elle est toute seule contraire à toute sorte de vices. Elle apaise les troubles qui agitent l'âme, et la rend, en quelque sorte, à elle-même. Il n'est pas possible de dompter tellement la nature, que nous ne soyons jamais émus d'aucune passion ; mais il en faut réprimer les mouvements avant qu'ils aient fait beaucoup de mal. Dieu nous a défendu de laisser coucher le soleil sur notre colère. Cicéron a mis lui-même le pardon des injures au nombre des vertus, bien que cela soit fort contraire au précepte qu'il avait donné de les repousser. « Je l'espère, dit-il, César, parce que vous n'oubliez rien que les injures. » Que si un homme aussi éloigné non seulement de la justice céleste et divine, mais de la justice humaine et civile, oubliait les injures, ne les devons-nous pas plutôt oublier, nous qui sommes appelés à une profession éminente, et qui prétendons à une vie éternelle. XIX. Lorsque les stoïciens tâchent d'ôter à l'homme les passions comme les maladies qui ruinent la santé de l'âme, les péripatéticiens s'y opposent, et soutiennent que la nature ne les lui a pas données sans une très grande raison. Ils n'auraient pas tort en cela, s'ils savaient quelles sont les justes bornes des choses. Ils disent que la colère est comme le foyer de la valeur, comme si pour se battre avec courage il fallait nécessairement être transporté de colère. Il faut bien voir par là qu'ils ne savent ni ce que c'est que la vertu, ni pourquoi Dieu a donné la colère à l'homme. Si elle a été donnée pour tuer des hommes, il n'y a rien de si cruel que l'homme, que Dieu a créé pour vivre dans l'innocence et dans la société, il n'y a rien de si semblable aux bêtes les plus farouches. Il y a trois passions qui l'engagent en toute sorte de crimes: la colère, le désir et le plaisir. C'est pour cela que les poètes ont feint qu'il y avait trois furies qui agitaient son âme. La colère demande la vengeance, le désir demande les richesses, et le plaisir demande la volupté. Dieu a mis à toutes ces choses certaines bornes qu'elles ne peuvent passer sans corrompre leur nature et sans devenir vicieuses. Il est aisé de les marquer. Le désir nous a été donné pour acquérir les choses qui sont nécessaires à la conservation de notre vie ; le plaisir nous a été donné pour la production des enfants, et la colère pour retenir dans le devoir ceux qui sont sous notre puissance, pour imprimer de la crainte aux jeunes gens, et pour empêcher qu'ils ne prennent une licence effrénée de se porter a toutes sortes de vices. S'il est juste, et même nécessaire, d'entrer en colère contre ceux qui sont au-dessous de nous, il est dangereux et impie d'y entrer contre nos égaux : cela est impie, parce que l'on ne le saurait faire sans violer l'humanité ; et cela est dangereux, parce que s'ils se défendent il faut ou périr ou les perdre. Le commandement que Dieu nous fait de ne nous point mettre en colère contre ceux qui nous offensent et qui nous disent des injures, montre clairement que cette passion ne nous a été donnée que pour l'usage que j'ai marqué, qui est de ne point souffrir, par une pernicieuse indulgence, les fautes de ceux qui sont au-dessous de nous, et de les corriger sans cesse, de peur que leurs vicieuses habitudes se fortifient. Quelques philosophes ont étendu, par ignorance, les bornes de ces passions, et les autres les ont absolument rejetées, bien que l'on en puisse faire un fort bon usage. C'est une des grandes sources des injustices et des impiétés qui se commettent dans le monde. Quand on entre en colère contre ses égaux, on excite des contestations, des querelles et des guerres. Quand on désire amasser de grandes richesses, on use de tromperies, et on commet des brigandages et des meurtres. Quand on ne cherche ce plaisir que pour le plaisir, on est porté aux fornications, aux adultères et à d'autres abominations. Il faut contenir ces commandements dans les bornes qui leur sont prescrites ; ce que ne peuvent faire ceux qui ne connaissent pas Dieu ; mais ceux qui le font sont patients, courageux et justes. XX. Il ne me reste plus à parler que des plaisirs des sens. Aussi bien suis-je obligé de finir ce livre, qui n'est déjà que trop long. Tous les plaisirs étant vicieux et funestes, il les faut réprimer et les vaincre, ou, comme je l'ai déjà dit, les renfermer dans les bornes qui leur sont prescrites. Les animaux ne sentent point d'autre plaisir que celui de la génération ; ils n'usent des sens que par nécessité ; ils voient pour chercher ce qui leur est nécessaire pour la conservation de leur vie; ils écoutent pour se reconnaître et pour s'assembler ; ils flairent et ils goûtent pour choisir ce qui leur est propre à manger et pour rejeter ce qui ne l'est pas ; ils boivent et mangent jusqu'à ce que leur estomac soit rempli. Mais la providence de l'excellent ouvrier qui a créé l'homme, a répandu le plaisir indifféremment sur toutes ses actions, afin que la vertu le combatte continuellement, comme un ennemi domestique. « On n'est excité aux adultères, dit Cicéron dans le dialogue qui a pour titre l’ancien Caton, et aux autres débauches les plus infâmes, que par les aiguillons de la volupté. La nature ou quelque divinité ayant donné l'esprit à l'homme, comme le plus excellent de tous les présents, il n'y a rien qui lui soit si contraire que le plaisir. Quand le plaisir domine, la tempérance n'est plus d'aucun usage, et la vertu ne peut s'accorder avec la volupté. » Dieu a donné à l'homme la vertu pour réformer la volupté et pour la renfermer dans des bornes, de peur qu'elle ne le surprenne pas ses attraits, qu'elle ne l'assujettisse à son empire et ne l'engage dans une mort éternelle. Le plaisir des yeux a divers objets et se tire de la vue des choses qui sont à l'usage de l'homme, et qui sont parées des beautés de fart ou de la nature. Les philosophes ont eu raison de l'ôter, et de soutenir que regarder le ciel est une occupation plus digne de l'homme que de regarder ce qu'il y a de plus rare et de plus excellent sous le ciel, et qu'il doit plutôt admirer la splendeur des astres qui y sont attachés que la variété des couleurs, et l'éclat de l'or et des pierreries qui brillent sur les tableaux et sur les plus riches ouvrages de la main des hommes. Mais après que ces philosophes nous ont exhortés avec assez d'éloquence à regarder le ciel, et à mépriser les spectacles que la terre nous peut présenter, ils s'y arrêtent eux-mêmes, et y prennent du plaisir. Pour nous, nous devons nous en abstenir absolument, parce qu'ils corrompent l'esprit et le portent au vice, et ne contribuent en rien à notre bonheur. Quiconque voit égorger un homme avec plaisir, souille sa conscience, bien que cet homme-là ait mérité la mort et qu'il y ait été condamné par les lois, et il est presque aussi coupable que s'il avait eu part aux homicides commis en secret. Ils appellent des jeux ces exercices où l'on répand le sang ! Ces hommes se sont tellement dépouillés des sentiments de l'humanité, qu'ils s'imaginent se jouer et se divertir lorsqu'ils massacrent d'autres hommes. Ils sont sans doute plus coupables que ceux dont ils se plaisent à voir répandre le sang. Je voudrais bien qu'on me dit si ceux-là ont de la pitié et de la justice, qui non seulement permettent que l'on tue des hommes qui implorent leur clémence, mais qui, non contents des blessures qu'ils leur ont vil recevoir et du sang qu'ils leur ont vu répandre, demandent avec faveur qu'on leur ôte la vie, et de peur que quelqu'un ne leur échappe en faisant semblant d'être mort, crient que l'on achève des misérables qui sont renversés par terre et percés de coups. Ils se fâchent quand les gladiateurs combattent trop longtemps sans se tuer; et, comme s'ils étaient altérés de sang, ils demandent qu'on en amène d'autres qui aient plus de vigueur. Cette coutume cruelle ôte tous les sentiments de l'humanité, et ceux qui l'ont une fois prise n'épargnent pas les innocents, et sont bien aises que l'on exerce indifféremment sur tout le monde les traitements qu'ils ont vu faire aux coupables. Ceux qui veulent marcher dans le chemin de la justice doivent bien se garder de devenir complices de ces meurtres publics. Quand Dieu nous a défendu de tuer, il nous a aussi défendu non seulement de voler, ce qui n'est pas non plus permis par les lois, mais aussi de faire beaucoup d'autres choses qui sont permises par les lois civiles. Il n'est pas permis à un homme de bien d'aller à la guerre, parce qu'il ne connaît point d'autre guerre que celle que sa vertu fait continuellement au vice. Il ne lui est pas permis d'intenter une accusation capitale, parce qu'il n'y a point de différence entre celui qui lue par le fer et celui qui tue par la langue, et qu'il est défendu de tuer de quelque manière que ce soit. Ainsi la défense que Dieu a faite de tuer ne souffre point d'exception. Que personne ne se persuade qu'il soit permis d'écraser des enfants qui viennent de naître ; c'est une horrible impiété de leur ôter la vie que Dieu leur a donnée. Cependant s'il se trouve des personnes qui, voulant se souiller des crimes les plus atroces, envient à ces faibles et innocentes créatures la jouissance de la lumière que leur créateur leur avait accordée, comment ceux qui n'épargnent pas leur propre sang épargneraient-ils celui des autres ? L'énormité de leur crime est si manifeste, qu'il n'y a point de couleur par où on puisse la déguiser. Que dirons-nous de ceux qui, par une fausse piété, exposent leurs enfants? Peuvent-ils passer pour innocents, quand ils abandonnent aux dents des chiens leurs propres entrailles? Et ne font-ils pas mourir ces enfants d'un plus cruel genre de mort que s'ils les avaient étranglés? Qui doute que ce ne soit une impiété de priver ces innocentes créatures de l'effet de la compassion des personnes charitables ? Quand ils auraient le bonheur de tomber entre les mains de quelqu'un qui prit le soin de les élever, celui qui les a exposés, les a mis en danger ou d'être réduits en servitude, ou d'être prostitués dans les lieux de débauche. Qui est-ce qui ne sait pas les outrages que l'on peut faire, soit par méprise ou autrement, aux deux sexes, lorsqu'on les confond, et dont Œdipe est un exemple funeste? Ceux qui déposent leurs enfants sont donc aussi coupables que ceux qui les tuent. Ces parricides prétendent trouver une excuse légitime dans leur pauvreté, qui ne leur a pas permis de nourrir un si grand nombre d'enfants. Il n'est pas au pouvoir des hommes d'avoir du bien : Dieu donne tous les jours des richesses aux pauvres, et réduit les riches à la pauvreté. Que si quelqu'un se trouve en effet si pauvre qu'il n'ait pas de quoi nourrir des enfants, qu'il s'abstienne de la compagnie de sa femme plutôt que de détruire l'image de Dieu. Ainsi l'homicide étant défendu, de quelque manière qu'on le commette, il n'est pas permis de le regarder, de peur que la conscience ne soit souillée par la vue du sang que l'on ne répand que pour donner un cruel plaisir au peuple. Je ne sais si la corruption du théâtre n'est point encore plus criminelle que celle des spectacles et des combats. La comédie ne représente le plus souvent que déjeunes filles corrompues et violées, que des femmes qui font l'amour : et plus les poètes qui ont décrit ces désordres ont d'élégance, plus leurs sentiments entrent avant dans l'esprit, et plus leurs erreurs s'attachent à la mémoire. Les tragédies ne contiennent autre chose que les parricides et les incestes des méchants princes. Les mouvements impudiques des bouffons n'inspirent que la débauche. Ils enseignent à commettre de véritables adultères quand ils en représentent d'imaginaires. Quelles impressions ces sales représentations ne font-elles pas dans l'esprit des jeunes gens, quand ils voient que tout le monde y assiste sans pudeur? Le plaisir, qui entre plutôt par les yeux que par les autres sens, s'allume dans leur cœur. Ils approuvent les infamies quand ils en rient ; et les jeunes gens dont il ne faut pas corrompre l'innocence, et les vieillards qui ne sont plus en âge de pécher, s'en retournent en leurs maisons plus corrompus qu'ils n'étaient venus au théâtre.
Il n'y a que de la légèreté, de la vanité et de l'extravagance
dans les jeux du cirque; les spectateurs entrent dans une fureur égale à
l'impétuosité avec laquelle les tenants courent dans la carrière. Ceux qui
semblaient n'être venus que pour regarder, se font regarder eux-mêmes par
l'excès de leurs clameurs et par le dérèglement de leurs gestes. Il faut donc
éviter absolument tous les spectacles, de peur qu'ils n'impriment les mouvements
inquiets des vices dans des âmes qui doivent être tranquilles et paisibles, et
que les attraits de la volupté ne nous détournent du service de Dieu et de la
pratique des bonnes œuvres. Les jeux sont des fêtes des faux dieux ; ils n'ont
été institués que pour honorer le jour de leur naissance, ou pour rendre la
consécration de leurs temples plus célèbre. Les chasses et les présents ont été
ordonnés au commencement en l'honneur de Saturne, les faux dieux du théâtre en
l'honneur de Bacchus, et les jeux du cirque en l'honneur de Neptune. Ils ont été
attribués par la suite du temps aux autres dieux, comme Sisinius Capiton le
prouve fort au long dans les livres qu'il a faits des spectacles. Quiconque va à
ces spectacles, qui sont des cérémonies de la superstition païenne, quitte le
service de Dieu et s'attache à celui des démons. |
|
CAPUT XXI. De aurium voluptatibus, et sacris Litteris. Aurium voluptas ex vocum et cantuum suavitate percipitur; quae scilicet tam vitiosa est, quam oblectatio illa, de qua diximus, oculorum. Quis enim non luxuriosum ac nequam putet eum, qui scenicas artes domi habeat? Atqui nihil refert, utrumne luxuriam solus domi, an cum populo exerceas in theatro. Sed jam de spectaculis dictum est. Restat unum, quod est nobis expugnandum; ne capiamur iis, quae ad sensum intimum penetrant. Nam illa omnia, quae verbis carent, id est aeris et nervorum suaves soni, possunt facile contemni, quia non adhaerent, nec scribi possunt. Carmen autem compositum, et oratio cum suavitate decipiens, capit mentes, et quo voluerit impellit. Inde homines litterati cum ad Dei religionem accesserint, si non fuerint ab aliquo perito doctore fundati, minus credunt. Assueti enim dulcibus et politis sive orationibus, sive carminibus, divinarum litterarum simplicem communemque sermonem pro sordido aspernantur. Id enim quaerunt, quod sensum demulceat. Persuadet autem quidquid suave est, et animo penitus, dum delectat, insidit. Num igitur Deus et mentis, et vocis, et linguae artifex diserte loqui non potest? Imo vero summa providentia carere fuco voluit ea quae divina sunt, ut omnes intelligerent quae ipse omnibus loquebatur. Ergo qui veritati studet, qui non vult se ipse decipere, abjiciat inimicas ac noxias voluptates, quae animam sibi vinciant, ut corpus cibi dulces: praeferantur vera falsis, aeterna brevibus, utilia jucundis. Nihil aspectu gratum sit, nisi quod pie, quod juste fieri videas; nihil auditu suave, nisi quod alit animam, melioremque te reddit. Maximeque hic sensus non est ad vitium detorquendus, qui nobis ideo datus est, ut doctrinam Dei percipere possemus. Itaque si voluptas est, audire cantus et carmina, Dei laudes canere et audire jucundum sit. Haec est voluptas vera, quae comes et socia virtutis est. Haec est non caduca et brevis ut illae quas appetunt, qui corpori, ut pecudes, serviunt; sed perpetua, et sine ulla intermissione delectans. Cujus terminos si quis excesserit, nihilque aliud ex voluptate petierit, nisi ipsam voluptatem; hic mortem meditatur, quia sicut vita perpetua in virtute est, ita mors in voluptate. Qui enim temporalia maluerit, carebit aeternis; qui terrena praetulerit, coelestia non habebit. CAPUT XXII. De saporis et odoris voluptatibus. Ad voluptates autem saporis et odoris, qui duo sensus ad solum corpus pertinent, nihil est quod a nobis disputetur; nisi forte quis exigit ut dicamus, turpe esse sapienti ac bono, si ventri et gulae serviat; si unguentis oblitus, ac floribus coronatus incedat: quae qui facit, utique insipiens, ineptus, et nihili est, et quem ne odor quidem virtutis attigerit. Fortasse quispiam dixerit: Cur ergo illa facta sunt, nisi ut iis fruamur? Atenim jam saepe dictum est, virtutem nullam futuram fuisse, nisi haberet quae opprimeret. Itaque fecit omnia Deus ad instruendum certamen rerum duarum. Ergo illecebrae istae voluptatum arma sunt illius, cujus opus unum est, expugnare virtutem, justitiamque ab hominibus excludere. His blandimentis et suavitatibus titillat animas. Scit enim quia mortis est fabricatrix voluptas. Nam sicut Deus hominem ad vitam, non nisi per virtutem ac laborem vocat: ita ille ad mortem per delicias ac voluptates; et sicut ad verum bonum per fallacia mala, sic ad verum malum per fallacia bona pervenitur. Cavenda sunt igitur oblectamenta ista, tanquam laquei et plagae; ne suavitudinum mollitie capti, sub ditionem mortis cum ipso corpore redigamur, cui nos mancipavimus. CAPUT XXIII. De tactus voluptate et libidine, atque de matrimonio et continentia. Venio nunc ad eam, quae percipitur ex tactu, voluptatem: qui sensus est quidem totius corporis. Sed ego non de ornamentis, aut vestibus, sed de sola libidine dicendum mihi puto; quae maxime coercenda est, quia maxime nocet. Cum excogitasset Deus duorum sexuum rationem, attribuit iis, ut se invicem appeterent, et conjunctione gauderent. Itaque ardentissimam cupiditatem cunctorum animantium corporibus admiscuit, ut in hos affectus avidissime ruerent, eaque ratione propagari et multiplicari genera possent. Quae cupiditas et appetentia in homine vehementior et acrior invenitur; vel quia hominum multitudinem voluit esse majorem, vel quoniam virtutem soli homini dedit, ut esset laus et gloria in coercendis voluptatibus, et abstinentia sui. Scit ergo adversarius ille noster, quanta sit vis hujus cupiditatis, quam quidam necessitatem dicere maluerunt; eamque a recto et bono, ad malum et pravum transfert. Illicita enim desideria immittit, ut aliena contaminent, quibus habere propria sine delicto licet. Objicit quippe oculis irritabiles formas, suggeritque fomenta, et vitiis pabulum subministrat: tum intimis visceribus stimulos omnes conturbat et commovet, et naturalem illum incitat atque inflammat ardorem, donec irretitum hominem implicatumque decipiat. Ac ne quis esset, qui poenarum metu abstineret alieno, lupanaria quoque constituit; et pudorem infelicium mulierum publicavit, ut ludibrio haberet tam eos qui faciunt, quam quas pati necesse est. His obscoenitatibus animas, ad sanctitatem genitas, velut in coeni gurgite demersit, pudorem extinxit, pudicitiam profligavit. Idem etiam mares maribus admiscuit; et nefandos coitus contra naturam contraque institutum Dei machinatus est: sic imbuit homines, et armavit ad nefas omne. Quid enim potest esse sanctum iis, qui aetatem imbecillam et praesidio indigentem, libidini suae depopulandam foedandamque substraverint? Non potest haec res pro magnitudine sceleris enarrari. Nihil amplius istos appellare possum, quam impios et parricidas, quibus non sufficit sexus a Deo datus, nisi etiam suum profane ac petulanter illudant. Haec tamen apud illos levia, et quasi honesta sunt. Quid dicam de iis, qui abominandam non libidinem, sed insaniam potius exercent! Piget dicere: sed quid his fore credamus, quos non piget facere? et tamen dicendum est, quia fit. De istis loquor, quorum teterrima libido et execrabilis furor ne capiti quidem parcit. Quibus hoc verbis, aut qua indignatione tantum nefas prosequar? Vincit officium linguae sceleris magnitudo. Cum igitur libido haec edat opera, et haec facinora designet, armandi adversus eam virtute maxima sumus. Quisquis affectus illos fraenare non potest, cohibeat eos intra praescriptum legitimi tori, ut et illud, quod avide expetit, consequatur, et tamen in peccatum non incidat. Nam quid sibi homines perditi volunt? Nempe honesta opera voluptas sequitur: si ipsam per se appetunt, justa et legitima frui licet. Quod si aliqua necessitas prohibebit, tum vero maxima adhibenda virtus erit, ut cupiditati continentia reluctetur. Nec tantum alienis, quae attingere non licet, verum etiam publicis vulgatisque corporibus abstinendum, Deus praecepit; docetque nos, cum duo inter se corpora fuerint copulata, unum corpus efficere. Ita qui se coeno immerserit, coeno sit oblitus necesse est; et corpus quidem cito ablui potest: mens autem contagione impudici corporis inquinata non potest, nisi et longo tempore, et multis bonis operibus, ab ea quae inhaeserit colluvione purgari. Oportet ergo sibi quemque proponere, duorum sexuum conjunctionem generandi causa datam esse viventibus, eamque legem his affectibus positam, ut successionem parent. Sicut autem dedit nobis oculos Deus, non ut spectemus, voluptatemque capiamus, sed ut videamus propter eos actus, qui pertinent ad vitae necessitatem, ita genitalem corporis partem, quod nomen ipsum docet, nulla alia causa nisi efficiendae sobolis accepimus. Huic divinae legi summa devotione parendum est. Sint omnes, qui se discipulos Dei profitebuntur, ita morati et instituti, ut imperare sibi possint. Nam qui voluptatibus indulgent, qui libidini obsequuntur, ii animam suam corpori mancipant, ad mortemque condemnant: quia se corpori addixerunt, in quod habet mors potestatem. Unusquisque igitur, quantum potest, formet se ad verecundiam, pudorem colat, castitatem conscientia et mente tueatur; nec tantum legibus publicis pareat: sed sit supra omnes leges, qui legem Dei sequitur. Quibus bonis si assueverit, jam pudebit eum ad deteriora desciscere: modo placeant recta et honesta, quae melioribus jucundiora sunt quam prava et inhonesta pejoribus. Nondum omnia castitatis officia executus sum: quam Deus non modo intra privatos parietes, sed etiam praescripto lectuli terminat; ut cum quis habeat uxorem, neque servam, neque liberam habere insuper velit, sed matrimonio fidem servet. Non enim, sicut juris publici ratio est, sola mulier adultera est, quae habet alium, maritus autem, etiam si plures habeat, a crimine adulterii solutus est. Sed divina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari jure conjungit, ut adulter habeatur, quisquis compagem corporis in diversa distraxerit. Nec ob aliam causam Deus, cum caeteras animantes suscepto foetu maribus repugnare voluisset, solam omnium mulierem patientem viri fecit; scilicet ne foeminis repugnantibus, libido cogeret viros aliud appetere, eoque facto, castitatis gloriam non tenerent. Sed neque mulier virtutem pudicitiae caperet, si peccare non posset. Nam quis mutum animal pudicum esse dixerit, quod suscepto foetu mari repugnat? Quod ideo facit, quia necesse est in dolorem atque in periculum veniat, si admiserit. Nulla igitur laus est, non facere quod facere non possis. Ideo autem pudicitia in homine laudatur, quia non naturalis est, sed voluntaria. Servanda igitur fides ab utroque alteri est; immo exemplo continentiae docenda uxor, ut se caste gerat. Iniquum est enim, ut id exigas, quod praestare ipse non possis. Quae iniquitas effecit profecto, ut essent adulteria, foeminis aegre ferentibus praestare se fidem non exhibentibus mutuam charitatem. Denique nulla est tam perditi pudoris adultera, quae non hanc causam vitiis suis praetendat; injuriam se peccando non facere, sed referre. Quod optime Quintilianus expressit: Homo, inquit, neque alieni matrimonii abstinens, neque sui custos, quae inter se natura connexa sunt. Nam neque maritus circa corrumpendas aliorum conjuges occupatus potest vacare domesticae sanctitati; et uxor, cum in tale incidit matrimonium, exemplo ipso concitata, aut imitari se putat, aut vindicari. Cavendum igitur, ne occasionem vitiis nostra intemperantia demus: sed assuescant invicem mores duorum, et jugum paribus animis ferant. Nos ipsos in altero cogitemus. Nam fere in hoc justitiae summa consistit, ut non facias alteri, quidquid ipse ab altero pati nolis. Haec sunt quae ad continentiam praecipiuntur a Deo. Sed tamen ne quis divina praecepta circumscribere se putet posse, adduntur illa, ut omnis calumnia, et occasio fraudis removeatur, adulterum esse, qui a marito dimissam duxerit, et eum qui praeter crimen adulterii uxorem dimiserit, ut alteram ducat; dissociari enim corpus et distrahi Deus noluit. Praeterea non tantum adulterium esse vitandum, sed etiam cogitationem; ne quis aspiciat alienam, et animo concupiscat: adulteram enim fieri mentem, si vel imaginem voluptatis sibi ipsa depinxerit. Mens est enim profecto quae peccat; quae immoderatae libidinis fructum cogitatione complectitur: in hac crimen est, in hac omne delictum. Nam etsi corpus nulla sit labe maculatum, non constat tamen pudicitiae ratio, si animus incestus est; nec illibata castitas videri potest, ubi conscientiam cupiditas inquinavit. Nec vero aliquis existimet, difficile esse fraenos imponere voluptati, eamque vagam et errantem castitatis pudicitiaeque limitibus includere; cum propositum sit hominibus etiam vincere, ac plurimi beatam atque incorruptam corporis integritatem retinuerint; multique sint qui hoc coelesti genere vitae felicissime perfruantur. Quod quidem Deus non ita fieri praecepit, tamquam astringat, quia generari homines oportet: sed tamquam sinat. Scit enim quantam his affectibus imposuerit necessitatem. Si quis hoc, inquit, facere potuerit, habebit eximiam incomparabilemque mercedem. Quod continentiae genus quasi fastigium est, omniumque consummatio virtutum. At quam si quis eniti atque eluctari potuerit, hunc servum dominus, hunc discipulum magister agnoscet; hic terram triumphabit; hic erit consimilis Deo, qui virtutem Dei coepit. Haec quidem difficilia videntur: sed de eo loquimur, cui calcatis omnibus terrenis, iter in coelum paratur. Nam quia virtus in Dei agnitione consistit, omnia gravia sunt, dum ignores; ubi cognoveris, facilia. Per ipsas difficultates nobis exeundum est, qui ad summum bonum tendimus. CAPUT XXIV. De poenitentia, de venia, ac praeceptis Dei. Nec tamen deficiat aliquis, aut de se ipse desperet, si aut cupiditate victus, aut libidine impulsus, aut errore deceptus, aut vi coactus, ad injustitiae viam lapsus est. Potest enim reduci, ac liberari, si eum poeniteat actorum, et ad meliora conversus, satisfaciat Deo. Quod fieri posse Cicero non putavit, cujus haec in Academico tertio verba sunt: « Quod si liceret ut iis qui in itinere deerravissent, sic viam deviam secutos corrigere errorem poenitendo, facilior esset emendatio temeritatis. » Licet plane. Nam si liberos nostros, cum delictorum suorum cernimus poenitere, correctos esse arbitramur, et abdicatos abjectosque rursus tamen suscipimus, fovemus, amplectimur: cur desperemus clementiam Dei patris poenitendo posse placari? Ergo idem Dominus ac parens indulgentissimus remissurum se poenitentibus peccata promittit, et oblitteraturum omnes iniquitates ejus, qui justitiam denuo coeperit operari. Sicut enim nihil prodest male viventi ante actae vitae probitas, quia superveniens nequitia justitiae opera delevit: ita nihil officiunt peccata vetera correcto, quia superveniens justitia labem vitae prioris abolevit. Is enim quem facti sui poenitet, errorem suum pristinum intelligit; ideoque Graeci melius et significantius μετάνοιαν dicunt, quam nos latine possimus resipiscentiam dicere. Resipiscit enim, ac mentem suam quasi ab insania recipit, quem errati piget; castigatque seipsum dementiae, et confirmat animum suum ad rectius vivendum: tum illud ipsum maxime cavet, ne rursus in eosdem laqueos inducatur. Denique muta quoque animalia, cum fraude capiuntur, si aliquo se modo in fugam extricaverint, fiunt postmodum cautiora, vitantque semper ea omnia, in quibus dolos insidiasque senserunt. Sic hominem poenitentia cautum ac diligentem facit ad evitanda peccata, in quae semel fraude deciderit. Nemo enim potest esse tam prudens, tam circumspectus, ut non aliquando labatur. Et idcirco Deus imbecillitatem nostram sciens, pro sua pietate aperuit homini portum salutis; ut huic necessitati, cui fragilitas nostra subjecta est, medicina poenitentiae subveniret. Ergo quicumque aberraverit, referat pedem, seque quamprimum recipiat ac reformet:
Sed revocare gradum, superasque
evadere ad auras, Degustatis enim male jucundis voluptatibus, vix divelli ab his possunt: facilius recta sequerentur, si earum suavitates non attigissent. Sed si eripiant se malae servituti, condonabitur his omnis error, si errorem suum vita meliore correxerint. Nec lucrari se quisquam putet, si delicti conscium non habebit: scit enim ille omnia, in cujus conspectu vivimus, nec si universos homines celare possumus, Deum possumus, cui nihil absconditum, nihil potest esse secretum. Exhortationes suas Seneca mirabili sententia terminavit. « Magnum, inquit, nescio quid, majusque quam cogitari potest, numen est, cui vivendo operam damus. Huic nos approbemus. Nam nihil prodest inclusam esse conscientiam: patemus Deo. » Quid verius dici potest ab eo qui Deum nosset, quam dictum est ab homine verae religionis ignaro? Nam et majestatem Dei expressit, majorem esse dicendo, quam ut eam cogitatio mentis humanae capere posset; et ipsum veritatis attigit fontem, sentiendo vitam hominum supervacuam non esse, ut Epicurei volunt, sed Deo ab his operam vivendo dari, siquidem juste ac pie vixerint. Potuit esse verus Dei cultor, si quis illi monstrasset; ac contempsisset profecto Zenonem, et magistrum suum Sotionem, si verae sapientiae ducem nactus esset. « Huic nos, inquit, approbemus. » Coelestis prorsus oratio, nisi antecederet ignorantiae confessio; nihil prodest inclusam esse conscientiam: patemus Deo. » Nullus ergo mendacio, nullus dissimulationi locus est; quia parietibus oculi hominum submoventur: Dei autem divinitas nec visceribus submoveri potest, quominus totum hominem perspiciat, et norit. Idem in ejusdem operis primo: « Quid agis, inquit? quid machinaris? quid abscondis? Custos te tuus sequitur; alium tibi peregrinatio subduxit, alium mors, alium valetudo: haeret hic, quo carere numquam potes. Quid locum abditum legis, et arbitros removes? Putas tibi contigisse, ut oculos omnium effugias? demens! Quid tibi prodest non habere conscium habenti conscientiam? » Non minus mirabiliter de conscientia et Deo Tullius. « Meminerit, inquit, Deum se habere testem; id est, ut ego arbitror, mentem suam, qua nihil homini dedit Deus ipse divinius. » Item cum de justo ac bono viro loqueretur: « Itaque talis vir, inquit, non modo facere, sed ne cogitare quidem quidquam audebit, quod non audeat praedicare. » Purgemus igitur conscientiam, quae oculis Dei pervia est; et, ut ait idem, « semper ita vivamus, ut rationem reddendam nobis arbitremur; » putemusque nos momentis omnibus non in aliquo ut ille dixit, orbis terrae theatro ab hominibus, sed desuper spectari ab eo, qui et judex, et testis idem futurus est; cui rationem vitae reposcenti, actus suos inficiari non licebit. Ergo satius est aut effugere conscientiam, aut nos ipsos ultro aperire animum, et perniciem rescissis vulneribus effundere: quibus nemo alius mederi potest, nisi solus ille, qui gressum claudis, visum caecis reddidit, maculata membra purgavit, mortuos excitavit. Ille ardorem cupiditatis extinguet, extirpabit libidines, invidiam detrahet, iram mitigabit. Ille reddet veram et perpetuam sanitatem. Appetenda est haec omnibus medicina, quoniam majori periculo vexatur anima, quam corpus; et quamprimum latentibus morbis adhibenda curatio est. Neque enim si utatur aliquis oculorum acie clara, membris omnibus integris, firmissima totius corporis valetudine; tamen eum dixerim sanum, si efferatur ira, superbia tumidus infletur, libidini serviat, cupiditatibus inardescat: sed eum potius, qui ad alienam felicitatem non attollat oculos, opes non admiretur, alienam mulierem sancte videat, nihil omnino appetat, non concupiscat alienum, non invideat ulli, non fastidiat quemquam; sit humilis, misericors, beneficus, mitis, humanus; pax in animo ejus perpetua versetur. Ille homo sanus, ille justus, ille perfectus est. Quisquis igitur his omnibus praeceptis coelestibus obtemperaverit, hic cultor est verus Dei, cujus sacrificia sunt, mansuetudo animi, et vita innocens, et actus boni. Quae omnia qui exhibet, toties sacrificat, quoties bonum aliquid ac pium fecerit. Deus enim non desiderat victimam, neque muti animalis, neque mortis ac sanguinis, sed hominis et vitae. Ad quod sacrificium neque verbenis opus est, neque februis, neque cespitibus, quae sunt utique vanissima: sed iis quae de intimo pectore proferuntur. Itaque in aram Dei, quae vere maxima est, et quae in corde hominis collocata, coinquinari non potest sanguine, justitia imponitur, patientia, fides, innocentia, castitas, abstinentia. Hic est verissimus ritus: haec illa lex Dei, ut a Cicerone dictum est, praeclara et divina, semper quae recta et honesta jubet, vetat prava et turpia; cui parentem sanctissimae ac certissimae legi, juste ac legitime necesse est vivere. Cujus legis pauca equidem capita posui, quod sum pollicitus ea tantummodo esse dicturum, quae summum fastigium virtuti et justitiae imponerent. Si quis volet caetera omnia comprehendere, ex fonte ipso petat, unde ad nos rivus iste manavit. CAPUT XXV. De sacrificio, et de dono Dei digno; atque de forma laudandi Deum. Nunc de sacrificio ipso pauca dicemus. « Ebur, inquit Plato, non castum donum Deo. » Quid ergo? Picta scilicet ex texta pretiosa? Immo vero non castum donum Deo, quidquid surripi, quidquid corrumpi potest. Sed sicut hoc vidit, non oportere viventi offerre aliquid, quod sit ex mortuo corpore; cur illud non vidit, non debere incorporali corporale munus offerri? Quanto melius Seneca, et verius? « Vultisne vos, inquit, Deum cogitare magnum et placidum, et majestate leni verendum amicum, et semper in proximo? Non immolationibus et sanguine multo colendum (quae enim ex trucidatione immerentium voluptas est?): sed mente pura, bono honestoque proposito. Non templa illi congestis in altitudinem saxis extruenda sunt: in suo cuique consecrandus est pectore. » Vestes igitur, gemmas, et caetera, quae habentur in praetio, si quis putet Deo chara, is plane, quid sit Deus, nescit, cui putat voluptati esse eas res, quas etiam homo si contempserit, jure laudabitur. Quid ergo castum, quid Deo dignum, nisi quod ipse in illa divina lege sua poposcit? Duo sunt, quae offerri debeant, donum, et sacrificium: donum in perpetuum, sacrificium ad tempus. Verum apud istos, qui nullo modo rationem divinitatis intelligunt, donum est, quidquid auro argentoque fabricatur; item quidquid purpura et serico texitur. Sacrificium est victima, et quaecumque in ara cremantur. Sed utroque non utitur Deus; quia et ipse incorruptus est, et illud totum corruptibile. Itaque Deo utrumque incorporale offerendum est, quo utitur. Donum est integritas animi; sacrificium, laus, et hymnus. Si enim Deus non videtur, ergo his rebus coli debet, quae non videntur. Nulla igitur alia religio est vera, nisi quae virtute ac justitia constat. Quomodo autem Deus justitia hominis utatur, intellectu facile est. Si enim justus fuerit homo, accepta immortalitate, in aeternum Deo serviet. Homines autem non nisi ad justitiam nasci, cum philosophi veteres, tum etiam Cicero suspicatur. Disserens enim de legibus: « Sed omnium, inquit, quae in hominum doctorum disputatione versantur, nihil est profecto praestabilius, quam plane intelligi nos ad justitiam esse natos. » Id ergo solum Deo exhibere atque offerre debemus, ad quod capiendum nos ipse generavit. Hoc autem duplex sacrificii genus quam sit verissimum, Trismegistus Hermes idoneus testis est; qui nobiscum, id est, cum prophetis, quos sequimur, tam verbis quam re congruit; sicque de justitia locutus est: « Hoc verbum, o fili, adora et cole. » Cultus autem Dei unus est, malum non esse. Item in illo sermone perfecto, cum exaudisset Asclepium quaerentem a filio suo, utrum placeret patri ejus offerri thus, et alios odores ad sacrificium Dei, exclamavit: « Bene, bene ominare, o Asclepi. Est enim maxima impietas, tale quid de uno illo ac singulari bono in animum inducere. Haec et his similia huic non conveniunt. Omnium enim quaecumque sunt, plenus est, et omnium minime indigens. Nos vero gratias agentes adoremus. Hujus enim sacrificium, sola benedictio. » Et recte.
Verbo enim sacrificari oportet Deo;
siquidem Deus verbum est, ut ipse confessus est. Summus igitur
colendi Dei ritus est, ex ore justi hominis ad Deum directa laudatio:
quae tamen ipsa ut Deo sit accepta, et humilitate, et timore, et
devotione maxima opus est; ne quis forte integritatis et innocentiae
fiduciam gerens, tumoris et arrogantiae crimen incurrat, eoque facto
gratiam virtutis amittat. Sed ut sit Deo carus, omnique macula
careat, misericordiam Dei semper imploret, nihilque aliud precetur,
nisi peccatis suis veniam, licet nulla sint. Si quid aliud
desideraverit, non est opus dicto scienti quid velimus. Si quid ei
boni evenerit, gratias agat; si quid mali, satisfaciat, et id sibi
ob peccata sua evenisse fateatur; et nihilominus etiam in malis
gratias agat, et in bonis satisfaciat: ut idem sit semper, et
stabilis, et immutabilis et inconcussus. Nec tantum hoc in templo
putet sibi esse faciendum, sed et domi, et in ipso etiam cubili suo.
Secum denique habeat Deum semper in corde suo consecratum; quoniam
ipse est Dei templum. Quod si Deo, patri ac domino, hac assiduitate,
hoc obsequio, hac devotione servierit, consummata et perfecta
justitia est; quam qui tenuerit, hic (ut ante testati sumus) Deo
paruit, hic religioni atque suo officio satisfecit. |
XXI. Le plaisir de l'ouïe procède de la douceur de la voix et du chant, et n'est pas moins vicieux que celui de la vue, dont je viens de parler. Qui ne prendra pour des hommes perdus de débauche, ceux qui ont dans leur maison un équipage de théâtre? Il n'y a pas moins de dérèglement à avoir chez soi un théâtre et des acteurs, que de les avoir en public et de les regarder avec tout le peuple. J'ai assez parlé des spectacles ; il ne me reste plus qu'à donner des avis à ceux qui prendront la peine de lire cet ouvrage, qui est de ne se pas laisser charmer par les plaisirs qui s'insinuent jusqu'au fond de l'âme. Il est aisé de mépriser des sons que l'on ne peut écrire, et les concerts des instruirions qui ne s'attachent pas fortement à l'esprit. Mais un poème composé avec art, surprend l'esprit par sa douceur, l'attire et l'enchante. C'est de là que procède le peu de créance que les savants ajoutent à nos mystères ; car étant accoutumés aux ornements et aux figures de l'éloquence et de la poésie, ils méprisent les instructions solides, mais peu élégantes que leur donnent nos doctrines, et la simplicité du langage de l'Écriture. Ils ne cherchent que ce qui chatouille leurs sens, et ils ne se laissent persuader que par des discours agréables. Est-ce que Dieu, qui est l'auteur de l'esprit, de la langue et de la parole, ne saurait parler en termes élégants ? Il a proposé la vérité sans fard et sans ornements, afin que tout le monde la pût connaître. Ceux qui aiment la vérité et qui ne veulent pas être trompés, doivent rejeter les plaisirs lui corrompent l'âme de la même sorte que les -ajouts corrompent le corps, et doivent préférer les biens véritables aux faux, les éternels aux temporels, les utiles aux agréables. Rien ne doit plaire à leurs yeux que ce qui se fait avec piété et avec justice; rien ne doit plaire à leurs oreilles que ce qui peut nourrir l'âme. Il faut bien se garder d'abuser d'un sens qui nous a été donné pour recevoir la doctrine du ciel. Si nous nous plaisons à entendre des airs et des chansons, entendons les louanges de Dieu, voilà le plaisir solide, parce qu'il est joint à la vertu. C'est un plaisir qui ne passe pas promptement comme ceux du corps, mais qui dure toujours. Ceux qui en cherchent d'autres, cherchent la mort, parce que la mort est dans le plaisir, comme la vie est dans la vertu ; car quiconque voudra jouir des biens temporels et terrestres, sera privé des éternels et des célestes. XXII. Je n'ai rien à dire des plaisirs du goût et de l'odorat, qui sont les deux sens les plus grossiers, et qui ne se rapportent qu'au corps, si ce n'est qu'il serait honteux à un homme et à un homme de bien d'être l'esclave de sa bouche [et de son ventre, de se couvrir de parfums et de fleurs; ce que nul ne peut faire pour peu qu'il ait d'esprit, et pour peu qu'il lui reste de vertu. Quelqu'un demandera peut-être : pour quelle fin ces choses-là ont été mises au monde, s'il n'est pas permis d'en jouir. J'ai déjà dit que la vertu ne pourrait remporter aucune victoire, si elle n'avait des ennemis à combattre. Les attraits de la volupté sont les armes de celui dont l'unique occupation est d'attaquer la vertu et d'exterminer l'innocence ; il enchante l'âme par ces charmes dont il sait que le poison est mortel. Il nous jette dans la mort par le plaisir, de la même sorte que Dieu nous attire à la vie par le travail. Il nous engage dans le véritable mal par de faux biens, de la même sorte que l'on parvient au véritable bien par de faux maux. Il faut donc éviter ces divertissements comme des filets et comme des pièges, de peur qu'ils ne nous assujettissent à l'empire de la mort, XXIII. Je dirai maintenant quelque chose de l'attouchement, qui est un plaisir qui se répand sur toutes les parties du corps. Je ne crois pas devoir parler des habits ni des ornements, mais seulement de la volupté, et faire voir combien elle est dangereuse et avec combien de soin on est obligé de la réprimer. Quand Dieu a créé les deux sexes, il leur a donné une inclination par laquelle ils se recherchent l'un l'autre, et par laquelle ils se joignent ensemble avec un plaisir très sensible. C'est par l'accomplissement de ce désir, si général et si ardent, que les espèces de tous les animaux se conservent. Il semble que ce désir est plus vif et plus impétueux dans les hommes que dans les bêtes ; soit que Dieu ait voulu qu'il y eut sur la terre une plus grande multitude d'hommes que d'autres animaux, ou qu'il leur ait donné à eux seuls la vertu, afin qu'ils eussent la gloire de résister aux charmes de la volupté. Notre ennemi sait combien est grand le pouvoir de cette cupidité, que quelques-uns appellent une nécessité, et qu'ils détournent de son véritable objet, pour la porter vers un autre. Il inspire aux hommes de mauvais désirs, afin qu'au lieu de se contenter des plaisirs permis, ils en cherchent de défendus. Il met devant les yeux des beautés qui excitent les passions; il allume dans le cœur le feu de l'amour et l'excite jusqu'à ce qu'il ait réduit l'homme en cendre. Il a établi des lieux de prostitution, de peur que quelqu'un ne fût détourné de la débauche par l'appréhension des lois: il y expose de misérables femmes qui ont renoncé à la pudeur, et il fait son divertissement et son jeu des infamies qu'elles y souffrent. Ainsi il plonge dans le bourbier des âmes que Dieu a créées pour être saintes. Il les dépouille de la pudeur, de l'honnêteté. Il a inventé les conjonctions abominables et contraires à la nature par lesquelles les mâles se corrompent réciproquement. De quel crime peut-on espérer que ceux-là se puissent abstenir, qui sacrifient à leur brutalité un âge pour lequel sa faiblesse et l'innocence ne leur devraient donner que de la compassion et du respect ? Il n'y a point de paroles qui égalent l'énormité de ce crime. Je ne saurais rien dire de ceux qui en sont coupables, sinon que ce sont des impies et des parricides, qui ne se contentant pas de jouir du sexe dont Dieu leur a accordé l'usage, outragent le leur propre par une brutalité sacrilège. Cependant ces actions-là passent pour honnêtes parmi eux, ou n'y passent tout au plus que pour des fautes fort légères. Que dirai-je de ceux qui s'abandonnent à une débauche, ou plutôt à une folie détestable? Il me fâche d'en parler. Mais que voyons-nous qu'il doive arriver à ceux qui ne rougissent pas de la pensée de se plonger dans ces abominât ions? Il ne faut point avoir de honte de publier ce qu'ils n'ont point de honte de faire. Je parle de ceux dont l'horrible impudicité et l'exécrable fureur n'épargnent pas la tête, cette partie la plus élevée et la plus sacrée du corps. Comment pourrai-je témoigner assez d'indignation et assez d'horreur d'un crime si infâme et si détestable ? Je n'ai point de paroles qui ne soient au-dessous de son énormité. Noos avons besoin d'une très grande vertu pour nom préserver d'un si funeste débordement. Quiconque ne peut arrêter l'impétuosité de cette furieuse passion, la doit renfermer dans bornes d'un mariage légitime, afin que, sans devenir criminelle, elle jouisse du plaisir qu'elle recherche. Que peuvent dire les débauchés pour excuser leur dérèglement? Est-ce qu'il n'y a rien que d'honnête dans le plaisir? On demeure d'accord qu'il est quelquefois permis; mais quand il est défendu, il faut lui opposer la continence. Dieu n'a pas seulement défendu de jouir des personnes qui ont donné leur foi à un autre et qui sont engagées dans le mariage, mais aussi de celles qui n'étant point dans cet engagement, s'abandonnent à l'impudicité publique. Il nous enseigne que, quand deux corps sont joints ensemble, ils n'en font plus qu'un. Quiconque se plonge dans la boue, se salit. Ceux qui se sont salis de la sorte peuvent se laver bientôt après. Mais ceux qui ont souillé leur conscience par l'attouchement d'une débauchée ne peuvent effacer cette souillure qu'en beaucoup de temps et par un grand nombre de bonnes œuvres. Chacun doit rappeler souvent cette pensée dans son esprit que Dieu n'a établi la distinction des sexes que pour la conservation de la nature, et que l'union n'en est permise que pour la génération légitime des enfants. Comme il ne nous a pas donné les yeux afin que nous prissions plaisir à regarder ce qu'il y a de beau et d'agréable ici-bas, mais afin que nous vissions tout ce qu'il est nécessaire de voir pour l'usage et pour la commodité de la vie, il ne nous a pas donné les parties naturelles pour remplir les désirs d'une insatiable brutalité, mais pour mettre des enfants au monde. C'est une loi à laquelle faut obéir avec une profonde soumission. Tous ceux qui font profession de servir Dieu doivent se rendre maîtres de leurs passions; car ceux qui s'abandonnent au plaisir et qui à assujettissent leur esprit aux sens, se condamnent à la mort, puisque c'est sur les sens et sur le corps que la mort exerce sa puissance. Chacun doit conserver avec un soin particulier la pudeur et la chasteté, et ne suivre pas seulement en cela les lois des hommes, mais s'élever au-dessus d'elles en observant exactement celle de Dieu. Quand il aura fait une fois habitude de cette vertu, il aura honte des moindres désordres, et trouvera plus de satisfaction dans la privation des plaisirs, que les débauchés n'en trouvent dans la jouissance. Ce ne sont pas là tous les devoirs de la chasteté : il y en a quelques autres ; Dieu a renfermé la fidélité conjugale dans l'étendue du lit nuptial. Il ordonne que celui qui a une femme lui garde la foi qu'il lui a promise, sans pouvoir en avoir une autre, soit libre, soit esclave : la loi de Dieu n'est point semblable à celle des homme? Si le droit romain ne déclare adultère que la femme qui connaît un autre homme que son mari, et qu'il exempte de ce crime un homme qui a plusieurs femmes outre la sienne, l'Évangile ne met point de distinction à cet égard entre l'homme et la femme, et tient coupable celui qui jouit d'une autre que de celle qu'il a épousée. C'est pour ce sujet que Dieu a voulu qu'au lieu que, parmi les animaux, les femelles ne souffrent plus le mâle après qu'elles ont conçu, les femmes le souffrent toujours ; car peut-être que si les femmes refusaient à leurs maris ce qu'ils désirent, ils le chercheraient dans la compagnie d'une autre, et violeraient la fidélité du mariage. Les femmes ne conserveraient pas elles-mêmes la gloire de la chasteté s'il n'était en leur pouvoir de la perdre. Quand une bête refuse de souffrir le mâle après qu'elle a une fois conçu, on ne dit pas que ce soit en elle une marque de continence; elle ne refuse de le souffrir que parce que si elle le souffrait, elle en sentirait de la douleur ou encourrait du danger. On ne mérite pas d'être loué pour n'avoir pas fait ce qu'où n'a pu faire. On loue la continence dans l'homme, parce qu'elle ne lui est pas naturelle, et qu'elle dépend de sa liberté. Le mari et la femme doivent la garder également, et le mari doit donner à la femme l'exemple de la fidélité qu'il exige d'elle. S'il l'exige sans la garder, il est injuste, et c'est de cette injustice que sont venus les adultères, lorsque les femmes ont cessé d'être fidèles à des hommes qui n'avaient plus pour elles d'amour ni de tendresse. Les plus effrontées usent de cette excuse dans leurs débauches, et disent qu'en manquant de fidélité à leurs maris, elles ne leur font point d'injure, mais qu'elles repoussent celle qu'elles ont reçue. Quintilien a excellemment exprimé cette pensée : « Celui, dit-il, qui ne s'abstient pas de la femme d'un autre, ne gardera pas aisément la sienne. Il ne verra pas le désordre de sa maison pendant qu'il tâchera de le porter dans celle de son voisin. Une femme à qui ce malheur arrive se laisse aisément corrompre par l'exemple, et quand elle a manqué à la foi, elle croit avoir une excuse, de dire ou qu'elle a imité son mari, ou qu'elle s'est vengée de sa perfidie. » Il faut prendre garde que notre incontinence ne soit l'occasion de celle d'un autre. Il faut que le mari et la femme se rendent réciproquement la fidélité qu'ils se doivent, et qu'ils portent également le même joug auquel ils se sont soumis. Traitons les autres de la même manière que nous voulons être traités, et ne faisons jamais à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Voilà les obligations que nous impose le précepte de la continence. Ajoutons-y néanmoins encore quelque chose pour ne pas le renfermer dans des bornes trop étroites. Les personnes mariées se doivent conduire de telle sorte, que jamais elles ne se tendent aucun piège. Quiconque épouse une femme qui a été répudiée par son mari commet un adultère, et quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet aussi un adultère, si ce n'est qu'elle l'ait commis la première. Dieu ne veut point que ceux qu'il a unis et qui ne font qu'un seul corps se séparent. Il ne défend pas seulement l'adultère, il en défend la pensée et le regard accompagné d'un mauvais désir. La seule image du plaisir suffit pour rendre l'âme coupable: c'est l'âme qui commet le péché et qui en est souillée. Ce n'est pas être chaste que de conserver la pureté du corps et perdre celle de l'âme. Que personne ne s'imagine qu'il soit difficile de garder la continence et de résister à la volupté : c'est une ennemie que tout le monde est obligé de combattre et sur laquelle plusieurs remportent la victoire. Ce n'est pas que Dieu impose la nécessité de se priver absolument des plaisirs du corps ; ils sont permis dans le mariage, et l'usage en est nécessaire pour la multiplication des hommes. On sait combien les mouvements de cette passion sont violents. Mais quiconque les pourra réprimer en aura une plus grande gloire, et remportera une récompense qui n'est due qu'à la plus éminente vertu. Dieu reconnaîtra pour son serviteur et pour son disciple celui qui aura eu le courage et la force de la pratiquer ; il le fera triompher de la terre, et l'élèvera au ciel. Je demeure d'accord que cela paraît difficile; mais je parle aussi des personnes qui ont assez de générosité pour fouler aux pieds les plaisirs terrestres et pour en chercher d'incorruptibles. La vertu consistant dans la connaissance de Dieu, pendant que l'on est privé de cette connaissance, les peuples paraissent pesants, au lieu qu'après cela ils deviennent fort légers. Ceux qui aspirent comme nous à la perfection, y doivent arriver au travers des plus fâcheuses difficultés. XXIV. Que si néanmoins quelqu'un étant ou vaincu par la cupidité, ou charmé par le plaisir, ou aveuglé par Terreur, ou contraint par la force, s'éloigne du chemin de la justice, il ne faut pas qu'il perde pour cela courage, ni qu'il s'abandonne au désespoir; il peut rentrer dans le bon chemin, ou se délivrer de la tyrannie de ses passions, en concevant un regret sincère de ses fautes, en formant le dessein d'une conversion sérieuse, et en satisfaisant par de bonnes œuvres à la justice divine qu'il a offensée par ses crimes. Cicéron n'ayant pas cru que ce changement fût possible, en a parlé en ces termes dans te troisième livre des Questions académiques : « Si ceux qui se sont écartés du chemin de la vérité y pouvaient rentrer en détestant leur erreur, ils se trouveraient fort heureux dans leur égarement. »
Ils le peuvent certainement ; car si nous croyons que nos enfants
ont changé de vie, nous voyous qu'ils témoignent du repentir de leurs fautes ;
et si, au lieu que nous les avions chassés de notre présence et menacés de les
priver de notre succession, nous les recevons avec joie, et les embrassons avec
tendresse, pourquoi désespérerions-nous de la clémence de notre père ? C'est le
plus doux de tous les pères, et le plus indulgent de tous les maîtres, qui
promet de pardonner à ceux qui se repentiront sérieusement de leurs fautes.
Comme l'innocence ne sert de rien à celui qui l'a perdue par ses crimes, les
crimes ne nuisent en rien à celui qui les a effacés par la pénitence. Quiconque
en a conçu les sentiments, reconnaît sa faute, et change en quelque sorte
d'esprit, comme il est marqué par le terme grec qui est plus convenable que le
nôtre, et qui pourrait être rendu par celui de résipiscence ; car ceux qui
renoncent aux désordres de leur vie passée et qui réforment leurs mœurs,
retournent en quelque sorte à la sagesse d'où ils s'étaient éloignés. Quand les
bêtes ont une fois échappé d'un péril, elles se tiennent sur leurs gardes plus
qu'auparavant, et évitent avec plus d'adresse les filets où elles s'étaient
laissé prendre. Ainsi ceux qui se repentent sérieusement de leurs péchés,
veillent sur eux-mêmes avec une plus grande application pour n'en plus commettre
de semblables. Il n'y a personne, pour vigilant qu'il puisse être, qui ne soit
quelquefois surpris et qui ne fasse quelque faute. Dieu, qui connaît notre
faiblesse, a eu la borne de nous accorder le remède de la pénitence. C'est
pourquoi ceux qui se sont égarés, doivent revenir au bon chemin le plus tût
qu'il est possible. Je sais bien qu'il est aussi difficile de te relever, qu'il
est facile de tomber. Il est difficile de renoncer aux plaisirs dont on a goûté
la douceur : on s'en priverait avec moins de peine, si l'on n'en avait jamais
joui. Ceux néanmoins qui auront le courage de se délivrer de cette tyrannie,
obtiendront de Dieu le pardon. Que personne ne se flatte, dans l’impénitence, de
l'espérance de l'impunité, sous prétexte qu'il n'a point de complices, et que
ses crimes sont inconnus. Quand ils seraient inconnus aux hommes, ils ne le
seraient pas à Dieu. Sénèque a fini ses exhortations par une merveilleuse
sentence : « Le Dieu, dit-il, au culte duquel toute la suite de notre vie se
rapporte en quelque manière, est quelque chose de plus grand que nous ne
saurions penser; nous devons nous conduire de telle sorte qu'il approuve notre
conduite. » Le secret de notre conscience ne nous servira de rien ; il n'y a
point de secret pour lui. Un homme instruit des vérités de notre religion,
aurait-il pu mieux parler qu'à part ce philosophe, qui n'en avait ni le
connaissant Cicéron a parlé de Dieu et de la conscience d'une manière aussi admirable que Sénèque. « Souvenons-nous, dit-il, que nous avons Dieu pour témoin, c'est-à-dire notre conscience, qui est la chose la plus excellente et la plus divine que Dieu nous ait donnée. » Faisant en un autre endroit le portrait d'un homme de bien, il dit : « Un homme tel que celui que je décris, ne fera ou ne pensera jamais rien qu'il ne puisse publier. » Effaçons donc les taches de notre conscience, qui est exposée aux yeux de Dieu ; et, comme dit le même auteur, songeons, à chaque action que nous faisons, que nous serons tenus d'en rendre compte, et que nous sommes exposés non à la vue de tous les hommes, comme Cicéron a dit, mais à la vue de Dieu. Il nous serait plus aisé de nous cacher de notre propre conscience que de nous cacher de lui : il faut donc que nous lui découvrions nos blessures, et que nous en fassions sortir tout le venin. Il n'y a que celui qui a redressé les boiteux, qui a rendu la vue aux aveugles, qui a guéri les lépreux et ressuscité les morts, qui les puisse réformer; il éteindra dans notre cœur l'ardeur de la concupiscence, il en arrachera la racine de la volupté ; il y apaisera les mouvements de la jalousie et de la colère. Il faut avoir recours à ces remèdes avec d'autant plus d'empressement, que les maladies de l'âme sont plus dangereuses que celles du corps. Quand un homme aurait l'usage de tous ses sens, et qu'il jouirait d'une parfaite santé, il ne laisse pas d'être malade s'il est transporté de colère, s'il est enflé d'orgueil, s'il est consumé par le feu de l'amour, et qu'il soit esclave des autres passions. Au contraire, celui qui ne porte point d'envie au bonheur d'autrui, qui n'admire point les richesses, qui ne regarde jamais une femme avec un mauvais désir pour elle, qui ne souhaite point le bien d'autrui, qui ne méprise personne, qui a dans le cœur la douceur, la modestie, la libéralité, l'amour de la paix, celui-là, dis-je, jouit d'une santé parfaite. Ceux qui observent religieusement ces préceptes sont véritables serviteurs de Dieu, et l'honorent par le sacrifice de leurs bonnes œuvres. Dieu ne nous demande point de victimes sensibles, il ne nous demande que la pureté de nos mœurs. Pour faire ce sacrifice, il ne faut ni herbes, ni gazon, ni entrailles de bêtes ; il ne faut que les mouvements du cœur. L'autel sur lequel on offre est au milieu du cœur même, et cet autel n'est point souillé de sang, parce que l'on ne met dessus que l'innocence, la patience, la douceur, la chasteté et l'abstinence. Voilà les cérémonies par lesquelles Dieu veut être adoré; voilà la loi excellente et divine qui commande constamment le bien, qui défend constamment le mal, et qui porte infailliblement à la justice et à la sainteté. Je n'ai touché qu'une partie des commandements qu'elle renferme; ceux qui voudront savoir les autres pourront les puiser dans la source dont nous n'avons ici qu'un ruisseau. XXV.
Je dirai maintenant quelque chose des sacrifices. « L'ivoire, dit
Platon, n'est pas un présent digne de Dieu. Quoi donc! seront-ce des tableaux ou
des étoffes précieuses? Ce qui se peut corrompre et ce qui peut être ravi n'est
pas un présent de Dieu. » Platon, ayant fort bien reconnu qu'il ne faut rien
offrir de mort à un Dieu vivant, comment n'a-t-il pas reconnu qu'il ne faut rien
offrir de corporel a un Dieu incorporel? Sénèque en a beaucoup mieux jugé. Quand
il a dit : « Figurez-vous un Dieu dont la bonté est égale à la grandeur, dont la
douceur est infinie aussi bien que la majesté, qui est toujours présent, qui
veut être honoré non par le sang des animaux (car quel plaisir pourrait-il
prendre à les voir égorger?), mais par la pureté et par la sainteté de la
conscience. » Il ne lui faut point élever de temples d'une magnifique
architecture, mais le consacrer dans soi-même. Quiconque s'imagine que Dieu
prenne plaisir à recevoir de riches choses, des pierreries, ou qu'il estime des
choses que les hommes sages méprisent, ne connaît pas Dieu. Quel sera donc le
présent digne de lui, si ce n'est ce qu'il demande par la loi? On offre à Dieu
des présents et des sacrifices. Ceux qui n'ont aucune connaissance de la manière
dont il veut être adoré se persuadent qu'il ne lui faut point offrir d'autres
présents que des ouvrages d'or et d'argent, des étoffes de soie et de pourpre,
ni d'autres sacrifices que celui des victimes et des autres matières qui peuvent
être brûlées sur l'autel. Mais Dieu étant incorruptible, il n'a besoin ni de ces
dons, ni de ces sacrifices corruptibles. Ainsi il lui faut offrir des dons et
des sacrifices qui n'aient rien ni de corruptible ni de corporel. Le présent
qu'il lui faut offrir, c'est l'intégrité de la conscience; le sacrifice, c'est
la louange. Dieu étant invisible, le culte qu'on lui rend le doit être aussi. Il
n'y a de véritable religion que celle qui consiste dans la vérité et dans la
justice. Il est aisé de comprendre de quelle manière Dieu est honoré par la
justice de l'homme. Si l'homme est juste, il aura l'immortalité pour la
récompense de sa justice, et servira Dieu éternellement. Cicéron et des
philosophes plus anciens que lui se sont doutés que l'homme n'a été mis dans le
monde que pour y pratiquer la justice. Voici comment il en parle dans les livres
des Lois : « Parmi les vérités qui sont enseignées par les savants, il n'y en a
point de si excellente, ni de si glorieuse pour l'homme, que d'être né pour être
juste. Nous ne devons donc offrir à Dieu que ce qu'il veut recevoir de nous.
Trismégiste reconnaît ces deux sortes de sacrifices, et s'accorde parfaitement
avec nous, ou avec les prophètes que nous suivons, tant pour les termes que pour
le sens, lorsqu'il parle de la justice. « Adorez, dit-il, mon fils, et suivez
cette parole : le service unique que l'on rend à Dieu est de s'abstenir du mal.
» Dans le Discours parfait, après qu'Asclépius a demandé à son fils si son père
avait pour agréable qu'on lui présentât de l'encens et d'autres parfums dans les
sacrifices, il s'écrie : « Mon cher Asclépius, on ne saurait, sans impiété,
avoir de semblables pensées touchant ce bien souverain et unique. » Des présents
de cette sorte ne lui conviennent point du tout ; il a U plénitude de toutes ces
choses, et n'en a aucun besoin. Rendons-lui de profondes actions de grâces et
une humble adoration : le sacrifice n'est autre chose que la bénédiction et la
louange. Dieu étant une parole, c'est par la parole qu'il lui faut offrir des
sacrifices, comme Trismégiste l'a confessé. Le culte le plus parfait et le
service le plus excellent que Dieu puisse recevoir, c'est la louange publiée par
la bouche d'un homme juste; il faut que cette louange-là, pour être agréable,
soit accompagnée d'humilité, de crainte et de respect, de peur que celui qui la
présente, ne mettant sa confiance dans son innocence et dans sa vertu, n'en
perde le mérite par son orgueil. S'il veut plaire à Dieu et être exempt de
péché, il faut qu'il implore sans cesse sa miséricorde, qu'il ne demande autre
chose que le pardon de ses fautes, quand même il n'en aurait commis. Que s'il
désire quelque grâce, il n'a pas besoin de l'exprimer, puisque Dieu connaît ses
désirs. Quand il lui arrive du bien, qu'il en remercie Dieu. Quand il lui arrive
du mal, qu'il l'accepte comme une peine due à ses péchés, et comme un moyen de
satisfaire à la divine justice. Qu'il ne cesse jamais ni de remercier Dieu au
temps auquel il lui arrive du mal, ni de satisfaire à la justice au temps auquel
il lui arrive du bien, afin qu'il soit toujours égal, et qu'il demeure dans une
assiette immobile et immuable. Il ne croira pas être obligé à s'acquitter de ces
devoirs-là que dans l'église; il s'en acquittera en tous lieux, dans sa chambre
et dans son lit : il fera un temple de son cœur, parce qu'il est lui-même le
temple de Dieu. En servant le Seigneur souverain de l'univers et le père commun
de tous les hommes avec cette assiduité et ce zèle; il arrivera à la perfection
du christianisme, et remplira tous ses devoirs. |
|
Da |
D |
|
Da D |
|