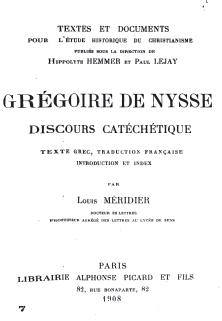
GRÉGOIRE DE NYSSE
DISCOURS CATÉCHÉTIQUE
Traduction française : M. LOUIS MERIDIER.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
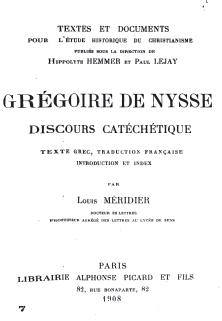
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
TEXTE ET TRADUCTION
L'enseignement catéchétique est nécessaire aux initiateurs du mystère de la piété, pour permettre à l'Église de s'accroître par l'augmentation des âmes sauvées, en faisant entendre aux infidèles la parole digne de foi de la doctrine. Toutefois la même méthode d'enseignement ne saurait convenir à tous ceux qui viennent écouter la parole. Il faut, au contraire, s'inspirer de la diversité des religions pour y ajuster diversement ; la catéchèse, et tout en proposant le même but à l'enseignement, recourir, suivant les cas, à des arguments différents. [2] Le sectateur du judaïsme a, en effet, telles préventions qui ne sont pas celles de l'homme élevé dans l'hellénisme; de même pour l'Anoméen, le Manichéen, les partisans de Marcion, de Valentin, de Basilide, et toute la série de ceux qui se sont égarés dans l'hérésie. Chacun d'eux a des préventions particulières ; d'où la nécessité d'entrer en lutte contre les croyances sur lesquelles ils se fondent. Car la nature de la maladie doit déterminer la forme du traitement qu'on lui applique. [3] On ne traitera pas par les mêmes remèdes le polythéisme du Grec et l'incrédulité du Juif touchant Dieu le Fils unique, et on n'aura pas recours aux mêmes armes pour renverser, dans les esprits livrés aux erreurs des hérésies, les fictions erronées qu'ils brodent sur les dogmes. Et en effet, les raisons qui peuvent remettre dans le droit chemin le partisan de Sabellius ne sont pas celles qui feront du bien à l'Anoméen, pas plus que la lutte engagée contre le Manichéen n'est profitable au Juif. Il faut, encore une fois, considérer les opinions préconçues des individus, et régler son enseignement sur la nature de l'erreur dont chacun d'eux est atteint, en mettant en avant, dans chaque discussion, certains principes et propositions vraisemblables, afin que les points sur lesquels les parties sont d'accord permettent de découvrir la vérité, par la suite logique de l'argumentation.
[4] Ainsi donc, toutes les fois que l'on discute avec un homme attaché aux croyances grecques on fera bien de débuter ainsi : Croit-il à la divinité, ou partage-t-il l'opinion des athées? S'il nie l'existence de Dieu, on l'amènera, en parlant de la savante et sage économie du monde, à reconnaître là l'existence d'une puissance qui s'y manifeste et qui est supérieure à l'univers. Si au contraire il ne met pas en doute l'existence de la divinité, mais se laisse entraîner a croire à une multitude de dieux, ayons recours à une argumentation de ce genre : [5] La divinité, selon lui, est-elle parfaite ou imparfaite ? Si, comme il est probable, il confesse la perfection de la nature divine, obligeons-le à étendre cette perfection à tous les aspects de la divinité, de peur qu'il ne considère le divin comme un mélange de contraires, l'imparfait s'y unissant au parfait. Qu'il s'agisse de la puissance, ou de !a faculté de concevoir le bien, de la sagesse, de l'incorruptibilité, de l'éternité, ou de toute autre conception convenant à la divinité qui vienne à être envisagée, il reconnaîtra, par la suite logique du raisonnement, que la perfection doit être partout considérée dans la nature divine.
[6J Ce point étant accordé, il ne sera plus difficile d'amener la pensée, qui s'est dispersée sur une foule de dieux, à l'aveu d'une divinité unique. Si l'adversaire reconnaît en effet qu'il faut accorder à l'objet de la discussion une perfection absolue, mais en ajoutant qu'il y a une foule d'entités divines marquées des mêmes caractères, il faut de toute nécessité, dans ces natures que ne distingue aucune différence, et qui sont envisagées avec les mêmes attributs, montrer ce qui leur est propre; ou, si la pensée ne peut concevoir aucune particularité là où il n'existe pas de différence, ne pas supposer de distinction. [7] Car si l'on ne découvre pas de différence de plus ou de moins, en vertu de cette idée que la notion de perfection exclut un amoindrissement, ni aucune différence d'infériorité ou de supériorité (car on ne concevrait plus de divinité là où subsisterait ce qualificatif d'infériorité), ni aucune différence d'ancienneté et de nouveauté, puisque la notion du, divin exclût la négation de l'éternité; — si donc l'idée de divinité reste une et identique à elle-même, et que le raisonnement ne découvre nulle part aucune particularité, de toute nécessité la conception erronée d'une multitude de dieux se trouvé acculée à l'aveu d'une divinité unique. [8] En effet, si la bonté et la justice, la sagesse et la puissance lui sont accordées au même degré, et si l'immortalité, l'éternité et tout autre attribut conforme à la piété lui sont reconnus de la même manière, toute différence disparait, de quelque façon que l'on raisonne, et avec elle disparaît nécessairement la croyance au polythéisme, puisque cette identité absolue nous amène à croire à l'unité.
I. Mais puisque la doctrine de notre sainte religion sait discerner une différence de personnes dans l'unité de nature, il ne faut pas que notre exposé, en luttant contre les Grecs, se laisse entraîner au judaïsme. Il convient donc, à l'aide d'une distinction habile, de corriger à son tour l'erreur qui se manifeste sur ce point.
[2] Ceux-là même qui restent étrangers à nos doctrines ne conçoivent pas la divinité sans verbe, et leur assentiment sur ce point suffira à expliquer notre propre thèse. Convenir en effet que Dieu ne va pas sans verbe revient à lui accorder expressément le verbe dont on ne le suppose pas dépourvu. Mais on parle aussi dans les mêmes termes de la parole humaine. Si donc l'adversaire déclare se représenter le verbe divin à la ressemblance de notre parole, on pourra l'amener ainsi à une conception plus élevée. [3] Il faut en effet, de toute nécessite, se persuader que le verbe, comme toutes les autres facultés, est proportionné à la nature. On distingue dans l'homme un certain pouvoir, une vie, une sagesse; Mais on ne se fonderait pas sur la similitude des termes pour supposer chez la divinité une vie, ou une puissance, ou une sagesse du même genre. Le sens de ces mots-là se rapetisse à la mesure de notre nature. Comme notre nature est périssable et faible, notre vie par suite est éphémère, inconsistante notre puissance, incertain notre verbe. [4] Dans la nature souveraine, au contraire, tous les attributs qu'on lui accorde s'étendent pour se proportionner à la grandeur du sujet. Par conséquent, lorsqu'on parle du Verbe de Dieu, on ne doit pas s'imaginer qu'il tient sa réalité de l'acte de la parole, pour perdre ensuite celle réalité, à la façon de notre propre verbe. Comme notre nature périssable a un verbe périssable, ainsi la nature incorruptible et éternelle possède un Verbe éternel et substantiel.
[5] Une fois que la suite du raisonnement aura ainsi amené l'adversaire à confesser la substance éternelle du Verbe divin, force lui sera bien de convenir que la substance du Verbe est douée de vie. Il serait impie, en effet, d'attribuer au Verbe une substance inanimée à la façon des pierres. S'il est une substance pensante et incorporelle, il possède absolument la vie ; s'il est dépourvu de vie, il est aussi absolument dépourvu de substance. Mais précisément, on a montré l'impiété d'une conception qui donnerait le Verbe comme dépourvu de substance. On a donc, du même coup, démontré en bonne logique que le Verbe dont il est question possède la vie. [6] Or, si l'on a la conviction que la nature du Verbe est simple, selon toute apparence, et qu'elle ne se montre ni double ni composée, on ne saurait envisager le Verbe vivant comme participant à la vie. En effet, une conception de ce genre, soutenant que l'un est contenu dans l'autre, rentrerait dans le cas d'une nature composée. Mais il faut nécessairement, si l'on reconnaît l'unité de nature, regarder le Verbe comme vivant de lui-même, et non comme participant à la vie. [7] Si donc le Verbe vit, étant lui-même la vie, il a aussi, d'une façon absolue, la faculté de vouloir, car aucun des êtres vivants n'est dépourvu de volonté. Mais cette volonté doit logiquement, comme le veut la piété, être tenue pour puissante. Refuser de lui reconnaître la puissance, sérail soutenir absolument son impuissance. [8] Mais précisément la conception du divin exclut l'impuissance. Aucune dissonance en effet n'est admise dans la recherche de la nature divine, et il faut, de toute nécessité, convenir que la puissance du Verbe répond à sa volonté, pour qu'on n'aille pas envisager dans cette unité un mélange et une réunion de contraires ; l'impuissance et la puissance s'observeraient en effet dans la même volonté, si dans certains cas elle était puissante, et impuissante dans d'autres. La volonté du Verbe, étant toute-puissante, doit nécessairement n'incliner vers rien de ce qui est mal, car la tendance au mal est étrangère à la nature divine. Tout ce qui est bon, elle doit le vouloir, et, le voulant, le pouvoir absolument ; et cette puissance ne doit pas rester inefficace, mais transformer en actes tous ses désirs du bien. [9] Le monde est une œuvre bonne, et aussi tout ce qu'il renferme, avec la sagesse et l'habileté qui s'y observent. Donc, tout est l'œuvre du Verbe, du Verbe vivant et substantiel, puisqu'il est le Verbe de Dieu ; doué de volonté, puisqu'il vit ; capable d'exécuter tout ce qu'il choisit de faire ; choisissant absolument ce qui est bon et sage, portant enfin tous les caractères de l'excellence.
[10] Ainsi le monde est reconnu une œuvre bonne, et il a été démontré plus haut qu'il était l'ouvrage du Verbe, du Verbe qui choisit le bien et qui peut le réaliser; d'autre part, le Verbe dont nous parlons est différent de celui dont il est le Verbe. Car cette notion rentre, en un sens, dans celles qui sont dites relatives, puisqu'il faut bien, avec le Verbe, entendre aussi l'auteur du Verbe ; le Verbe en effet ne peut exister qu'en étant le Verbe de quelqu'un. Si donc l'esprit des auditeurs distingue par un terme marquant la relation le Verbe lui-même de celui dont il procède, ce mystère lie risquera plus, en combattant les conceptions païennes, de s'accommoder aux doctrines des adeptes du judaïsme. Il évitera au contraire l'absurdité des unes et des autres en reconnaissant que le Verbe est à la fois vivant, actif et créateur, ce que refuse d'admettre le Juif, et qu'il n'y a pas de différence de nature entre le Verbe lui-même et celui dont il procède.
[11] Nous disons en effet, pour ce qui est de nous, que le verbe procède de l'intelligence, sans se confondre avec elle, ni s'en distinguer absolument: car en tant qu'il procède d'elle, il s'en distingue et n'est pas la même chose, mais en tant qu'il est la manifestation de l'intelligence, il ne saurait être regardé comme s'en distinguant. Si par sa nature, il ne fait qu'un avec elle, il s'en distingue en tant que sujet. Il en est de même pour le Verbe de Dieu. En tant qu'il a son existence propre, il se distingue de celui dont il la tient ; mais en tant qu'il montre en lui-même tous les caractères que l'on observe en Dieu, il se confond par sa nature avec celui que font reconnaître les mêmes marques. Qu'il s'agisse de la bonté, de la puissance, de la sagesse, de l'éternité, du privilège d'être inaccessible au mal et à la mort, de la perfection complète, ou en général de tout autre attribut dont on fera un signe distinctif de ridée du Père, on reconnaîtra aux mêmes signes le Verbe qui tient de lui son existence.
II. De même que nous apprenons à connaître le Verbe, en nous élevant de la sphère de notre vie jusqu'à la nature souveraine, de même nous arrivons à concevoir l'Esprit, en considérant dans notre propre nature comme une ombre et une image de la puissance invisible. Mais en nous le souffle est l'aspiration de l'air qui, en vertu d'une loi naturelle, fait entrer dans notre organisme et s'exhaler ensuite un élément étranger. Dans le cas où la parole s'exprime, ce phénomène est celui de la voix, manifestation de ce qui est en puissance dans la parole. [2] Dans la nature divine, la piété nous oblige à croire à un Esprit (souffle) de Dieu, puisqu'il a été établi qu'il y a un Verbe de Dieu. Car le Verbe de Dieu ne doit pas être inférieur au nôtre, et il le serait si, en face du nôtre qui est accompagné d'un souffle, il était conçu sans Esprit. Mais croire à un élément étranger, qui, à la ressemblance de notre souffle, affluerait du dehors dans la personne divine et deviendrait en elle l'Esprit, serait faire injure à Dieu. Rappelons-nous qu'en apprenant qu'il y avait un Verbe de Dieu, nous ne l'avons pas conçu comme un objet dépourvu de substance, ni comme le résultat d'une connaissance acquise ; nous n'avons pas pensé qu'il se manifestât au moyen de la voix pour cesser d'être, une fois exprimé, ni qu'il fût soumis à aucun des accidents que nous observons dans le nôtre. Nous l'avons conçu comme une substance possédant la volonté, l'activité et la toute-puissance. [3] De même, instruits de l'existence d'un Esprit de Dieu, qui accompagne le Verbe, et manifeste son activité, nous ne le concevons pas comme le souffle d'une respiration. Car ce serait rabaisser la majesté divine que de supposer à la ressemblance de notre propre souffle celui qu'elle possède. Non, nous l'envisageons comme une force substantielle, vivant en elle-même d'une existence propre, qu'on ne peut séparer de Dieu, en qui elle réside, ni du Verbe de Dieu qu'elle accompagne, qui ne s'anéantit pas en se dissipant, mais qui a une existence substantielle à la façon du Verbe de Dieu, qui possède la volonté, qui se meut de soi-même, active, choisissant le bien en toute circonstance, et ayant, pour réaliser tous ses désirs, un pouvoir correspondant à sa volonté.
III. Ainsi, en sondant d'un regard attentif les abîmes du mystère, l'esprit a, dans une certaine mesure, l'intuition secrète de la doctrine relative à la connaissance de Dieu, sans pouvoir toutefois éclaircir par la parole la profondeur inexprimable de ce mystère, ni expliquer comment le même objet peut être dénombré tout en échappant au dénombrement, être aperçu dans ses parties distinctes tout en étant conçu comme unité, être divisé par la notion de personne sans admettre de division dans la substance. [2] La notion de personne distingue en effet l’Esprit du Verbe, et les distingue à leur lourde celui qui possède le Verbe et l'Esprit. Mais quand on a compris ce qui les sépare, on voit que l'unité de la nature n'admet pas de partage. Ainsi le pouvoir de la souveraineté unique ne se divise pas en un morcellement de divinités différentes, et d'autre part, la doctrine ne se confond pas avec la croyance juive, mais la vérité tient le milieu entre les deux conceptions, elle purge de ses erreurs chacune de ces écoles, et tire de chacune ce qu'elle renferme de bon. La croyance du Juif est redressée par l'adjonction du Verbe et la foi au Saint-Esprit. La croyance erronée des païens au polythéisme se trouve effacée par le dogme de l'unité de nature, qui annule l'idée fantaisiste d'une pluralité. [3] Gardons de la conception juive la notion de l'unité de nature, et de la croyance païenne retenons seulement la distinction des personnes, en corrigeant de part et d'autre l'impiété par le remède correspondant. Le dénombrement de la Trinité est, pour ainsi dire, le remède de ceux qui s'égarent au sujet de l'unité, et la doctrine de l'unité, celui des esprits que disperse leur croyance à la pluralité.
IV. Si le sectateur du judaïsme combat ces doctrines, il ne sera plus aussi difficile d'argumenter contre lui, car les enseignements au milieu desquels il a grandi fourniront le moyen de mettre la vérité en lumière. L'existence d'un Verbe de Dieu et d'un Esprit de Dieu, conçus comme des forces substantielles, créatrices de tout ce qui a été fait, et embrassant la réalité, résulte, manifestement des Ecritures inspirées de Dieu. Il suffit de mentionner un seul témoignage, en laissant aux esprits plus zélés le soin de découvrir la plupart des autres. [2] « Le firmament, disent les Ecritures, a été fait par le Verbe du Seigneur ; et par l'Esprit de sa bouche, toute l'armée qu'il renfermé. » Quel Verbe et quel Esprit? Car Verbe ici ne signifie pas « langage », et Esprit ne veut pas dire « souffle ». Sans quoi la Divinité revêtirait un caractère humain, à l'image de notre nature, si l'on enseignait que le Créateur de l'univers possède un Verbe de ce genre et un Esprit de cette sorte. [3] Mais comment le langage et le souffle pourraient-ils produire une force qui suffît à organiser les cieux avec les armées qu'ils renferment? Car si le Verbe de Dieu est semblable à notre langage, et son Esprit à notre soufflé, la force résultant de ces éléments semblables est absolument semblable, elle aussi, et le Verbe de Dieu a exactement la même puissance que le nôtre. Mais précisément nos paroles, à nous, sont inefficaces et inconsistantes comme le souffle qui s'exhale au fur et à mesure de notre bouche. [4] Ceux qui abaissent la Divinité à la ressemblance de notre parole étendront donc absolument cette inefficacité et cette inconsistance au Verbe et à l'Esprit de Dieu. Or si, comme le dit David, le firmament a été créé par le Verbe de Dieu, et si les armées qu'il renferme ont été constituées par l'Esprit de Dieu, le mystère de la vérité est établi par là même, et nous enseigne la notion d'un Verbe et d'un Esprit substantiels.
V. Toutefois le païen sera peut-être conduit par les idées générales, et le Juif par les conceptions de l'Écriture, à ne pas contester l'existence d'un Verbe et d'un Esprit de Dieu. Mais le plan de Dieu le Verbe relatif à l'homme sera rejeté à l'examen par l'un et l'autre également, comme une théorie à la fois invraisemblable, et peu convenable à la nature de la divinité. Nous partirons donc d'un principe différent, pour amener, sur ce point encore, nos adversaires à la foi.
[2J Ils sont convaincus que toutes choses ont été créées par la raison et la sagesse de celui qui a organisé l'univers, ou bien ils font encore des difficultés pour admettre cette conception. S'ils n'accordent pas qu'une raison et une sagesse ont présidé à l'organisation de la réalité, ils frapperont d'incohérence et de gaucherie le principe de l'univers. Mais si c'est là une conclusion absurde et sacrilège, il faut bien convenir qu'ils reconnaîtront dans la réalité le gouvernement suprême d'une raison et d'une sagesse. Or précisément il a été démontré plus haut que le Verbe de Dieu n'a pas le même sens que le mot « parole » et n'est pas non plus la possession d'une science ou d'une sagesse ; que c'est une puissance substantielle, choisissant le bien en tout, et capable d'exécuter tout ce qu'elle choisit. Le monde étant bon, a donc pour cause la puissance qui met au jour et qui crée le bien. Si le fondement de l'univers dépend de la puissance du Verbe, comme la suite du raisonnement l'a montré, il faut de toute nécessité attribuer à l'organisation des parties de l'univers une seule cause, le Verbe lui-même, auquel toutes choses doivent d'avoir été appelées à la vie.
[3] Qu'on tienne à l'appeler Verbe ou Sagesse, ou Puissance, ou Dieu, ou lui donner tout autre nom sublime et auguste, nous ne disputerons pas sur ce point. Quel que soit en effet le mot ou le nom que l'on trouve pour désigner le sujet, les paroles qualifient une seule et même chose, la puissance éternelle de Dieu, qui crée ce qui existe, imagine ce qui n'est pas, embrasse les choses créées, prévoit celles qui seront: ce Dieu le Verbe, qui est sagesse et puissance, la suite du raisonnement nous a montré en lui le créateur de la nature humaine, qu'aucune nécessité n'a amené à former l'homme, mais qui a ménagé la naissance d'un être semblable, dans la surabondance de son amour. Sa lumière en effet ne devait pas rester invisible, ni sa gloire sans témoin, ni sa bonté sans profit, ni non plus inactives toutes les autres qualités dont s'entoure à nos yeux la nature divine, ce qui fût arrivé, s'il n'y avait eu personne pour y participer et en jouir.
[4] Si donc l'homme est appelé à la vie pour prendre part aux biens de Dieu, il est nécessairement apte, par sa constitution, à partager ces biens. De même en effet que l'œil participe à la lumière grâce aux principes lumineux qui y sont naturellement déposés, et attire à soi, en vertu de ce pouvoir inné, ce qui a la même nature, de même il fallait qu'une certaine affinité avec le divin fût mêlée à la nature humaine, pour lui inspirer, au moyen de cette correspondance, le désir de se rapprocher de ce qui lui est apparenté. [5] En effet, même dans la nature des êtres privés de raison qui vivent dans l'eau ou dans les airs, chaque animal a reçu une organisation correspondant à son genre de vie, de sorte que, grâce à la conformation particulière de leur corps, ils trouvent leur élément approprié, celui-ci dans l'air, celui-là dans l'eau. De même l'homme, créé pour jouir des avantages divins, devait avoir une affinité de nature avec l'objet auquel il participe. [6] Aussi a-t-il été doué de vie, de raison, de sagesse, et de tous les avantages vraiment divins, afin de que chacun d'eux fît naître en lui le désir de ce qui lui est apparenté. L’éternité étant aussi un des avantages attachés à la nature divine, il fallait donc, de toute nécessité, que l'organisation de notre nature ne fût pas sur ce point non plus déshéritée, mais qu'elle possédât en elle-même le principe de l'immortalité, afin que cette faculté innée lui permît de connaître ce qui est au-dessus d'elle, et lui donnât le désir de l'éternité divine.
[7] C'est ce que montre le récit de la création du monde, d'un mot qui embrasse tout, en disant que l'homme a été fait à l'image de Dieu ; car la ressemblance de cette image implique l'ensemble de tous les caractères qui distinguent la divinité, et tout ce que Moïse nous raconte, plutôt à la façon d'un historien, sur ce sujet, en nous présentant des doctrines sous la forme d'un récit, se rattache au même enseignement. Car le paradis, et la nature spéciale de ses fruits, qui procurent à ceux qui en goûtent, non la satisfaction de l'estomac, mais la connaissance et la vie éternelle, tout cela concorde avec les considérations précédentes sur l'homme, établissant qu'à l'origine notre nature était bonne et vivait au milieu du bien.
[8] Mais peut-être cette affirmation est-elle contestée par celui qui considère la condition présente, et qui s'imagine convaincre de fausseté ce discours, en faisant valoir que l'homme aujourd'hui, loin d'être en possession de ces biens, se montre à nous dans une situation presque entièrement opposée. Où est en effet ce caractère divin de l'âme ? où est cette absence de souffrance physique? où est cette éternité ? Brièveté de notre vie, caractère douloureux de notre condition, destinée périssable, disposition à souffrir toutes les variétés de maladies physiques et morales, tels sont, avec d'autres du même genre, les arguments dont il accablera notre nature, persuade qu'il réfute ainsi la doctrine que nous avons exposée au sujet de l'homme. Mais pour éviter que le discours soit en rien détourné de sa suite naturelle, nous nous expliquerons là-dessus aussi en quelques mots.
[9] Le caractère anormal des conditions actuelles de la vie humaine ne suffit pas à prouver que l'homme n'a jamais été en possession de ces biens. En effet, l'homme étant l'œuvre de Dieu, qui s'est inspiré de sa bonté pour amener cet être à la vie, personne, en bonne logique, ne pourrait soupçonner celui qui doit son existence à cette bonté, d'avoir été plongé dans les maux par son Créateur. Il y a une autre cause à notre condition présente, et à la privation qui nous a dépouillés d'un état plus enviable. Ici encore le point de départ de notre raisonnement ne sera pas sans obtenir l'assentiment des adversaires. En effet, celui qui a créé l'homme pour le faire participer à ses propres avantages, et qui a déposé dans sa nature, en l'organisant, le principe de tout ce qui est beau, pour que chacune de ces dispositions orientât son désir vers l'attribut divin correspondant, celui-là ne l'aurait pas privé du plus beau et du plus précieux de ces avantages, je veux parler de la faveur d'être indépendant et libre. [10] Si quelque nécessité, en effet, dirigeait la vie humaine, l'image, sur ce point, serait mensongère, étant altérée par un élément différent du modèle. Comment nommer une image de la nature souveraine ce qui serait assujetti et asservi à des nécessités? Ce qui a été fait en tout point à l'image de la Divinité devait, assurément, posséder dans sa nature une volonté libre et indépendante, de façon que la participation aux avantages divins fût le prix de la vertu.
[11] Mais d'où vient, direz-vous, que l'être ainsi honoré de tous les plus nobles privilèges sans exception, ait reçu en échange de ces biens une condition inférieure? Cela encore s'explique aisément. Aucune apparition du mal n'a eu son principe dans la volonté divine, car le vice échapperait au blâme s'il pouvait se réclamer de Dieu comme de son créateur et de son auteur. Mais le mal prend naissance au dedans, il se forme par un effet de notre volonté toutes les fois que l'âme s'éloigne du bien. De même, en effet, que la vue est l'exercice d'une faculté naturelle, et que la cécité est la privation de cette activité, il y a entre la vertu et le vice une opposition du même genre. Car il est impossible de concevoir l'existence du mal autrement que comme l'absence de la vertu. [12] La disparition progressive de la lumière s'accompagne de l'obscurité, qui n'existe pas en présence de la lumière. De même, tant que le bien est présent dans notre nature, le mal n'a pas d'existence par lui-même, et c'est la disparition de l'élément supérieur qui donne naissance à l'élément inférieur. Ainsi le caractère propre de la liberté étant de choisir librement l'objet désiré, la responsabilité des maux dont vous souffrez aujourd'hui ne retombe pas sur Dieu, qui a créé votre nature indépendante et libre, mais sur votre imprudence, qui a choisi le pis au lieu du mieux.
VI. Mais vous vous demandez peut-être quelle est la cause de cette faute volontaire ; c'est en effet la question où vous amène la suite logique du discours. Nous trouverons donc, ici encore, un principe conforme à la raison, qui éclairera notre recherche. Voici en effet l'enseignement traditionnel que nous avons reçu des Pères. Cet enseignement n'est pas un récit de forme mythique, mais tire sa valeur persuasive de notre, nature elle-même.
[2] La pensée distingue deux mondes dans la réalité, que la spéculation divise en intelligible et sensible. Rien ne saurait être conçu à côté d'eux dans la nature, qui échappe à cette division. Un grand intervalle les sépare l'un de l'autre, de sorte que la nature sensible ne rentre pas dans les marques de l'intelligible, ni l'intelligible dans les marques de la nature sensible, mais que chacune d'elles tire son caractère propre de qualités contraires. La nature intelligible, en effet, est incorporelle, impalpable, sans forme ; la nature sensible, comme son nom l'indique, tombe sous la perception des sens. [3] Dans le monde sensible lui-même, malgré l'opposition profonde des éléments entre eux, un accord équilibrant les contraires a été ménagé par la sagesse directrice de l'univers, et ainsi se trouve réalisée l'harmonie intérieure de la création entière, sans aucune dissonance naturelle qui interrompe la continuité de l'accord. De même, il s'opère, par un effet de la sagesse divine, un mélange et une combinaison du sensible et de l'intelligible, pour que tout puisse participer également au bien, et que rien de ce qui existe ne soit exclu de la nature supérieure. Aussi, bien que la sphère convenable à la nature intelligible soit l'essence subtile et mobile, qui, par la place qu'elle occupe au-dessus du monde, tire du caractère particulier de sa nature une profonde affinité avec l'intelligible, il se produit, en vertu d'une sagesse supérieure, un mélange de l'intelligible avec la création sensible, pour que rien dans la création ne se voie rejeté, suivant la parole de l'apôtre, ni privé de la participation aux privilèges divins.
[4] Voilà pourquoi la nature divine opère dans l'homme le mélange de l'intelligible et du sensible, comme l'enseigne le récit de la création du monde. Il dit en effet : « Dieu ayant pris une motte de terre, en forma l'homme, et de son propre souffle il éveilla la vie dans son ouvrage », pour que l'élément terrestre s'élevât par son union avec la divinité, et que cette seule et même grâce pût s'étendre également à travers toute la création, par le mélange de la nature inférieure avec celle qui domine le monde.
[5] Le monde intelligible préexistant à l'autre, et chacune des puissances angéliques ayant reçu en partage, de l'autorité qui dirige toutes choses, une certaine activité pour l'organisation de l'univers, c'était aussi une de ces puissances qui avait été chargée de maintenir et de gouverner la sphère terrestre, ensuite avait été formée avec la terre une figure qui reproduisait la puissance suprême, et cet être était l'homme. En lui résidait la beauté divine de la nature intelligible, mêlée à une certaine force secrète. Voilà pourquoi celui qui avait reçu en partage le gouvernement de la terre trouve étrange et intolérable que, de la nature placée sous sa dépendance, sorte et se manifeste une substance faite à l'image de la dignité souveraine.
[6] Quant à la question de savoir comment a pu tomber dans la passion de l'envie celui qui n'avait été créé en vue d'aucune fin mauvaise par la puissance qui a organisé selon le bien l'univers, il n'entre pas dans l'objet du présent ouvrage de la traiter en détail, mais il est possible d'en exposer l'enseignement, même en quelques mots, aux esprits un peu dociles. On ne conçoit pas en effet l'opposition de la vertu et du vice comme celle de deux choses se manifestant en substance ; mais de même que le néant s'oppose à l'être, sans qu'on puisse qualifier de substantielle l'opposition du néant et de l'être, car nous disons au contraire que la non-existence s'oppose à l'existence, de même aussi le vice s'oppose à l'idée de la vertu. Il n'existe point en lui-même, mais il est conçu comme résultant de l'absence du bien. Nous disons que la cécité s'oppose à la vue, non que la cécité existe naturellement par elle-même : la possession précède la privation ; de même aussi le vice se conçoit, disons-nous, dans la privation du bien, à la façon d'une ombre dont le progrès suit le recul de la lumière.
[7] Or, la nature incréée n'admet pas le mouvement dans le sens d'un changement, d'une transformation, d'une altération, et tout ce qui existe au contraire par l'effet de la création a une tendance naturelle au changement, puisque l'existence même de la création est partie du changement qui, en vertu de la puissance divine, a substitué l'être au néant. Or il faut ranger aussi dans la création la puissance dont nous avons parlé, qui choisit par un mouvement de sa libre volonté ce qui lui paraît bon ; quand celui-là eût fermé les regards au bien et connu l'envie, à la façon de l'homme qui abaissant en plein soleil ses paupières sur ses yeux, voit de l'obscurité, il en arriva lui aussi à concevoir le contraire du bien, pour n'avoir pas voulu tourner sa pensée vers le bien. Et c'est là l'envie.
[8] Il est reconnu que le point de départ de tout fait détermine les conséquences qui en sont la suite. Par exemple, la santé a pour conséquences la vigueur physique, l'activité, le plaisir de la vie, tandis que la maladie entraîne la faiblesse, l'inertie, le dégoût de l'existence. Ainsi, en toutes choses, la série des conséquences s'enchaîne au point de départ qui lui est propre. De même, par conséquent, que l'absence des passions est le principe et la condition d'une vie conforme à la vertu, de même; le penchant au vice produit par l'envie ouvre la voie à tous les maux qui se manifestent à sa suite. [9] Lorsqu'une fois celui qui avait fait naître l'envie en lui-même en se détournant du bien, eût incliné vers le mal, à la façon d'une pierre détachée du sommet d'une montagne, qui se trouve entraînée en avant par son propre poids, il se vit lui-même, quand il se fut arraché de son affinité naturelle avec le bien, et incliné vers le vice, emporté de son propre mouvement, par son poids pour ainsi dire, vers le dernier degré de la perversité; la faculté de penser qu'il avait reçue du créateur pour coopérer avec lui à communiquer le bien, il la fit servir à la découverte de desseins mauvais, et c'est ainsi qu'il circonvint habilement l'homme par fraude, le persuadant de devenir son propre meurtrier et l'amenant au suicide.
[10] La puissance qu'il avait reçue d'un bienfait de Dieu conférait en effet à l'homme une condition élevée, car il avait été chargé de régner sur la terre et sur tout ce qu'elle renferme ; elle lui conférait la beauté extérieure, puisqu'il avait été fait à l'image du modèle même de la beauté, — l'absence des passions, puisqu'il était le portrait de celui qui ne connaît pas la passion, une entière liberté de langage, puisqu'il se repaissait du délice de voir Dieu face à face : autant d'aliments qui enflammaient chez l'Ennemi la passion de l'envie.
[11] Mais il n'était pas capable d'exécuter son dessein par la force et par l'usage violent de son pouvoir, car la puissance attachée au bienfait de Dieu remportait sur sa violence. Toutes ces raisons l'amenèrent à tramer 1 des artifices en vue de détacher l'homme de la puissance qui lui donne sa force, pour le prendre facilement au piège de sa machination. Il en est de même pour une lampe dont la mèche a pris feu de tous côtés. Si ne pouvant éteindre la flamme en soufflant, on mélange de l'eau à l'huile, on arrivera par ce stratagème à obscurcir la flamme. De même ayant par fraude mêlé le vice à la libre volonté de l'homme, l'Ennemi a déterminé comme l'extinction et l'obscurcissement du bienfait divin. Ce bienfait venant à manquer, ce qui lui est opposé se présente de toute nécessité à sa place. Or à la vie s'oppose la mort, à la puissance la faiblesse, à la bénédiction l'imprécation, à la liberté de tout dire, un sentiment de honte, et à tous les biens, ce que l'esprit regarde comme leurs contraires. Voilà pourquoi le genre humain est plongé dans les maux présents, ce premier pas ayant fourni le point de départ qui a abouti à un tel résultat.
VII. Et que personne ne demande si Dieu prévoyait ce malheur que l'humanité devait s'attirer par son imprudence, quand il se détermina à créer l'homme, pour lequel il eût été peut-être plus avantageux de ne pas être que d'être en proie aux maux. C'est là en effet ce que font valoir pour établir leur erreur ceux qui se sont laissé séduire par tromperie aux doctrines manichéennes, quand ils s'appuient là-dessus pour déclarer que le créateur de la nature humaine était mauvais. Si Dieu en effet n'ignore rien de ce qui est, et si l'homme est plongé dans les maux, il devient impossible de garder intacte la doctrine de la bonté de Dieu, puisqu'il aurait appelé à l'existence l'homme destiné à vivre dans les maux. Car si l'activité dans le bien caractérise absolument une nature bonne, cette vie misérable et mortelle ne saurait plus, dit le manichéen, être regardée comme l'ouvrage du bien, mais il faut attribuer à une vie de ce genre une cause différente, naturellement portée au mal,
[2] Tous ces arguments et d'autres du même genre ont, à première vue, un caractère spécieux qui leur prêle une certaine force, aux yeux des hommes profondément imbus de la supercherie hérétique comme d'une teinture indélébile ; mais les esprits doués d'une vue plus pénétrante de la vérité aperçoivent clairement la mauvaise qualité de ces arguments, et les moyens qu'ils mettent à notre portée d'en démontrer la supercherie. Il est bon aussi, ce me semble, d'invoquer sur ce point l'Apôtre lui-même, à l'appui de l'accusation que nous portons contre eux. Il distingue en effet, dans son discours aux Corinthiens, les âmes de condition charnelle et les âmes de condition spirituelle, montrant, à mon avis, par ces paroles, que ce n'est pas au moyen de la sensation qu'il convient de juger le bien ou le mal, mais qu'il faut dégager son esprit des phénomènes corporels pour distinguer, dans leurs caractères propres, la nature du bien et celle du mal. « L'homme spirituel, dit-il en effet, juge de tout. »
[3] Voici, selon moi, ce qui a fait naître dans l'esprit de ceux qui émettent de semblables idées, ces doctrines fantaisistes : ils définissent le bien d'après le plaisir de la jouissance corporelle ; comme la nature du corps est nécessairement soumise aux accidents et aux infirmités, puisqu'elle est composée et entraînée vers la dissolution, et que des accidents de ce genre s'accompagnent, dans une certaine mesure, d'une sensation douloureuse, ils pensent que la création de l'homme est l'œuvre d'un Dieu méchant. Si leur intelligence avait su regarder plus haut ; si, dégageant leur esprit de toute disposition voluptueuse, ils avaient porté des yeux libres dépassions vers la nature de la réalité, ils n’auraient pas cru à l'existence du mal en dehors du vice. Tout mal se caractérise par la privation du bien, sans avoir d'existence propre, ni se présenter à la pensée comme une réalité ; aucun mal, en effet, n'existe en dehors de la volonté, mais c'est l'absence du bien qui lui donne son nom. Or, ce qui n'est pas n'a pas de réalité, et ce qui n'a pas de réalité n'est pas l'œuvre de celui qui a créé la réalité.
[4] La responsabilité du mal ne retombe donc pas sur Dieu, auteur de ce qui est, et non de ce qui n'est pas ; créateur de la vue, et non de la cécité ; qui a produit la vertu, et non la privation de vertu ; qui a proposé comme récompense à ceux qui régleraient leur conduite sur la vertu le privilège de jouir des biens divins, sans avoir assujetti la nature humaine à son bon plaisir par aucune nécessité tyrannique, en l'entraînant vers le bien contre son gré à la façon d'un objet inanimé. Si, quand la lumière brille de tout son éclat dans un ciel pur, on se prive volontairement de la vue en abaissant les paupières, le soleil ne saurait être mis en cause par celui qui n'y voit pas.
VIII. Mais on s'indigne, en tout cas, quand on tourne les yeux vers la dissolution du corps ; on admet difficilement que notre existence prenne fin avec la mort, et; on représente comme le pire des maux que notre vie s'éteigne dans la condition du cadavre. Que l'on considère donc, dans cette triste nécessité, l'excès de la bienfaisance divine, et peut-être ainsi sera-t-on amené plutôt à admirer la faveur qui se manifeste dans la sollicitude de Dieu pour l'homme. [2] C'est la jouissance des plaisirs qui attache à l'existence ceux qui participent à la vie. Car celui dont l'existence se passe au milieu des peines juge, dans ces conditions, qu'il vaut beaucoup mieux ne pas être que d'être en proie à la souffrance. Examinons donc si l'organisateur de cette vie a eu un autre but que de nous faire vivre dans les conditions les meilleures.
[3] Par un libre mouvement de notre volonté, nous avions contracté la participation au mal, en Taisant entrer le mal dans notre nature, à la faveur d'un sentiment de plaisir, comme un poison assaisonné de miel ; et étant déchus, pour cette faute, de la félicité que nous concevons dans l'absence de passions, nous avions élé transformés par ce mouvement vers le mal. Voilà pourquoi l'homme retourne à la terre en se décomposant, à la façon d'un vase de terre cuite, pour qu'une fois débarrassé de l'impureté qu'il renferme actuellement, il soit restauré par la résurrection dans sa forme primitive.
[4] C'est une doctrine toute semblable que Moïse nous expose à la manière d'un historien et sous le voile d'allégories. D'ailleurs ces allégories elles-mêmes contiennent un enseignement très clair. Quand les premiers hommes se laissèrent entraîner à ce qui était défendu, et furent dépouillés de cette félicité bénie, dit Moïse, le Seigneur donna des vêtements de peau aux premiers hommes créés. Selon moi, ce n'est pas à des peaux de cette nature que se rapporte le sens véritable du récit. De quelle espèce, en effet, sont les animaux qui, une fois égorgés et dépouillés, fournissent le vêtement ainsi imaginé ? Mais étant donné que toute peau séparée de l'animal est chose morte, je suis absolument persuadé quenelle condition mortelle, jusque là réservée à la nature privée de raison, fut désormais appliquée aux hommes, dans une pensée de sollicitude prévoyante, par le médecin qui soignait notre disposition au mal, sans être destinée par lui à subsister éternellement. En effet, le vêtement rentre dans les choses qui nous sont appliquées au dehors, et qui à l'occasion offrent leur utilité à notre corps, sans être inhérentes à sa nature.
[5] La condition mortelle a donc été, en vertu d'un plan approprié, empruntée à la nature des êtres privés de raison, pour revêtir la nature qui avait été créée en vue de l'immortalité ; elle en enveloppe l'extérieur, non l'intérieur; elle intercepte la partie sensible de l'homme, mais ne touche pas a l'image divine elle-même. Or la partie sensible se dissout, mais n'est pas détruite, car la destruction est le passage au néant, tandis que la dissolution est le retour de cette partie aux éléments du monde, dont elle était formée, et sa dispersion. Ce qui se trouve en cet état n'a pas péri, bien qu'échappant à notre perception sensible.
[6] La cause de la dissolution est éclaircie par l'exemple que nous avons donné. Comme les sens ont une étroite affinité avec l'élément épais et terrestre, et que la nature de l'intelligence est supérieure aux mouvements de la sensation et plus élevée qu'eux, voilà pourquoi le discernement du bien, lorsque les sens en ont fait l'essai, a été égaré par eux, et cette méconnaissance du bien a déterminé la formation de l'état contraire ; c'est ainsi que la partie de nous-mêmes devenue inutile pour avoir accueilli l'élément contraire est livrée à la dissolution. Voici quel est le sens de l'exemple. [7] Supposons le cas suivant: un vase fait d'argile a été rempli par malveillance de plomb fondu, et le plomb une fois versé s'est solidifié de sorte qu'il est désormais impossible de le faire couler hors du vase. Le propriétaire du vase le réclame, et connaissant l'art du potier, il brise l'enveloppe tout autour du plomb ; puis il modèle le vase de nouveau en le ramenant à sa première forme, en vue de son usage propre, une fois qu'il l'a eu vidé de la matière qui s'y était mélangée. Ainsi procède l'artiste qui modèle notre propre vase. Le mal ayant été mélangé à la partie sensible, je veux dire à l'élément corporel, le Créateur, ayant décomposé la matière qui renfermait le mal, pour modeler de nouveau le vase purifié de l'élément contraire, au moyen de la résurrection, le restaurera, par la reconstitution de ses éléments, dans sa beauté primitive.
[8] Or il y a entre l’âme et le corps une certaine union, une participation commune aux maux qui accompagnent la faute, et la mort du corps présente une certaine analogie avec celle de l'âme. De même en effet que, pour la chair, le fait d'être séparée de la vie sensible prend chez nous le nom de mort, de même aussi pour l'âme, nous appelons mort sa séparation d'avec la véritable vie. Dans ces conditions, étant donné, comme on l'a dit plus haut, qu'une seule et même participation au mal s'observe pour l'âme et pour le corps, puisque l'un et l’autre contribuent à donner au mal sa force active, voici ce qui en résulte : La mort par voie de dissolution, qui résulte de l'application des peaux mortes, n'atteint pas l'âme. Et en effet comment pourrait se dissoudre ce qui n'est pas composé? [9] Mais comme l'âme aussi a besoin d'être débarrassée par quelque traitement des souillures que ses fautes y ont fait naître, le remède de la vertu lui a été appliqué dans la vie présente pour traiter les plaies de cette nature, et si elle reste incurable, c'est dans la vie de l'au-delà que le traitement a été mis en réserve.
[10] Il y a pour le corps différentes sortes de maladies, qui se prêtent plus facilement que d'autres à un traitement, et pour ces dernières on a recours aux incisions, aux cautérisations, et aux potions amères pour détruire le mal qui a frappé le corps, C'est une méthode semblable que nous annonce expressément le jugement de l'au-delà pour la guérison des infirmités de l'âme. Pour les hommes frivoles, c'est une menace et un procédé de correction sévère, afin que la crainte d'une expiation douloureuse nous amène à fuir le mal et à devenir plus sages ; mais les esprits plus sensés y voient avec foi un procédé de guérison et de traitement appliqué par Dieu, qui veut ramener la créature formée par lui à sa grâce primitive. [11] Car ceux qui enlèvent par l'incision ou la cautérisation les excroissances et les verrues qui se sont formées sur le corps contre nature, n'arrivent pas à guérir sans douleur celui qu'ils soulagent ; mais ils ne pratiquent pas l'incision pour endommager le patient; de même toutes les callosités matérielles qui se forment sur nos âmes devenues charnelles par leur participation aux maladies, sont, au moment du jugement, coupées et retranchées par l'ineffable sagesse et par la puissance de celui qui est, selon le mot de l'Evangile, le médecin des méchants. « Ce ne sont pas en effet, dit-il, les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. »
[12] La grande affinité qui s'est établie entre l'âme et le mal a la conséquence suivante : L'incision de la verrue cause une vive douleur à la surface du corps, car ce qui s'est développé dans la nature contre la nature elle-même, tient à la substance par une sorte de sympathie, et il se produit un mélange inattendu de l'élément étranger avec notre propre être, en sorte que la séparation de l'élément contre nature entraîne une sensation douloureuse et aiguë ; de même aussi, quand l'âme s'exténue et se consume dans les reproches que lui attire sa faute, comme dit le prophète, à cause de son union profonde avec le mal, nécessairement doit se présenter un cortège de douleurs indicibles et inexprimables, dont la description est impossible au même titre que celle des biens que nous espérons. Ni les uns ni les autres en effet ne se prêtent aux moyens d'expression dont dispose le langage ni aux conjectures de la pensée.
[13] Si donc on observe à distance la fin que se propose la sagesse du gouverneur de l'univers, on ne peut plus, en bonne logique, désigner mesquinement le créateur de l'humanité comme responsable des maux, en disant qu'où bien il ignore l'avenir, ou bien le connaissant et l'ayant créé, il n'est pas étranger à l'élan qui porte vers le mal. En effet, il savait l'avenir et il n'a pas empêché le mouvement qui le préparait.
Que le genre humain dût se détourner du bien, c'est ce que n'ignorait pas le maître souverain dont la puissance embrasse toutes choses, et qui voit les temps à venir aussi bien que le passé. [14] Mais de même qu'il assistait en esprit à l'égarement du genre humain, il l'a vu en pensée ramené vers le bien. Qu'y avait-il donc de meilleur? ne point appeler du tout notre nature à la vie, puisqu'il prévoyait que la créature à venir s'écarterait du bien, ou après l'avoir fait naître, la rappeler une fois malade, par la voix du repentir, à sa grâce primitive ?
[15] Se fonder sur les souffrances du corps qui viennent nécessairement se greffer sur le caractère inconsistant de notre nature, pour nommer Dieu l'auteur des maux, ou lui refuser absolument le titre de créateur de l'homme, afin de ne pas lui imputer la responsabilité de nos souffrances, dénote la dernière mesquinerie d'esprit chez ceux qui distinguent à l'aide de la sensation le bien et le mal. Ils ne savent pas que cela seul est naturellement bon qui n'a pas de contact avec la sensation, et qu'une seule chose est mauvaise : l'éloignement du véritable bien.
[16] Juger d'après la peine et le plaisir le bien et l'absence du bien, est le propre de la nature dépourvue de raison, chez les êtres en qui-la conception du véritable bien ne peut trouver place, parce qu'ils n'ont point part à la pensée ni à l'intelligence. Mais l'homme est l'ouvrage de Dieu; comme tel, il est bon, et destiné aux plus grands biens; c'est ce qui résulte clairement, outre ce qui a été dit, d'une infinité d'autres raisons que leur grand nombre nous oblige à passer sous silence pour ne pas tomber dans l'excès.
[17] Or en nommant Dieu le créateur de l'homme, nous n'avons pas oublié les points qui ont été minutieusement fixés dans le préambule à l'adresse des païens. On y montrait que le verbe de Dieu, étant substantiel et doué d'une existence réelle, est lui-même à la fois Dieu et Verbe, qu'il embrasse toute puissance créatrice, ou plutôt qu'il est la puissance en soi, porté vers tout ce qui est bien, et accomplissant tout ce qu'il a résolu, au moyen du pouvoir associé à son désir, que la vie de tout ce qui existe est sa volonté et son œuvre, que c'est lui qui a appelé l'homme a la vie, après l'avoir paré, à l'image de Dieu, de tous les plus beaux privilèges.
[18] Or cela seul est pur nature immuable qui ne lient pas sa naissance d'une création, et tout ce que la nature incréée a tiré du néant, ayant commencé d'être à partir de cette transformation, vil au contraire dans le changement. Ce changement se produit sans cesse dans le sens du mieux, si la créature agit suivant sa nature, et elle est au contraire entraînée vers l'état opposé par un mouvement ininterrompu, si elle s'est détournée de la droite voie.
[19] L'homme rentrait dans cette dernière catégorie, lui que le caractère changeant de sa nature avait détourné sur la pente de l'étal opposé. D'autre part, l'abandon du bien une fois consommé a pour conséquence l'apparition de toutes les formes du mal, de sorte que l'éloignement de la vie fil place à la mort, que la privation de la lumière entraîna l'obscurité, que l'absence de vertu amena l'apparition du mal, et que toutes les formes du bien furent remplacées une à une par toute la série des maux opposés. Celui qui était tombé dans ces maux et les autres du même genre, par l'effet de son imprudence (car l'être dont la raison avait été égarée était incapable de rester dans la raison, et s'étant écarté de la sagesse, de prendre quelque décision sage), celui-là, par qui devait-il être ramené à la grâce primitive? [20] A qui importait le relèvement de la créature déchue, le rappel à la vie de l'être tombé dans la mort, la direction donnée à l'homme égaré ? A qui, si ce n'est au maître absolu de la nature ? A celui-là seul qui avait donné la vie a l'origine, appartenait en effet le pouvoir et le privilège de la ranimer, même éteinte. C'est ce que nous apprend le mystère de la vérité, en nous enseignant que Dieu a créé l'homme à l'origine, et l'a sauvé après sa chute.
IX. Jusqu'ici notre doctrine obtiendra peut-être l'assentiment de celui qui considère l'enchaînement des idées, parce que rien dans notre exposé ne lui semblera étranger a la conception qu'on doit avoir de Dieu. Mais il n'aura pas la même attitude dans la suite, devant les faits qui sont la principale confirmation du mystère de la vérité : la naissance humaine (du Christ) et sa croissance depuis l'âge le plus tendre jusqu'à la maturité, le besoin de nourriture et de boisson, la fatigue, le sommeil, la douleur et les larmes, la scène de la dénonciation et du tribunal, la crucifixion, la mort et la mise au tombeau. Les faits compris dans le mystère de la religion émoussent en quelque façon la foi des petits esprits, de sorte que les doctrines exposées tout d'abord les empêchent d'accepter aussi ce qui y fait suite. Ce qu'il y a de vraiment digne de Dieu dans la résurrection d'entre les morts, ils ne l'admettent pas, à cause du caractère avilissant qui s'attache à la mort.
[2] A mon avis, il faut d'abord, en dégageant un peu sa raison de la grossièreté charnelle, concevoir en soi le bien lui-même et ce qui en diffère, en se demandant avec quels caractères distinctifs l'un et l'autre se présentent à la pensée. Aucun esprit réfléchi, je pense, ne contestera qu'une seule chose entre toutes soit honteuse par nature : l'infirmité qui s'attache au mal; et que ce qui est étranger au mal soit exempt de toute honte. Or ce qui est pur de tout élément honteux est conçu comme rentrant absolument dans le bien, et ce qui est vraiment bon n'admet aucun mélange du contraire. D'autre part, tout ce que l'esprit découvre dans la notion du bien convient à Dieu. [3] Que l'on montre donc dans la naissance, l'éducation, la croissance, le progrès vers la maturité naturelle, l'épreuve de la mort, et la résurrection, autant de formes du mal ; ou, si l'on convient que les états en question sont en dehors du mal, il faudra bien reconnaître que ce qui est étranger au mal n'a rien de honteux. Or ce qui est pur de toute honte et de tout mal étant parfaitement bon, comment ne pas plaindre de leur folie les représentants d'une doctrine pour qui le bien ne convient pas à Dieu ?
X. Mais, dira-t-on, c'est une chose petite et aisée à circonscrire que la nature humaine: or la divinité est infinie ; comment l'infini aurait-il pu être circonscrit dans l'atome? Mais qui nous dit que l'infini de la divinité ait été circonscrit dans les limites de la chair, comme en un récipient? Car il n'en est même pas ainsi dans notre propre vie : la nature pensante ne s'y enferme pas dans les bornes de la chair. [2] Mais si le volume du corps est circonscrit par ses propres parties, l'âme, grâce aux mouvements de la pensée, s'étend à son gré à toute la création, elle s'élève jusqu'aux cieux, et se pose sur les abîmes de la mer, parcourt l'étendue de la terre, pénètre dans son activité jusqu'aux régions souterraines, souvent même embrasse par la pensée les merveilles des cieux, sans être alourdie par le corps qu'elle traîne à sa suite.
[3] Si l'âme humaine, mêlée au corps en vertu des lois naturelles, peut être partout, à son gré, qui oblige à dire de la divinité qu'elle est enfermée de toutes parts dans la nature charnelle, au lieu d'arriver, par les exemples qui sont à notre portée, à former sur le plan de Dieu une conjecture digne de lui ? Dans le cas de la lampe, en effet, on voit le feu s'attaquer tout autour à la matière qui l'alimente, et si la raison distingue le feu attaché à la matière, de la matière qui allume le feu, il n'est pas possible, en fait, de séparer l'un de l'autre les éléments, pour montrer la flamme en soi, distincte de la matière; mais l'une et l'autre se confondent en un seul. Il en est ainsi dans le sujet qui nous occupe.
[4] Et qu'on n'aille pas faire entrer en compte dans notre exemple la nature périssable du feu ; mais qu'on retienne seulement de notre image ce qu'elle a de convenable, en rejetant ce qu'elle contient d'inapplicable. De même donc que nous voyons la flamme s'attacher à la matière qui l'alimente, sans s'y enfermer, qui nous empêche, quand nous concevons une union et un rapprochement entre une nature qui est divine, et l'humanité, de conserver intacte dans ce rapprochement l'idée qu'on doit se faire de Dieu, fermement convaincus que la Divinité, même si elle est dans l'homme, échappe à toute délimitation ?
XI. Si vous vous demandez, d'autre part, comment la divinité se mélange à l'humanité, il est temps que vous cherchiez auparavant de quelle nature est l'union de l'Ame et de la chair. Fl si l'on ignore la manière dont votre âme s'unit au corps, n'allez pas croire que l'autre question non plus soit, en aucune façon, du ressort de votre intelligence. Mais de même que, dans le premier cas, nous avons été amenés à croire que l'âme était une nature différente du corps, en considérant qu'une fois isolée de l'âme, la chair est morte, de même aussi dans le second, nous reconnaissons que la nature divine diffère de la nature mortelle et périssable, dans le sens d'une majesté plus haute, tout en étant incapables de concevoir comment s'opère le mélange de Dieu avec l'homme.
[2] Que Dieu ail pris naissance dans la nature humaine, c'est ce que les miracles rapportés nous empêchent de mettre en doute ; quant à savoir comment, nous renonçons à le chercher, comme une entreprise qui dépasse le raisonnement. Et en effet, en croyant que toute la création corporelle et intelligible est l'œuvre de la nature incorporelle et incréée, nous n'associons pas non plus à notre foi sur ce point la recherche du pourquoi ou du comment. Qu'il y ait eu création, nous l'admettons, et nous laissons de côté, sans curiosité indiscrète, la manière dont a été organisé l'univers, comme une question mystérieuse et inexplicable.
XII. Quant au fait que Dieu s'est manifesté sous une forme charnelle, que celui qui en cherche les preuves en regarde les effets. Car on ne peut avoir de l'existence de Dieu, considérée en bloc, d'autre preuve que le témoignage de ses effets. De même donc qu'en jetant les yeux sur l'univers, et en examinant dans ses diverses faces l'économie du monde, ainsi que les bienfaits réalisés dans notre vie par une action divine, nous comprenons qu'il existe au-dessus une puissance créatrice de ce qui naît et protectrice de ce qui existe, de même aussi, quand il s'agit du Dieu qui s'est manifesté à nous au moyen de la chair, nous regardons comme une preuve suffisante de cette manifestation de la divinité les miracles considérés dans leurs effets, en remarquant dans les actions rapportées tous les traits caractéristiques de la nature divine.
[2] Il appartient à Dieu de donner la vie aux hommes, à Dieu de conserver ce qui existe par sa providence, à Dieu d'accorder le manger et le boire aux êtres qui ont en partage une vie charnelle, à Dieu de faire du bien à qui est dans le besoin, à Dieu de ramener à elle-même par la santé la nature qui s'était altérée par un effet de la maladie, à Dieu de régner également sur toute la création, sur la terre, sur la mer, sur l'air, et sur les régions plus élevées que l'air, à Dieu d'avoir une puissance qui suffise à tout, et avant toutes choses d'être supérieur à la mort et à la corruption. [3] Si donc le récit qui le concerne omettait quelqu'un de ces privilèges et d'autres du même genre, les esprits étrangers à la foi pourraient, avec raison, opposer au mystère de notre religion une fin de non-recevoir ; si, au contraire, tout ce qui permet de concevoir Dieu se remarque dans les récits qui nous parlent de lui, quel obstacle la foi rencontre-t-elle ?
XIII. Mais, dit-on, la naissance et la mort caractérisent la nature charnelle. J'en conviens. Mais les conditions qui ont précédé sa naissance et suivi sa mort ne participent pas aux lois de notre nature. Si nous jetons les yeux, en effet, sur les deux extrémités de la vie humaine, nous savons et d'où nous tenons notre origine et à quelle lin nous aboutissons: c'est à une faiblesse que l'homme doit son origine, et sa vie s'achève dans l'infirmité. Dans l'autre cas, au contraire, la naissance n'a pas eu pour principe une faiblesse, pas plus que la mort n'a abouti à un état d'infirmité. Et en effet la naissance n'a pas été déterminée par la volupté, pas plus que la corruption n'a succédé à la mort.
[2] Vous restez incrédule devant ce miracle ? Je me félicite de votre incrédulité ; car vous reconnaissez que ces miracles dépassent la nature, en vertu des raisons qui vous font considérer notre enseignement comme dépassant la croyance. La religion que nous prêchons ne s'appuie pas sur les lois naturelles ? Que cela précisément vous démontre la divinité de celui qui s'est manifesté à nous. En effet, si ce qu'on raconta du Christ rentrait dans les bornes de la nature, où serait le divin? Mais si le récit dépasse la nature, les points qui excitent votre incrédulité prouvent justement la divinité de celui que nous prêchons. [3] La naissance de l'homme résulte d'un accouplement, et après la mort il entre dans la destruction. Si ces caractères se retrouvaient dans la doctrine que nous prêchons, vous refuseriez absolument d'admettre comme un Dieu celui que notre témoignage placerait dans les conditions propres à notre nature. Mais vous entendez dire, au contraire, que s'il a eu une naissance, il n'a point participé aux conditions de notre nature, qu'il leur a échappé par le caractère de sa naissance et par le privilège d'être soustrait au changement qui aboutit à la corruption ; il conviendrait donc, en bonne logique, de tourner dans l'autre sens votre incrédulité, en vous refusant à penser qu'il était un homme comme ceux que l’on voit naître conformément à la nature.
[4] Car il faut bien, si l’on ne croit pas à son humanité dans de semblables conditions, en arriver à croire qu'il était Dieu. En effet, celui qui nous rapporte sa naissance raconte en même temps qu'il naquit d'une vierge. Si donc le récit nous fait croire à sa naissance, les mêmes raisons ne nous permettent pas non plus de clouter qu'elle ait eu lieu dans ces conditions. [5] Celui qui parle de la naissance ajoute que sa mère était une vierge. Et celui qui fait mention de la mort atteste avec la mort la résurrection. Si donc le récit qu'on vous fait vous amène à accorder qu'il y a eu mort et naissance, vous accordez forcément, en vertu du même récit, que cette naissance et cette mort sont exemptes de tout caractère d'infirmité. — Mais ce sont là des choses qui dépassent la nature. — Il ne rentre donc point, lui non plus, dans l'ordre de la nature, celui dont il est démontré que la naissance a eu lieu dans des conditions surnaturelles.
XIV. Quelle est donc la cause, dit-on, qui a fait descendre la divinité à cette basse condition ? On hésite à croire que Dieu, l'infini, l'incompréhensible, l'inexprimable, supérieur à toute conception et à toute grandeur, se mêle à la souillure de la nature humaine, avilissant dans ce mélange avec la bassesse les formes sublimes de son activité.
XV. Nous ne sommes pas en peine de trouver à cette objection encore une réponse en rapport avec la majesté divine. [2] Vous cherchez la raison pour laquelle Dieu a pris naissance dans l'humanité ? Si vous retranchez de la vie les bienfaits qui viennent de Dieu, vous ne pourrez dire à quels caractères vous reconnaissez le divin. Car ce sont les bienfaits que nous recevons qui nous font connaître le bienfaiteur; en considérant ce qui arrive, nous conjecturons par analogie la nature du bienfaiteur. Si donc l'amour de l'humanité est une propriété de la nature divine, vous tenez la raison que vous demandiez, vous tenez la cause de la présence de Dieu dans l'humanité.
[3] Il fallait en effet le médecin à notre nature tombée dans la maladie, il fallait le restaurateur à l'homme déchu, il fallait l'auteur de la vie à celui qui avait perdu la vie, il fallait celui qui ramène au bien à celui qui s'était détaché de la participation au bien ; l'homme enfermé dans les ténèbres demandait la présence de la lumière, le captif cherchait le rédempteur, le prisonnier, le défenseur, l'esclave retenu sous le joug de la servitude, le libérateur. Etaient-ce là des raisons sans importance, qui ne méritaient pas de blesser la vue de Dieu, et de le faire descendre, pour la visiter, vers la nature humaine, placée dans une situation si pitoyable et malheureuse ?
[4] Mais Dieu pouvait, dit-on, faire du bien à l'homme tout en restant exempt de faiblesse. Celui qui a organisé l'univers par un acte de sa volonté, et qui a donné l'existence au néant par la seule impulsion de son désir, que n'a-t-il aussi détaché l'homme de la puissance ennemie, pour le ramener à sa condition première, s'il lui plaisait de le faire ? Au contraire, il prend des chemins détournés et longs, il revêt la nature corporelle, il entre dans la vie par la voie de la naissance, et parcourt successivement toutes les étapes de la vie, après quoi il fait l'expérience de la mort, et il atteint ainsi son but, par la résurrection de son propre corps, comme s'il ne lui était pas possible, en restant dans les hauteurs de la gloire divine, de sauver l'homme par décret, et de mépriser l'emploi de moyens aussi détournés. Il faut donc que nous établissions encore la vérité en face des objections de ce genre, pour que rien ne puisse entraver la foi de ceux qui recherchent avec un soin attentif l'explication rationnelle du mystère;
[5] Examinons donc, en premier lieu, ce qui s'oppose exactement à la vertu : question à laquelle nous avons déjà consacré plus haut un certain développement. Comme l'obscurité s'oppose à la lumière, et la mort à la vie, le vice s'oppose manifestement à la vertu, et le vice seulement. De la foule d'objets que l'on considère daris la création, rien ne se distingue par un contraste absolu de la lumière ou de la vie, rien : ni pierre, ni bois, ni eau, ni homme, absolument rien de ce qui existe, en dehors des notions proprement opposées, comme l'obscurité et la mort. Il en est de même pour la vertu ; on ne saurait dire que rien dans la création soit conçu comme s'opposant à elle, si ce n'est la notion du vice.
[6] Si notre enseignement prétendait que la divinité a pris naissance dans le vice, notre adversaire aurait lieu d'attaquer notre foi, et de traiter de disproportionnée et de discordante notre doctrine sur la nature divine ; car il serait sacrilège de dire que la sagesse personnifiée, lu bonté, l'incorruptibilité, toutes les notions et les appellations sublimes se sont transformées au point d'aboutir à leurs contraires. [7] Si donc la véritable vertu, c'est Dieu; si rien ne s'oppose par nature à la vertu en dehors du vice ; si Dieu prend naissance, non pas dans le vice, mais dans la nature humaine, et s'il n'y a d'indigne de Dieu et d'avilissant que l'infirmité attachée au mal, — étant donné que Dieu n'y est pas né, et ne pouvait y naître en vertu de sa nature, pourquoi rougit-on de convenir que Dieu est entré en contact avec la nature humaine, puisqu'on n'observe dans la condition de l'homme aucune opposition avec la conception de la vertu? Ni la faculté de raisonner, en effet, ni celle de comprendre, ni celle de connaître, ni aucune autre du même genre, propre à l'être humain, ne se trouvent opposées à la conception de la vertu.
XVI. Mais, dit-on, la transformation elle-même qui s'opère dans notre corps est une forme de faiblesse. Celui qui a pris naissance dans ce corps se trouve dans un état de faiblesse ; or la divinité est exempte d'infirmité. On se fait donc de Dieu une conception étrangère à lui, si l'on prétend établir que l'être naturellement exempt de faiblesse en vient à partager un état de faiblesse. — Mais à ces objections nous opposerons encore une fois le même argument : le mot faiblesse se prend dans deux sens, un sens propre et un sens abusif. Le mouvement qui, avec la participation de la volonté, fait passer de la vertu au vice est vraiment une faiblesse ; tout ce qui, au contraire, se présente successivement dans la nature à mesure qu'elle déroule l'enchaînement qui lui est propre, sera appelé plus justement un mode d'activité qu'un état de faiblesse: ainsi la naissance, la croissance, la permanence du sujet à travers l'afflux et l'écoulement de la nourriture, la réunion des éléments pour former le corps, et en sens inverse, la dissolution du composé et le retour des éléments à leur milieu naturel.
[2] Avec quoi la divinité, suivant notre religion, est-elle donc entrée en contact? Est-ce avec la faiblesse prise au sens propre, c'est-à-dire avec le vice, ou est-ce avec la mobilité de notre nature ? Si en effet notre enseignement affirmait que la divinité a pris naissance parmi ce qui a été défendu, il faudrait fuir l'absurdité d'une doctrine qui n'exposerait sur la nature divine aucune idée sensée ; mais si, à l'en croire, Dieu est entré en contact avec notre nature, qui tenait de lui à la fois sa première origine et le principe de son existence, en quoi la religion que nous prêchons manque-l-elle à l'idée qu'on doit se faire de Dieu, puisqu'aucun état de faiblesse ne trouve place avec la foi dans nos idées sur Dieu ? Car nous ne disons pas davantage du médecin qu'il tombe malade, quand il soigne le malade; mais même s'il prend contact avec la maladie, celui qui la soigne reste exempt de mal.
[3] La naissance n'est pas en soi une infirmité, un mal, et on ne saurait appliquer à la vie le qualificatif d'infirmité. C'est l'infirmité attachée à la volupté qui détermine la naissance de l'homme, et l'impulsion qui entraîne au mal les êtres vivants, est une maladie de notre nature ; Dieu au contraire, suivant le mystère de notre religion, est exempt de l'un et de l'autre. Si donc la naissance a été exempte de volupté, et si la vie a été exempte de vice, quelle infirmité subsiste-t-il qui ait été partagée par Dieu, suivant le mystère de notre sainte religion ?
[4] Et si notre adversaire traite d'infirmité la dissociation de l'âme et du corps, il serait juste qu'il donnât bien auparavant ce même nom à la réunion des deux éléments. Car si la séparation des éléments qui étaient unis est une infirmité, l'union des éléments qui étaient séparés en est également une; il y a changement, en effet, dans l'assemblage de ce qui était séparé, comme dans la dissociation des éléments qui étaient entrés en contact, et avaient formé un tout.
[5] Le nom qu'on donne au changement final est précisément celui qui convient aussi au changement initial. Mais si le premier changement accompli, celui que nous appelons naissance, n'est pas une infirmité, on ne saurait non plus traiter logiquement d'infirmité le second changement, celui que nous nommons mort, et dans lequel se dissout l'union du corps et de l'âme.
[6] Quant à Dieu, nous soutenons qu'il a passé par les deux évolutions de notre nature, dont l'une met l'âme en contact avec le corps, et dont l'autre sépare le corps de l'âme ; et nous affirmons que s'étant mêlé à chacun des deux éléments, je veux dire à la partie sensible et à la partie intelligible du composé humain, il a, grâce à cette combinaison ineffable et inexprimable, exécuté son dessein : l'union durable, et même éternelle, des éléments une fois unis, c'est-à-dire de l'âme et du corps.
[7] Notre nature ayant été en effet entraînée, même en la personne de Dieu, vers la dissociation de l'âme et du corps, en vertu de Tordre qui lui est propre, il a réuni de nouveau les parties séparées comme avec une colle, je veux dire avec la puissance divine, en rajustant dans une union indestructible ce qui avait été divisé. Et c'est là la résurrection, le retour, après la dissolution, des éléments qui avaient été accouplés, à une union indissoluble, pour que la grâce première attachée au genre humain pût être rappelée, et que nous pussions revenir à la vie éternelle, une fois que se serait écoulé dans la décomposition le vice uni à notre nature, comme il arrive pour un liquide qui se répand et disparaît, quand on a brisé le vase où il est renfermé, et que rien n'est là pour le contenir.
[8] Or, de même que la mort, s'étant une fois produite pour le premier homme, s'était transmise en même temps à toute la nature humaine, de même le principe de la résurrection s'étend, grâce à un seul, à l'humanité entière. Celui qui a de nouveau uni à son propre corps l'âme qu'il avait revêtue, grâce à sa puissance, communiquée à l'un et à l'autre dès leur origine, a mêlé, sur une échelle plus générale, la substance intelligible à l'élément sensible, parce que l'impulsion donnée a suivi sans peine jusqu'au bout une marche logique.
[9] En effet, dans l'humanité qu'il avait revêtue, l'âme est retournée au corps après la décomposition, et c'est là, pour ainsi dire, le point de départ d'un mouvement qui étend en puissance à toute la nature humaine également, l'union de ce qui avait été séparé. Et voilà le mystère du dessein de Dieu touchant la mort et de la résurrection d'entre les défunts : si Dieu n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps selon l'ordre inévitable de la nature, il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort, et en devenant lui-même un principe de réunion pour les éléments séparés.
XVII. Mais on prétendra que l'objection qui nous avait été proposée ne se trouve pas encore détruite, et que l'argument avancé par les incrédules reçoit au contraire de ce qui a été dit une force nouvelle. En effet, si Dieu possède toute la puissance que notre discours a démontrée, s'il est en son pouvoir de détruire la mort et d'ouvrir l'accès de la vie, que n'exécute-t-il son dessein par un acte pur de sa volonté, au lieu d'effectuer notre salut par un moyen détourné, en venant au monde et en grandissant, et en faisant, pour sauver l'homme, l'épreuve de la mort, quand il pourrait, sans passer par là, assurer notre salut?
[2] En réponse à une objection de ce genre, il suffirait de faire remarquer aux esprits sensés que les malades ne fixent pas non plus aux médecins la nature du régime ; ils ne chicanent pas leurs bienfaiteurs sur la forme du traitement, en demandant pourquoi celui qui les soigne se met en contact avec la partie malade et imagine ce remède-là, pour les délivrer du mal, quand il devrait en employer un autre ; mais ils considèrent le résultat du bienfait et reçoivent avec reconnaissance le service rendu.
[3] En réalité, comme le dit la prophétie, l'immensité de la bonté divine nous assiste d'une manière mystérieuse et ne se montre pas clairement encore dans la vie présente : autrement en effet, toutes les objections des incrédules disparaîtraient, si l'objet de notre attente était exposé aux yeux ; mais maintenant il attend les siècles à venir, pour y découvrir ce que la foi seule nous fait voir aujourd'hui. Dans ces conditions, il faudrait demander à quelques raisonnements, autant que possible, une solution des questions présentes en accord avec ce qui précède.
XVIII. Et peut-être serait-il superflu, si l'on croit fermement que Dieu a fait un séjour dans notre vie, de critiquer sa présence, en prétendant qu'elle n'a pas eu lieu suivant les lois d'une certaine sagesse et suivant une raison supérieure. Pour les esprits qui ne sont pas animés d'une hostilité excessive contre la vérité, il y a une preuve bien grande de cette visite divine : celle qui s'est manifestée même avant la vie future, dans l'existence présente, je veux dire l'attestation résultant des faits eux-mêmes.
[2] Qui ne sait en effet comment la tromperie mise en œuvre par les démons avait été consommée dans toutes les parties de la terre, et s'était rendue maîtresse de la vie humaine par le culte insensé des idoles ; comment c'était devenu un usage chez tous les peuples de l’univers d'honorer les démons sous la forme des idoles, par les sacrifices d'animaux et les souillures déposées su les autels ? [3] Mais dès que se fut manifestée, selon la parole de l'apôtre, la grâce de Dieu, salutaire pour toute l'humanité, au moyen de la nature humaine qu'elle avait revêtue pour nous visiter, tout s'anéantit à la façon d'une fumée ; on vit cesser les folies des oracles et des prédictions, s'évanouir les processions solennelles et les souillures sanglantes des hécatombes, et chez la plupart des peuples, disparaître entièrement autels, propylées, enceintes sacrées, copies d'images consacrées et tout ce qu'entretenaient les ministres des démons pour se tromper eux-mêmes et duper ceux qu'ils rencontraient, de sorte qu'en beaucoup d'endroits, on ne se souvient pas même si ces choses ont existé jadis; à leur place, s'élevèrent, sur toute la surface de la terre, à la gloire du nom du Christ, des temples et des lieux de sacrifice, le sacerdoce auguste et pur de sang, et la sagesse sublime, qui se dirige par les actes plutôt que par les paroles, et le dédain de la vie et le mépris de la mort. Ceux que les tyrans voulaient obliger à trahir leur foi le firent éclater ouvertement, en recevant avec indifférence les mauvais traitements infligés à leur corps, et leur condamnation à mort, ce qu'ils n'eussent évidemment pas supporté avec cette fermeté, s'ils n'avaient eu la preuve certaine et incontestable de la visite divine.
[4] Le fait suivant lui-même peut être donné aux Juifs comme une preuve suffisante du passage sur la terre de celui auquel ils refusent de croire. Jusqu'à la manifestation divine du Christ, ils virent resplendir en effet le palais de Jérusalem, ce temple renommé au loin, les sacrifices célébrés chaque année conformément à la loi; tout ce qui avait été fixé par la loi sous une forme voilée, pour les esprits capables d'entendre le sens mystique, jusqu'à ce moment-là se développa sans obstacle, suivant les rites religieux qui avaient été prescrits dès l'origine. [5] Mais quand ils eurent vu celui qui était attendu, celui qui leur avait été enseigné auparavant par la voix des prophètes et par la loi, et quand, au lieu de croire à sa révélation, ils lui eurent préféré ce qui était désormais une superstition entachée d'erreur, et dont l'interprétation mauvaise leur faisait conserver la lettre de la loi, avec un attachement servile a la coutume plutôt qu'à l'esprit, alors ils ne surent pas accueillir la grâce qui s'était manifestée, et du caractère auguste de leurs cérémonies il ne subsiste plus que des récits : le temple ne nous est plus même connu par ses traces, de cette ville brillante, il ne reste que des ruines, et des antiques prescriptions de la loi, les Juifs n'ont rien gardé ; l'accès du lieu saint dans la ville même de Jérusalem a été interdit par décret des souverains.
XIX. Cependant, puisque ni les païens ni les défenseurs des doctrines juives ne veulent voir là des preuves de la présence divine, il serait bon que notre exposé établît clairement en détail, à propos des objections qui nous ont été faites, pourquoi la nature divine s'unit à la nôtre, sauvant ainsi le genre humain par son intervention directe, au lieu de réaliser par décret son dessein. Quel pourrait donc être notre point de départ pour amener notre discours, par un raisonnement suivi, au but que nous proposons ? Par quoi commencer, si ce n'est par exposer sommairement les idées que se fait sur Dieu la piété?
XX. Tout le monde convient que la foi doit attribuer à la Divinité non seulement la puissance, mais aussi la justice, In bonté, la sagesse, et tout ce qui porte la pensée vers la nature supérieure. Par suite, pour le plan dont nous parlons, il est impossible que tel des attributs convenables à Dieu tende à se manifester dans les faits accomplis à l'exception de tel autre. Car il n'est absolument aucun de ces noms sublimes qui représente en soi, et en soi seul, une vertu indépendamment des autres : la bonté n'est pas vraiment telle, si elle n'est placée aux côtés de la justice, de la sagesse et de la puissance; car l'absence de justice, ou de sagesse, ou de puissance n'a pas le caractère du bien. De même la puissance séparée de la justice et de la sagesse n'est pas conçue comme rentrant dans la vertu, car la puissance, sous cette forme, est une chose brutale et tyrannique. [2] De même aussi les autres attributs, la sagesse, si elle était donnée indépendamment de la justice, ou la justice, si elle n'était conçue avec la puissance et le bien, seraient, dans ces conditions, appelées plus justement du nom de vice ; car ce qui manque de l'élément supérieur, comment le compter au nombre des biens?
[3] Mais puisqu'il convient de réunir dans nos idées sur Dieu tous ces attributs, examinons si quelqu'une des conceptions que l'on doit se faire de Dieu manque au plan divin qui concerne l'homme. Nous cherchons, à propos de Dieu, toutes les marques qu'il donne de sa bonté. Et quel témoignage de bonté aurait pu être plus éclatant que de réclamer le transfuge passé à l'ennemi, sans que la nature ferme dans le bien et immuable fût affectée par son contact avec la mobilité de la volonté humaine ? Car il ne serait pas venu nous sauver, comme le dit David, si un sentiment de bonté n'avait déterminé un tel dessein.
[4] Mais la bonté de ce dessein eût été inutile, si la sagesse n'avait rendu actif l'amour de l'humanité, lît en effet, dans le cas des malades, nombreux sont sans doute ceux qui désirent voir délivrée de ses maux la personne souffrante, mais ceux-là seuls font aboutir leur bonne volonté en faveur des malades, qui trouvent dans leur science un moyen de travailler activement à la guérison du patient. La sagesse doit donc avoir été unie de la façon la plus étroite à la bonté.
[5] Comment la sagesse se découvre-t-elle dans les faits unie à la bonté? Car il n'est pas possible de percevoir en soi, isolément, la bonté de l'intention. Comment en effet le dessein pourrait-il se manifester s'il ne se montrait dans les faits ? Or les actions accomplies, en se déroulant suivant un enchaînement régulier et un certain ordre, laissent paraître le caractère sage et savant du plan divin.
[6] Et puisque la sagesse, comme on l'a dit plus haut, est une vertu à la condition expresse d'être associée à la justice, et que si on l'en séparait, elle ne serait plus, prise à part, un bien en soi, il serait bon d'unir aussi en pensée, dans la doctrine du plan relatif à l'homme, ces deux attributs, je veux dire la sagesse et la justice.
XXI. Qu'est-ce donc que la justice? Nous nous souvenons des points établis au début du discours, d'après la suite naturelle des idées : l'homme a été créé à l'image de la nature divine, et conserve sa ressemblance aven la divinité par les privilèges qui lui restent et par son libre arbitre; mais il a nécessairement une nature changeante. Celui qui tenait d'un changement le principe de l'existence, devait forcément en effet être enclin à changer. Car le passage du néant a l'existence est un changement; le non-être se transforme en être en vertu de la puissance divine, et le changement s'observe de toute nécessité chez l'homme, étant donné surtout que l'homme était une copie de la nature divine, et qu'une imitation, si elle n'offrait aucune différence, se confondrait absolument avec ce qu'elle reproduit.
[2] Or voici en quoi consiste la différence de l'image et du modèle par excellence : l'un est immuable par nature, l'autre au contraire tient d'un changement son existence, comme on l'a exposé, et étant en proie au changement ne reste absolument pas dans l'être,
[3] Le changement est un mouvement qui tend sans; cesse de l'état présent à un état différent, et un mouvement de ce genre prend deux formes : dans l'une, il tend sans cesse vers le bien, et là, le progrès ne connaît pas d'arrêt, puisque l'espace parcouru est conçu comme illimité ; dans l'autre, il tend vers l'état opposé, dont l'essence est de rie pas avoir d'existence : le contraire du bien, en effet, comme on l'a dit plus haut, s'oppose à lui à peu près dans le sens où nous disons que ce qui n'est pas s'oppose à ce qui est, et que la non-existence s'oppose à l'existence. Or dans la tendance et dans le mouvement qui s'accompagnent de variation et de changement, il est impossible à la nature de rester immuable en elle-même, mais notre volonté tend tout entière vers un but, parce que son désir du bien la met naturellement en mouvement.
[4] Mais le bien a deux formes: l'une véritable et naturelle, l'autre différente de celle-là, et colorée d'une apparence de bien. Leur critérium est l'intelligence établie au dedans de nous. On court avec elle la chance d'atteindre le véritable bien, ou le risque de se laisser détourner du bien par quelque apparence trompeuse, et de tomber dans l'état contraire, comme il arriva, dans la fable païenne, à la chienne qui, ayant vu dans l'eau l'ombre de ce qu'elle portait dans sa gueule, lâcha sa véritable pitance, et après avoir ouvert la gueule pour avaler l'image de son dîner, se trouva en proie à la faim.
[5] Il arriva donc que l'intelligence induite en erreur dans son désir du vrai bien, fut détournée vers ce qui n'est pas; trompée par l'instigateur et l'inventeur du vice, elle se laissa persuader que le bien était tout l'opposé du bien (car la tromperie fût restée sans effet, si l'apparence du bien n'avait été appliquée, à la façon d'un appât, à l'hameçon du vice) ; et l'homme tomba volontairement dans ce malheur quand il eut été amené par le plaisir à se soumettre à l'ennemi de la vie. Recherchez maintenant avec moi tous les attributs convenables aux idées que l'on se fait de Dieu, la bonté, la sagesse, la justice, la puissance, l'incorruptibilité et tout ce qui caractérise Dieu. [6] Etant bon, il prend donc en pitié l'homme déchu; étant sage, il n'ignore pas le moyen de le sauver. Le discernement du juste peut rentrer aussi dans la sagesse, car on ne saurait allier à la démence la véritable justice.
XXII. En quoi consiste donc ici la justice ? A ne pas avoir usé contre celui qui nous détenait, d'une autorité absolue et tyrannique, et à n'avoir laissé, en nous arrachant à ce maître par la supériorité de son pouvoir, aucun prétexte de contestation à celui qui avait asservi l'homme au moyen du plaisir. Ceux qui ont vendu pour de l'argent leur propre liberté, sont les esclaves de leurs acquéreurs, puisqu'ils se sont constitués eux-mêmes les vendeurs de leurs propres personnes, et il n'est permis ni à eux, ni à aucun autre parlant en leur faveur, de réclamer la liberté, ceux qui se sont volontairement voués à cette condition misérable fussent-ils de naissance noble. [2] Si, par intérêt pour la personne vendue, on usait de violence contre l'acheteur, on passerait pour coupable, en enlevant par un procédé tyrannique celui qui a été légalement acquis. Mais si on voulait le racheter, aucune loi ne s'y opposerait. De même, comme nous nous étions volontairement vendus, celui; qui par bonté nous enlevait pour nous remettre en liberté, devait avoir imaginé, non le procédé tyrannique de salut, mais le procédé conforme à la justice. C'était un procédé de ce genre que de laisser au possesseur le choix de la rançon qu'il voulait recevoir, pour prix de celui qu'il détenait.
XXIII. Quelle rançon devait donc naturellement préférer le possesseur? On peut, d'après la suite des idées, conjecturer son désir, si les points acquis comme évidents nous fournissent des indices pour la question présente. Celui qui, d'après la doctrine exposée au début du traité, avait fermé les yeux au bien, par envie pour le bonheur de l'homme, et qui avait engendré en lui-même les ténèbres du vice, celui qui était malade d'ambition, principe et fondement de la dépravation, et pour ainsi dire, mère des autres vices, contre quoi eût-il échangé celui qu'il détenait, si ce n'est, selon toute évidence, contre l'objet qui le dépassait en élévation et en grandeur, afin de satisfaire plus complètement la passion de son orgueilleux vertige, en recevant plus qu'il ne donnait ?
[2] Mais dans l'histoire de tous les temps, il ne connaissait rien de semblable à ce qu'il voyait se manifester alors : une conception se produisant sans union, une naissance exempte de corruption, l'allaitement donné par une vierge, des voix parties des régions invisibles, attestant d'en haut la condition merveilleuse de la naissance, la guérison sans effort et sans remèdes des infirmités naturelles, opérée par lui d'un seul mot et par un simple mouvement de la volonté, le retour des morts à la vie, la délivrance des possédés, l'effroi inspiré aux démons. C'était encore le pouvoir de commander aux phénomènes de l'air, celui de marcher à travers la mer; les flots ne s'ouvraient point de part et d'autre pour découvrir le fond de l'abîme sous les pas des arrivants comme dans le miracle de Moïse, mais la surface de l'eau se durcissait sous les pieds, et douée de résistance, soutenait solidement leur marche; c'était le privilège de se passer de nourriture aussi longtemps qu'il le voulait, les festins copieux offerts dans le désert à des milliers et des milliers de convives auxquels le ciel n'envoyait pas la manne, et que la terre ne nourrissait pas, pour satisfaire leurs besoins, de ses produits naturels, mais auxquels la libéralité de la puissance divine ouvrait ses mystérieux trésors; le pain qui naissait tout prêt, comme un produit de la terre, entre les mains des serviteurs, et se multipliait à mesure que s'en rassasiaient les convives, la bonne chère fournie par les poissons, sans que la mer eût à subvenir aux besoins du repas, mais grâce à celui qui avait répandu dans la mer l'espèce des poissons.
[3] Et comment passer un à un en revue les miracles de l'évangile? Devant cette puissance, l'ennemi comprit que le marché proposé lui donnait plus qu'il ne possédait. Voilà pourquoi il choisit le Sauveur comme rançon des prisonniers retenus dans le cachot de la mort. Mais il lui était impossible de contempler en face la vision de Dieu se présentant sans voile ; il fallait qu'il put voir en lui une part de la chair dont il s'était déjà rendu maître par le péché. Aussi la divinité s'est-elle recouverte de l'enveloppe charnelle, afin que l'ennemi, ayant sous les yeux cet élément bien connu et familier, ne fût pas saisi d'effroi, à l'approche de la puissance supérieure, et que, remarquant la puissance dont la lumière grandissait doucement à travers les miracles, il jugeât cette apparition plus digne d'attirer le désir que d'exciter l'effroi.
[4] Vous voyez comment la bonté a été unie à la justice, et comment la sagesse n'en a pas été séparée. Que la puissance divine ait imaginé de devenir accessible en s'enveloppant d'un corps, afin que le plan de notre salut ne fût pas entravé par l'effroi de l'apparition divine, ce fait démontre l'union de tous ces attributs : bonté, sagesse, justice. La volonté de nous sauver atteste en effet sa bonté ; le caractère de contrat, donné au rachat de la créature asservie, montre sa justice ; et le fait d'avoir ouvert intentionnellement à l'ennemi l'accès de l'inaccessible, est une preuve de la sagesse suprême.
XXIV. Mais il est naturel qu'un esprit attentif à l'enchaînement du discours cherche où se découvre dans les faits mentionnés le pouvoir de la divinité, où se découvre l'incorruptibilité de la puissance divine. Pour rendre ces points encore parfaitement clairs, examinons donc avec soin la suite du mystère, où se montre le mieux le mélange de la puissance avec l'amour de l'humanité.
[2] Tout d'abord, le fait que la nature toute puissante a été capable de descendre jusqu'à la bassesse de la condition humaine est une plus grande preuve de puissance que les miracles d'un caractère imposant et surnaturel. Car l'accomplissement par la puissance divine d'une action grande et sublime est, en quelque sorte, une conséquence logique de sa nature. Et on ne ferait pas entendre un paradoxe en disant que toute la création comprise dans l'univers, et tout ce qui existe en dehors du monde visible, s'est constitué en vertu de la puissance divine, la volonté même de Dieu s'étant transformée en substance selon son désir. Mais l'humiliation de Dieu montre la surabondance de son pouvoir, qui n'est entravé en rien au milieu de ces conditions contraires à sa nature.
[3] La tendance à monter est propre à la nature du feu, et on ne saurait s'étonner d'un phénomène naturel à la flamme. Si au contraire, on voit la flamme s'abaisser à la façon des corps pesants, on trouve surprenant un semblable phénomène. Comment le feu, tout en restant feu, déroge-t-il à sa nature par le mode de son mouvement, dans cette tendance à descendre? Il en est ainsi pour la puissance divine et suprême : ni les immensités des cieux, ni l'éclat des astres, ni l'ordonnance de l'univers et l'économie prolongée du monde ne font voir cette puissance autant que la condescendance qui l'incline vers la faiblesse de notre nature. Nous y voyons comment la grandeur, se trouvant placée dans la bassesse, se laisse apercevoir dans la bassesse sans déchoir de son élévation ; comment la Divinité, s'étant unie à la nature humaine, devient ceci tout en restant cela.
[4] Comme on l'a dit plus haut, il était impossible à la puissance adverse d'entrer en contact avec Dieu s'il se présentait sans mélange, et d'affronter son apparition, si elle avait lieu sans voile ; c'est pourquoi la Divinité, voulant offrir une prise facile à celui qui cherchait à nous échanger contre un objet plus précieux, se cacha sous l'enveloppe de notre nature, afin que l'appât de la chair fit passer avec lui l'hameçon de la Divinité, comme il arrive pour les poissons gourmands, et qu'ainsi, la vie ayant été logée dans la mort, et la lumière étant venue briller dans les ténèbres, on vît disparaître ce qui est conçu comme opposé à la lumière et à la vie. Car il est impossible aux ténèbres de subsister en présence de la lumière, de même qu'il ne peut y avoir de mort quand la vie est en activité.
[5] Reprenons donc dans ses points essentiels la suite du mystère, afin de compléter sa justification en réponse à ceux qui accusent le plan divin de faire réaliser à la Divinité par une intervention personnelle le salut de l'humanité. Car la Divinité doit conserver en tout les attributs qui lui conviennent; il ne faut pas se faire d'elle sur tel point une idée élevée, pour exclure tel autre caractère de la dignité qui convient à Dieu : toute conception élevée et conforme à la piété doit être sans réserve attribuée à Dieu par la foi, et l'une doit s'enchaîner à l'autre par une exacte succession.
[6] On a démontré la bonté, la sagesse, la justice, la puissance, l'incorruptibilité, tous ces attributs qui se manifestent dans l'organisation du plan qui nous concerne. La bonté se fait voir dans la volonté de sauver celui qui était perdu, la sagesse et la justice se sont manifestées dans la forme de notre salut, Dieu a montré sa puissance en devenant semblable à l'homme, et en prenant sa forme, pour se régler sur la bassesse de notre nature ; il l'a montrée en donnant à croire qu'il pourrait comme les hommes devenir la proie de la mort ; il l'a montrée enfin, en réalisant, une fois devenu tel, ce qui lui appartient en propre, et ce qui est conforme à sa nature.
[7] Or le propre de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres; le propre de la vie, c'est de détruire la mort. Puisqu'en nous laissant entraîner hors du droit chemin, nous avions été à l'origine détournés de la vie, et précipités dans la mort, en quoi l'enseignement de la religion sort-il de la vraisemblance, si la pureté s'attache aux misérables souillés par le péché, la vie aux morts, si une direction est donnée aux égarés, afin que la souillure disparaisse, que l'égarement soit guéri, et que ce qui était mort soit rappelé à la vie?
XXV. Que la Divinité ait revêtu notre nature, c'est un fait qui ne saurait présenter rien d'étrange ni de contraire au bon sens pour les esprits qui conçoivent la réalité sans mesquinerie excessive. Qui serait assez faible d'esprit pour ne pas croire, en considérant l'univers, que la Divinité est tout, qu'elle se revêt de l'univers, qu'elle l'embrasse et y réside ? Ce qui existe dépend en effet de celui qui existe, et rien ne peut exister qui ne possède l'existence dans le sein de Celui qui est. Si donc tout est en lui, et s'il est dans tout, pourquoi rougir de la religion qui nous enseigne que Dieu a pris naissance dans l'homme, puisqu'aujourd'hui même la foi n'exclut pas de l'homme son existence ?
[2] Si en effet la présence de Dieu en nous ne prend pas ici la même forme que là, il n'en est pas moins reconnu que maintenant comme alors il est également en nous. Aujourd'hui il est mêlé à nous, en tant qu'il maintient la nature dans l'existence ; alors il s'est mélangé à notre être, pour que notre être pût devenir divin par son mélange avec le divin, après avoir été arraché à la mort, et délivré de la tyrannie de l'ennemi; car sa résurrection devient pour la race mortelle le principe du retour à la vie immortelle.
XXVI. Mais peut-être, en examinant la justice et la sagesse qui s'observent dans ce plan divin, est-on amené à regarder comme une sorte de tromperie la méthode imaginée dans ces conditions par Dieu en vue de notre salut. En se livrant au maître de l'homme sans dévoiler sa divinité, mais en la recouvrant de la nature humaine, à l'insu de l'ennemi, Dieu a eu recours, en un sens, à une tromperie et à un procédé captieux, puisque le propre des trompeurs est de détourner l'attente de ceux que visent leurs machinations et d'agir contre cette attente. Mais si l'on considère la vérité, on reconnaîtra jusque-là une preuve suprême de la justice et de la sagesse divines.
[2] C'est en effet le propre d'une nature juste de donner à chacun selon son mérite, et d'une nature sage de ne pas faire dévier la justice, tout en ne séparant pas des décisions de la justice les bienveillantes intentions de l'humanité, mais de concilier adroitement les unes et les autres, en rendant, selon la justice, ce qui est mérité, et en restant, par la bonté, dans les intentions de l'humanité. Examinons donc si ces deux caractères ne s'observent pas dans les faits accomplis.
[3] L'action de payer le trompeur selon son mérite en le trompant à son tour, montre la justice, et l'intention du procédé atteste la bonté de son auteur. Le propre de la justice, en effet, est d'attribuer à chacun les résultats dont il a auparavant posé les fondements, et semé les causes, de même que la terre rend des fruits en rapport avec la nature des semences qui y ont été jetées. Le propre de la sagesse, d'autre part, est de ne pas s'écarter, dans la façon dont on rend la pareille, de l'amélioration qu'on se propose. [4] L'empoisonneur et le médecin qui traite la victime d'un empoisonnement mélangent également une drogue à sa nourriture, mais entre les mains du premier, c'est le poison, dans celles du second, le remède du poison, et le procédé du traitement n'altère en rien le caractère bienfaisant de l'intention : si l'un et l'autre mêlent une drogue à la nourriture, nous savons du moins, en considérant leur dessein, louer l'un et blâmer l'autre. Il en est de même ici. Le trompeur reçoit à son tour, selon la règle de la justice, ce qu'il a semé par un acte de sa volonté propre (car il est trompé, lui aussi, par l'homme qu'on lui présente en appât, lui qui avait le premier trompé l'homme par l'amorce du plaisir) ; mais l'intention du procédé en change avantageusement le caractère.
[5] L'un avait exécuté sa tromperie en vue de corrompre la nature; l'autre, à la fois juste, bon et sage, a imaginé la tromperie pour sauver celui qui avait été corrompu, faisant ainsi du bien non seulement à la créature perdue, mais encore à l'auteur de notre perte. Le rapprochement de la vie et de la mort, de la lumière et des ténèbres, de l'incorruptibilité et de la corruption, amène la disparition et l'anéantissement de l'élément inférieur, pour le bien de celui qui est délivré de ces maux.
[6] Quand il s'est mêlé à l'or une matière moins précieuse, les ouvriers qui en ont le soin font disparaître par le feu l'élément étranger que contient l'or et qui doit être éliminé, et ramènent ainsi à son éclat naturel la matière la plus précieuse; cette séparation toutefois ne va pas sans peine ; il faut du temps pour que le feu fasse disparaître l'impureté par sa puissance de destruction, et c'est une sorte de traitement qu'on applique à l'or en faisant fondre l'élément même dont la présence a pour effet d'altérer sa beauté. [7] De même ici, la mort, la corruption, les ténèbres, et tous les fruits du vice étant attachés à l'auteur du mal, l'approche de la puissance divine détruit, à la façon du feu, l'élément contraire à la nature, purification bienfaisante pour la nature, quoique le partage soit pénible. L'adversaire lui-même ne saurait mettre en doute la justice et le caractère salutaire du procédé employé, si toutefois il pouvait comprendre le bienfait.
[8] Ceux qu'on traite par les coupures et les cautérisations s'impatientent contre les médecins, sous la douleur aiguë de la coupure, mais si ces soins leur procurent la santé, et si la souffrance causée par la brûlure disparaît, c'est de la reconnaissance qu'ils auront pour les auteurs du traitement. De même la nature ayant été, par ces moyens détournés et longs, débarrassée du mal qui s'y était mêlé et attaché, quand seront rétablis dans leur condition primitive ceux qui sont maintenant plongés dans le vice, le concert d'actions de grâces s'élèvera de toute la création, et de la bouche de ceux qui auront été châtiés au cours de cette purification, et de la bouche de ceux qui n'auront pas même eu besoin, d'être purifiés.
[9] Ce sont ces enseignements et d'autres du même genre que nous donne le grand mystère de l'incarnation divine. C'est en se mêlant à l'humanité, en revêtant tous les caractères propres à la nature, la naissance, l'éducation, la croissance, et en franchissant toutes les étapes jusqu'à l'épreuve de la mort, que Dieu a exécuté tout ce dont nous avons parlé plus haut, délivrant l'homme du vice, et guérissant l'auteur même du vice. C'est en effet guérir une infirmité que tic faire disparaître, même au prix de souffrances, la maladie.
XXVII. Il était rigoureusement logique que celui qui se mêlait à notre nature acceptât d'en revêtir tous les caractères distinctifs pour s'unir étroitement à nous. Car ceux qui lavent les vêtements pour les nettoyer ne laissent pas de côté une partie des souillures, en se bornant à enlever les autres; mais ils purifient de ses taches toute la pièce d'étoffe d'un bout à l'autre, pour que tout le vêtement ait la même beauté, et resplendisse d'un égal éclat au sortir Au lavage ; de même la vie humaine ayant été souillée par le péché dans son principe, dans sa fin et dans tout l'intervalle, la puissance qui la nettoie devait passer partout et ne pas appliquer à l'une des parties le traitement de la purification, pour laisser l'autre sans remède. [2] Voilà pourquoi, notre vie étant comprise de part et d'autre entre deux extrémités, je veux dire le commencement et la fin, on trouve à chacune des deux extrémités la puissance qui redresse notre nature ; elle est entrée en contact avec le commencement, elle s'est étendue de là jusqu'à la fin, et a occupé tout l'espace compris dans l'intervalle.
[3] Or puisqu'il n'y a pour tous les hommes qu'une seule façon d'entrer dans l'existence, d'où devait venir celui qui nous visitait, pour s'établir dans notre vie? Du ciel, dit peut-être celui qui rejette comme avilissante et sans gloire la forme de la naissance humaine. Mais l'humanité n'était pas au ciel, et dans la vie supraterrestre ne régnait sous aucune forme la maladie du vice. Or celui qui se mêlait à l'homme voulait régler sur ses vues bienfaisantes cette étroite union. Là où le mal n'existait pas, et où ce n'était pas la vie humaine qui était gouvernée, comment veut-on que l'homme en soit descendu pour revêtir Dieu, et il serait plus juste de dire non pas un homme, mais un portrait, une image de l'homme? Comment se serait opéré le redressement de notre nature, si la créature terrestre étant malade, c'était un être différent qui eût été choisi parmi les habitants célestes pour se mélanger avec Dieu? Car le malade ne peut éprouver l'effet du traitement, si ce n'est pas la partie souffrante qui reçoit spécialement la guérison.
[4] Si donc la partie malade, était sur terre, et si la puissance divine, par souci de sa propre dignité, ne s'était pas attachée à cette partie malade, la sollicitude qui eût absorbé la puissance divine autour d'objets n'ayant rien de commun avec nous, eût été sans profit pour l'homme. Car l'indignité eût été la même pour la Divinité, si toutefois il n'est pas absolument sacrilège de concevoir d'autre indignité que le vice. Mais pour l'esprit mesquin, aux yeux de qui la majesté divine consiste à ne pas admettre de contact avec les caractères propres de notre nature, le déshonneur n'est nullement atténué, que ce soit sur un corps céleste ou terrestre que la Divinité se soit façonnée. Toute la création, en effet, est, à une égale distance, inférieure au Très-Haut, que l'élévation de sa nature rend inaccessible, et l'univers reste sur le même rang au-dessous de lui. Car ce qui est absolument inaccessible n'est pas accessible à tel objet, et inabordable pour tel autre, mais se trouve également élevé au-dessus de tout ce qui existe.
[5] La terre n'est donc pas plus éloignée que le ciel de la majesté divine, et le ciel n'en est pas plus rapproché qu'elle ; et les êtres qui habitent chacun de ces deux éléments ne différent en rien les uns des autres, à ce point de vue. On ne peut donc dire que les uns touchent à la nature inaccessible, et que les autres en soient séparés; autrement nous supposerions que la puissance souveraine de l'univers ne s'étend pas également à toutes choses, mais qu'elle surabonde ici et que là elle est insuffisante. Cette différence de mesure et de degré aurait pour conséquence logique de faire apparaître la divinité comme composée, rie s'accordant pas avec elle-même, si on la supposait éloignée de nous, par la loi de sa nature, et rapprochée au contraire de quelque autre créature, et facile à saisir par suite de cette proximité.
[6] Mais le regard de la véritable doctrine, quand il s'agit de cette majesté sublime, ne se porte pas en bas ni en haut pour faire un rapprochement. Toutes choses en effet restent également au-dessous de la puissance directrice de l'univers, de sorte que si la créature terrestre semble par sa nature indigne de cette étroite union avec la divinité, on ne saurait pas davantage en trouver une autre qui en fût digne. Si tout reste également loin de cette majesté, une seule chose s'accorde avec la dignité de Dieu : secourir la créature dans le besoin. En reconnaissant que la puissance qui guérit est allée là où se trouvait la maladie, en quoi notre croyance manque-t-elle à l'idée qu'on doit se faire de Dieu?
XXVIII. Mais les adversaires tournent en ridicule notre nature; ils reviennent sans cesse sur le caractère de la naissance, et s'imaginent par là ridiculiser la religion, comme s'il était indigne de Dieu d'entrer par un lel moyen en contact avec la vie humaine. Sur ce sujet, on a déjà dit précédemment qu'il n'y a d'avilissant par sa propre nature que le mal et tout ce qui a une affinité avec le vice. L'ordre de la nature, réglé par un acte de la volonté de Dieu, et par une loi divine, échappe à l'accusation du mal; sans quoi l'accusation portée contre la nature atteindrait le Créateur, si quelqu'une des choses qui s'y rattachent était accusée d'être avilissante et indigne.
[2] Si donc la divinité ne s'est séparée que du vice, et si la nature n'a pas le caractère du vice; si, d'autre part, c'est dans l'homme et non dans le vice que Dieu a pris naissance, et s'il n'y a pour l'homme qu'une façon d'entrer dans la vie, celle qui introduit dans l'existence la créature engendrée, quelle autre manière d'entrer dans la vie décrètent-ils pour Dieu ? Ils trouvent raisonnable que la nature affaiblie par le mal du vice ait été visitée par la puissance divine, mais la forme de cette visite les mécontente; ils ignorent que la structure du corps a dans toutes ses parties la même importance, et que rien de ce qui y contribue à l'organisation de la vie n'est accusé d'être méprisable ou défectueux.
[3] La disposition de l'organisme est tout entière établie en vue d'un seul, et même but, et ce but est de conserver l'existence à l'être humain. Les autres organes maintiennent la vie présente de l'homme en se partageant différentes formes d'activité ; c'est par eux que s'exerce la faculté de percevoir et d'agir; les organes de la génération sont chargés de pourvoir à l'avenir ; ils assurent, par leur intermédiaire, à la nature une succession continue.
[4] Si c'est au point de vue de l'utilité qu'on se place, quel est celui des organes regardés comme importants auquel ceux-là céderont la première place? Sur lequel ne leur donnerait-on pas à bon droit l'avantage ? Ni l'œil en effet, ni l'oreille, ni la langue, ni aucun organe des sens n'assurent la continuité ininterrompue de notre espèce ; car ils regardent, nous l'avons dit, la jouissance actuelle. Ce sont les autres qui conservent à la nature humaine l'immortalité, de sorte que l'activité de la mort sans cesse dirigée contre nous est en un sens vaine et inefficace, puisque la nature comble chaque fois le vide par la succession des nouveaux venus. Que contient donc notre religion qui soit indigne de Dieu, si Dieu a pris, pour se mélanger à la vie humaine, les voies que la nature emploie pour lutter contre la mort?
XXIX. Passant de cette question à une autre, les adversaires essaient encore d'injurier notre doctrine. Si la méthode employée était bonne et digne de Dieu, disent-ils, pourquoi a-t-il différé son bienfait? Pourquoi, lorsque le vice était encore à ses débuts, n'a-t-il pas coupé court à ses progrès ultérieurs ?
[2] A cette objection nous répondrons simplement que c'est la sagesse et la prévoyance de l'être bienfaisant par nature qui ont différé le bienfait. En effet, dans le cas des maladies physiques, quand une humeur corrompue envahit les conduits du corps, jusqu'au moment où l'élément contraire à la nature s'est manifesté à la surface, ceux qui appliquent aux maladies une méthode savante ne traitent pas le corps à l'aide d'astringents ; ils attendent que le mal caché dans les profondeurs se montre au dehors, et alors, quand il est à découvert ils lui appliquent le traitement. Ainsi donc, une fois que la maladie du vice se fut abattue sur la nature humaine, le médecin de l'univers attendit qu'il ne restât caché dans notre nature aucune forme de perversité.
[3] Voila pourquoi ce n'est pas aussitôt après la jalousie et le fratricide de Caïn qu'il applique à l'homme le traitement. En effet, ceux qui furent, détruits du temps de Noé n'avaient pas encore fait éclater leur vice, la funeste maladie des crimes de Sodome ne s'était pas manifestée, ni la lutte des égyptiens contre Dieu, ni l'arrogance des Assyriens, ni le crime commis par les Juifs contre les saints de Dieu, ni le massacre criminel des enfants ordonné par Hérode, non plus que tous les autres méfaits dont on garde la mémoire, et tous ceux qui furent commis à l'insu de l'histoire dans la suite des générations, quand la racine du mal poussait différentes sortes de rejetons suivant les diverses inclinations de la volonté humaine.
[4] Lorsque le vice fut arrivé à son comble, et qu'il n'y eut plus aucune sorte de perversité qui n'eût été osée par les hommes, alors Dieu se mit à soigner la maladie, non pas à son début, mais dans son entier épanouissement, pour que le traitement pût s'étendre à toute l'infirmité humaine.
XXX. Si l'on s'imagine réfuter notre doctrine en faisant valoir que, même après l'application du traitement, la vie humaine est encore gâtée par les fautes, qu'on se laisse guider vers la vérité par un exemple familier. Quand le serpent a reçu sur la tête le coup mortel, les replis qui viennent à la suite ne sont pas abattus avec la tête, mais elle est déjà morte que la queue reste animée du principe vital qui lui est propre et conserve le mouvement de la vie. Il en est de même pour le vice: on peut le voir, frappé du coup mortel, troubler encore de ses débris la vie humaine.
[2] Mais laissant de côté, sur ce point encore, leurs critiques contre l'enseignement de la religion, les adversaires font valoir comme un grief, que la foi ne s'étend pas à toute l'humanité. Pourquoi donc, disent-ils, la grâce de l'Évangile ne s'est elle pas étendue à tous les hommes? Pourquoi, à-côté d'un certain nombre qui s'attachent à la doctrine nouvelle, une portion considérable de l'humanité en reste-t-elle privée ? Ou bien Dieu n'a pas voulu distribuer largement son bienfait à tous, ou bien il n'en a absolument pas eu le pouvoir, et ni l'une ni l'autre de ces deux causes n'est exempte de reproche. Car il ne sied pas à Dieu de ne pas vouloir le bien, ni d'être incapable de le faire. Si donc la foi est un bien, pourquoi, disent-ils, la grâce de l'Evangile ne s'est-elle pas étendue à tous?
[3] Si nous établissions en effet, nous aussi, dans notre doctrine que la volonté divine distribue au hasard la foi aux hommes, les uns se trouvant appelés à la recevoir, et les autres étant exclus de l'invitation, on aurait lieu de porter une semblable accusation contre la religion. Mais si l'appel s'adresse également à tous, sans distinction de conditions, d'âge ni de race (car si dès les premiers débuts de la prédication, les ministres de la doctrine purent, en vertu d'une inspiration divine, parler la langue de tous les peuples, c'était pour que personne ne fût exclu des bienfaits de cet enseignement), comment donc pourrait-on encore raisonnablement reprocher à Dieu que sa doctrine ne se soit pas imposée à tous ?
[4] Celui qui a la libre disposition de toutes choses a permis dans son extrême considération pour l'homme que nous eussions aussi notre royaume, dont chaque individu serait seul maître. C'est là la volonté, faculté exempte de servitude, et libre, fondée sur l'indépendance de notre raison. Il serait donc plus juste de faire retomber une telle accusation sur ceux qui n'ont pas été conquis à la foi, et non sur celui qui a invité les hommes à y acquiescer. [5] Même quand Pierre prêcha au début la doctrine devant une immense assemblée de Juifs, et que trois mille hommes reçurent la foi en même temps, les incrédules, quoique plus nombreux que ceux qui avaient fait acte de foi, ne reprochèrent pas à l'Apôtre de ne pas les avoir convaincus. Il n'eût pas été non plus raisonnable, quand la grâce était exposée aux yeux de tous, que celui qui s'y était volontairement soustrait accusât de son mauvais partage un autre que lui-même.
XXXI. Mais même devant des raisons de ce genre, les adversaires ne restent pas à court de répliques et de chicanes. Dieu pouvait s'il le voulait, disent-ils, amener de force les récalcitrants eux-mêmes à accepter la bonne nouvelle. Où serait donc ici le libre arbitre? Où serait la vertu et la gloire d'une conduite droite ? C'est seulement aux êtres inanimés et privés de raison qu'il appartient de se laisser mener au gré d'une volonté étrangère. La nature raisonnable et pensante, au contraire, si elle met de côté la liberté, perd du même coup le privilège de la pensée. Quel usage fera-t-elle en effet de la raison, si le pouvoir de choisir à son gré dépend d'un autre?
[2] Or si la volonté reste inactive, la vertu disparaît forcément, entravée par l'inertie de la volonté ; et sans vertu, la vie aussitôt perd son prix, l'éloge dû à la bonne conduite se trouve supprimé, le péché se commet sans péril, il devient impossible d'établir une différence entre les manières de vivre. Qui pourrait encore raisonnablement accuser l'homme déréglé, ou louer l'homme vertueux? Cette réponse vient d'elle-même à la bouche de tout le monde: Il ne dépend point de nous d'avoir une volonté ; c'est une puissance supérieure qui conduit les volontés humaines à se ranger à la décision du maître. Si la foi n'a pas pris naissance dans toutes les âmes, la faute n'en est donc pas à la bonté divine, mais à la disposition de ceux qui recevaient la prédication.
XXXII. Que mettent encore en avant les adversaires? Que la nature souveraine devait, avant tout, ne se prêter en aucune façon à l'épreuve de la mort, mais qu'elle aurait pu, sans en venir là, réaliser facilement son dessein par la surabondance de son pouvoir. En admettant même qu'il dût absolument en être ainsi en vertu de quelque raison mystérieuse, Dieu devait du moins ne pas accepter l'ignominie d'une mort infâme. Car quelle mort pourrait être plus infâme, dit-on, que celle de la croix?
[2] A ces objections, que répondrons-nous? Que la naissance rend la mort inévitable. Celui qui avait une fois décidé de partager la condition humaine, devait, passer par tous les états qui caractérisent notre nature. Or la vie humaine étant enfermée entre deux limites, si, après avoir franchi l'une, il n'avait pas pris contact avec la suivante, son dessein fût resté inachevé, puisqu'il n'aurait pas touché à l'un des deux états qui distinguent notre nature.
[3] Peut-être la connaissance exacte du mystère permettrait-elle de dire avec plus de vraisemblance que la naissance n'est pas la cause de la mort, mais que c'est au contraire à cause de la mort que Dieu a accepté de naître. Ce n'est pas en effet le besoin de vivre qui amène l'Eternel à se soumettre à la naissance, mais le désir de nous rappeler de la mort à l'existence. Il fallait ramener de la mort à la vie notre nature entière ; Dieu s'est donc penché sur notre cadavre afin de tendre, pour ainsi dire, la main à l'être qui gisait; il s'est approché de la f mort, jusqu'à prendre contact avec l'état de cadavre, et à fournir à la nature, au moyen de son propre corps, le point de départ de la résurrection, en ressuscitant l'homme entier par sa puissance.
[4] L'homme en qui s'était incarné Dieu, l'homme qui s'était élevé, par sa résurrection, avec la divinité, n'était en effet tiré que de notre limon. Or, de même que dans notre corps l'activité d'un seul des sens entraîne une sensation commune pour l'ensemble de l'organisme qui est uni au membre, de même, la nature tout entière formant pour ainsi dire un seul être vivant, la résurrection du membre s'étend à l'ensemble, et de la partie se communique au tout, en vertu de la continuité et de l'unité de la nature. En quoi la doctrine du mystère sort-elle donc de la vraisemblance, si celui qui est debout se penche sur celui qui gît pour le relever de sa chute? D'autre part, la croix renferme-t-elle encore un enseignement plus profond? C'est ce que savent peut-être ceux qui sont versés dans l'interprétation du sens caché. En tout cas, celui qui nous vient de la tradition, le voici.
[5] C'est suivant le sens le plus élevé et plus divin que tout a été dit et s'est passé dans l'Evangile ; d'autre part, rien n'y échappe à ce caractère de se révéler absolument comme un mélange du divin et de l'humain, la parole et les faits se déroulant d'une façon humaine, et le sens caché révélant la présence du divin. Dans ces conditions, il serait logique de ne pas considérer non plus sur ce point particulier l'un des deux éléments en négligeant l'autre, mais de voir dans la mort le côté humain, et de rechercher avec soin, dans la façon dont elle s'est produite, l'élément divin. [6] Or le propre de la Divinité c'est de se répandre à travers tout, et de s'étendre dans toutes ses parties à la nature de ce qui existe ; rien ne peut en effet subsister dans l'être, sans rester dans le sein de celui qui a l'être; et la nature divine est ce qui existe par excellence et avant tout. Qu'elle soit partout dans l'univers, c'est ce que la permanence du monde nous oblige de toute nécessité à croire. Nous apprenons par la croix, dont la forme se partage en quatre, et nous donne à compter, à partir du centre vers lequel converge l'ensemble, quatre prolongements, nous apprenons, dis-je, que celui qui y fut étendu au moment où le plan divin s'accomplissait par sa mort, est celui qui unit étroitement et ajuste à lui-même l'univers, en ramenant par sa propre personne à un seul accord et à une seule harmonie les diverses natures du monde. [7] Ce que la pensée conçoit dans le monde est en effet soit en haut, soit en bas, à moins qu'elle n'arrive, en le traversant, aux limites qui bornent les côtés. Si donc elle réfléchit à l'organisation des êtres célestes ou souterrains, ou de ceux qui sont aux deux extrémités de l'univers, partout la divinité se présente d'abord à la réflexion ; seule, elle s'observe en toutes les parties du monde et maintient toutes choses dans l'existence.
[8] Cette nature, doit-on la nommer divinité, raison, puissance, sagesse, ou lui donner quelque autre appellation sublime, capable de désigner plus clairement l'être souverain? Notre doctrine ne dispute nullement sur un nom ou sur une forme de langage. Donc puisque toute la création se ramène à cet être et tourne autour de lui, et tient de lui sa cohésion, le haut y étant, grâce à lui, étroitement uni avec le bas, et les côtés l'un avec l'autre, nous devions être non seulement amenés par l’ouïe à la connaissance de la divinité, mais encore être instruits par la vue des conceptions supérieures. C'est de là qu'est parti le grand Paul quand il initie le peuple d'Ephèse, et lui donne par son enseignement le moyen de connaître ce que représentent la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur. [9] Il désigne en effet par un mot spécial chaque prolongement de la croix; il nomme hauteur la partie supérieure, profondeur la partie inférieure, largeur et longueur les bras latéraux. Et il rend cette idée encore plus claire, à mon avis, quand il s'adresse aux Philippiens: « Au nom de Jésus-Christ, dit-il, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. » Ici, il comprend dans une seule et même appellation la traverse centrale, désignant par ces mots : sur la terre, tout l'intervalle entre les habitants du ciel et ceux qui sont sous la terre.
[10] Voilà le mystère qui nous a été enseigné au sujet de la croix. Quant aux faits qui viennent à la suite dans le récit, leur enchaînement est si naturel que, de l'aveu des incrédules eux-mêmes, rien n'y est étranger à l'idée qu'on doit se faire de Dieu. Que le Sauveur ne soit pas resté dans la mort, que les blessures faites au corps par la lance ne soient pas devenues un obstacle à son existence, qu'après la résurrection il soit apparu librement à ses disciples, quand il désirait être à leurs côtés, en restant invisible, et se trouver au milieu d'eux, sans avoir besoin d'entrer par les portes, qu'il ait fortifié les disciples en leur insufflant l'esprit, qu'il leur ait annoncé aussi qu'il était avec eux et que rien ne les séparait de lui, que les yeux l'aient vu s'élever au ciel, tandis que la pensée le sent partout, voilà des faits qui n'ont pas besoin de l'aide du raisonnement pour révéler leur nature divine, ou pour dénoter la puissance sublime et supérieure. [11] Il est inutile, ce me semble, de les passer en revue l'un après l'autre, car le récit en fait éclater de lui-même le caractère surnaturel. Mais puisque les dispositions divines relatives à la purification par l'eau font partie, elles aussi, des enseignements révélés, — qu'on veuille les nommer baptême, illumination ou régénération, nous ne disputerons pas sur la forme du mot, — il serait bon là-dessus encore de dire quelques mots.
XXXIII. Les adversaires en effet nous entendent tenir des propos de ce genre : « Dans le passage de l'être mortel à la vie, il était logique, puisque la première naissance conduisait à l'existence mortelle, qu'une autre naissance fût trouvée, ne commençant pas par la corruption, et n'aboutissant pas à la corruption, mais amenant l'être, une fois né, à une existence immortelle. De même que l'être qui avait reçu le jour se trouvait nécessairement mortel au sortir d'une naissance mortelle, de même cette naissance exempte de corruption a pour but de faire triompher l'être engendré de la corruption produite par la mort. » Quand ils entendent donc ces propos et d'autres du même genre, et qu'on commence par les instruire de la forme du baptême, en leur disant qu'une prière à Dieu, l'invocation de la grâce céleste, de l'eau et la foi sont les moyens par lesquels s'accomplit le mystère de la régénération, ils restent incrédules, en considérant les dehors, parce que suivant eux l'acte accompli sous une forme matérielle ne s'accorde pas avec la promesse divine. Comment en effet, disent-ils, une prière, et l'invocation de la puissance divine, que l'on fait sur l'eau, deviennent-elles une source de vie pour les initiés ?
[2] Ces incrédules, s'ils ne font pas une résistance excessive, une simple réponse suffit pour les amener à accepter la doctrine. Demandons-leur en effet à notre tour, puisque le mode de la naissance charnelle est très clair pour tout le monde, comment la semence d'où doit sortir la formation de l'être vivant devient un homme. Mais bien certainement il n'y a sur ce point aucune théorie qui en découvre, par quelque procédé de raisonnement, l'explication probable. Qu'ont de commun en effet, si on les compare, la définition de l'homme, et la qualité qui s'observe dans cette semence ? L'homme est un être doué de raison et d'intelligence, capable de pensée et de connaissance ; cette semence nous apparaît avec une qualité d'humidité, et la réflexion n'y conçoit rien de plus que ce que distingue la sensation.
[3] La réponse que l'on nous ferait sans doute à cette question : Comment est-il probable que l'homme se soit formé de cette semence? celle réponse, nous la ferons aussi, si l'on nous interroge sur la régénération effectuée par l'eau. Dans le premier cas, en effet, chaque personne interrogée a ces mots à la bouche : « C'est par un effet de la puissance divine que cette semence devient un homme; sans elle, la semence resterait inerte et inefficace. » Si donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la matière qui produit l'homme, si c'est la puissance divine qui transforme en nature humaine ce que nous voyons, il serait de la dernière démence et de la dernière injustice de reconnaître à Dieu, dans le premier cas, une si grande puissance, et de s'imaginer, dans le second, que la Divinité n'a plus la force d'accomplir son dessein.
[4] Qu'y a-t'-il de commun, disent-ils, entre l'eau et la vie ? Et qu'y a-t-il de commun, leur répondrons-nous, entre cet élément humide et l'image de Dieu ? Mais dans le cas-là, il n'y a point à s'étonner si l'élément humide se transforme par lu volonté de Dieu pour devenir l'être vivant le plus élevé en dignité, lien est de même dans le cas présent. Nous soutenons qu'il n'y a rien d'extraordinaire si la présence de la puissance divine fait passer à l'incorruptibilité l'être qui a pris naissance dans la nature corruptible.
XXXIV. Mais ils cherchent une preuve de la présence de la divinité quand on l'invoque pour sanctifier la cérémonie. Que celui qui fait cette recherche relise ce qui a été précédemment examiné. En établissant en effet le caractère vraiment divin de la puissance qui s'est manifestée à nous par la chair, nous avons fourni un appui à la question présente.
[2] En démontrant la divinité de celui qui nous est apparu sous une forme charnelle, et qui a révélé sa nature par les miracles accomplis au cours de sa vie, on a démontré du même coup que sa présence se produisait chaque fois qu'il était invoqué. Toute chose en effet a un caractère particulier qui fait connaître sa nature; le propre de la nature divine, c'est la vérité. Or Dieu a promis d'être toujours aux côtés de ceux qui l'invoqueraient, et au milieu de ses fidèles, de rester avec tous, et d'être en relation avec chacun. Nous n'aurions donc plus besoin d'une autre preuve de la présence de la divinité, si les miracles mêmes nous ont déjà donné foi à son caractère divin, si nous savons que le propre de la divinité c'est d'être pure de mensonge, et si, nous fondant sur le caractère véridique de la promesse, nous ne mettons pas en doute la présence de la chose promise.
[3] L'invocation adressée dans la prière précède la dispensation de la grâce divine : c'est une preuve surabondante que l'acte en train de s'accomplir est amené par Dieu à son entier achèvement. Et en effet, dans l'autre forme de la procréation de l'homme, l'impulsion fournie par les parents, même s'ils n'invoquent pas dans une prière la divinité, arrive, par un effet de la puissance divine, comme on l'a dit plus haut, à former l'être engendré, tandis que sans elle leur effort est vain et inutile. S'il en est ainsi, combien plus complet sera, dans la forme spirituelle de la génération, l'effet recherché, puisque Dieu a promis d'être présent, et a déposé dans l'acte accompli, comme l'a admis notre foi, le pouvoir émanant de sa personne, et puisque notre propre volonté est tendue vers l'objet désiré; combien plus complet, dis-je, si le secours de la prière vient s'y ajouter comme il convient ?
[4] Ceux qui prient Dieu de faire lever sur eux le soleil n'affaiblissent en rien un phénomène qui se produit quoi qu'il arrive, et même on ne saurait taxer d'inutile leur empressement à prier, quand ils demandent à Dieu ce qui se produirait dans tous les cas. De même, les esprits persuadés que la grâce assistera, selon la promesse véridique qui a été faite, les hommes régénérés par la dispensation de ce sacrement, ou bien ajoutent ainsi à la grâce, ou bien ne détournent point celle qui existe. Car la divinité de celui qui a fait la promesse nous a portés à croire que la grâce est présente dans tous les cas, et le témoignage de cette divinité nous est donné par les miracles. De sorte que tout nous interdit de mettre en doute la présence de la Divinité.
XXXV. L'entrée de l'homme dans l'eau, et sa triple immersion renferment un autre mystère. Le procédé employé pour notre salut doit son efficacité moins a la direction de la doctrine qu'aux actes mêmes de celui qui a accepté de partager la condition de l'homme : il a donné à la vie une réalité effective, pour qu'au moyen de la chair revêtue par lui et déifiée avec lui, se trouvât sauvé en même temps ce qui est apparenté à la chair et de même nature. Dans ces conditions, il était nécessaire d'imaginer un procédé où les actes accomplis par celui qui suit eussent une affinité et une analogie avec celui qui conduit. Il faut donc voir avec quels caractères nous est apparu le guide de notre vie, afin que, selon la parole de l'Apôtre, l'imitation de ceux-qui suivent, se réglant sur l'auteur de notre salut, ait un heureux résultat.
[2] Les hommes rompus aux exercices militaires dressent les conscrits à la manœuvre, en leur montrant pour les instruire le mouvement bien rythmé de la marche militaire, mais si l'on ne suit l'exemple donné, on n'acquiert pas cette sorte de science; de même, les hommes animés d'un zèle égal pour le bien doivent, de toute nécessité, suivre par une exacte imitation le guide qui nous conduit à notre salut, et mettre à exécution l'exemple qu'il donne. Il est impossible en effet d'atteindre un but semblable, si l'on ne suit pas un chemin analogue.
[3] Ceux qui, perdus dans les sinuosités d'un labyrinthe ne savent en sortir, et qui rencontrent une personne familiarisée avec ce dédale, arrivent, en marchant derrière, à parcourir jusqu'au bout les détours compliqués et trompeurs de l'édifice ; ils n'en seraient pas sortis, s'ils n'avaient suivi les pas de leur guide: représentez-vous de même que le labyrinthe de la vie serait inextricable pour la nature humaine, si l'on ne prenait la route qui a conduit hors de l'enceinte Celui qui y est entré.
[4] Par labyrinthe, j'entends au figuré la prison sans issue de la mort, où avait été enfermé l'infortuné genre humain. Qu'avons-nous donc vu se produire pour l'auteur de notre salut? Pendant trois jours il est resté dans la mort, puis il est revenu à lavie.il nous faut donc imaginer pour nous-mêmes quelque chose d'analogue. Quelle est l'invention qui nous permettra de reproduire intégralement sa conduite ?
[5] Tout être une fois mort a un séjour approprié, qui lui est fixé par la nature ; c'est la terre où il est étendu et enseveli. Or il y a une étroite affinité entre la terre et l'eau ; ce sont les seuls éléments doués de pesanteur et portés à descendre ; seuls ils subsistent l'un dans l'autre et sont absorbés l'un par l'autre. Puisque le guide de notre vie est descendu sous la terre en mourant, suivant la condition commune, l'imitation de sa mort que nous poursuivons est figurée dans l'élément qui s'en rapproche. [6] Et de même que Lui, l'Homme venu d'en haut, après avoir accepté l'état de cadavre et avoir été déposé dans la terre, est revenu à la vie le troisième jour, de même quiconque se trouve uni à lui selon la nature charnelle, s'il a en vue le même résultat heureux, je veux dire s'il a la vie pour but, reproduit, en répandant sur lui de l'eau, en guise de terre, et en se plongeant à trois reprises dans cet élément, la grâce obtenue après le troisième jour.
[7] On a déjà dit plus haut que la mort a été introduite à dessein dans la nature humaine par la prévoyance divine, pour que le vice s'étant une fois écoulé dans la séparation du corps et de l’âme l'homme reconstitué par la résurrection se retrouvât intact, libre de passions, pur et exempt de tout mélange avec le vice. Mais le dessein que se proposait en mourant l’auteur et le guide de notre salut s'est réalisé d'une façon parfaite, il a été entièrement rempli suivant son propre but. [8] Les éléments qui étaient unis ont été en effet séparés par la mort, et les éléments séparés ont été de nouveau rapprochés, pour que la nature ayant été purifiée par la décomposition des parties unies ensemble, je veux dire l'âme et le corps, le retour à la vie de ces éléments séparés se trouvât exempt du mélange qui les altérait. Au contraire, pour ceux qui suivent ce guide, la nature ne permet pas une imitation exacte en tous points, mais elle l'admet maintenant dans la mesure de ses forces, et réserve le reste pour le temps à venir.
[9] En quoi consiste donc cette imitation? A faire disparaître le vice mélangé à la nature, dans le simulacre de mortification exécuté au moyen de Peau ; ce n'est pas à la vérité une disparition complète, mais comme une solution de la continuité du mal ; deux causes contribuent à la destruction du vice: le repentir du pécheur et l'imitation de la mort; c'est par elles que l’homme est délivré on quelque sorte de son union avec le mal : le repentir l'amène à haïr et à éloigner le vice, et la mort opère la destruction du mal.
[10] S'il était possible dans cette imitation de subir une mort complète, il n'y aurait pas imitation, mais condition identique, et le mal disparaîtrait absolument de notre nature, de sorte que, suivant la parole de, l'Apôtre, nous mourrions une fois pour toutes au péché. Mais, comme on l'a dit, nous imitons la puissance supérieure dans la mesure où le permet la pauvreté de notre nature; en versant sur nous l'eau à trois reprises, et en nous élevant hors de l'eau, nous figurons l'ensevelissement salutaire et la résurrection opérée en trois jours, dans la pensée que si l'eau est à notre disposition, si nous sommes libres de nous y plonger et d'en ressortir, de même le souverain de l'univers avait le moyen, après s'être plongé dans la mort comme nous dans l'eau, de revenir à la condition bienheureuse qui lui est propre.
[11] Si donc l'on considère la vraisemblance, si l'on juge des faits d'après le degré de puissance disponible de part et d'autre, on n'y trouvera aucune différence, puisque le Sauveur et l'homme exécutent chacun de leur côté ce qui est en leur pouvoir, suivant la mesure de leur nature. De même que l'homme peut sans danger entrer en contact avec l'eau, s'il le veut, il est donné à la puissance divine, avec une facilité infiniment plus grande, et d'entrer dans la mort et de ne point y éprouver de changement dans le sens d'une faiblesse.
[12] Voici donc pourquoi il nous fallait préluder par l'eau à la grâce de la résurrection : c'était pour apprendre qu'il nous est également facile d'être baptisés dans l'eau, et d'émerger de la mort. Mais dans les événements de la vie, certaines choses plus que d'autres sont décisives, et sans elles on ne pourrait réussir: cependant, si l'on met en parallèle le commencement avec la fin, le début comparé au résultat paraîtra insignifiant. Comment mettre en effet sur le même pied l'homme et la semence destinée à former l'être vivant? Et pourtant sans l'une, l'autre n'existerait pas. De même aussi, le privilège si grand de la résurrection, quoique supérieur de sa nature, tire d'ici ses origines et ses causes, car il est impossible que ce résultat se produise, s'il n'a été précédé de cette préparation.
[13] Je le déclare, il est impossible à l'homme de ressusciter sans la régénération du baptême, non que j'aie en vue la reconstitution et la restauration du composé humain ; la nature doit en effet s'y acheminer dans tous les cas, sous l'impulsion de ses propres lois, conformément au plan de son organisateur, qu'elle reçoive la grâce du baptême ou qu'elle reste exclue de cette initiation ; je veux parler de la restauration qui ramène à l'état bienheureux, divin, exempt de toute affliction.
[14] Tout ce qui reçoit le privilège de revenir à l'existence par la résurrection ne retourne pas à la même vie, mais il y a une grande distance entre ceux qui ont été purifiés et ceux qui ont besoin encore de purification. Ceux qu'a dirigés tout d'abord durant cette vie la purification du baptême, ceux-là se retireront vers le genre de vie approprié à leur nature ; or l'absence de passions est étroitement unie à la pureté, et dans l'impassibilité réside sans conteste la béatitude. Quant à ceux dont les passions se sont endurcies et qui n'ont mis en oeuvre aucun moyen d'effacer la souillure, ni l'eau du sacrement, ni l'invocation de la puissance divine, ni l'amendement du repentir, de toute nécessité ! ils doivent, eux aussi, avoir la place qui est en rapport avec leur conduite.
[15] Or l'endroit qui convient à l'or altéré est le fourneau du raffineur, pour qu'une fois fondu le vice qui s'était mélangé à ces pécheurs, leur nature, au bout de longs siècles, soit rendue à Dieu pure et intacte. Puisque le feu et l'eau possèdent la propriété de nettoyer, ceux qui ont effacé la souillure de leur vice dans l'eau du sacrement n'ont pas besoin de l'autre forme de purification; ceux-là, au contraire, qui n'ont pas été initiés à cette purification doivent nécessairement être purifiés par le feu.
XXXVI. La raison universelle et renseignement des écritures montrent en effet que l’on ne peut entrer dans le chœur divin sans avoir été entièrement lavé des souillures du vice. Cette condition, bien petite par elle-même, devient pourtant le principe et le fondement de grands biens. Je dis qu'elle est petite, étant donné la facilité avec laquelle s'obtient cet heureux résultat. Quelle peine a-t-on à croire que Dieu est partout, qu'étant en tout il assiste aussi ceux qui invoquent sa puissance vivifiante, et qu'étant présent il fait ce qui convient à son caractère ? [2] Or le propre de l'activité divine, c'est d'opérer le salut de ceux qui en ont besoin. Ce salut se réalise par la purification effectuée dans l'eau. Celui qui a été purifié participera à l'état de pureté, et la pureté véritable c'est la nature divine. Vous voyez combien la chose est simple en son principe, et facile à réaliser : de la foi et de l'eau, l'une laissée à la disposition de notre volonté, et l'autre étroitement associée à la vie humaine. Mais le bien auquel ces conditions donnent naissance a une étendue et une qualité qui l'unissent étroitement à la divinité elle-même.
XXXVII. Mais puisque l'être humain est double, formé par le mélange d'une âme et d'un corps, les hommes en voie de salut doivent nécessairement prendre contact par l'un et par l'autre avec le guide qui les conduit vers la vie. L'unie une fois mêlée à lui par la foi y trouve le point de départ de son salut ; en effet l'union avec la vie implique la participation à la vie ; mais le corps a une autre façon de jouir du Sauveur et de se mêler à lui. [2] Ceux à qui on a fait absorber insidieusement du poison, en amortissent par une autre drogue l'influence pernicieuse, mais l'antidote doit pénétrer, comme le poison, dans les organes vitaux de l'homme, pour que l'effet du remède, en passant par eux se distribue dans le corps tout entier; de même, après avoir goûté à ce qui dissout notre nature, nous avions nécessairement besoin de ce qui en réunit les éléments séparés, pour que ce remède, pénétrant en nous, chassât par son effet contraire l'influence funeste du poison déjà introduit dans notre corps.
[3] Quel est donc ce remède? C'est précisément ce corps glorieux qui s'est montré plus fort que la mort et qui est devenu pour nous la source de la vie. Comme un peu de levain, selon la parole de l'Apôtre, s'assimile toute la pâte, ainsi le corps élevé par Dieu à l'immortalité, une fois introduit dans le nôtre, le change et le transforme tout entier en sa propre substance. De même en effet que la présence d'une drogue pernicieuse mêlée à un corps bien portant réduit à l'impuissance tout ce qui a subi le mélange, de même aussi le corps immortel, par sa présence dans celui qui l'a reçu, transforme en sa propre nature jusqu'à l'ensemble de l'organisme.
[4] Mais pour pénétrer dans le corps, il n'y a pas d'autre moyen que de se mêler, par la voie de la nourriture et de la boisson, aux organes de la vie. Le corps est donc dans la nécessité de recevoir par le procédé permis à la nature, la puissance qui vivifie. Or le corps en qui s'est incarné Dieu est le seul qui ait reçu cette grâce ; d'autre part, on a montré que notre corps ne pouvait être admis à l'immortalité, si son étroite union avec l'être immortel ne le faisait participer à l'incorruptibilité. Il convient donc d'examiner comment ce seul corps, en se partageant indéfiniment sur toute la surface de la terre, entre tant de milliers de fidèles, a pu se donner tout entier à chacun dans la parcelle reçue et se conserver lui-même entier.
[5] Pour que notre foi, considérant la suite rigoureuse de la doctrine, n'éprouve aucune hésitation devant le sujet proposé à notre réflexion, il est bon de nous arrêter un instant aux lois de la nature du corps. Qui ne sait en effet que notre nature physique, prise en soi, ne fonde pas son existence sur une substance propre, mais se maintient et subsiste grâce à la force qui afflue en elle, attirant par un mouvement incessant ce qui lui manque, et rejetant ce qui est inutile ? [6] Supposons une outre pleine de liquide ; si son contenu s'échappait par le fond, elle ne conserverait pas sa forme renflée, à moins qu'un autre liquide n'y pénétrât par le haut pour combler le vide qui se produit; on se rend compte ainsi, devant le pourtour volumineux du récipient, qu'il n'appartient pas en propre à l'objet qu'on voit, mais que c'est l'afflux du liquide qui, à l'intérieur du récipient, moule les contours du volume. De même, nous ne voyons pas que la structure de notre corps ait en propre aucun moyen de se maintenir : c'est la force qu'on y introduit qui assure sa permanence.
[7] Cette force est la nourriture, et elle en porte le nom. Elle n'est pas la même pour tous les corps qui se nourrissent, mais chacun a sa nourriture appropriée qui lui a été assignée par l'organisateur de la nature. Certains animaux se nourrissent de racines qu'ils déterrent, d'autres vivent d'herbes, quelques-uns de chair; quant à l'homme, il se nourrit principalement de pain. Pour entretenir en nous et conserver l'élément humide, nous avons pour boisson non seulement de l'eau pure, mais souvent de l'eau adoucie avec du vin, afin d'accroître notre chaleur interne. Quand on considère ces éléments, on considère donc ce qui est, en puissance, le volume de notre corps ; une fois en moi, ils deviennent en effet mon sang et mon corps, en vertu de la faculté d'assimilation qui, de part et d'autre, fait prendre à la nourriture la forme du corps.
[8] Ces points ayant été ainsi bien établis par nous, nous devons ramener notre pensée au sujet qui nous occupe. On recherchait en effet comment le seul corps du Christ peut vivifier entièrement la nature des hommes qui possèdent la foi, en se partageant entre tous sans s'amoindrir lui-même. Peut-être touchons-nous donc à l'explication vraisemblable du fait. Admettons en effet les points suivants : tout corps tire sa substance de la nourriture, et cette nourriture consiste en aliment solide et en boisson ; le pain fait partie des aliments solides, tandis que l'eau adoucie à l'aide du vin se range dans la boisson ; d'autre part, le Verbe de Dieu, à la fois Dieu et Verbe, comme on l'a établi au début, s'est mélangé à la nature humaine, et une fois dans, notre corps, sans imaginer pour la nature une nouvelle manière d'être, a fourni à ce corps le moyen de subsister par les procédés habituels et appropriés : il maintenait sa substance à l'aide d'aliment solide et de boisson, et cet aliment solide était le pain. [9] Dans ces conditions, de même que pour nous, comme on l'a déjà dit bien des fois, quand on voit le pain, on voit en un sens le corps humain, puisque le pain pénétrant dans le corps devient le corps lui-même, de même ici, le corps en qui Dieu s'était incarné, puisqu'il se nourrissait de pain, était en un sens identique au pain, la nourriture, comme on l'a dit, se transformant pour prendre la nature du corps. On a reconnu en effet à cette chair glorieuse la propriété commune à tous les hommes : ce corps, lui aussi, se maintenait à l'aide du pain. Mais ce corps, devenu le séjour de Dieu, avait été transformé par sa présence et élevé à la dignité divine. Nous avons donc maintenant raison de croire que le pain sanctifié par le Verbe de Dieu se transforme pour devenir le corps de Dieu le Verbe.
[10] Et en effet ce corps était du pain en puissance, et il a été sanctifié par la présence du Verbe qui a résidé dans la chair. Le changement qui a élevé à la puissance divine le pain transformé dans ce corps, amène donc ici encore un résultat équivalent. Dans le premier cas en effet, la grâce du Verbe sanctifiait le corps qui tirait du pain sa substance, et qui en un sens était lui-même du pain; de même ici le pain, suivant la parole de l'Apôtre, est sanctifié par le Verbe de Dieu et par la prière; mais ce n'est pas par la voie de l'aliment qu'il arrive à être le corps du Verbe ; il se ; transforme aussitôt en son corps, par la vertu du Verbe, comme il a été dit dans cette parole : « Ceci est mon corps ».
[11] Mais toute chair a besoin aussi de l'élément humide pour se nourrir, car sans ce double concours, ce qu'il y a on nous de terrestre ne pourrait rester en vie ; de même donc que nous soutenons la partie solide de notre corps par une nourriture consistante et solide, de même nous fournissons à l'humidité un supplément tiré de l'élément qui a la même nature ; une fois en nous, il se change en sang par notre faculté d'assimilation, surtout si par son mélange avec le vin il acquiert le pouvoir de se transformer en chaleur.
[12] Or la chair glorieuse habitée par Dieu a accepté aussi cet élément en vue de sa subsistance, et le Dieu qui s'est révélé s'est mélangé à la nature périssable afin de déifier l'humanité avec lui en l'admettant au partage de la divinité; voilà pourquoi il se distribue comme une semence à tous les croyants, suivant le plan de la grâce, au moyen de cette chair composée de vin et de pain, et il se mêle au corps des croyants, pour que cette union avec le corps immortel permette à l'homme de participer lui aussi à l'incorruptibilité. Tel est le bienfait qu'il accorde en transformant, par la vertu de la consécration, la nature des apparences en ce corps immortel.
XXXVIII. Il ne manque, je crois, à notre exposé aucune des questions qui intéressent la religion, si ce n'est la théorie de la foi. Nous l'exposerons également, en quelques mots, dans le présent traité. Ceux; qui cherchent un exposé plus complet le trouveront dans d'autres travaux, où nous avons déjà expliqué minutieusement la doctrine avec tout le soin dont nous sommes capables, et où, en soutenant des controverses contre les adversaires, nous avons aussi examiné en elles-mêmes les questions qui nous ont été proposées. [2] Dans le présent traité, nous avons cru bien faire en nous bornant à ce que dit l'Evangile : celui qui est engendré suivant la régénération spirituelle sait de qui il est fils, et quelle est sa nature ; seule, en effet, cette forme de génération a le pouvoir de choisir ce qu'elle veut être, et d'être ce qu'elle choisit.
XXXIX. Les autres êtres qui naissent doivent en effet l'existence à l'impulsion de leurs parents, tandis que la naissance spirituelle dépend de la volonté de celui qui naît. Mais dans ce dernier cas, le danger est de se tromper sur son intérêt, puisque chacun est libre dans son choix ; il est donc bon, je le dis, que celui qui veut être l'auteur de sa propre naissance, connaisse d'avance par le raisonnement qui il lui sera avantageux d'avoir pour père, et de qui il vaudra mieux pour lui tenir sa nature ; on a dit en effet que cette sorte de naissance choisit librement ses parents.
[2] Or comme le monde est divisé en deux parts, l'élément créé et l'élément incréé, et que la nature incréée possède en soi la stabilité et l'immutabilité, tandis que la création est sujette à l'altération et au changement, celui qui choisit avec réflexion le parti avantageux, de qui préfèrera-t-il être le fils, de la nature que l’on voit en proie au changement, ou de l'élément qui possède une nature immuable et ferme dans le bien, et toujours semblable à elle-même ?
[3] L'Evangile fait connaître les trois personnes et les trois noms par lesquels s'opère la naissance chez les croyants : celui qui est engendré dans la Trinité est également engendré par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit, car l'Evangile dit de l'Esprit : ce qui est né de l'Esprit est Esprit, et : Paul engendre dans le Christ, et : le Père est père de tous. Qu'ici donc la raison de l'auditeur montre sa sagesse, et qu'elle n'aille pas se faire la fille de la nature toujours en proie au mouvement, quand elle peut prendre pour source de sa propre existence la nature stable et immuable.
[4] La vertu de l'acte accompli est en effet en rapport avec la disposition de l'âme qui s'approche du sacrement. Par suite, si elle reconnaît le caractère incréé de la sainte Trinité, elle entre dans la vie stable et immuable, tandis que si une conception erronée lui fait voir dans la Trinité la nature créée, et si elle reçoit dans cette idée le baptême, elle se trouve naître de nouveau à l'existence changeante et en proie à l'altération : car l'être engendré partage nécessairement la nature des parents.
[5] Qu'y aura-t-il donc de plus avantageux d'entrer dans la vie immuable, ou d'être de nouveau ballotté sur les flots d'une existence instable et changeante? Pour quiconque a la moindre parcelle déraison, la stabilité a beaucoup plus de prix que l'instabilité, la perfection que l'imperfection, ce qui est sans besoin que ce qui a des besoins, et l'être dont l'élévation se fait progressivement est inférieur en dignité à celui qui n'a pas de progrès à réaliser, et qui reste immuable dans la perfection. Un esprit sensé sera donc bien forcé, en tout cas, de choisir entre les deux partis : ou de croire que la sainte Trinité rentre dans la nature incréée, et ainsi de la prendre, dans la naissance spirituelle, pour source de sa propre vie, —ou bien, s'il regarde le Fils et le Saint-Esprit comme étrangers à la nature du Dieu qui a le premier rang, du Dieu véritable et bon, — je veux dire à la nature du Père, de ne pas adopter ces croyances au moment de sa naissance, s'il ne veut pas entrer à son insu dans la nature imparfaite, qui a besoin d'amélioration, et revenir en quelque sorte à son milieu naturel, en détachant sa foi de la nature supérieure.
[6] Se mettre en effet sous la dépendance de quelque objet créé, c'est placer, à son insu, l'espoir de son salut dans cet objet même, et non dans la divinité. Car dans la création, tout se tient étroitement, parce que tout passe au même degré du néant à l'être. Et de même que dans la structure des corps, une étroite affinité unit entre eux tous les membres, que les uns se trouvent à la partie supérieure, et les autres à la partie inférieure du corps, de même la nature créée ne fait qu'un dans le plan de la création, et la différence qui sépare en nous l'élément supérieur de l'élément inférieur n'introduit aucune désunion dans sa cohésion interne. Les choses qui ont été d'abord conçues comme également dépourvues d'existence, même si elles diffèrent sur d'autres points, ne nous découvrent sur celui-là aucune différence de nature.
[7] Si donc l'homme est créé, et s'il regarde aussi ! comme des créatures l'Esprit et Dieu le Fils unique, il serait insensé d'espérer un changement qui l'amènerait à la vie supérieure, alors qu'il revient à lui-même. Ce qui lui arrive est semblable aux idées que se faisait Nicodème. Apprenant du Seigneur qu'il faut naître d'en haut, et ne comprenant pas le sens de la révélation, il se trouvait ramené par ses raisonnements au sein maternel. De sorte que s'il se dirige, non vers la nature incréée, mais vers la création qui partage son origine et sa servitude, il appartient à la naissance qui vient d'en bas, et non à celle qui vient d'en haut. Or l'Evangile dit que la naissance des créatures envoie de salut vient d'en haut.
XL. Mais l'enseignement catéchétique, s'il s'arrête à ce qui a été dit, ne me paraît pas suffisant. Il faut en effet, ce me semble, en considérer aussi la suite. Cette suite, beaucoup de ceux qui viennent chercher la grâce du baptême, la négligent ; ils s'égarent en se dupant eux-mêmes, et leur régénération n'a que l'apparence, sans la réalité. Car la transformation de notre vie opérée par la régénération ne peut être une transformation, si nous restons dans notre état présent. Celui qui vit dans les mêmes conditions, j'ignore comment on peut s'imaginer que la naissance ait fait de lui un autre homme, puisqu'il n'y a de changé en lui aucun de ses traits caractéristiques. Que la naissance salutaire que nous recevons ait en vue le renouvellement et la transformation de notre nature, cela est évident pour tout le monde. [2] Mais la nature humaine, prise en soi, ne relire du baptême aucun changement : ni la raison, ni l'intelligence, ni la faculté de savoir, ni aucune autre propriété caractéristique de la nature humaine ne subit de transformation. Sans doute en effet la transformation aurait lieu dans le sens du pire, si l'une de ces propriétés naturelles éprouvait un changement. Si donc la naissance venue d'en haut est une restauration de l'homme, et si ces propriétés n'admettent pas de changement, il faut examiner au prix de quelle transformation s'accomplit la grâce de la régénération.
[3] C'est évidemment quand sont détruits les caractères mauvais de notre nature que s'opère le changement qui nous améliore. Si donc, selon la parole du prophète, le bain dans l'eau du sacrement purifie les désirs de notre volonté, en effaçant les vices de l'âme, nous devenons meilleurs, et nous sommes transformés dans le sens du mieux. Mais si le bain est donné au corps sans que l'âme soit lavée des souillures causées par les passions, et si la vie qui suit l'initiation s'accorde par son caractère avec la vie dépourvue d'initiation, si hardie que soit cette parole, je veux la dire sans détours : dans ces cas-là, l'eau est de l'eau ; car le don du Saint-Esprit ne se manifeste nulle part dans l'acte accompli, toutes les fois que l'homme, non content d'insulter à l'image divine qui est en lui, par le vice affreux de la colère ou par la passion de la cupidité, par le désordre indécent de l'esprit, par les fumées de l'orgueil, par l'envie et par le dédain, persiste à garder les gains injustement réalisés, et que la femme acquise par lui au prix de l'adultère continue à servir à ses plaisirs.
[4] Si ces vices et d'autres du même genre se montrer après comme avant dans la vie de celui qui a reçu le baptême, je ne puis voir ce qu'il y a de changé, puisque j'ai sous les yeux le même homme qu'auparavant. La victime de l'injustice, la victime de la calomnie, l'homme dépouillé de ses biens, ne voient, en ce qui les concerne, aucun changement chez celui qu'a lavé l'eau du baptême. Ils ne lui ont pas entendu dire comme Zachée : « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce qu'ils disaient avant le baptême, aujourd'hui encore ils le rappellent tout au long sur son compte; ils l'appellent des mêmes noms: cupide, plein de convoitise pour le bien d'autrui, grassement entretenu par l'infortune des autres hommes. Celui qui reste dans le même état, et qui ensuite va parlant partout du baptême qui l'a amélioré en le transformant, qu'il écoute Paul disant : Si un homme s'imagine être quelque chose, en n'étant rien, il s'abuse lui-même. Car ce que vous n'êtes pas devenu, vous ne l'êtes pas.
[5] A tous ceux qui l'ont reçu, dit des hommes régénérés l'Evangile, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'enfant est absolument de même race que son père. Si donc vous avez reçu Dieu, et si vous êtes devenu l'enfant de Dieu, montrez par le choix de votre volonté le Dieu qui est en vous, montrez en vous-même celui qui vous a engendré. Les marques auxquelles nous connaissons Dieu doivent faire voir la parenté avec Dieu de celui qui est devenu fils de Dieu. Il ouvre sa main et rassasie tous les êtres de bonne volonté, il pardonne l'iniquité, et regrette le mal qu'il envoie ; le Seigneur est bon envers tous, il n'exerce pas sa colère chaque jour; Dieu est un maître droit, et il n'y a pas d'injustice en lui; et tous les traits du même genre dont nous instruit çà et là l'Ecriture. Si vous portez ces marques, vous êtes devenu vraiment l'enfant de Dieu. [6] Si vous persistez au contraire dans les caractères du vice, vous répéterez en vain que vous êtes né d'en haut. La voix du prophète vous dira : Tu es fils d'un homme, et non du Très-Haut. Tu aimes la vanité, tu recherches le mensonge. Tu ne sais comment l'homme est magnifié ; tu ignores qu'il ne peut l'être qu'en étant pieux.
[7] Il faudrait ajouter à ces enseignements ce qui nous reste à dire : c'est d'abord que les biens offerts dans les promesses divines à ceux qui auront bien vécu défient, par leur nature, la possibilité d'en donner un aperçu. Comment décrire en effet ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas ouï, ce qui n'est pas parvenu jusqu'à l'esprit de l'homme? La vie douloureuse des pécheurs ne peut, elle non plus, être comparée à rien de ce qui fait souffrir les sens ici-bas. Même ci l'on applique à quelqu'un des châtiments infligés dans l'au-delà les noms connus ici-bas, la différence reste immense. Par le mot : feu, vous avez appris à concevoir tout autre chose que le feu d'ici-bas, parce que celui-là possède une propriété que n'a pas celui-ci ; l'un en effet ne s'éteint pas, tandis que l'expérience a découvert bien des moyens d'éteindre l'autre, et la différence est grande entre le feu qui s'éteint et le feu inextinguible. C'est donc tout autre chose que le feu d'ici-bas.
[8] Qu'en entendant parler du ver, on ne se laisse pas entraîner non plus, par la similitude des noms, à songer, à cette bête qui vit sur la terre; le qualificatif d'éternel qui s'y ajoute nous fait concevoir en effet une nature différente de celle que nous connaissons. Puisque ce sont là les traitements qui nous attendent dans l'autre monde, et qu'ils sont, dans la vie, le résultat et l'épanouissement de la libre volonté de chacun selon l'équitable jugement de Dieu, les esprits sages doivent avoir en vue non pas le présent," mais l'avenir, jeter dans cette vie brève et passagère les fondements de l'ineffable félicité, et, en tournant leur volonté vers le bien, se garder de faire l'expérience du mal, aujourd'hui pendant la vie, plus tard au moment de la rémunération éternelle.
************************
Les lignes suivantes, qui manquent dans la plupart des mss. figurent à la suite du Discours catéchétique dans le manuscrit du British Museum et ont été reproduites dans les éditions de Paris. On les trouve dans l’édition de la Patrologie gréco-latine de Migne.
Le début de ce fragment est inintelligible. Il est probable que les premiers mots ont été omis.
Notre foi, dans les caractères qui distinguent le Christ, veut envisager deux natures, dont elle confesse l'union substantielle; et par là elle met en lumière la grandeur de la pitié et de la compassion qui ont fait accepter à Dieu, dans son amour pour nous, de voir notre nature s'unir à la sienne et être comptée avec elle. Grâces soient rendues à Dieu pour son ineffable bienfait! Mais en voilà assez. Pourtant, puisque Sévère ne s'attache qu'à des mots, et ne fait résider la piété que dans des paroles et dans des sons, malgré cette déclaration de l'Apôtre: Ce n'est pas dans le langage que consiste le royaume de Dieu, mais dans la puissance et dans la vérité; puisqu'aux yeux de Sévère, le meilleur théologien est celui qui est versé dans les catégories d'Aristote, et dans les autres subtilités de la philosophie païenne, nous nous voyons obligés d'éclaircir mot par mot, au moment voulu, la signification des textes utilisés dans notre réponse à Sévère, suivant le sens où les ont pris les docteurs de l'Eglise. Nous voulons que les lecteurs, en présence des textes, puissent au premier coup d'œil en saisir le sens, sans être empêchés, faute de connaître la signification des termes, de pénétrer le sens des conceptions qui y sont enfermées.