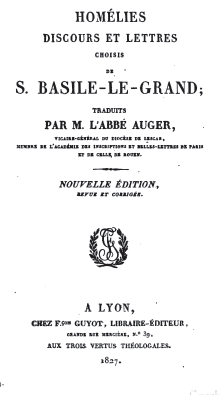
BASILE LE GRAND (SAINT)
DISCOURS ADRESSÉ AUX JEUNES GENS, SUR L’UTILITÉ QU'ILS PEUVENT RETIRER DE LA LECTURE DES LIVRES PROFANES.
Traduction française : l'Abbé AUGER.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
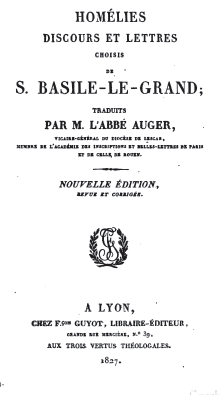
Traduction française : l'Abbé AUGER.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
HOMÉLIES
DISCOURS ET LETTRES
CHOISIS
S. BASILE-LE-GRAND;
TRADUITS
PAR M. L'ABBÉ AUGER,
VICAIRE-GENERAL DU DIOCESE DE LESCAR,
MEMBRE DE L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES DE PARIS
ET DE CELLE, DE ROUEN.
NOUVELLE ÉDITION
REVUE ET CORRIGÉS*
A LYON,
CHEZ F.çois GUYOT, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
GRANDS RUE MERCIÈRE, N.° 39,
AUX TROIS VERTUS THÉOLOGALES.
1827
Les Eglises d'Orient et d'Occident, dans le quatrième siècle, ont produit une foule de grands hommes capables d'honorer, par l'étendue de leur génie, par leurs talents et par leurs vertus, non seulement l'Eglise, mais encore leur siècle et l'humanité toute entière. Athanase, Chrysostôme, Grégoire de Nazianze, Augustin, Jérôme, Ambroise, et beaucoup d'autres encore, malgré leur humilité sincère, ont jeté un éclat qui a effacé, sans contredit, les plus habiles rhéteurs et philosophes de leur temps, et les a placés presque à côté des plus célèbres écrivains de l'antiquité. Basile n'est pas un des moins distingués de ces illustres personnages: des connaissances variées, un sens profond, une diction brillante à la fois et solide, une dialectique vive et triomphante, une vertu austère et rigide, que tempérait une gaîté décente et douce, une âme forte et active, qui, se rendant maîtresse d'un corps languissant et faible, portait ses regards hors de la sphère qu'elle était chargée de mettre en mouvement, s’occupait des intérêts de toute l'Eglise, de chaque Eglise en particulier, de chacun des fidèles, de chacun de ses amis ; en un mot, une grande science, un grand caractère, de grandes vertus, de grands talents, ont mérité à Basile le surnom de Grand parmi les hommes de son siècle, et lui ont assuré ce titre dans les générations suivantes.
Grégoire de Nazianze, cet ami tendre et ardent, l’a loué avec toute la chaleur de l'amitié et du génie. Parmi des beautés d'un ordre supérieur, son panégyrique offre quelquefois des détails beaucoup trop longs et qui ne pourraient plaire dans notre langue. C'est ce qui m'a empêché de le traduire en entier. J'en suivrai la marche, d'autant plus que l'orateur suit le grand homme qu'il célèbre, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. J'en détacherai les morceaux qui me sembleront les plus frappants, les plus propres à embellir ce discours préliminaire, que je terminerai par quelques réflexions sur l'éloquence de saint Basile, sur les traducteurs des ouvrages de ce Père, et sur la nouvelle traduction que j'offre, maintenant au public. Puisse ce nouveau fruit de mes veilles être aussi agréable aux amateurs de la savante et riche antiquité, qu'utile aux jeunes ecclésiastiques qui voudront puiser l'éloquence sacrée dans les sources !
La famille de saint Basile était ancienne, noble et illustrée. Ses ancêtres paternels et maternels étaient distingués, non seulement par leur naissance, par leurs richesses, par les honneurs et les places qu'ils avaient obtenus, mais encore par des talents rares qui relevaient ces places et ces honneurs, par des vertus peu communes qui les faisaient estimer et chérir autant qu'ils étaient honorés et admirés, et surtout par une piété héroïque qui leur fit prendre le parti, pendant la persécution de Maximin, de quitter leur ville avec un petit nombre de serviteurs, pour aller s'enfoncer dans les forêts du Pont, où ils vécurent misérablement pendant sept années. Le père et la mère de notre saint évêque avaient des biens dans l'Arménie, dans la Cappadoce et dans le Pont ; ce qui lui faisait regarder, pour ainsi dire, ces trois provinces comme ses trois patries. L'opinion la plus commune le fait naître à Césarée en Cappadoce, vers l'an 328, de Basile qui était du Pont, et d'Emmélie qui était de Cappadoce. Basile et Emmélie eurent dix enfants, fils et filles, qui tous dix firent le bonheur et la joie de leurs parents par les plus excellentes qualités de l'esprit et du cœur. Le plus célèbre fut sans doute, le grand Basile. Son père jouissait d'une réputation aussi brillante que bien fondée: il surpassait en mérite tous ses contemporains; et, pour me servir des paroles de saint Grégoire, son fils seul empêcha qu'il ne fût le premier des hommes. Il se chargea lui-même d'instruire la première jeunesse de ce fils précieux qui manqua de lui être enlevé par une maladie violente. Le jeune Basile saisit avidement les principes des sciences et des lettres, dans une maison où il trouvait à la fois des instructions utiles et des exemples d'une piété sublime.
Ce fut dans le Pont qu'il fit ses premières études sous un père habile. Il savait déjà beaucoup, mais plus il savait, plus il était avide d'apprendre. Cette curiosité inquiète, indice non équivoque d'un vrai génie, lui fit désirer de se transporter dans une ville où il trouvât, sinon de plus savants maîtres, du moins des motifs d'émulation avec des condisciples de son âge, et un théâtre plus étendu où ses talents pussent avoir plus d'exercice. Césarée, ville fameuse, où il avait reçu la naissance, lui offrait ces avantages; il y vole avec l'agrément de son père, et, après y avoir séjour né quelque temps, il passe à Constantinople, qui était alors le centre de l'empire, s'imaginant qu'il trouverait de plus grandes ressources encore qu'à Césarée. Ce fut là probablement qu'il forma, une liaison étroite avec Libanius, rhéteur fort connu, dont il fut le disciple ou l'émule. Ce qu'il y a de certain, c'est que Libanius fut toujours l'admirateur de saint Basile, et que, quoique d'une religion différente (il resta toute sa vie attaché au paganisme), il n'estimait pas moins ses vertus sévères qu'il admirait ses talents distingués.
Dans la Grèce existait une ville, dont le nom est célèbre, qui y avait dominé autrefois, surtout par ses forces navales, par son activité et par son courage. Cette domination n’avait pas été de longue durée, elle était tombée entièrement ; mais elle avait été remplacée par un empire plus flatteur peut-être, l'empire de l'esprit et des lumières, qui durait depuis près de huit siècles. Du temps de Cicéron, des hommes riches envoyaient déjà leurs enfants à Athènes pour y puiser le goût, de la saine philosophie et de la bonne littérature. Au temps dont nous parlons, on les y envoyait encore, et pour le même sujet. Basile qui aurait pu sans orgueil se compter parmi les maîtres, qui était en état de donner des leçons aux autres, voulut visiter cette ville, le séjour des lettres et des sciences, le centre du goût et de la politesse, se mettre de nouveau sous la discipline des rhéteurs et des philosophes, comme pour perfectionner et achever son éducation. L'esprit orné des plus belles connaissances dans tous les genres, ayant étudié particulièrement l'art d'expliquer ses pensées avec non moins de clarté que de force, il était déjà connu à Athènes, et sa réputation avait précédé son arrivée dans cette ville savante.
Ecoutons ici saint Grégoire de Nazianze, ou du moins le fond de ses idées. Athènes, dit-il, me sera toujours singulièrement précieuse à cause du bien inestimable qu'elle m'a procuré. Elle m'a fait connaître ce grand homme qui ne m'était pas entièrement inconnu. En cherchant la science, j'ai trouvé le véritable bonheur, à peu près comme Saül qui trouva un royaume en cherchant les ânesses de son père. Nous vivions à Athènes, ajoute-t-il, où le désir de nous instruire et la volonté de Dieu nous avaient réunis au sortir de la même patrie. Je m'y étais rendu quelque temps avant Basile; il m'y suivit de bien près : on l'y attendait avec impatience, et tout le monde avait un extrême désir de s'en emparer d'abord. Les jeunes disciples, athéniens et autres, de toutes les conditions, ont un amour insensé pour les sophistes, c'est une manie qui va jusqu'à la fureur et qu'il est impossible de réprimer. Lorsqu'ils se sont choisi un maître, ils font tout ce qu'ils peuvent pour grossir le nombre de ses disciples et pour l'enrichir par leurs soins. Cet empressement a je ne sais quoi de ridicule et tient de la folie. Ils se saisissent de toutes les avenues, des ports, des hauteurs, des campagnes, des solitudes, de toutes les parties de l'Attique et de la Grèce ; et lorsqu'un jeune homme approche d'Athènes, étant tombé-entre leurs mains (car il faut qu'il se rende de gré ou de force), ils livrent cette proie à leur sophiste qui leur en tient un grand compte : c'est une espèce de rétribution pour les soins qu'il prend de les instruire. Voici la réception qu'ils lui font essuyer. On le conduit en grande pompe au bain par la place publique. Ceux qui sont chargés de le conduire, marchent les premiers deux à deux, éloignés les uns des autres à distances égales- Quand ceux qui précèdent sont près d'arriver, comme s'ils étaient surpris tout à coup de quelque fureur subite, ils poussent un grand cri en sautant. C'est un signal pour arrêter ceux qui suivent, comme si le bain ne voulait pas s'ouvrir. Ils frappent violemment sur les portes pour intimider le nouveau venu par cette cérémonie. Enfin, après qu'on lui a permis l'entrée du bain, ils le mettent en liberté, et quand il est sorti, ils l'admettent en leur compagnie, et le regardent comme un de leurs condisciples. Je connaissais déjà en partie la gravité des mœurs de Basile, j’avais pour lui une grande vénération; je tâchai d'inspirer les mêmes sentiments à ceux qui le connaissaient moins. Il fut le seul des jeunes gens qui venaient étudier à Athènes, qu'on dispensa d'une réception bruyante et désagréable.
Ce fut-là le commencement de notre amitié, c'est la première étincelle de ce feu qui s'alluma dans nos cœurs, c'est ainsi que nous fûmes, pour ainsi dire, blessés des traits d'un amour réciproque. Ce service et d'autres que je lui rendis encore, les témoignages que nous nous donnâmes mutuellement, resserrèrent de plus en plus notre union, et nous attachèrent inséparablement l'un à l'autre. Nous nous découvrîmes avec le temps nos pensées, et le désir que nous avions de nous livrer à une philosophie sainte. La maison, la table, les penchants, les vues, tout était commun ; et le commerce que nous avions ensemble nous fortifiait chaque jour dans nos premières résolutions. Comment peindre les douceurs et les charmes de notre amitié chrétienne et vertueuse, de cette amitié pure que Dieu avouait? puis-je m'en rappeler le souvenir sans verser des larmes? Nous avions la même émulation pour les sciences, sans que la jalousie pût jamais trouver accès dans nos cœurs. Nous ne disputions pas à qui l'emporterait, mais à qui céderait, persuadés que tous nos avantages n'étaient pas plus à l'un qu'à l'autre : il semblait que nous n'eussions qu'une âme en deux corps. Nous n'avions qu'un désir et qu'une affaire, nous n'étions touchés que de la vertu et des espérances de l'avenir ; nous ne songions qu'à nous détacher du monde avant que la mort nous en séparât. Nous réglions sur ce plan notre vie et toutes nos actions, nous conformant aux préceptes de la loi divine, et nous animant l'un l'autre à la pratique du bien. Si je ne craignais qu'on ne me soupçonnât de quelque vanité, je dirais que nous nous servions mutuellement de règle, pour discerner le bien d'avec le mal. Nous n'avions de liaison qu'avec des gens modestes et pacifiques, les insolents et les opiniâtres étaient bannis de notre commerce : nous ne recherchions que les personnes dont la société pût nous être profitable, dans la persuasion qu'il est bien plus facile de se laisser entraîner au vice que d'attirer à la vertu, comme il est plus aisé de gagner la maladie des autres que de leur rendre la santé. Nous ne connaissions que deux chemins ; l'un nous menait à l'église pour y entendre les interprètes de la loi divine, l'autre nous conduisait chez nos maîtres. Nous renonçâmes de bon cœur aux fêtes, aux spectacles, aux assemblées, aux banquets. Athènes est un séjour d'autant plus pernicieux aux âmes, que les richesses de la Grèce y affluent de toutes parts : l'exemple de tant de gens qui courent après cette idole peut facilement séduire. Mais ce qui pouvait nous perdre ne servit qu'à nous confirmer dans la foi : nous reconnûmes l'imposture de ces biens périssables ; et ce qui attirait tant d'adorateurs aux démons ne nous donna pour eux que du mépris. Si l'on croit qu'il y a un fleuve[1] dont les eaux conservent leur douceur en coulant à travers la mer, ou qu'il est un animal[2] qui vit dans le feu sans s'y consumer : voilà ce que nous étions au milieu de nos condisciples. Nous avions toujours autour de nous une foule des plus illustres, qui suivaient Basile, qui l'écoutaient comme leur maître, le prenaient en tout pour leur règle. Notre réputation s'était répandue dans toute la Grèce, et au-delà. Nos maîtres étaient aussi célèbres qu'Athènes était fameuse ; nous étions aussi connus que nos maîtres, et tous ceux qui parlaient d'eux, parlaient de nous comme de deux hommes admirables, comme de deux parfaits amis. Les noms de Pylade et d'Oreste n’étaient pas plus révérés chez les Grecs. Basile contribuait à ma gloire autant qu'à ma perfection.
Eh! a-t-on jamais vu (c'est toujours saint Grégoire qui parle et qui s'étend avec complaisance sur les louanges de son ami), a-t-on jamais vu un homme plus prudent et plus sage même avant le temps? Les jeunes gens et les vieillards le respectaient, ils le mettaient au-dessus des plus fameux personnages de notre siècle et des siècles passés. Qui jamais eut moins besoin de s'instruire pour régler ses mœurs? qui jamais joignit de si bonnes mœurs à tant de doctrine? Est-il quelque genre d'érudition où il n'ait eu la supériorité, comme s'il ne se fût pas appliqué à autre chose, possédant toutes les sciences en général avec plus d'étendue que les autres ne connaissent quelque objet particulier? Quoique doué d'un esprit vif et pénétrant, il étudiait avec une application extrême ; de sorte que le travail et l'étude auraient suppléé en lui au défaut de génie. Jamais éloquence n'a été plus vive et plus animée que la sienne. Nul n'a été plus versé dans toutes les finesses de la grammaire, de cet art qui apprend la langue, qui s'occupe de l’histoire, et de la poésie dont elle donne les règles. Nul n'a plus excellé dans une philosophie parfaite, dans cette science sublime, soit qu'on la regarde du côté de l'action et de la spéculation, ou du côté de la dialectique, c'est-à-dire, du raisonnement et des preuves. Ceux qui disputaient contre lui se seraient plutôt tirés des labyrinthes de la fable que de rembarras où il les jetait par la force de ses raisons. Il apprit l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique; mais il se contenta d'en savoir autant qu'il en fallait pour se garantir des attaques de ceux qui se piquaient de ces sortes de connaissances. Ses maladies et les remèdes qu'il employa lui apprirent la médecine, cette science qui en suppose tant d'autres, et dont il prit ce qu'elle a de plus noble et de plus relevé. Mais il était surtout profond dans la morale, dont il avait fait une étude particulière. En un mot, il ressemblait en quelque sorte à un vaisseau plein de marchandises rares et diverses ; il savait tout ce qu'on peut naturellement savoir.
Les maîtres de Basile lui étaient aussi fortement attachés que ses condisciples ; mais en vain les uns et les autres firent les plus grands efforts pour le retenir à Athènes qu'il avait résolue de quitter: ils furent obligés de céder à ses raisons pressantes. Il abandonna donc une ville où il laissait un ami tendre qui ne tarda pas à le rejoindre. Que cette séparation fut cruelle ! dit saint Grégoire ; il nous semblait qu'on divisait nos corps en deux parties et que nous étions près d'expirer: deux taureaux qui ont été nourris ensemble, et qui ont toujours tiré la même charrue, ne poussent pas des mugissements plus lugubres quand on les sépare.
…………………………
L'empereur Valens, partisan furieux de l'arianisme, voulait l'introduire dans toutes les Eglises. Il croyait pouvoir réussir sans peine dans celle de Césarée, qui manquait d'un chef et d'un défenseur habile. Basile apprend cette nouvelle ; aussitôt faisant avec générosité le sacrifice de tous ses ressentiments, oubliant les anciennes querelles, il accourt à Césarée. Par sa prudence et par ses égards il regagne l'amitié et la confiance de son évêque, qui sentait d'ailleurs combien un tel homme lui était nécessaire dans la circonstance. Il anime les forts, fortifie les faibles, remplit tout le monde de son esprit et de son courage; enfin, grâce à ce défenseur aussi éclairé qu'intrépide l’Eglise de Césarée présente de toutes parts un front si redoutable qu'on n'ose pas même l'attaquer, Quoique simple prêtre, il continue de la gouverner sous Eusèbe; et, si le prélat conduisait le peuple, il servait de guide au prélat même.
Il s'offrit une occasion qui montra dans tout son jour sa fermeté courageuse et son zèle charitable. La ville fut affligée et désolée par une famine cruelle. Personne ne se mettait en devoir de la secourir. Les pauvres souffraient de la faim, plusieurs même étaient sur. le point de périr misérablement ; les riches avares, loin d'ouvrir leurs cœurs à la compassion, enfermaient leur blé afin de le vendre avec plus d'avantage; ils prétendaient trafiquer des misères d'autrui; les calamités-publiques étaient pour eux comme une moisson et une récolte,: Basile pourvoit à tout, imagine et exécute; par ses exhortations véhémentes, il confond la dureté des âmes: cupides, fait ouvrir les greniers ; il console les pauvres et les nourrit, il fait préparer des aliments et les leur sert lui-même. Pauvre volontaire, ayant abandonné tous ses biens comme un fardeau incommode, la confiance générale lui remet entre les mains des fonds immenses dont il dispose en faveur des malheureux.
Eusèbe meurt : Basile avait gouverné sous lui l'Eglise de Césarée ; il la gouvernera encore avec le titre d'évêque. Il est élevé à l'épiscopat auquel l'appelaient les vœux de tout le peuple, sans aucun désir de sa part, surtout par les démarches et les sollicitations du père de son ami, qui fit taire l'intrigue pour qu'on n'écoutât que la voix des talents, des vertus et des services. Ordinairement ceux qui désirent les places, montrent beaucoup d'activité avant que d'y parvenir, mais laissent ralentir leur zèle dès qu'ils ont obtenu l'objet de leurs vœux» Basile, qui n’avait point désiré la dignité épiscopale, ne la regarda que comme une grande carrière où il devait courir avec plus d'ardeur, que comme un vaste théâtre où sa vertu devait se développer et paraître avec plus d'éclat. Il étendit ses soins sur tous ceux qu'il était chargé de conduire ; il cherchait à les gagner tous et à les soumettre par une conduite également douce et ferme. Trop de douceur et de mollesse languit et manque son effet; trop de rigueur et d'austérité choque et rebute : pour éviter ces deux extrêmes, il tempéra sagement ce qu'il y avait peut-être de trop austère dans ses manières, avec une complaisance qui était soutenue d'une grande fermeté. Son exemple et ses actions faisaient plus que ses paroles ; sans avoir recours aux ruses et aux artifices, il se rendait maître des esprits par de sincères témoignages d'amitié et de bienveillance ; il aimait mieux user d’indulgence que de se servir de toute son autorité.
Une grande Eglise dont les affaires auraient surchargé l'esprit d'un autre, n’était pas un champ assez étendu pour le zèle de Basile ; ce grand homme, quoique modéré dans ses désirs, ne connaissait aucunes bornes quand il s'agissait de ne pas laisser diminuer et affaiblir le royaume de Jésus-Christ : son courage embrassait le monde entier, ou du moins toutes les parties de l'univers où avait pénétré la doctrine de l’Evangile. Il voyait avec douleur l'héritage de Dieu, cette portion que Jésus-Christ avait acquise par ses lois et par ses souffrances, cette race choisie, ce sacerdoce royal, cette nation sainte, dans un état si déplorable, divisée par tant d'erreurs et de sectes différentes. Il méditait donc les Ecritures, il s'en remplissait pour abattre l'orgueil et l’audace des hérétiques, pour les confondre par écrit ou de vive voix. Il écrivait aux évêques de l'Orient et de l'Occident, les animait ou les éclairait selon la circonstance. Ses écrits et ses discours enseignaient à tout le monde la doctrine de la vérité et le chemin du salut. Il se servait également de l’action et de la parole ; il allait trouver les uns, envoyait vers les autres, ou les faisait venir chez lui : avis, remontrances, reproches, exhortations, il employait à propos ces divers moyens ; il combattait pour les nations entières, pour les villes, pour les particuliers, se servant de tous les remèdes les plus propres aux maux qu'il voulait guérir.
Qu'il est beau de voir cet homme d'une constitution si frêle, occupé des affaires de toute l'Eglise ! qu'il est beau encore de le voir aux prises avec toute la puissance de l'empereur et de, ses ministres, triompher de cette puissance avec une fermeté tranquille que rien ne pouvait étonner ni séduire ! Valens croyant qu'après avoir assujetti tant de nations à son empire, après avoir subjugué tous les peuples voisins, il était indigne de lui d'être vaincu par un seul homme et par une seule Eglise, entreprit de livrer à Basile de nouvelles attaques. Toujours obstiné dans l'arianisme, et voulant rendre toute l'Eglise arienne s'il était possible, il mettait en usage les exils, les proscriptions, les promesses et les menaces, les caresses bien ménagées et la force ouverte : il charge le préfet Modeste de réduire, par tous les moyens qu'il pourra, l’évêque de Césarée.
Fidèle exécuteur des volontés de son maître, le préfet mande à son palais Basile, qui entre, non pas comme s'il eût été cité en jugement, mais comme s'il fût venu à un festin. Eh bien ! Basile, lui dit Modeste d'un ton dur, quelle raison as-tu d'oser t'opposer à l'empereur, et de lui résister seul avec tant d'insolence et d'opiniâtreté? Que voulez-vous dire? lui répondit Basile ; en quoi montré-je de l'insolence? je ne vous comprends pas encore. C'est, reprit Modeste, que tu refuses d'embrasser la religion du prince, lorsque tous les autres se sont rendus. — Non, répliqua Basile, non, mon empereur ne peut vouloir que j'adore une créature, moi qui suis l'ouvrage de Dieu, et à qui on recommande de devenir semblable à Dieu. — Que penses-tu donc de nous? ceux qui te signifient les ordres du prince ne sont-ils donc rien? crois-tu qu'il ne te sera pas honorable de te ranger de notre parti, et de nous avoir pour compagnons? — Vous êtes des préfets illustres, j'en conviens, mais vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Ce serait beaucoup d’honneur pour moi de vous avoir pour compagnons, puisque vous êtes des créatures du très Haut ; mais je voudrais que vous fussiez semblables à ceux qui sont sous notre discipline. Ce n'est pas la dignité des personnes, c'est la foi qui fait honneur au christianisme. Ce discours irrita le préfet et redoubla son courroux ; il se leva de son siège, et parla au saint évêque d'un ton plus dur encore. Quoi ! lui dit-il, est-ce que tu ne redoutes pas mon pouvoir? — Pourquoi le redouterais-je? que m'arrivera-t-il? que me ferez-vous? — J'ai mille moyens de te nuire : un seul me suffirait. — Quels sont tous ces moyens? je vous prie de vous expliquer. — La confiscation des biens, l'exil, les tourments, la mort. — Imaginez d'autres menaces, car celles que vous venez d'exprimer ne me regardent nullement. — Comment cela? — Celui qui n'a rien ne peut craindre la proscription de ses biens. A moins peut-être que vous ne demandiez ces vêtements usés et quelques livres : voilà toute ma richesse. Je ne connais pas l'exil ; je ne suis attaché à aucun lieu ; je regarderai comme ma patrie toute contrée où l’on me jettera ; ou plutôt, je sais que toute la terre appartient à Dieu, et que j'y suis étranger et voyageur. Quant aux tourments, quelle prise auraient-ils sur un homme qui n'a plus de corps, qui pourrait à peine recevoir un premier coup ; ce coup est le seul qui soit en votre pouvoir. Enfin la mort me serait un bienfait insigne ; elle me réunirait plus tôt à Dieu pour lequel seul je vis, pour lequel je suis plus qu'à demi éteint, auquel je brûle depuis longtemps de me rejoindre. Le préfet fut frappé de ces paroles : Jusqu'à ce jour, dit-il, on ne m’avait pas encore parlé avec cette liberté. C'est peut-être, lui répondit Basile, que vous n'avez pas encore rencontré d'évêque ; car, en pareille circonstance, il vous aurait tenu le même langage. Oui, Modeste, nous sommes dans tout le reste complaisants et doux. Nous nous humilions plus que personne, ainsi que notre loi nous le prescrit ; nous ne nous élevons avec fierté, ni contre un prince puissant, ni même contre le dernier des hommes. Mais quand il s'agit des intérêts de Dieu, nous bravons tout, nous n'envisageons que lui. Le feu, le glaive, les bêtes féroces, les ongles de fer qui déchirent nos membres nous causent plus de plaisir que de terreur. Ainsi, outragez-nous, menacez-nous, faites tout ce que tous voudrez, usez de toute votre puissance, instruisez l'empereur de nos réponses, vous ne nous gagnerez jamais ; vous ne nous persuaderez jamais de souscrire à une doctrine impie, quand vous nous feriez des menaces encore plus cruelles. Modeste comprit par cet entretien qu'il était impossible d intimider Basile et de le vaincre. Il le traita depuis avec respect et avec une sorte de soumission ; on voit même par les lettres que lui écrivit dans la suite saint Basile qu'il devint son ami. Il représenta alors à Valens que l'évêque de Césarée ne céderait jamais aux menaces, qu'on ne pouvait l'accabler qu'à force ouverte. L'empereur, touché de la vertu de Basile (car on ne peut s'empêcher de respecter la vertu jusque dans ses ennemis) défendit qu'on lui fît aucune violence. C'est saint Grégoire de Nazianze qui nous a conservé l'entretien vraiment noble et sublime que je viens de rapporter.
Je prolongerais ce discours préliminaire outre mesure, si je voulais entrer dans tous les détails que nous offre son panégyrique, si j'entreprenais exposer l'espèce de réparation que Valens fit à Basile ; les prodiges de Dieu en faveur du saint évêque, lesquels empêchèrent l'empereur de le bannir suivant la résolution qu'on lui en avait fait prendre; toutes les occasions où ce grand homme témoigna le même courage et la même fermeté; ce qu'il eut à souffrir même de la part des catholiques qui lui reprochaient d'avoir molli dans la foi, parce qu'il avait usé, dans quelques occasions, dune sage condescendance: mais je ne puis résister au plaisir de citer une parole qu'il adressa, dans une entrevue avec le prince, à un des officiers de sa maison, parole qui fait connaître son tour d'esprit piquant et agréable. Saint Grégoire de Nazianze parle de l'entrevue et ne cite point la parole, qui sans doute ne lui a point paru assez grave pour un panégyrique : on la trouve dans l'historien Théodoret. A la suite de l'empereur était un officier de sa maison nommé Démosthène, qui voulant faire quelques reproches à saint Basile, fit une faute de langage ; saint Basile se tournant de son côté se contenta de lui dire : Un Démosthène ignorant ! puis il continua de parler au prince. Il lui parla, dit-on, d'une manière divine, au point que Valens, touché de ses excellents discours, commença à s'adoucir envers les catholiques.
Saint Basile, d'après le témoignage de son ami qui le connaissait bien, réunissait toutes les vertus, une frugalité rare, un grand amour de la pauvreté et de la chasteté, une âme douce à la fois et sévère, un caractère gai avec décence, une charité ardente et sans bornes. Il vivait comme s'il n'eût point eu de corps ; il renvoyait les excès et la gourmandise à ceux qui mènent une vie animale et terrestre. Méprisant tous les mets qui ne sont faits que pour flatter le goût, il ne mangeait précisément que ce qui était nécessaire pour s'empêcher de mourir. Il était pauvre sans orgueil et sans ambition ; il renonça de bon cœur à toutes les richesses qu'il possédait, afin d'être plus libre, et de se sauver plus facilement à travers les flots de cette vie, N'ayant que son corps et son vêtement, il mettait toute sa richesse à ne posséder rien, il mettait tout son luxe à se passer tout. Qui a jamais eu une plus haute estime de la virginité que Basile? qui jamais a plus gourmandé la chair, non seulement dans sa personne, mais encore par les règlements qu'il a faits pour les autres? N'est-ce pas lui qui a bâti tant de monastères pour les vierges, qui a inventé de si belles règles pour mortifier tous les sens, pour tenir tous les membres dans la dépendance? Amateur zélé de la vertu, ennemi déclaré du vice, autant il traitait avec indulgence ceux qui s'acquittaient de leur devoir, autant il s'armait de se» vérité contre ceux qui y manquaient Un souris de sa part était un éloge ; son silence était une réprimande qui allait fouiller dans la conscience des coupables et les punir de leurs fautes. Cet homme si austère et si rigide, était agréable dans le commerce de la vie. J'en puis parler sûrement, dit saint Grégoire de Nazianze, pour lavoir beaucoup pratiqué. Qui jamais fit un récit avec plus d'agrément, ou assaisonna de plus de délicatesse la plaisanterie? Pouvait-on reprendre avec plus de douceur? Ses réprimandes n'a voient rien de fier, son indulgence était sans faiblesse ; il avait trouvé, comme nous l'avons déjà dit, le juste tempérament, et un sage milieu entre les deux extrêmes.
Arrêtons-nous un peu sur sa charité ; voyons combien il aimait les pauvres, avec quel zèle il les soulageait et les servait. Cet homme si illustre par la gloire de ses ancêtres et par son mérite personnel, ne dédaignait pas de baiser les pauvres et les malades il les embrassait comme ses frères, non par vanité, il était fort éloigné de tout sentiment d'orgueil; mais il voulait par son exemple confondre la fausse délicatesse qui répugne à approcher de ceux que l'indigence oppresse ou qu'afflige la maladie. Simple pour lui-même, il n’était magnifique que pour Dieu et pour les pauvres. Sans parler de cette pompe auguste et majestueuse, dont l'empereur lui-même fut ébloui lorsqu'il entra dans l'église de Césarée le jour d'une grande fête, de cette pompe qui, selon l'expression de saint Grégoire, représentait les chœurs des anges, et qui annonçait combien l'humble pontife était jaloux dune sainte magnificence dans les cérémonies divines. Faisons quelques pas hors des murailles avec le même saint Grégoire ; considérons cette ville nouvelle, ce beau monument de la piété d'un évêque charitable, ce commun trésor des riches, où animés par ses exhortations, ils apportent, non seulement leur superflu, mais même leur nécessaire. C'est dans ce pieux magasin qu'ils viennent mettre leurs richesses à l'abri des vers et des brigands ; c'est-là qu'elles ne craignent ni l'envie, ni le temps qui corrompt et use tout : c'est-là que la maladie est endurée patiemment, que les calamités trouvent des ressources, et la miséricorde un exercice salutaire. Sans autres fonds que la confiance publique, saint Basile avait élevé hors de la ville de Césarée un édifice non moins superbe que commode, où les pauvres et les affliges trouvaient en tout temps un asile favorable et des secours de toutes espèces.
Ecoutons encore saint Grégoire de Nazianze. Sa réputation, dit-il, était si bien établie, que plusieurs imitaient ses moindres vertus, jusqu'à ses défauts même, pour se faire remarquer et pour acquérir de la gloire ; sa pâleur, sa barbe, sa marche tranquille, sa manière de se nourrir et de se vêtir ; et, comme pour l'ordinaire on outre ce qu'on imite, la gravité de celui qu'ils prenaient pour modèle dégénérait chez eux en une tristesse déplaisante : Basile faisait tout naturellement et n'affectait rien. A ne considérer que les apparences, on aurait cru voir plusieurs Basiles ; mais ce n’étaient que des statues mortes, ou des échos n'articulant distinctement que les dernières paroles. Ils lui ressemblaient d'autant moins qu'ils s'efforçaient davantage de lui ressembler. On se faisait un point d'honneur d'avoir eu quelque commerce avec Basile, de lui avoir rendu des respects, de citer quelques-unes de ses actions, et de ses paroles sérieuses ou enjouées.
En célébrant la mémoire de son ami, l'orateur ne manque pas de rappeler ses écrits et ses talents. Il parle de ses Homélies sur l'ouvrage des six jours, auxquelles il donne les plus grands éloges, de ses Livres dogmatiques et ascétiques, de ses Homélies familières, de ses Discours de morale, de ses Panégyriques des martyrs, de ses Commentaires sur l’Ecriture sainte dont il paraît que nous avons perdu un grand nombre ; il s'étend beaucoup sur la pureté de sa foi que quelques personnes mal intentionnées ou mal instruites avaient voulu obscurcir; il met au-dessus de tout son éloquence, qui véritablement est admirable. Une excellente dialectique, sans laquelle on ne peut être bon orateur, des connaissances étendues et variées qui nourrissent le discours, des mouvements vrais qui l'animent, une imagination riche qui embellit tout, de grandes pensées, de sublimes conceptions, un fréquent et bel usage de l'Ecriture sainte; de la douceur, de la force, des grâces, une diction pure, une précision attique ; tel est en général le caractère de l'éloquence de saint Basile. Sa marche, ainsi que celle de saint Jean Chrysostôme, est libre et facile. J'ai remarqué dans l'orateur de Césarée le même défaut que dans celui d'Antioche; ils sont trop curieux l'un et l'autre de parure et d'ornements, de tableaux; agréables et de descriptions fleuries. Quoiqu'ils aient un bien meilleur goût que les Pères latins, et qu'en général le langage chez eux soit presque aussi beau que chez les anciens Grecs, il faut convenir cependant qu'ils n'ont pas la sage sobriété de Démosthène, d'Eschine, ni d'Isocrate en qui néanmoins quelques-uns trouvent un peu trop de recherche, ni même du célèbre orateur de Rome à qui ses contemporains reprochaient un peu de luxe asiatique. Je renvoie encore ici aux inflexions que j'ai faites là-dessus dans le discourt préliminaire pour le saint Jean Chrysostôme. Je me contente de remarquer, comme alors que c’était probablement le vice du siècle, siècle des rhéteurs et des sophistes. Saint Basile nous en offre une preuve convaincante. Ses lettres, qu'il écrivait en suivant son impulsion naturelle, sans se prêter au goût de son temps, ne présentent nulle part, ou du moins fort rarement, le défaut dont nous parlons. Elles ont été admirées avec justice par tous les connaisseurs comme des chefs-d'œuvre. Au nombre de plus de trois cent cinquante, elles sont toutes écrites du ton le plus convenable et le plus simple, avec une variété infinie. Saint Basile est aussi supérieur à saint Jean Chrysostôme dans le genre épistolaire qu'il lui est inférieur dans le genre oratoire. Chrysostôme à ce qu'il paraît, ainsi que Démosthène, savait peu descendre du ton sérieux de l'orateur. Quoique ses lettres annoncent la plus belle âme, quoiqu'elles soient pleines de sentiment et d'un tendre intérêt pour ses amis, le ton en général en est un peu uniforme, elles n'ont pas à beaucoup près la facilité et la variété de celles de saint Basile. Mais aussi quel orateur ! quelle abondance d'idées grandes et nobles ! quelle élocution toujours brillante et toujours populaire ! quelle diversité de tours vifs et animes ! quelle effusion de belles images et de sentiments pathétiques ! quelle multitude accablante d'arguments forts et pressants! saint Basile n'a au-dessus de lui dans certains endroits qu'un peu plus de force, d'énergie et de précision. On peut dire en deux mots de ces deux hommes qui auraient fait la gloire de tout siècle où ils eussent paru, qu'il avaient tous deux de l'esprit et du génie, mais que Basile avait plus d'esprit, et Chrysostôme plus de génie. Ce qu'ils avaient l'un et l'autre à peu près également, c’était une grande connaissance de l'Ecriture sainte.
Je dirai peu de chose des traducteurs de saint Basile, et de la traduction que j'offre maintenant au public. Les Homélies sur l'Hexaméron, ou ouvrage des six jours, n'ont jamais été traduites dans notre langue, du moins que je sache. M. Hermant, qui a écrit la vie du saint évêque, a traduit ses Ascétiques. La traduction m'en a paru bonne, claire et naturelle. Je n'ai pas été aussi content de la traduction des Homélies et des Lettres, qui est du même Nicolas Fontaine qui a traduit plusieurs ouvrages de saint Jean Chrysostôme, Elle n'est pas fort exacte, le sens est manqué en plusieurs endroits: le style des homélies n'est pas assez, oratoire, celui des lettres n'est pas assez dégagé. J'en ai cependant profité quand je l'ai trouvée fidèle et élégante. Je n'ai rien négligé pour saisir partout le sens et l'esprit de l'orateur, pour ne point défigurer, ni dans ses discours, ni dans ses lettres, le génie d'un des plus grands hommes qui aient paru dans le monde et dans l'Eglise, d'un homme qui a mérité l'admiration de tous ceux qui avaient embrassé la religion chrétienne, et de ceux mêmes qui étaient restés attachés au paganisme.
DE
Le but et le sujet de ce Discours sont d'apprendre aux jeunes gens l'utilité qu'ils peuvent retirer de la lecture des livres profanes, ceux qu'ils doivent rejeter comme nuisibles ceux qu'ils doivent lire comme utiles ; les excellents préceptes de morale et les exemples de vertu que leur offrent ces derniers, exemples et préceptes conformes à l'Evangile, auquel ces livres les préparent ou dans lequel ils les confiraient. Ce discours est un modèle et un chef-d'œuvre dans son genre. On y voit une érudition sage qui instruit sans ennuyer, une grande sévérité de principes assaisonnée de tous les charmes du style; ce sont les Grâces, pour ainsi dire, mais graves et austères, qui dictent les leçons de la Sagesse.
Mes chers enfants,
Bien des motifs m'engagent à vous donner les conseils que je crois les meilleurs pour vous et les plus salutaires. A l'âge où je suis, le grand nombre d'événements par où j'ai passé, les révolutions diverses que j'ai éprouvées, ces révolutions si propres à instruire, m'ayant donné de l'expérience, je dois être en état de montrer le chemin le plus sûr à des jeunes gens qui commencent leur carrière. D'ailleurs, après vos parents, personne ne vous touche de plus près que moi, de sorte que j'ai pour vous une tendresse vraiment paternelle ; et, si je ne m'abuse sur vos sentiments, je me flatte aussi que vous me regardez comme tenant la place des auteurs de vos jours. Si donc vous êtes dociles à mes préceptes, vous serez dans le second ordre de ceux que loue Hésiode : sinon sans vous rien dire d'offensant, je me contenterai de vous rappeler les vers de ce poète, dans lesquels il dit, que le premier mérite est de voir par soi-même ce qu'il y a de mieux à faire ; le second, de pouvoir suivre les avis utiles qu'un autre vous donne ; mais que celui-là n'est bon à rien, qui ne sait ni agir par soi-même, ni profiter des conseils d'autrui.[3] Ne soyez pas étonnés si, lorsque vous avez des maîtres dont vous allez tous les jours recevoir les leçons, lorsque vous conversez avec les plus illustres des anciens écrivains, par les livres qu'ils nous ont laissés, je prétends avoir trouvé quelque chose de meilleur à vous dire. Je viens vous avertir de ne pas suivre aveuglément des docteurs profanes, de ne pas vous livrer à eux sans réserve, mais de prendre chez eux ce qu'il y a de bon, et de savoir ce qu'il faut rejeter. Comment donc pourrons-nous faire ce choix? c'est ce que je veux vous apprendre, et c'est par où je vais commencer.
Nous croyons, mes chers enfants, que la vie présente n'est rien ; tout ce qui se borne à l’utilité de cette vie n'est pas un bien à nos yeux. La naissance, la force, la beauté, la bonne mine, les honneurs, l'empire même, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde, nous paraît peu désirable : sans envier le bonheur de ceux qui possèdent ces avantages, nous portons plus loin nos espérances ; et, dans tout ce que nous faisons, nous nous proposons pour terme une vie future. Tout ce qui peut nous y conduire, nous disons qu'il faut l'aimer et le rechercher de toutes ses forces, mais qu'on doit mépriser tout ce qui ne saurait nous aider à l'obtenir. Pour vous expliquer quelle est cette vie, quelle en sera la nature et le séjour, il faudrait vous entretenir plus longtemps que je n'ai résolu, et sur des objets qui passeraient votre capacité. Il me suffira de vous dire qu'en rassemblant toute la prospérité dont les hommes ont joui depuis qu'il en existe, on ne trouvera rien qui approche du bonheur d'une autre vie ; on verra que toute la somme des biens présents est aussi inférieure au moindre des biens futurs, que l'ombre et le songe sont au-dessous de la réalité : ou plutôt, pour me servir d'un exemple plus propre, autant l’âme est plus précieuse que le corps, autant la vie future l'emporte sur la vie présente. Les saintes Ecritures nous apprennent, ces vérités, en nous instruisant par des dogmes mystérieux. Mais comme votre jeunesse ne vous permet pas encore de pénétrer dans leur profondeur, nous exerçons les yeux de votre esprit à regarder dans des livres qui ne leur sont pas opposés, comme dans des ombres et dans des miroirs. C'est ainsi qu'on occupe les soldats de divers exercices qui paraissent des amusements, mais qui leur servent pour des combats sérieux. Imaginez-vous qu'on nous propose un combat de la plus grande importance, et qu'il faut nous y préparer avec tout le soin dont nous sommes capables, nous occuper de la lecture des poètes, des orateurs, de tous les écrivains qui peuvent nous servir à perfectionner notre âme. Comme donc les ouvriers en teinture préparent avec de certaines drogues les étoffes qu'ils veulent teindre en couleur de pourpre, ou en toute autre couleur que ce soit ; de même, si nous voulons empreindre en nous l’idée du beau assez fortement pour qu'elle soit ineffaçable, nous devons nous initier dans les sciences profanes, avant que de vouloir entrer dans les secrets des sciences sacrées. Par là, nous nous accoutumerons à ces vives lumières, comme on s'accoutume à regarder le soleil en voyant son image dans l'eau.
Si les sciences profanes ont quelque rapport avec les sciences sacrées, il nous sera avantageux de les connaître; sinon, nous en connaîtrons la différence en les rapprochant l'une de l'autre, et cela ne contribuera pas peu à nous affermir dans la connaissance de la vérité. Par quelle comparaison pourra-t-on mieux se représenter l'une et l'autre doctrine? Les arbres ont une vertu naturelle pour se charger de fruits dans leur saison, mais ils produisent aussi des feuilles qui sont comme l'ornement des rameaux que le vent agite avec elles : c'est ainsi que les âmes produisent la vérité, qui est comme le fruit et la production principale ; mais c'est un avantage que ces mêmes âmes soient environnées des sciences profanes, comme de feuilles qui ombragent le fruit et qui l'embellissent On dit que Moïse, dont la sagesse est si vantée, s’était exercé dans les sciences des Egyptiens (Act. 7. 22.), lesquelles lui servirent de degrés pour parvenir à la contemplation du grand Etre. On dit aussi que, dans les siècles suivants, Daniel fut instruit dans la sagesse des Chaldéens, avant que de s'appliquer aux sciences sacrées (Dan., I. 4).
Je vous ai montré suffisamment que les sciences profanes ne sont pas inutiles ; il faut maintenant vous apprendre dans quelles sources vous devez les puiser. Pour commencer par les poètes dont les discours sont plus variés, nous ne devons pas nous attacher à tout ce qu'ils disent. Nous recueillerons les actions et les paroles des grands hommes dont ils nous parlent ; nous les admirerons, et nous tâcherons de les imiter. Mais quand ils nous présenteront d'infâmes personnages, nous nous boucherons les oreilles pour nous garantir de pareils exemples, comme fit Ulysse, suivant leur rapport, pour éviter le chant des sirènes (Odyssée. l. 12. v. 173.). On s'accoutume aux mauvaises actions, en écoutant de mauvais discours. Nous devons donc garder soigneusement notre âme, de peur que des maximes perverses ne s'insinuent par l'agrément des paroles, et que nous n'avalions le poison avec le miel. D'après cela nous ne ferons aucune estime des poètes médisants et satiriques, ni de ceux qui représentent des hommes livrés à l'amour et au vin. Nous ne les écouterons pas, lorsqu'ils mettent la félicite à jouir d'une table somptueuse qui retentit de chansons dissolues ; et encore moins lorsqu'ils parlent de la pluralité des dieux et de leurs querelles indécentes. Le frère, chez les poètes, est en discorde avec son frère; les parents et les enfants se font une guerre implacable. Ils attribuent à leurs dieux des adultères, des amours et des commerces infâmes, et surtout à ce Jupiter qu'ils annoncent comme la divinité suprême. Abandonnons au théâtre ces horreurs qu'on rougirait d'attribuer à des brutes. Je puis raisonner de même sur les écrivains en prose, qui ne cherchent qu'à corrompre l'esprit de ceux qui les lisent. Nous n'imiterons point ces orateurs qui ne se servent de leur art que pour tromper. Des chrétiens qui ont choisi la voie droite et véritable, à qui l'Evangile défend même les procès, ne peuvent s'accommoder du mensonge, ni dans les affaires judiciaires, ni dans aucune autre. Nous étudierons ceux de leurs écrits où ils ont loué la vertu et blâmé le vice. Dans les fleurs, on se contente d'en regarder la couleur et d'en respirer l'odeur, mais les abeilles en expriment un suc dont elles composent leur miel. C'est ainsi que ceux qui, dans leurs lectures, ne se proposent pas l'agrément et le plaisir, en tirent des maximes utiles qu'ils déposent dans leur esprit. Et, afin de suivre la comparaison des abeilles, nous devons imiter en tout leur exemple. Sans s'arrêter indifféremment à toutes les fleurs, sans entreprendre de tirer tout le suc de celles sur lesquelles elles reposent, elles n'en prennent que ce qui est utile pour leur travail et laissent le reste. Nous de même, si nous sommes sages, après avoir pris dans les livres ce qui est propre et conforme à la vérité, nous passerons ce qui ne conduit pas à ce terme. Et comme en cueillant les roses nous évitons les épines, ainsi en lisant les livres profanes, nous recueillerons ce qu'ils ont de bon, avec autant de soin que nous éviterons ce qui serait capable de nuire. Nous devons donc examiner, avant tout, les sciences que nous voulons étudier, et les diriger à une fin convenable. Comme la vertu est le chemin de la vie bienheureuse à laquelle nous tendons, et que les poètes, ainsi que les autres écrivains, et surtout les philosophes, ont célébré la vertu dans plusieurs de leurs ouvrages, il faut nous appliquer principalement à ceux de leurs écrits où ils la recommandent. Ce n'est pas, non, ce n'est pas un médiocre avantage que l'esprit des jeunes gens s'accoutume et s'habitue à ce qui est honnête. Ces premières traces s'impriment dans leurs âmes encore tendres assez fortement pour qu'elles ne puissent jamais s'en effacer. Croyons-nous qu'Hésiode ait eu d'autre motif que d'exciter les jeunes gens à être vertueux, en écrivant ces vers qui sent dans la bouche de tout le monde, et dont voici le sens? Le chemin qui conduit à la vertu semble, au premier coup d’œil, rude, difficile, escarpé, n'offrant que des sueurs et de la fatigue : aussi n’est-il pas donné à tout le monde d'en approcher à cause de sa raideur, ou d'arriver jusqu'au sommet. Mais quand une fois on y est arrivé, alors on voit que ce même chemin est beau, uni, doux, facile, plus agréable qu'un autre qui conduit au vice, qu'on peut prendre sur le champ, comme dit le même poète, parce qu'il en est voisin. Pour moi, il me semble qu'en parlant ainsi, Hésiode ne s'est proposé autre chose que de nous exhorter tous et de nous inviter à être vertueux, et à ne pas nous laisser décourager par la peine avant que d'être arrivés au but. Si nous trouvons d'autres écrivains chez qui la vertu soit également célébrée, remplissons-nous de leurs préceptes comme conduisant au même terme.
Un homme habile à expliquer le sens des poètes, me disait que toute la poésie d'Homère est l’éloge de la vertu; que tout ce qui n'est pas pour l’ornement tend à cette fin, et qu'on en voit un bel exemple dans le chef des Céphalléniens[4] qui sort nu d'un naufrage : que dans cet état, n'étant couvert que de sa vertu, préférable aux plus beaux vêtements, loin d'encourir de la honte, il inspira d'abord du respect à une jeune princesse; qu'ensuite les autres Phéaciens eurent tant de vénération pour lui, que, sans penser à leur luxe et à leur opulence, ils ne regardaient, ils n'admiraient qu'Ulysse, ils ne souhaitaient rien davantage que d'être cet Ulysse sorti des flots dans un état si misérable. L'interprète d'Homère ajoutait que par là le poète semblait s'écrier : O hommes, rechercher la vertu, laquelle nous fait triompher du naufrage, et rend un homme qui sort nu des flots, plus respectable que les opulents Phéaciens. Oui, sans doute, les autres biens n'appartiennent guère plus à leurs possesseurs qu’à ceux qui en sont privés, parce qu'ils passent d'une main a une autre comme dans les jeux de hasard: mais la vertu est la seule possession qu'on ne peut nous enlever, la seule qui nous reste pendant la vie et à la mort. C'est là pourquoi Solon, à ce qu'il me semble, disait aux riches: Nous ne changerons jamais pour vos richesses la vertu, parce que celle-ci nous reste toujours au lieu que les biens passent d'un homme à un autre homme.[5] Théognis pense à peu près de même, lorsqu’il dit que Dieu (quel que soit le Dieu dont il parle) fait pencher la balance tantôt d'un coté, tantôt d'un autre; que celui qui était riche tombe souvent dans la dernière indigence.
Prodicus, sophiste de Chio, raisonne à peu près de même, dans un de ses ouvrages, sur la vertu et sur le vice. Ce n'est pas un homme méprisable que ce Prodicus, et il mérite d'être lu avec attention. Quoique j'aie oublié ses propres paroles, et que je sache uniquement qu'il a écrit en prose, j'ai retenu son idée qu'il exprime à peu près de la sorte. Il dit qu'Hercule, encore très jeune et dans l'âge à peu près où vous êtes, délibérant sur la route qu'il devait choisir, s'il prendrait celle qui conduit à la vertu par la peine, ou une autre plus facile, il se présenta à lui deux femmes, dont l'une était la vertu, et l'autre le vice, qu'il reconnut à leur extérieur, avant qu'elles eussent ouvert la bouche. L'une avait relevé sa beauté par un excès de parure, elle semblait nager dans les délices et traînait à sa suite tout l'essaim des plaisirs : elle cherchait à entraîner Hercule en lui montrant tout son cortège et lui promettant plus encore. L'autre, quoique maigre et desséchée, avait un regard ferme : elle lui tenait un autre langage ; loin de lui promettre une vie douce et tranquille, elle lui annonçait mille fatigues, mille travaux, mille périls sur terre et sur mer, mais dont la récompense serait d'être placé au rang des dieux. Prodicus ajoute qu'Hercule suivit jusqu'à sa mort cette dernière route qu'on lui indiquait.
En général, tous ceux qui ont écrit de la sagesse, ont loué la vertu dans leurs ouvrages, chacun suivant leurs forces. Nous devons les écouter, et tâcher d'exprimer leurs maximes dans notre conduite. Car celui-là seul est sage qui confirme sa philosophie par des actions ; ceux qui ne sont philosophes qu'en paroles ne méritent aucun égard. Le vrai sage me paraît ressembler à un peintre qui, représentant les plus belles figures d'hommes comme impossibles les préceptes du christianisme. Je ne passerai point sous silence la modération d'Alexandre, qui ne voulut pas même voir les filles de Darius, ses captives, quoiqu'elles eussent la réputation d'être les plus belles princesses du monde. Il aurait cru déshonorer sa victoire, en cédant aux attraits des femmes après avoir triomphé des hommes. Cette tempérance revient à cette maxime de l'Evangile, que celui qui regarde une femme avec un mauvais désir, quoiqu'il ne commette pas réellement l'adultère, n'est pas exempt de crime, parce qu'il admet la concupiscence dans son âme (Matth. 5. 28.). J'ai assez de peine à me persuader que ce soit par hasard, et non par un dessein formé, que Clinias, un des disciples de Pythagore, ait observé fidèlement un de nos préceptes. Qu'a-t-il donc fait? Il aurait pu, en prêtant serment, éviter de perdre une somme de trois talents ; il aima mieux payer ce qu'on lui demandait, que de prêter un serment même conforme à la vérité. Il avait, à ce qu'il me semble, entendu la défense qui nous est faite de jurer par quoi que ce soit (Matth. 5. 24 et suiv.).
Mais je reviens à ce que je disais d'abord. Nous devons choisir ce qui est utile, et non prendre tout sans distinction. Parmi les aliments, nous avons soin de rejeter ceux qui sont nuisibles; et nous ne ferions aucun choix des sciences qui nourrissent notre âme ! Nous serions comme un torrent qui entraîne dans sa course tout ce qu'il rencontre ! Un pilote n'abandonne pas son vaisseau au caprice des vents, il le conduit au port selon les principes de son art. Des artisans en fer ou en bois vont à leurs fins par des règles certaines; et nous serions inférieurs à de simples ouvriers pour l'intelligence de nos plus grands intérêts ! Dans les ouvrages des mains on aurait un but pour se diriger dans le travail ; et on ne s'en proposerait aucun pour la vie humaine, pour un objet que doit avoir en vue, dans tous ses discours et dans toutes ses actions, quiconque ne veut pas absolument ressembler aux brutes ! Si nous n'agissons pour une fin, notre esprit, comme un vaisseau sans gouvernail et sans lest, flottera à l'aventure. Dans les combats de la lutte et de la musique, on se livre à des exercices préparatoires, pour obtenir la couronne promise. Celui qui s'est exercé à lutter ne se présentera point pour jouer de la flûte ou toucher de la lyre. Le fameux Polydamas, avant de paraître aux jeux olympiques, arrêtait des chars dans leur course, et par là augmentait ses forces. Milon,[6] se tenant sur un bouclier frotté d'huile, ne pouvait être arraché de sa place ; et quelque effort qu'on employât, il restait inébranlable comme une colonne fixée avec du plomb. En un mot, les exercices de ces hommes étaient des préparations pour le combat. Si, négligeant les exercices de la lutte, ils se fussent occupés des talents de Marsyas ou d'Olympe,[7] loin d'acquérir de la gloire et des couronnes, ne se seraient-ils pas rendus ridicules? Timothée non plus n'a pas abandonné la musique pour vivre dans les palestres;[8] il n’aurait pas alors effacé tous les musiciens de son siècle. Il était, dit-on, si habile dans son art, qu'à son gré il excitait l'indignation par des tons graves et austères, et que bientôt il l'apaisait par des sons plus doux. On dit que chantant devant Alexandre selon le mode phrygien, il l'anima jusqu'à lui faire prendre les armes au milieu du repas ; et qu'ensuite, adoucissant peu à peu son ton, il le ramena à des sentiments de bienveillance pour les convives : tant il est vrai que l'exercice est nécessaire pour parvenir à la perfection dans la musique et dans la lutte.
Puisque nous avons parlé de couronnes et d'athlètes, poursuivons nos idées. C'est après s'être épuisés dans les gymnases, de peines, de travaux, de fatigues pour augmenter leurs forces; après avoir reçu bien des coups dans des combats particuliers ; après s'être laissé imposer le régime le plus sévère ; enfin, pour ne pas entrer dans les détails, c'est après avoir mené une vie qui est une longue préparation pour les combats, que les athlètes entrent en lice, et qu'alors ils essuient de plus rudes travaux, ils s'exposent à de plus grands périls, pour obtenir une couronne d'ache, d'olivier, ou autre semblable, pour être proclamés vainqueurs par un héraut: et nous, à qui on propose des prix si admirables qu'il est impossible d'en exprimer la grandeur et l'étendue, nous obtiendrions ces prix en ne nous donnant aucune peine, en vivant sans attention et avec toute licence! Une vie lâche mériterait donc des éloges, et il faudrait regarder comme le plus heureux des hommes Sardanapale, [9] ou ce Margitès qu'Homère, supposé qu'il soit auteur de ce poème, nous représente comme ne sachant ni labourer, ni fouir, incapable de s'occuper d'aucun des travaux nécessaires à la vie. N'est-il pas plus vrai de dire avec Pittacus, que les biens ne viennent pas sans peine? En effet, après avoir beaucoup travaillé, c'est tout ce que nous pourrons faire que d'obtenir ce bonheur auquel il n'y a rien de comparable dans le monde. Nous ne devons donc pas nous livrer à la paresse, ni sacrifier à la satisfaction d'un moment de grandes espérances, en nous exposant à des peines et à des confusions éternelles, non seulement devant les hommes (ce qui serait déjà à considérer pour une personne raisonnable), mais dans les lieux où le souverain juge exerce sa justice, soit sous terre, soit ailleurs. Il pourra traiter favorablement celui qui aura péché par imprudence ou par faiblesse ; mais celui qui aura fait par malice un mauvais choix, subira, sans aucune pitié, des supplices beaucoup plus rigoureux.
Que faut-il donc faire? dira-t-on. Il faut négliger tout le reste pour avoir soin de notre âme. Il ne faut s'embarrasser du corps qu'autant que la nécessité le demande. L’âme doit être la mieux partagée. Elle est renfermée dans le corps comme dans une prison; la philosophie doit l'en délivrer autant qu'il est possible, et affranchir le corps lui-même des affections qui asservissent l’âme. Il ne faut manger que pour apaiser la faim, et non pour satisfaire la sensualité. Ceux qui ne pensent qu'à imaginer des mets exquis, qui parcourent les terres et les mers comme pour porter un tribut à un maître fâcheux et difficile, sont misérables par ces soins là même, et souffrent dès ici bas comme dans les enfers, occupés tristement à couper la flamme, à mettre de l’eau dans un crible, à remplir un tonneau percé, sans trouver aucune fin de leurs peines. Avoir un soin excessif de sa chevelure et de ses habits, c'est un malheur, suivant Diogène, ou un crime.[10] Oui, être curieux de parure, est aussi honteux que d'être impudique ou adultère. Eh! qu'importe à un homme de sens d'être revêtu d'habits somptueux ou de n'avoir qu'un vêtement simple, pourvu que ce dernier puisse le garantir du froid et du chaud? Il faut donc éviter dans tout le reste le superflu, et ne travailler pour le corps qu'autant que c'est le bien de l’âme. Un homme vraiment digne de ce nom, ne doit pas moins rougir d'aimer trop la parure et son corps, que de s'abandonner lâchement à tout autre vice. Ce n'est pas se connaître que d'avoir des soins trop empressés pour son corps: ce n'est pas comprendre la sage maxime qui nous dit que ce qu'on voit de l'homme n'est pas l'homme ; qu'on a besoin d'une sagesse supérieure pour se connaître soi-même ; qu'il est plus difficile d'y parvenir lorsque l'œil de l'entendement n'est point pur, que de regarder le soleil lorsque les yeux au corps sont malades. On purifie son esprit, pour le dire suffisamment quoiqu'en peu de mots, en dédaignant les plaisirs des sens, en ne repaissant pas ses yeux de vains spectacles qui leur font illusion, ou de la vue de personnes qui allument le feu de la concupiscence; en n'admettant pas dans l’âme, par les oreilles, des sons qui la corrompent. Une musique efféminée fait naître les vices les plus honteux et les plus bas. Nous devons en rechercher une autre, qui soit plus utile et qui ne nous inspire que des sentiments de vertu. Telle était celle dont David, ce divin auteur des chants sacrés, se servait, dit-on, pour calmer les emportements de Saül (I Rois. 16. 23.). On dit que Pythagore,[11] ayant rencontré des hommes ivres qui revenaient d'un repas de débauche, ordonna au musicien de changer de ton, et de chanter selon le mode dorien. Ce chant, dit-on, les fit tellement revenir à eux-mêmes, qu'ils jetèrent leurs couronnes et s'en retournèrent chez eux tout confus. On en voit d'autres qui s'agitent au son des flûtes comme des Corybantes[12] ou des Bacchantes : tant il y a de différence à entendre une musique honnête ou licencieuse. On doit donc éviter celle de nos jours aussi soigneusement que ce qu'il y a de plus honteux au monde. J'ai honte d'avertir de ne point répandre dans l'air des parfums de toute espèce pour flatter l'odorat, et encore moins de se parfumer soi-même. Que dirai-je des plaisirs du toucher et du goût, sinon que ceux qui les recherchent sont esclaves, comme les bêtes de leur ventre et des plus grossiers appétits?
En un mot, il faut mépriser le corps, à moins qu'on ne veuille se plonger dans les plaisirs sensuels comme dans la fange ; ou il ne faut le ménager qu'autant que son ministère peut être utile à la sagesse. C'est le sentiment de Platon, conforme à celui de saint Paul, qui nous avertit de ne point flatter notre corps, dans la crainte d'allumer en nous de mauvais désirs (Rom. 13. 14.). Avoir trop de soin du corps, et négliger, comme n'étant d'aucun prix, l’âme dont il est le serviteur, c'est comme si on était jaloux des outils d'un art, et qu'on ne se mît guère en peine de l'art même dont ils sont les instruments. Il est donc à propos de châtier le corps et de le dompter comme une bête féroce. Servons-nous de la raison comme d'un frein, pour retenir les mouvements tumultueux qui s'élèvent dans l’âme ; ne lâchons pas toutes les brides au plaisir de peur que l'esprit ne soit entraîné par les passions, comme un cocher est emporté par des chevaux indociles. Rappelons-nous ce mot de Pythagore, qui, voyant un de ses disciples faire trop bonne chère et s'engraisser trop, lui dit : Quand cesseras-tu de te préparer une rude prison? Platon, qui savait combien le corps peut nuire à l’âme, avait choisi exprès à Athènes l'Académie, lieu malsain, pour retrancher le trop d'embonpoint du corps, comme on retranche dans la vigne le luxe des feuilles. J'ai entendu dire à un médecin qu'un excès de santé est souvent dangereux.
Ce serait donc une folie manifeste de trop ménager le corps puisque ce ménagement nuit à l’âme aussi bien qu'au corps. Si nous nous accoutumons à dédaigner celui-ci, nous ne serons plus guère touchés des choses humaines. Quel besoin aurons-nous des richesses, si nous dédaignons les plaisirs corporels? Pour moi, je ne le vois pas, à moins que, comme les dragons de la fable, nous n'ayons du goût à garder des trésors enfouis. Ceux qui auront appris à n'être pas esclaves des passions, seront bien éloignés de rien faire ou de rien dire de bas pour acquérir des richesses. Tout ce qui est superflu, quand ce seraient les sables de la Lydie, ou les ouvrages de ces fourmis qui apportent l’or,[13] ils le mépriseront d'autant plus qu'ils en sentiront moins le manque. Ils régleront l'usage des choses sur les besoins de la nature, et non sur le plaisir. Quiconque ne suit pas cette règle, placé comme sur un penchant, est entraîné par la pente sans pouvoir s'arrêter. Plus il amasse, plus il veut amasser encore pour satisfaire ses désirs, suivant cette sentence de Solon, fils d'Exécestide : Les mortels ne mettent aucunes bornes au désir des richesses.[14] Théognis peut aussi nous servir de maître ; il disait : Je n’aime ni ne souhaite les richesses ; je me contenterai de peu avec une vie exempte de douleur. Pour moi, je ne puis me lasser d'admirer le mépris que faisait Diogène de toutes les prospérités humaines. Il prétendait être plus riche que le grand roi,[15] parce qu'il a voit besoin pour vivre de moins de choses que lui. Et nous, à moins que nous n'ayons tout l'or, les terres et les troupeaux innombrables du Mysien Pythius,[16] nous ne sommes pas contents ! Toutefois, ne désirons pas les richesses, si nous en manquons ; si nous en avons, applaudissons-nous plus de savoir en user que de les posséder. C'est une belle parole de Socrate, qui, voyant un riche fier de ses grands biens, dit qu'il ne l’admirerait pas avant que l'expérience lui eût appris comment savait user de sa fortune. Si Phidias et Polyclète, qui firent deux statues admirables, l'un de Jupiter pour la ville d'Elée, l'autre de Junon pour Argos, avaient plus estimé l'or et l'ivoire de leurs statues, que leur art qui donnait tant de prix à l'ivoire et à l’or, ils se seraient rendus ridicules en se glorifiant d'une richesse étrangère. Et nous, qui croyons que la vertu humaine n'est pas assez décorée par elle-même, nous nous imaginons être à l'abri de tout reproche !
Mais ce n'est point assez de mépriser les richesses et de dédaigner les plaisirs des sens, si nous recherchons la flatterie et les fausses louanges, si nous imitons les finesses et les ruses du renard d'Archiloque.[17] Un homme sage ne doit rien tant éviter que la vaine gloire et le désir de plaire au peuple. Prenant en tout la raison pour guide, il faut qu'il aille droit au but jugé le meilleur, sans être détourné par les contradictions des hommes, par les affronts et par les périls. Celui qui n'est point dans ces sentiments, ne ressemble-t-il pas à ce savant égyptien qui se métamorphosait en plante, en bête, en feu, en eau, qui prenait toutes les formes qu'il voulait?[18] C'est ainsi qu'un flatteur change avec les circonstances et avec les personnes. Il louera ce qui est juste devant des hommes qui aiment la justice, il tiendra un autre langage devant d'autres qui ne pensent pas de même. Il changera d'opinions au gré de ceux avec lesquels il vit, comme le polype[19] prend la couleur de la terre qu'il touche.
Tout ce que je viens de dire, nous l'apprendrons plus parfaitement dans nos livres ; mais aidons-nous des instructions profanes pour tracer au moins une première ébauche de vertu. Ceux qui rassemblent de tous côtés ce qui peut leur être utile, sont comme les fleuves qui se grossissent des ruisseaux qu'ils recueillent de toutes parts dans leur course. Suivant Hésiode, les sciences s'acquièrent peu à peu, comme les trésors s'accumulent en réunissant plusieurs sommes modiques. Bias répondit à son fils qui partait pour l'Egypte, et qui lui demandait ce qu'il devait faire pour lui plaire davantage : Vous me plairez, lui dit-il, si vous amassez des provisions pour la vieillesse. Par ces provisions, il entendait la vertu qu'il resserrait dans des limites fort étroites, en bornant son utilité à la vie humaine. Pour moi, quand on compterait les années de Tithon ou d'Arganthonius,[20] qu'on y joindrait celles de Mathusalem (Gen. 5. 27.), qui a vécu près de mille ans ; quand on rassemblerait tous les âges des hommes depuis qu'il en existe, je me rirais de tout cela comme d'une idée d'enfant, en le comparant à la vie future, dont il n'est pas plus possible d'imaginer le terme, que de supposer la fin de l’âme qui est immortelle. Je vous exhorte à faire des provisions pour le grand voyage, et à ne rien négliger de ce qui vous fera parvenir plus aisément a votre patrie véritable. Si le chemin offre des difficultés et des fatigues, ne perdons pas courage ; mais rappelons-nous celui qui nous engage à choisir le meilleur plan de vie, et à croire que l'habitude nous adoucira toutes les peines n'est honteux de perdre le présent pour avoir à regretter le passé, lorsque tous les regrets seront superflus.
Je viens de vous dire les vérités dont j'ai cru que vous retireriez le plus de fruit, et je ne cesserai jamais de vous donner les meilleurs conseils. Il est trois sortes de malades ; prenez garde de ressembler aux plus incurables, et que les infirmités de vos aînés ne se rapprochent de celles de leurs corps. Ceux qui ne sont que médiocrement malades vont trouver eux-mêmes le médecin ; d'autres, dont les maladies sont plus graves, le font venir dans leur maison ; mais ceux qui sont attaqués d'une mélancolie noire qu'il est impossible de guérir, ne peuvent souffrir le médecin qui vient les visiter. Craignez d'être aussi à plaindre qu'eux, si vous rebutez les esprits les plus sages.
[1] Alphée, fleuve d’Arcadie.
[2] La Salamandre, qui jetée dans le feu, loin d'y périr, l'éteint, si l'on en croit Pline.
[3] Hésiode, dans le poème intitulé : Les ouvrages et les jours, v. 291. Cette pensée du poète grec a été souvent répétée après lui, entre autres par Tite-Live dans le discours de Minucius au dictateur Fabius.
[4] Le chef des Céphalléniens, Ulysse qui commandent à des peuples de ce nom. On peut voir dans l’Odyssée, liv. 6, la manière dont il fut reçu par les Phéaciens.
[5] Les vers que St. Basile, ainsi que Plutarque, donnent à Solon se trouvent dans Théognis, v. 316.
[6] C'est le fameux Milon de Crotone. Pausanias rapporte le même fait de ce robuste athlète. Polydamas, dont il est parlé un peu auparavant, n’était guère moins connu.
[7] Marsyas et Olympe, tous deux joueurs de flûte célèbres, Olympe était de Mysie. La fable dit de Marsyas que c'était un satyre ; qu'il osa défier Apollon, et qu'il lut puni de son audace.
[8] Palestres, lieux ou salles où s'exerçaient les athlètes.
[9] Sardanapale, roi d'Assyrie, célèbre par son luxe et par sa mollesse.
[10] Diogène Laërce rapporte cette même parole de Diogène philosophe cynique.
[11] Cicéron rapporte à peu près le même fait du même Pythagore.
[12] Corybantes, prêtres de Cybèle, célébraient les fêtes de cette déesse en battant du tambour, sautant, dansant et courant partout comme des insensés. On sait avec quelles folies les femmes, sous le nom de Bacchantes, célébraient les fêtes de Bacchus.
[13] Ce sont sans doute ces fourmis de l'Inde dont parle Hérodote dans son troisième livre; fourmis aussi grandes que des renards, qui fouillent la terre comme les autres, et qui, pour se faire des logements, apportent au-dessus un sable rempli de grains d'or.
[14] Le vers que cite le Grec se trouve dans Théognis, v. 227, avec une très légère différence
[15] Par grand roi, les Grecs entendaient toujours le roi de Perse.
[16] Il paraît que ce Pythius est le môme dont il est parlé dans le septième livre de l'histoire d'Hérodote. D'après l'historien, l'orateur aurait dû dire le Lydien Pythius.
[17] Archiloque, connu par ses poésies satiriques, avait composé des apologues dans lesquels le renard jouait le principal rôle. On disait donc le renard d’Archiloque, comme nous disons quelquefois le renard de La Fontaine.
[18] Ce savant égyptien était un roi d'Egypte, homme de peu de naissance, mais fort habile, nommé Cetés par les Egyptiens, et Protée par les Grecs. On peut voir, dans l'Hérodote de M. Larcher, t. 2. p. 387 et 388, ce qui a donné lieu à ce que la fable raconte de Protée.
[19] Plutarque se sert de la même comparaison dans le Traité sur la manière de distinguer un flatteur d’un ami.
[20] On connaît Tithon, époux de l'Aurore, qui parvint à une extrême vieillesse, et fut changé en cigale. Arganthonius, roi des Tartessiens, régna 80 ans, et en vécut 120. Voyez Hérodote, livre premier de son histoire.