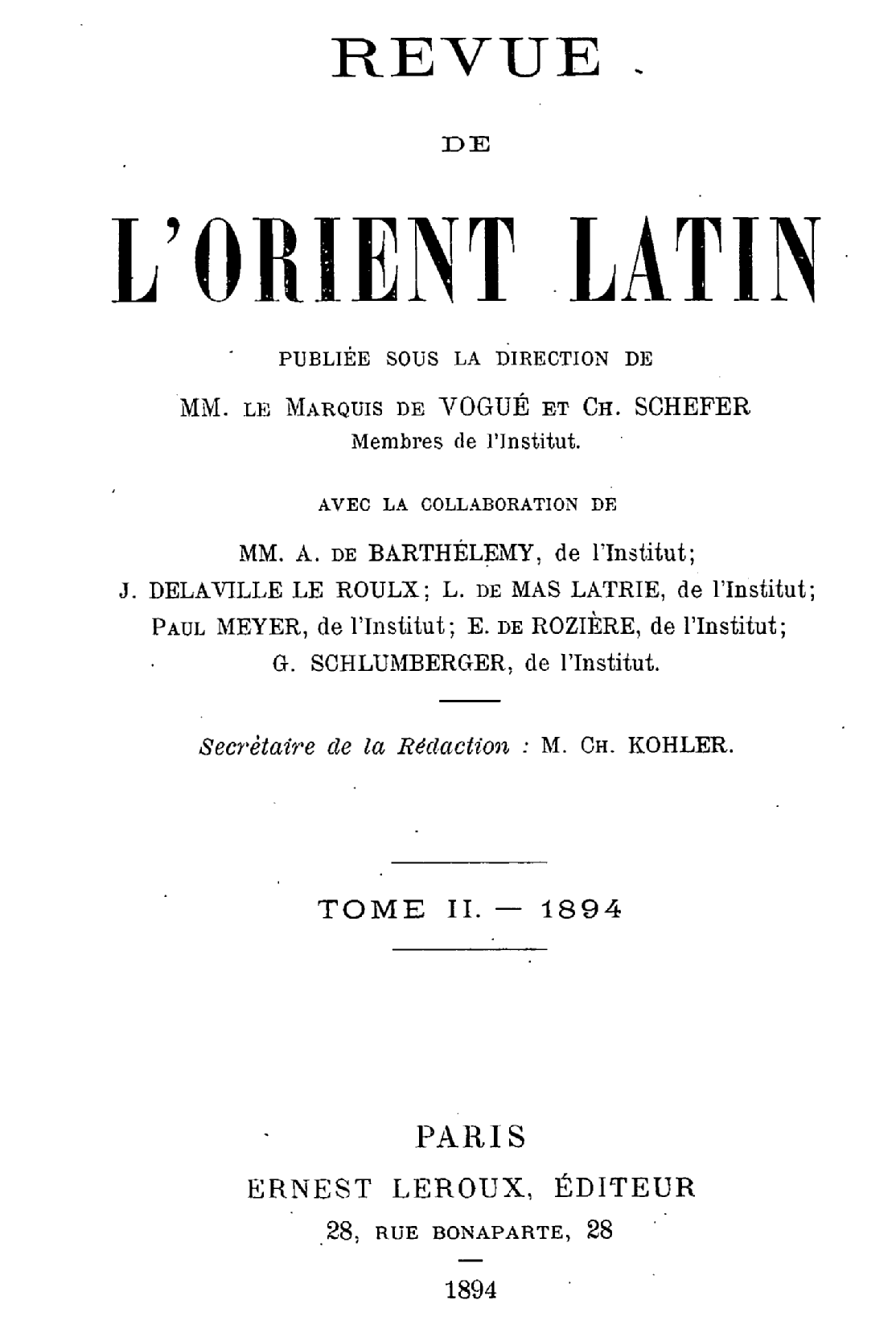
OUSAMA IBN MOUNKIDH
AUTOBIOGRAPHIE partie III
Traduction française : HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
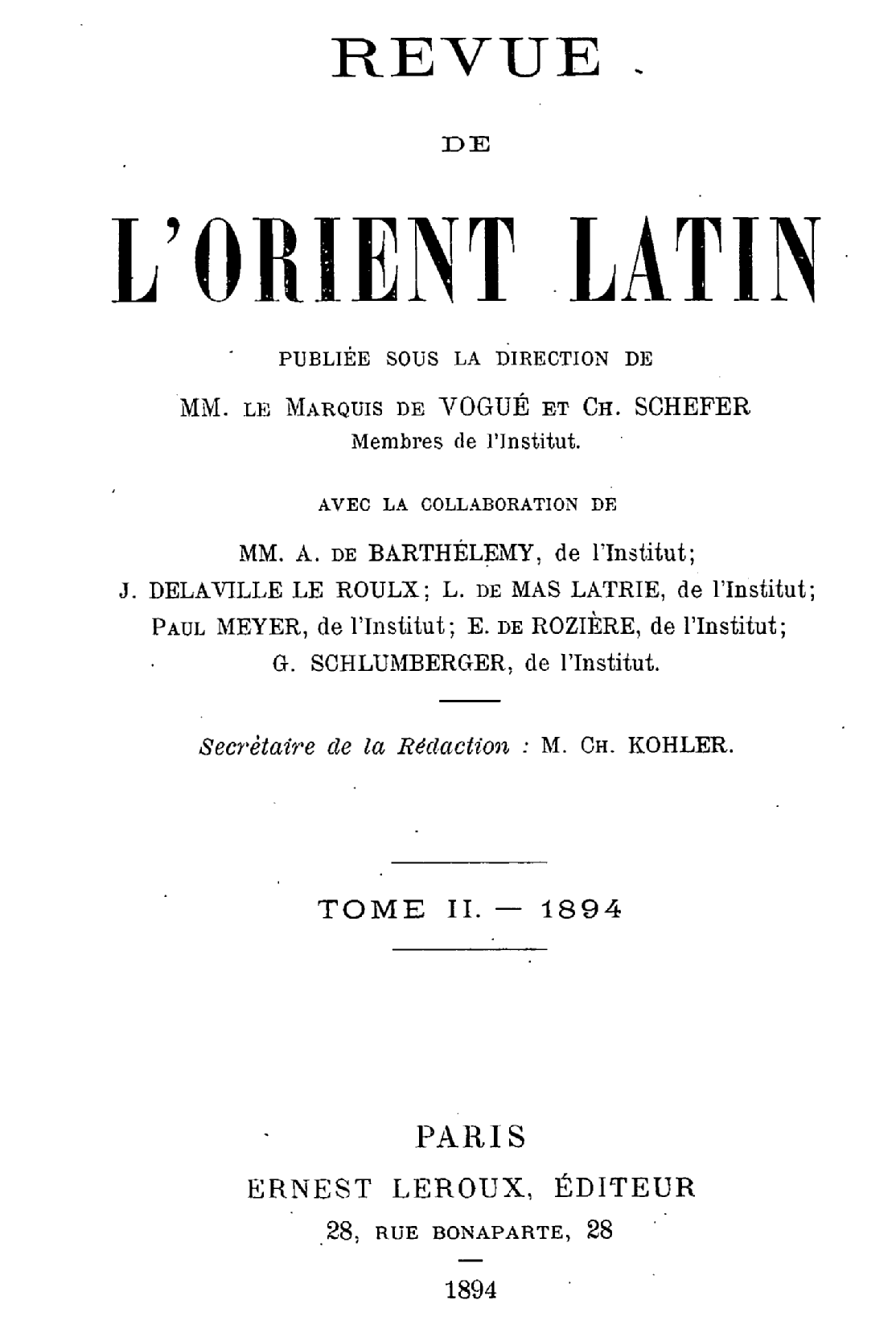
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Je m'informai de cet homme, et j'appris que sa mère avait été mariée à un Franc et qu'elle avait tué son mari. Son fils usait de ruse contre les pèlerins francs, et se servait d'elle pour l'aider à les assassiner. Les Francs l'avaient finalement soupçonné de pareils méfaits et lui avaient appliqué la coutume franque.
On avait installé une grande barrique, et on l'avait remplie d'eau, puis on avait placé en travers une planchette de bois. Alors, l'homme qui était l'objet des suspicions fut garrotté, suspendu par ses omoplates à une corde et précipité dans la barrique. S'il était innocent, il enfoncerait dans l'eau, et on l'en retirerait au moyen de cette corde, sans qu'il fût exposé à y mourir. Avait-il au contraire commis quelque faute, impossible pour lui de plonger dans l'eau. Le malheureux, lorsqu'on le jeta dans la barrique, fit des efforts pour aller jusqu'au fond, mais il n'y réussit pas, et dut se soumettre aux rigueurs de leur jugement (qu'Allah les maudisse !). On lui passa sur les yeux le poinçon d'argent rougi au feu, et on l'aveugla.
Puis, ce même homme se rendit a Damas, où l'émir Mou'în ad-Dîn[161] (qu'Allah l'ait en pitié !) subvint à tous ses besoins et dit un jour à l'un de ses serviteurs : « Tu le conduiras chez Bourhân ad-Dîn de Balkh (qu'Allah l'ait en pitié !), auquel tu enjoindras en mon nom de lui donner un professeur qui lui enseigne le Coran, avec quelques notions de jurisprudence. » — L'aveugle s'écria : « Aussi vrai que le secours et la victoire émanent d'Allah, telle n'était pas mon ambition. » — « Qu'espérais-tu de moi ? » reprit Mou'în ad-Dîn. — L'aveugle répondit : « Que tu me donnerais un cheval, une mule et des armes, que tu ferais de moi un cavalier. » Mou'în ad-Dîn dit' alors : « Je ne me serais pas imaginé qu'un aveugle pût être rangé parmi les cavaliers. »
Entre les Francs, nous en voyons qui sont venus se fixer au milieu de nous et qui ont fréquenté la société des musulmans. Ils sont bien supérieurs à ceux qui, plus récemment, les ont rejoints dans les régions qu'ils occupent. Ils constituent, en effet, une exception qu'il ne faut point ériger en règle.
C'est ainsi que j'envoyai un de mes compatriotes à Antioche pour régler une affaire. A ce moment, le chef de la municipalité (ar-raïs) y était Theodoros Sophianos (Ta'odoros ibn Assafî). Nous avions l'un avec l'autre des liens d'amitié. Son autorité prévalait à Antioche. Il dit un jour à mon compatriote : « Je suis invité par un Franc de mes amis, tu viendras avec moi, afin que tu voies leurs usages. »
Voici ce que m'a raconté mon compatriote- : « J'allai avec lui, et nous entrâmes dans la maison d'un chevalier parmi les chevaliers de vieille roche, qui étaient arrivés avec la première expédition des Francs. Il avait été rayé des rôles pour l'impôt et dispensé de tout service militaire, et de plus avait été doté à Antioche d'un fief, d'où il tirait sa subsistance. Sur son ordre, on apporta une table magnifique, dressée avec des mets d'une pureté excessive et d'une perfection absolue. Cependant, mon hôte s'aperçut que je m'abstenais de manger.
« Mange, me dit-il, tu t'en trouveras bien. Car moi non plus, je ne mange pas de la nourriture des Francs, mais j'ai des cuisinières égyptiennes, et je ne me nourris que de leur cuisine. De plus, il n'entre jamais dans ma maison aucune viande de porc. » Je me décidai à manger, mais avec circonspection. Ensuite nous prîmes congé de notre hôte. Quelques jours après, je passais sur la place du marché, lorsqu'une femme franque s'attacha à moi, proférant des cris barbares dans leur langue, et je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle me disait. Un rassemblement se forma autour de moi. C'étaient des Francs, et j'eus la conviction que ma mort était proche. Mais voici que ce même chevalier s'était avancé. Il me vit, s'approcha et dit à la femme : « Qu'as-tu donc à faire avec ce musulman ? » — « Il est, répondit-elle, le meurtrier de mon frère Hurso ('Ours). » Or, Hurso était un chevalier d'Apamée, qui avait été tué par un soldat de l'armée de Hama. Le chevalier chrétien fit des reproches à la femme, et lui dit : « Tu as devant toi un bourgeois (bourdjâsî), c'est-à-dire un commerçant, qui ne combat pas, qui n'assiste même pas aux combats. » Il réprimanda ensuite la foule assemblée, qui se dispersa. Puis il me prit par la main et m'accompagna. Ce fut grâce à ce repas que j'échappai à une mort certaine. »
La nature humaine présente cette singularité que le même homme s'enfonce dans les abîmes, affronte les dangers, sans éprouver aucun effroi, et s'effraye de ce dont ne s'effrayent ni les jeunes gens ni les femmes.
J'ai constaté cela chez mon oncle paternel 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân (qu'Allah l'ait en pitié !), l'un des hommes les plus braves de sa race. Il avait à son actif des campagnes illustres et des coups de lance réputés. Apercevait-il une souris, les traits de son visage en étaient altérés, il était pris d'une sorte de frisson à son aspect et il s'éloignait de l'endroit où il la voyait.
Au nombre de ses serviteurs, il y avait un brave, connu pour son courage et pour sa hardiesse, nommé Sandoûk. Il avait peur des serpents au point d'en perdre la tête. Un jour, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) lui dit en présence de mon oncle paternel : « O Sandoûk, tu es un homme remarquable, d'une bravoure reconnue. Ne rougis-tu pas de la peur que te font éprouver les serpents ? » — Il répondit : « O mon maître, qu'y a-t-il là de surprenant ? A Homs, il y avait un homme courageux, un héros d'entre les héros, qui s'effrayait des souris et qui en mourait. » Il faisait allusion à son maître, mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !), qui lui dit : « Qu'Allah te flétrisse, ô Sandoûk ! »
J'ai vu un esclave (mamlouk) de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), nommé Lou'lou'. C'était un brave, plein d'audace. J'étais sorti une nuit de Schaïzar, avec nombre de mulets et de bêtes de somme, voulant aller dans la montagne pour en rapporter des charges de bois, que j'y couperais afin d'en fabriquer une noria {nâ'oûra). Nous avions quitté les alentours de Schaïzar, nous imaginant que l'aurore était proche, et nous étions arrivés à un village nommé Doubais, la moitié de la nuit n'étant pas encore écoulée. Je dis : « Descendez de vos montures, car nous n'entrerons pas avant le jour dans la montagne. » Lorsque nous fûmes descendus et installés, nous entendîmes le hennissement d'un cheval et nous dîmes : « Ce sont les Francs. » Nous montions aussitôt à cheval dans les ténèbres, tandis que je me promettais de donner un coup de lance à l'un d'eux et de lui prendre son cheval, résigné que j'étais à leur laisser enlever nos bêtes de somme et leurs valets. Je chargeai Lou'lou' et trois serviteurs de nous devancer et de nous renseigner sur ce hennissement. Ils partirent en avant au galop, rencontrèrent ceux que nous avions entendus en troupes et en masses nombreuses. Lou'lou' les aborda en disant : « Parlez ; sinon, je vous tuerai jusqu'au dernier. » Il était un archer très habile, ses interlocuteurs le reconnurent et lui dirent : « N'es-tu pas le gardien (hâdjib) Lou'lou' ?» — « En effet, » répondit-il. Or c'était l'armée de Hama, commandée par l'émir Saïf ad-Dîn Souwâr (qu'Allah l'ait en pitié !), qui revenait d'une incursion sur le territoire des Francs.[162] La bravoure de Souwâr assurait son autorité sur ces troupes si nombreuses ; mais, lorsqu'il voyait dans sa maison un serpent, il sortait en fuyant et disait à sa femme : « A toi de t'en tirer avec le serpent ! » Elle se levait pour attaquer et elle tuait le serpent.
Le combattant, fût-il le lion, peut être anéanti et réduit à l'impuissance par le plus infime obstacle, comme il m'arriva devant Homs. Dans une sortie, mon cheval fut tué et je fus frappé par cinquante épées. Tout cela par un effet de la volonté divine, puis par la négligence de mon écuyer dans l'adaptation des rênes du mors, qu'il avait attachées aux anneaux, au lieu de les faire passer à travers. Lorsque je tirai les rênes pour me sauver, elles se détachèrent du lien qui les unissait aux anneaux, et il m'arriva ce qui m'arriva.
Un jour, le crieur public s'était fait entendre à Schaïzar du côté de la kibla (du sud). Nous fûmes bientôt équipés, prêts à partir. Mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) se mirent en mouvement et je me tins derrière eux. Le crieur public se montra alors au nord, du côté des Francs. Je montai sur mon cheval pour me diriger vers le crieur public. Je vis nos hommes traverser le gué, les uns sur les talons des autres ; je le traversai à mon tour et je leur dis : « Ne craignez rien, je suis là pour vous défendre. » Puis je gravis au galop la colline des Karmates (râbiyat Al-Karâmita),[163] et de là j'aperçus des cavaliers qui s'avançaient en masses considérables, ayant à leur tête un cavalier recouvert par une cotte de mailles et par un casque. Celui-ci s'était approché de moi. Je me dirigeai vers lui, voulant profiter de l'occasion contre lui d'abord, contre ses compagnons ensuite. Il vint à ma rencontre. Au moment où je poussais mon cheval vers lui, mon étrier se détacha. Je me trouvai forcément face à face avec lui et je m'élançai à sa rencontre sans étrier. Lorsque notre contact fut immédiat et qu'il ne me resta plus qu'à pointer de ma lance, mon adversaire me salua et m'offrit ses services. Or c'était le général (as-sallâr) 'Omar, l'oncle maternel du général (as-sallâr) Zain ad-Dîn Ismâ'îl ibn 'Omar ibn Bakhtyâr, qui était monté avec l'armée de Hama vers la place de Kafartâb. Les Francs avaient fait une sortie contre les assaillants qui, mis en déroute, s'en retournaient vers Schaïzar où ils avaient été précédés par l'émir Souwâr (qu'Allah l'ait en pitié !).
Le guerrier est exposé fréquemment à perdre l'équipement de son cheval. Or, la moindre chose, la plus légère, cause du dommage, parfois la mort, sans compter ce qu'amènent les décrets et les décisions d'Allah.
J'ai pris part à la lutte contre les lions dans des campagnes innombrables et j'en ai tué plus que personne au monde, sans qu'ils m'aient fait éprouver aucun mal.
Je sortis un jour à la chasse avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) sur une montagne voisine de Schaïzar, où nous lancions les faucons sur les perdrix. Nous étions sur la montagne, mon père et nous avec lui, ainsi que les fauconniers. Au pied de la montagne se tenaient quelques écuyers et des fauconniers pour recueillir les faucons et assurer leur repos dans les touffes de jusquiame. Une lionne nous apparut. J'entrai dans une caverne qui renfermait un repaire où elle s'était réfugiée. Je criai pour appeler un de mes écuyers, nommé Yousouf. Celui-ci se déshabilla, saisit un couteau et pénétra dans le repaire. Quant à moi, une lance à la main, je me tins en face de l'endroit. Lorsqu'elle sortirait, je lui donnerais un coup de lance. Mon écuyer cria : « Sur vos gardes !"Elle est sortie. » Je lui donnai un coup de lance, mais je la manquai, parce qu'elle avait le corps mince. L'écuyer cria : « Il y avait auprès de moi une autre lionne, qui est sortie sur les traces de la première. » Je me levai, je me tins près de la porte de la caverne, porte étroite, haute d'environ deux tailles d'homme, pour voir ce que nos compagnons, qui étaient dans la plaine, feraient à l'égard des lions qui étaient descendus vers eux.
Une troisième lionne sortit, alors que j'étais absorbé par l'attention que je prêtais aux deux premières. Elle me renversa, me jeta de la porte de la caverne vers les bas-fonds qui étaient au-dessous. Elle faillit me déchirer. Je fus endommagé par une lionne, moi qui n'avait pas été endommagé par les lions. Gloire à Celui qui rend les décrets, qui cause les causes ! J'ai assisté à des manifestations de faiblesse d'âme et de lâcheté chez certains hommes, que je n'aurais pas soupçonnées possibles, même chez les femmes. J'étais un jour sur la porte de la maison de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Je n'avais pas encore dix ans. Voici qu'un écuyer de mon père, nommé Mohammad Al-'Adjamî, souffleta un tout jeune serviteur de la maison. Celui-ci prit la fuite devant son agresseur et vint se suspendre à mon vêtement. Il fut bientôt rejoint par l'autre, tandis qu'il ne lâchait pas ma robe, et reçut un second soufflet. Je frappai Mohammad avec un bâton que je tenais à la main. Mohammad me repoussa. Je tirai alors un couteau que j'avais sur moi, je l'en frappai ; la lame pénétra dans son sein gauche et il tomba. Un vieil écuyer de mon père, nommé le kaïd Asad, nous rejoignit, s'arrêta près du blessé, examina sa plaie. Lorsque celui-ci revint à lui, les flots de sang en jaillissaient, semblables aux bulles qui se forment à la surface de l'eau. Le patient devint jaune, eut des frissons et perdit connaissance. On le porta dans sa maison. Il habitait avec nous dans la forteresse. Il ne put jamais se remettre de son étourdissement jusqu'à son dernier jour. Enfin, il mourut et fut enterré. »
Un fait de même nature est le suivant. Nous recevions à Schaïzar la visite d'un Alépin, homme distingué, lettré qui jouait aux échecs, soit devant une table, soit à distance. On l'appelait Abou 'l-Mardja' Salim ibn Kânit (qu'Allah l'ait en pitié !). Il passait chez nous chaque année un temps plus ou moins long. Plusieurs fois il tomba malade. Le médecin lui conseillait alors la saignée. Mais, lorsque l'opérateur se présentait devant lui, son teint s'altérait et il était saisi de frayeur. Après la saignée, il perdait connaissance et restait évanoui jusqu'à ce que l'ouverture fût bandée. Alors il se remettait.
Le contraire de cela était que nous avions parmi nos compagnons, parmi les Banoû Kinâna, un nègre nommé 'Ali ibn Faradj, sur le pied duquel avait poussé un furoncle. Les doigts du pied se gâtèrent et tombèrent malades ; le pied lui-même sentit mauvais. Le chirurgien dit au malade : « Il n'y a rien à faire pour ton pied, sinon de le couper. Autrement tu es perdu. » Le chirurgien se procura une scie et se mit à lui scier la jambe, au point que, terrassé par l'effusion de son sang, il perdit connaissance. Lorsqu'il fut remis, le chirurgien recommença son opération, jusqu'à ce qu'il eût enlevé le pied depuis le milieu de la jambe qui, bien soignée, guérit.
'Ali ibn Faradj (qu'Allah l'ait en pitié !) était un des hommes les plus robustes et les plus vigoureux. Il chevauchait sur sa selle avec un seul étrier ; de l'autre côté, il y avait une courroie dans laquelle était son genou. Il assistait au combat, luttait de la lance avec les Francs, malgré cet état d'infériorité. Je le voyais (qu'Allah l'ait en pitié !), défiant tout homme de le vaincre, soit par la ruse, soit par la contrainte. Il était d'humeur douce, en dépit de sa force et de sa bravoure.
Lui et les Banoû Kinâna, ils habitaient notre forteresse, la Forteresse du pont (housn al-djisr). Un certain jour, il envoya dès le matin vers des hommes parmi les notables des Kinânites pour leur faire dire : « Aujourd'hui, il tombe une petite pluie. Or, j'ai chez moi un restant de boisson fermentée et de victuailles. Faites-moi l'honneur de venir chez moi, que nous buvions. » On se réunit chez lui. Il s'assit devant la porte de la maison et dit : « Y en a-t-il un parmi vous qui pourrait sortir par cette porte, si je m'y opposais ? » Il faisait allusion à sa force. — « Non, répondirent les assistants, par Allah. » — Il reprit : « Aujourd'hui, il tombe une petite pluie. Il n'y a rien ce matin dans ma maison, ni farine, ni pain, ni boisson fermentée. Or, aucun de vous n'est dépourvu dans sa maison de ce dont il a besoin pour sa journée. Envoyez quérir dans vos maisons votre nourriture et votre boisson fermentée. Quant à moi, je fournirai la maison et nous nous réunirons aujourd'hui pour boire et pour converser. » — « D'accord, ô Abou 'l-Hasan, » répondirent-ils unanimement. Ils envoyèrent alors quérir ce que leurs maisons renfermaient à manger et à boire et achevèrent leur journée chez 'AU ibn Faradj, qu'ils vénéraient. Que soit exalté celui qui a créé ses créatures de plusieurs catégories ! Où retrouver pareille énergie, pareille force d'âme en présence de la lâcheté et de la faiblesse d'esprit de ces autres ?
Je rapprocherai de cela ce que m'a raconté un Kinânite dans la Forteresse du pont (housn al-djisr). Un de ceux qui l'habitaient devint hydropique. Il se fendit le ventre, guérit et reprit son ancien état de santé. Je dis : « J'aimerais le voir et l'interroger. » Or, mon information émanait d'un Kinânite, nommé Ahmad ibn Ma'bad ibn Ahmad, qui manda cet homme auprès de moi. Je l'interrogeai sur son état et sur la manière dont il s'était traité lui-même. Il répondit : « Je suis un mendiant dans la solitude. Mon ventre s'est gonflé par l'hydropisie au point que j'étais incapable de me mouvoir et que je me suis dégoûté de la vie. Alors j'ai pris un rasoir, j'ai asséné plusieurs coups sur les orifices de mon nombril, dans la largeur de mon ventre, que j'ai fendu. Il en est sorti deux marmites pleines d'eau (il voulait dire : deux mesures). A peine l'eau en avait-elle suinté sans arrêt que mon ventre s'est aminci. J'ai recousu le trou et soigné la blessure qui a guéri. Mon mal a complètement cessé. » J'examinai l'endroit où il avait pratiqué la fente de son ventre sur une longueur d'un empan. Sans aucun doute, cet homme avait eu sur la terre une faveur exceptionnelle.
Dans d'autres circonstances, j'ai vu un hydropique, dont le ventre avait été ouvert par le médecin. Il en sortit de l'eau, comme du ventre de celui qui se l'était fendu lui-même. Seulement il mourut de cette opération. Mais la destinée est une forteresse imprenable.
La victoire dans la guerre vient d'Allah (qu'il soit béni et exalté !), non pas des dispositions prises, de l'organisation, du nombre des fuyards et des vainqueurs. Toutes les fois que mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !) m'envoyait pour combattre les ennemis, Turcs ou Francs, je lui disais : « O mon maître, ordonne-moi les dispositions à prendre, lorsque je rencontrerai l'ennemi. » — Il répondait : « O mon cher fils, la guerre se dirige elle-même. » Et il disait vrai.
Mon oncle paternel m'avait prescrit de me charger de sa-femme et de ses enfants, celle-là une princesse (khatoun), fille de Tadj ad-Daula Toutousch, avec une escorte de troupes, et de partir pour les conduire à la forteresse de Masyâth, qui lui appartenait alors. Dans sa sollicitude pour eux, il voulait les soustraire aux chaleurs excessives de Schaïzar.
Je montai à cheval. Mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) montèrent à cheval avec nous, afin de nous conduire à une certaine distance. Puis, ils s'en retournèrent, accompagnés seulement de quelques jeunes mamlouks qui traînaient les montures de rechange et portaient les armes. Toutes les troupes étaient avec moi. En approchant de la ville, ils entendirent tous deux remuer le tablier[164] du pont, et dirent : « Il s'est passé quelque chose sur le pont. » Ils stimulèrent leurs chevaux, s'avancèrent avec précaution, et trottèrent dans cette direction. Une trêve avait été conclue entre nous et les Francs (qu'Allah les maudisse !), et pourtant ceux-ci s'étaient fait précéder par un homme qui leur révéla le secret d'un gué, d'où ils passeraient vers la Ville du pont (madînat al-djisr), située dans une île, à laquelle on ne pouvait accéder que par un pont voûté, construit de pierre et de chaux, protégé contre l'entrée des Francs. Cet espion leur indiqua la place du gué. Ils vinrent en masse d'Apamée sur leurs chevaux, et, dès l'aurore, ils arrivèrent au passage, qui leur avait été montré, traversèrent le fleuve, s'emparèrent de la ville, pillèrent, firent des prisonniers, tuèrent, envoyèrent une partie des captifs et du butin à Apamée, et s'installèrent dans les maisons. Chacun d'eux plaça comme marque distinctive sa croix sur une maison, ficha en terre devant la porte son étendard.
Lorsque mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) remontèrent à la citadelle, les habitants les implorèrent et se lamentèrent bruyamment. Or, il advint qu'Allah (gloire à lui !) répandit sur les Francs la terreur et l'impuissance. Les Francs ne reconnurent pas l'endroit où ils avaient franchi le fleuve. Ils lancèrent leurs chevaux, qu'ils montaient couverts de leurs cottes de mailles, sur un autre point que celui où était le gué de l'Oronte. Le nombre des noyés fut considérable, chaque cavalier plongeant dans l'eau, tombant de sa selle, et s'enfonçant dans l'abîme, tandis que le cheval remontait à la surface. Ceux qui ne périrent pas s'enfuirent en désordre, sans se préoccuper les uns des autres. Voilà ce qu'était devenue une armée considérable, tandis que mon père et mon oncle avaient en tout une escorte de dix mamlouks adolescents.
« Mon oncle resta dans la Ville du pont (al-djisr), et mon père retourna à Schaïzar. Quant à moi, j'avais conduit les enfants de mon oncle paternel à Masyâth. Le lendemain, je revins vers le soir, je fus informé des événements, je me présentai chez mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) et je le consultai pour savoir si je devais me rendre incontinent auprès de mon oncle à la Forteresse du pont (housn al-djisr). « Tu arriveras de nuit, me répondit-il, lorsqu'ils seront endormis. Vas-y plutôt demain matin. » Dès l'aurore, je me mis en route, je me présentai chez mon oncle et nous montâmes à cheval, afin de visiter l'endroit où les Francs s'étaient noyés. Quantité de nageurs lui offrirent leurs services et retirèrent de l'eau de nombreux cadavres de cavaliers Francs. Je dis à mon oncle : « O mon maître ! ne trancherons-nous pas leurs têtes, pour les envoyer à Schaïzar ? » — « Fais-le, si tu veux », me répondit-il. Il nous suffit de trancher vingt têtes environ. Le sang en découlait, comme si la mort les avait atteints à ce moment même, et cependant elle remontait à un jour et une nuit. J'imagine que l'eau avait conservé leur sang dans cet état. Nos hommes s'approprièrent des armes de tout genre en grand nombre, cottes de mailles, épées, bois de lances, casques, chausses de mailles.
Et j'ai vu un des laboureurs (fallâh) de la Ville du pont (al-djisr), qui s'était présenté devant mon oncle paternel, sa main cachée sous ses vêtements. Mon oncle lui dit, en plaisantant avec lui : « Que m'as-tu donc réservé comme ma part du butin ? » — Il répondit : « Je t'ai réservé un cheval avec son équipement, une cotte de mailles, un bouclier et une épée. » L'homme partit et apporta le tout. Mon oncle accepta l'équipement, mais rendit le cheval, et reprit : « Qu'as-tu dans la main ? ». — L'autre répondit : « Nous nous sommes empoignés, moi et le Franc. Je ne possédais ni équipement, ni épée. Je renversai le Franc, et je lui donnai un si violent coup de poing à la figure, que recouvrait le bas d'un heaume en mailles, que je l'étourdis et que je saisis son épée avec laquelle je le tuai. La peau des articulations de mes doigts fut réduite en charpie, et ma main enfla au point que je ne pouvais pas m'en servir. » Il nous montra sa main. Elle ressemblait à sa description et laissait voir à découvert les os de ses doigts.
Il y avait dans l'armée de la Ville du pont {al-djisr) un Kurde, nommé Abou ‘l-Habasch, dont la fille Rafoûl avait été faite prisonnière par les Francs. Abou 'l-Habasch soupirait sur la captivité de sa fille, disant à quiconque le rencontrait pendant une journée entière : « Rafoûl a été faite prisonnière ». Nous sortîmes le lendemain pour nous avancer le long du fleuve et nous vîmes sur la rive une masse noire. Aussitôt l'un des écuyers reçut l'ordre de nager, d'examiner cette masse noire. Il s'y rendit. Or, voici que c'était Rafoûl revêtue d'un vêtement bleuâtre. Elle s'était jetée de sur le cheval du Franc qui l'avait conquise et s'était noyée, son vêtement restant suspendu à un saule. Le gémissement de son père Abou 'l-Habasch finit par s'apaiser.
Le cri de détresse qui avait retenti au milieu des Francs, leur déroute et leur mort furent dus à une grâce d'Allah et non à une supériorité de forces ou à une armée. Béni soit Allah qui décrète ce qu'il veut !
La crainte que l'on inspire est quelquefois profitable à la guerre. C'est ainsi que l'atabek parvint en Syrie, et je l'accompagnais, en l'année 529.[165] Damas était son objectif. Nous avions fait halte à Al-Koutayyifa. Salah ad-Dîn[166] me dit : « Monte à cheval, et devance-nous jusqu'à Al-Foustouka. Ne t'écarte pas de la route, afin qu'aucun de nos soldats ne puisse fuir dans la direction de Damas. » Je pris les devants et, après une heure d'attente, voici que Salah ad-Dîn était venu me rejoindre à la tête d'un petit nombre de ses compagnons.
Un nuage de fumée s'élevait sous nos yeux à 'Adhrâ. Salah ad-Dîn envoya des cavaliers examiner d'où provenait cette fumée. C'étaient des hommes de l'armée de Damas, qui faisaient brûler de la paille en abondance dans 'Adhrâ. Ils s'enfuirent. Salah ad-Dîn les poursuivit, et nous l'escortions, trente ou quarante cavaliers tout au plus. Arrivés à Al-Kousair, nous y trouvâmes l'armée de Damas toute entière, barrant l'accès du pont. Nous nous tenions dans le voisinage du caravansérail. Ce fut notre cachette. Nous en faisions sortir cinq ou six cavaliers à la fois, pour que l'armée de Damas les aperçût. Ils revenaient ensuite se mettre à l'abri dans le caravansérail, nos ennemis étant convaincus que nous y avions établi une embuscade.
Salah ad-Dîn fit partir un cavalier vers l'atabek pour lui faire connaître notre situation critique. Tout à coup, nous vîmes environ dix cavaliers se diriger vers nous en toute hâte et derrière eux s'avançait l'armée en rangs serrés. Ils parvinrent jusqu'à nous. A ce moment même, l'atabek venait d'arriver. Son armée le suivait. Zengui adressa des reproches à Salah ad-Dîn sur ce qu'il avait fait, et lui dit : « Tu t'es lancé précipitamment jusqu'à la porte de Damas avec trente cavaliers pour te faire tailler en pièces, ô Mohammad.[167] » Et il le réprimanda. Tous deux s'exprimaient en turc, et je ne savais pas le sens de leurs paroles.
Lorsque les avant-gardes de notre armée nous eurent rejoints, je dis à Salah ad-Dîn : « Ordonne seulement, je prendrai avec moi ceux qui sont arrivés jusqu'à présent, je fondrai sur les cavaliers de Damas, qui sont postés en face de nous, et je les délogerai. » — « N'en fais rien », me répondit-il. Pour donner un tel conseil, quand on est au service de Zengui, il faut n'avoir pas entendu la manière dont il m'a traité. » N'était la faveur d'Allah le Très Haut, n'était cette crainte et cette terreur qui leur fut inspirée, nos ennemis nous auraient délogés.
Il m'arriva pareille chose. J'avais accompagné mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !), se rendant de Schaïzar à Kafartâb. Avec nous il y avait pas mal de laboureurs (fallâh) et de vagabonds, avides de piller dans la banlieue de Kafartâb des récoltes et du coton. Ces hommes se dispersèrent pour piller, tandis que les cavaliers de Kafartâb étaient montés à cheval pour se poster devant leur ville. Nous étions entre eux et la populace disséminée au milieu des champs et des plants de coton. Voici qu'un de nos compagnons, un cavalier d'entre les éclaireurs, arriva vers nous au galop en disant : « La cavalerie d'Apamée est arrivée. » Mon oncle paternel me dit : « Tu resteras en face des cavaliers de Kafartâb, tandis que j'emmènerai les troupes pour aller à la rencontre des cavaliers d'Apamée. » Je me tins à la tête de dix cavaliers dissimulés par les oliviers. De temps en temps, trois ou quatre d'entre eux nous quittaient pour faire illusion aux Francs et pour retourner ensuite vers les oliviers, tandis que les Francs s'imaginaient que nous étions en nombre. Eux étaient concentrés, criaient, poussaient leurs chevaux jusque dans notre voisinage, tandis que nous ne bougions pas, afin de les voir rebrousser chemin. Cette situation se prolongea jusqu'au retour de mon oncle paternel et jusqu'à la déroute des Francs venus d'Apamée.
Un des écuyers de mon oncle lui dit : « O mon maître, tu vois ce qu'il a fait (c'était de moi qu'il parlait). Il est resté en arrière et n'a pas pris part à la bataille que tu as livrée aux cavaliers d'Apamée. » — Mon oncle lui répondit : « Si Ousâma n'avait pas, à la tête de dix cavaliers, retenu la cavalerie et l'infanterie de Kafartâb, ils auraient pris possession de cette contrée entière. » Inspirer la crainte et la terreur aux Francs avait, à cette époque, plus d'avantages que leur livrer bataille. Car nous étions peu nombreux, tandis qu'ils disposaient d'armées considérables.
Il m'arriva encore pareille aventure à Damas. J'étais un jour avec l'émir Mou'în ad-Dîn[168] (qu'Allah l'ait en pitié), lorsqu'un cavalier vint lui dire : « Les brigands ont fait main basse sur une caravane, qui passait sur la colline, emportant des étoffes de coton écru. » Mou'în ad-Dîn me dit : « Tu vas chevaucher dans leur direction. » — Je répondis : « A toi d'ordonner ; dis aux officiers de ta garde de faire monter à cheval tes troupes pour t'accompagner. » — Il reprit : « Qu'avons-nous besoin des troupes ? » — J'insistai : « En quoi, dis-je, leur concours peut-il nous nuire ? » — Il répéta : « Nous n'avons pas besoin d'elles. »
Mou'în ad-Dîn était un cavalier intrépide ; mais, dans certaines circonstances, l'audace est un excès et une calamité. Nous partîmes, vingt cavaliers au plus. Le lendemain matin, Mou'în ad-Dîn lança deux cavaliers par ci, deux autres par là, encore un sur une autre piste pour explorer les chemins. Nous deux également, nous nous avancions à la tête de quelques hommes. Lorsqu'il fut temps de faire notre prière de l'après-midi, Mou'în ad-Dîn dit à un de mes écuyers : « O Sawindj, monte examiner vers l'ouest, dans quel sens nous devons nous tourner pour prier. » Celui-ci nous avait à peine salués qu'il revenait au galop, disant : « Ces hommes sont dans la vallée ; ils portent sur leurs têtes des pièces d'étoffes écrues. » Mou'în ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) ordonna de monter à cheval. Je lui dis : « Laisse-nous quelque répit pour revêtir nos casaques rembourrées. Puis, lorsque nous les approcherons, nous saisirons les têtes de leurs chevaux et nous les frapperons de nos lances, sans qu'ils sachent si nous sommes plus ou moins nombreux. » — « Non, répondit-il, c'est lorsque nous les aurons rejoints que nous revêtirons nos casaques. »
Il monta à cheval et se dirigea avec nous vers les brigands. Nous les atteignîmes dans la vallée de Halboûn, vallée étroite, où la distance entre les deux montagnes est à peine de cinq coudées et aux deux côtés de laquelle les montagnes sont escarpées, très élevées. Le défilé ne livre passage qu'à un cavalier après l'autre.
Les brigands formaient une troupe de soixante-dix fantassins, munis d'arcs et de flèches en bois. Nous étions arrivés jusqu'à eux, mais nos écuyers étaient en arrière avec nos armes, fort à distance de nous. Nos adversaires étaient, les uns dans la vallée, les autres au pied de la montagne. Je m'imaginai que les premiers étaient de nos compagnons, et je les pris pour des laboureurs de la campagne, que la frayeur aurait entraînés jusque-là ; à mes yeux, les seconds seuls étaient les brigands.
Je brandis mon épée, et je m'élançai contre ceux-ci. Mon cheval, en grimpant sur le roc escarpé, faillit rendre le dernier soupir. Lorsque je fus arrivé, et que mon cheval s'arrêta, incapable de se mouvoir, l'un d'eux agita sa flèche en bois dans sa main pour me frapper. Je poussai un cri retentissant, et je l'intimidai. Il retira sa main de sur moi, et je fis aussitôt redescendre mon cheval. J'avais peine à croire que je leur échapperais.
L'émir Mou'în ad-Dîn gravit le sommet de la montagne, espérant y trouver des laboureurs (fallâh), qu'il comptait exciter au combat. Il me cria d'en haut : « Ne lâche pas nos ennemis jusqu'à ce que je revienne », et demeura caché à nos regards. Je revins vers ceux qui étaient dans la vallée ; j'avais enfin reconnu que c'étaient les brigands. Je fis une charge contre eux, à moi seul, tant l'endroit était resserré ! Ils s'enfuirent en laissant tomber les étoffes de coton écru qu'ils portaient, et je leur enlevai deux mulets qu'ils emmenaient et qui portaient également des étoffes de coton écru. Ils montèrent jusqu'à une caverne située sur la pente de la montagne. Nous les voyions sans pouvoir nous frayer un chemin jusqu'à eux.
L'émir Mou'în ad-Dîn revint vers le soir, mais il n'avait pas fait de nouvelles recrues. Si l'armée avait été avec nous, pas un de ces brigands n'aurait eu la vie sauve, et nous aurions recouvré toute leur capture.
Une aventure analogue m'arriva une autre fois, et la cause en fut, d'abord l'accomplissement de la volonté divine, puis le manque d'expérience guerrière. Nous étions partis avec l'émir Kotb ad-Dîn Khosrou ibn Talîl de Hama pour nous rendre à Damas au service d'Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !), et nous étions parvenus à Homs. Lorsque Khosrou se disposa au départ sur la route de Balbek, je lui dis : « J'irai en avant pour visiter l'église de Balbek ', en attendant que tu me rejoignes. » — « Fais, » répondit-il. Je montai à cheval et je m'en allai.
J'étais dans l'église, lorsqu'un cavalier vint me dire de la part de Khosrou : « Une bande de voleurs a marché contre une caravane, dont ils se sont emparés. Monte à cheval, reviens vers moi dans la direction de la montagne. » Je montai à cheval, je le rencontrai et, ayant gravi la montagne, nous aperçûmes les voleurs, au-dessous de nous dans la vallée, que cette montagne, sur laquelle nous étions, entoure de tous les côtés. Un compagnon de Khosrou lui dit : « Tu vas descendre vers eux. » — J'intervins : « Ne le fais pas. Nous contournerons le sommet, gardant notre position au-dessus de leurs têtes, nous leur barrerons la route vers l'ouest et nous les ferons captifs. » Ces voleurs venaient des régions franques. Un autre compagnon[169] dit : « A quoi bon contourner le sommet ? Nous sommes arrivés jusqu'à eux, c'est comme s'ils étaient déjà nos prisonniers. » On résolut de descendre. Lorsque les voleurs nous virent, ils montèrent sur la montagne. Khosrou me dit : « Monte, rattrape-les. » Je fis des efforts pour gravir la pente, mais sans y réussir.
Il était resté sur la montagne quelques-uns de nos cavaliers, six ou sept, qui mirent pied à terre pour se mesurer avec les brigands et marchèrent, menant en laisse leurs chevaux. Les brigands, qui étaient nombreux, se précipitèrent sur nos compagnons, tuèrent deux de leurs cavaliers et s'emparèrent de leurs deux chevaux, ainsi que d'un troisième cheval dont le possesseur put s'échapper. Quant aux brigands, ils descendirent par l'autre versant de la montagne, emportant leur butin.
Nous nous en retournâmes, après que deux de nos cavaliers eurent été tués et qu'on nous eut pris trois chevaux, ainsi que la caravane. Un tel aveuglement avait eu pour origine le manque d'expérience guerrière.
Lorsqu'on se jette aveuglément dans les périls, ce n'est pas que l'on fasse fi de l'existence. La seule cause de cette témérité, c'est que l'homme, connu pour son courage et appelé un héros, lorsqu'il assiste au combat, subit l'obsession de son ambition qui l'oblige à faire ce dont il a la réputation et ce qui le distingue des autres hommes. Et pourtant son âme, qui redoute la mort et le danger, le dominerait presque et le détournerait de ses projets, s'il ne la contraignait pas et s'il ne l'entraînait pas à ce qu'elle déteste. Il éprouve au début de la stupeur et il pâlit ; mais, une fois lancé dans la mêlée, son effroi disparaît et son trouble s'apaise.
J'ai assisté au siège de la forteresse d'As-Saur,[170] avec le roi des émirs, l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !), dont j'ai déjà rapporté plusieurs exploits. La forteresse appartenait à l'émir Fakhr ad-Dîn Kara Arslan, fils de Dâwoud, fils de Sokmân, l'Ortokide (qu'Allah l'ait en pitié !), et elle était garnie d'arbalétriers. L'atabek Zengui s'était auparavant épuisé en vains efforts contre Amid.
Aussitôt que les tentes furent dressées, l'atabek envoya l'un de ses compagnons crier au-dessous de la citadelle : « O troupe d'arbalétriers, l'atabek me charge de vous dire : Par la grâce du sultan, si un seul de mes compagnons tombe victime de vos flèches, je vous couperai les mains. » L'atabek mit en position contre As-Saur les machines de guerre qui abattirent un côté de la place. A peine ce côté était-il abattu que les troupes y montèrent. Un garde du corps de l'atabek, un Alépin, nommé Ibn Al-'Ouraik, monta par cette brèche, attaqua de son épée les arbalétriers qui lui infligèrent plusieurs blessures et le jetèrent du haut de la forteresse dans le fossé. Nombre de nos combattants passèrent ensuite par cette brèche et conquirent la forteresse. Les lieutenants de l'atabek y arrivèrent et en prirent les clefs qu'ils firent parvenir à Housâm ad-Dîn Timourtasch, fils d'Ilgazi, l'Ortokide, auquel l'atabek la céda.
Il advint qu'une flèche d'arbalète atteignit au genou un homme de la troupe du Khorasan et lui fendit la partie arrondie qui est à l'intersection du genou. Cet homme mourut. Au premier moment, après que l'atabek se fut emparé de la forteresse, il fit mander les arbalétriers, neuf en tout, qui vinrent avec leurs arcs bandés sur les épaules. Il ordonna de détacher à chacun d'eux les pouces des poignets ; leurs mains se desséchèrent et dépérirent.
Quant à Ibn Al-'Ouraik, il soigna ses blessures et guérit, après avoir frôlé la mort. Il était courageux, affrontant les dangers.
J'ai été témoin d'un fait du même genre. L'atabek Zengui avait campé devant la forteresse d'Al-Bâri'a, qui est entourée de blocs de rochers sur lesquels on ne peut pas dresser les tentes. L'atabek descendit dans la plaine et délégua dans le commandement les émirs à tour de rôle. Un jour, l'atabek se dirigea à cheval vers ses troupes. Le roulement avait amené à leur tête Abou Bakr Ad-Doubaisî, qui était mal outillé pour le combat. L'atabek s'arrêta et dit à Abou Bakr : « Va de l'avant, combats les ennemis. » Abou Bakr entraîna ses compagnons, bien qu'ils n'eussent pas d'équipement. Les défenseurs de la citadelle firent une sortie contre les assaillants.
Un compagnon d'Abou Bakr, nommé Mazyad, qui ne s'était encore fait connaître, ni par son ardeur batailleuse, ni par son courage, prit les devants, se battit avec acharnement, donna des coups d'épée dans les rangs ennemis, dispersa leurs masses et reçut plusieurs blessures. Je le vis lorsqu'on le transporta vers notre armée. Il semblait rendre le dernier soupir. Puis il guérit. Abou Bakr Ad-Doubaisî en fit un officier, lui donna un manteau d'honneur et se l'attacha comme garde du corps.
L'atabek disait : « J'ai trois serviteurs dont l'un craint Allah le Très Haut et ne me craint pas. » Il désignait ainsi Zain ad-Dîn 'Ali Koûdschek (qu'Allah l'ait en pitié !). « Le deuxième me craint et ne craint pas Allah le Très Haut. »
Il désignait ainsi Nasir ad-Dîn Sonkor (qu'Allah l'ait en pitié !). « Le troisième ne craint ni Allah ni moi. » Il désignait ainsi Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî (qu'Allah l'ait en pitié !).
J'ai constaté chez Salah ad-Dîn (puisse Allah se détourner de lui !) ce qui justifie la parole de l'atabek à son sujet. Un jour nous avions assailli Homs où, la nuit précédente, le sol avait été détrempé par une pluie si abondante que les chevaux ne pouvaient pas se mouvoir dans l'épaisseur de ce bourbier, tandis que les fantassins luttaient. corps à corps. Salah ad-Dîn s'était arrêté, m'ayant avec lui. Nous voyions les fantassins devant nous. L'un d'eux se rendit de grand matin vers les fantassins de Homs et se mêla à eux, sous les yeux de Salah ad-Dîn. Celui-ci dit à l'un de ses compagnons : « Amène cet homme qui était à côté du déserteur. » On partit et on l'amena. Salah ad-Dîn lui dit : « Quel était ce fantassin qui s'est enfui d'auprès de toi et qui est entré dans Homs ? » — Il répondit : « Par Allah, ô mon maître, je ne le connais pas. » — « Tranchez-le par le milieu », s'écria Salah ad-Dîn. — Je dis : « O mon maître, emprisonne-le, et fais une enquête sur le déserteur. S'il le connaissait ou s'il était uni avec lui par quelque parenté, tu lui couperas le cou. Sinon, tu aviseras. » Salah ad-Dîn parut incliner à mes idées. Mais un de ses écuyers, placé derrière lui, dit : « L'un s'enfuit, on met la main sur son voisin. Qu'on lui coupe le cou ou qu'on le tranche par le milieu ! » Sa parole mit en fureur Salah ad-Dîn qui dit : « Tranchez-le par le milieu. » On lui lia le pied selon l'usage et on le trancha par le milieu. Cet homme n'avait commis aucune faute, sinon d'avoir persisté dans son attitude et d'avoir trop peu craint Allah le Très Haut.
J'ai vu dans une autre circonstance Salah ad-Dîn, à notre retour de la bataille de Bagdad, alors que l'atabek voulait faire montre de persévérance et d'énergie, alors qu'il avait ordonné à Salah ad-Dîn de se diriger vers l'émir Kafdjâk pour l'assiéger. Notre voyage au départ de Mossoul dura six jours, avec des privations extrêmes, pour arriver à l'endroit où était l'émir et où nous le trouvâmes comme suspendu dans les montagnes du Kouhistân. Nous établîmes notre camp devant une forteresse nommé Mâsourra, où notre arrivée eut lieu au lever du soleil. Une femme se montra sur le rebord de la citadelle et dit : « Avez-vous apporté du coton écru ? » — Notre réponse fut : « Le moment nous semble peu propice à la vente et à l'achat. » — Elle reprit : « Nous voudrions du coton écru pour vos linceuls ; car, d'ici cinq jours, vous mourrez tous. » Elle entendait par là que cet endroit était insalubre.
Salah ad-Dîn s'établit et prit ses mesures pour attaquer la citadelle dès le lendemain matin. Il ordonna aux sapeurs de pénétrer sous une des tours, la citadelle étant toute entière construite en argile et les hommes qui s'y trouvaient appartenant tous à la classe des laboureurs (fallâh). L'attaque eut lieu, nous gravîmes la colline qui portait la citadelle, les troupes du Khorasan minèrent une tour qui tomba avec deux hommes, dont l'un mourut et dont l'autre fut fait captif par nos compagnons. On l'amena à Salah ad-Dîn qui dit : « Tranchez-le par le milieu. » — Je dis : « O mon maître, nous sommes au mois de ramadan, c'est un musulman, ne nous chargeons, pas d'un péché par son meurtre. » — Il reprit : « Tranchez-le par le milieu, afin que la citadelle capitule. » — Je répliquai : « O mon maître, la citadelle, tu la posséderas dans un instant. » Il répéta : « Tranchez-le par le milieu », et s'entêta dans cette résolution. On trancha l'homme par le milieu et aussitôt après nous prîmes possession de la citadelle.
On vit bientôt Salah ad-Dîn s'avancer vers la porte, dans l'intention de redescendre de la citadelle, avec ses troupes victorieuses. Il confia la garde de la citadelle à quelques-uns de ses compagnons et partit pour s'installer un moment dans sa tente, tant que durerait la dispersion de son armée. Ensuite il monta à cheval et me dit : « Monte aussi. » Nous chevauchâmes pour aller vers les hauteurs de la citadelle. Il s'assit, fit venir le gardien de la citadelle, qui devait le renseigner sur ce qu'elle renfermait et qui introduisit devant lui des femmes et des jeunes gens, des chrétiens et des juifs.
Il se présenta une vieille, une Kurde, qui dit à ce gardien : « As-tu vu mon fils, un tel ? ».— Le gardien répondit : « Il a été tué ; une flèche en bois l'a atteint. » — Elle reprit : « Et mon fils, un tel ? » —Le gardien répondit : « L'émir l'a tranché par le milieu. » Elle cria, se découvrit la tête, montra sa chevelure semblable à du coton cardé. Le gardien lui dit : « Tais-toi à cause de l'émir. » — « Mais, répondit-elle, que reste-t-il à l'émir qu'il puisse faire contre moi ? J'avais deux fils qu'il a tués. » On la renvoya.
Le gardien fit comparaître ensuite un vieillard (schaïkh) très âgé, avec des cheveux blancs magnifiques, qui marchait sur deux bâtons. Il salua Salah ad-Dîn, qui dit : « Qu'est-ce que ce vieillard ? » — Le gardien répondit : « C'est l'imâm de la forteresse. » — « Avance, 6 vieillard, s'écria Salah ad-Dîn, avance ! » Il le fit asseoir devant lui, étendit la main, le saisit par la barbe, sortit un couteau serré dans la ceinture de sa robe et coupa cette barbe à partir du menton. Elle lui resta dans la main en fils comme des articulations de doigts. Le vieillard dit à Salah ad-Dîn : « O mon maître, comment ai-je mérité ta manière d'agir envers moi ? » — L'émir répondit : « Par ta rébellion contre le sultan. » — « Par Allah, reprit le vieillard, je n'ai rien su de ton arrivée avant qu'à l'instant le gardien soit venu m'en instruire et me faire comparaître. »
Puis nous allâmes camper devant une autre citadelle, appelée Al-Karkhînî, dont le seigneur était aussi l'émir Kafdjâk, et dont nous prîmes possession. On y trouva un magasin rempli de vêtements cousus en coton écru, aumône destinée aux pauvres de La Mecque. Salah ad-Dîn s'empara de ce que possédaient les habitants de la citadelle, chrétiens et juifs coalisés, et on les dépouilla de leurs biens, à la manière dont le pillage est pratiqué par les Grecs (Ar-Roum). Puisse Allah (gloire à lui !) se détourner de Salah ad-Dîn !
C'est à ce point du chapitre que je m'arrêterai pour lui appliquer ce vers dont je suis l'auteur :
Renonce à mentionner avec complaisance les assassins ; car ce qu'on raconte d'eux ferait blanchir parmi nous les cheveux des nouveau-nés.
Je reviens à rapporter quelques détails sur ce qui nous advint, à nous et aux Ismaéliens, dans la forteresse de Schaïzar.
Pendant cette journée,[171] un de mes cousins, nommé Abou Abd Allah ibn Hâschim (qu'Allah l'ait en pitié !), vit en passant un Bathénien dans une tour du palais de mon oncle paternel. Ce Bathénien avait avec lui son épée et son bouclier. La porte était ouverte. Au dehors stationnait une foule nombreuse de nos compagnons. Pas un n'osait se diriger vers le Bathénien. Mon cousin 'dit à l'un de ceux qui se tenaient là : « Entre vers lui. » Cet homme entra. Sans tarder, le Bathénien lui asséna un coup et le blessa. Il sortit blessé. Mon cousin dit à un autre : « Entre vers lui. » Cet autre entra, fut frappé, blessé, et sortit comme était sorti son prédécesseur. Alors mon cousin dit : « O chef (ra'îs) Djawâd, entre vers lui. » Le Bathénien' s'adressa au chef Djawâd en ces termes : « O artisan de souffrances que tu es ! Que n'entres-tu pas ? Tu fais entrer vers moi les autres hommes, tandis que tu demeures immobile. Entre, ô artisan de souffrances, pour voir de tes yeux. » Le chef Djawâd entra vers le Bathénien qu'il tua. Ce Djawâd était un arbitre dans les luttes, un homme d'une grande bravoure.
Peu d'années se passèrent jusqu'à l'époque où je le revis à Damas.[172] Il était devenu marchand de fourrages, vendeur d'orge et de paille, et avait vieilli, au point d'être devenu semblable à l'outre usée, de ne plus pouvoir chasser les rats de sa marchandise.
Qu'est-ce donc que la vie des hommes ? Je m'étonnais des commencements de Djawâd pour aboutir à ce dénouement et des changements que sa longévité avait apportés à son état. J'ai longtemps ignoré que la maladie de la vieillesse est générale, s'attaquant à tous ceux que la mort a oubliés. Mais, maintenant que j'ai gravi le sommet des quatre-vingt-dix ans, que le passage des jours et des années m'a épuisé, je suis devenu comme Djawâd le marchand de fourrages et non pas comme le prodigue (al-djawâd), le dissipateur. La faiblesse m'a figé au sol, la vieillesse a fait rentrer une partie de mon corps dans l'autre, au point que je ne me suis plus reconnu moi-même, que j'ai soupiré sur ce que j'étais hier et que j'ai dit en décrivant mon état :
Lorsque j'atteins de la vie un terme que je désirais, je souhaite le trépas.
La longueur de mon existence ne m'a pas laissé d'énergie pour combattre les vicissitudes du temps, quand elles m'attaquent en ennemies.
Mes forces sont affaiblies et j'ai été trahi par les deux alliés en qui j'avais mis ma confiance, ma vue et mon ouïe, alors que je suis monté jusqu'à cette limite.
Car, lorsque je me lève, je m'imagine soulever une montagne ; si je marche, je crois marcher attaché avec des chaînes.
Je rampe, le bâton dans cette main que j'ai connue portant pour les combats une lance fauve et une épée en acier de l'Inde.
Je passe la nuit sur la couche la plus moelleuse dans l'insomnie et dans l'agitation, comme si j'étais étendu sur des rochers.
L'homme est renversé de haut en bas dans la vie. C'est au moment même où il arrive à la perfection et à la plénitude qu'il retourne à ses commencements.
Et c'est moi pourtant qui disais autrefois à Misr pour condamner le bien-être et le laisser-aller de l'existence (comme elle a rapidement et promptement marché vers son dénouement !) :
Regarde les vicissitudes de ma vie, comme elle m'a accoutumé, après que mes cheveux sont devenus blancs, à de nouvelles habitudes !
Et dans cette transformation qu'a apportée le revirement du temps il y a un enseignement par l'exemple. Quel est l'état que les jours écoulés n'aient point modifié ?
J'avais été un brandon de guerre ; toutes les fois que la guerre s'éteignait, je la rallumais en frottant comme des briquets les épées blanches sur les gardes des sabres.
Mon seul souci était de lutter avec mes rivaux que je considérais comme des proies que je déchirerais ; car ils tremblaient devant moi ;
Qui faisais pénétrer plus de terreur qu'une nuit, qui m'élançais plus impétueux qu'un torrent, plus entreprenant sur le champ de bataille que la mort.
Or, je suis devenu comme la jeune fille flexible, langoureuse, qui repose sur les coussins rembourrés, derrière le voile et les rideaux.
J'ai failli tomber en poussière par la durée de ma halte, comme l'épée indienne est rouillée par une trop longue attente dans les fourreaux.
Après les cottes de mailles de la guerre, je suis enveloppé dans des manteaux en étoffes de Dabîk ; malheureux que je suis, malheureux manteaux !
L'aisance n'est ni ce que je recherche ni ce que je poursuis ; la jouissance n'est ni mon affaire, ni ma préoccupation.
Et je n'aimerais atteindre ni la gloire dans une vie d'abondance, ni la célébrité sans briser les épées blanches et les fers des lances.
Et je m'imaginais alors que le favori du temps n'est jamais usé, que son héros n'est jamais affaissé, et que, lorsque je retournerais en Syrie, j'y retrouverais mes jours comme je les avais connus, sans que le temps y eût rien changé pendant mon absence. Mais, lorsque je revins, les promesses de mes désirs me prouvèrent le mensonge de mes illusions, et cette imagination s'évanouit comme l'éclat du mirage. 0 Allah, pardonne-moi cette phrase incidente qui m'a échappé par l'effet d'un chagrin qui s'est abattu sur moi et qui s'est ensuite dissipé. Je reviens au sujet qui m'occupe et je me dégage de l'oppression de la nuit ténébreuse.
Si les cœurs étaient purifiés de la souillure des péchés, s'ils s'en remettaient à Celui qui connaît les mystères, ils sauraient que s'exposer aux dangers des guerres n'abrège pas l'éloignement du terme inscrit d'avance. Car j'ai vu, au jour où nous nous combattions, nous et les Ismaéliens, dans la forteresse de Schaïzar, un enseignement par l'exemple, qui démontre à l'homme courageux et intelligent, et même à l'homme lâche et stupide, que la durée de l'existence est fixée, marquée par le destin, sans que le terme en puisse être avancé ni retardé.
Lorsque, dans cette journée, nous eûmes fini de combattre, un homme cria sur le côté de la forteresse : « Les ennemis ! » J'avais auprès de moi quelques-uns de mes compagnons avec leurs armes. Nous courûmes en hâte vers celui qui avait crié. Nous lui dîmes : « Qu'as-tu ? » — Il répondit : « Je flaire ici les ennemis. » Nous nous rendîmes vers une étable vide, obscure, et nous y entrâmes. Il s'y trouvait deux hommes armés qui furent tués par nous. Nos recherches nous firent ensuite rencontrer un de nos compagnons qui avait été assassiné. Son corps reposait sur quelque chose. Lorsqu'il eut été soulevé, il recouvrait un Bathénien qui s'était enveloppé d'un linceul et avait placé le corps sur sa poitrine. Après avoir emporté notre compagnon, nous tuâmes celui qui était au-dessous de lui et, par nos soins, il fut déposé, lui, dans la mosquée voisine de cet endroit, criblé de blessures graves. Nous ne mettions pas en doute qu'il fût mort, puisqu'il ne se mouvait pas et qu'il ne respirait plus. Et moi, par Allah, je remuais avec mon pied sa tête sur les dalles de la mosquée, et nous cloutions de moins en moins qu'il fût mort. Le malheureux avait passé devant cette étable, avait entendu un bruit léger et avait avancé sa tête pour vérifier ce qu'il entendait. Un des Bathéniens l'ayant tiré en avant, on lui avait donné des coups de poignard jusqu'à ce qu'il passât pour mort. Mais Allah (gloire à lui !) décida que ces blessures au cou et sur tout le corps fussent recousues, qu'il guérît et qu'il revînt à son ancien état de santé. Béni soit Celui qui rend les décrets, qui fixe les trépas et les vies !
J'ai assisté à quelque chose de semblable. Les Francs (qu'Allah les maudisse !) avaient fait une incursion contre nous dans le dernier tiers de la nuit. Nous montâmes à cheval dans l'intention de les poursuivre. Mon oncle Izz ad-Dîn[173] (qu'Allah l'ait en pitié !) nous retint et nous dit : « C'est une embuscade et l'attaque aura lieu de nuit. » A notre insu, des fantassins avaient quitté Schaïzar pour se lancer à la poursuite des Francs qui tombèrent sur une compagnie d'entre eux à sa rentrée et la décimèrent. Les autres échappèrent au massacre.
Le lendemain matin, je me tenais à Bandar Kanîn, village dans la banlieue de Schaïzar, lorsque je vis s'avancer trois individus, deux ressemblant à des hommes, celui du milieu avec une face différente de ce que sont les faces humaines.
Ils approchèrent de nous. Celui du milieu avait été frappé par un Franc d'un coup d'épée en plein nez et son visage avait été fendu jusqu'aux oreilles. La moitié de son visage, devenu pendant, était retombée sur sa poitrine, et 'entre les deux moitiés de sa face était une ouverture presque large d'un empan. Il marchait entre deux compagnons. Ce fut ainsi qu'il rentra à Schaïzar. Le chirurgien lui recousit le visage et le soigna. Cette blessure fut de nouveau recouverte de chair. Il guérit et revint à son ancien état jusqu'à ce qu'il mourût sur sa couche. Il vendait des bêtes de sommes et était appelé Ibn Gazi le Balafré (Ibn Gazi al-maschtoûb). Son surnom de Balafré était dû à ce coup d'épée.
Qu'on n'aille pas s'imaginer que la mort peut être avancée par la témérité à affronter le danger, ni retardée par l'excès de la prudence. En effet, ma vie prolongée fournit l'instruction la plus frappante par l'exemple. Car que d'effrois j'ai bravés, combien de fois me suis-je précipité dans les lieux redoutables et au milieu des dangers ! Combien ai-je combattu de cavaliers, tué de lions ! Que de coups j'ai portés avec les épées, d'atteintes avec les lances ! Que de blessures j'ai faites avec les flèches et avec les arbalètes ! Je n'en suis pas moins par rapport au trépas dans une forteresse inaccessible, au point que j'ai accompli mes quatre-vingt-dix ans et que j'ai considéré mon état de santé et de vie comme conforme à la parole du Prophète : « La santé me suffit comme maladie. » En effet, ma délivrance de ces dangers a eu comme conséquence ce qui est plus pénible que la mort violente et que le combat. Et mourir à la tête d'un détachement de l'armée m'eût été plus doux que les difficultés de l'existence. Parce que ma vie a duré trop longtemps, les jours écoulés m'ont repris tous les plaisirs qui en faisaient le charme, et la souillure de la privation a troublé la limpidité de mon existence prospère.
C'est de moi-même que j'ai dit :
Avec mes quatre-vingts années, le temps a flétri ma peau, et j'ai enduré la faiblesse de mon pied, le tremblement de ma main ;
Lorsque j'écris, alors je semble tracer des caractères avec la pointe de l'épée d'un homme effrayé ; on les dirait l'œuvre d'un vieillard aux paumes vacillantes, saisi d'épouvante.
Aussi étonne-toi d'une main incapable de manier le kalam, après qu'elle a brisé les lances dans le poitrail du lion.
Si je marche, soutenu par mon bâton, il n'y a pas terrain si dur que mon pied alourdi n'y enfonce, comme dans la vase.
Dis à celui qui souhaite une longue existence : Regarde les conséquences de la longévité et de la sénilité !
Mon énergie s'est affaiblie et a été ruinée, le bien-être de ma vie a disparu et a pris fin, j'ai été renversé par la trop longue durée de mon séjour parmi les humains, mon feu allumé dans les ténèbres tend à s'éteindre, et je suis devenu conforme à ce que j'avais dit :
Les destins paraissent m'avoir oublié, au point que je me sens harassé comme une chamelle exténuée d'avoir longtemps voyagé dans le désert.
Et mes quatre-vingts ans ne m'ont laissé aucune force ; si je veux me lever la nuit pour prier, je suis comme brisé en morceaux.
J'accomplis ma prière en restant assis ; et me prosterner, lorsque je désire me mettre à genoux, m'est un supplice.
Cet état m'a averti que le temps du voyage suprême est proche, et que l'heure du départ est arrivée.
Affaibli par les années, j'étais devenu impuissant à servir les sultans ; je cessai de vivre sur le seuil de leurs palais, je séparai mes destinées de leurs destinées, je demandai à être relevé de mes fonctions, et je leur rendis les biens dont ils m'avaient gratifié. Je ne savais que trop combien l'abaissement produit par la caducité fait perdre les forces nécessaires pour remplir de lourdes tâches, et combien le vieillard (schaïkh) âgé est pour l'émir une marchandise hors de vente. Je me confinai dans ma maison, je fis de l'obscurité mon trait distinctif, je finis par trouver une vraie satisfaction dans mon isolement à l'étranger et dans ma retraite, loin de ma patrie et du sol natal. Ma répugnance finit par s'apaiser au point que je n'éprouvai plus aucune amertume. Je pris patience, comme le captif s'habitue à ses chaînes, comme le voyageur altéré supporte la violence de la soif, tant qu'il ne trouve pas à l'étancher.
Enfin, je fus mandé par une lettre missive de notre maître Al-Malik An-Nasir Salah ad-Dîn,[174] le sultan de l'islam et des musulmans, celui qui sert de trait d'union pour l'affirmation de la foi, qui frappe les adorateurs des croix, qui élève le drapeau de la justice et des bonnes œuvres, qui ressuscite l'autorité de l'émir des croyants,[175] Abou 'l-Mouthaffar Yousouf, fils d'Ayyoub. Puisse Allah embellir l'islam et les musulmans en lui accordant longue vie, les fortifier par les épées et les conceptions acérées de notre maître, leur concéder la faveur de s'abriter à son ombre étendue, comme il leur a concédé la faveur de remplacer les sources impures par les abreuvoirs de sa générosité ! Puisse Allah faire pénétrer jusqu'aux extrémités de la terre sa haute puissance d'ordonner et de défendre, établir ses sabres tranchants comme des arbitres sur les cous de ses ennemis ! Car sa clémence a creusé des mines pour m'atteindre dans les contrées, alors que j'y vivais, séparé de lui par les montagnes et les plaines, dans un coin perdu de la terre, n'ayant plus ni fortune ni famille.
Tout à coup, il m'arracha à la morsure des malheurs, grâce à sa belle initiative, me transporta à sa noble cour par un effet de sa bienveillance large et abondante, répara ce que le temps avait brisé de ma personne, et, dans sa grandeur d'âme, remit en vogue le vieillard qui, hors lui, n'aurait pas trouvé preneur. Il répandit sur moi les faveurs les plus étonnantes, m'autorisa, dans sa générosité, à m'emparer, comme d'un butin, de ses dons les plus parfaits, au point que, grâce à sa libéralité débordante, il me récompensa de mes services antérieurs auprès d'autres princes. Il m'en tenait compte et y avait égard avec tant de sollicitude qu'il paraissait y avoir assisté, en avoir été témoin. Ses cadeaux prenaient le chemin de ma maison pendant mon sommeil, et affluaient vers moi, alors que j'étais accroupi, que je restais assis.
Maintenant, grâce à sa munificence, je suis de plus en plus comblé chaque jour de biens et d'honneurs ; grâce à la noblesse de ses intentions, il m'a mis, moi, le plus humble des serviteurs d'Allah, à l'abri des chances d'accidents. Sa grâce m'a rendu ce que m'avait arraché le temps par des chocs terribles ; il a versé sur moi ses largesses, après que sa règle et sa tradition m'eurent tant alloué que les cous les plus solides ne sauraient porter le plus léger de ses bienfaits ; et sa générosité n'a laissé subsister aucun de mes désirs, dont j'aie à souhaiter la satisfaction, que j'emploie mon temps à lui réclamer jour et nuit.
Sa miséricorde s'est étendue à tous les serviteurs d'Allah, ses bénédictions ont fait revivre les contrées. Il est le sultan qui a restauré la tradition des khalifes bien dirigés,[176] qui a relevé la colonne de la dynastie et de la foi, la mer dont l'eau ne s'épuise point par le grand nombre de ceux qui s'y désaltèrent, le donateur prodigue, dont la libéralité ne s'arrête pas, malgré les rangs serrés des visiteurs. La nation n'a pas cessé de se sentir, par ses épées comme dans une forteresse imprenable, par sa générosité comme dans un printemps aux pluies bienfaisantes, par sa justice comme dans des rayons de lumière, qui dissipent les ténèbres des vexations et qui éloignent la main étendue de l'ennemi violent, par son autorité puissante comme sous des ombrages touffus, dans un bonheur ininterrompu, le bonheur nouveau suivant la trace du bonheur passé, tant que se succéderont la nuit et le jour, tant que tournera le globe céleste.
[161] Mou in ad-Din Anar.
[162] En 1137.
[163] Lecture douteuse, peut-être râbiyat Al-Karâfita.
[164] Peut-être convient-il de traduire : Ils entendirent tous deux battre la timbale du pont.
[165] L'atabek Zengui. Du 22 octobre 1134 au 10 octobre 1135.
[166] Salah ad-Din Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguisiyâni.
[167] Le texte porte : yâ moûsâ « ô Moïse ».
[168] Mou'in ad-Din Anar.
[169] Mot douteux.
[170] Vers 1133.
[171] Vers 1135.
[172] Du 28 août 1139 au 16 août 1140.
[173] 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân.
[174] Le grand Saladin, en 1174. Le texte porte la formule plus complète : Salah ad-dounyâ wa-'d-dîn.
[175] L'émir des croyants est le khalife 'Abbaside de Bagdad, Al-Moustadi'.
[176] Expression imitée du Coran, xlix, 7, par laquelle on désigne les quatre khalifes orthodoxes, successeurs immédiats du Prophète, Abou Bekr, 'Omar, 'Othman et Ali.