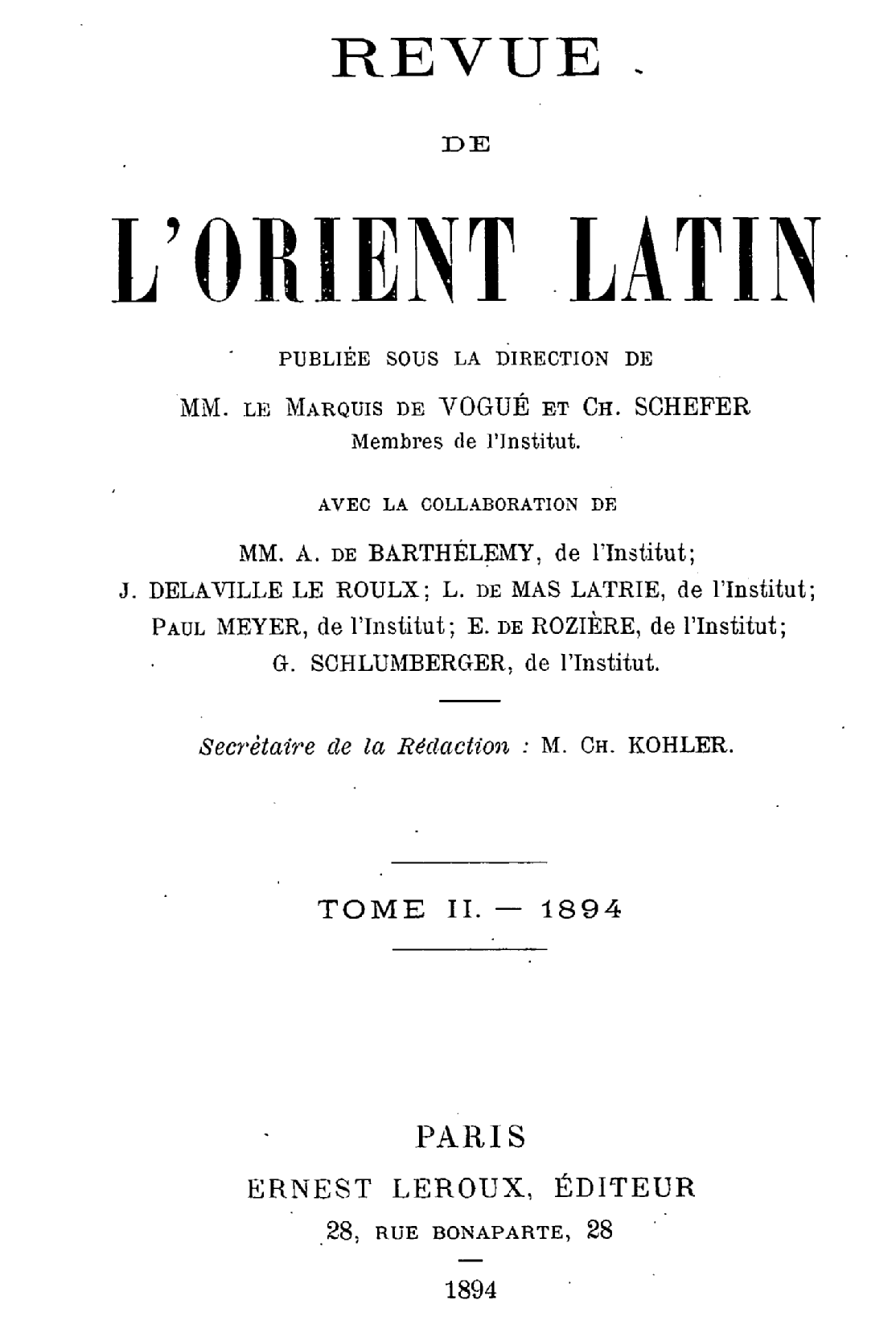
OUSAMA IBN MOUNKIDH
AUTOBIOGRAPHIE : Partie I
Traduction française : HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
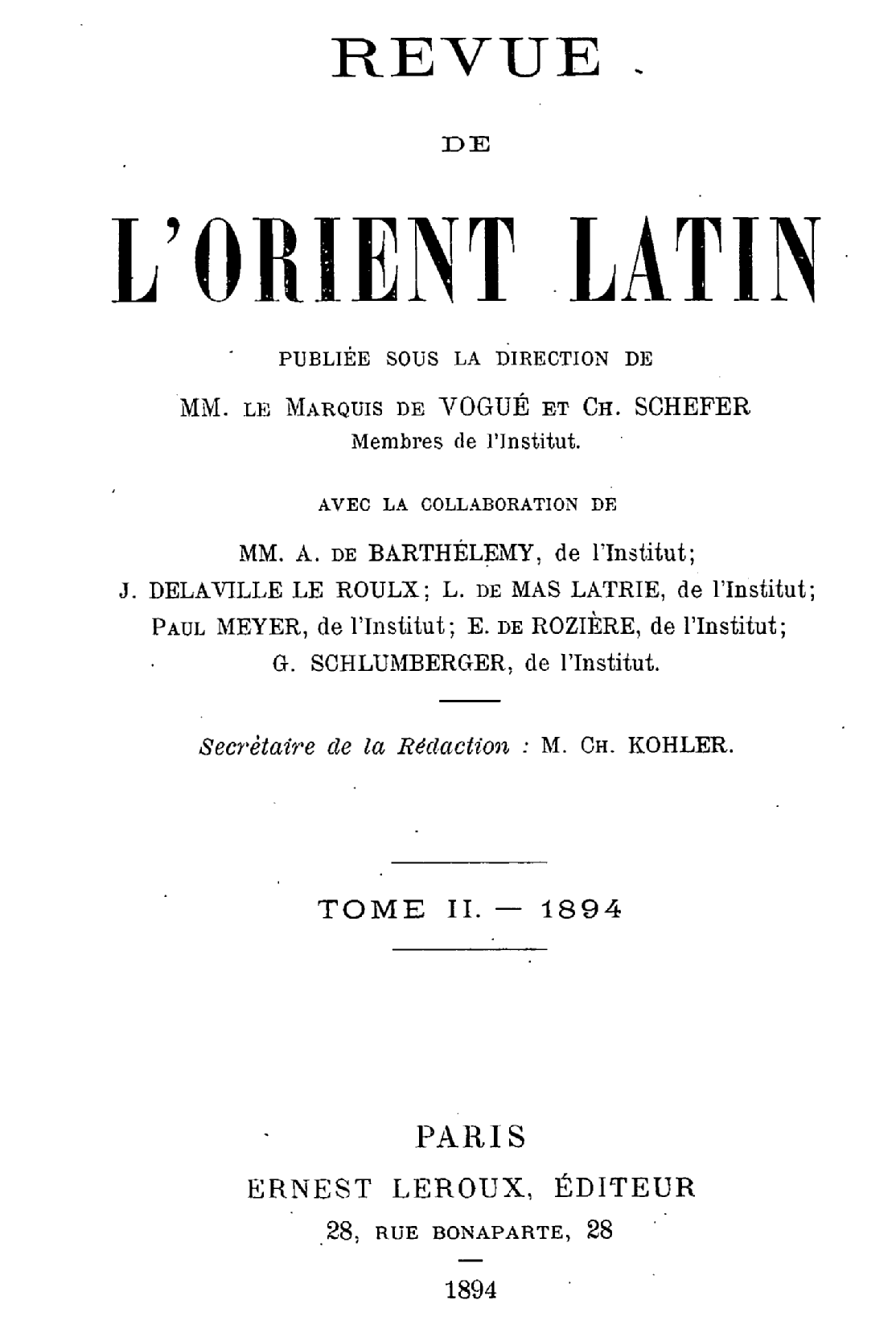
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
TRADUCTION FRANÇAISE D'APRÈS LE TEXTE ARABE
PAR
HARTWIG DERENBOURG
Quelques bons juges, MM. Barbier de Meynard, Hagenmeyer et Wellhausen, tout en manifestant leur sympathie pour mon essai de restitution historique dans la Vie d'Ousâma, ont exprimé le regret que je n'aie pas mis à leur disposition une traduction suivie, exacte, calquée sur l’Autobiographie, sans additions et sans omissions, avec l'ordonnance originale du document authentique lui-même. Le reproche impliquait une invitation trop flatteuse pour ne pas être acceptée avec empressement par l'éditeur de l'Autobiographie. Il croyait avoir rompu pour quelque temps le lien qui l'a uni à l'émir de Schaïzar pendant de longues années. C'est à recommencer, m'assure-t-on, au risque de quelques redites et de répétitions inévitables. Je me soumets, en saisissant cette occasion de mieux rendre les parties déjà connues de l'Instruction par les exemples, d'améliorer la formé de premier jet que j'avais adoptée, quand j'ai reproduit naguère en français un grand nombre de passages.
Lorsque je suis allé à l'Escurial en 1880, les feuillets du texte arabe étaient disséminés au hasard dans plusieurs liasses. Je les ai reconnus et rassemblés. Il ne subsiste plus de lacunes entre eux jusqu'à la fin, y compris la souscription. Mais le commencement, les quarante-deux premières pages, ont échappé à toutes les investigations. En conséquence, pas d'introduction, pas d'avertissement au lecteur. On entre dans le livre au milieu d'un récit de bataille, par la fin d'une phrase commencée. Ce début insolite ajoute encore à ce que la rédaction de l'auteur présente de décousu, d'incohérent, excepté peut-être dans le chapitre final sur les soixante-dix années de chasses, où se sont complus le jeune homme et le vieillard. Cette monographie si curieuse de pure cynégétique devait-elle être omise dans un recueil consacré exclusivement à l'Orient latin ? Après réflexion, je ne l'ai pas pensé. La faune ne doit pas être négligée par ceux qui étudient un pays à une époque donnée et certaines notices d'écrivains chrétiens seront utilement contrôlées par les assertions sincères et expérimentées d'Ousâma.
Je me suis demandé d'autre part si je ne donnerais pas plus de relief à l'ouvrage sauvé de l'oubli d'Ousâma Ibn Mounkidh, en y pratiquant d'habiles coupures, en l'allégeant de détails insignifiants, d'anecdotes notoirement indifférentes aux lecteurs de cette Revue. Ma réponse à cette question ne pouvait être ni hésitante, ni favorable au système des éliminations. Il m'a paru qu'un choix, pour impartial et pour raisonné qu'il s'efforçât d'être, deviendrait forcément parfois embarrassé, souvent arbitraire, toujours inspiré par des tendances de goût personnel, et que les avantages d'une traduction intégrale, sans aucune mutilation, en dépasseraient de beaucoup les inconvénients. Bien loin de rien élaguer, j'ai tenu à être aussi complet que possible ; dans ce but, j'ai ajouté, sous forme d'appendice, trois morceaux que j'ai retrouvés ailleurs, fragments empruntés à la première partie, aujourd'hui perdue, de l'Autobiographie.
On excusera la sobriété de l'annotation : il a paru oiseux de refaire ou de reproduire ici le commentaire qu'avec l'index les amateurs curieux de détails et d'explications n'auront aucune peine à retrouver dans ma Vie d'Ousâma.
PAR
et c'est ainsi qu'on désigne
Mou'ayyad ad-Daula Abou 'l-Mouthaffar Ousâma,
fils de mourschid,
de la tribu de Kinâna, de la ville de schaizar,
de la race des mounkidhites.
[11][L'atabek Zengui] avait reconnu que le combat redevenait très meurtrier pour les musulmans. Or il était arrivé de la part de l'imâm Ar-Rachid, fils d'Al-Moustarschid Billah (qu'Allah les ait tous deux en pitié !)[12] un envoyé auprès de l'atabek pour le mander. C'était Ibn Bischr. Il prit part à cette bataille.[13] Une cuirasse dorée le couvrait. Un cavalier franc, nommé Ibn Ad-Dakîk, le frappa de sa lance en pleine poitrine. L'arme lui ressortit par le dos (qu'Allah l'ait en pitié !). En revanche, un très grand nombre de Francs furent massacrés. L'atabek ordonna qu'on réunît leurs têtes dans un champ cultivé qui fait face à la citadelle. On pouvait les évaluer à trois mille têtes.
Plus tard, l'empereur des Grecs[14] avait de nouveau quitté le pays pour se rendre dans les contrées de Syrie en l'an 532.[15] Ils avaient conclu un accord, lui et les Francs (qu'Allah leur fasse défection !). Les alliés s'étaient concertés pour se porter vers Schaïzar et pour l'assiéger. Salah ad-Dîn[16] me dit : « Ne sais-tu pas ce qu'a fait mon fils que j'ai subrogé en ma place[17] ? » Il désignait ainsi son fils Schihâb ad-Dîn Ahmad. — « Eh bien, dis-je, qu'a-t-il fait ? » — « Il a envoyé, me répondit-il, un messager vers moi pour m'inviter à me pourvoir de quelque autre qui se charge d'administrer mon territoire. » — Je repris : « Et toi, qu'as-tu-fait ? » — « J'ai, me dit-il, envoyé moi aussi un messager vers l'atabek pour remettre en sa possession un endroit qui lui appartient. » — Je m'écriai : « Que tu as mal agi ! L'atabek ne serait-il pas fondé à dire de toi : Lorsque ce sont des morceaux de viande, il les mange ; ne reste-t-il plus que des os, il me les jette ? » — « S'il en est ainsi, demanda-il, que me conseilles-tu ? » — Je lui répondis : « Je m'installerais dans la ville. Si Allah le Tout Puissant lui apporte le salut, ce sera grâce à ta bienheureuse intervention, et tu pourras te présenter la tête haute chez ton maître.[18] Si la ville est prise et que nous soyons tués, ce sera un effet de nos destinées et tu n'auras encouru aucun reproche. » — Il se contenta de répliquer : « Personne ne m'a encore tenu pareil langage. »
Je m'imaginais qu'il écouterait mon avis. Je réunis les troupeaux, de la farine en quantité, de la graisse.et ce qui nous était nécessaire pour supporter un blocus. J'étais dans ma maison, située à l'ouest de la ville.[19] lorsqu'un messager vint me trouver de sa part et me dit : « Salah ad-Dîn te fait prévenir qu'après-demain nous nous mettrons en route vers Mossoul. Prends tes dispositions en conséquence pour le départ. » Mon cœur se serra à la pensée d'abandonner mes enfants, mes frères et mes femmes dans une ville assiégée, tandis que je me rendrais à Mossoul.
Le lendemain, à l'aurore, je montai à cheval et je me dirigeai vers latente de Salah ad-Dîn. Je lui demandai l'autorisation de rentrer à Schaïzar. C'était pour moi une nécessité absolue. Il me répondit : « Lorsque ta famille traverse une telle épreuve, ne t'attarde pas. » Mon cheval me transporta rapidement à Schaïzar.
Le spectacle qui s'y offrit à mes yeux attrista mon cœur. Mon fils[20] avait combattu bravement, puis était descendu de sa monture et avait pénétré dans ma maison. Il en avait enlevé tout ce qui s'y trouvait en fait de tentes, d'armes et de selles et s'était chargé de défendre les êtres aimés.[21] Mes compagnons poursuivirent sans relâche une lutte qui fut un malheur terrible, épouvantable.
Puis les circonstances déterminèrent mon départ pour Damas, tandis que les émissaires de l'atabek[22] se succédaient pour me desservir auprès du prince de Damas.[23] Je restai dans cette ville pendant huit années,[24] et j'y assistai à nombre de combats. Le prince (qu'Allah l'ait en pitié !) m'octroya libéralement une redevance et un fief. Il me distingua en m'admettant dans son intimité et en me faisant des honneurs. Ces faveurs s'ajoutaient aux marques de bienveillance dont j'étais l'objet de la part de l'émir Mou'în ad-Dîn[25] (qu'Allah l'ait en pitié !), aux obligations que je lui avais, à la sollicitude qu'il témoignait pour mes intérêts.
Diverses causes m'obligèrent ensuite à gagner l'Egypte. Il s'égara bien des ustensiles de ma maison, ainsi que beaucoup d'armes que je ne pus emporter avec moi, et les pertes que j'éprouvai dans mes possessions furent pour moi une nouvelle catastrophe. Et cependant l'émir Mou'în ad-Dîn. me voulait du bien, m'aimait et était très affligé de me laisser partir, mais il avouait son impuissance à me soutenir. Ce fut au point qu'il m'envoya son secrétaire, le chambellan Mahmoud Al-Moustarschidî, qui me dit en son nom : « Par Allah, si je disposais de la moitié des hommes, je me mettrais à leur tête pour battre l'autre moitié ; si je disposais seulement du tiers des hommes, je me mettrais à leur tête pour battre les deux autres tiers et je ne t'abandonnerais pas. Mais la population entière s'est coalisée contre moi, et je n'ai plus sur elle aucune autorité.
En quelque lieu que tu sois, l'amitié que je te porte te restera fidèle. » C'est à ce sujet que je dis :
Mou’in ad-Dîn, combien de colliers ta générosité attache à mon cou, ainsi que les colliers des colombes !
Tes bienfaits font de moi ton esclave volontaire : les cœurs généreux prodiguent la becquée de leurs bienfaits.
Ce n'est que de ton affection que je me réclame encore, si nobles que soient ma race et mes actions.
N'as-tu pas su que, pour avoir fait remonter mon origine à ta personne, chaque archer m'a visé au cœur ?
Sans toi, mon naturel intraitable n'aurait jamais subi de violence, que je ne l'eusse effacée avec mon sabre.
Mais j'ai redouté le feu allumé par tes ennemis contre toi, et pourtant j'avais agi pour éteindre l'incendie.
Mon arrivée à Misr[26] eut lieu le jeudi deux du second djoumada, en l'an 539.[27] Aussitôt Al-Hâfith li-dîn Allah[28] m'enjoignit de rester,[29] ordonna qu'en sa présence on me revêtit d'un manteau d'honneur, me donna une riche garde-robe et cent dinars, me fit introduire dans ses bains et m'assigna comme résidence une maison magnifique parmi les maisons d'Al-Afdal, fils de l'Émir des armées (amîr al-djouyoûsch).[30] On y avait laissé les nattes, les tapis et une installation complète, avec quantité d'ustensiles en cuivre. Tout cela m'était octroyé à titre définitif. Aussi restai-je longtemps à Misr, honoré, respecté, comblé de faveurs non interrompues, tirant les revenus d'un fief prospère.
Les nègres, alors fort nombreux, étaient animés de mauvais sentiments et ressentaient de l'aversion les uns contre les autres. On voyait, d'une part les Raihânites, fidèles serviteurs d'Al-Hâfith, d'autre part les Djouyoûschites, les Alexandrins et les Farhites. Les Raihânites étaient seuls pour faire face à tous les autres unis contre eux. Une partie des jeunes gens de la garde particulière faisaient cause commune avec les Djouyoûschites. Les troupes affluaient dans les deux camps. Al-Hâfith tenta une médiation ; ses représentants allèrent et vinrent et il s'efforça d'amener la pacification ; mais il échoua dans ses démarches auprès des combattants massés aux alentours de son palais. Dès le lendemain matin, la rencontre eut lieu au Caire. Les Djouyoûschites et leurs alliés remportèrent la victoire sur les Raihânites, qui laissèrent mille morts sur le Petit Marché de l'Émir des armées (souwaikat amîr al-djouyoûsch), au point que tout l'emplacement en fut chargé. Nous ne cessions pas d'être sous les armes nuit et jour, dans la crainte d'une attaque des Djouyoûschites, comme autrefois avant mon arrivée au Caire.
Après le massacre des Raihânites, on se figurait généralement qu'Al-Hâfith, dans son mécontentement, sévirait contre leurs meurtriers. Mais Al-Hâfith était malade, à toute extrémité et mourut (qu'Allah l'ait en pitié !) deux jours après. Il n'y eut pas deux chèvres pour se disputer à coups de corne sa succession. Le khalifat échut à Ath-Thâfir bi-amr Allah, le plus jeune de ses fils. Celui-ci prit pour vizir Nadjm ad-Dîn Ibn Masâl, un vieillard très âgé, tandis que l'émir Saïf ad-Dîn Abou ‘l-Hasan 'Ali Ibn As-Sallâr était alors relégué dans l'administration d'une province. Celui-ci recruta et rassembla des troupes, marcha sur Le Caire et s'y rendit dans sa propre maison. De son côté, Ath-Thâfir bi-amr Allah convoqua les émirs dans le Palais du vizirat et envoya vers nous le régisseur des palais, chargé de nous dire : « O émirs, ce Nadjm ad-Dîn est mon vizir et mon représentant. Que quiconque m'obéit lui obéisse et se conforme à ses ordres. » — Les émirs s'écrièrent : « Nous sommes les esclaves soumis et fidèles de notre maître. » L'intendant rapporta cette réponse.
Ce fut à ce moment qu'un émir vénérable, nommé Lakroûn, prit la parole en ces termes : « O émirs, laisserons-nous massacrer 'Ali Ibn As-Sallâr ? » — « Non, par Allah, » répondirent-ils.— « Dans ce cas, dit Lakroûn, agissez. » Ils partirent tous, sortirent du Château, sellèrent leurs chevaux et leurs mulets et apportèrent leur concours à Saïf ad-Dîn Ibn As-Sallâr.
Lorsque Ath-Thâfir vit ce mouvement et qu'il eut essayé en vain de l'enrayer, il mit à la disposition de Nadjm ad-Dîn Ibn Masâl des sommes considérables et lui dit : « Rends-toi dans le Hauf, réunis des hommes, groupe-les, fais leur des distributions d'argent et repousse avec eux Ibn As-Sallâr. »
Ibn Masâl se mit en route pour exécuter ces instructions. Mais Ibn As-Sallâr entra au Caire et pénétra dans le Palais du vizirat. L'armée entière fut d'accord pour lui promettre obéissance. Il traita les troupes avec bonté. Il m'ordonna à moi, ainsi qu'à mes compagnons, de séjourner dans sa maison, et m'y assigna un endroit où j'habiterais.
Dans le Hauf, Ibn Masâl avait rassemblé en grande quantité des hommes de Lawâta, des soldats de Misr, des nègres et des Arabes. Roukn ad-Dîn 'Abbâs, beau-fils de 'Ali Ibn As-Sallâr, était sorti de la ville et avait établi ses campements en dehors de Misr. Le lendemain matin, une bande de Lawâta, commandée par un parent d'Ibn Masâl, apparut tout à coup et se dirigea vers la tente qu'il occupait. Un certain nombre d'hommes de Misr quittèrent 'Abbâs en fuyant. Quant à lui, il resta ferme à son poste avec ses officiers d'ordonnance et ceux de ses soldats qui tinrent bon jusqu'au soir de cette attaque par surprise.
Ibn As-Sallâr, informé de ce qui s'était passé, me fit venir pendant la nuit. J'habitais sa maison. Il me dit : « Ces chiens (il entendait par là les soldats de Misr) ont retenu l'émir (il désignait ainsi 'Abbâs) dans de vains amusements jusqu'au moment où une bande de Lawâta s'est élancée à la nage contre lui. Ils se sont alors enfuis, quelques-uns sont même rentrés dans leurs maisons au Caire, bien que l'émir s'y opposât. » — Je répondis : « O mon maître, à l'aube nous monterons à cheval pour attaquer cette engeance et, avant le milieu de la matinée, nous en aurons fini avec eux, si Allah le Tout Puissant le veut. » — « C'est bien, dit Ibn As-Sallâr, monte à cheval au point du jour. »
Le lendemain, à la première heure, nous fîmes une sortie contre nos adversaires. Pas un seul d'entre eux n'échappa, excepté ceux à qui leurs chevaux firent traverser le Nil à la nage. Le parent d'Ibn Masâl fut fait prisonnier et eut le cou tranché.
L'armée toute entière, sous les ordres de 'Abbâs, fut alors dirigée contre Ibn Masâl. 'Abbâs le rencontra devant Dalâs, mit en déroute ses partisans et tua Ibn Masâl lui-même. Il n'y eut pas moins de dix-sept mille hommes tués, nègres et blancs. La tête d'Ibn Masâl fut apportée au Caire, et il ne resta plus personne qui s'obstinât ou qui se révoltât contre Saïf ad-Dîn.
Ath-Thâfir revêtit Ibn As-Sallâr du manteau du vizirat, et le surnomma Al-Malik Al-’Adil « le roi juste ». Il fut chargé du pouvoir, malgré la répugnance et l'aversion qu'il inspirait à Ath-Thâfir, qui nourrissait contre lui de mauvaises pensées et qui avait même conçu la résolution de le mettre à mort.
Le khalife convint avec quelques-uns des jeunes gens de sa garde particulière et avec d'autres personnes, dont il obtint le concours et qu'il soudoya, qu'on envahirait la maison d'Ibn As-Sallâr et qu'on le mettrait à mort. On était au mois de ramadan.[31] Les conjurés se réunirent dans une maison voisine de celle qu'occupait le vizir, pour attendre que la nuit fût à moitié passée et que les compagnons d'Al-’Adil[32] se fussent dispersés.
J'étais ce soir-là dans sa société. Lorsque ses commensaux eurent fini de souper et qu'ils eurent pris congé de lui, le vizir, informé en toute hâte par un de ses fidèles de ce qu'on tramait contre lui, manda deux hommes d'entre ses gardes du corps et ordonna que ses gardes du corps feraient invasion en masse dans la maison où ses ennemis étaient réunis. Cette maison, par la volonté d'Allah, qui avait résolu de ne pas les faire périr tous, avait deux portes, l'une voisiné, l'autre éloignée de la maison d'Al-’Adil. Une première troupe pénétra par la porte la plus rapprochée avant que les autres fussent parvenus à la seconde porte par laquelle passèrent et sortirent nombre de fuyards, entre autres environ dix jeunes gens de la garde particulière du khalife, amis de mes officiers d'ordonnance, qui vinrent à moi pendant cette nuit pour que nous les cachions. Le lendemain matin, la ville entière était occupée à rechercher les fuyards. Tous ceux sur lesquels on réussit à mettre la main furent tués.
Une des choses étonnantes que je vis en ce jour fut la fuite d'un nègre d'entre les conspirateurs qui chercha une retraite à l'étage supérieur de ma maison, tandis qu'on le poursuivait l'épée à la main. Il s'éleva au-dessus du sol à une hauteur considérable. Dans la cour de ma maison était un grand figuier. Du toit en terrasse, il sauta dans la direction de cet arbre, y tomba juste, puis descendit, entra par un couloir étroit qui était là tout près et qui aboutissait à un salon, marcha sur un flambeau de cuivre, le brisa, et alla se cacher derrière un tas de bagages amoncelés dans le salon. Ceux qui le poursuivaient étaient montés après lui. Je poussai un cri retentissant pour les effrayer, et je les fis rejoindre par mes officiers d'ordonnance, qui les éloignèrent. J'allai trouver ce nègre. Il avait ôté un riche costume qu'il portait et me dit : « Prends-le pour toi. » —Je répondis : « Qu'Allah te comble de ses faveurs ! Je n'en ai pas besoin. » Je fis sortir cet homme sous bonne escorte, et il fut sauvé.
Je m'assis alors sur un banc de pierre dans le vestibule de ma maison. Voici qu'entra vers moi un jeune homme qui salua et s'assit. J'admirai sa conversation et ses réparties. Nous étions entrain de causer, lorsqu'on vint l'appeler ; aussitôt il se laissa emmener. J'envoyai l'un de mes officiers d'ordonnance que je chargeai de le suivre et de me rapporter la cause de cet appel pressant. L'endroit où je me tenais était voisin du palais d'Al-’Adil. Dès que le jeune homme eut été introduit devant le vizir, celui-ci ordonna de lui couper le cou, et incontinent il fut mis à mort. Mon officier d'ordonnance revint vers moi, il s'était informé de la faute si cruellement punie. On lui répondit : « Ce jeune homme écrivait de faux firmans.[33] » Gloire à celui qui fixe la durée des existences et l'heure des trépas !
La guerre civile avait fait de nombreuses victimes parmi les soldats de Misr et parmi les nègres.
Le vizir Al-Malik Al-’Adil me donna comme instruction de m'équiper pour me rendre vers Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn[34] (qu'Allah l'ait en pitié !) et me dit : « Tu emporteras de l'argent et tu te rendras vers lui pour qu'il mette le siège devant Tibériade et pour qu'il détourne de nous l'attention des Francs. Cette diversion nous permettra, en partant d'ici, d'aller ravager Gaza. » Or les Francs (puisse Allah leur faire défection !) avaient commencé à reconstruire Gaza[35] pour se mettre en mesure de bloquer ensuite Ascalon. Je répondis : « O mon maître, si Nour ad-Dîn allègue des excuses, ou que d'autres préoccupations l'arrêtent, que m'ordonnes-tu ? » — Il me dit : « Dans le cas où il dresserait ses tentes devant Tibériade, donne-lui la somme qui sera entre tes mains. Si, au contraire, il est empêché par un obstacle quelconque, enrôle autant de soldats que tu le pourras. Monte alors vers Ascalon, restes-y pour combattre les Francs et annonce-moi ton arrivée pour que je te transmette des ordres en conséquence. »
Al-’Adil me remit six mille dinars de Misr et toute une charge de bête de somme en étoffes de Dabîk, en soie brochée d'or, en fourrures de petit-gris, en brocart de Damiette, en turbans. Il mit à ma disposition des guides arabes, sous la conduite desquels je partis. Il ne m'avait laissé aucun prétexte de ne point voyager, en me fournissant tout ce dont j'avais besoin, gros et menu.
Lorsque nous fûmes arrivés près d'Al-Djafr, les guides me dirent : « Voici un endroit qui ne peut pas manquer de contenir des Francs. » Sur mon ordre, deux d'entre les guides montèrent sur deux dromadaires, pour nous précéder à Al-Djafr. Au bout d'un moment, ils revinrent, leurs dromadaires les ramenant au grand galop. « Les Francs, s'écrièrent-ils, sont près d'Al-Djafr. » Je ne bougeai pas, je réunis les chameaux chargés de mes bagages et quelques hommes de ma caravane, et je les ramenai vers l'ouest. Puis j'interpellai six cavaliers qui étaient à mon service, et je leur dis : « Précédez-nous, je m'avance sur vos traces. » Ils se mirent à trotter, tandis que je les suivais. L'un d'eux revint vers moi et me dit : « Pas âme qui vive près d'Al-Djafr. Peut-être les' guides ont-ils pris des corbeaux pour des hommes. » Les guides et lui se disputèrent.
Je fis alors revenir ceux qui avaient ramené les chameaux en arrière et je continuai ma route. Parvenu à Al-Djafr, j'y remarquai de l'eau, des herbes et des arbres. Voici que tout à coup il surgit de cette prairie un homme vêtu de noir que nous fîmes prisonnier. Mes compagnons, qui s'étaient disséminés, s'emparèrent d'un autre homme, de deux femmes et de plusieurs jeunes gens.
Une de ces femmes vint à moi, s'accrocha à mon vêtement et dit : « O maître, je dépends de ta générosité. » — Je répondis : « Tu peux être sans crainte ; qu'as-tu ? » — « J'ai, dit-elle, que tes compagnons m'ont enlevé un morceau d'étoffe, un animal qui brait, un animal qui aboie, enfin un objet précieux. »—Je dis à mes officiers d'ordonnance : « Que celui qui a pris quoi que ce soit le rende. » L'un d'eux apporta un morceau d'étoffe, long à peine de deux coudées. « C'est le morceau d'étoffe, » dit la plaignante. Un autre apporta un fragment de sandaraque. « C'est, dit-elle, l'objet précieux. » — Je demandai : « Où sont restés l'âne et le chien ? » — On me répondit : « Quant à l'âne, on l'a jeté dans la prairie, après lui avoir lié les pieds de devant et les pieds de derrière. Le chien a été lâché, il court d'un endroit à l'autre. »
Je réunis mes prisonniers, et je fus frappé de leur état lamentable d'affaissement physique. Ils avaient la peau desséchée sur les os. Je leur dis : « Qui êtes-vous donc ? » — « Nous sommes, répondirent-ils, des rejetons d'Oubayy. » Or, les Banoû Oubayy sont une tribu d'Arabes Tayyites ; ils ne mangent que des charognes et disent : « Nous sommes les plus parfaits des Arabes. Il n'y a parmi nous ni mutilé, ni lépreux, ni malade atteint d'une maladie chronique, ni aveugle. » Lorsqu'un hôte s'assied à leur foyer, ils égorgent pour lui un animal vivant, et lui font préparer une nourriture à part. Je leur dis : « Quelles circonstances vous ont amenés jusqu'ici ? » — Ils répondirent : « Nous avons à Hismâ plusieurs tas de grand millet (dhoura) enfouis, que nous sommes venus prendre. » — J'insistai : « Depuis quand êtes-vous arrivés ? » — Ils répondirent : « Depuis la fête qui a suivi le ramadan[36] nous sommes ici, sans avoir vu de nos yeux la moindre provision. » — « De quoi vivez-vous alors ? » demandai-je. — « D'os cariés, répondirent-ils en désignant ainsi les os gâtés qu'ils ramassaient ; nous les pilons, nous y ajoutons de l'eau et des feuilles d'arroche, plante répandue dans cette région. Cela suffit à notre subsistance. » — Je repris : « Mais comment nourrissez-vous vos chiens et vos ânes ? » — Ils dirent : « Les chiens mangent comme nous ; quant aux ânes, on les bourre d'herbe sèche. » — Je leur dis encore : « Pourquoi donc n'êtes-vous pas entrés à Damas ? » — Ils reprirent : « C'est que nous avons craint la peste. » Or, jamais peste ne mit les gens aussi bas qu'étaient ces malheureux. Cela se passait le jour après la Fête des victimes.[37] Je m'arrêtai jusqu'à l'arrivée de mes chameaux et je distribuai une partie des provisions qui nous accompagnaient. Je coupai en deux un morceau d'étoffe rayée, qui était roulé autour de ma tête, et je le partageai entre les deux femmes. La joie causée par les provisions faillit troubler la raison d'hommes affamés ; je leur dis : « Ne restez pas ici ; car les Francs vous feraient captifs ! »
Une aventure singulière de ce voyage fut ce qui m'advint un soir, alors que j'avais fait halte pour réciter les prières du coucher du soleil et de la nuit,[38] en les abrégeant et en les confondant.[39] Les chameaux étaient partis. Je m'arrêtai sur une hauteur et je dis à mes officiers d'ordonnance : « Allez dans tous les sens à la recherche des chameaux, puis revenez vers moi. Je ne bougerai pas d'ici. » Ils galopèrent de tous côtés, mais sans résultat. L'un après l'autre, ils me rejoignirent et me dirent : « Nous n'avons rien aperçu, et nous ne savons pas quelle direction ils ont prise., » — Je répondis : « Nous implorerons le secours d'Allah le Tout Puissant et nous nous laisserons conduire par le coucher des étoiles. » Notre abandon dans le désert, loin de nos chameaux, avait rendu notre situation très pénible. Or il y avait parmi les guides un certain Djizziyya, plein de vigilance et de sagacité. Lorsqu'il s'aperçut de notre retard, il comprit que nous nous étions égarés à distance, sortit un briquet, monta sur son chameau et fit jaillir dans l'air des étincelles qui se répandirent par-ci par-là. Si loin que nous fussions, ce spectacle nous frappa. Nous avions bientôt pris le chemin du feu, qui nous ramenait directement à eux. N'était la faveur d'Allah et ce qu'il inspira à ce guide, nous étions perdus !
Voici une autre péripétie de ce voyage. Avant de partir, le vizir Al-Malik Al-’Adil[40] m'avait dit : « Tu ne feras rien savoir aux guides que tu amènes de la somme que tu emportes ! » En conséquence, je plaçai quatre mille dinars dans une sacoche sur un mulet de selle tenu en laisse près de moi par un de mes écuyers ; je plaçai les deux autres mille dinars, de l'argent pour mes frais d'entretien, une bride en or et des dinars magrébins dans une autre sacoche sur un cheval conduit en laisse à ma suite par un de mes écuyers. A chaque station que je faisais, je plaçais les sacoches au centre d'un tapis dont je ramenais les extrémités sur elles ; j'étendais ensuite un deuxième tapis sur le premier et je dormais sur les sacoches. A l'heure du départ, je me levais le premier ; les deux écuyers venaient recevoir leur dépôt, et ce n'est que lorsqu'ils avaient serré les deux sacoches sur les animaux maintenus à nos côtés que je montais à cheval, que je réveillais mes compagnons et que nous nous préoccupions de poursuivre notre route
Un soir nous fîmes halte dans le Désert des fils d'Israël (tîh banî Isrâ'îl). Lorsque je me levai pour donner le signal du départ, l'écuyer chargé de tenir en laisse le mulet vint, prit la sacoche, la jeta sur les hanches du mulet et tourna autour de l'animal pour le sangler. Le mulet lui glissa des mains et partit au galop, emportant la sacoche. Je montai aussitôt sur mon cheval que mon valet tenait tout préparé et je dis à l'un de mes écuyers : « En avant ! en avant ! » Je galopai à la poursuite du mulet, sans parvenir à l'atteindre ; il courait comme un onagre, et mon cheval était épuisé par la longueur de la route. L'écuyer me rejoignit. Je lui dis : « Cours par ici, tu rattraperas le mulet. » Il revint en disant :
« Par Allah, ô mon maître, je n'ai pas vu le mulet, mais j'ai rencontré sur mon chemin cette sacoche que j'ai ramassée. » — Je répondis : « C'était précisément de la sacoche que je m'étais mis en quête. La perte du mulet m'importe peu. » Je retournai au campement. En attendant, le mulet était rentré au galop dans l'écurie et y occupait sa place. Il n'avait voulu en fuyant que se débarrasser des quatre mille dinars.
Après plusieurs étapes, nous étions arrivés à Bosra et nous avions trouvé Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn devant Damas. L'émir Asad ad-Dîn Shirkouh[41] (qu'Allah l'ait en pitié !) venait aussi d'arriver à Bosra. Ce fut avec lui que j'allai rejoindre l'armée. J'y parvins le dimanche soir. Le lendemain matin, j'eus un entretien avec Nour-ad-Dîn sur l'objet de ma mission. Il me dit : « O Ousâma, sache que les habitants de Damas sont nos ennemis et que les Francs sont nos ennemis. Il n'y aura de sécurité d'aucune part, si je m'avance entre les uns et les autres. » — Je lui dis : « Tu me permettras bien d'enrôler quelques-uns de ceux qui n'ont pas été admis dans les troupes régulières. Je les prendrai et je te les ramènerai. Tu m'associeras l'un de tes chefs à la tête de trente cavaliers, afin que tout se passe en ton nom. » — Nour ad-Dîn répondit : « Fais à ta guise. » Jusqu'au lundi suivant, j'avais enrôlé huit cent soixante cavaliers, avec lesquels je me dirigeai au cœur des régions occupées par les Francs. Les cors retentissaient lorsque nous faisions halte et aussi lorsque nous partions en campagne. Nour ad-Dîn avait envoyé pour m'accompagner 'Ain ad-Daula Al-Yâroukî, à la tête de trente cavaliers.
A mon retour, je passai devant Al-Kahf et Ar-Rakîm. Je m'y arrêtai et j'entrai prier dans la mosquée. Mais je ne m'engageai pas dans le défilé qui y débouche. Un des émirs Turcs qui étaient avec moi, nommé Berschek, arriva avec l'intention de pénétrer dans cette passe étroite. Je lui dis : « Que vas-tu faire là-bas ? Prie plutôt au dehors. » — Il répondit : « Il n'y a de Dieu qu'Allah ! Suis-je donc un bâtard, que je ne puis pénétrer dans cette gorge resserrée ? » — « Que dis-tu là ? » lui répliquai-je. — Il reprit : « Cet endroit est de ceux où jamais le fils d'une femme adultère ne pénétrera, dont il ne pourra jamais forcer l'accès. » Sa parole eut pour effet que je me levai aussitôt, que j'entrai aussi dans cette passe, que j'y priai et que j'en sortis. Et pourtant, Allah le sait, je n'ajoutais pas foi à ses paroles. La plupart des soldats vinrent, entrèrent et accomplirent leurs dévotions.
Un de mes officiers, Barak Az-Zoubaidî, se faisait servir par un esclave noir très dévot, assidu à la prière, un homme des plus minces et des plus longs. A son tour, cet esclave, arrivé au même endroit, fit avec persistance des efforts pour entrer. Mais il n'y réussit pas. Le malheureux se mit à pleurer, s'affligea, soupira de regret et s'en retourna en voyant son incapacité d'entrer.
Un matin, nous arrivâmes enfin au point du jour à Ascalon. A peine avions-nous installé nos armes et nos bagages près de la place publique destinée à la prière (al-mousallâ), que les Francs nous saluèrent en nous attaquant dès que le soleil fût levé. Nasir ad-Daula Yâkoût, gouverneur d'Ascalon, accourut vers nous, en disant : « Enlevez, enlevez vite vos bagages ! » — Je lui répliquai : « Tu as donc peur ? Les Francs ne nous les prendront certes pas. » — « Il est vrai, dit-il, que j'ai peur. » — Je le rassurai en disant : « Ne crains rien. Ils nous voyaient nous avancer dans la plaine et s'efforçaient de nous barrer la route, lorsque nous n'étions pas encore parvenus dans Ascalon. Nous ne les avons pas redoutés alors. Pourquoi les redouterions-nous, aujourd'hui que nous sommes près d'une ville qui nous appartient ? »
Les Francs restèrent immobiles à peu de distance pendant un certain temps ; puis ils retournèrent dans leurs régions, rassemblèrent une armée contre nous et vinrent nous assaillir avec cavaliers, fantassins et objets de campement, afin de cerner Ascalon. Nous étions sortis pour les atteindre et les fantassins d'Ascalon avait aussi opéré une sortie. Je fis le tour de cette troupe de fantassins et je leur dis : « O nos compagnons d'armes, retournez derrière vos murailles et laissez-nous aux prises avec les Francs. Si nous sommes vainqueurs, vous nous rejoindrez. S'ils sont victorieux, vous serez là en réserve sains et saufs dans l'enceinte. Dans ce cas, gardez-vous bien de revenir à la charge. »
Je les quittai et je me dirigeai vers les Francs. Déjà ceux-ci avaient fait le tracé de leurs campements et se préparaient à dresser leurs tentes. Entourés et pressés par nous, ils n'eurent pas le temps de replier les toiles. Ils les abandonnèrent déployées comme elles l'étaient et reculèrent.
Lorsque les Francs se furent éloignés de la ville, un certain nombre des habitants, qui étaient rentrés dans leurs foyers, les poursuivirent, renonçant aux défenses de la place et à leur sécurité. Les Francs se retournèrent, fondirent sur eux et en tuèrent plus d'un. Les fantassins, que j'avais tenus à l'écart, furent mis en déroute, ne purent pas battre en retraite et jetèrent sur le sol leurs boucliers. A notre tour, nous reprîmes le combat contre les Francs, qui furent vaincus et rentrèrent dans leurs régions, situées aux environs d'Ascalon. Quant aux fantassins mis en déroute, ils s'empressèrent, en revenant, de récriminer l'un contre l'autre et dirent : « Ibn Mounkidh a fait preuve de plus d'expérience que nous. Il nous avait conseillé de rebrousser chemin. Nous n'en., avons rien fait avant d'avoir été repoussés, et d'avoir essuyé un affront. »
Mon frère ‘Izz ad-Daula Abou 'l-Hasan 'Ali (qu'Allah l'ait en pitié !), avec ses compagnons d'armes, se trouvait parmi ceux qui étaient venus avec moi de Damas à Ascalon. Il était un des plus brillants cavaliers entre les musulmans. Il combattait pour les intérêts de la religion, non pour ceux de ce monde. Nous étions un jour sortis d'Ascalon pour faire une incursion et tenter la lutte contre Bait Djibrîl. Lorsque, après y être arrivés et l'avoir attaqué, nous fûmes sur le retour, je vis qu'il devait se passer quelque chose de grave devant Ascalon. J'ordonnai à mes compagnons de faire halte. Du feu fut allumé et jeté sur les piles de blé fauché. Alors, nous changeâmes nos positions. Je restai en arrière de, nos troupes. Les Francs (qu'Allah les maudisse !) avaient quitté toutes les forteresses du voisinage, où était massée leur nombreuse cavalerie, et s'étaient concentrés pour assiéger Ascalon sans trêve, jour et nuit. C'étaient eux qui, cette fois, avaient pris l'offensive contre nos compagnons.
L'un de ceux-ci vint à moi au galop et me dit : « Les Francs sont là. » Je rejoignis nos compagnons, et déjà ils avaient devant eux les avant-gardes des Francs, qui sont (qu'Allah les maudisse !) les guerriers les plus prudents du monde. Ils avaient gravi une éminence, où ils s'étaient postés ; nous, de notre côté, nous étions montés sur une éminence leur faisant face. Au milieu, une foule de nos compagnons débandés et les gardiens de nos montures conduites en laisse passaient au-dessous des Francs. Aucun de leurs cavaliers ne descendait vers eux par crainte d'une embuscade ou d'une ruse de guerre. S'ils étaient descendus, ils auraient capturé nos compagnons jusqu'au dernier.
Nous faisions face aux Francs avec des forces inférieures, nos troupes ayant été précédemment mises en déroute. Les Francs restèrent immobiles sur l'éminence qu'ils occupaient jusqu'au moment où nos compagnons cessèrent de dénier. Alors, ils se ruèrent sur nous et nous fûmes repoussés devant eux, la lutte étant circonscrite entre nous. Ils n'avaient pas besoin de grands efforts pour nous atteindre. Car ceux dont les chevaux ne bronchèrent pas furent tués ; ceux dont les chevaux s'affaissèrent furent emmenés comme prisonniers. Ensuite les Francs quittèrent le champ de bataille.
Allah (qu'il soit exalté !) décréta pour nous le salut, grâce à leur système de temporisation. Si nous avions été en nombre comme ils l'étaient et que nous eussions l'emporté la victoire sur eux, comme ils la remportèrent sur nous, nous les aurions exterminés.
J'étais resté quatre mois dans Ascalon pour combattre les Francs. Dans cette campagne, nous avions surpris Youbnâ, nous y avions tué environ cent hommes et fait des captifs. Au bout de cette période, je reçus une lettre d'Al-Malik Al-’Adil, pour me rappeler. Je retournai à Misr. Mon frère 'Izz ad-Daula Abou 'l-Hasan 'Ali resta dans Ascalon jusqu'au moment où l'armée de cette ville partit pour conquérir Gaza. Ce fut là que mon frère fut tué en martyr. Il avait compté parmi les savants, les cavaliers et les dévots d'entre les musulmans.
Et, quant à la sédition dans laquelle fut tué Al-Malik Al-’Adil Ibn As-Sallâr (qu'Allah l'ait en pitié !), celui-ci avait envoyé à Bilbis des troupes commandées par le fils de sa femme, Roukn ad-Dîn 'Abbâs, fils d'Abou ‘l-Foutoûh, fils de Tamîm, fils de Bâdîs, pour protéger la région contre les Francs. 'Abbâs avait amené son fils Nasir ad-Dîn Nasr (qu'Allah l'ait en pitié !), qui resta quelques jours avec son père à la tête des troupes, puis rentra au Caire sans avoir reçu d'Al-’Adil ni autorisation ni congé. Al-’Adil désapprouva son retour et lui ordonna de rejoindre l'armée, dans la pensée où il était, que le jeune homme était revenu au Caire pour s'amuser, pour se distraire et par ennui d'un séjour prolongé dans une garnison.
Mais le fils de 'Abbâs s'était concerté avec Ath-Thâfir et, d'accord avec lui, il avait enrôlé quelques jeunes écuyers du khalife par lesquels il ferait assaillir Al-’Adil dans son palais, au. moment où, après être entré le soir dans son harem, il se serait endormi. Nasr se réservait alors de le tuer, et s'était entendu avec un des ostadars du palais pour qu'il l'informât aussitôt que son maître sommeillerait. La maîtrise de la maison appartenait à la femme d'Al-’Adil, qui était la grand'mère de Nasr, et auprès de laquelle celui-ci était admis sans avoir à demander audience:
Lorsque Al-’Adil s'endormit, l'ostadar en apporta la nouvelle à Nasr qui, avec six de ses hommes, fondit sur lui dans la maison, où il reposait Ils le tuèrent. Nasr lui coupa la tête, qu'il apporta à Ath-Thâfir. Cet événement eut lieu le jeudi 6 de moharram en l'an 548.[42]
Al-’Adil avait dans son palais ses mamlouks et les troupes en faction, environ mille hommes, mais ils étaient dans le Palais du Salut (dâr as-salâm), et il fut. tué dans le gynécée. Ils sortirent du Palais et la lutte se déchaîna entre eux et entre les partisans d'Ath-Thâfir et de Nasr. Mais elle s'apaisa dès que celui-ci eut apporté la tête d'Al-’Adil sur la pointe de sa lance. Les fidèles d'Al-’Adil, en la voyant, se partagèrent en deux partis : les uns sortirent du Caire pour offrir leurs services et jurer obéissance à 'Abbâs ; les autres jetèrent leurs armes, se présentèrent devant Nasr, fils de 'Abbâs, baisèrent la poussière et s'attachèrent à sa personne.
Quelques jours après, son père 'Abbâs rentra un matin au Caire et s'installa dans le Palais du vizirat. Ath-Thâfir le revêtit du manteau d'honneur et lui confia la direction des affaires.
Quant à Nasr, il fréquentait sans cesse le khalife et avait des relations intimes avec lui, au grand déplaisir de 'Abbâs, qui s'indignait contre son fils, parce qu'il n'ignorait pas le système qui consiste à frapper les hommes les uns par les autres, pour que les uns réduisent à néant et dépouillent de tout ce qu'ils possèdent les autres, jusqu'à ce que les deux adversaires s'entre-détruisent.
Un soir, 'Abbâs et Nasr me firent appeler auprès d'eux. Ils étaient en tête-à-tête, s'adressant l'un à l'autre des reproches. A plusieurs reprises 'Abbâs apostrophait son fils qui baissait la tête avec la grâce du léopard, réfutant chaque point successivement. A chaque réponse, 'Abbâs, qui s'échauffait, se mettait à le blâmer et à le réprimander de plus belle. Je dis à 'Abbâs : « O mon maître Al-Afdal,[43] pourquoi accuser ainsi mon maître Nasir ad-Dîn et lui adresser des objurgations qu'il écoute patiemment ? Fais retomber sur moi ton blâme ; car je suis associé à tout ce qu'il fait, j'ai ma part dans ses péchés, comme dans ses nobles actions. Mais, du reste, quelle est sa faute ? Il n'a lésé aucun de tes compagnons^ n'a montré aucune négligence dans l'administration de ton bien, et aucune pensée de son âme n'a porté atteinte au prestige de ta puissance, puisque tu as atteint ce haut rang. Sa conduite ne mérite pas ton blâme. » 'Abbâs ne s'entêta pas, et son fils me tint compte de mon attitude.
Ath-Thâfir conçut alors le projet de pousser Nasr a tuer son père, dont il deviendrait le successeur comme vizir. Le khalife combla Nasr des plus riches présents. Un jour, j'étais chez Nasr, lorsqu'il reçut de la part d'Ath-Thâfir vingt plateaux en argent, contenant vingt mille dinars. Quelques jours s'écoulèrent sans cadeaux ; puis un nouvel envoi réunit en vêtements de tout genre une collection telle que je n'en avais jamais vu auparavant de pareille. Après une interruption de quelques jours, le khalife lui fit porter cinquante plateaux d'argent, contenant cinquante mille dinars. Après un nouveau délai fort court, il lui-fit amener trente mulets de selle et quarante chameaux avec leur attirail, leurs sacs à grains et leurs brides.
Entre Ath-Thâfir et Nasr circulait sans cesse un messager, nommé Mourtafi', fils de Fahl. Telle était mon intimité avec le fils de 'Abbâs qu'il ne me permettait de le quitter, ni pendant la nuit, ni pendant le jour. Je dormais, la tête appuyée sur son oreiller.
Un soir, j'étais avec lui dans le Palais.de la schâboûra, lorsqu'arriva Mourtafi', fils de Fahl. Ils causèrent ensemble pendant le premier tiers dei la nuit, tandis que je me tenais à l'écart. Puis Nasr se retourna, m'invita à «rapprocher et me dit : « Ou étais-tu donc ? » — « Près de la fenêtre, lui répondisse, occupé à lire le Coran ;.car aujourd'hui je n'avais pas eu le temps de terminer ma lecture quotidienne. » Alors Nasr commença à me révéler quelques points de leur entretien pour voir ce que j'en penserais ; il désirait être fortifié par moi dans la résolution coupable qu'Ath-Thâfir cherchait à lui faire prendre. Je lui dis : « O mon maître, puisse Satan ne pas te faire trébucher ! Puisses-tu ne pas te laisser tromper par qui veut t'égarer ! Car le meurtre de ton père est une autre affaire que le meurtre d'Al-’Adil. Aussi ne fais pas une chose pour laquelle tu serais maudit jusqu'au jour du jugement dernier. » Nasr baissa la tête, coupa court à notre conversation, et ce fut pour nous deux le moment de nous endormir.
'Abbâs connut les projets que son fils avait ourdis contre lui. Il le cajola, chercha à le gagner et se concerta avec lui pour mettre à mort Ath-Thâfir. Le khalife et Nasr étaient des compagnons du même âge. Ils sortaient ensemble la nuit en gardant l'incognito. Nasr invita un jour le khalife à venir dans sa maison, située au Marché des fabricants d'épées (soûk as-souyoûfiyyîn). Il avait disposé dans une des ailes de sa maison une poignée de ses compagnons. Lorsque la compagnie eut pris place, ces hommes s'élancèrent sur. le khalife et le tuèrent. Cet événement eut lieu la veille au soir du jeudi, dernier jour du mois de moharram, en l'année 549.[44]
'Nasr jeta le cadavre d'Ath-Thâfir dans un souterrain de sa maison. Le khalife était venu, accompagné d'un esclave noir, qui ne le quittait jamais, et qu'on appelait Sa’id ad-Daula. On le mit également à mort.
Le lendemain matin,. 'Abbâs se rendit au palais selon son habitude, afin d'apporter ses salutations pour la journée du jeudi. Il s'assit dans un salon de la partie du palais où siège le vizir, comme s'il attendait le moment où Ath-Thâfir accueillerait ses hommages. Lorsque l'heure où le khalife lui donnait audience chaque jour fut passée, 'Abbâs manda le régisseur du palais et lui dit : « Qu'a notre maître pour avoir manqué l'audience du salut ? » Le régisseur ne savait que répondre. 'Abbâs s'emporta contre lui et lui dit, : « Pourquoi ne me réponds-tu pas ? » — Il répliqua : « O mon maître, notre maître, nous ne savons pas où il est. » — « Les pareils de notre maître, reprit le vizir, ne sont jamais égarés. Retourne pour faire une nouvelle enquête. » — Le régisseur partit, revint et dit : « Nous n'avons pas trouvé notre maître. » — 'Abbâs s'écria : « Le peuple ne saurait rester sans khalife. Entre chez les princes, frères d'Ath-Thâfir. Qu'un d'entre eux sorte ! Nous lui prêterons le serment de fidélité. » — Le régisseur revint presqu'aussitôt lui dire : « Les princes te font savoir : Nous n'avons aucune part au pouvoir, le père d'Ath-Thâfir nous en ayant déshérités, lorsqu'il l'a transmis à notre frère Ath-Thâfir. Après lui, c'est à son fils qu'appartient l'autorité. » — « Eh ! bien, dit alors 'Abbâs, amenez-le, ce fils, que nous le proclamions khalife. »
Or 'Abbâs avait tué Ath-Thâfir et s'était proposé de dire que celui-ci avait été tué par ses frères et de punir leur crime par leur mort. Lé fils d'Ath-Thâfir parut. C'était un enfant, qu'un des eunuques du Château portait sur son épaule. 'Abbâs le prit et le souleva dans ses bras. L'assemblée pleura. Puis 'Abbâs, sans abandonner son fardeau, entra dans la salle d'audience d'Ath-Thâfir, où se tenaient les fils d'Al-Hâfith, l'émir Yousouf et l'émir Djibrîl, ainsi que le fils de leur frère, l'émir Abou 'l-Bakâ.
Nous étions assis dans le portique. Le palais contenait plus de mille hommes des troupes de Misr. Nous n'éprouvions aucun trouble, lorsque, tout à coup, une troupe sortit de l'audience vers la salle, et l'on entendit le cliquetis des épées s'acharnant sur une victime. Je dis à un écuyer Arménien qui me servait : « Regarde qui l'on vient de tuer. » Il revint immédiatement et me dit : « Ces gens ne se conduisent pas en musulmans. C'est mon maître Abou 'l-Amâna (il désignait ainsi l'émir Djibrîl) qu'ils ont tué. L'un d'eux a fendu le ventre du cadavre pour en retirer les intestins. Ensuite 'Abbâs sortit, portant sous son aisselle la tête de l'émir Yousouf découverte, labourée par un coup d'épée, laissant ruisseler des flots de sang. Abou 'l-Bakâ, le fils du frère de l'émir Yousouf, se trouvait avec Nasr, fils de 'Abbâs. On fit entrer l'oncle et le neveu dans un salon du Château, où ils furent tués. Il y avait dans le palais mille épées nues !
Ce jour fut un des plus pénibles que j'aie endurés. Car je vis les hommes se vautrer dans les hontes d'une impiété telle que la réprouvent Allah et toutes ses créatures.
Une curieuse aventure, qui advint en ce même jour, fut que 'Abbâs, voulant entrer dans la salle du conseil, en trouva la porte verrouillée à l'intérieur. Or, il y avait un vieil eunuque, chargé d'ouvrir et de fermer la salle d'audience. Il était surnommé Amin al-Moulk. Après de nombreux essais, on finit par forcer la serrure. On entra et l'on trouva le gardien derrière la porte. Il était mort subitement et tenait la clef dans sa main.
Quant à la guerre civile, qui éclata dans Misr et où 'Abbâs vainquit les troupes de la ville, elle eut pour cause le malaise ressenti par tous les cœurs, lorsque 'Abbâs eut fait aux enfants d'Al-Hâfith (qu'Allah l'ait en pitié !) ce qu'il leur fit. L'hostilité et la haine restèrent d'abord à l'état latent. Celles des filles d'Al-Hâfith, qui se trouvaient encore dans le palais, écrivirent au champion des musulmans,[45] à Abou 'l-Gârât Talâ’i Ibn Rouzzik (qu'Allah l'ait en pitié !) pour implorer son secours. Celui-ci enrôla des combattants et sortit de son gouvernement pour se diriger vers Le Caire. 'Abbâs donna des instructions pour qu'on équipât la flotte et pour qu'on y apportât des provisions, des armes et de l'argent. Il prit le commandement de l'armée de mer et de terre, le jeudi 10 de safer, en l'an 549.[46] Il ordonna à son fils Nasir ad-Dîn Nasr de rester au Caire et me dit : « Tu resteras avec lui. »
Lorsque 'Abbâs fut sorti de son palais pour arrêter la marche d'Ibn Rouzzik, ses soldats le trahirent et fermèrent les portes du Caire. La lutte s'engagea entre nous et eux sur les routes et dans les avenues, leurs cavaliers nous combattant pour nous barrer le passage, et leurs fantassins nous atteignant avec des flèches en bois et avec des pierres du haut des terrasses, tandis que les femmes et les enfants nous jetaient des pierres par les fenêtres. La lutte ne dura entre nous et eux qu'un seul jour, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. 'Abbâs remporta la victoire. Les rebelles ouvrirent les portes du Caire et. s'enfuirent. 'Abbâs s'attacha à leurs pas tant qu'ils restèrent sur le territoire de Misr et en fit périr un grand nombre. Puis il retourna dans son Palais et reprit son droit d'ordonner et d'interdire. Il résolut d'incendier la Barkiyya parce que les maisons des soldats étaient groupées dans ce quartier du Caire. Je cherchai par la douceur à modifier ses idées, et je lui dis : « O mon maître, lorsque le feu brûlera, l'incendie consumera ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux pas, et tu ne sauras comment l'éteindre. » Je réussis à le détourner de son projet et j'obtins la grâce de l'émir Al-Mou'taman, fils d'Abou Ramâda, après que 'Abbâs eut ordonné son exécution. Je demandai excuse pour lui, et sa faute lui fut pardonnée.
La rébellion s'apaisa. Elle avait effrayé 'Abbâs, en lui démontrant l'hostilité des troupes et des émirs, en le convaincant qu'il n'y avait point place pour lui au milieu d'eux. Sa résolution fut bientôt définitive : il s'éloignerait de Misr et se rendrait en Syrie auprès d'Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !), dont il implorerait l'assistance.
Les messages entre le personnel des Châteaux et Ibn Rouzzik :se succédaient sans trêve. Depuis mon entrée en Egypte, j'étais uni à lui par des liens d'amitié et par des relations suivies. Un envoyé vint me trouver de sa part pour me dire : « 'Abbâs ne peut rester en Egypte. Il doit en sortir pour aller en Syrie. Alors moi, je m'emparerai du pouvoir. Quant à toi, tu sais ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Aussi ne t'associeras-tu pas à son départ. Il ne manquera pas, ayant besoin de toi en Syrie ; de t'inviter à le suivre et d'insister pour t'emmener avec lui. Aussi vrai qu'Allah est le seul dieu, ne t'attache pas à ses pas ; car tu auras ta part dans tout avantage que je recueillerai. » Ce furent les satans qui soufflèrent tout cela aux oreilles de 'Abbâs, ou peut-être le-soupçonna-t-il, connaissant l'affection qui existait entre moi et Ibn Rouzzik.
Voici quelques détails sur la sédition qui contraignit 'Abbâs à quitter l'Egypte et amena son meurtre par les Francs. Lorsqu'il soupçonna l'accord entre moi et Ibn Rouzzik, ou bien lorsqu'il en eut été informé, il me fit venir et me fit prêter des serments solennels, ne laissant aucune échappatoire, que je partirais avec lui et que je l'accompagnerais. Ma parole ne lui paraissant pas une garantie suffisante, il envoya pendant la nuit son ostadar, qui avait accès dans son gynécée et qui emmena dans sa maison mes femmes, ma mère et mes enfants, en me disant de sa part : « Je prends à ma charge en ton lieu et place toute dépense que comportera leur entretien pendant la route, et je les ferai transporter avec la mère de Nasir ad-Dîn : » 'Abbâs disposa pour son voyage ses chevaux, ses chameaux et ses mulets. Il possédait deux cents chevaux et juments tenus en laisse entre les mains des serviteurs, selon l'habitude égyptienne, deux-cents mulets de selle et quatre cents chameaux pour porter ses bagages.
'Abbâs était adonné avec ardeur à l'étude des étoiles, et, sous l'influence d'un horoscope favorable, il avait fixé son départ au samedi 15 du premier rabi, en cette même année.[47] J'étais auprès de lui, lorsque se présenta un de ses serviteurs qu'on appelait 'Antar[48] le grand, qui gérait ses affaires, grandes et petites, et qui-lui dit : « O mon maître, qu'avons-nous à espérer de notre départ pour la Syrie ? Prends tes trésors, tes femmes, tes aides de camp et tes fidèles, conduis-nous vers Alexandrie ; c'est de là qu'après avoir réuni des troupes fraîches nous reviendrons attaquer Ibn Rouzzik et ses partisans. Si nous sommes victorieux, tu reprendras possession de ton palais et de ton autorité. Si nous échouons, nous retournerons à Alexandrie, où nous nous fortifierons et où nous nous mettrons en état de défense contre notre ennemi. » Mais 'Abbâs le rabroua et déclara son opinion 1 erronée. Et pourtant il était dans le vrai !
La veille, le vendredi, en se levant, 'Abbâs m'avait fait appeler dès l'aube. J'étais à peine arrivé auprès de lui que je lui dis : « O mon maître, lorsque je passe mon temps dans ta société depuis l'aurore jusqu'à la nuit, comment pourrais-je vaquer à mes préparatifs de voyage ? » — Il me répondit : « Il y a chez nous des messagers venus de Damas ; tu les expédieras, puis tu iras faire tes préparatifs. »
Auparavant, il avait fait appeler un certain nombre d'émirs et leur avait demandé le serment de ne pas le trahir et de n'ourdir aucun complot contre lui. Il avait fait venir aussi les chefs de certaines tribus arabes, de Darmâ, Zouraik, Djoudhâm, Sinbis, Talha, Djafar et Lawâta, et leur avait fait prêter un serment identique par le Coran et par le divorce. Nous étions sans défiance au moment où je me trouvais auprès de 'Abbâs, le matin du vendredi, lorsque, tout à coup, des hommes armés parurent et se précipitèrent sur nous, conduits par les émirs mêmes qui, la veille, s'étaient laissé arracher un serment de fidélité.
'Abbâs ordonna de seller ses bêtes de somme. Elles furent sellées et arrêtées devant la porte de son palais. Il y avait entre nous et les révoltés de Misr comme une barrière, qui les empêchait de nous atteindre, par suite de l'encombrement produit en avant de nous par l'accumulation des bêtes de somme. Voici que 'Antar le grand, le majordome de 'Abbâs, celui qui lui avait donné un si excellent avis, sortit vers les gens de son maître, et il était leur chef, s'emporta contre eux et les invectiva en disant : « Retournez dans vos maisons, et laissez paître librement les bêtes de somme. » Les palefreniers, les muletiers et les chameliers partirent. Les bêtes de somme restèrent à l'abandon. Le pillage s'y exerça sans obstacle.
'Abbâs me dit : « Sors, amène à notre aide les Turcs, qui ont leurs quartiers près de la Porte de la victoire (bâb an-nasr) ; les payeurs les rétribueront largement. » Lorsque j'arrivai à eux et que je leur adressai cet appel, ils montèrent tous à cheval, et ils n'étaient pas moins de huit cents cavaliers, mais ils sortirent du Caire par la Porte de la victoire afin de se dérober au combat. Les mamlouks de 'Abbâs étaient plus nombreux que les Turcs ; ils sortirent également par la Porte de la victoire et je retournai vers le vizir pour l'en informer.
Je m'occupai ensuite de faire sortir mes femmes, qu'il avait fait transporter dans son palais. En même temps que j'y réussis, je fis sortir les femmes de 'Abbâs. Puis, lorsque la route fut libre et que les bêtes de somme eurent été volées jusqu'à la dernière, les hommes de Misr parvinrent jusqu'à nous et nous expulsèrent. Nous n'étions qu'une poignée d'hommes ; ils formaient une masse compacte.
Après que nous eûmes dépassé la Porte de la victoire, ils s'élancèrent vers les issues de la ville, les fermèrent et revinrent piller nos maisons. Chez moi, ils prirent dans la grande salle de mon habitation quarante sacs magnifiques en cuir, contenant une quantité considérable d'argent, d'or et de vêtements, et enlevèrent dans mon écurie trente-six chevaux et mules destinés à être montés, avec leurs selles et leur attirail en parfait état, et aussi vingt-cinq chameaux. Quant à mon fief de Koûm Aschfîn, ils y firent main basse sur deux cents têtes de bœufs appartenant aux fermiers, sur mille moutons et sur des greniers regorgeant de denrées.
Nous n'étions pas encore bien loin de la Porte de la victoire, que les tribus arabes, dont 'Abbâs avait réclamé le serment de fidélité, se concentrèrent et nous combattirent depuis le vendredi dès l'aube jusqu'au jeudi 20 du premier rabi'.[49] La lutte se poursuivait pendant toute la journée. Lorsque la nuit devenait noire et que nous faisions halte, ils nous laissaient d'abord nous endormir en paix, pour ensuite détacher contre nous une centaine de cavaliers montés, poussant leurs chevaux sur l'une des ailes de notre camp, et élevant tout à coup la voix dans un cri retentissant. Ceux de nos cavaliers qui, prenant peur, sortaient à leur rencontre, devenaient leurs prisonniers.
Il m'arriva un jour de me trouver séparé de mes compagnons. J'étais monté sur un cheval blanc, le plus mauvais de mes trotteurs. Mon écuyer l'avait sellé, sans que nous eussions prévu ce qui arriverait. Je n'avais emporté aucune autre arme que mon épée. Les Arabes fondirent sur moi. J'étais hors d'état de les repousser et mon cheval était incapable de me conduire vite hors de leur portée. Déjà leurs lances m'avaient effleuré. Je me dis : « Si je sautais à bas de mon cheval et si je brandissais mon épée pour essayer de me défendre ! » Je rassemblai tout mon courage pour sauter. Mais mon cheval fit un faux pas : je tombai sur des pierres et sur un sol escarpé. Le choc produisit une lésion dans la peau de ma tête, et mon étourdissement fut tel que je restai sur place, sans savoir où j'en étais.
Quelques-uns des Arabes s'arrêtèrent devant moi et me virent adossé, avec la tête découverte, sans connaissance. Mon épée avait été projetée avec les harnais du cheval. Un Arabe m'asséna deux coups avec l’épée, en disant : « Donne-lui bonne mesure ! » Je ne savais rien de Ce qui se disait autour de moi. On s'empara ensuite de mon cheval et de mon épée.
Les Turcs m'aperçurent et s'empressèrent vers moi. Nasir ad-Dîn Nasr, fils de 'Abbâs, m'envoya un cheval et une épée. Enfin je partis, ne disposant pas même d'un bandage pour comprimer mes blessures. Je n'en puis pas moins glorifier aujourd'hui encore Celui dont la royauté est éternelle !
Notre caravane se mit en route. Aucun de nous n'avait de provisions suffisantes. Lorsque je voulais boire de l'eau, je descendais de cheval pour en puiser dans le creux de ma main. Quand je pense que, le soir qui avait précédé mon départ, j'étais assis dans une des salles d'entrée de ma demeure, sur une sorte de trône, et qu'on m'avait présenté seize charges de réceptacles pleins d'eau et Allah le Tout Puissant sait combien de cruches et d'outrés en peau !
Je compris que je ne pourrais pas emmener avec moi les gens de ma famille. De Bilbis, je les fis retourner auprès d'Al-Malik As-Sâlih Abou 'l-Gârât Talât Ibn Rouzzik (qu'Allah l'ait en pitié !). Il les traita avec faveur, leur assigna une maison et se chargea de subvenir à leurs besoins.
Lorsque les Arabes, qui nous combattaient, se disposèrent à retourner en Egypte, ils vinrent à nous, nous demandant notre garantie pour l'époque où nous serions revenus.
Nous avions continué à avancer, lorsque le dimanche, 23 du premier rabi[50] l'armée des Francs massée nous surprit dès l'aurore à Al-Mouwailih. 'Abbâs fut tué, ainsi que son fils Housâm al-Moulk ; son autre fils, Nasir ad-Dîn Nasr, fut fait captif. Les Francs prirent à 'Abbâs ses trésors et ses femmes, et tuèrent les soldats qui tombèrent entre leurs mains. Parmi leurs prisonniers était mon frère Nadjm ad-Daula Abou 'Abd Allah Mohammad.
Enfin ils se lassèrent de nous combattre, après que nous nous fûmes retranchés à l'abri de leurs coups sur les montagnes. Notre voyage se continua à travers les régions des Francs, dans des conditions plus pénibles que la mort, sans les provisions nécessaires aux hommes, sans fourrages pour les chevaux, jusqu'aux montagnes des Banoû Fahîd (qu'Allah les maudisse !.), dans, la Vallée de Moïse (wâdî Moûsâ).
Notre montée, s'effectua par des-chemins aussi étroits qu'escarpés jusqu'à une vaste-plaine-et jusqu'à des hommes, vrais satans lapidés. Tous ceux d'entre nous qu'ils purent saisir isolément, ils les tuèrent.
Ce pays devait être habité par quelque émir Tayyite, descendant de Rabî'a. Je demandai : « Quel émir de la tribu de Rabî'a est ici présent ? » — On me répondit : « Mansour, fils de Guidafl. » Or, c'était un de mes amis. Je donnai deux dinars à un homme de service qui irait trouver Mansour, et qui lui dirait : « Ton ami Ibn Mounkidh te salue et te prie de venir vers lui demain de bon matin. »
Notre nuit fut troublée par la crainte que nous ressentions. Lorsque l'aurore brilla, les habitants s'équipèrent et se postèrent près de la source. « Nous ne vous laisserons pas, dirent-ils, boire notre eau, quand nous, nous mourons de soif. » Or, cette source aurait suffi aux besoins de Rabî'a et de Modar. Et combien n'avaient-ils pas d'autres sources semblables sur leur territoire ! Mais leur but était uniquement de provoquer la lutte entre nous et eux et de s'emparer de nos personnes.
Nous en étions là, lorsque Mansour, fils de Guidafi, arriva, leur adressa des reproches et les invectiva. Ils se dispersèrent. Mansour me dit' : « Monte à cheval. » Nos chevaux nous descendirent par, un chemin plus étroit et plus accidenté que celui par lequel j'étais monté. Nous étions parvenus sains et saufs dans le fond de la vallée, après avoir, failli périr. Je réunis pour l'émir Mansour mille dinars de Misr, et je lui en fis présent. Il nous quitta. Nous poursuivîmes notre route, et enfin, avec ceux qui avaient échappé aux massacres des Francs et des Banoû Fahîd, nous atteignions la contrée de Damas le vendredi 5 du dernier rabi,[51] dans cette même année. Notre délivrance, après les périls d'un tel voyage, fut un signe manifeste de la providence d'Allah et de son admirable protection.
Dans cette série d'événements, il m'arriva une histoire étonnante. Ath-Thâfir avait envoyé à Nasr, fils de 'Abbâs, un cheval d'amble, petit, gracieux, franc d'origine. J'avais quitté Le Caire pour me rendre dans un village, qui m'appartenait, tandis que mon fils Abou 'l-Fawâris Mourhaf tenait société au fils de 'Abbâs. « Nous voudrions, dit celui-ci, pour ce cheval d'amble une selle élégante, une selle de Gaza. » —Mon fils lui répondit : « O mon maître, je t'en connais une vraiment exceptionnelle. » — « Où est-elle ? » demanda-t-il. — Mon fils répliqua : « Dans la maison de ton serviteur, mon père. Il possède une selle de Gaza magnifique. » — « Fais-la apporter, » dit Nasr. Celui-ci envoya dans ma maison un messager qui prit la selle. Nasr en fut enchanté et la fit attacher sur le cheval d'amble. Cette selle était montée de Syrie avec moi sur l'un des chevaux tenus en laisse ; elle était contrepointée, avec une bordure noire, d'un très bel effet. Elle pesait cent trente mithkals. Lorsque je revins de mon fief, Nasir ad-Dîn me dit : « Nous nous sommes mal conduits à ton égard et nous t'avons enlevé cette selle de ta maison. » — Je répondis : « O mon maître, quel bonheur pour moi d'avoir pu te servir ! »
Lorsque plus tard les Francs nous attaquèrent à Al-Mouwailih, j'avais avec moi cinq de mes mamlouks montés sur des chameaux, les Arabes leur ayant pris leurs chevaux. Au moment où les Francs survinrent, nombre de chevaux erraient librement.. Mes écuyers descendirent des chameaux, interceptèrent la course des chevaux et en prirent cinq, qui leur servirent de montures. Or, sur l'un des chevaux dont ils s'étaient emparés était placée cette même selle d'or que le fils de 'Abbâs s'était appropriée naguère.
Parmi les survivants de notre caravane étaient Housâm al-Moulk, cousin de 'Abbâs, et un frère utérin de 'Abbâs, fils d'Al-’Adil.[52] Housâm al-Moulk avait entendu raconter l'histoire de la selle. Il dit, pendant que je prêtais l'oreille : « Tout ce qu'a possédé ce malheureux (il désignait ainsi Nasr) a été pillé, que ce soit par les Francs ou par ses compagnons d'armes. » — Je dis alors : « Peut-être fais-tu allusion à la selle d'or ? » — « Précisément, » répondit-il. J'ordonnai qu'on apportât la selle, puis je dis à Housâm al-Moulk : « Lis le nom inscrit sur la selle, si c'est celui de 'Abbâs, celui de son fils ou le mien. Et qui, du temps d'Al-Hâfith, pouvait chevaucher à Misr sur une selle d'or, si ce n'est moi ? » Or, mon nom était brodé en noir sur le tour de la selle, dont le milieu était contrepointé. Lorsqu'il l'eut constaté, il me fit des excuses et garda le silence.
Et, n'était l'action de la volonté divine à l'égard de 'Abbâs et de son fils, n'étaient les conséquences de la rébellion et de l'ingratitude, 'Abbâs aurait dû chercher un avertissement dans ce qui advint avant lui à Al-Malik Al-Afdal Roudwân Ibn Al-Walakhschî (qu'Allah l'ait en pitié !). Il était vizir, lorsque les troupes s'étaient révoltées contre lui[53] à l'instigation d'Al-Hâfith, comme elles se révoltèrent contre 'Abbâs, et il avait quitté l'Egypte pour se rendre en Syrie, sa maison et son gynécée ayant été livrés au pillage.
Sur ces entrefaites, un homme, qu'on appelait le chef (kaïd) Moukbil, vit une jeune fille entre les mains des nègres. Il la leur acheta et l'envoya dans sa maison. Or Moukbil avait une femme vertueuse, qui fit monter la jeune fille dans une chambre au haut de la maison. Elle l'entendit qui disait : « Par la vie d'Allah, tu nous feras triompher de qui s'est révolté contre nous et a renié nos bienfaits.»—La femme lui demanda : « Qui es-tu ? » — La jeune fille répondit : « Je suis Goutte de rosée (Katr an-nidâ), fille de Roudwân. » La femme fit alors appeler et manda son mari, le chef Moukbil, qui était de service dans ses fonctions à la porte du Château, et lui fit connaître l'origine de la jeune fille. Celui-ci écrivit à Al-Hâfith une lettre pour l'en informer. Al-Hâfith envoya aussitôt un serviteur du Château vers la demeure de Moukbil pour prendre la jeune fille et la ramener au Château.
Quant à Roudwân, il s'était rendu à Salkhad auprès de Amin ad-Daula Goumouschtakîn.[54] Celui-ci honora Roudwân, lui donna l'hospitalité et lui offrit ses services. Or, à ce moment, le roi des émirs, l'atabek Zengui, fils de Ak Sonkor, assiégeait Balbek. Il envoya un messager vers Roudwân et insista pour attirer vers lui cet homme parfait, noble, brave, qui était en même temps un écrivain distingué, et pour lequel les troupes se sentaient fort portées, à cause de ses nobles qualités.
L'émir Mou'in ad-Dîn[55] me dit : « Si cet homme s'attache à l'atabek, il en résultera un grand dommage pour nous. » — Je lui demandai alors : « Quels sont tes projets ? » — Il me répondit : « Tu iras vers Roudwân. Peut-être le détourneras-tu de se rendre auprès de l'atabek et le détermineras-tu à venir à Damas. A toi de voir ce que tu croiras devoir faire dans ces conjonctures. »
Je me rendis vers Roudwân à Salkhad. J'eus une entrevue avec lui et avec son frère, surnommé Al-Auhad « l'Unique », et je m'entretins avec eux deux. Al-Afdal Roudwân me dit : « Je ne suis plus libre ; car j'ai engagé ma parole avec ce sultan[56] que je me joindrais à lui. Me voici donc tenu d'exécuter ma promesse. » — Je lui répondis : « Qu'Allah te donne la prééminence ! Pour ma part, je suis sur le point de retourner vers mon maître, car il ne saurait se passer de moi. Il a compté qu'auparavant je te ferais connaître toute ma pensée. » — « Parle », dit Roudwân. — « Lorsque tu seras parvenu au camp de l'atabek, lui dis-je alors, crois-tu qu'il divisera son armée en deux moitiés, dont l'une partira avec toi pour l'Egypte, dont l'autre restera pour nous assiéger ? » — « Non certes», répondit-il. —Je repris : « Eh ! bien, lorsqu'il aura campé devant Damas, qu'il aura assiégé et pris cette ville après de longs efforts, pourra-t-il, avec des troupes affaiblies, des provisions épuisées, après des marches forcées, se rendre avec toi en Egypte sans renouveler d'abord son équipement et sans reconstituer son armée ? » — « Non certes », répondit-il. — Je poursuivis : « A ce moment, l'atabek te dira : Nous irons ensemble à Alep pour y renouveler notre appareil de voyage. Puis, lorsque vous aurez atteint Alep, il dira : Nous allons nous avancer jusqu'à l'Euphrate pour recruter les Turcomans. Une fois que vous serez campés sur les bords de l'Euphrate, il te dira : Si nous ne traversons pas l'Euphrate, nous ne pourrons pas enrôler les Turcomans. L'Euphrate traversé, l'atabek se parera de toi et tirera vanité auprès des sultans orientaux de pouvoir dire : Ce grand d'Egypte est maintenant à mon service. C'est alors que tu souhaiteras revoir une pierre d'entre les pierres de Syrie, mais tu ne le pourras plus. Tu te souviendras à ce moment de ma parole et tu penseras : Il m'avait donné un bon conseil que je n'ai pas écouté. »
Roudwân baissa la tête et resta pensif, ne sachant que dire. Puis il se tourna vers moi et me demanda : « Que dois-je décider, puisque tu veux t'en retourner ? » — Je lui répondis : « S'il y a quelque utilité à ce que je reste, je resterai. » — « C'est le cas », me dit-il.
Je restai. Il y eut entre nous plusieurs entretiens. Il fut enfin convenu que Roudwân se rendrait à Damas, y recevrait trente mille dinars, dont la moitié serait payée en espèces et dont l'autre moitié serait représentée par un fief, qu'on attribuerait à son habitation la Maison d'Al-'Akîkî, et que ses compagnons recevraient une solde.
Roudwân souscrivit à ces conditions de sa plus belle écriture et me dit : « Si tu veux, je partirai avec toi. » — « Non, lui répondis-je. Je prendrai les devants, j'emporterai d'ici une colombe messagère. Dès que je serai arrivé, que j'aurai installé ta maison et que j'aurai tout disposé, je lâcherai vers toi la colombe et, sur l'heure, je me mettrai en route pour te rencontrer à mi-chemin, afin de t'introduire à Damas. » Nos conventions ainsi arrêtées, je pris congé de Roudwân et je partis.
Amin ad-Daula, de son côté, désirait que Roudwân retournât en Egypte pour y exécuter les promesses qu'il lui avait faites, pour y satisfaire les ambitions qu'il avait éveillées en lui. Amin ad-Daula rassembla les hommes disponibles et les amena à Roudwân après que je l'eus quitté. A peine celui-ci avait-il franchi les frontières de l'Egypte que ses troupes turques le trahirent et pillèrent ses bagages.[57] Il mit sa personne à l'abri dans une des tribus arabes et envoya une députation vers Al-Hâfith pour lui demander l'aman. Peu après, il rentra à Misr et, sur l'ordre du khalife, fut aussitôt emprisonné, ainsi que son fils.
Au moment où j'arrivai à Misr,[58] Roudwân était enfermé dans un bâtiment accolé au Palais. A l'aide d'un clou en fer, il finit par percer le mur sur une épaisseur de quatorze coudées. Il sortit dans la nuit du mercredi au jeudi.[59] L'un des émirs, son parent, informé de ses intentions, se tenait auprès du Palais pour l'attendre, ainsi que l'un de ses protégés, appartenant à la tribu de Lawâta. Tous trois marchèrent jusqu'au Nil, qu'ils traversèrent à la hauteur de Gizeh ? Sa fuite mit Le Caire en agitation. Le lendemain matin, il se montra à Gizeh dans un salon de réception, où la foule se pressa autour de lui, pendant que l'armée de Misr se disposait à le combattre. Puis, le vendredi matin, il passa sur l'autre rive du Nil pour atteindre Le Caire, tandis que l'armée égyptienne, sous la direction de Kaimâz, le Maître de la porte (Sâhib al-bâb), revêtait ses cottes de mailles pour le combat. Lorsque Roudwân les eut rejoint, il les mit en déroute et entra au Caire.
J'étais monté à cheval et je m'étais dirigé avec mes compagnons vers la porte du Palais, avant que Roudwân ne fût entré dans la ville. Je trouvai les portes du Palais fermées, sans que personne se tînt aux abords. Je revins sur mes pas et je ne bougeai plus de ma maison.
Roudwân s'était établi dans la mosquée Al-Akmar. Les émirs se rendirent en foule vers lui, apportant des vivres et de l'argent. Al-Hâfith, de son côté, avait massé une troupe de nègres dans le Palais. Ils burent, s'enivrèrent, puis on leur ouvrit la porte et ils sortirent, demandant la tête de Roudwân. Le tumulte qui se produisit fit monter à cheval tous les émirs, qui abandonnèrent Roudwân et se dispersèrent. A son tour, il quitta la mosquée, mais sa monture n'y était plus ; son écuyer l'avait prise et était parti.
Un jeune garde du corps vit Roudwân arrêté sur le seuil de la mosquée, et lui dit : « O mon maître, ne veux-tu pas prendre ma place sur mon cheval ? » — « Bien volontiers », dit Roudwân. Le jeune homme s'avança vers lui au galop, l'épée à la main, inclina la tête en se penchant comme pour descendre et frappa Roudwân de son épée. Celui-ci tomba. Les nègres, l'ayant rejoint, le tuèrent. Les gens de Misr se partagèrent les morceaux de sa chair, dont ils mangèrent pour.se donner du courage. Il y aurait eu là pour 'Abbâs une instruction par l'exemple et un avertissement, si Allah n'en avait pas décidé autrement.
Dans ce même jour, un homme de nos compagnons, un Syrien, fut atteint de nombreuses blessures. Son frère vint me trouver et me dit : « Mon frère est dans un état désespéré. Voici ce qui lui est arrivé : il a été blessé par des épées et par d'autres armes, a perdu connaissance et ne revient pas à lui. » — Je répondis : « Retourne et saigne-le. » — Il répliqua : « Son corps a rendu vingt livres de sang. » — Je répétai : « Retourne et saigne-le. Car j'ai plus d'expérience des blessures que toi. Il n'y a pour lui d'autre remède que la saignée. » Il partit, resta loin de moi pendant deux heures, puis revint tout joyeux, en disant : « Je l'ai saigné et il est revenu à lui, s'est assis, a mangé et bu. Son mal l'a quitté. » — Je m'écriai : « Gloire à Allah ! Si je n'avais pas expérimenté ce procédé sur moi-même plus d'une fois, je ne te l'aurais pas recommandé. »
Ensuite, je m'attachai au service d'Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !).[60] Il entra en correspondance avec Al-Malik As-Sâlih[61] pour le prier de mettre en route mes femmes et mes enfants, qui étaient demeurés à Misr et qu'il traitait avec bienveillance. Le vizir renvoya le messager chargé de la demande et s'excusa en disant qu'il s'effrayait pour eux des Francs. Puis il m'écrivit en ces termes : « Tu reviendras à Misr, car tu sais dans quelles relations nous sommes ensemble. Mais, si tu éprouves trop de répulsion contre les gens du Château, tu te rendras à La Mecque, je te ferai parvenir un décret t'octroyant la ville d'Ouswân et je mettrai à ta disposition les renforts nécessaires pour que tu sois en mesure de combattre les Abyssins ; car Ouswân est une ville frontière sur les confins des territoires musulmans. C'est là que je te ferai rejoindre par tes femmes et par tes enfants. » Je consultai Al-Malik Al-’Adil et je cherchai à pénétrer son opinion. « O un tel, me dit-il, tu n'es certes pas disposé, alors que tu es délivré de Misr et de ses luttes intestines, à y retourner. La vie est trop courte pour cela. C'est moi qui ferai les démarches en vue d'obtenir pour ta famille un sauf-conduit du roi des Francs[62] et qui enverrai quelqu'un pour ramener tes proches. » Et, en effet, Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) détacha un messager qui obtint et me fit parvenir de la part du roi un sauf-conduit valable sur terre et sur mer. Je mis en route l'un de mes serviteurs, porteur du sauf-conduit, ainsi que d'une lettre d'Al-Malik Al-’Adil et aussi d'une lettre pour Al-Malik As-Sâlih. Celui-ci fit parvenir mes proches parents jusqu'à Damiette sur un bateau du domaine privé, les munit des sommes et des provisions nécessaires à leurs besoins et leur donna ses instructions. A partir de Damiette, ils larguèrent les voiles en pleine mer sur un navire franc. Lorsqu'ils approchèrent d'Acre, où se trouvait le roi (puisse Allah ne point le prendre en pitié !) le roi envoya sur un frêle esquif quelques hommes qui, avec leurs haches, brisèrent le navire, sous les yeux de mes parents. Le roi monta à cheval, resta sur la rive, pillant tout ce qu'il y rencontrait.
Mon serviteur arriva jusqu'à lui à la nage, en apportant le sauf-conduit, et lui dit : « O mon maître le roi, ceci, n'est-il pas ton sauf-conduit ? » — « En effet, répondit le roi, mais il est d'usage chez les musulmans que, lorsqu'une de leurs embarcations fait naufrage en face d'une ville, les habitants de cette ville aient le droit d'y exercer le pillage. » — « Nous feras-tu prisonniers ? » demanda mon serviteur. — « Non », répondit le roi. Celui-ci (qu'Allah le maudisse !) les réunit dans une maison et alla jusqu'à fouiller les femmes de manière à enlever tout ce que la troupe possédait.
Il y avait sur le navire des parures que les femmes y avaient déposées, des costumes, des perles, des épées, des armes, de l'or et de l'argent, une valeur d'environ trente mille pièces d'or.
Le roi fit main basse sur le tout et remit aux voyageurs cinq cents pièces d'or, en leur disant : « Que cette somme serve à votre rapatriement. » Or, ils n'étaient pas moins de cinquante personnes, hommes et femmes.
A ce moment, j'accompagnais Al-Malik. Al-’Adil Nour ad-Dîn dans les régions du roi Massoud, à Ra'bân et à Kaisoûn. Le salut de mes enfants, des enfants de mon frère et de nos femmes me rendit facile à endurer la perte de mon bien. Je ne fus sensible qu'à la perte de mes livres. Il y avait quatre mille volumes, rien que des ouvrages précieux. Leur disparition est restée pour moi un crève-cœur tant que j'ai vécu.
Ce sont là des catastrophes qui ébranlent les montagnes et qui anéantissent les richesses. Et Allah (gloire à lui !) les compense par sa miséricorde, cicatrise les plaies par sa grâce et par son pardon. Que d'événements graves auxquels j'ai assisté, que de catastrophes dont j'ai été frappé ! Et pourtant ma personne y est restée sauve, parce que les destins l'avaient ainsi décidé. J'ai été ruiné par la perte de ma fortune et, dans l'intervalle de ces événements graves, j'ai pris part à des batailles innombrables avec les infidèles et avec les musulmans. Et, parmi les merveilles de ce que j'ai vu et éprouvé en fait de batailles, je rapporterai ce que ma mémoire me rappellera ; car l'oubli ne saurait être blâmé chez ceux sur lesquels a passé une longue série d'années. Il est héréditaire chez les fils d'Adam depuis leur premier père (sur lui soit la bénédiction et le salut !).
Un exemple, dont j'ai été témoin, du point d'honneur chez les cavaliers et de leur intrépidité à braver les dangers, fut qu'il y eut une rencontre entre nous et Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Karâdjâ, seigneur de Hama à cette époque.[63] La guerre entre nous et lui était de celles qu'on boit à petites gorgées, les détachements restant toujours en-éveil et les troupes rivalisant de rapidité dans la lutte. Or, je vis venir à moi un de nos soldats et de nos cavaliers les plus réputés, Djam'a le Noumairite. Il était en larmes. Je lui dis : « Qu'as-tu donc pour le moment à pleurer ainsi, ô Abou Mahmoud ? » — Il répondit : « J'ai reçu un coup de lance de Sourhanak, fils d'Abou Mansour. » — « Eh bien, repris-je, quelle importance y a-t-il à recevoir un coup de lance de Sourhanak ? » — Il répondit : « Aucune, sinon qu'il me vient d'un homme tel que Sourhanak. Par Allah, la mort me serait plus légère que le coup dont il m'a frappé. Mais il m'a atteint par surprise et à l'improviste. » J'essayai de le calmer et d'atténuer la chose à ses yeux. Mais il fit faire volte-face en arrière à la tête de son cheval. Je lui dis : « Où vas-tu, ô Abou Mahmoud ? » — Il répondit : « Vers Sourhanak. Par Allah, je lui donnerai un coup de lance ou je mourrai de sa main. » Il s'absenta pendant une heure, je m'occupai de l'ennemi qui me faisait face ; puis il revint en riant. Je lui demandai : « Qu'as-tu fait ? » — Il ré pondit : « Je lui ai donné un coup de lance, par Allah ; et, si je l'avais manqué, j'étais perdu. » En effet il avait fondu sur Sourhanak qui était au milieu de ses compagnons, l'avait percé d'un coup de lance et était revenu. »
Voici un fragment de poésie relative à Sourhanak et à Djam'a :
C'est d'Allah que vient ton lait ! Tu ne £ imaginais pas qu'il exercerait le talion, qu'il serait altéré, empêché de dormir par des désirs de vengeance.
Tu l'avais réveillé, puis tu t'étais endormi toi-même ; mais lui, il ne s'était pas assoupi, par colère contre toi ; comment dormirait-il dans son ardeur ?
Si le temps triomphe de toi, et ce sera peut-être un jour, c'est qu'on t'aura donné trop bonne mesure et que la coupe débordera.
Ce Sourhanak était un des cavaliers les plus illustres, un chef des Kurdes. Seulement il était jeune, tandis que Djam'a était en pleine maturité, avec le discernement de l'âge et la supériorité du courage.
L'action de Sourhanak m'a rappelé ce que fit Malik ibn Al-Hârith Al-Aschtar (qu'Allah l'ait en pitié !) à l'égard d'Abou Mousaika Al-Iyâdî. Lorsque, à l'époque d'Abou Bekr As-Siddik (qu'Allah l'ait en sa grâce !), les Arabes rompirent avec l'islamisme et qu'Allah (gloire à lui !) eut résolu de les combattre en faveur de cette religion, Abou Bekr dirigea les armées vers les tribus d'Arabes apostats. Or, Abou Mousaika Al-Iyâdî était, avec les Banoû Hanîfa, les plus puissants des Arabes, tandis que Malik Al-Aschtar était l'un des généraux d'Abou Bekr (qu'Allah l'ait en pitié !). Lorsque l'accord fut rétabli, Malik s'avança entre les deux armées en présence et cria : « O Abou Mousaika ! » Celui-ci sortit des rangs. L'autre reprit : « Malheur à toi, ô Abou Mousaika ! Comment, après avoir pratiqué l'islamisme et lu le Coran, tu es revenu à l'impiété ! » — « O Malik, prends garde à toi, dit Abou Mousaika. Il est interdit aux musulmans de boire du vin. Or, sans vin, il n'y a pas de constance. » — « Te plairait-il, reprit Malik, de lutter avec moi en combat singulier ? » — « Oui », dit l'autre. Ils s'entrechoquèrent avec les lances et avec les épées. Abou Mousaika frappa Malik, lui fendit la tête et lui renversa les paupières, ce qui le fit surnommer Al-Aschtar (l'homme aux paupières renversées). Malik revint alors, en se retenant à la crinière du cheval depuis la selle. Des gens de sa famille et de ses amis se réunirent à lui en pleurant. Il dit à l'un d'eux : « Fais pénétrer ta main dans ma bouche. » Celui-ci fit pénétrer son doigt dans la bouche de Malik qui le mordit. L'homme se tordit de douleur. Malik s'écria : « Votre maître n'a aucun mal. L'on dit que, tant que les dents sont solides, la tête est solide. Bourrez ma blessure de farine fine, puis bouchez-la avec un turban. » Une fois qu'on eut bourré et bouché la plaie, il dit : « Amenez mon cheval ». — On lui demanda : « Pour aller où ? » — Il répondit : « Vers Abou Mousaika. » Malik s'avança entre les deux armées en présence et cria : « O Abou Mousaika. » Abou Mousaika s'avança, rapide comme la flèche. Malik frappa Abou Mousaika de son épée sur l'épaule qu'il fendit jusqu'à l'endroit de la selle et le tua. Malik retourna vers son campement, resta quarante jours sans pouvoir remuer. Ensuite il se remit et guérit de cette blessure.
J'ai vu un cas analogue où l'homme blessé de la lance fut sauvé, alors qu'on s'était imaginé qu'il était mort. Nous avions eu une rencontre avec les éclaireurs de la cavalerie de Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Karâdjâ, qui avait fait invasion dans notre pays et nous avait dressé une embuscade.
Puis, après la bataille, nos cavaliers se séparèrent. Alors vint à moi un cavalier de nos troupes, nommé 'Ali ibn Salam, un Noumairite, et dit : « Nos compagnons se sont débandés. Si les ennemis fondent sur eux, ils les anéantiront. » — Je dis : « Retiens en mon nom mes frères et mes cousins, afin que je ramène nos hommes en arrière. » — 'Ali s'écria : « O émirs, laissez Ousâma ramener les hommes en arrière et ne le suivez pas. Autrement, l'ennemi fondrait sur eux et les délogerait. » — Ils répondirent : « Nous rentrerons. » Je sortis au galop de mon cheval pour faire rentrer nos hommes en arrière. Quant aux ennemis, ils se tenaient à distance d'eux pour les attirer et s'emparer de leurs personnes. Mais, lorsqu'ils me virent leur faire rebrousser chemin, ils s'élancèrent sur nous et leur embuscade se montra, tandis que j'étais à quelque distance de mes compagnons. Je revins sur mes pas pour les rejoindre, voulant protéger leurs derrières. Je trouvai mon cousin Laith ad-Daula Yahya (qu'Allah l'ait en pitié !) qui avait dégainé à l'arrière-garde de mes compagnons sur le côté de la route au sud, tandis que j'étais sur le côté du nord. Nous avions rejoint nos compagnons.
Un cavalier ennemi, Faris ibn Zimâm, un Arabe bien connu, s'avança en hâte et passa devant nous, avide de jouer de la lance sur nos compagnons. Mon cousin me devança, le frappa de sa lance. Faris tomba, ainsi que son cheval, et la lance se brisa avec un fracas que nous entendîmes, moi et mes compagnons.
Or, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait envoyé un messager à Schihâb ad-Dîn qui l'amena avec lui, lorsqu'il vint nous combattre. Après le coup de lance qui atteignit Faris ibn Zimâm, et après la déception de la campagne, Schihâb ad-Dîn rendit la liberté au messager qui emporta une réponse touchant l'objet de sa mission et retourna à Hama.
J'interrogeai le messager : « Est-ce que Faris ibn Zimâm est mort ? » — « Non, répondit-il, par Allah. Il n'est même pas blessé. » Il ajouta : « Laith ad-Daula l'a frappé de la lance sous nos yeux. Il l'a renversé et il a renversé son cheval. J'ai bien entendu le fracas de la lance, lorsqu'elle s'est brisée ; mais, au moment où Laith ad-Daula l'enveloppait à gauche, il s'est rejeté sur le côté droit, tenant lui-même à la main une lance, sur laquelle son cheval s'est abattu près d'un précipice. Cette lance s'est brisée. Laith ad-Daula s'est acharné contre son adversaire avec sa propre lance ; elle lui est tombée des mains. Ce que tu avais entendu était donc le fracas de la lance de Faris ibn Zimâm. La lance de Laith ad-Daula a été apportée devant Schihâb ad-Dîn en ma présence. Elle était intacte, sans la moindre fêlure, et Faris n'a pas été le moins du monde blessé. »
Son salut m'étonna. Ce coup de lance avait ressemblé aux coups que l'on porte avec une épée tranchante, selon la parole d'Antar :
Les chevaux et les cavaliers savent que j'ai violemment séparé leur masse par un coup d'une épée tranchante.
L'armée et l'embuscade de Schihâb ad-Dîn s'en retournèrent sans avoir conquis ce qu'ils auraient voulu.
Le vers précédent est extrait d'une poésie par 'Antara ibn Shaddâd (Antar), dans laquelle il dit :
Je suis un héros, dont une moitié appartient à la plus haute lignée de 'Abs ; l'autre, je la protège avec mon sabre.
Et, lorsque l'escadron demeure immobile et observe du coin de l'œil, je suis considéré comme supérieur à qui se vante de ses oncles paternels et maternels.
Certes la mort, si on la comparait à quelque chose, devrait être assimilée aux coups portés par mes pareils lorsque l'ennemi s'arrête dans le campement resserré.
Les chevaux et les cavaliers savent que j'ai violemment séparé leur masse par un coup d'une épée tranchante.
Renonces à descendre de vos montures ; car je suis le premier à mettre pied à terre. Sur quelles montures chevaucherais-je, si je n'en descendais jamais ?
Il m'arriva une aventure analogue devant Apamée. En effet, Nadjm ad-Din Ilgazi[64] l'Ortokide défit les Francs devant Al-Balât, et cela le vendredi 5 du premier djoumada, en l'an 513,[65] et les anéantit. Roger (Roûdjâr), prince d'Antioche, fut tué, ainsi que tous ses cavaliers.
Mon oncle Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân (qu'Allah l'ait en pitié !) s'était rendu au camp de Nadjm ad-Dîn Ilgazi, tandis que mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était resté en arrière, dans la citadelle de Schaïzar. Mon oncle lui avait recommandé de me faire partir pour Apamée à la tête des hommes valides restés avec moi à Schaïzar et de les exciter, ainsi que les Arabes, à une incursion pour piller les champs cultivés d'Apamée. Une quantité d'Arabes était venue grossir notre population.
Peu de jours après le départ de mon oncle, le héraut nous appela aux armes. J'entraînai avec moi une petite bande, vingt cavaliers tout au plus. Nous étions convaincus qu'Apamée était dégarnie de cavalerie. A notre suite s'avançait une masse de pillards et de Bédouins. Parvenus à la Vallée de Boémond (wâdî aboû 'l-maimoûn), isolés des pillards et des Arabes qui s'étaient dispersés dans les champs, nous vîmes fondre sur nous un détachement considérable de Francs. Il leur était arrivé cette nuit-là même soixante cavaliers et soixante fantassins. Nous fûmes délogés de la vallée, pourchassés. A la fin, nous avions rattrapé ceux de nos hommes qui étaient occupés à dévaster les plantations.
Les Francs poussèrent un cri de guerre retentissant. Je dédaignai la mort, en pensant que tout ce monde y était exposé avec moi. A la tête des Francs s'avançait un cavalier, qui avait rejeté sa cotte de mailles et s'était allégé afin de pouvoir nous dépasser. Je me précipitai sur lui et je l'atteignis en pleine poitrine. Son cadavre s'envola à distance de la selle. Puis je courus sus à leurs cavaliers, qui s'avançaient à la file. Ils reculèrent. Et pourtant je n'avais pas l'expérience des combats, car c'était ma première bataille. J'étais monté sur un cheval rapide comme l'oiseau ; je m'élançai à leur poursuite pour frapper dans leurs rangs, sans qu'ils m'inspirassent de terreur.
Dans l'arrière-garde des Francs, il y avait un cavalier monté sur un rouan cap de more qui ressemblait à un chameau. Il avait sa cotte de mailles et sa cuirasse. J'avais peur de lui et je ne me souciais pas qu'il dégainât en faisant un retour offensif contre moi. Tout à coup, il éperonna sa monture, dont je vis avec joie briller la queue. Elle paraissait épuisée. Je m'élançai sur le cavalier, je le frappai, et ma lance traversa son corps, faisant saillie en avant de près d'une coudée. La légèreté de mon corps, la violence du coup porté et la rapidité de mon cheval me firent tomber de la selle. Je m'y assis de nouveau, je brandis ma lance, bien convaincu que j'avais tué le Franc, et je rassemblai mes compagnons. Ils étaient tous sains et saufs.
Un petit mamlouk m'accompagnait, tenant en laisse une jument rouanne de rechange qui m'appartenait. Il montait une belle mule de selle, avec une housse aux franges d'argent. Il en descendit, la lâcha et enfourcha la jument qui prit son vol avec lui jusqu'à Schaïzar.
Aussitôt que je fus de nouveau réuni à mes compagnons, qui s'étaient emparés de la mule, je m'informai de mon écuyer. « Il s'en est allé, » me répondirent-ils. Je compris qu'il allait rentrer dans Schaïzar et inquiéter à mon sujet le cœur de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). J'apostrophai l'un de nos soldats et je lui dis : « Fais hâte vers Schaïzar et informe mon père de ce qui s'est passé. »
Mon écuyer, à peine rentré, avait été invité par mon père à se présenter devant lui. « Par quelles épreuves avez-vous passé ? » demanda Mourschid. — « O mon maître, répliqua l'écuyer, les Francs ont fait une sortie contre nous ; ils étaient bien mille, et je m'étonnerais s'il y avait un seul survivant en dehors de mon maître. » — « Mais, dit Mourschid, comment ton maître aurait-il échappé seul au massacre général ? » — « Je l'ai vu, dit l'écuyer, couvert de sa cuirasse, chevaucher sur sa jument grise pommelée. »
Il en était là de son récit, quand le cavalier envoyé par moi survint, apportant la certitude. A mon tour, je rentrai. Mon père m'interrogea, et je lui dis : « O mon maître, c'est bien vraiment ma première bataille. Lorsque j'ai vu les Francs en venir aux mains avec nos hommes, j'ai dédaigné la mort, "je me suis tourné contre les Francs, pour me faire tuer ou pour sauver tout ce monde. » Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) m'appliqua alors ce vers du poète :
Le lâche fuit pour sauver sa tête ; l'homme brave défend même ceux qui ne lui tiennent pas de près.
Mon oncle (qu'Allah l'ait en pitié !) arriva quelques jours après, ayant pris congé de Nadjm ad-Din Ilgazi (qu'Allah l'ait en pitié !). Il m'envoya aussitôt quérir par un messager, me priant de me rendre auprès de lui à l'heure accoutumée. Il me reçut, ayant à ses côtés un homme d'entre les Francs. « Ce cavalier, me dit-il, est venu d'Apamée, il aspire à voir le cavalier qui a frappé le chevalier Philippe, car les Francs ont été surpris du coup qui lui a été porté, qui a fendu sa cotte de mailles à deux endroits de la bordure, et pourtant le chevalier a été sauvé. » — « Comment, m'écriai-je, a-t-il pu être sauvé ?» — Le cavalier Franc répondit : « Le coup s'est émoussé contre la peau des hanches. » — Je dis : « Merveille du destin ! Combien le destin est une forteresse imprenable ! Je n'aurais jamais supposé que le cavalier survivrait à un coup pareil ! »
Voici mon opinion : Il est indispensable à celui qui se propose de donner un coup de lance qu'il serre sa main et son avant-bras contre son côté, sur la lance, et qu'il laisse le cheval se diriger d'après ce qu'il fait lui-même au moment où il frappe. Car, toutes les fois que l'homme remue sa main ou sa lance ou tend celle-là pour manier celle-ci, le coup ne laisse aucune trace et ne cause aucun dommage.
J'ai vu un cavalier de nos hommes, nommé Badî ibn Talîl Al-Kouschairî. C'était un de nos braves. Nous nous étions rencontrés, nous et les Francs. Il était désarmé, n'ayant sur lui que deux vêtements. Un cavalier Franc le frappa de la lance en pleine poitrine, fit une entaille dans la courbe autour de la poitrine. Le fer sortit de l'autre côté. Cet homme revint, et nous ne supposions pas qu'il regagnerait sa demeure vivant. Or, Allah (gloire à lui !) décréta qu'il échappât et que sa blessure guérît. Mais, pendant une année entière, lorsqu'il voulait dormir sur le dos, il ne pouvait s'asseoir sans qu'un homme l'assît en le saisissant par les épaules. Puis, ce dont il se plaignait se calma et il revint à ses habitudes de se mouvoir et de chevaucher. Aussi dis-je : Gloire à Celui dont la volonté domine ses créatures, qui fait vivre et qui fait mourir, tandis qu'il reste vivant et ne meurt pas, dans la main duquel est tout bien, dont la puissance est universelle[66] !
Il y avait chez nous un artisan, nommé 'Attâb, le plus corpulent et le plus long des hommes. Celui-ci entra un jour dans sa maison et, au moment de s'asseoir, appuya sa main sur une étoffe placée à sa portée. Elle contenait une aiguille qui lui entra dans la paume de la main et il en mourut. Par Allah, il gémissait dans la ville et l'on entendait son gémissement de la citadelle à cause de sa haute stature et de sa voix sonore. Il mourait d'une piqûre d'aiguille, tandis qu'Al-Kouschairî avait une lance qui lui pénétrait dans la poitrine et qui le transperçait sans qu'il fût atteint gravement.
Une certaine année, le seigneur d'Antioche[67] (qu'Allah le maudisse !) déploya contre nous ses cavaliers, ses fantassins, ses tentes. Nous montâmes à cheval et nous les atteignîmes, nous imaginant qu'ils allaient nous combattre. Ils vinrent, s'établirent dans leur campement habituel et s'enfermèrent dans leurs tentes. Nous rentrâmes de notre côté jusqu'à la fin du jour. Puis, nous montâmes à cheval, nous imaginant qu'ils allaient nous combattre. Mais ils ne bougèrent pas de leurs tentes.
Mon cousin Laith ad-Daula Yahya avait des récoltes qui avaient prospéré. Elles étaient dans le voisinage des Francs. Il réunit des bêtes de somme pour aller chercher et pour emporter ses récoltes. Nous partîmes avec lui au nombre de vingt hommes armés et nous nous postâmes entre lui et les Francs jusqu'à ce qu'il eût pris possession des récoltes. Il partit.
Je m'écartai avec un de nos affranchis, un certain Housâm ad-Daula Mousâfir (qu'Allah l'ait en pitié !), vers un vignoble, au milieu duquel nous avions aperçu des individus placés sur le bord du fleuve.[68] Lorsque, au déclin du soleil, nous arrivâmes aux individus que nous avions vus, voici que c'était un vieillard portant une calotte de femme et un autre vieillard. Housâm ad-Daula, qui était (qu'Allah l'ait en pitié !) un homme excellent, habitué à plaisanter, dit au premier des deux vieillards : « O schaïkh, que fais-tu ici ? » — Il répondit : « J'attends les ténèbres et je donnerai satisfaction à Allah le Tout Puissant sur les chevaux de ces infidèles. » — Je repris : « O schaïkh, sera-ce avec tes dents que tu couperas leur cavalerie ? » — « Non, dit-il, mais avec ce couteau. » Il tira du milieu de sa robe un couteau, attaché par un fil, brillant comme un tison ardent. Il n'avait aucun autre vêtement que sa robe. Nous le quittâmes et nous prîmes congé de lui.
Le lendemain matin, je montai à cheval, attendant ce qui adviendrait des Francs. Voici que le schaïkh était assis sur une pierre de la route, avec du sang figé sur sa jambe et sur son pied. Je lui dis : « Salut ! qu'as-tu fait ? » — Il répondit : « Je leur ai pris un cheval, un bouclier et une lance. Un fantassin s'est attaché à moi, au moment où je m'éloignais de leur armée, m'a donné un coup de sa lance et l'a fait pénétrer dans ma cuisse. J'ai pu lui échapper avec le cheval, le bouclier et la lance. » Il méprisait le coup qu'il avait reçu, comme si un autre en avait été frappé. Cet homme, appelé Az-Zamarrakal, était parmi les satans des bandits.
C'est à son sujet que l'émir Mou'în ad-Dîn[69] (qu'Allah l'ait en pitié !) m'a raconté ce qui suit : « Alors que je séjournais à Homs, je fis une expédition contre Schaïzar. A la fin du jour, je m'en retournai camper près d'un domaine sur le territoire de Hama. J'étais alors en hostilité avec le seigneur de Hama. Voici que vinrent à moi des gens entraînant un schaïkh dont ils se méfiaient, qu'ils avaient fait prisonnier et amené. Je lui dis : « O schaïkh, qui es-tu ? » — Il répondit : « O maître, je suis un mendiant âgé, atteint d'une maladie chronique. » Il me montra sa main, qui était atteinte d'une maladie chronique, et me dit : « Les troupes m'ont pris deux chèvres ; je me suis mis à la poursuite des soldats, dans l'espoir qu'ils me feraient l'aumône de mes deux chèvres. » Je donnai à quelques-uns de mes gardes du corps l'ordre de garder le mendiant jusqu'au matin. Ils le firent asseoir au milieu d'eux et s'assirent auprès de lui sur les manches d'une pelisse. Le mendiant trompa leur surveillance pendant la nuit, sortit de la pelisse et la laissa sous eux pour s'enfuir. Le lendemain, ils s'élancèrent à sa poursuite ; mais il les devança et disparut. »
Mou'în ad-Dîn continua en ces termes : « Et j'avais envoyé quelques-uns de mes compagnons pour régler une affaire. Lorsqu'ils revinrent, et parmi eux était un de mes gardes du corps, nommé Saumân, qui habitait naguère Schaïzar, je lui racontai l'histoire du schaïkh. Il me dit : « Quels regrets il m'inspire ! Si je l'avais rattrapé, j'aurai bu son sang à ce Zamarrakal. » — Je lui demandai : « Qu'y a-t-il donc entre toi et lui ? » — Il répondit : « L'armée des Francs campa devant Schaïzar. Je me mis à en faire le tour. Peut-être leur dérobe-rais-je un cheval. Lorsque l'obscurité fut complète, je m'avançais vers une écurie qui était devant moi. Or, voici que ce Zamarrakal m'arrêta et me dit : « Où vas-tu ? » — Je lui répondis : « Prendre un cheval dans cette écurie. » — Il répliqua : « Comment, depuis le souper, j'observerais l'écurie pour que tu y prisses toi le cheval ! » — Je dis : « Tu n'es pas dans la bonne voie. » — Mais il reprit : « Tu ne passeras pas, par Allah. Je ne te laisserai rien prendre. » Je ne tins pas compte de sa défense et je me dirigeai vers l'écurie. Alors il se leva et cria de sa voix la plus forte : « O ma misère, ô déception pour mon honneur et pour ma renommée ! » Il vociféra jusqu'au moment où les Francs s'élancèrent contre moi. Quant à lui, il avait disparu. Les Francs me poursuivirent de si près que je me jetai dans le fleuve. Je ne croyais pas que je leur échapperais. L'aurais-je rattrapé que j'aurais bu son sang. Car c'est un brigand redoutable qui n'a jamais suivi les troupes que pour les voler. »
Ce Saumân disait : « Qui verrait Zamarrakal le considérerait comme incapable de voler dans sa maison une couronne de pain rond. »
En fait de vol merveilleux, je raconterai l'anecdote suivante : J'avais à mon service un certain 'Ali ibn Ad-Doûdawaihi, dont la conduite était répréhensible. Les Francs (qu'Allah les maudisse !) campèrent un jour devant Kafartâb qui appartenait alors à Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî (qu'Allah l'ait en pitié !). Cet 'Ali ibn Ad-Doûdawaihi sortit de la ville, tourna autour des Francs et prit un cheval, sur lequel il monta et qu'il amena au galop hors du campement. 'Ali entendait du bruit derrière lui et s'imaginait qu'un cavalier s'acharnait à sa poursuite. Il pressait sa monture, le bruit persistant sur ses derrières. Son galop se poursuivit l'espace de deux parasanges, sans que le bruit discontinuât. Alors il se retourna pour voir ce qui l'accompagnait ainsi dans les ténèbres. C'était une mule, compagne du cheval, qui avait rompu son licou pour le suivre. 'Ali serra ses rênes sur la tête de la mule dont il s'empara. Au lendemain matin, il vint auprès de moi à Hama m'offrir le cheval et la mule. Le cheval était une des montures les meilleures, les plus belles et les plus rapides.
J'étais un jour auprès de l'atabek, alors qu'il assiégeait Rafaniyya.[70] Il m'avait mandé. Il me dit : « O Ousâma, qu'as-tu fait de ton cheval dont tu as fait mystère ? » On lui avait raconté l'histoire du cheval. Je lui répondis : « Non, par Allah, ô mon maître, je n'ai pas de cheval caché. Tous mes chevaux sont montés par nos soldats.» — Il reprit :« Et le cheval Franc ? » — « Il est présent », lui dis-je. — Il ordonna : « Envoie, qu'on l'amène. » J'envoyai pour qu'on l'amenât, puis je dis à l'écuyer : « Conduis-le à l'étable de l'atabek. » — L'atabek s'écria : « Je le laisserai provisoirement chez toi. » Le lendemain matin il le monta et devança tous les autres de vitesse, puis il le rendit à mon étable. Il demanda de nouveau qu'on le lui amenât de la ville, le monta et devança tous les autres de vitesse. Je le fis alors transporter dans son étable.
Et j'ai vu dans le combat qui suivit la fin de la trêve cet épisode : Il y avait chez nous parmi nos troupes un cavalier réputé, nommé Rafi' Al-Kilâbî. Nous nous combattîmes, nous et les Banoû Karâdjâ[71] qui avaient recruté et rassemblé contre nous des Turcomans, ainsi que d'autres soldats. Nous les laissâmes se déployer dans une plaine de la région. Ils s'amoncelèrent pour nous combattre. Nous retournâmes, en protégeant la rentrée les uns des autres, ce Rafi' étant à la tête de ceux qui défendaient notre arrière-garde. Il portait un casaquin ; sur sa tête était un casque sans visière. Il se retourna, comme s'il voyait une occasion de les châtier. Une flèche le frappa, lui faisant une entaille à la gorge, la déchira. Il tomba sur place raide mort.
J'ai vu mourir de même Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Karâdjâ.[72] Les différends entre nous et lui étaient apaisés, et il avait envoyé à mon oncle un message pour lui dire : « Tu ordonneras à Ousâma de me rejoindre le plus tôt possible avec un seul cavalier, pour que nous allions à la découverte d'un endroit propice à nos embûches et à notre attaque contre Apamée. » Mon oncle m'ayant donné des ordres dans ce sens, je montai à cheval, je rencontrai Mahmoud et j'allai avec lui examiner toutes les positions.
Notre armée et la sienne se rassemblèrent bientôt. J'avais le commandement de l'armée de Schaïzar, il commandait son armée. Avant d'être arrivés à Apamée, nous étions en présence des cavaliers et des fantassins Francs dans la région dévastée qui précède la ville. C'est un terrain où les chevaux évoluent difficilement à cause des pierres, des colonnes et des fondements de murailles détruites. Nous fûmes impuissants à déloger les Francs de cet endroit.
Un de nos soldats me dit : « Tu voudrais les tailler en pièces ? » — « Certes, » répondis-je. — « Eh bien, reprit le soldat, dirige-nous vers la porte de la citadelle. » — Je lui dis : « Allez-y. » Mon interlocuteur se repentit de sa parole et reconnut que nos ennemis nous fouleraient aux pieds pour arriver avant nous à leur citadelle. Il chercha à me détourner de ce qu'il m'avait d'abord conseillé. Mais je ne voulus rien entendre et je pris la direction de la porte.
A l'instant où les Francs nous virent engagés dans le chemin de la porte, ils revinrent vers nous, fantassins et cavaliers, nous foulèrent aux pieds et passèrent. Leurs cavaliers mirent pied à terre à l'entrée de la porte et renvoyèrent leurs chevaux, qu'on fit remonter jusque dans la forteresse même. Ils alignèrent les pointes de leurs lances dans l'espace de la porte. Moi et un de mes compagnons, serviteur de mon père, né dans sa maison, nommé Rafi, fils de Soûtakîn, nous nous tenions sous le mur en face de la porte, atteints par nombre de pierres et de flèches en bois, tandis que Schihâb ad-Din, avec son escorte, se tenait à distance, dans sa crainte des Kurdes.
Par accident, un coup d'e lance avait atteint l'un de nos compagnons, nommé Hâritha An-Noumairî, parce qu'il était accroupi sur le poitrail de son cheval. La lance s'enfonça ensuite dans le cheval, le blessa violemment et finit par retomber. La peau du poitrail de l'animal fut toute entière enlevée et la bête resta suspendue sur ses jambes de devant.
Schihâb ad-Dîn se tenait à l'écart du champ de bataille. Et pourtant une flèche lancée de la forteresse l'atteignit et le frappa sur le côté de l'os du poignet, sans pénétrer plus avant que l'épaisseur d'un grain d'orge. Son aide de camp vint me dire de sa part : « Reste à ton poste, afin de rallier les troupes dispersées dans le pays, car j'ai été blessé, et je crois sentir ma blessure jusque dans mon cœur. Je m'en retourne ; veille sur nos hommes. »
Il partit. Je ramenai les hommes, je fis halte devant le château fort de Khouraiba. Les Francs y avaient placé une sentinelle pour nous épier de loin, lorsque nous projetterions une incursion vers Apamée.
J'arrivai au déclin du jour à Schaïzar. Schihâb ad-Dîn était dans la maison de mon père. Il avait voulu dénouer les bandages de sa blessure et la soigner. Mon oncle l'en empêcha et lui dit : « Par Allah, tu ne dégageras pas ta blessure ailleurs que dans ta résidence. » — Il répondit : « Je suis dans la maison de mon père. » C'était mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) qu'il désignait ainsi. Mon oncle reprit : « Lorsque tu seras parvenu chez toi et que ta blessure sera guérie, la maison de ton père sera à ta disposition. » Schihâb ad-Dîn se dirigea vers l'ouest et se rendit à Hama. Il s'y arrêta le lendemain et le surlendemain. Puis sa main noircit, il perdit connaissance et mourut. Ainsi s'accomplit sa destinée.
Parmi les coups de lance les plus terribles, j'ai vu un coup dont un cavalier d'entre les Francs (puisse Allah leur faire défection !) frappa l'un de nos cavaliers, nommé Sâya ( ?) ibn Kounaib, un Kilâbite. Celui-ci eut trois côtes fendues à gauche et trois à droite, sans parler de son coude atteint et détaché par le tranchant de la lame, comme le boucher disjoint les articulations. Le Kilâbite mourut sur l'heure.
Un Kurde qui servait dans nos troupes, un nommé Mayyâh, frappa de la lance un cavalier d'entre les Francs, fit pénétrer dans son corps un fragment de sa cotte de mailles et le tua. Puis les Francs firent, quelques jours après, une incursion contre nous. Mayyâh s'était juste marié. Il sortit armé et, au dessus de sa cuirasse, il portait, comme les nouveaux épousés, un vêtement rouge qui le faisait remarquer. Un cavalier le frappa de sa lance et le tua (qu'Allah l'ait en pitié !).
Que le deuil causé par sa mort fut proche de ses noces !
Je me souviens à ce propos de ce qu'on a raconté au sujet du Prophète (qu'Allah lui donne la bénédiction et le salut !). On venait de réciter devant lui la parole de Kais ibn Al-Khatîm :
Je me bats avec eux au jour du danger pour ma famille, en soupirant, comme si ma main, par rapport à l'épée, était un joueur d'échecs ayant perdu une tour.
Le Prophète (qu'Allah lui donne la bénédiction !) dit aux assistants d'entre les Ansâr (qu'Allah les ait en grâce !) : « Est-ce que quelqu'un parmi vous a pris part à la Journée du verger ? » — « Moi, dit l'un d'eux, ô envoyé d'Allah (qu'Allah te donne la bénédiction et le salut !), et Kais ibn Al-Khatîm en était également, au moment où il venait de se marier. Il portait un manteau rouge. Or, par Celui qui t'a envoyé apporter la vérité, il se conduisit à la bataille comme il l'a dit de lui-même.
Entre autres coups de lance merveilleux, je rapporterai qu'un Kurde, nommé Hamadât, nous était uni par de très anciennes relations. Il avait voyagé avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) jusqu'à Ispahan à la cour du sultan Malik-Schah.[73] Depuis, il avait vieilli et sa vue s'était affaiblie. Ses enfants avaient grandi. Mon oncle 'Izz ad-Dîn[74] lui dit un jour : « O Hamadât, tu as vieilli et tu t'es affaibli. Nous avons des devoirs envers toi, en raison de tes services. Si tu voulais seulement rester attaché à ta mosquée (or il y avait une mosquée contiguë à la porte de sa maison) ! Nous inscririons tes fils sur les rôles, et toi, tu recevrais chaque mois deux dinars, avec une charge de farine, pourvu que tu te tiennes dans ta mosquée. » — Il répondit : « C'est entendu, ô émir. » L'arrangement ne dura que peu de temps ; puis il vint trouver mon oncle et lui dit : « O émir, par Allah, ma nature ne s'accommode pas de cette vie sédentaire dans le temple. Être tué sur mon cheval me semble plus désirable que mourir sur ma couche. » — « Libre à toi ! », répondit mon oncle qui ordonna de lui rétablir sa solde antérieure. Quelques jours à peine s'étaient écoulés depuis lors, quand le comte de Cerdagne,[75] seigneur de Tripoli, fit une incursion sur notre territoire. Nos hommes se mirent en campagne vers eux, et Hamadât était parmi ceux qui répandaient la terreur. Il s'arrêta sur un tertre dans la direction de la kibla.[76] Un chevalier franc s'élança contre lui du côté ouest. Nos compagnons lui crièrent alors : « O Hamadât. » Il se retourna et vit le chevalier se diriger vers lui. Hamadât tourna la tête de son cheval à gauche, saisit sa lance et la fit pénétrer en droite ligne dans la poitrine du Franc qui fut transpercé. Le Franc revint en se suspendant à la crinière de son cheval, expirant. Lorsque le combat fut terminé, Hamadât dit à mon oncle : « O émir, si Hamadât était dans la mosquée, qui aurait donné pareil coup de lance ? »
Cela me remet en mémoire la parole d'Al-Find Az-Zimmânî.
O coup de lance d'un vieillard très âgé, décrépit, usé ! J'en ai rajeuni ; car d'ordinaire les gens de mon âge ont horreur des armes.
Al-Find, quoique très âgé, avait assisté au combat. Il avait frappé de la lance deux cavaliers qui s'étaient approchés de lui et les avait tous deux atteints.
Il nous, était arrivé quelque chose d'analogue. Un paysan (fallâh) de la ville haute vint en galopant vers mon père et mon oncle (qu'Allah les ait tous deux en pitié !), en disant :
« J'ai vu un détachement de Francs égarés, qui sont venus du désert. Si vous décidiez une sortie contre eux, vous les feriez prisonniers. » Mon père et mon oncle[77] mirent en campagne leurs troupes pour surprendre le détachement égaré. Or c'était le comte de Cerdagne, à la tête de trois cents cavaliers et de deux cents Turcopoles (Tourkouboûlî). On appelle ainsi les archers des Francs. Lorsqu'ils aperçurent nos compagnons, ils remontèrent sur leurs chevaux, firent une charge à fond sur nos soldats, les mirent en déroute et les contraignirent à abandonner jusqu'au dernier le champ de bataille.
Un mamlouk de mon père, nommé Yâkoût le Long, s'acharna contre eux, sous les yeux de mon père et de mon oncle (qu'Allah les ait tous deux en pitié !). Il donna un coup de lance à un de leurs cavaliers, un autre cavalier étant à côté du premier, alors que ceux-ci poursuivaient nos compagnons. Yâkoût renversa les deux cavaliers et les deux chevaux. Or cet écuyer avait une conduite douteuse et irrégulière, ne cessant de s'exposer aux punitions. Toutes les fois que mon père se proposait de le châtier, mon oncle disait : « O mon frère, donne-moi sa grâce et ne lui oublie pas ce coup de lance. » Alors mon père lui pardonnait grâce à l'intercession de son frère.
Ce Hamadât, dont j'ai parlé plus haut, était un causeur ingénieux. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) m'a raconté ce qui suit : « Un matin, je dis à Hamadât, alors que nous nous trouvions sur la route d'Ispahan : « O émir Hamadât, as-tu mangé quoi que ce soit aujourd'hui ? » — « Oui, répondit-il, ô émir, j'ai mangé un morceau de pain trempé. » — Je repris : « Nous avons chevauché de nuit sans faire halte, sans allumer de feu. D'où t'est venu ce pain trempé ? » — Il répondit : « Le mélange a été opéré dans ma bouche. J'y mettais le pain et je buvais là-dessus de l'eau. Il en résultait comme du pain trempé. »
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait pris part à nombre de combats. Il avait sur le corps des blessures horribles et mourut cependant sur sa couche.[78] Un jour, il assistait à la bataille, armé et couvert d'un heaume musulman. Un homme l'attaqua avec le fer d'un javelot, et c'est ainsi qu'à cette époque les Francs combattaient le plus souvent les Arabes. Le fer se fixa dans la visière du casque. Mon père se replia et laissa saigner son nez, sans dommage pour lui-même. Et si Allah (gloire à lui !) avait décrété que le javelot déviât de la visière du casque, mon père en serait mort.
Une autre fois, il fut frappé à la jambe par une flèche de bois. Dans sa bottine était une dague. La flèche s'y enfonça et s'y brisa, sans le blesser, parce que telle était la beauté de la protection dont l'entourait Allah le Tout Puissant.
Il assista (qu'Allah l'ait en pitié !), le dimanche 29 de chewâl, en l'an 497[79] à la bataille livrée contre Saïf ad-Daula Khalaf ibn Moulâ'ib Al-Aschbahî ( ?), seigneur d'Apamée, sur le territoire de Kafartâb. Mon père avait revêtu sa cuirasse. L'écuyer, dans sa hâte, avait négligé de rejeter sur le côté le crochet de la cuirasse. Une pique atteignit mon père à l'endroit que l'écuyer avait négligé de dissimuler au-dessus du sein gauche et alla sortir au-dessus du sein droit. Les causes de son salut furent que, la volonté divine ayant ordonné merveille en fait de blessure, Allah (gloire à lui !) décréta merveille en fait de guérison.
Dans ce même jour, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait donné un coup de lance à un cavalier ; puis, inclinant de côté son cheval, il avait ployé sa main pour retirer le fer enfoncé dans le corps du blessé. Voici ce qu'il m'a raconté : « Je ressentis comme une piqûre à mon poignet. Je l'attribuai à la chaleur produite par les feuilles de métal de la cuirasse. Mais ma lance me tomba des mains et je la ramassai. Je m'aperçus alors que j'avais été atteint à la main et que la peau y était pendante par la rupture d'un nerf. » Je vis mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), alors que Zaid le chirurgien soignait sa blessure. A son chevet un serviteur se tenait debout. Celui-ci dit : « O Zaid, sors ce caillou de la blessure. » Le chirurgien ne lui répondit pas. Il reprit : « O Zaid, ne vois-tu pas ce caillou ? Ne le retireras-tu pas de la blessure ? » Ennuyé de son insistance, Zaid dit : « Où est ce caillou ? Ce que je vois est le haut d'un nerf, qui s'est rompu. » Or, en réalité, ce nerf était blanc, semblable à l'un des cailloux de l'Euphrate.
Mon père fut ce même jour percé d'un autre coup de lance. Allah le sauva au point qu'il mourut (qu'Allah l'ait en pitié !) sur sa couche le lundi 8 de ramadan 531. ' Il avait une magnifique écriture, que n'avait point altérée le coup de lance sur la main. Il ne copiait que le Coran. Un jour, je l'interrogeai et je lui dis : « O mon maître, combien as-tu achevé d'exemplaires ? » — Il répondit : « A l'heure Suprême vous le saurez. » Lorsque sa mort fut proche, il dit : « Dans cette caisse que voilà, il y a des transcriptions de ma main, que j'ai distinguées chacune par une conclusion originale. Mettez-les sous ma joue dans le tombeau. » Le compte fait, il y en avait quarante-trois, avec quarante-trois appendices différents. Il y avait un exemplaire en grand format, écrit en lettres d'or, qui contenait à la fin une dissertation sur les sciences relatives au Coran ; telles que ses variantes, ses particularités, sa langue, ce qui y abroge et ce qui y est abrogé, son explication, les causes de sa révélation et sa jurisprudence. Dans cette-dissertation intitulée : Le grand commentaire, la sépia, le rouge et le bleu alternaient. Mon père avait écrit en lettres d'or un autre exemplaire indépendant de son commentaire. Quant aux autres copies, l'encre y était employée pour le texte, mais l'or pour les décades, les quintains, les coupes des versets, les têtes des cent quatorze chapitres (soûra) et les têtes des trente sections (djous').
Mon livre ne comportait pas ici cette mention. Je ne l'y ai insérée que pour demander à" qui lira l'un de ces exemplaires d'implorer en faveur de mon père la pitié d'Allah. Je reviens à mon sujet. Dans cette même journée, un ancien serviteur de mon oncle paternel 'Izz ad-Daula Abou ‘l-Mour-haf Nasr (qu'Allah l'ait en pitié !), serviteur qui se nommait Mouwaffak ad-Daula Schim'oûn, reçut un coup de lance terrible destiné à mon autre oncle paternel 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân (qu'Allah l'ait en pitié !). Il était advenu que mon oncle Soultân avait envoyé Schim'oûn en mission à Alep vers le roi Roudwân, fils de Tadj ad-Daula Toutousch. En l'accueillant, celui-ci dit à ses serviteurs : « Voici le modèle des serviteurs et des justes dans leurs devoirs envers leurs maîtres. »Puis, s'adressant à Schim'oûn, il ajouta : « Raconte-leur ce qui t'est arrivé au temps de mon père et comment alors tu t'es conduit envers ton maître. » — Schim'oûn prit la parole en ces termes : « O notre maître, hier j'ai assisté au combat avec mon maître. Un cavalier l'a assailli pour lui donner un coup de lance. Je me suis précipité entre, ce cavalier et mon maître pour racheter celui-ci au prix de ma vie. Le cavalier s'est vengé sur moi et m'a fendu deux côtes. Je le jure par ta bienveillance, je les ai apportées avec moi dans un coffret. » — Le roi Roudwân lui dit : « Je ne te rendrai pas réponse, tant que tu n'auras pas envoyé chercher le coffret et les côtes. » Schim'oûn resta auprès du roi et fit chercher le coffret. Il contenait deux os de ses côtes. Roudwân, saisi d'admiration, dit à ses compagnons : « Agissez de même à mon service. »
Quant au fait sur lequel Roudwân avait interrogé Schim'oûn et qui s'était passé du temps de son père Tadj ad-Daula Toutousch, voici ce que c'était : Mon grand-père Sadîd Al-Moulk Abou 'l-Hasan 'Ali ibn Moukallad ibn Nasr Ibn Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !) avait envoyé son fils 'Izz ad-Daula Nasr (qu'Allah l'ait en pitié !) au service de Tadj ad-Daula, campé dans la banlieue d'Alep. Toutousch le fit saisir, emprisonner, surveiller et ne permit à personne d'entrer auprès de lui, excepté à son mamlouk, à ce Schim'oûn. On faisait bonne garde autour de la tente. Mon oncle écrivit à son père (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) en lui demandant de faire partir vers lui, dans telle nuit qu'il désigna, des hommes de ses compagnons qu'il indiqua et des chevaux de selle qui se rendraient dans un endroit fixé d'avance. Lorsque cette nuit fut arrivée, Schim'oûn entra dans la tente et ôta ses vêtements que son maître revêtit. Celui-ci sortit devant les gardiens qui ne le reconnurent pas, alla rejoindre ses compagnons, monta à cheval et partit.
Schim'oûn dormit sur la couche demeurée vide. A l'aurore, les gardiens furent étonnés de ne pas le voir arriver, lui qui venait régulièrement assister son maître pour les ablutions. Or, Nasr (qu'Allah l'ait en pitié !) était un de ces ascètes qui se lèvent la huit pour lire en psalmodiant le Livre d'Allah 1 le Tout Puissant. Lorsqu'au matin ils ne virent pas Schim-'oûn entrer selon son habitude, ils pénétrèrent dans la tente et l'y trouvèrent, tandis que 'Izz ad-Daula était parti. Tadj ad-Daula, informé par eux de ce qui s'était passé, manda Schim-'oûn. Celui-ci se présenta aussitôt. « Quels moyens as-tu employés ? » demanda Toutousch. — « J'ai, répondit Schim-'oûn, donné mes vêtements à mon maître, qui, à la faveur de ce déguisement, a pu s'échapper ; quant à moi, j'ai dormi sur sa couche. » —Le prince reprit : « Et n'as-tu pas craint que je fasse tomber ta tête ? » — Schim'oûn dit alors : « O mon maître, lorsque tu auras fait tomber ma tête, si je sais mon maître en sûreté, au milieu des siens, cette perspective suffira à me rendre heureux. Il ne m'a acheté et ne m'a élevé que pour pouvoir disposer un jour de ma vie. » Tadj ad-Daula (qu'Allah l'ait en pitié !) dit alors à son chambellan : « Que l'on remette à cet écuyer les chevaux, les bêtes de somme, les objets de campement et tous les bagages de son maître. » Il l'envoya rejoindre celui auquel il appartenait, ne lui tint pas rancune, ne lui manifesta aucune colère à propos de ce qu'il avait fait pour le service de son maître. C'est à ce propos que Roudwân avait dit à Schim'oûn : « Raconte à mes compagnons ce qui t'est arrivé au temps de mon père et comment tu t'es conduit envers ton maître. »
Je reviens au récit de la bataille, dont j'ai parlé précédemment, que nous avions engagée avec Ibn Moulâ'ib. Mon oncle 'Izz ad-Daula (qu'Allah l'ait en pitié !) subit, dans cette journée, plusieurs blessures dont l'une produite par un coup de lance au bas de la paupière, près du coin intérieur de l'œil. La lance s'accrocha au coin de l'œil, à son extrémité. La paupière se détacha complètement et resta suspendue à la peau qui la retenait à l'angle extérieur de l'œil endommagé, vacillant ; car ce sont les paupières qui seules maintiennent l'œil. Le chirurgien sut recoudre la partie déchirée de l'œil et le guérit. L'œil atteint reprit sa santé d'autrefois, sans qu'on pût le distinguer de l'autre.
Mon père et mon oncle (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) étaient parmi les hommes les plus courageux de leur contrée. J'admirai leur conduite un jour qu'ils étaient sortis pour la chasse aux faucons dans la direction du Tell Milh, qui abondait en oiseaux aquatiques. A notre insu, l'armée de Tripoli avait fait invasion et s'était répandue dans la région. Nous rentrâmes. Mon père relevait de maladie. Mon oncle, avec sa faible escorte, s'avança vers les Francs jusqu'au moment où ceux-ci le virent traverser le gué. Quant à mon père, il laissa son cheval marcher au trot. Je l'accompagnais et j'étais encore un adolescent. Il tenait à la main un coing qu'il suçait. Lorsque nous fûmes parvenus dans le voisinage des Francs, il me dit : « Va de ton côté, entre par la levée. » Mais lui, il passa le fleuve aux environs du point occupé par les Francs.
Une autre fois, je vis mon père, alors que les cavaliers de Mahmoud, fils de Karâdjâ, avaient fait incursion sur le territoire de Schaïzar. Nous étions à une certaine distance de la ville. J'avais assisté à la bataille et pris part au combat, revêtu de ma casaque, monté sur mon cheval, armé de ma lance. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était sur une mule. Je lui dis : « O mon maître, pourquoi ne montes-tu pas sur ton cheval ? » — Il répondit : « Certes non. » Et il resta sur sa mule, sans se troubler et sans se hâter. Quant à moi, effrayé pour lui, j'insistai pour qu'il montât sur son cheval jusqu'au moment où nous arrivâmes à la ville, sans qu'il eût quitté sa mule. Lorsque nos ennemis furent rentrés dans leur campement et que notre sécurité fut revenue, je dis à mon père : « O mon maître, tu vois l'ennemi campé entre nous, et notre territoire, pourquoi ne montes-tu pas sur un des chevaux tenus en laisse pour ton usage ? J'ai beau t'en presser, tu ne m'écoutes pas. » — « Mon fils, répondit Mourschid, il y a dans mon horoscope que je serai inaccessible à la peur. » Or, mon père avait la main longue dans la science des astres, malgré sa crainte du péché, sa foi, ses jeûnes continuels et sa récitation du Coran. Il m'encourageait à m'instruire à mon tour dans cette science ; mais je m'y refusais et je m'en défendais, bien qu'il me dit sans cesse : « Mais sache au moins les noms des étoiles et distingue celles qui montent de celles qui descendent à l'horizon. » Et il persistait à me les faire connaître et à me les nommer.
Un trait de bravoure des hommes et une manifestation de leur point d'honneur à la guerre se déroulèrent devant mes yeux.[80] Nous vîmes un matin, à l'heure de la prière de l'aurore, une petite troupe de Francs, dix cavaliers environ, venir jusqu'à la porte de la ville avant qu'elle fût ouverte. Ils dirent au portier : « Quel est le nom de cette contrée ? » La porte avait deux battants en bois avec des poutres transversales. Le portier était à l'intérieur. Il répondit : « C'est Schaïzar. » Par un interstice de la porte, les Francs lui lancèrent une flèche de bois ; puis, ils s'en retournèrent, au trot de leurs montures.
De notre côté, on monta à cheval. Mon oncle (qu'Allah l'ait en pitié !) fut le premier prêt. J'étais avec lui, et les Francs se retiraient sans se presser. Quelques-uns de nos soldats nous rejoignaient l'un après l'autre. Je dis à mon oncle : « Ordonne seulement, et je poursuivrai les Francs avec nos compagnons, je saurai bien les désarçonner avant, qu'ils soient loin d'ici. » — Mon oncle, qui était plus expert que moi aux choses de la guerre, me répondit : « Il n'y a pas en Syrie un seul Franc qui ne connaisse Schaïzar. Quelque machination se cache là-dessous. »
Mon oncle appela deux cavaliers montés sur des chevaux, agiles et leur dit : « Allez explorer le Tell Milh. » C'est là que d'ordinaire les Francs se mettaient en embuscade. Arrivés sur le sommet, les deux cavaliers furent attaqués par l'armée d'Antioche toute entière. En hâte, nous nous étions avancés vers les Francs, pour saisir l'occasion de nous mesurer avec eux avant que le combat fût terminé. Avec nous étaient Djam'a, de la tribu de Noumair, et son fils Mahmoud. Or, Djam'a était notre cavalier et notre schaïkh. Son fils Mahmoud s'était aventuré au milieu de l'armée franque. Djam'a crie : « O cavaliers, sauvez mon fils ! » Nous revînmes avec lui, à la tête de seize cavaliers ; nos lances frappèrent seize cavaliers Francs, auxquels notre compagnon fut arraché. Nous nous mêlâmes, nous et les Francs, jusqu'à ce que l'un de nos cavaliers emportât sous son aisselle la tête du fils de Djam'a[81] ; il fut sauvé par l'un de nos coups de lance.
Malgré ce succès, qu'aucun homme ne se fie à son courage et ne soit infatué de sa bravoure. Par Allah, je partis avec mon oncle paternel[82] (qu'Allah l'ait en pitié !) pour une incursion contre Apamée.[83] Il advint que les troupes de cette ville firent une sortie pour protéger le départ d'une caravane qu'ils mirent en route. Sur le retour, nous les rencontrâmes et nous mîmes à mort environ vingt hommes. Je vis alors Djam'a le Noumairite (qu'Allah l'ait en pitié !), portant enfoncée la moitié d'une lance, qui avait d'abord atteint le coussinet sous la selle, qui était sortie d'un des coins jusqu'à sa cuisse, qui avait pénétré dans son corps par derrière et s'y était brisée. J'en fus ému. Mais il me dit : « Ne t'inquiète pas ! Je suis sain et sauf. » Il saisit la pointe de la lance et la retira, lui et son cheval étant tous deux en parfait état. Je lui dis : « O père de Mahmoud, j'aimerais m'approcher de la forteresse pour l'examiner. » — Il dit : « En route ! » Nous trottions ensemble sur nos deux chevaux. Arrivés à un point d'où nous dominions la forteresse, voici que huit Francs étaient postés sur la route située au-dessus de l'amphithéâtre, sur une hauteur d'où l'on ne pouvait descendre que par ce chemin. Djam'a me dit : « Fais halte pour que je te montre comment je vais les traiter. » — Je répondis : « Ce n'est pas juste ; mais nous allons les assaillir, moi et toi. » — « Soit », dit-il. Nous nous élançâmes sur eux et nous revînmes, assurés d'avoir fait ce qu'aucun autre n'aurait pu faire. A nous deux, nous avions mis en déroute huit cavaliers Francs. Nous demeurâmes sur cette hauteur pour examiner la forteresse. Nous n'y fûmes troublés que par un petit fantassin qui était monté pour nous attaquer sur cette montée escarpée. Il avait emporté un arc et des flèches en bois. Il nous atteignit, sans qu'aucun chemin nous fût ouvert dans sa direction. Nous fûmes mis en déroute, croyant à peine que nous lui échapperions, et nos chevaux ne furent pas touchés. Revenus sur nos pas, nous entrâmes dans les prairies autour d'Apamée, d'où nous poussâmes devant nous un butin considérable de buffles, de bœufs et de brebis, et nous nous en retournâmes. Mon cœur soupirait à la pensée de ce fantassin qui nous avait mis en déroute, dans la direction duquel aucun chemin n'avait été ouvert pour nous. Comment donc un seul fantassin nous avait-il mis en déroute, nous qui avions mis en déroute huit cavaliers Francs ?
J'étais présent un jour, alors que les cavaliers de Kafartâb, en petit nombre, avaient fait une incursion contre nous. Nous nous élançâmes sur eux, désirant profiter de leur petit nombre. Or ils avaient disposé contre nous une embuscade où leurs combattants étaient massés. Les auteurs de l'attaque s'étaient enfuis. Nous nous mîmes à leur poursuite jusqu'à une certaine distance de la ville. L'embuscade sortit contre nous, ceux que nous repoussions revinrent à la charge, et notre conviction fut que, si nous étions mis en déroute, ils nous anéantiraient jusqu'au dernier. La rencontre eut donc lieu et nous leur fîmes face. Allah nous donna la victoire sur eux et nous délogeâmes dix-huit de leurs cavaliers, les uns frappés de la lance et tués, d'autres frappés et jetés à terre sans qu'ils fussent morts, d'autres enfin dont les chevaux furent atteints et qui devinrent ' des fantassins. Ceux d'entre eux qui étaient restés en vie sur le terrain dégainèrent leurs épées, se postèrent pour guetter tous les passants et les frapper.
Djam'a le Noumairite (qu'Allah l'ait en pitié !) passa devant l'un de ces Francs. Celui-ci marcha vers lui et le frappa à la tête. Djam'a avait sur la tête un haut bonnet que le coup déchira, lui fendant le front, d'où le sang découla jusqu'à s'épuiser. Son front resta ouvert comme la bouche d'un poisson. Je le rencontrai, tandis que nous étions ainsi entourés de Francs, et je lui dis : « O père de Mahmoud, pourquoi ne pas bander ta blessure ? » — Il répondit : « Ce n'est pas actuellement le temps des bandages et des compressions sur les blessures. » Or Djam'a, de tout temps, avait sur le visage un teint brûlé, noir, et il avait les yeux chassieux, avec des veines visibles. Après que cette blessure l'eut atteint et que son sang en eut coulé avec abondance, le mal dont il se plaignait aux yeux cessa, sans qu'il y éprouvât désormais ni chassie ni douleur. Parfois la santé des corps est le résultat des maladies.
Quant aux Francs, ils se réunirent après que nous eûmes tué d'entre eux ceux que nous tuâmes et se postèrent en face de nous. Je vis alors venir à moi mon cousin Dhakhîrat ad-Daula Abou 'l-Kanâ Khitâm (qu'Allah l'ait en pitié !). Il me dit : « O mon cousin, tu as avec toi deux montures tenues en laisse, tandis que je suis sur ce cheval efflanqué. »—Je dis à l'écuyer : « Fais avancer pour lui le cheval rouge. » Ce que fit l'écuyer. Au moment même où Khitâm fut en équilibre sur sa sellé, il fit une charge à lui seul contre les Francs. Ceux-ci l'attirèrent au point qu'il se jeta au milieu d'eux, reçut' un coup de lance et fut désarçonné. Le cheval fut aussi atteint. Les Francs retournèrent leurs lances pour renverser Khitâm ; mais il portait une cotte de mailles-résistante sur laquelle les lances n'avaient pas prise. Nous criâmes à l'envi : « Au secours de votre compagnon, de votre compagnon ! » Nous nous élançâmes-contre eux, nous les mîmes en fuite et nous le dégageâmes, alors qu'il était sain et sauf. Quant au cheval, il mourut le jour même. Gloire à Celui qui préserve, au Tout Puissant !
Cette bataille eut lieu pour le bonheur de Djam'a et pour la guérison de ses yeux. Gloire à celui qui dit : [84]« Il se peut que vous abhorriez une chose, tandis qu'elle est parfaite pour vous. »
Il m'arriva une aventure analogue. J'étais en Mésopotamie (Al-Djazîra), dans l'armée de l'atabek.[85] Un de mes amis m'appela dans sa maison. J'y vins, accompagné d'un écuyer nommé Gounaim, qui était devenu hydropique, son cou s'étant aminci et son corps s'étant enflé. Il s'était expatrié avec moi et-je lui en tenais compte. Mon serviteur conduisit sa mule dans l'étable de mon ami, en se joignant aux écuyers des autres personnes présentes -Nous avions parmi nous un jeune Turc qui s'était enivré et qui avait été vaincu par l'ivresse. Il sortit vers l'étable, tira son couteau et s'élança contre les écuyers qui s'enfuirent et partirent. Quant à Gounaim, vu sa faiblesse et sa maladie, il avait étendu la selle sous sa tête et dormait. Il ne se leva qu'après la sortie de tous ceux qui étaient dans l'étable. Cet ivrogne le frappa de son couteau au-dessous du nombril et fit dans son corps une fente large de quatre pouces. Il tomba sur le sol à la place même. Celui qui nous avait invités (c'était le seigneur de la forteresse de Bâsahrâ) le fit transporter dans ma demeure, où l'on porta également l'auteur de la blessure, atteint de son côté à l'épaule. Je rendis la liberté à mon serviteur. Le chirurgien alla vers lui. Il se remit, se reprit à marcher et à se mouvoir ; seulement sa blessure n'était pas cicatrisée et, pendant deux mois, il ne cessait pas d'en sortir comme des croûtes et de l'eau jaunâtre. Puis la blessure se ferma, le corps s'amincit, il revint à la santé et ce fut cette blessure qui causa sa guérison.
J'ai vu un jour le fauconnier arrêté devant mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) pour lui dire : « O mon maître, ce faucon a perdu ses plumes, et il va mourir ; l'un de ses yeux est déjà perdu. » Mon père avait chassé avec ce faucon à l'époque où c'était un faucon fringant, et maintenant il était perdu. Nous partîmes pour la chasse. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait avec lui plusieurs faucons. Il lança celui-là sur un francolin. Le faucon bondissait dans les touffes de jusquiame, où rappelait le francolin, parmi des amas de broussailles.[86] Le faucon y pénétra avec lui, ayant sur l'œil comme un gros point. Une épine des broussailles le piqua sur cette tache qu'elle perça. Le fauconnier emporta le faucon dont l'œil désarticulé, sécrétait des humeurs, et dit : « O mon maître, l'œil du faucon est perdu. » Il ajouta : « Le faucon est perdu tout entier. » Le lendemain, le fauconnier ouvrit l'œil de l'animal. Or, il était guéri. Ce faucon demeura sain et sauf chez nous et y mua à deux reprises. Il fut parmi les plus agiles des faucons.
Son souvenir m'a été rappelé par ce qui advint à Djam'a et à Gounaim, bien que ce ne soit pas ici l'endroit de mentionner les faucons.
J'ai vu également un hydropique, auquel on pratiqua une saignée et qui mourut, tandis que Gounaim, qui eut le ventre fendu par cet ivrogne, fut sauvé et guéri. Gloire au Tout Puissant !
L'armée d'Antioche fit une incursion contre nous.[87] Nos compagnons s'étaient rencontrés avec leurs avant-gardes et étaient allés en avant vers eux, tandis que, posté sur leur route, j'attendais leur arrivée jusqu'à moi. Peut-être me fourniraient-ils une occasion de les atteindre. Je voyais nos compagnons en déroute passer devant moi. Entre ceux qui passèrent ainsi, je reconnus Mahmoud, fils de Djam'a, et je lui dis : « Halte-là, ô Mahmoud ! » Il s'arrêta un instant, puis poussa son cheval et me quitta. Les éclaireurs de la cavalerie franque me rejoignirent. Je fus porté vers eux, tandis que je brandissais en arrière ma lance dans leur direction, en les observant et en les regardant. Aucun de leurs cavaliers ne se pressait de m'atteindre pour me donner un coup de lance. Devant moi étaient quelques-uns de nos compagnons. Nous étions entourés de jardins clos par des murs hauts d'une taille d'homme. Je fis faire volte-face à ma monture qu'un de nos compagnons tenait par la poitrine, je retournai sur la gauche la tête de ma jument et je l'éperonnai. La muraille était devenue proche. Je la saisis et elle se trouva placée entre moi et les Francs rangés en lignes. Un d'entre eux se hâta de me rattraper. Il portait une tunique en soie verte et jaune, sous laquelle je croyais deviner une cotte de mailles. Je le laissai passer devant moi, j'éperonnai ma jument et, dans le voisinage du mur, je lui donnai un coup de lance. Il se renversa au point que sa tête rejoignit son étrier ; son bouclier et sa lance lui tombèrent des mains, ainsi que son casque de sa tête. Puis il se releva de nouveau sur sa selle. Il avait une cotte de mailles sous le manteau et mon coup ne l'avait pas blessé. Ses compagnons le rejoignirent, revinrent en arrière pour ramasser le bouclier, la lance et le casque. Lorsque le combat fut terminé et que les Francs se furent éloignés, Djam'a (qu'Allah l'ait en pitié !) vint à moi pour s'excuser au nom de son fils Mahmoud. « Ce chien, dit-il, s'est enfui de toi. » — « Qu'importe ? » répondis-je. — Il reprit : « Mon fils s'enfuit de toi, et cela serait sans importance !» — Je dis : « Par ta vie, ô père de Mahmoud, toi aussi tu t'enfuiras de moi. » — Il répliqua : « O émir, par Allah, certes la mort me serait plus légère que la fuite en t'abandonnant. »
Peu de jours après, les cavaliers de Hama firent une incursion contre nous. Ils nous prirent un troupeau de bœufs et les enfermèrent dans une île au-dessous du Moulin Al-Djalâlî. Les archers montèrent au-dessus du Moulin pour protéger le troupeau de bœufs. Je les rejoignis, moi, Djam'a et Schoudjâ' ad-Daula Mâdî, un esclave né dans notre maison, un brave. Je leur dis à tous deux : « Nous traverserons sur l'autre rive et nous enlèverons les animaux. » Ce plan fut exécuté. Quant à Mârlî, sa jument fut atteinte par une flèche en bois qui la tua. A grand-peine, je le ramenai vers ses compagnons. Pour ma part, ma jument reçut une flèche en bois à la nuque, où elle fit une trouée d'un empan environ, sans que, par Allah, ma monture frappât du pied, ni qu'elle s'agitât, ni qu'elle parût sentir la blessure. Enfin Djam'a revint terrifié sur sa jument. A notre retour, je lui dis : « O père de Mahmoud, ne t'avais-je pas dit que tu t'enfuirais de moi, toi qui blâmais ton fils Mahmoud ? — Il répondit : « Je n'ai eu peur que pour ma jument ; car elle m'est chère. » Et il s'excusa.
Ce même jour, nous nous étions rencontrés avec les cavaliers de Hama. C'étaient leurs avant-gardes qui avaient poussé vers l'île les troupeaux de bœufs. Il y eut un combat entre nous et eux. Parmi les combattants étaient les cavaliers principaux de l'armée de Hama, Sourhanak, Gazi At-Toullî, Mahmoud ibn Baldâdjî, Hadr At-Toût et le généralissime Khotlokh. Les troupes de Hama étaient plus nombreuses que les nôtres. Cependant notre attaque les mit en déroute. Je me dirigeai vers un de leurs cavaliers, pour lui donner un coup de lance. Or, c'était Hadr At-Toût, qui me dit : « A tes ordres, ô Ousâma. » Je me détournai de lui vers un autre, que je frappai. Ma lance lui tomba sous l'aisselle et elle ne se serait pas enfoncée, s'il l'avait laissée aller. Mais il serra son avant-bras sur l'aisselle pour saisir la lance, tandis que sa jument passait rapidement devant moi. La lance traversa la selle jusqu'au cou de la monture qui s'accroupit, puis se releva sur le bord du torrent qui descend vers Al-Djalâlî. Le cavalier frappa sa jument, la poussa devant lui et mit pied à terre. Je louai Allah (gloire à lui !) de ce que ce coup de lance ne lui avait causé aucun dommage, car mon adversaire était Gazi At-Toullî, et (qu'Allah l'ait en pitié !) il était un héros.
Un certain jour, l'armée d'Antioche s'établit contre nous dans les campements qu'elle occupait toutes les fois qu'elle nous attaquait. Nous leur faisions face sur nos chevaux. Le fleuve[88] nous séparait. Aucun de nos ennemis ne prit l'offensive contre nous. Ils avaient dressé leurs tentes et s'y étaient établis. Nous retournâmes en arrière pour regagner nos demeures. Nous les voyions de la citadelle. Tout à coup, il sortit de nos troupes environ vingt cavaliers vers Bandai-Kanîn, village voisin de Schaïzar, pour faire paître leurs chevaux, sans se munir de leurs lances. Deux cavaliers Francs se détachèrent, allèrent auprès de ces hommes qui faisaient paître leurs chevaux, rencontrèrent sur la route un particulier qui poussait devant lui une vache, s'emparèrent de lui et de sa vache. Nous les observions de la forteresse. Nos hommes remontèrent, à cheval et se tinrent "en arrêt, n'ayant pas emporté leurs lances. Mon oncle paternel[89] dit : « Ils sont à vingt, sans pouvoir délivrer un prisonnier gardé par deux cavaliers. Si Djam'a était présent, vous verriez ce qu'il ferait. » A peine avait-il ainsi parlé que Djam'a s'armait pour s'élancer au galop contre eux. Mon oncle paternel s'écria : « Voyez maintenant ce qu'il va faire. » Lorsque Djam'a arriva au galop à proximité des deux cavaliers, il détourna la tête de son cheval et le fit avancer à une certaine' distance derrière eux. Mon oncle paternel, installé sur un balcon de sa-résidence dans la forteresse, le vit alors s'arrêter loin des deux cavaliers Francs, quitta le balcon et rentra furieux en disant : « C'est une trahison. » Or Djam'a s'était arrêté par crainte d'un creux visible devant les deux cavaliers. Peut-être recelait-il une embuscade. Lorsque Djam'a, parvenu à ce creux, constata qu'il ne renfermait personne, il s'élança sur les deux cavaliers, délivra l'homme et la vache et repoussa ses deux adversaires jusqu'à leurs campements, sous les yeux de Boémond[90] (Ibn Maïmoun), seigneur d'Antioche. Lorsque les deux cavaliers Francs furent rentrés, Boémond leur fit prendre leurs boucliers qu'il livra en pâture aux bêtes, fit renverser leurs tentes, les expulsa et dit : « Un seul cavalier d'entre les musulmans repousse deux cavaliers d'entre les Francs ! Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des femmes. » Quant à Djam'a, mon oncle paternel le réprimanda et s'irrita contre lui, parce qu'il s'était arrêté loin d'eux tout d'abord, lorsqu'il les avait poursuivis. Djam'a répondit : « O mon maître, j'ai craint que dans le creux de la Colline des Karmates, il n'y eût une embuscade qui m'assaillirait. Lorsque j'eus exploré ce creux et que j'eus vu qu'il ne renfermait personne, j'ai délivré le prisonnier et sa vache et je les ai fait avancer jusqu'à ce qu'ils eussent rejoint notre armée. » Mais mon oncle n'accueillit pas son excuse et lui témoigna du mécontentement.
[11] Dans ce texte, l’orthographe a parfois été modifiée en supprimant certains accents ; mais la seule modification importante est celle qui a consisté à transformer Maûsil en Mossoul, plus moderne.
Il existe à ce jour un livre en français de cette Autobiographie présentant une version partielle; il est intitulé Ousâma, un prince syrien face aux croisés, trad. d’André Miquel, éd. Texto, 2007.
[12] Le khalife 'Abbaside Ar-Rachid succéda à son père Al-Moustarschid Billah le 7 septembre 1135 et fut déposé le 8 août 1136.
[13] En septembre 1135.
[14] « Le roi des Roum » dit le texte. C'était Jean Comnène.
[15] Entre le 19 septembre 1137 et le 7 septembre 1138. Le siège de Schaïzar par les Grecs dura du 29 avril au 21 ou au 22 mai 1138.
[16] L'émir chambellan de Zengui, Salah ad-Din Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî.
[17] Je ne suis sûr, ni du texte, ni du sens.
[18] Mot à mot : « ton visage sera blanc auprès de ton maître. »
[19] Texte et traduction me laissent des doutes.
[20] Ousâma veut parler de son fils préféré, l'émir 'Adoud ad-Daula Abou 'l-Fawâris Mourhaf.
[21] Traduction hypothétique, le texte étant très endommagé.
[22] L'atabek Zengui.
[23] Schihâb ad-Din Mahmoud, fils de Tadj al-Mouloûk Boûrî, fils de Togtakin.
[24] Depuis la fin de 532 jusqu'à la fin de 538 de l'hégire (août 1138 à juin 1144 de notre ère). Cela fait en tout cas moins de huit années.
[25] Mou'in ad-Din Anar, le vrai maître de Damas sous ce prince et sous ses trois successeurs.
[26] Ousâma emploie indifféremment les noms de Misr et de Al-Kâhira « Le Caire ». Nous nous sommes chaque fois conformé rigoureusement au texte.
[27] Le 30 novembre 1144.
[28] Le khalife Fatimide régnant, qui mourut le 10 octobre 1149.
[29] A moins qu'il ne faille lire comme je le propose dans la note 1 du texte et traduire « me manda ».
[30] Al-Afdal, fils de Badr Al-Djamâli « l'émir des armées », fut assassiné en décembre 1121 par ordre du khalife Al-Amir bi-Akham Allah, après avoir dirigé comme vizir les affaires d'Egypte pendant vingt-huit années consécutives, sous trois khalifes.
[31] Le 26 de ramadan 544, c'est-à-dire le 27 janvier 1150.
[32] C'est-à-dire du vizir Al-Malik Al-’Adil Ibn As-Sallâr.
[33] Littéralement : « contrefaisait les tauki'. »
[34] Il s'agit du grand Nour ad-Dîn, fils de Zengui.
[35] Ce fut à la fin de 1149 ou au plus tard en 1150 que Baudouin III, roi de Jérusalem, entreprit la restauration de Gaza, qui était en ruines, pour en confier la garde aux Templiers.
[36] Depuis le 1er février 1150.
[37] En arabe 'îd al-adhâ. Cette fête tombe le 10 du douzième mois, du dzoûlhidjdja. Ces Arabes erraient donc dans le pays depuis soixante-dix jours environ, lorsque Ousâma les rencontra le 11 avril 1150.
[38] Les quatrième et cinquième prières de la journée musulmane.
[39] Lecture et traduction douteuses.
[40] Le vizir Ibn As-Sallâr.
[41] Asad ad-Din Shirkouh, fils de Shâdî, était le frère de Nadjm ad-Dîn Ayyoub, père de Saladin.
[42] Le 3 avril 1153.
[43] Surnom de 'Abbâs.
[44] Dans la soirée du 15 avril 1154.
[45] Littéralement « au cavalier des musulmans »
[46] Le 26 avril 1154.
[47] 30 mai 1154.
[48] Peut-être : « 'Anbar » ; de même à la page suivante.
[49] Du 29 mai au 4 juin 1154.
[50] Le 7 juin 1154.
[51] Le 19 juin 1154.
[52] Al-’Adil est ici le vizir ibn As-Sallâr.
[53] Le 14 juin 1139.
[54] Manuscrit et texte imprimé portent l'atabek Amin ad-Daula Togtakîn.
[55] Mou'in ad-Din Anar, premier ministre à Damas.
[56] L'atabek Zengui.
[57] En septembre 1139.
[58] Le 30 novembre 1144.
[59] Du 12 au 13 avril 1148.
[60] A partir du 19 juin 1154.
[61] Talâ'i' Ibn Rouzzik.
[62] Le roi de Jérusalem, le « roi des Francs », était alors Baudouin III.
[63] Vers 1123.
[64] Le texte porte Nadjm ad-Din Ibn Ilgazi.
[65] 14 août 1119. Confusion avec la seconde bataille de Danith qui eut lieu à cette date, tandis que Roger avait été vaincu et tué à Al-Balât dès le 28 juin.
[66] Cf. Coran, III, 25.
[67] Probablement Baudouin II, vers 1122.
[68] De l'Oronte.
[69] Mou'in ad-Din Anar.
[70] L'atabek Zengui, en 1137.
[71] Samsam ad-Din Khirkhân, prince d'Emesse, et Schihâb ad-Din Mahmoud, prince de Hama.
[72] En 1124.
[73] Le sultan Seldjoukide Malik-Schah mourut en 1092.
[74] 'Izz ad-Din Abou 'l-'Asâkir Soultân, émir de Schaïzar.
[75] En arabe : As-Sardânî, c'est-à-dire Guillaume Jourdain, comte de Cerdagne, neveu de Raimond de Saint-Gilles. Événements de 1108.
[76] Vers le sud-est.
[77] Je traduis ainsi, bien que le texte semble porter : et mes deux oncles
[78] Le 30 mai 1137.
[79] 25 juillet 1104.
[80] Probablement au printemps de 1122.
[81] Le manuscrit porte : « la tête de Djam'a ».
[82] L'émir 'Izz ad-Din Abou 'l-'Asâkir Soultân.
[83] Vers 1124.
[84] Coran, II, 213.
[85] L'atabek Zengui.
[86] Traduction par à-peu-près et par conjecture.
[87] Vers 1127.
[88] L'Oronte.
[89] 'Izz ad-Din Abou ‘l-'Asàkir Soultân.
[90] Boémond Ier, ou peut-être Boémond II.