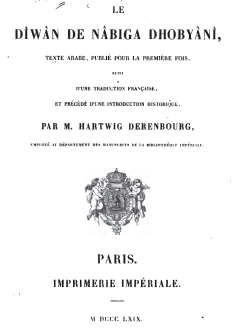
NABIGA DHOBYÂNÎ
DÎWÂN
Traduction française : M. HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
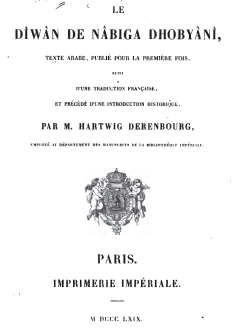
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LE
DÎWÂN DE NÂBIGA DHOBYÂNÎ,
TEXTE ARABE, PUBLIÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS.
SUIVI
D'UNE TRADUCTION FRANÇAISE,
ET PRÉCÉDÉ D'UNE INTRODUCTION HISTORIQUE,
PAR M. HARTWIG DERENBOURG,
EMPLOYÉ AU DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS
DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE.

PARIS.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
M CCC.
LXIX.
Nâbiga Dhobyânî, ou selon d'autres Nâbiga Dhibyânî, vécut successivement à Hîra et à Gassân, louant les rois, se vantant même de ne jamais faire l'honneur de ses panégyriques qu'aux princes. Ces petits Etats, soumis à la domination de la Perse et de Byzance, n'en étaient pas moins indépendants. Un tribut annuel et surtout l'incorporation de soldats arabes dans les légions étrangères pour la défense du territoire, telles étaient les plus lourdes charges que les suzerains faisaient peser sur leurs vassaux. La nature même du pays, les accidents du sol, les rochers, les montagnes et les cavernes, sans compter les torrents et les cours d'eau, formaient pour la liberté de ces populations comme un rempart, dont la victoire même n'avait pas raison. On bâtissait, on chantait, on guerroyait-, les constructeurs étaient à l'œuvre pour élever les célèbres « châteaux » de Hîra et de Gassân; les poètes étaient sûrs de recevoir de tout temps un accueil empressé; on se disputait leurs hommages, on les comblait de présents, et, s'ils étaient en faveur, leurs vers étaient sans cesse répétés par déjeunes et belles esclaves, dont on avait orné la mémoire en leur faisant retenir les morceaux les plus appréciés. Enfin les hommes d'armes entretenaient l'ardeur guerrière, créant des alliances entre les tribus, plus souvent encore cherchant à les exciter les unes contre les autres, se mettant quelquefois au service des princes pour les combattre dans d'autres occurrences.
La vie agitée de Nâbiga Dhobyânî se passa dans un tel milieu, on ne peut plus favorable d'ailleurs à l'inspiration du poète. Il ne but pas toujours « une coupe à laquelle le musc s'attache », et il dut payer bien cher sa gloire. Sans doute il serait téméraire d'attacher une valeur historique à toutes les anecdotes qui nous ont été conservées sur lui et ses contemporains. Le. siècle qui précède l'avènement de l’islâm, et dont Nâbiga est une des dernières figures et aussi une des plus caractérisées, ne s'est pas encore entièrement dépouillé de la couche légendaire qui couvre les origines du peuple arabe. Les sources sont déjà nombreuses et abondantes; mais elles ne sont pas toutes également pures, et on ne peut y puiser qu'avec circonspection. Ces récits, ces dialogues, ces aventures, n'ont pas une plus grande valeur que les divers chapitres d'un roman historique. Le fond est vrai, les détails sont œuvre d'imagination. Quant à la chronologie, il faut renoncer à fixer aucune date précise : l'ordre dans lequel tous ces princes se sont succédé sur le trône n'est pas encore aujourd'hui établi avec certitude, et la durée de leurs règnes est rapportée différemment par les annalistes les plus célèbres. L'accord n'est complet que lorsque deux auteurs se sont copiés, ou en ont copié tous deux un troisième, selon un procédé très légitime aux yeux des Arabes.
Le diwân même de Nâbiga n'a pas échappé tout à fait à cette immixtion d'éléments étrangers; heureusement ils sont assez rares et assez disséminés pour qu'on puisse n'en tenir aucun compte dans une biographie du poète. Mais une telle esquisse n’aurait que les contours si on se refusait absolument à utiliser les couleurs qu'y a répandues avec prodigalité la fantaisie orientale. Sans chair et sans vie, elle présenterait une image peu fidèle de cette nature sensible et nerveuse que le moindre choc mettait en mouvement et qui n'était jamais plus riche et plus expansive que lorsqu'elle cédait à une impression de crainte et de terreur. Il vaut mieux laisser son animation au tableau que nous ont transmis les chroniqueurs arabes; peut-être quelques traits sont-ils flattés; peut-être y a-t-il par-ci par-là des inexactitudes et des erreurs de pinceau; mais l'ensemble est ressemblant, et il doit être facile de reconnaître l'homme à la vue du portrait.
Nâbiga Dhobyânî (ou Dhibyânî) est le nom sous lequel on connaît le poète Ziyâd ben Mou'âwiya (selon d'autres Ziyâd ben 'Amr ben Mou'âwiya), ben Djâbir ben Dibâb ben Djâbir ben Yarboû’ ben Gucith ben Mourra ben ‘Auf ben Sa'd ben Dhobyân (ou Dhibyân) ben Baguîd ben Reith ben Gatafân ben Sa'd ben Keis ben Modar. Nous savons aussi le nom de la mère du poète. Elle se nommait 'Atika bint Oneis Achdja'i. Il portait comme titre honorifique le prénom de Abou Omâma ou encore de Abou 'Akrab. Ce dernier nom doit être pris à la lettre; car il avait une fille nommée 'Akrab, qui fut emmenée en captivité par Nomân ben Wâïl ben Djoulâh, mais immédiatement relâchée dès qu'elle eut dit : « Je suis la fille de Nâbiga. » Il se pourrait qu'Omâma fût également le nom d'une de ses filles. Il y a pour ce prénom la variante d'Asma'î, qui propose de lire Abou Thomâma.
Le surnom de Nâbiga a été l'objet de trois interprétations. D'après les uns, le poète fut ainsi nommé pour avoir employé le verbe nabaga dans ce vers :
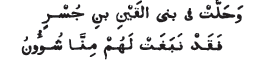
« Et elle est restée chez les Bènou Kein ben Djousr, et nos embarras sont devenus clairs pour eux. »
Mais ce vers, qui ne se trouve pas dans le dîwân, a comme la marque de son origine, il n'a été forgé et n'est jamais cité que pour donner l'étymologie du mot Nâbiga.
Une autre tradition refuse à Nâbiga un talent précoce. Il était, dit-on, un homme mûr quand il se lança dans la poésie, et il ne débuta que fort tard. Il était déjà un des chefs de sa tribu[1] quand il se décida à u laisser jaillir ses vers ». Asma'î rapporte même qu'un jour Nâbiga rendit une visite avec un de ses oncles. Celui-ci, qui n'était pas rassuré le moins du monde pour son neveu, tremblait qu'il ne fût embarrassé et qu'il ne restât sans répondre aux politesses qu'on ne manquerait pas de lui faire. L'hôte, pour délier la langue de son interlocuteur, lui tendit une coupe pleine, l'invita à la vider, et lui dit malicieusement :
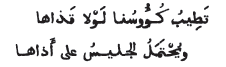
« Nos coupes seraient suaves, s'il n'y tombait pas un fétu, et l'on peut admettre un convive, malgré le mal qu'elles font. »
Nâbiga, prisa l'improviste, répliqua sur le même ton :
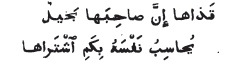
« Le fétu qui y tombe! Le propriétaire de ces coupes est un avare qui compte avec lui-même pour savoir combien il les a payées. »
Ce serait le premier vers que Nâbiga aurait prononcé.
Enfin le surnom de Nâbiga est appliqué à tout poète qui a inauguré la carrière dans sa famille, et qui n'a pas eu, comme Zoheir, un père poêle, une mère poète, un frère poète, etc. C'est pour ainsi dire la « source jaillissante », sans qu'on sache par quels canaux souterrains ses eaux ont été amenées, par quels chemins inconnus elles ont passe pour arriver à l'endroit où nous les voyons sortir de terre. Si, à l'origine, on désigne comme nâbiga celui qui n'a pas recueilli la poésie comme un héritage, mais qui a cédé à la force impérieuse d'une vocation réelle, plus tard on appela ainsi tous les poètes distingués de l'antiquité, et on trouve une énumération de nawâbiy comprenant Imrou'ou'lkeis ben Hodjr, Nâbiga Ziyâd ben 'Amr, Zoheir et A’châ.
Nâbiga faisait aussi partie des poètes qu'on appelle des « étalons ». Si 'Alkama ben Abda est spécialement connu sous le nom de 'Alkama 'Ifahl, un grand nombre d'autres poètes n'en sont pas moins compris dans cette catégorie. Le sens de ce titre n'est pas exactement rendu par un « héros, qui s'est distingué soit comme guerrier, soit comme poète. » Les plus beaux vers ne pouvaient mériter à leur auteur cette distinction qu'autant qu'ils contenaient une sentence générale. Nâbiga ne fut, dit-on, appelé ainsi qu'après avoir dit : « On m'a rapporté qu'Abou Kâboûs me poursuit de ses menaces ; quelle sécurité reste-t-il quand le lion rugit? » Si jamais poète a mérité d'être mis au nombre des fouhoûl, c'est Nâbiga, car on trouve dans son diwân un très grand nombre d'apophtegmes, et son esprit observateur et réfléchi le portait à généraliser les leçons qu'il avait reçues des événements.
Les premières années de la vie de Nâbiga durent se passer dans le calme et dans l'obscurité. Plus tard, au moment où la faveur des princes et l'admiration de tous ceux qu'il avait charmés eurent fait de lui le familier et le commensal des rois, on lui rappelait son humble naissance, on lui jetait à la face, comme un reproche, l'absence d'aïeux illustres; et Yazid ben Sinân répudiait sa fille après l'avoir épousée, sous prétexte que Nâbiga était un homme de 'Odhra ben Sa'd. Yazid n'avait pas touché juste; il reprochait à Nâbiga une parenté que celui-ci ne se connaissait pas. Mais le poète, dans sa fierté, ne donne pas un démenti à son adversaire. « J'ai revendiqué, dit-il, l'origine que tu me reprochais, tandis que toi, Yazid, tu as dû abandonner ta race méprisable. »
La plus ancienne poésie qui nous ait été conservée de Nâbiga paraît appartenir à l'époque même de ses débuts. C'est le chant du Dhobyânite, qui ne connaît encore que sa belle et qui invoque le témoignage de sa tribu, non pas encore pour se justifier auprès du prince, mais pour faire excuser par sa maîtresse un départ précipité. Il nous raconte « ses courses insensées à travers la vaste plaine sur une chamelle folle. » Il complète alors les parts de ceux qui jouent au meisir, et il raille le barbon obligé de renoncer à cet exercice divertissant. Ce n'est point encore le courtisan ni le favori qui parlent; mais toute cette « orientale » témoigne d'une ardeur juvénile, d'une inspiration primesautière et désintéressée, qui ne devaient pas résister entièrement à l'amitié et à la générosité des rois. Il ne risquera plus de « faire tomber son coussin et sa selle » que lorsque, craignant la colère de Nomân, il s'enfuira de Hîra à Gassân.
Cependant jamais, pendant sa longue carrière, il ne cessa de considérer l'intérêt de sa tribu comme une affaire personnelle, dont il devait chercher, trouver et hâter la solution ; il regarda toujours une participation directe et constante aux luttes des Bènou Dhobyân comme un devoir impérieux. Les Bènou Dhobyân étaient établis dans un canton nommé Charibba, non loin de la Mecque, au milieu des autres Bènou Gatafân. Ces populations n'ont pas d'histoire jusqu'au moment où, vers le milieu du vie siècle, nous les trouvons soumises à un roi, Zoheir ben Djadhîma, celui que Nâbiga se plaindra plus tard de voir marcher parmi ses ennemis à la tète d'une armée « qui a l'éclat et la couleur du granit. » Les luttes mêmes qui agitaient alors la partie septentrionale de la péninsule ne troublaient pas encore le repos et la tranquillité de ces contrées. Il n'en était pas de même pour les Bènou Asad : placés plus au nord-ouest sur les confins du Nadjd et du Hedjaz, craignant que leur territoire ne devînt tôt ou tard l'enjeu des combats que se livraient les souverains de Gassân et de Hîra, ils ne pouvaient rester aussi indifférents à ce qui se passait autour d'eux; ils avaient pris bravement parti pour Hîra et lui fournissaient régulièrement des troupes auxiliaires. Ils étaient ainsi assurés de ne pas être surpris par une invasion venant du nord, tandis que leur alliance constante avec les Bènou Dhobyân garantissait leur sécurité au midi.
Après la bataille de Halîma gagnée par Hârith ben Abî Chamir Cassani sur le roi de Hîra, Moundhir III, un grand nombre de Bènou Asad furent faits prisonniers.[2] Nâbiga vint trouver le roi, et lui demanda leur mise en liberté. Un autre poète, 'Alkama ben 'Abda, réclama la même faveur pour ses compatriotes, les Bènou Tamîm « Tu t'es montré, dit-il, indulgent pour toutes les tribus, aussi ai-je poussé en avant ma chamelle vers Hârith le généreux. » Voulant plus tard louer les épées de Gassân, Nâbiga rappellera comme un heureux souvenir qu'elles sont un héritage de la journée de Halîma. » Pourtant ses sympathies attiraient le poète à la cour de Hîra. Moundhir III l'avait comblé de ses bienfaits et de ses libéralités.[3] A sa mort, vers 562, il salua de ses vœux l'avènement de son fils aîné 'Amr, fils de Hind. « Quelle sagesse éclatante, quelle perfection on l'annonce chez Ibn Hindi. Puisse mon corps, depuis la partie que portent mes sandales jusqu'à la boucle la plus élevée de mes cheveux, servir de rançon au prince! » Comme on voit, le poète ne marchande pas son dévouement. Il ajoute, en rattachant l'éloge du prince au passé de la dynastie : « Avant lui, son père et le père de son père avaient bâti la gloire de leur vie en tirant au cordeau l'édifice. Toi, tu as rétabli la tranquillité en Irak, et dans les châteaux on avait garni de défenseurs les fossés et les fortifications. » 'Amr, fils de Hind, qui inspirait au poète une telle confiance, vécut et mourut sur le champ de bataille. Il ne semble pas avoir apprécié ni récompensé le dévouement de Nâbiga; car ni les biographies ni les vers qui nous restent ne font en aucun autre endroit mention de ce prince.
Nâbiga ne pouvait pas d'ailleurs s'abandonner à la douce oisiveté des cours, pendant que le Nadjd tout entier était en ébullition. La paix dont jouissaient les Bènou Gatafân venait d'être troublée par un pari engagé à l'occasion de deux chevaux, Dahis et Cobra. Il n'en fallut pas plus pour amener une guerre civile entre deux tribus sœurs, 'Abs et Dhobyân. Cette lutte, dont l'origine futile semblait présager l'apaisement prochain, dura néanmoins quarante années, et se compliqua de tous les éléments qu'elle trouva sur son passage. Chaque camp devint comme un centre autour duquel se groupaient toutes les inimitiés et toutes les hostilités. Nâbiga vit avec douleur s'allumer une guerre entre ceux qu'il avait confondus jusque-là dans une égale amitié. « Va, dit-il, fais savoir aux Bènou Dhobyân que je ne les confondrai plus avec les Bènou 'Abs. » Le nom du roi Zoheir, que le poète voit encore à la tête de ses ennemis, montre qu'il assistait aux commencements de cette longue guerre.
Les frères d'armes de Nâbiga, les Bènou Dhobyân, se coalisèrent avec les Bènou Asad et les Bènou Tamîm contre les Bènou 'Abs unis aux Bènou Amir. Au milieu de ces rencontres nombreuses et incessantes, le principal souci de Nâbiga fut le maintien des alliances contractées et le désir ardent de sauver l'indépendance du territoire occupé par sa tribu. Les Bènou Asad avaient d'ailleurs depuis longtemps fait leurs preuves d'indépendance, lorsque « de blanches épées avaient achevé » un despote qui les opprimait, Hodjr, le père du poète Imrou'ou'lkeis. Les forces dont disposaient de part et d'autre les combattants ressortent clairement des vers suivants de Nâbiga : « Puissent les Bènou Dhobyân trouver avantage dans la situation de leur pays isolé de tout parent et de tout allié; car ils ont pour eux les Bènou Asad, toujours prêts à les défendre avec deux mille braves couverts de leurs armes et de leurs cuirasses. » Puis, s'adressant à un de ses adversaires, Zour'a ben 'Amr, il lui dit : « Laisse à distance de toi de tels hommes, qui sont sans reproche et qui ont repoussé la tribu de 'Abs dans le pays de Ka'âki, malgré les efforts des Bènou 'Amir qui ont levé la main pour lutter. » Ailleurs Nâbiga, écrivant une satire contre ce même Zour'a, qui « avait envoyé à son adresse d'étranges poésies, » énumère complaisamment les nombreuses branches des Bènou Asad qui apporteront l'appui de leur concours aux guerriers de sa tribu.
Le serment d'alliance ne fut pas rompu, malgré les suggestions perfides des Bènou 'Amir, qui avaient dit aux Bènou Dhobyân : « Rompez avec les Bènou Asad. » Nâbiga répond avec indignation : « Malheur à l'ignorance, l'ennemie des peuples! » Puis il ajoute dans son amour de la conciliation : « Faites plutôt la paix avec nous tous, si vous y êtes disposés, mais ne nous parlez pas ainsi, ô Bènou 'Amir! » La prédilection de Nâbiga pour les Bènou Asad est telle que, fort de leur alliance, il ne veut pas au jour du combat d'autre « cotte de mailles. »
A côté de ces luttes intestines, la guerre entre la Perse et l'empire byzantin se poursuivait au nord de l'Arabie. Moundhir IV, roi de Hîra, cherchait à venger sur Hârith elasgar la mort de son père, qui avait expiré si malheureusement sur le champ de bataille de Halîma. L'armée de Hîra comptait dans ses rangs un détachement des Bènou Fazâra, une tribu Dhobyânite. Déjà, un an auparavant, Hisn ben Hodheifa, un Fazârite, n'avait pas craint de faire une invasion à Gassân. Dans son ardeur guerrière, ce jeune homme bouillant avait entraîné les Bènou Asad à partager les chances de son aventure et à braver Gassân, en s'écriant : « Qu'on n'aille pas s'approcher de nos frontières. » Il exposa ses alliés à de « redoutables averses, » pendant qu'il invitait les Bènou Fazâra à chercher un refuge sur les montagnes. Le roi Ghassanide, Hârith elasgar, furieux de voir son repos sans cesse troublé par des incursions sur son territoire et par l'appui prêté ouvertement à ses ennemis, réunit des forces considérables pour la journée de 'Ein Obâg. Il remporta une victoire éclatante; et cette fois encore, ce fut aux prières de Nâbiga que les captifs durent leur délivrance. Le poète fut même obligé de plaider la cause de Hisn auprès de Nomân, fils de Hârith elasgar, sans l'aveu duquel son père ne voulait sans doute pas relâcher un aussi dangereux prisonnier. Nâbiga entra chez lui. Nomân lui dit : « Hisn est coupable à notre égard et à l'égard du roi. » — « On t'a fait un faux rapport, » reprit Nâbiga, et il chercha à justifier son client, dont il obtint la grâce. La faveur du roi retint pendant quelque temps le poète à Gassân, où Hârith lui prodigua les honneurs et le combla de bienfaits a qui ne pincent pas avec des queues de scorpions. »
Vers 583, après la mort de Moundhir IV, qui mourut sous les coups de l'ennemi victorieux, le trône de Hîra fut occupé par Nomân ben Moundhir Abou Kâboûs. Plusieurs de ses prédécesseurs avaient attiré à leur cour les poètes, en se faisant non pas seulement leurs protecteurs, mais aussi leurs émules. Nomân ben Moundhir suivit l'exemple de ses devanciers, et les châteaux de Hîra retentirent sous son règne de chants comme ils n'en avaient jamais entendu. Les triomphateurs des concours poétiques ouverts chaque année à la foire de 'Okâth vinrent l'un après l'autre demander au prince éclairé la consécration de leurs talents, et renouveler à sa cour les luttes pacifiques dans lesquelles ils avaient obtenu d'éclatantes victoires. Il se constitua ainsi à Hîra un centre littéraire, une sorte d'académie poétique, dont les membres parcouraient toute la péninsule, portant leurs vers chez les princes et dans les tribus, mais sachant toujours où était leur point de ralliement, et, si j'ose ainsi parler, où flottait leur drapeau.
Nâbiga, dont les pensées n'avaient jamais cessé d'être tournées vers Hîra, dut bientôt se dérober aux manques de sympathie qu'on lui prodiguait. Mais il n'en sut pas moins conserver l'amitié des princes qui l'avaient si bien accueilli, et il parvint à se ménager un retour à Gassân pour l'heure de la disgrâce et de l'exil. Hîra l'attirait : il y possédait un coin de terre où il pouvait se mouvoir et se retirer librement; les présents de deux générations de rois s'étalaient sur sa table, couverte de vases magnifiques en or et en argent; le commencement d'un nouveau règne et les espérances qui s'y rattachaient augmentaient encore son impatience et lui faisaient hâter ses préparatifs de départ; car, par-dessus tout, il tenait à ne pas perdre l'influence légitime qu'il avait exercée sur les princes aussi bien que sur les sujets, et il aspirait à retrouver auprès de Nomân le rang qu'il avait occupé à la cour de son père et de son aïeul. Le poète fut bien vite admis dans l'intimité du prince;[4] les récits des conteurs ont associé leurs deux mémoires, et le nom de Nomân ben Moundhir appelle involontairement sous la plume des historiens les éloges que lui adressa Nâbiga Dhobyânî. Les documents, jusque-là rares et dispersés, deviennent plus nombreux et plus explicites; les récits se croisent et se contredisent ou se confirment, donnant pour chaque fait une série de variantes qui attestent à la fois la puissance du souvenir et l'imagination vive des narrateurs. Il semble que les biographes de Nâbiga aient concentré sur ce point unique toutes leurs informations, et que la vie du poète ne commence vraiment pour eux qu'à l'avènement de Nomân ben Moundhir Abou Kâboûs.
Dès lors, plus de parties de plaisir, plus de fêtes joyeuses, plus même de repas intimes, sans que Nâbiga y soit convié. L'huissier qui se tient à la porte du prince sait qu'à toute heure et sans se faire annoncer le poète peut entrer chez son royal ami. L'intimité a comblé toutes les distances, le talent et la puissance traitent d'égal à égal. Le seul privilège que Nomân ait gardé, c'est de continuer les libéralités qui sont devenues une tradition dans sa famille. Il se montre plus grandiose même dans sa générosité que l'Euphrate, « alors que, par le souffle agité des vents, ses vagues lancent sur les deux rives leur écume, et qu'il est grossi par tous les torrents qui débordent avec fracas, entraînant avec eux des amas d'arbustes et de branches. » Poursuivant la même comparaison, Nâbiga appelle son bienfaiteur « une mer de générosité, sur laquelle se balancent légèrement les vaisseaux. » tandis qu'ailleurs il dit que par sa mort « les hommes perdraient leur printemps, et l'année son mois sacré. » C'est « le plus parfait des hommes, » c'est « un soleil, et les autres rois ne sont que des étoiles; quand le soleil se lève, on ne voit plus aucune étoile. »
Ces années de bonheur et de prospérité ne furent pas fécondes pour le talent poétique de Nâbiga. Il vivait sur son passé et semblait s'endormir au sein des grandeurs. Sa maison regorgeait de gros bétail, « de chamelles blanches avec leurs selles neuves de Hîra, de chevaux fougueux qui s'emportent malgré le frein des rênes »; il était servi par « de jeunes esclaves relevant avec leurs pieds les pans de leurs manteaux, rafraîchies par le sommeil de midi et que l'on prendrait pour des gazelles au désert. » Le luxe et l'oisiveté avaient envahi peu à peu sa vie entière, tandis qu'il était devenu le point de mire de toutes les vanités humiliées, de toutes les ambitions blessées. Les cœurs étaient rongés par la jalousie en voyant ce parvenu comblé d'honneurs et de richesses, et ses ennemis étaient décidés à exploiter toute occasion favorable pour le perdre à jamais dans l'esprit de Nomân.
Les moyens auxquels on eut recours étaient aussi habiles qu'infâmes. Que l'on adopte l'une ou l'autre des trois versions que donne l’Aghani, ou qu'on les considère comme répondant à une série d'essais visant au même but et se complétant l'un l'autre, il est certain que « l'on avait mis dans la bouche du poète certaines paroles, et que ses ennemis avaient en secret fait part au roi de leurs calomnies. » Tout d'abord on avait répandu des satires violentes contre le prince, et on désignait Nâbiga comme en étant l'auteur.[5] Mourra ben Sa’d ben-Korei, qui avait composé avec un de ses compagnons l'un de ces pamphlets, le dénonça au roi comme l'œuvre de son favori. On y maudissait Nomân, « l'héritier de l'orfèvre, le lâche, l'ignorant. » En effet, Moundhir, père de Nomân, avait épousé une jeune fille de Fadak, Salmâ, dont le grand-père était orfèvre. Mais Nomân se cachait tellement peu de cette origine que plus d'une fois il est appelé Ibn Salmâ par ses panégyristes. Une telle accusation se condamnait par sa grossièreté même à être considérée comme une lâche imposture.
L'insuccès de cette première tentative ne découragea pas Mourra, un de ces Bènou Korei' dont Nâbiga ne se défiait pas encore, mais que plus tard il devait stigmatiser comme des menteurs «qui, avec leurs faces de singes, sont toujours en quête de victimes pour leurs calomnies. » Nomân ben Moundhir avait épousé sa belle-mère Moutadjarrada, qui passait pour être la plus belle femme de son temps. Elle n'était plus de première jeunesse au moment où elle se maria ainsi pour la troisième fois; mais le roi était petit de taille, il avait les cheveux roux, la figure grêlée, l'air chétif, et la conscience de son infériorité physique le disposait à la jalousie. Deux de ses intimes seuls, Nâbiga et Monakhkhal Yachkourî, avaient accès auprès de la reine. Un jour, Nâbiga entra sans être attendu dans l'appartement où elle se tenait. Sans le vouloir, elle laissa tomber son voile, et le poète vit « son corps enduit de safran, semblable à un manteau de soie jaune, sa taille parfaite, les fossettes de son ventre aux plis gracieux et sa gorge que soulève une mamelle ferme. » Elle lui apparut « comme le soleil au jour où il brille dans les constellations de Sa'd, ou comme une perle tirée de sa coquille, dont la vue réjouit le plongeur….. ou encore comme une statue de marbre sur un piédestal. » Elle chercha immédiatement à ressaisir son voile et à cacher son corps avec un bras potelé, qui couvrait presque entièrement son visage, et avec une « main teinte, délicate, dont les doigts ressemblent aux tiges du 'anam, qu'on peut nouer, tant elles sont flexibles. » La flèche « décochée par un arc sonore » perça le cœur du poète, le réveilla de sa torpeur, et il décrivit la reine, sans la nommer, dans une longue poésie très chaleureuse et très sensuelle.
Il eut l'imprudence de réciter ces vers pleins d'ardeur amoureuse à Mourra ben Sa'd ben Korei, celui-là même qui le poursuivait d'une haine acharnée. Nâbiga avait encore redoublé la colère de son ennemi en faisant devant Nomân un éloge pompeux d'un sabre, nommé dhoû 'rrika, que Mourra possédait et auquel il tenait beaucoup, il avait dû s'exécuter et se dessaisir de son arme de prédilection. Il se vengea en récitant au roi les vers que la vue de la reine avait inspirés au poète. Nâbiga n'était pas coupable, il était connu pour sa chasteté, bien que l'âge n'eut pas encore entièrement fait disparaître sa beauté native. Un moment d'entraînement, un regain de jeunesse avaient donné à sa poésie une allure que lui-même semble condamner lorsqu'il reproche à ses cheveux blancs tant de pétulance juvénile. » —
« Ne pourrai-je pas, dit-il, me corriger de ce qu'interdit la vieillesse ?»
C'est sans aucun doute à cet éloge excessif de Moutadjarrada qu'il faut attribuer la disgrâce du poète. Mais le rapport de Mourra n'aurait peut-être pas suffi à le faire condamner, si Monakhkhal n'était intervenu pour faire cause commune avec les diffamateurs. Moutadjarrada était la maîtresse de Monakhkhal, et elle était parvenue à cacher à son royal époux l'affection qu'elle avait pour son amant. Deux fils qu'elle avait mis au monde ressemblaient, dit-on, d'une manière frappante à leur père et fort peu à Nomân. Celui-ci n'en était que plus amoureux de celle qui le trompait. « Décris-nous-la, » dit-il un jour à Nâbiga, un soir qu'il était assis avec lui et Monakhkhal chez la reine. Nâbiga ne se fit pas prier; il récita les vers qu'il avait composés récemment. Au début, le charme de la poésie séduisit les auditeurs, puis le poète arriva à dire : « Lorsque tu touches, tu touches à pleines mains un corps solide, large, qui remplit bien sa place. Lorsque tu fais l'attaque, tu t'attaques à une hauteur dont les formes rebondies sont enduites de parfums. Lorsque tu te retires, tu te retires d'un défilé aride avec l'effort de l'adolescent qui manie une corde solidement tordue. » A ces mots, Monakhkhal bondit, et s'écria : « C'est la description d'un témoin oculaire. » L'amant jaloux excita le mari; Nomân résolut de tuer Nâbiga, qui s'enfuit d'abord dans sa tribu, puis en Syrie auprès des princes de Gassân. L'impunité dont jouit Monakhkhal put tout d'abord faire dire au poète que, « pour un chameau galeux, on en avait brûlé un autre, et que le malade, on l'avait envoyé au pâturage. » Mais bientôt Monakhkhal, surpris avec la reine dans une position qui ne permettait aucun doute sur la nature de leurs relations, fut mis à mort, ou, selon d'autres, enterré vivant.
Ce fut dans ce premier séjour auprès de Nomân que Nâbiga eut l'occasion de rencontrer le jeune Labîd, fils de Rabî'a. C'était encore un enfant, et il était venu accompagner ses oncles à la cour de Hîra. Il montra tant d'esprit dans ses réponses aux questions qui lui furent adressées, et fit tellement bonne impression sur son vieil interlocuteur, que celui-ci lui prédit qu'il serait un jour le plus grand poète des Arabes. Et cependant Labîd appartenait à la tribu des Bènou 'Abs, les ennemis des Bènou Dhobyân, et il avait eu à lutter contre les susceptibilités de Rabi' ben Zyâd, un des familiers de Nomân. Mais Nâbiga, s'élevant au-dessus de ses sympathies ou de ses défiances personnelles, n'hésita pas à reconnaître le talent véritable de celui-qui se vantait d'avoir parmi ses ancêtres ‘Amir, fils de Sa'sa'a.
L'huissier du roi, 'Isâm, fils de Ghahbar Djarmî Khâridjî était l'ami de Nâbiga; il l'avait prévenu du changement qui s'était opéré dans l'esprit de Nomân; il avait entendu le roi dire en parlant du poète : « Je finirai par l'atteindre. » Devant ces menaces, Nâbiga s'était enfui à la hâte sans même prendre le temps de réunir sa caravane de chameaux et d'esclaves, sans emporter la moindre parcelle des richesses qu'il avait amassées. A peine en sûreté, il commença à protester contre les accusations dont il avait dû subir l'âcreté et contre la disgrâce qu'elles avaient amenée. « Envoie, dit-il, chez les Bènou Dhobyân, consulte et n'agis pas contre moi avec précipitation, sans t'être informé... Si ma main droite t'avait criminellement trahi, je la séparerais de ma main gauche. »
Nâbiga ne trouva pas dans sa tribu, dont il invoquait le témoignage, l'affection et la reconnaissance qu'il avait cru pouvoir en espérer. Yazid ben Sinân avait profité de son absence pour exciter contre lui ses compatriotes. D'un autre côté, les mesures de prudence qu'il conseillait dans les rapports avec Gassân, lui furent souvent comptées comme autant de lâchetés, et on lui reprocha ses craintes comme une trahison. En vain sous Nomân, frère et successeur de 'Amr IV, il engagea les Bènou Dhobyân à quitter leurs quartiers de Dhoû Oukour, en vain il leur dit : « O mes compagnons! déjà le lion s'est replié sur ses griffes, prêt à bondir. » Nomân, roi de Gassân, envoya contre eux une armée, à la tête de laquelle se trouvait Nomân ben Wâïl ben Djoulâh. Après la victoire, il ne mit pas seulement en liberté 'Akrab, la fille de Nâbiga, mais tous les prisonniers de Gatafân durent encore une fois leur délivrance à son intercession.
Pendant que la chamelle de Nâbiga « trottait pour le conduire chez Ibn Djoulâh, » on répandait dans toute la tribu des satires nombreuses contre lui. Il nous en reste encore un échantillon plein d'âpretés sanglantes, dont la brûlure est comme celle des charbons ardents. » Et pourtant, dit le poète avec indignation, « ce n'était pas à vous de me repousser; aussi ma réponse est-elle à jamais fixée au milieu de vos personnes et de vos biens. » Malgré les injures de Badr qui le raille de marcher avec une « armée qui chasse les passereaux et les corbeaux, » et de trahir les Bènou Dibâb, une branche des Bènou Dhobyân, Nâbiga profita de son influence à la cour de Gassân pour sauver de l'esclavage « de belles vaches aux yeux sombres, » comme il appelle les captives de sa tribu.
Après avoir quitté la cour de Hîra, Nâbiga, fatigué de haines et de jalousies, se laissa facilement retenir à Gassân par 'Amr ben Hârith, qui avait succédé à son père ou son frère Hârith elasgar. Nâbiga devint le chantre « des armées d'une race sans mélange, de ces hommes dont la valeur ne ment pas. » La supériorité militaire de Gassân sur Hîra s'était affirmée aussi bien à 'Ein Obâg qu'à Halîma, et Nomân ben Moundhir ne disposait que de forces peu considérables, tandis que ‘Anir voyait ses guerriers nombreux «courir à la mort comme des chameaux jeunes et fringants et faire circulera l'envi la coupe du trépas, tenant dans leurs mains des épées brillantes aux pointes acérées. » C'est ainsi que le poète pouvait louer Gassân, tout en restant attaché à ses compatriotes et fidèle à l'amitié qu'il avait vouée aux princes de Hîra.
Malgré une pluie de présents et de bienfaits de 'Amr, malgré la bonne opinion que Nâbiga avait conçue de son nouveau maître, malgré la bienveillance qu'il rencontrait partout, malgré la générosité naturelle qu'il admirait sincèrement chez tous ces héros, jamais le poète ne put se résigner à l'injuste soupçon qui pesait sur son passé, jamais il ne se rappela sans émotion ces châteaux de Hîra qui semblaient désormais fermés pour lui, jamais il ne cessa d'affirmer son innocence et de protester contre l'injustice qui l'avait frappé. Laissons-lui la parole : « Une menace d'Abou Kâboûs, dont j'ignore les motifs, est arrivée jusqu'à moi.... et j'ai passé une nuit comme si j'avais été mordu par un serpent mince et tacheté, dont les dents distillent un venin pénétrant. » Ailleurs, le poêle nous parle de « la couche d'épines » que lui ont préparée « des fourbes et des menteurs. »
Mais, s'il insiste avec énergie pour qu'un jugement inique soit rapporté, il ne s'abaisse pas à des récriminations, et il se souvient qu'autrefois « les présents du jour ne nuisaient pas à ceux du lendemain. » On sent, d'un côté, une souffrance profonde et une agitation fébrile; de l'autre, une reconnaissance vraie et un étonnement plein de déceptions dans toutes les poésies où Nâbiga essaye de se justifier. « Non, dit-il, par la vie de celui dont j'ai parcouru la Kaaba, par le sang répandu qui s'est figé sur les pierres sacrées, par celui qui donne la sécurité à ces oiseaux réfugiés dans son asile . . . je n'ai proféré aucune des paroles mauvaises qu'on t'a rapportées. » Il dit encore, prenant à témoin les chamelles assemblées de Lasâf et de Thabra, qui visitent le mont liai dans leur course effrénée : « Tu as fait peser sur moi la faute d'un coupable. . . Si je ne puis arriver a faire convaincre de mensonge mon ennemi, si je jure en vain de mon innocence, si aucune de mes paroles ne trouve créance auprès de toi, alors comme la nuit tu m'atteins, quand je m'imaginais qu'une grande distance nous séparait. Je suis entraîné vers toi par des crocs de fer recourbés attachés à des câbles puissants que tendent des mains vigoureuses. »
Cet état anormal, l'amertume des regrets, ces nuits « dont les étoiles avançaient lentement, » n'absorbèrent heureusement pas complètement l'esprit de Nâbiga. « Tantôt le mal laissait du répit au malade, et tantôt il revenait à la charge. » La faveur royale se partageait entre les deux poètes qui s'étaient déjà rencontrés à Gassân après la bataille de Halîma, Nâbiga et 'Alkama ben 'Abda. Leur union était telle qu'ils avaient pris pour maîtresses deux sœurs, Si'lâ et Mi'lâ. Hassan ben Thâbit entra un jour chez le roi. Il vit Nâbiga assis à sa droite, et à sa gauche se tenait un homme qu'il n'avait jamais rencontré. « Connais-tu ces deux hommes? demanda le roi. — L'un, dit Hassan, je le connais, c'est Nâbiga; mais l'autre, je ne sais qui il est. — C'est 'Alkama ben Abda; et, si tu veux, je les prierai de nous réciter des vers. Quand tu les auras entendus, tu seras libre d'entrer en concurrence avec eux ou de te taire. — Soit, répliqua Hassan. » Alors Nâbiga chanta : « Laisse-moi, ô Omeima! au souci qui m'accable, laisse-moi aux tourments d'une nuit dont les étoiles avancent lentement! » — « Voici la moitié du programme réalisée, reprit le roi. A ton tour, 'Alkama, de te distinguer. » Et il dit : « Un cœur inquiet t'a emporté au delà des belles nuits; car la jeunesse est déjà un peu loin, alors que les cheveux commencent à blanchir. » — « L'autre moitié du programme est réalisée, dit le roi. A toi, Hassan, de chanter maintenant après eux ou de l'abstenir. «Avec l'audace de la jeunesse, Hassan fit l'éloge des Djafnites, les représenta auprès du tombeau de leur ancêtre Ibn Mâriya, et mérita d'être mis de pair avec ses illustres rivaux. Plus, tard, Hassan, désireux de briller seul, se rendit à la cour de Nomân ben Moundhir et y occupa pendant quelque temps la place laissée vacante par le départ de Nâbiga.
Après la mort de ‘Amr IV, Nâbiga resta auprès de son successeur Nomân ben Hârith Abou Karib. Au milieu des révoltes continuelles des Bènou Dhobyân, Nâbiga sut parfaitement concilier le dévouement qu'il devait à son protecteur et l'amitié qu'il n'avait cessé de témoigner aux hommes de sa tribu. Si les Bènou Dhobyân furent battus à Dhoû Oukour, ils prirent une revanche en se joignant aux Bènou Hounn, qui avaient su conserver leur indépendance en s'établissant dans des retraites inaccessibles. Nâbiga eut beau dissuader le prince de cette expédition, en lui disant : « Lutter avec eux est toujours pénible. » Les Bènou Hounn parvinrent à repousser toute attaque de leurs magnifiques dattiers ; « qui descendent s'abreuver dans la vallée, dont la croupe se mouille avant que leur gorge se désaltère. »
Nomân était un guerrier « dont les marmites étaient toujours en ébullition, et dont les chaudières laissaient déborder les causes de mort. » A tout instant, le bruit courait dans le pays qu'il avait péri dans quelque expédition. L'inquiétude populaire a été exprimée par Nâbiga : « Lorsque Nomân viendra à succomber, on dessellera les montures et on jettera du côté de la cour leurs caparaçons; une femme chaste poussera à la fin de la nuit des soupirs à se rompre, ou peu s'en faut, la poitrine. » Un morceau vraiment dramatique est l'élégie composée par Nâbiga lorsque le roi mourut. La nouvelle s'est répandue, mais elle n'a pas été confirmée. On espère avoir été le jouet d'une fausse alerte. Mais voici que de nouveaux arrivants, témoins du malheur, racontent qu'à Djaulân « ont été enterrées tant d'énergie et de générosité. » Toute cette scène de place publique est racontée avec une vivacité qui fait oublier « la couronne de cheveux blancs » qui couvre la tête du poète.
A la mort de Nomân Abou Karib, qui eut lieu vers 600, Nâbiga résolut de retourner à Hîra auprès de Nomân ben Moundhir. C'est, à l'heure du départ qu'il appela la bénédiction de Dieu sur « des hôtes qui brillent comme les lanternes dans l'obscurité des nuits. » Nâbiga avait appris que Nomân Abou Kâboûs était malade. Il partit, et sur la route, dans son impatience, il demandait à tout voyageur : « Conduis-moi vers Nomân; peu m'importe où je me rencontrerai avec lui. Puisse Dieu lui amener les pluies matinales ! » Porté sur une litière par des jeunes gens qui se relayaient, Nomân se faisait alors promener au milieu d'une foule « demandant à Dieu de prolonger ses jours. »
Nâbiga, en arrivant à Hîra, n'osa pas d'abord se présenter à Nomân. « Je ne paraîtrai pas devant toi, dit-il, si je dois paraître en accusé. » Il comptait d'ailleurs sur ses deux compagnons de route, Manthoûr ben Zabbân et Seyyâr ben 'Amr, deux Bènou Fazâra, pour le réconcilier avec le prince. Il alla trouver son ancien ami, le chambellan 'Isâm. Celui-ci, croyant qu'il voulait entrer comme autrefois, lui barra le passage. « Je ne t'accuse pas de m'interdire l'entrée, lui dit Nâbiga, mais que se passe-t-il derrière ton rideau, ô 'Isâm! » Hassan ben Thâbit, qui avait remplacé le poète exilé dans les faveurs de Nomân, fut bientôt informé de ce retour inattendu. Il fut effrayé, et se douta que Nâbiga aurait bientôt recouvré son empire sur le prince. Une retraite volontaire lui parut préférable à une disgrâce honteuse, et il laissa le champ libre à son rival.
Nomân ben Moundhir n'était plus porté sur une litière, et la flèche de la mort ne s'était pas encore « mise cette fois de la partie. » Le roi, apprenant l'arrivée de Seyyâr et de Manthoûr, qu'il aimait beaucoup, leur fît dresser une tente de cuir, dans laquelle il s'enfermait avec eux et une jeune esclave chargée de les distraire par ses chants. Les vers de Nâbiga avaient été exilés en même temps que lui de la cour; aussi personne n'osait-il prononcer ce nom devant le roi. Les deux Fazârites, quel que fût le sujet de l'entretien, ne craignaient pas de le ramener toujours vers un même point : à tout instant ils parlaient de Nâbiga. La jeune chanteuse, qui était présente, dit : «Ils ont avec eux un cheikh, et ce n'est pas sans motif qu'ils parlent sans cesse de Nâbiga. » L'un d'eux lui apprit les vers : « O demeure de Meyya, » etc. et lui dit : « Chante-les au roi quand il voudra s'endormir. » Lorsque Nomân les entendit : « Voilà, dit-il, de la poésie élevée, ce sont des vers de Nâbiga. » Puis il accueillit l'excuse du poète, lui pardonna et le combla d'honneurs. Nâbiga demanda la permission au roi de lui réciter quelques-unes de ses nouvelles poésies. Nomân, saisi d'admiration, céda au poète cent chameaux noirs avec leurs bergers, leurs tentes et leurs chiens.
Après un long exil, Nâbiga se trouvait enfin dans sa vieillesse réhabilité aux yeux du prince qu'il avait tant aimé, et rendu à la vie tranquille après laquelle il soupirait depuis si longtemps. Mais Nomân, qui autrefois, après l'avoir entendu, lui avait fait remplir de perles la bouche en disant : « C'est ainsi qu'on doit louer les rois, » éprouvait maintenant du dégoût pour ces panégyriques exagérés, qui étaient autant l'œuvre du courtisan que du poète. Un jour, Nâbiga entra chez lui et lui dit : « La terre s'affaisserait si elle te perdait un jour; mais tant que tu resteras, elle demeurera solide et ferme. » Nomân répondit à cet éloge par un regard furieux. Ka'b ben Zoheir était présent. Il dit : « Puisse Dieu accorder le bonheur au roi! L'expression de Nâbiga était fausse; il aurait dû dire : C'est que tu es comme le contrepoids qui la tient en équilibre, et que tu l'empêches ainsi de pencher d'un côté ou de l'autre, Nomân sourit, et ordonna de leur donner à tous deux des présents. Sans l'intervention de Ka'b, Nâbiga aurait été mis à mort,
Nâbiga devait survivre à Nomân Abou Kâboûs, qui mourut vers 605 « sous un toit formé par les poitrines des éléphants. » Ce traitement barbare lui fut infligé par Kasrâ Parwîs, blessé de ce que son vassal n'avait voulu lui donner aucune de ses parentes comme épouse, et l'avait fait engager à « chercher ce qui lui convenait parmi les vaches de la Perse. »
Lorsqu'on annonça à Nâbiga la mort de Nomân et le traitement que lui avait fait subir Kasrâ, il dit : « Il a été cherché par le destin qui cherche les rois. » Puis il développa ainsi sa pensée : « Quand le destin cherche une victime, il l'atteint avec ses griffes; le destin s'abat sur l'un après l'autre sans être appelé. Il n'y a pas d'homme si glorieux et si honoré sur lequel il ne se jette comme un loup. Il détruit sur l'heure les plus illustres d'entre eux, les perçant de ses flèches acérées qui atteignent leur but. Pour moi, j'ai trouvé les traits de la mort préparant à chacun son trépas pour l'heure inscrite d'avance. »
Nâbiga se retira ensuite dans sa tribu. Il ne lui convenait pas de rester auprès de l'usurpateur imposé par Kasrâ, Yyâs ben Kabîsa. La guerre de Dâhis et de Gobrâ était complètement terminée; les Bènou Dhobyân s'étaient désormais réconciliés avec les Bènou ‘Abs, leurs alliés naturels, et toute la race de Gatafân s'était unie contre les Bènou 'Amir et les autres Hawâzin. C'est à cette guerre que semble se rapporter une poésie de Nâbiga. Elle est dirigée contre 'Amir ben Tofeil, le chef des troupes ennemies, un guerrier plein de jeunesse et de témérité, un poète' qui ne craignait pas de railler Nâbiga. Celui-ci lui répondit : « Si 'Amir a parlé sottement, c'est que la jeunesse fait excuser la sottise. . . Ne laisse pas emporter ta raison par les vagues bouillonnantes de l'orgueil qui débordent sans trouver d'issue. » Puis il lui montre réunis contre lui dans leur colère « les cavaliers de Manoûla, qui ne laissent pas tomber leurs corps sur leurs selles, et ceux de Mourra, dont l'aigle flotte au-dessus de leurs bataillons. »
Comment et en quelle année mourut Nâbiga? La seule réponse que l'on puisse faire avec certitude, c'est qu'il ne connut pas la mission de Mohammad et n'assista pas à l'avènement de la nouvelle religion. Tandis que Hassan ben Thâbit devenait le chantre de l’islam naissant, son rival à la cour de Nomân, celui-là même dont il avait reconnu la supériorité et la concurrence, errait dans le Yaman, où il tomba dans le délire et où il mourut. « Que les herbes odorantes et le musc et l'ambre ne cessent de croître sur sa dernière demeure rafraîchie par l'eau du ciel... Qu'elle y fasse pousser nénufars et plantes suaves aux fleurs éclatantes! » On ne sait pas même où est le tertre sous lequel repose celui qu'on surnomma « la fontaine jaillissante, » et qui dit de lui-même : « Mes rimes quand elles passent sont puissantes comme les rochers, » ou encore : « Le poète de second ordre me ressemble aussi peu que la jeune chamelle à l'étalon blanc. »
Nâbiga avait la conscience de son talent, et il savait qu'à 'Okâth aucun poète n'était capable de « fendre sa poussière ». Cet orgueil légitime, parce qu'il était fondé, avait soutenu le poète au milieu des épreuves qu'il avait traversées, et il se regardait comme le panégyriste des rois. « Je suis, dit-il en s'adressant à Ibn Djouiâh, je suis de ceux qui ne louent jamais que les princes, » comme pour lui faire sentir tout le prix de l'exception faite en sa faveur. D'un autre côté, il se vante de savoir répondre aux injures de ses ennemis. Provoqué par Yflzîd ben ‘Amr, il lui répond : « Que de fois d'autres m'ont insulté avant toi, sans que je fusse à court de paroles. » « J'ai juré, dit-il encore, que je serais de ceux dont l'approche est pénible à un ennemi. » On voit que, s'il réservait les éloges aux rois, il ne regardait pas les hommes moins haut placés comme indignes d'être « atteints » par ses satires.
Non seulement les poésies de Nâbiga excitaient l'admiration générale, mais son goût le faisait choisir comme arbitre par ses rivaux eux-mêmes. Chaque année, à la foire de 'Okâth, on dressait à Nâbiga une tente de cuir, où il rendait ses arrêts, et les poètes les plus éminents recherchaient son approbation. Un A'châ, un Hassan ben Thâbit, une Khansâ venaient lui réciter leurs vers et s'inclinaient devant ses jugements. Hassan, plein de confiance, lui chanta : «Nous avons des écuelles d'argent qui brillent dès le matin, et nos épées dégouttent du sang de nos ennemis. Nous avons mis au monde les Bènou 'Ankâ et les deux fus de Moharrik; honore en nous un oncle maternel et en lui un fils. » Nâbiga lui dit : « Tu es un poète, mais tu as rabaissé tes écuelles et tes épées, tu t'es montré fier de tes enfants, mais tu ne t'es pas montré fier de tes parents. » Puis, joignant l'exemple au précepte, il ajouta : Ce n'est pas toi, fils de mon frère, qui aurais dit: « Alors, comme, la nuit tu m'atteins, » etc. Hassan s'éloigna tout confus, sans répondre un seul mot.
Hassan enviait beaucoup le talent poétique de Nâbiga, qu'il considérait comme le premier de tous les poètes arabes, devant lequel la gloire d'Imrou'ou'lkeis même devait pâlir. Parfois, Hassan fait une réserve pour lui-même, et il n'hésite pas à se déclarer dans son dîwân le plus incomparable de tous les poètes. Zoheir, qui vécut presque en même temps que Nâbiga, n'aurait pu mieux taire, d'après Abou 'Amr, que de se constituer sou rhapsode. Les hommes du Hedjaz les ont d'ailleurs réunis tous deux dans une égale admiration, et leur ont accordé la palme sur tous leurs concurrents. Parmi les poètes qui reconnaissaient la supériorité de Nâbiga, il faut citer Djarîr, et aussi son contemporain Akhtal; nommons enfin le grammairien Abou Aswad Dhou'alî.
Quelles que soient d'ailleurs les préférences individuelles, il y a unanimité pour placer Nâbiga dans « la première classe de poètes, parmi ceux qui sont supérieurs à tous les autres. » On lui adjoint parfois Imrou'ou'lkeis et Tarafa, ou Imrou'ou'lkeis et A'châ, ou bien Imrou'ou'lkeis et Zoheir, ou encore on dresse une liste où se suivent par ordre de mérite Imrou'ou'lkeis, Nâbiga, Zoheir et A'châ. Ces classifications, dont on pourrait multiplier les exemples à l'infini, montrent quelles oppositions séparaient les diverses appréciations, et combien l'accord était peu établi entre les critiques. Les collections, celle des six poètes, celle des moallakât, ces ouvrages qui témoignent d'un choix réfléchi, pourraient être également invoquées en faveur de l'autorité dont jouissaient tes poésies de Nâbiga.
Le pieux khalife 'Omar est souvent cité comme un de ses admirateurs fanatiques. « C'est le premier poète de Gatafân, » avait-il dit d'abord. Plus tard il se reprit, et il s'écria : « Non, c'est le premier de tous les poètes arabes ». 'Abdou'lmalik ben Marwân, qui aimait et comprenait la poésie, alla en Syrie, dans le pays même où étaient écloses plusieurs poésies de Nâbiga. Il chercha longtemps, et il demanda : « Y a-t-il parmi vous un homme qui soit en état de réciter les excuses que Nâbiga adressa à Nomân ben Moundhir, lorsqu'il lui dit : Je jure, et puissé-je ne laisser dans ton âme aucun doute, etc. » On ne trouva personne. Le khalife dit alors à 'Amr ben Mountachir Morâdî; « Et toi, le peux-tu? » — « Oui, » répondit-il ; et quand il eut terminé, 'Abdou 'Imalik lui dit : « C'est le plus grand des poètes arabes. » Cet enthousiasme pour Nâbiga était tellement vif, qu'un jour le khalife monta en chaire à Médine pour admonester le peuple. Il ne fit pas entendre au début le « Gloire à Dieu » habituel, mais il dit : « O habitants de Médine! je ne vous aimerai pas tant que je me souviendrai du traitement que vous avez infligé à ‘Othman, fils de 'Affân ; et moi, vous ne m'aimerez pas non plus tant que vous penserez au jour de Harra. » Puis il récita le vers de Nâbiga : « Je n'aime pas à voir un tombeau se dresser toujours en face de moi, ni une hache suspendue au-dessus de ma tête, comme pour me transpercer. » C’est ainsi que 'Abdou 'Imaiik, au lieu des versets du Coran, apportait jusque dans la chaire les poésies de Nâbiga.
Les qualités particulières qui, aux yeux des Arabes, distinguaient son talent sont avant tout « la beauté de ses entrées en matière, l'éclat de son langage, l'éloquence de ses vers dont le style marche sans entraves ». Le célèbre grammairien Farrâ disait de lui : « Il a beau langage ; il commence et il coupe bien; on voit dans ses vers une puissance poétique qui n'est déparée par aucune faiblesse dans l'exposition. » Hammâd Râwiyya vante surtout sa concision. Interrogé un jour pourquoi il mettait Nâbiga au premier rang. « C'est, répondit-il, que, pour avoir un sens complet, il n'est pas besoin de prendre un vers entier, ni même un demi-vers, mais parfois un quart de vers seulement. » C'est pour une qualité semblable, son habileté à résumer dans un trait général une réflexion qui avait frappé son esprit, qu'il avait été mis au nombre des fouhoûl. La terreur a souvent été regardée comme sa principale source d'inspiration. A ce point de vue exclusif, je préfère la réponse d'Abou 'Ifath Iskandarî, à qui on demandait ce qu'il pensait de Nâbiga. « Il est habile à faire des chansons amoureuses quand la passion l'entraîne, à composer des satires quand il a le cœur ulcéré, à louer lorsqu'il brigue des faveurs, à s'excuser quand il craint. Il ne lance jamais un trait sans atteindre le but. »
Les poésies de Nâbiga encoururent aussi la sévérité des critiques. L'illustre grammairien Isâ ben 'Omar, le maître de Sibaweihi, jugeait très sévèrement les poètes arabes les plus renommés, et en particulier Nâbiga. Ibn Koteiba lui reproche une fois d'avoir été plus heureux dans l'idée que dans l'expression. Ibn 'Abd Rabbihi cite plusieurs passages qui étaient incriminés par Asma'i, soit pour le manque de justesse des mots employés, soit pour l'exagération « détestable » des images contenues dans certaines descriptions. Mais le principal reproche qui pesa sur Nâbiga, ce fut l'abus dans ses rimes de ce que les prosodistes arabes appellent l'ikwâ. Cette faute consiste dans l'emploi alternatif des voyelles ou et à la fin des vers dans un même morceau de poésie. Comme l'a fort ingénieusement supposé M. Caussin, il est probable que cette atteinte aux règles de la rime écrite n'existait pas pour l'oreille, et qu'on entendait un même son intermédiaire comme notre e muet, quelle que fût la voyelle réclamée par la construction grammaticale. Ce fut à Yathrib ou Médine que Nâbiga, prévenu par des amis, reconnut « ce défaut dont il n'avait pas tenu compte jusque-là, » et que, dit-on, il s'appliqua à le corriger. Que le poète ait ainsi soumis toutes ses poésies à une sorte de révision, ou qu'il se soit borné à corriger quelques passages, ce qui est certain, c'est que dans le dîwân, tel que nous le possédons, il n'y a pas un seul vers qui n'ait, à côté de la leçon fautive, une variante donnant pleine satisfaction aux exigences de la grammaire et de la métrique. » « Quand je suis revenu de Yathrib, disait fièrement Nâbiga, j'étais le premier des poètes. »
Cette tradition est-elle authentique, ou n'a-t-elle été inventée que pour dissimuler l'intervention des exégètes? Plus d'un de ces changements, s'il réconcilie le vers avec les règles, le brouille complètement avec le mouvement poétique, et se ressent de la main lourde qui a passé par là. Khalaf elahmar ne se vante pas seulement d'avoir imité à s'y méprendre la manière des plus grands poètes et d'avoir étonné les savants de Koûfa eu leur montrant les vers qu'il avait fait entrer dans le dîwân de chacun d'eux, mais il était particulièrement fier d'avoir su contrefaire les poésies de Nâbiga. Abou Hâtim dit : Voici ce que j'ai entendu dans la bouche de Khalaf elahmar : « C'est moi qui ai fait au nom de Nâbiga la poésie qui contient le vers suivant : Des chevaux qui s'abstiennent de nourriture, d'autres qui ne s'en abstiennent pas sous la poussière qui les couvre, d'autres enfin qui rongent leurs freins. » Cette poésie ne se trouve pas dans notre dîwân; mais il se peut qu'il renferme d'autres vers apocryphes, et nous ne pouvons pas nous flatter d'avoir l'œuvre primitive de Nâbiga. La poésie xxxi, qui est peut-être de Aus ben Hodjr, ne paraît avoir été attribuée à Nâbiga qu'à cause du nom Omâma cité au premier vers. Les poésies x et xxiii sont de Badr et de Yazid. Quant aux vingt-huit autres, elles paraissent toutes, dans leur rédaction primitive, avoir été composées par Nâbiga. Mais il est fort difficile de fixer pour elles le point où s'arrête le travail de première main et le point où commence la retouche. Ainsi, dans la poésie xii, il y a les trois derniers vers pour lesquels A'lam croit devoir remarquer qu'ils étaient inconnus à As-ma'î. Toute l'histoire de l'ancienne littérature poétique des Arabes montre d'ailleurs bien clairement que, au moment même où les textes, jusque-là transmis de bouche en bouche, furent pour la première fois établis par les grammairiens, les poésies avaient déjà subi de nombreuses altérations, qu'elles avaient été modifiées et transformées par ceux-là mêmes qui les colportaient dans la péninsule, et qui, en récitant, laissaient leur imagination venir au secours de leur mémoire. L'ordre et la suite des vers n'étaient même pas respectés : le mètre seul contenait et arrêtait jusqu'à un certain point la mobilité de poésies livrées à la merci de ces chantres ambulants.
Lorsque les grammairiens cherchèrent a recueillir les épaves de la vieille poésie, ils se trouvèrent en présence de fragments nombreux, sans commencement ni fin, qu'une image frappante avait fait détacher des morceaux auxquels ils avaient survécu. D'un autre côté, une similitude fortuite de mètre et de rime avait amené la réunion de vers qui n'avaient d’autre rapport entre eux que cette ressemblance extérieure. Il restait les différences de dialecte, comme la marque de la tribu où avait vécu chaque poète ; mais elles ne pouvaient être respectées par des esprits ardents à établir l'unité de la langue arabe et à l'imposer partout où ils ne la rencontraient pas. L'application des trois voyelles fut comme le coup de mort pour les finesses et les variétés délicates de la prononciation. On introduisit violemment la grammaire et le lexique du Coran dans les poésies antéislamiques, et on leur enleva ainsi une partie de leur originalité. Les poésies de Nâbiga semblent porter encore jusqu'à un certain point la trace de leur origine. Quelques mots, évidemment empruntés à la langue du Nord, exhalent comme un goût de terroir, qui a dû échapper aux philologues arabes, et il semble que ceux-ci n'aient pas complètement épuré son vocabulaire de locutions araméennes.
Tout en regrettant les altérations qui nous dérobent aujourd'hui le texte primitif, il faut savoir gré aux linguistes arabes d'avoir fait rendre par les Bédouins le dépôt qu'ils avaient si longtemps conservé, et d'avoir sauvé ces débris précieux de l'antiquité arabe, en les fixant par l'écriture. Les poésies de Nâbiga ont eu pour premier éditeur Abou Sa'îd 'Abdou'lmalik ben Koreib Bâhilî Basrî, connu sous le nom d'Asma’î, qui vécut à la cour de Haroun Errachîd. Nous savons d'ailleurs que les poésies de Nâbiga étaient récitées à sa cour. Asma'î avait réuni les « six poésies, » comme il nommait son recueil des six poètes. Il avait été aidé dans cette tâche par son élève Abou Hâtim Sidjistânî. Cette collection devait recevoir avec le temps des additions, empruntées soit aux recueils parallèles Cormes à la même époque, soit aux collections des philologues, qui plus tard encore s'efforçaient de compléter par leurs trouvailles l'œuvre de leurs devanciers. Pour Nâbiga en particulier, son Diwân contient vingt-quatre poésies transmises par Asma'î; les autres sont rapportées d'après l'autorité de Toûsî, qui vivait au milieu du IIIe siècle de l'hégire (vers 864. ap. J. C.), et qui en devait la connaissance à ses maîtres. Il est impossible de préciser quel fut le dernier rédacteur du Diwân des six poètes; il se pourrait que ce fût le commentateur Abou Hadjâdj Yoûsouf ben Soleimân, connu sous, le nom de A'lam, qui mourut en 476 de l'hégire (1083-4 après J. C.).
Abou Sa'îd Hasan ben Hosein Sokkarî, mort en 375 de l'hégire (888-9 ap. J. C), avait publié une autre anthologie contenant des poésies de Nâbiga Dhobyânî, Imrou'ou'lkeis, Zoheir, Nâbiga Dja'dî et Labîd. Des vers que ne contient pas notre dîwân sont attribués par Yâkoût à Nâbiga, et il dit les avoir empruntés à l'édition d'Ibn Fourât. Enfin, l'auteur de l'Aghani et Ibn Koteiba connaissent aussi des poésies qui n'ont pas eu accès dans notre dîwân. Il faut aussi mentionner la recension contenue dans le Mountahâ'ttalb d'Ibn Meimoûn, une anthologie poétique qui ne contenait, dit-on, pas moins de mille poèmes. Les vers d'une même poésie s'y trouvaient souvent dans un ordre tout différent de celui qu'ils occupent dans le dîwân. Abou 'Obeida semble aussi avoir publié son édition de Nâbiga, dont quelques variantes nous ont été conservées. Plusieurs indices paraissent encore attester l'existence d'une recension koufite et d'une recension basrite. C'est dans la première que Khalaf elahmar se vantait d'avoir fait passer ses interpolations; c'est comme toujours, ici encore, la tradition de Basrâ qui est parvenue jusqu'à nous.
L'éditeur d'un poêle antéislamique ne peut donc pas plus se proposer de donner toutes les œuvres de son auteur qu'il ne peut espérer remonter au texte primitif. Son but doit être de reproduire aussi fidèlement et aussi complètement que possible le Diwân, tel qu'il était sorti de la main d'un grand philologue, d'un Asma'î par exemple ou d'un Ibn Sikkît.
Parmi les procès de tendance que les linguistes arabes firent subir aux auteurs qu'ils publiaient, M. Nöldeke signale avec raison les changements amenés par des considérations religieuses. Cependant il ne faut pas s'exagérer l'importance de ces modifications, ni leur attribuer une foule d'idées qu'on est étonné de rencontrer dans les vieilles poésies arabes. L'islam n'est pas un fait isolé; il n'a pas réussi comme un de ces coups de théâtre qui frappent par leur nouveauté et leur imprévu, mais parce qu'il était la conséquence naturelle du mouvement monothéiste qui s'était produit dans la péninsule pendant tout le siècle qui précéda la prophétie de Mohammad. Les Juifs avaient apporté en Arabie comme partout leur croyance à l'unité de Dieu; le christianisme était assis sur les trônes de Gassân et de Hîra ; de plus, les esprits étaient surexcités, comme dans les époques qui précèdent l'avènement de croyances nouvelles. Nâbiga ne fut pas chrétien, mais il fut un de ceux qui, dans la période entre Jésus et Mohammad, crurent à un Dieu unique et à la résurrection. Son dîwân nous présente un certain nombre de passages tout à fait authentiques où il exprime les sentiments religieux dont son cœur est animé. « Un homme qui a une religion et qui l'observe se rendra-t-il jamais coupable d'un parjure?. . . Dieu n'aime que sa justice et son équité; pour lui, le mal n'est pas le bien, et une bonne action n'est jamais perdue. »
Mais le poète ne reste pas ainsi dans les considérations générales. Parlant de la foi des Ghassanides, il dit: « Leur pays est tout plein de Dieu, leur religion est solide, et ils ne craignent rien plus que les châtiments de la vie future. Chaussés de sandales légères, parés de belles ceintures, ils sont salués avec des branches odorantes au jour des rameaux. » Nous voyons ailleurs « leurs troupeaux paître près de la croix de Zaurâ. » A Hîra, la reine Moutadjarrada est tellement belle que, « si elle se présentait devant an moine aux cheveux blancs, qui sert Dieu par son abstinence et ses prières, il serait fasciné par sa beauté et par le charme de son langage. » Ce sont de tels précurseurs qui ont préparé les voies au triomphe éclatant de l'islam. Il suffisait, pour assurer une pareille victoire, qu'un homme sût exploiter la foi sincère de ces âmes naïves, avides d'enthousiasme, et transformer leur piété en un fanatisme ardent.
Nâbiga, qui mourut peu d'années avant la mission du Prophète, est un des derniers représentants de la culture antéislamique. Sa vie n'est pas, comme celle de son homonyme Nâbiga Dja'di, par exemple, ou de Hassan ben Thâbit et de tant d'autres, coupée en deux et partagée entre deux périodes qui auraient l'une et l'autre exercé une égale influence sur son développement poétique. Si l'on veut classer les trente poésies du dîwân, il faudra ou adopter l'ordre chronologique qui a été à peu près établi dans la première partie de cette introduction historique, ou encore grouper tous les morceaux qui se rapprochent par leur objet et leur origine. On pourra ainsi, en mettant de côté les poésies x et xxiii qui ne sont pas de Nâbiga, séparer : 1° les poésies de Hîra : i, ii, vii, viii, xiv, xix, xxvi, xxix ; 2° les poésies de Gassân: iii, iv, ix, xv, xvi, xx, xxiv. xxviii: 3° les poésies locales relatives aux alliances des Bènou Dhobyân : xii, xiii, xviii, xxv; 3° les poésies personnelles qui, à l'exception de vi et de xxvii, sont toutes des satires; ce sont : v, xi, xvii, xxi, xxii, xxx. Cette classification est loin d'être absolue, surtout si l'on pense aux rapports continuels qui existaient entre les rois du Nord et les tribus du Nadjd ; mais elle se justifie par le genre et la couleur des poésies contenues dans chacune de ces quatre sections.
Les poésies de Nâbiga eurent de nombreux imitateurs qui, avec les mœurs littéraires des Arabes, furent naturellement des plagiaires. Ibn Koteiba cite Rabfa ben Makroûm Dabbî, 'Adi ben Zeid, Abou Nowâs. Mais il faut mettre en tête de la liste le poète Hassan ben Thâbit. Une étude attentive de son dîwân montre d'étranges analogies avec celui de Nâbiga. Ce serait excéder les limites d'un tel travail que de rapporter ici les nombreux passages qui pourraient être incriminés.
Les destinées du dîwân que nous publions pour la première fois furent bien singulières. Écrit au nord de l'Arabie, il était déjà devenu presque introuvable en Syrie sous le khalifat de 'Abdou'lmalik ben Marwân. Nous le retrouvons, à peu près à la même époque, en Perse, dans le Khorasan, où il avait pour lecteur un certain Djoneid ben 'Abd errahmân. Mais c'est en Espagne, dans cette nouvelle péninsule arabe, que le poète de la Syrie devait trouver des lecteurs, des copistes et des commentateurs. Le Diwân des six poètes, le plus important et le plus ancien monument de la vieille littérature arabe, n'a pu trouver dans tout l’Orient musulman un cheikh qui lui donnât la préférence sur les œuvres des poètes abbasides ou sur les élucubrations plates des modernes. Puissent ceux qui liront le Diwân de Nâbiga dans la patrie du poète ou parmi nous, avoir autant de plaisir à l'étudier que j'en ai eu à le traduire!
Nâbiga Dhobyânî dit pour célébrer Nomân ben Moundhir et pour se justifier auprès du roi des calomnies que les Bènou Korei' avaient répandues, en dépeignant sous de fausses couleurs les rapports du poète avec Moutadjarrada :
O demeure de Meyya, qu'on voyait sur le sommet, puis sur le versant de la montagne! Elle est déserte! et les années ont passé sur elle bien longues!
Je m'y suis arrêté un instant au déclin du jour pour l'interroger. Elle a été impuissante à me répondre, dans toute l'habitation il n'y avait personne.
J'ai retrouvé seulement les pieux pour les chevaux, et j'ai eu bien de la peine à les reconnaître, et j'ai retrouvé le fossé semblable à une citerne creusée dans un sol vierge, dans une terre rocailleuse.
La vieille servante avait rendu au fossé ses bords, et l'avait ensuite consolidé à coups de pelle au milieu de l'humidité.
Elle avait déblayé la voie encombrée où le cours du torrent était emprisonné, et en avait, élevé les rives jusqu'aux deux rideaux et au garde-meuble placés à l'entrée de la demeure.
Cette demeure, elle a été abandonnée un soir; un soir ses habitants ont émigré, et elle a été frappée par le même ennemi qui a frappé Lobad.
Mais détourne les yeux de ce que tu vois, puisque le passé ne peut revenir, et relève les bois de la selle sur une chamelle pétulante et robuste comme l'onagre,
Atteinte par une masse compacte de chair, et dont les dents de devant laissent entendre un grincement comme celui de la poulie par le frottement de la corde.
On aurait dit que lorsque la fin du jour me surprit au milieu des plantations de djalil, ma selle reposait sur un animal effarouché, qui vit dans la solitude,
Un animal sauvage de Wadjra, aux jambes tachetées, aux flancs minces et effilés comme l'épée de choix d'un bon armurier.
Un nuage, parti d'Orion, avait dirigé contre lui sa course nocturne, tandis que le vent du nord lui lançait sa charge de grêle.
Effrayé par la voix du chasseur, il a passé une nuit comme la lui souhaitent ses ennemis, tant il était accablé par la crainte et par la violence du froid !
Le chasseur a lancé sa meule ; mais lui, il s'est confié à la légèreté de ses chevilles, pures de tout défaut.
Le chien Domrân, excité par son maître, a eu beau lutter comme le soldat courageux sur le champ de bataille ;
D'un coup de corne l'animal poursuivi a atteint et traversé l'épaule de son adversaire, frappant comme frappe le vétérinaire pour guérir une jambe malade.
On dirait, en voyant la corne sortir de l'autre côté, une broche oubliée par des buveurs dans le morceau de viande qu'ils font rôtir.
Domrân cherche à mordre l'extrémité de la corne et se replie pour en atteindre le bois noir, raide et qu'aucun effort ne peut fléchir.
Lorsque le chien Wâchik voit que son compagnon a été renversé et qu'il n'y a aucune voie ouverte ni pour obtenir une rançon, ni pour exercer le talion.
Il se dit à lui-même : « Je ne verrai donc pas ce que je désirerais tant voir! Ton ami lui-même n'a pu ni échapper ni saisir sa proie. »
Ainsi vigoureuse; et bouillante, ma chamelle me conduira vers Nomân, ce prince qui répand ses bontés sur tous, de près et au loin.
Parmi les hommes, je n'en vois aucun dont les actions puissent être comparées aux siennes, et je n'en excepte pas un,
Si ce n'est le roi Salomon; en effet, c'est à lui que Dieu a dit : « Lève-toi au milieu des créatures et délivre les de l'erreur,
« Emprisonne les démons, auxquels j'avais permis de bâtir Tadmor avec des dalles et des colonnes. »
O Nomân! que celui qui t'obéit soit récompensé dans la mesure de son obéissance, et dirigé dans la bonne voie;
Que le rebelle soit poursuivi avec un acharnement qui détourne le méchant de son iniquité; mais réserve ta rancune
Pour tes pairs, ou bien pour celui que tu dépasses comme le cheval vainqueur à la course dépasse celui qui vient second.
C'est Nomân qui a confié à une chamelle légère, suivie de ses gracieux petits, des présents tels que l'avare n'en confiera jamais;
C'est lui qui donne jusqu'à cent têtes de bétail, parmi les animaux dont le sadân de Toûdih embellit les poils touffus comme la crinière d'un lion;
Et aussi des chamelles blanches domptées, aux jarrets tordus, et qu'on a chargées des selles neuves de Hîra;
C'est lui qui donne de jeunes esclaves relevant avec leurs pieds les pans de leurs manteaux, rafraîchies par le sommeil de midi, et que l'on prendrait pour des gazelles au désert ;
C'est lui aussi qui donne des chevaux qui, dans leur impétuosité, s'emportent malgré le frein des rênes, semblables aux oiseaux quand ils veulent échapper à l'averse glaciale.
O Nomân, porte un jugement comme la fille de la tribu, lorsqu'elle vit les colombes à la recherche des eaux voler vers l'abreuvoir.
Elles étaient pressées entre les deux côtés de la montagne, et pourtant elle les suivit d'un œil pur comme le cristal, et pour lequel les collyres ne furent jamais réclamés par la maladie.
Elle dit: « Plût au ciel que ces colombes fussent à nous, et la moitié en plus, sans compter notre colombe, je m'en contenterais. »
On les a recomptées, et l'on a trouvé que son calcul était exact : quatre-vingt dix-neuf, ni plus, ni moins.
Sa colombe complétait la centaine; en un moment, elle avait calculé ce nombre.
Non, par la vie de celui, dont j'ai parcouru la Kaaba, par le sang, répandu qui s’est figé sur les pierres sacrées ;
Par celui qui donne la sécurité à ces oiseaux réfugiés dans son asile, que caressent les cavaliers de la Mecque entre Gueil et Sa'ad,
Je n'ai proféré aucune des paroles mauvaises qu'on t'a rapportées; si je mens, que ma main ne puisse plus même soulever mon fouet jusqu'à moi!
Il n'y a eu que propos de gens de rien, propos dont j'ai souffert, et qui sont tombés comme un coup sur mon cœur.
J'ai été averti qu'Abou Kâboûs me poursuit de ses menaces; quel repos peut-on goûter, quand le lion rugit?
Un moment de répit, ô prince, dont je voudrais racheter la vie au prix de celle de tous les hommes, et de tout ce que je possède de biens et d'enfants !
Ne me frappe pas de ta puissance sans égale, quand bien même mes ennemis t'obséderaient pour t'en traîner.
Jamais l'Euphrate, alors que, par le souille agité des vents, ses vagues lancent sur les deux rives leur écume,
Et qu'il est grossi par tous les torrents qui débordent avec fracas, entraînant avec eux des amas d'arbustes et de branchages,
Alors que le nautonier effrayé se cramponne au gouvernail après les heures de souffrance et d'angoisse,
N'est à aucun jour plus grandiose que Nomân, lorsqu'il répand ses libéralités sans que les présents du jour nuisent à ceux du lendemain.
Cet éloge, puisses-tu l'entendre d'une oreille favorable! Je ne te l'ai pas offert, ô prince! pour être comblé de bienfaits.
Ce n'est qu'une excuse; si elle n'est pas accueillie, celui qui te l'a présentée est à jamais voué au malheur.
Et il dit encore :
Il n'y a plus de trace de Dhoû Housâ, qu'habitait Fartanâ, ni des tertres élevés, ni des deux bords de l'Arîk, ni des torrents qui se précipitent,
Ni du point de rencontre des sentiers; les étés et les printemps, qui y ont passé depuis, en ont détruit les derniers vestiges.
Et cependant j'ai cherché à me représenter les signes qui pouvaient me rappeler ces lieux, et je les ai reconnus après six ans, car celte année-ci est la septième.
Que j'ai peine à distinguer les cendres noircies comme un collyre, et le fossé ébréché et peu profond comme une citerne délabrée !
On dirait que les vents déchaînés, en laissant traîner leurs queues sur la poussière, y ont dessiné une de ces nattes habilement tressées par des artistes,
Qu'on expose sur un tapis de cuir aux courroies neuves, et qu'un marchand promène dans la foire aux parfums.
Je parvins à retenir, à refouler mes pleurs; déjà ma poitrine était inondée par les larmes qui coulent en abondance, ou s'échappent goutte à goutte.
Je reprochai à mes cheveux blancs tant de pétulance juvénile, et je dis: « Ne pourrai-je pas me corriger de ce qu'interdit la vieillesse ? »
Une autre inquiétude s'est abattue sur mon cœur et l'a envahi comme une maladie que cherchent à guérir des mains habiles.
Une menace d'Abou Kâboûs, dont j'ignore les motifs, est venue m'atteindre à travers Râkis et les autres vallées tortueuses qui nous séparent,
Et j'ai passé une nuit comme si j'avais été attaqué par un serpent mince et tacheté, dont les dents renferment un venin pénétrant.
Même pendant les plus longues des nuits, on tient éveillé le malheureux qui a été mordu, grâce à de petites clochettes, ornements de femme, que ses mains font résonner.
Les enchanteurs cherchent à conjurer les effets dangereux du poison ; tantôt le mal laisse du répit au malade, et tantôt il revient à la charge.
On m'a appris que tu m'as blâmé, ô prince ! C'est là une nouvelle à laquelle mes oreilles ne veulent pas ajouter foi.
Tu aurais dit : « Je finirai par l'atteindre. » Quoi de plus terrible qu'une telle parole venant d'un homme puissant comme toi ?
Par ma vie, et je ne fais pas bon marché de ma vie, il n'y a que mensonges dans tout ce qu'ont dit contre moi les Bènou Korei'.
Les Bènou Korei' ben 'Auf (et ce sont eux seuls que j'ai ici en vue), avec leurs faces de singe, sont toujours en quête de victimes pour leurs calomnies.
Il est venu vers toi un homme qui cache dans son cœur une haine violente contre moi et qui s'est associé un autre ennemi animé des mêmes sentiments;
Il est venu vers toi, te rapportant des paroles d'un tissu léger, des paroles mensongères; mais il ne t'a pas rapporté la vérité, qui est unie et claire;
Il est venu vers toi, te rapportant des paroles que je n'aurais pas prononcées quand bien même on chargerait mes bras de chaînes.
Je jure, et puissé-je ne laisser dans ton âme aucun doute! D'ailleurs un homme qui a une religion et qui l'observe se rendrait-il jamais coupable d'un faux serment?
Je jure par les chamelles assemblées de Lasâf et de Thabra, qui visitent le mont Ilâl dans leur course effrénée,
Qui, rapides comme le samâm aux yeux enfoncés, rival des airs, abandonnent sur le chemin plus d'une de leurs compagnes épuisées.
Et portent leurs cavaliers couverts de poussière et empressés pour le pèlerinage, sur leurs dos recourbés comme les extrémités des arcs;
Certes tu as fait peser sur moi la faute d'un coupable que tu as laissé en liberté, comme si pour un chameau galeux on en brûlait un autre, et le malade, on l'envoyait en pâturage.
Si je ne puis arriver à convaincre de mensonge mon ennemi, si je proteste en vain de mon innocence,
Si aucune de mes paroles ne trouve créance auprès de toi, et que sans hésiter tu persistes dans la voie où tu t'es engagé,
Alors, comme la nuit, tu m'atteins quand même je m'imaginais qu'une grande distance nous séparait.
Je suis entraîné vers toi par des crocs de fer recourbés attachés à des câbles puissants que tendent des mains vigoureuses.
Tes menaces iront-elles chercher un serviteur qui n'a jamais trahi sa foi, pour laisser en repos un serviteur infidèle qui a failli,
Toi qui es le printemps dont les bienfaits soutiennent les hommes, et l'épée tranchante à qui la mort a prêté sa puissance?
Dieu n'aime que sa justice et son équité; pour lui le mal n'est pas le bien, et une bonne action n'est jamais perdue.
Puisses-tu te désaltérer tant que tu voudras une coupe toujours pleine, aux bords de laquelle le musc s'attache!
Et il dit encore :
Laisse-moi, Omeima, au souci qui m'accable, laisse-moi aux tourments d'une nuit dont les étoiles avancent lentement,
Et qui s'est prolongée au point que je me suis dit : « Elle ne finira pas, et le pasteur des étoiles ne rentrera pas aujourd'hui. »
Laisse-moi, Omeima, avec un cœur dans lequel la nuit a fait rentrer les soucis qui s'en étaient éloignés et où la tristesse a redoublé de toute part.
Que de fois 'Amr et avant lui son père ont répandu sur moi leurs bienfaits, qui ne pincent pas comme les queues de scorpions.
Je le jure (et mon serment n'admet aucune réticence), je le jure, et toute ma science repose sur la bonne opinion que j'ai de mon maître;
Aussi vrai qu'il a deux tombeaux de famille, l'un à Djillik et l'autre à Seidâ, près de Hârib;
Aussi vrai qu'il descend de Hârith le Djafnite, le chef de sa race, certes il ne manquera pas d'attaquer avec son armée la résidence de son adversaire.
J'ai foi en sa victoire, puisqu'on a dit que des armées de Gassân, sans mélange, se sont mises en marche.
Ses plus proches cousins et 'Amr ben 'Amir. voilà des hommes dont la valeur ne ment pas.
Lorsqu'ils partent avec leurs troupes, on voit planer au-dessus de leurs têtes des bandes d'oiseaux, montrant le chemin à d'autres bandes;
Elles les accompagnent, et s'élancent quand ils s'élancent; elles aiment la vue du sang et y sont aguerries.
Regarde-les comme elles sont là derrière les combattants, clignant de l'œil, immobiles comme les vieillards dans leurs manteaux en poil de lièvre.
Penchées sur le champ de bataille, elles ont la certitude que la tribu de Gassân sera la première à l'emporter quand les deux armées seront en présence.
C'est qu'elles sont habituées à ces peuples, et qu'elles les ont reconnus aux lances de Khatt qu'ils ont mises en arrêt sur le cou de montures
Endurcies à la lutte, gardant leur maintien sévère, malgré des blessures saignantes ou fermées par une croûte.
Lorsque les guerriers sont appelés à en descendre pour le combat, ils courent tous à la mort comme des chameaux jeunes et fringants;
Ils font circuler à l'envi la coupe du trépas; dans leurs mains sont des épées brillantes aux pointes acérées.
Il n'est pas de casque qui dans la mêlée ne vole en éclats et qui n'aille rejoindre les cartilages arrachés au-dessous des sourcils.
Ils sont sans reproche, mais leurs épées ont reçu des entailles par suite du choc des bataillons.
Transmises comme un héritage depuis la journée de Halîma jusqu'à ce jour, elles ont été éprouvées dans toute occasion ;
Elles transpercent la cuirasse saloûkite aux doubles mailles, et elles allument sur le rocher étincelle comme celle d'Elhoubâhib ;
Elles portent des coups d'estoc et de taille, qui séparent les têtes de leurs assises et font jaillir le sang comme l'urine des chamelles grosses qui se défendent de leurs mâles par des ruades.
Ces mêmes héros ont une générosité naturelle, comme Dieu n'en a donné à personne autre, et leur bienveillance n'est jamais absente.
Leur pays est tout plein de Dieu ; leur religion est solide, et ils ne craignent rien excepté, les châtiments de la vie future.
Chaussés de sandales légères et parés de belles ceintures, ils sont salués avec des brancb.es odorantes au jour des Rameaux.
Les blanches esclaves de leur tribu viennent les saluer, laissant leurs costumes de soie rouge suspendus aux porte-manteaux.
Ces hommes conservent la beauté primitive de leurs corps, grâce à des vêtements dont les manches unies prennent une couleur foncée en arrivant aux épaules.
Ils ne croient pas au bien sans un mal à la suite, et ne croient pas non plus au mal frappant sans relâche.
J'ai dédié ces vers à Gassân, bien que je sois resté attaché à mes compatriotes, alors même que les voies se sont resserrées autour de moi.
Et il dit encore :
Je sais, comme si j'avais été là auprès de Nomân, qu'un de ses familiers lui a rapporté une nouvelle qui n'a pas été démentie.
Hisn et une tribu des Bènou Asad se seraient levés et se seraient écriés: « Qu'on n'aille pas s'approcher de nos frontières ! »
Ils avaient perdu la raison; tant les avait éblouis l'art du Ma'addite pour conduire les troupeaux et leur chercher au loin des pâturages !
Mais voici que Nomân a entraîné à sa suite les nobles montures de Djaulân, qui bravent les chaleurs de l'été, aussi bien les montures dont le sabot retentit quand on les pousse en avant que celles qui sont tenues en laisse,
Jusqu'à ce qu'elles aient demandé un asile chez les hommes de Milh, où elles goûtent pour la première fois les délices d'un sommeil que n'ont point interrompu les courses nocturnes.
Elles suent comme ces grandes outres qu'on a liées avec des cordes après les avoir remplies, et laissent couler une eau qui ne se boit pas.
Leur corps élancé les fait ressembler, quand elles trottent sous l'impulsion des rênes, aux mâles des autruches, dont les jambes toutes rouges sont à leurs extrémités recouvertes d'un léger duvet.
Leurs cavaliers, les cheveux en désordre, les narines gonflées, allument partout la guerre, les vieillards aussi bien que les jeunes gens.
Il n'y a plus de repos pour Hisn-, il est sans cesse réveillé par les cris d'une tribu qui vient d'être dépouillée sur les bords des Amrâr.
On voit maintenant des bandes de chameaux en grand nombre campées près de la croix élevée sur la Zaurâ.
Puisque tu as échappé par la faveur divine au péril qui te menaçait, cherche un refuge, ô Fazâra, sur les montagnes et dans les plaines aux pierres noires ;
Et ne va pas au-devant du malheur, comme l'ont fait les Bènou Asad; car leur ennemi a lancé contre eux ses redoutables averses.
Personne ne survécut excepté des fuyards, dont le salut n'était même pas encore assuré, ou des prisonniers attachés avec des courroies et dépouillés de leurs armes,
Ou des nobles femmes, belles comme les vaches du désert, qui, enchaînées au-dessus des poignets et des chevilles,
Appelaient les Bènou Kou'ein à leur secours, quand déjà le fer avait mordu dans leur peau, comme le thikâf dans les lances les plus dures.
Les Bènou Kou'ein, lorsqu'ils cherchèrent à se rallier, n'ont plus rencontré dans leurs demeures que le cri de détresse de Soû', de Dou'mî et d'Eyyoûb.
Et il dit encore :
On m'a plus d'une fois répété que Zour'a (et la folie vaut ce qu'elle vaut) envoie à mon adresse les plus étranges poésies.
J'ai juré, ô Zour'a ben 'Amr, que je serais de ceux dont l'approche est pénible à un ennemi.
Te souviens-tu du jour de 'Okâth, alors que tu me rencontras tout poudreux et que tu ne pouvais fendre ma poussière ?
Nous nous sommes partagé les rôles : moi, j'ai pris la Fidélité, et toi tu t'es choisi la Trahison.
Puissent des poèmes t'atteindre, et des armées pousser en avant contre toi les devants de leurs selles !
Qu'on y trouve les Bènou Koriz, attachant leurs cuirasses aux sangles de leurs chameaux, et la tribu de Rabî'a ben Houdhâr;
Et les gens de Harrâb et de Kadd, dont la gloire est ainsi posée que jamais leur corbeau n'est réduit à s'envoler;
Et les Bènou Kou'ein, qui, n'en doute pas, viendront contre toi sans se rogner les ongles,
Infectés par le fer rouillé de leurs armes, semblables sous leurs cottes de mailles aux Djinn de Bakkâr;
Et aussi les Bènou Souwâ'a, qui te rendront visite en députant vers toi une armée que conduira Abou 'l-mithfâr ;
Et avec eux les Bènou Djadhîma, une tribu loyale, des princes qui règnent depuis Khabt jusqu'à Tïchâr,
Qui campent à la fois aux deux côtés de 'Okâth, tandis que leurs enfants crient 'Ar'âri en jouant ;
Des hommes qu'on voit, alors que le tumulte guerrier est à son comble, demeurer fermes à leur poste au jour de la terreur et de la déroute;
Et aussi les Gâdirites, qui vont planter leurs drapeaux dans des positions solides,
Portés sur des chamelles blanches, dont les selles ressortent comme une masse de sang répandue sur les dos d'une troupe de vaches sauvages.
Ils serrent entre leurs jambes les extrémités des selles 'ilâfites, et pendant ce temps les femmes chastes restent abandonnées comme aux jours d'impureté,
Laissant passer leurs mains à travers les bracelets, et ne se montrant que par les ouvertures pratiquées dans les vêtements rayés du Yaman et derrière leurs voiles.
Pures, elles ne laissent pas troubler leurs nuits d'abstinence et défient les soupçons du mari le plus méchant et le plus jaloux.
Une telle réunion de guerriers changerait un vaste champ de bataille en un défilé étroit, et laisserait derrière elle les collines comme si elles étaient des plaines.
Jamais ils n'ont été privés de la meilleure des nourritures, et leurs mères ont enfanté contre toi de nombreux enfants, tous mâles.
Autour de moi sont les Bènou Doûdân, qui ne me trahiront pas, et les Bènou Baguîd, tous mésalliés.
Zeid ben Zeid domine à Ourâ'ir, et sur les bords du Kouneib règne Mâlik ben Himâr ;
A Roumeitha domine Soukein, et à Dotheina les Bènou Seyyâr.
Ces peuples élèvent des montures, filles de 'Asdjadî et de Lâhik, aux flancs poudreux, quand elles quittent le pâturage,
Alors que le ya'did coule encore sur les coins de leurs lèvres, et que leurs narines sont jaunies par le djardjâr.
Elles sont appelées à suivre leurs mères, qui accourent empressées comme les mères des animaux féroces quand, après n'avoir mis bas qu'une fois, elles perdent leurs petits.
Certes Roumeitha peut compter sur nos lances pour défendre ce qu'il renferme de plantes humides ou sèches.
Déjà nos cavaliers ont atteint des jeunes filles dans leur sécurité, et aussitôt ils leur ont fait prévoir le idhâr.
Et il dit encore :
Sou'âd s'en est allée, et un matin tout lien avec elle a été rompu : elle s'est fixée à Char' et dans les vallées de Idam.
Elle est de la tribu de Yalî et, quand mon cœur s'est épris d'elle, c'était de la folie, c'était une vision de mes rêves.
Quand elle se retournait, elle n'était pas de celles qui montrent un talon noir, et elle ne vendait pas aux deux côtés de Nakhla les chaudrons de pierre.
Blanche de peau, c'était la beauté la plus parfaite d'entre tous les êtres qui marchent sur terre ; c'était la personne la plus délicieuse avec qui tu eusses jamais causé.
Elle a dit : « Je te vois déjà devenu le frère de la selle et de la monture sellée ; tu trouveras sur ton chemin dos dangers qui ne te laisseront pas atteindre le tempe de la vieillesse. »
Adieu, ma belle! car pour nous, notre rôle n'est pas de folâtrer avec les femmes, car la religion a ses rigueurs,
Nous avançons rapidement, lâchant la bride à des chamelles aux yeux enfoncés, espérant en Dieu, espérant accomplir les actes de piété, et obtenir la nourriture de chaque jour.
Que ne demandes-tu aux Bènou Dhobyân ce que je vaux, alors que la fumée enveloppe l'homme aux cheveux gris, qui, par avarice, s'abstient du meisir.
Et que le vent souille dans la direction de Dhoû Ouroul, poussant en avant, sur le soir, ses troupeaux de nuages,
Alors qu'ils répandent de côté leurs ombres pourprées sur le Tîn, et poussent à leur tour d'autres nuages glacés, qui ont perdu leur eau?
Tu ne trouveras pas chez eux un homme d'honneur ni un homme de savoir qui ne te dise, s'il est vrai qu'il y a une différence entre celui qui ignore une chose et celui qui la sait,
Que je complète les parts de ceux qui jouent avec moi au meisir, que je leur donne ce qui reste après le partage, que je couvre de nourriture les grands plats,
Et que je fends la vaste plaine sur une chamelle folle, qui après la fatigue a commencé à gémir sur sa lassitude et son dégoût.
Elle a failli me faire tomber ma selle et mon coussin à Dhoû'lmadjâz, et pourtant elle n'y avait pas flairé de chameaux ;
Mais c'est qu'elle avait entendu la voix de la Mecquoise qui disait au moment du départ : « Y a-t-il parmi vos cavaliers légers quelqu'un qui achète des peaux? »
Je lui criai, alors qu'elle courait sous le poitrail de ma chamelle : « Gare! qu'elle ne t'écrase pas ! d'ailleurs le marché est clos. »
Ma chamelle, après avoir reposé pendant trois nuits, en a passé une quatrième à Dhoû 'lmadjâz pour observer le campement dispersé.
Déjà, quand la colonne de l'aurore s'est entrouverte, elle trottait comme une ânesse qui craint le chasseur avide de viande,
Et elle s'écartait de l'astan aux extrémités noires, ressemblant dans sa course aux servantes qui au matin portent leurs fagots,
Ou bien encore au taureau sauvage de Haudâ, lorsqu'il veut entrer en baissant la tête pour prendre ses quartiers par une nuit de djoumâdâ qui distille une pluie fine :
Il a pris ses quartiers sur des monceaux de sable aux pieds du Bakkâr, qui le repousse; et, toutes les fois qu'il veut y jeter un regard furtif, le sol s'éboule sous ses pas ;
Il a exposé au vent ses cornes et son front comme le forgeron quand il s'incline pour souiller sur les charbons,
Jusqu'au matin où il s'est élancé, rapide comme la pointe d'une épée, pour rechercher les plaines caillouteuses et les collines de Loubnân.
Et il dit, en apprenant que Nomân était malade :
Je t'ai caché une nuit d'insomnie passée à Djamoûmein, et deux soucis, l'un apparent, l'autre dont je fais mystère,
Les accidents d'une âme qui se plaint du mal qui la trouble et des soucis dont elle est abreuvée, sans y trouver aucune issue.
Mon âme me presse avec instance d'imposer sa volonté au destin; a-t-elle donc trouvé jusqu'ici un arbitre du destin?
N'a-t-elle pas vu le plus parfait des hommes, porté sur une litière par des jeunes gens, parcourir la tribu dans une promenade matinale ?
Et nous étions sur son chemin, demandant à Dieu de prolonger ses jours, de nous rendre à nous un roi, à la terre un civilisateur.
Nous espérions fermement le conserver si notre flèche remportait; mais nous craignions que la flèche de la mort ne vînt se mettre de la partie.
A toi le bonheur! mais nous craignons que la terre ne recouvre tes cendres, ô homme unique, et que la fortune dus hommes ne se mette à chanceler et à trébucher;
Qu'on ne renvoie les montures de ceux qui te cherchaient et qu'on ne desselle tes chevaux dont le temps n'usera plus le sabot.
Je t'ai vu m'observer d'un œil attentif, et mettre en campagne des hommes pour me garder et me surveiller.
C'est qu'on avait mis dans ma bouche certaines paroles, et que mes ennemis t'avaient fait part en secret de leurs calomnies.
Je le jure, je ne paraîtrai pas devant toi, si je dois paraître en accusé, et je ne chercherai pas de patron, si tu ne veux être mon protecteur.
Mais que ma famille entière serve, s'il le faut, de rançon pour racheter la vie d'un prince qui, si je venais à lui, accueillerait favorablement mon éloge, et boucherait les trous de ma misère.
Je musellerais mon chien dans la crainte que son aboiement ne troublât ton repos, quand bien même je serais établi à Mashoulân ou à Hâmir,
Et que mon habitation serait placée sur des hauteurs inaccessibles, où le berger, en faisant paître ses bêtes de somme, ressemblerait à un oiseau planant dans les airs,
Où les chèvres, si habiles à grimper les rochers trébucheraient sur les versants, et où, à midi même, les pointes disparaîtraient confondues avec les nuages,
Comme si là encore je craignais d'être contraint à me soumettre avec mes femmes, et que je voulusse leur donner la certitude de mourir libres.
Et quand bien même ma demeure serait très éloignée de toi, je dirais encore à tout voyageur que je rencontrerais venant de Ma'add :
« Conduis-moi vers Nomân ; peu m'importe où je me rencontrerai avec lui. Puisse Dieu lui amener les pluies du matin,
« Et la victoire le saluer dès l'aurore, sans que sa gloire cesse de briller au-dessus de tous les hommes qui passent!
« Puisse Dieu répandre sur lui ses meilleurs bienfaits et être son allié contre tous ses adversaires ! »
Car j'ai trouvé un jour qu'il est la perte de son ennemi, mais aussi qu'il est une mer de générosité sur laquelle se balancent légèrement les vaisseaux.
Et il dit pour s'excuser auprès de Nomân et pour le louer :
On m'assure que tu m'as blâmé, ô prince, et voilà ce qui cause mon souci et mon accablement.
Aussi ai-je passé une nuit comme si les femmes qui visitent les malades m'avaient préparé une couche d'épines, plus élevée et plus en désordre que ma couche ordinaire.
Je le jure, et puissé-je ne laisser subsister aucun doute dans ton âme, aussi vrai qu'après Dieu il n'y a plus de recours pour l’homme,
Si l'on t'a rapporté que je t'ai trahi, le délateur qui t'a fait un tel rapport est un fourbe et un menteur.
Pour moi, j'ai été de ceux qui avaient un coin de 5 terre où il leur était permis de se mouvoir et de se retirer librement.
Rois et sujets, toutes les fois que je venais à eux, me prenaient comme arbitre de leurs biens et me traitaient d'égal à égal,
Comme tu fais à l'égard de ceux que je te vois combler de bienfaits, et tu n'as jamais considéré comme une faute la reconnaissance qu'ils te témoignent.
Ne me laisse pas sous les coups de ta menace, pour que je ne sois pas parmi les hommes comme un chameau galeux enduit de poix liquide.
Ne sais-tu pas que Dieu t'a donné un degré de puissance tel que tu peux voir à tes pieds tous les rois s'agiter vainement?
Car tu es un soleil, et les rois sont des étoiles; quand le soleil se lève, on ne voit plus aucune de ces étoiles.
Jamais tu n'as laissé un frère égaré sans venir à son secours. D'ailleurs, quel homme est parfait?
Si je subis une injustice, c'est un esclave que tu auras atteint; mais si tu pardonnes, le pardon convient à un homme tel que toi.
Et il dit encore :
J'ai détourné les Bènou Dhobyân de Oukour, où chaque année au printemps ils prenaient leurs quartiers pendant le safar.
J'ai dit : « O mes compagnons, déjà le lion s'est replié sur ses griffes, prêt à bondir. »
Puissé-je ne jamais voir le moment où nos vaches aux yeux sombres, dont les rejetons ressemblent aux brebis de Douwwâr,
Regardant du coin de l'œil l'homme qui doit arriver de côté, tandis que leurs visages reflètent le mépris de la servitude et l'amour de la liberté;
Et ne se sentant pas derrière les mercenaires assez protégées contre tout acte criminel, se cramponneront aux bâts et aux selles des chameaux ;
Et où, répandant des pleurs qui tombent sur leurs lèvres, elles mettront toute leur espérance dans l'arrivée de Hisn et d'Ibn Seyyâr!
Si je rencontre de la résistance, je pourrai du moins me réfugier dans les défilés de la montagne et sur les deux versants de Harrat ennâr,
Ou bien je dresserai ma tente dans un pays noir, obscur, où l'âne même est arrêté, et où le voyageur ne chemine pas.
Une telle retraite nous défendra contre l'injustice des hommes, et elle sera appelée oammou 'ssabbâr (la mère des rochers).
Car c'est lui qui a poussé en avant les roufeidât de Djauch et de 'Itham, et il y a mêlé des hommes des tribus de Rib'î et de Hadjdjâr,
Deux héros de Koudâ'a, qui se sont établis autour de sa résidence, et qui lui ont fourni chefs et soldats.
Aussi est-il monté à la tête d'une année sans égale, qui chasse les bêtes féroces de la plaine, et dont les rangs sont serrés;
Qui ne baisse pas la voix pour cacher ses positions dans un pays où elle campe, et qui garde ses feux dont la clarté empêche le voyageur de s'égarer.
Les Bènou Dhobyân m'ont reproché la crainte qu'il m'inspire. Y a-t-il donc pour moi quelque honte à te craindre?
Et Badr dit, répondant à Nâbiga :
Va dire à Ziyâd, car le destin réservé à tout homme finit par l'atteindre, en dépit de son habileté et des précautions qu'il peut prendre :
Le besoin de la défense t'a fait quitter Leila pour Barad, que tu as préféré comme refuge à Djouchch A’yâr.
J'ai fini par rencontrer celui qui est à l'abri du reproche, à la tête d'une armée qui chasse les passereaux ainsi que les corbeaux, et dont les rangs sont serrés.
Il n'est que temps de songer aux tribus que tu as trompées, aux Bènou Dibâb, et de laisser Ibn Seyyâr.
Car il est devenu le représentant d'une tribu, à la tête de laquelle il est arrivé, et il a donné la liberté à tous ses prisonniers de Dhoû 'lkâr.
Et Nâbiga reprit, répondant à Badr :
Eh bien! qui donc ira dire en mon nom à Khoreim et à Zabbân, lui qui n'a pas fait attention que je suis son parent par alliance :
« Défiez vous de ces âpretés sanglantes, dont la brûlure est comme celle des charbons ardents.
« Pour moi, j'ai appris comment vous avez agi, et quelle importance vous avez donnée à la poésie de Badr.
« Et pourtant ce n'était pas à vous qu'il appartenait de me repousser, quand nous étions séparés par un pays éloigné et par la terre de Hadjr. »
Aussi ma réponse est-elle pour toujours fixée au milieu de vos personnes et de vos biens.
Lorsque quelqu'un espère un accident pour autrui, le mal tombe sur son cousin avec la violence d'un mal qui n'est pas récent, mais invétéré,
Et Nâbiga dit encore :
Les Bènou ‘Amir nous ont crié : « Rompez avec les Bènou Asad. » Malheur à l'ignorance, l'ennemie des peuples !
L'expérience nous interdit de chercher à les remplacer, et nous ne voulons pas de rupture après une alliance solide.
Faites plutôt la paix avec nous tous, si vous y êtes disposés; mais ne nous parlez pas ainsi, ô Bènou 'Amir.
Pour moi, je crains bien pour vous que vous ne vous attiriez par la haine que vous leur portez une journée comme celles du passé,
Une journée où les étoiles paraissent que le soleil brille encore, où la lumière n'est pas une lumière, où les ténèbres ne sont pas des ténèbres;
Ou bien que vous n'excitiez des troupes compactes, sans égales, qui, comme la nuit, mêlent les masses aux masses,
Avec les anneaux de leurs cottes de mailles suspendues aux courroies de leurs selles, obéissant» des chefs qui ont les narines gonflées, qui frappent à la tête.
Leur drapeau est dans les mains d'un illustre héros, qui parcourt la plaine sans jamais baisser les yeux.
Il conduit des escadrons aux armures foncées, qui ne cherchent leur salut qu'en se précipitant à la mort sur leurs juments bridées.
Combien nos cavaliers n'ont-ils pas laissé sur le champ de bataille de vos mains et de vos pieds comme pâture pour les hyènes !
Que de femmes ils ont affligées par la perte de leurs maris, que d'orphelins ils ont faits, qui ne l'étaient pas auparavant!
Les cavaliers ennemis savent qu'en dépit de leurs évolutions nous sommes dans la lutte les arbitres du bien et du mal.
Ils ont fui, tandis que celui qui conduisait ce troupeau était renversé sur le front, au milieu des braves, et que son corps étendu sur le sol ruisselait de sang.
El il dit encore, au sujet des Bènou 'Amir :
Puissent les Bènou Dhobyân trouver avantage dans la situation de leur pays, isolé de tout parent et allié,
A l'exception des Bènou Asad, toujours près à le défendre chaque matin avec deux mille braves, couverts de leurs armes et de leurs cuirasses,
Montés sur des chevaux de la race de Wadjih et de Lâhik, dont ils dirigent les rejetons, grâce au fouet !
Ils brandissent des lances aux longues poignées avec des mains longues, dont les doigts sont décharnés à leurs extrémités.
Laisse à distance de toi, Zour'a, de tels hommes, qui sont sans reproche, et qui ont poussé la tribu des Abs dans le pays de Ka'âki',
Malgré les efforts des Bènou ‘Amir, qui ont levé la main pour lutter, semblables aux chamelles enceintes qui résistent à leurs mâles.
Pour moi, je ne désire rien de Sahm, ni aucun secours de Malik, ni de leur cousin 'Abd ben Sa'd,
Maintenant qu'ils se sont établis à Dhoû Dargad et à ‘Outâyid, où ils n'entendent d'autre chant que le coassement des grenouilles.
Assis devant leurs maisons, ils n'ont pas d'autre ambition. Puisse Dieu couper ces nez camus !
Et il dit encore :
Dois-tu quitter dès ce soir ou demain seulement la famille de Meyya, iras-tu saluer en toute hâte, ou préféreras-tu t'en dispenser?
Le moment du départ est imminent; seulement nos montures n'ont pas encore emporté nos selles; mais c'est tout comme.
Le corbeau a cru que nous partirions demain, et telle est la nouvelle qu'a annoncée le corbeau noir.
Qu'il n'y ait donc ni vœux, ni salut pour la journée de demain, si nous devons demain nous séparer des amis!
Il est temps de le mettre en route, et tu n'as pas encore dit adieu à Mahdad, toi qui te rencontrais toujours avec elle, matin et soir.
Mais il faut aller sur la trace d'une chaste beauté qui t'a visé avec sa flèche; ton cœur a été atteint; c'est tout, si elle ne t'a pas tué.
C'était alors assez pour elle, puisque sa tribu était voisine de la tienne, et qu'elle se rapprochait encore de toi par ses billets et ses témoignages d'amour.
Mais voici que la passion qu'elle t'inspire a percé ton cœur d'une flèche décochée par un arc sonore.
Elle a regardé avec la prunelle d'une jeune gazelle apprivoisée, au teint foncé, aux prunelles noires, parée d'un collier :
Une rangée de perles enfilées orne sa poitrine ; l'or y répand ses feux comme un tison allumé.
Son corps, enduit de safran, ressemble à un manteau à raies jaunes; sa taille est parfaite, on dirait une branche que sa hauteur a recourbée ;
Son ventre a des fossettes aux plis gracieux, et sa gorge, elle la soulève par une mamelle ferme ;
Ses reins sont lisses; elle n'a pas d'embonpoint; ses hanches sont pleines ; sa peau est souple et flexible.
Elle s'est levée et elle est apparue entre les deux pans d'un voile, comme le soleil au jour où il brille dans les constellations de Sa'd,
Ou comme une perle tirée de sa coquille, qui réjouit le plongeur, et dont la vue le pousse à remercier Dieu et à se prosterner;
Ou comme une statue de marbre que l'on a placée sur un piédestal bâti de briques et de terre cuite enduites de chaux.
Sans le vouloir, elle a laissé tomber sou voile; puis elle a cherché à le ressaisir, et s'est cachée de nous avec sa main,
Avec une main teinte, délicate, dont les doigts ressemblent aux tiges du 'anam, qu'on peut nouer, tant elles sont flexibles.
Elle t'a exprimé par le regard un désir qu'elle ne pouvait satisfaire, comme le malade quand il interroge les visages des visiteurs.
Ses lèvres, semblables aux deux plumes de devant de la colombe d'Eika, montrent des glaçons attachés à ses gencives enduites d'un fard noir.
On dirait la pariétaire au matin, après que la pluie a cessé, lorsque sa tige est déjà sèche en haut et que le bas est encore humide.
Le prince affirme que sa bouche est fraîche, qu'il est doux d'en recevoir un baiser, désirable de s'y abreuver;
Le prince affirme, et je n'en ai pas goûté, qu'il est doux d'en recevoir un baiser. Si par hasard j'en goûtais, je lui dirais : Encore.
Le prince affirme, et je n'en ai pas goûté, qu'elle guérit, par une salive parfumée, celui qui est altéré, celui qui souffre de la soif.
Les jeunes filles ont pris son collier pour y enfiler des perles qui se suivent sans rompre l'harmonie.
Si elle se présentait devant un moine aux cheveux blancs, qui sert Dieu par son abstinence et ses
Il serait fasciné par sa vue et par le charme de son langage, tout en s'imaginant suivre les voies de Dieu, au moment même où il les aurait quittées;
Par sa parole, dont les accents, si tu pouvais les reproduire, feraient descendre les chèvres sauvages de leurs collines au large plateau ;
Et par sa chevelure noire, épaisse, à la floraison luxuriante, comme la vigne, lorsqu'elle est penchée sur les étais qui lui servent d'appui.
Lorsque tu touches, tu touches à pleines mains un corps solide, large, qui remplit bien sa place;
Lorsque tu fais l'attaque, tu t'attaques à une hauteur dont les formes rebondies sont enduites de parfums;
Lorsque tu te retires, tu te retires d'un défilé aride avec l'effort de l'adolescent qui manie une corde solidement tordue.
Jamais celui qui descend pour s'abreuver en elle ne remonte, et jamais celui qui remonte ne cherche un autre abreuvoir.
Et il dit encore :
J'avais dit à Nomân, au jour où je l'ai rencontré à Bourkat Sâdir, se dirigeant contre les Bènou Hounn ;
« Laisse de côté les Bènou Hounn ; car lutter avec eux est toujours pénible, même pour toi, qui pourtant n'abordes jamais la lutte qu'en homme qui sait soutenir le combat. »
Nobles dans leurs présents, fils de Odhra, ils sont tellement généreux que, faire les plus grandes largesses, c'est pour eux comme avaler une bouchée.
Ce sont eux qui ont défendu Wâdî 'lkourâ contre leur ennemi, avec une troupe meurtrière pour l'ennemi qui veut se mesurer avec elle,
Qui ont protégé ceux' qui descendent s'abreuver dans la vallée, ceux dont la croupe se mouille avant que leur gorge se désaltère,
Ceux de Bouzâkha, qui agitent leurs longs filaments, comme voltigent les poils des jeunes chamelles, objet de convoitise des marchands,
Ceux dont les fruits ont de petits noyaux, une enveloppe solide et une écorce qui ne se détache pas, quand les autres dattes perdent la leur.
Ils en ont repoussé Balî, et le matin a lui pour Balî dans une vallée profonde du Tihâma.
Ils les ont défendus contre l'invasion de Koudâ'a tout entier et du rouge Modar.
I
ls ont violemment tué, à Hadjr, le Teyyite, le père de Djibir, et ils ont marié de nouveau la mère de Djâbir.Et il dit encore :
Puisse Dieu favoriser toujours les hôtes que j'ai quittés, qui brillent comme les lanternes dans l'obscurité des nuits!
Ils ne s'abstiendraient pas du meisir, quand bien même, au plus fort de l'hiver, l'horizon serait chargé de nuages stériles, desséchés comme des peaux.
Rois et fils de rois, ils surpassent les autres hommes dans l'adversité aussi bien que dans la bonne fortune.
Ils ont la douceur de ‘Ad; leurs personnes sont pures de toute rébellion, de toute souillure et de toute faute.
Et il dit encore :
Rassemble à grand-peine ton Mahâch, ô Yazid ; pour moi, j'ai déjà mis sous les armes à votre intention les tribus de Yarboû et de Tamîm;
Et j'ai revendiqué l'origine dont tu m'as fait un crime, tandis que tu reniais la tienne, qui te semblait trop méprisable.
Tu m'as fait un crime de ne pas compter de nobles parmi mes ancêtres; mais c'est pure vanité d'orgueilleux, de vouloir passer pour noble.
Toutes les tribus de Thinna m'ont témoigné de l'inclination, que je me présente, au milieu d'elles, en oppresseur ou en opprimé ;
Et sans les Bènou 'Auf ben Bouhtha, la mère des enfants de ton père serait restée stérile sur un plateau de la montagne.
Et il dit encore :
Fais savoir aux Bènou Dhobyân que je ne les confondrai plus avec 'Abs, maintenant qu'il va s'établir sur les hautes montagnes et aussi à Athlam,
Avec une armée, qui a l'éclat et la couleur blanche du granit, qui peut montrer dans ses rangs Zoheir et Hidhyama.
Ils descendent s'abreuver aux citernes de la mort, lorsque le brave est contraint de s'y abreuver.
Et il dit encore :
Je t'en conjure, dis-moi si on porte le prince sar la litière.
Je ne t'accuse pas de m'avoir interdit l'entrée; mais que se passe-t-il derrière toi, ô 'Isâm ?
Si Abou Kâboûs meurt, les hommes perdront leur printemps, et l'année son mois sacré,
Et, après lui, nous ne tiendrons plus que la queue d'une vie qui sera comme une chamelle au dos aplati, qui n'a pas de bosse.
Et il dit encore :
Lorsque Nomân reviendra, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse; car Ma'add retrouvera sa puissance et son printemps.
La royauté et la puissance reviendront à Gassân : ce vœu, puissions-nous le réaliser!
Mais si Nomân vient à mourir, on dessellera les montures et on jettera du côté de la cour leurs caparaçons;
Une femme chaste poussera à la fin de la nuit des soupirs à se rompre, ou peu s'en faut, la poitrine,
Pour pleurer le meilleur des hommes, qu'elle ait perdu son époux, ou qu'elle l'ait encore près d'elle, partageant sa couche.
Et il dit encore :
Si 'Amir a parlé sottement, c'est que la jeunesse fait supposer la sottise.
Sois donc comme ton père ou comme Abou Barâ ; que la sagesse et la droiture soient tes compagnes.
Ne laisse pas emporter ta raison par les vagues bouillonnantes de l'orgueil, qui ne trouvent pas d'issue.
Un jour tu deviendras raisonnable, ou à peu près raisonnable, lorsque tu grisonneras, à moins que ce ne soit lorsque le corbeau deviendra gris.
Car si les cavaliers, au jour de Hisye, en te rencontrant, t'ont fait éprouver ce qu'ils t'ont fait éprouver,
Ce n'était pas qu'il s'agît d'une race éloignée de la leur; mais ils t'ont atteint dans leur colère,
Les cavaliers de Manoûla, qui ne sont jamais penchés sur leurs selles, et ceux de Mourra, dont l'aigle flotte au-dessus de leurs bataillons.
Et il dit encore :
Par ta vie, je ne craignais pas pour Yazid les vantardises extravagantes qu'on m'a rapportées.
Ne dirait-on pas que sa tête est ceinte d'une couronne, pour quelques petits troupeaux qui ont été atteints à Dhoû Abân !
C'est assez pour toi que tu sois flétri par des paroles fermes, que la rime fait passer sur ma langue.
Que de fois d'autres avant toi m'ont insulté et m'ont injurié, sans que je fusse à court de paroles ou embarrassé pour répondre.
Le poète de second ordre me ressemble aussi peu que la jeune chamelle à l'étalon blanc.
Tu as été l'instigateur de la faute, puis tu t'es retiré, comme le chameau aux sourcils épais se, détourne devant la corde fixant la selle.
Si Abou Koubeis t'avait en sa puissance, ta vie se prolongerait dans la honte;
Et ta barbe, qui a laissé passer tes impostures et tes fourberies, serait teinte en un rouge plus vif que celui du sang lorsqu'il sort en bouillonnant des entrailles.
Tu aurais sa confiance, si tu ne l'avais pas trahi : d'ailleurs quelle confiance peut inspirer un Yamanite?
Et Yazid dit pour lui répondre :
Si Abou Koubeis m'avait en sa puissance, tu me trouverais auprès de lui a la meilleure place;
Tu me trouverais plus bienveillant que toi pour les absents, plus habile à manier la parole et la lance.
Qui est plus perfide qu'un Syrien, qui laisse les muscles de sa langue s'agiter sans frein ?
Pour ce qui est de la fourberie, Ma'add sait combien elle est répandue, combien elle s'étale chez les Bènou Dhobyân.
Quand on coupe les testicules à un étalon, il devient impuissant, et son périnée se couvre d'ulcères.
Et Nâbiga dit, faisant l'éloge funèbre de Nomân ben Hârith ben Abî Chamir Gassânî :
La passion t'a entraîné, et ces campements ont été témoins de ta folie; pourquoi cet amour juvénile, quand on a une couronne de cheveux blancs?
Je me suis arrêté dans les environs de la maison, le temps et les nuages pluvieux en ont altéré les signes distinctifs.
Je demande à chacun des nouvelles de Sou'dâ, et depuis notre départ, sept années pleines ont passé sur l'habitation.
Je me suis enfin, consolé de ce que je ressentais par une excursion nocturne sur une monture solide, qui, en portant ma selle, trottait parfois et parfois aussi galopait,
Une monture aux muscles inférieurs fermes, au dos trapu, et qui court en agitant la tête, alors que déjà sont épuisés les chameaux de race à la marche légère.
Son agitation joyeuse me faisait croire que j'avais attaché ma selle sur un âne sauvage, qui vient de finir sa dentition, de ceux qui habitent le mont ‘Âkil,
Mince comme la corde tordue d'Andarîn, pelé, couvert d'aspérités, après avoir été mordu par les mâles bruyants, s'acharnant après une ânesse, aux poils ras, au dos long, et qu'il tourne et retourne, parce que les femelles lui font défaut;
Lorsqu'elle lutte de vitesse avec lui, il fait des efforts, et, si elle est fatiguée, il se laisse choir, bien qu'il n'éprouve ni fatigue, ni faiblesse;
Lorsqu'ils descendent tous deux dans la plaine, ils soulèvent la poussière; lorsqu'ils gravissent les hauteurs, les pierres se fendent sous leurs pas.
Que de fois pour les Bènou Barchâ, Dhouhl, ainsi que Keis et Cheibân, alors que les abreuvoirs leur offraient une retraite sûre,
J'ai été peiné de ce qui les a réjouis, et que de fois j'ai vu, pour celui qui était l'objet de leur terreur, se briser mes forces et mes affections!
Puissent les ennemis ne jamais avoir profit à la chute du pouvoir qu'ils subissaient, ni au soulèvement de Tamîm et de Wâïl!
Autrefois, chaque année au printemps, alors que les tribus agitaient jusqu'à l'eau des cieux, Tamîm et Wâïl prenaient les armes pour les forcer à se tenir sur leurs gardes,
Conduits par Nomân, alors que ses marmites étaient en ébullition et que ses chaudières laissaient déborder les causes de mort.
Il excitait les chameliers, enveloppé dans son manteau, sans même remuer les sourcils, tandis que les montures soulevaient la poussière.
Des hommes, méconnaissant mon caractère, disent : « Peut-être Ziyâd, toi qui ne tiens à rien, te montres-tu indifférent. »
Je suis tellement peu indifférent que je ne puis parler de lui sans que l'émotion agite profondément mon âme.
Mon patrimoine, s'il faut en parler, mes armes, mon cadeau nuptial, et ce que mes doigts ont amassé,
Tout me vient de toi, ainsi que mes nobles chamelles, blanches comme des vaches sauvages, mes chamelles qu'on excite en chantant lorsqu'elles portent la selle.
Quand même tu as laissé à l'abri de toute atteinte les colonnes d'un empire qu'avaient affermi tes ancêtres,
Puisses-tu ne nous quitter jamais! Mais la mort est un rendez-vous auquel tout homme finit par se rendre un jour.
Si Abou Hodjr échappe, les hommes dans leur bonheur ne connaîtront plus que de courtes nuits.
Si tu vis, jamais je ne prendrai la vie en dégoût; si tu es mort, à quoi bon prolonger plus longtemps ma vie?
Mais de nouveaux arrivants, témoins du malheur, sont venus confirmer la nouvelle qu'à Djaulân ont été enterrées tant d'énergie et de générosité.
Que la pluie arrose un tombeau, entre Bosrâ et Djâsim, d'une ondée, comme lorsqu'au printemps se succèdent les pluies fines et les averses ;
Que les herbes odorantes et le musc et l'ambre ne cessent de croître sur sa dernière demeure, rafraîchie par l'eau du ciel qui tombe doucement pendant plusieurs jours de suite-,
Qu'elle fasse pousser nénufars et plantes suaves aux fleurs éclatantes que je décrirai dans les plus beaux vers qui aient jamais été chantés.
Hârith Eldjaulân pleure la perte de son maître; le Haurân est désolé et comme anéanti.
Les hommes de Gassân sont assis, espérant encore son retour, et aussi les Turcs, les guerriers persans et Kâbil.
****************
Ici se terminent celles des poésies de Nâbiga qui ont été rapportées par Asma'î; nous y joindrons, si Dieu le permet, quelques poèmes choisis parmi ceux qui ont été transmis par d'autres.
Nâbiga dit, au moment où les Bènou ‘Abs avaient tué Nadia, où les Bènou Asad leur avaient tué deux hommes, et où 'Oyeina réclamait l'appui des Bènou ‘Abs:
J'ai visité des habitations à 'Oureitinât et aussi sur les points culminants de la vallée qu'habitait la tribu.
Les vicissitudes du temps les ont détruites : il n'en reste plus trace, non plus que des torrents qui s'élançaient avec fracas.
J'y ai arrêté ma jeune chamelle dans ma détresse; j'étais épuisé par l'excès de ma passion.
J'interrogeai ces lieux déserts, et mes larmes se répandirent en abondance, comme si elles coulaient par toutes les ouvertures d'une outre usée.
Ainsi pleure la colombe lorsqu'elle appelle ses petits et que, dans sa douleur, elle soupire sur une branche.
Fais parvenir en mon nom, 'Oyeina, une parole qui te concerne; c'est h toi, à toi-même, que moi je l'adresserai.
Mes rimes, quand elles passent, sont puissantes comme les rochers; rien ne peut en arrêter la marche.
C'est en cette monnaie que je paye qui veut me faire tort, comme on paye son créancier; que celui-ci me paye de même!
Tu trahis donc mon allié et tu t'attaches à 'Abs. O Yarboû ben Gueith, sus à cet intrus!
On dirait que tu es du nombre des chameaux des Bènou Okeich, derrière les jambes desquels on fait ballotter bruyamment une outre usée.
Tu es parfois sot comme l'autruche, et parfois aussi, tournant selon le souffle du vent, tu trames toute espèce de ruses.
Souhaite qu'ils restent à distance, et mets-toi sur tes gardes; c'est toi qui seras bientôt abandonné avec ton souhait
Dans un désert aride, où ne se trouve pas un habitant, où aucun guide ne demeure.
Si tu médites une trahison contre les Bènou Asad, je ne suis pas de ton bord, de même que tu n'es pas du mien.
Car ils sont la cotte de mailles que je revêts pour, le jour de Nisâr, et ils sont mon bouclier.
Eux, ils sont descendus à Djifâr contre Tamim, et ils ont pris part à la journée de 'Okâth; pour moi,
Je suis resté sur le champ de bataille, témoin d'exploits qui leur ont valu l'affection de mon cœur.
Ils ont attaqué Hodjr avec leurs troupes, et pendant toute cette journée, ils ne sont pas sortis de ma-pensée.
Ils se sont avancés contre Gassân avec une armée qui couvre tous les chemins, une armée qui s'agite en masses puissantes,
Toute composée de guerriers expérimentés, de vrais lions, qui sont montés sur des chevaux dont les uns ont la queue longue et les chairs luxuriantes,
Dont les autres, élancés comme les flèches et marqués d'un signe apparent, portent une tribu semblable à des Djinn.
Au matin où de blanches épées, pour achever Hodjr, se sont tournées contre lui au milieu de la poussière qui couvrait le champ de bataille.
Si, 'Oyeina, j'avais écouté quelqu'un de tes conseils, le repentir me ferait grincer des dents.
Et il dit encore :
Renonceras-tu, Katâmi, à tes coquetteries amoureuses ? Cesseras-tu d'être avare de tes saluts et de -tes paroles?
Pour ce qui est de ta coquetterie, n'y persiste pas ; si le moment du départ est venu, dis-moi du moins adieu.
Si, au matin de la séparation, elle avait été généreuse, alors qu'on avait déjà relevé les rideaux qui entourent le palanquin,
J'aurais jeté sur elle un regard furtif, et je l'aurais vue quitter son voile derrière le rideau.
Sa poitrine, où brillent les ornements précieux, est comme les charbons ardents répandus dans les ténèbres.
Les paillettes d'or et d'argent, ainsi que les perles, s'y détachent comme sur le cou d'une gazelle à la voix douce,
Qui, restée seule avec son mâle, trouve à sa portée au pied d'une hauteur l’arâk de la vallée.
Qui en broute les baies, et recherche le bachâm jusqu'au déclin du jour.
On dirait que le vin de Bosrâ, dont les chamelles portent solidement cachetés
Les cratères depuis Beit Râs jusqu'au marché bien établi de Lokman.
Qui, lorsque l'on brise les cachets, laisse monter les fleurs sèches à sa surface,
A été mélangé sur les dents de cette jeune fille avec l'eau fraîche des nuages chargés dont on a recueilli les pluies dans les citernes,
Avec cette eau, qui est devenue froide au contact de la pierre, tandis que le vent du sud est lancé sur les nuages rais à sec.
Elle aime ce goût et elle y pense au moment où elle est réveillée de son sommeil.
Ne songe plus à elle, puisque sa pensée est loin de toi, et qu'elle a persisté à vouloir te châtier pinson éloignement.
Mais, quelle sagesse éclatante, quelle perfection on t'annonce chez Ibn Hind!
Puisse mon corps, depuis la partie que portent mes sandales jusqu'à la boucle la plus élevée de mes cheveux, servir de rançon au prince!
Puisse-t-il faire incursion dans des tribus irritées à Dhihyaut avec une armée insatiable.
Conduite par un héros qui ne se repose jamais, préoccupé de questions graves et importantes.
Il a, pour se protéger contre l'ennemi, tous les plus nobles coursiers, et les cavales aux longs cous que l'on caparaçonne lorsque soufflent les vents brûlants,
Et les lances flexibles, dont les pointes brillent comme la flamme du forgeron.
Un messager l'a averti que les hommes d'une tribu, descendant de Djadhâm ou de Djoudhâm,
Avaient formé en masse une alliance, et que ces bandes s'excitaient l'une l'autre.
Mais lui, il a conduit en bas, dans la plaine de Atm, ses soldats tout couverts de poussière, infatigables à la marche, rapides comme les troupes voyageuses de faucons.
Ils s'avancent sur la foi de guides sûrs et de leurs avant-gardes, tandis que les généreuses chamelles de la Syrie agitent vivement leurs têtes.
Les troupes ennemies ont passé la nuit dans le repos, lui, il a passé la nuit à marcher, une nuit qui le rapproche d'eux, une nuit qu'ils ont trouvée bien longue.
Dès l'aurore, il leur a servi une liqueur vermeille et sans mélange, au point que leurs têtes sont devenues semblables à des œufs brisés d'autruche.
Tous ceux qui, semblables au chameau accroupi, avaient campé sur son territoire pour l'attaquer, ont goûté la mort, et le sang des fuyards a rougi ses ongles.
Belles comme les vaches du désert, les captives égalisent les pans de leurs robes pour couvrir les chaînes de leurs pieds.
Elles confient à ceux qui vont puiser l'eau, lorsqu'ils passent, leurs nourrissons couverts de poussière, qui ne veulent pas être sevrés.
On a vu s'élever une colonne de sable fin, enveloppant comme dans des langes de poussière les montagnes de Hisraâ.
Ceux qui en voulaient au prince ont cherché à l'atteindre, à réaliser le projet qu'ils en avaient conçu,
S'attaquant à un ennemi difficile à soumettre, qui résiste, et qui s'est élevé dans les hauteurs de la gloire.
Avant lui, son père et le père de son père avaient bâti la gloire de leur vie en tirant au cordeau l'édifice.
Tu as établi ta domination en Irak; et, dans tous les châteaux on avait garni de défenseurs les fossés et les remparts,
Et tes troupes ne cessaient pas d'occuper des positions inaccessibles, afin de protéger les gras pâturages.
Et il dit encore :
Est-ce que ton amour pour ta Sou'dâ s'est réveillé en toi, à la vue des demeures où vous vous êtes connus dans les vergers de Nou'nû, et plus tard à Dhâl Elasâwid ?
Les derniers vestiges ont disparu sous les attaques des vents qui détachaient violemment la poussière du sol, et des nuages chargés de pluie et de tonnerre.
Les taureaux à la longue queue et les vaches au nez retroussé y viennent rechercher les monceaux isolés de sable mouvant.
C'est ici que j'ai connu Sou'dâ, et Sou'dâ, insouciante, riait et marchait en se balançant au milieu de ses chastes compagnes.
Par ma vie, par la beauté de ma tribu, dès l'aurore on a vu un jour fondre sur nos troupeaux et nos maisons à Dhât Elmarâwid
Une troupe que conduisait Nomân, avec sa résolution et son habileté entreprenante, qui abat le courage des rebelles.
Plein d'énergie, sans faiblesse, il est favorisé d'un bonheur qui triomphe là où le sort trahit les plus généreux des hommes.
Il a ramené des jeunes filles et des femmes de noble extraction, aux manières aimables, sur lesquelles veille un gardien peu sévère.
Partout où elles étaient assises, elles traçaient des lignes sur le sable avec des branches, et cherchaient à cacher leurs mamelles luxuriantes qui ressemblent aux grenades.
Semblables aux gazelles au long cou, elles s'attachaient vivement à leurs enfants aux visages beaux comme ceux des jeunes veaux.
Insouciantes, elles n'avaient jamais éprouvé de malheur avant leur captivité chez Ibn Djoulâh, et elles n'espéraient pas qu'un envoyé de leur tribu vînt les racheter.
Nomân a atteint les Bènou Gueîth, et parmi ceux qui sont devenus ses esclaves, plus d'un a été couvert par lui de bienfaits.
Il faudra qu'une chamelle, courbée par la fatigue, porte en toute hâte un cavalier qui ne craint pas de voyager la nuit pour aller trouver Ibn Djoulâh.
Elle trottera jusqu'à ce qu'elle soit arrivée auprès de Nomân. Puisses-tu, toi, l'arbitre de mon sort, être racheté par tous mes biens acquis et légués par héritage !
Jai tranquillisé mon cœur après que le souffle s'en était envolé, et tu m'avais déjà comblé de bienfaits avant mon arrivée.
Je suis de ceux qui ne louent jamais que les princes; mais je ne suis pas jaloux du bonheur que tu as eu.
Tu as surpassé les hommes qui ont hâte d'arriver aux honneurs, autant que le coursier rapide devance à la chasse les chevaux qui poussent le gibier en avant.
Tu es plus généreux que Ma'add pour tes amis, plus terrible pour tes ennemis; tu es le premier à recueillir la pluie de la gloire.
Et il dit encore :
Est-ce que ton amour pour Asmâ s'est réveillé en toi, lorsque tu as vu les traces des demeures dans les vergers de Nou'inî, et plus tard à Dhât Ela-djâwoul ?
Les vents y ont séjourné, et ils y ont, l'un après l'autre, filtré la poussière à sa surface comme à travers des tamis;
Et aussi les pluies abondantes provenant de nuages épais, aux extrémités rapides, aux bords pendants,
Dans le milieu desquels le tonnerre gronde, et alors du nuage agité se précipitent les flots pressés d'une pluie torrentielle.
C'est ici que j'ai connu une tribu d'hommes généreux, et à leur place sont venus de nombreux troupeaux d'autruches à la démarche légère.
Tu peux y voir les taureaux à la longue queue s'occuper des vaches sauvages sur les monceaux de sable mouvant.
Elles remuent les cailloux avec leurs poitrines pour s'accoupler à leur fraîcheur, alors que le soleil vomit une salive brûlante.
Que de fois j'ai fait passer une chamelle rapide sur le dos d'une grande route qui ressortait comme la blanche tunique du Yamanite, et qui conduisait aux abreuvoirs;
Il s'en détachait des sentiers qui descendaient solitaires pour regagner ensuite le chemin bien tracé des deux côtés, à la direction nette.
Pour moi, ô Asmâ! j'ai été détourné de me rencontrer avec toi, par une aventure et un souci qui est venu m'absorber et chasser le souci que tu m'inspirais.
J'ai conseillé aux Bènou 'Auf, et je n'ai pu faire agréer mes conseils, et les liens qui nous unissent n'ont servi de rien auprès d'eux ;
Je leur ai dit : « Puissé-je ne jamais voir les femmes nobles et délicates qui habitent les deux côtés de Arîk et de 'Âkil,
« S'attacher vivement à leurs enfants semblables à de jeunes veaux, et dignes de lutter pour la beauté avec les gazelles lorsque, séparées du troupeau, elles courent sur le sable,
« Et quêter du secours au milieu des montures ennemies, dépassant les hauteurs d'Obéir et de Kawâthil;
« Et cependant ils ont laissé le champ libre au prince entre Djinâb et 'Alidj, pour se retirer de lui comme on se sépare sans regret d'un compagnon nuisible, lorsqu'il vous quitte!
« Puissé-je ne jamais me voir non plus, après que je vous ai prévenus, obligé de lutter pour vous faire rendre vos brebis, vos chameaux,
« Et vos femmes à la peau blanche, au caractère insouciant, qui versent leurs premières larmes en laissant échapper de leurs yeux ces pleurs involontaires qu'elles essuient avec les extrémités de leurs doigts ! »
Je craignais, et ma crainte dépassait celle du bouquetin qui se réfugie sur les sommets du Dhoû Matâra ;
Je craignais que 'Amr ne conduisît contre nous ses montures généreuses, les juments au pied nu et les chamelles à la semelle calleuse.
Lorsqu'on veut hâter la marche naturellement plus lente de ces juments, leur cou se tend en avant en même temps que leurs lèvres.
Minces comme des lames de ciseaux, elles n'ont plus même de moelle dans les os; elles sont élancées; leur cou, ainsi que leurs cuisses, est jaune de maigreur.
Alors même que le frottement douloureux avec les rochers a usé la pointe de leurs sabots, elles n'en sont pas moins gracieuses comme les lances flexibles.
Elles laissent échapper dans tous les endroits sur leur route des petits enveloppés dans leurs membranes comme dans des vêtements bigarrés,
Et l'on peut voir les oiseaux qui regagnent leurs nids, comptant pour se rassasier sur la belle viande de cette progéniture.
Ces cavales sont attachées sur le côté de chamelles à la peau olivâtre et de chamelles blanches, minces comme des lances, portant suspendues à des courroies les besaces et les marmites,
Et les larges cuirasses dignes des Tobba, et aussi les cottes de mailles aux longs pans, tissées par Soleim (Salomon),
Sur lesquelles on a répandu partout un mélange de sable fin, d'écume d'huile et de crottin de chameau, et les voilà devenues brillantes et polies pour être revêtues.
Tel est l'appareil d'un héros, qui ne trouve pas dans les distances un obstacle à l'exécution de ses projets, qui poursuit les ennemis, et dont la renommée n'a jamais été obscurcie.
Ses mains fixent l'heure de la mort, mais d'autres fois elles font tomber une pluie de présents et de bienfaits.
Lorsqu'il s'établit dans un pays où le sang n'a jamais coulé, il le laisse dans l'affliction, et marchant à une fin malheureuse.
Il s'avance au printemps avec son armée; à voir leur masse lorsqu'ils descendent dons la plaine, ne dirait-on pas le sol en feu de Râdjil avec ses cailloux brûlés ?
Et il dit encore :
Sont-ce les demeures de Thallâma, dont je retrouve les restes effacés depuis le point où Hobeyy s'élargit le plus jusqu'à Wou'âl ?
Sont-ce les eaux de Danâ et de 'Ouweiridât, ces endroits dont la trace a disparu après qu'y avaient demeuré des tribus compactes ?
C'est un repaire d'animaux sauvages; on ne voit plus que des troupeaux de vaches au milieu de ces ruines désertes, sur lesquelles les pluies printanières ont laissé leur trace.
Elles ont subi tour à tour les nuages de la nuit et ceux du jour, et les vents qui répandent de tous côtés des monceaux de sable.
La végétation est luxuriante, le terroir est humide; on y rencontre les chamelles qui viennent de mettre bas avec leurs petits, et celles qui n'ont pas encore mis bas.
Elles rongent l'écorce des branches de l’alâ, en agitant les poils qui ornent leurs têtes et qui ressemblent à des roseaux noirs et longs de Rodeina.
Lorsqu'elles sont sanglées, leur corps, depuis la croupe jusqu'au-dessus des chevilles, ressemble aux étoffes colorées de Khâl.
Mais, lorsque j'ai vu la maison déserte et que le cœur des hommes qui y habitaient est devenu contraire a mon cœur,
Je suis monté sur une chamelle puissante, muette, courageuse comme un mâle, qui marche sans éprouver de fatigue.
Puisse mon oncle paternel et mon oncle maternel servir de rançon pour un prince à qui elle apporte les excuses de son maître!
Quiconque puise chez Nomân plein un seau ne ressemble pas à qui est égaré et se trompe de route.
Si tu es homme à t'être formé une opinion défavorable de ton- serviteur, si tu as l'intention de le mettre à l'épreuve,
Envoie chez les Bènou Dhobyân, consulte, et n'agis pas contre moi avec précipitation et sans avoir consulté.
Non, par la vie de celui que j'exalte, par les chamelles qui portent les pèlerins au mont Ilâl,
Non, tu n'as pas laissé indifférents ceux qui te doivent de la reconnaissance; aussi accepte mon conseil. Comment serais-je indifférent, moi qui ai reçu de toi tout ce que je possède ?
Si ma main droite t'avait criminellement trahi, je la séparerais de ma main gauche.
Mais ce n'est jamais par moi que tu seras trahi. Et Dieu doit rétribuer chacun selon ses mérites.
Tes libéralités sont une mer qui ballotte les gros navires et les bateaux auxquels on a confié de lourdes charges;
Ses eaux arrivent jusqu'aux murs des châteaux, et elles en repoussent les vaisseaux des Nabatéens qu'elles jettent sur des bancs de sable.
Il donne généreusement les chamelles domptées, rapides, portant sur leurs dos les selles rouges.
Et il dit encore :
Allez tous deux, apportez en mon nom à Dhobyân un message, puisqu'il a quitté la voie de la raison pour s'engager dans un sentier d'erreur :
Sérieusement, ne détournerez-vous pas un fou d'une mauvaise action? Ne respecterez-vous pas les liens de parenté qui Vous unissent à un ami?
Si Sahm et les bandes de Malik se présentaient, si les troupes coalisées m'apportaient des excuses de la part de Mourra,
Ils amèneraient une armée telle que les hommes n'en ont jamais vu de semblable, et devant laquelle Kousâira même s'abaisserait au déclin du jour.
Puissiez-vous ne jamais regretter d'avoir repoussé nos familles, comme 'Obeidân, lorsqu'il interdisait aux troupeaux le pâturage dans sa prairie !
Ceux d'entre eux qui sont mes ennemis me font éprouver, aussi vrai qu'elle ne se plaint plus au matin, celle qui a été tenue éveillée par la douleur,
Ce qu'a éprouvé l'habitante du rocher de la part de son compagnon. Or les proverbes qui ont cours parmi les hommes se réalisent toujours.
Elle lui avait dit : « Je te convie à recevoir la rançon complète, mais ne commets pas la trahison de m'attaquer à l'improviste. »
Il jura par Dieu, quand ils se furent mis d'accord, et elle payait la somme, tantôt d'une façon irrégulière, parfois aussi chaque jour.
Lorsque la rançon lut entièrement donnée à peu de chose près, et que son âme égarée l'eut perverti,
Il se demanda de quel voile Dieu pourrait couvrir son action, afin qu'il pût à la fois être riche et tuer son adversaire.
Lorsqu'il vit que Dieu avait fait fructifier son bien, avait affermi son aisance et bouché les trous de sa misère,
Il s'appliqua à aiguiser le tranchant d'une hache, d'une arme solide de fer bien trempé.
Il se tint en embuscade au-dessus de la tanière solidement construite-, il voulait tuer son ennemie, à moins que sa main ne la manquât par trop de précipitation.
Mais Dieu la préserva du coup de hache, et la justice a un œil ouvert qui ne se ferme jamais.
Alors il lui dit : « Viens, prends Dieu pour arbitre entre nous de ce que nous possédons, ou bien achève l'affaire. »
Elle reprit : « Ferais-je un serment en prenant Dieu à témoin, quand je t'ai vu comme ensorcelé, ne craignant pas de prêter un faux serment?
Je n'aime pas à voir toujours se dresser en face de moi un tombeau, ni une bâche rester suspendue au-dessus de ma tête, prête à me transpercer. »
Et il dit encore :
Pais tes adieux à Omâma, et c'est le moins que tu lui doives; mais comment dire adieu à ceux que les chameaux ont déjà emportés?
Je ne t'avais vue qu'une fois, Omâma, lorsque mon regard rencontra le tien au jour de Namâra; mais les volontés du destin s'accomplissent.
Les caravanes qui se dirigent vers une tribu ont beau en être encore éloignées; elles y arrivent le soir, même si elles en sont encore séparées par Thahlân et par Nîr.
Et moi, parviendrai-je jusqu'à eux sur une chamelle élancée, hongre, aux vertèbres solides, si je voyage depuis le commencement de la nuit et si j'affronte les chaleurs du plein midi ?
Pendant une demi-année, six mois de suite, elle a été délivrée de la selle, qu'a couverte la poussière répandue dans l'air en Hîra ;
Elle a été exposée à la contagion; mais elle n'a pas été atteinte par la gale, et le chamelier avait acheté pour elle des herbes médicinales contre de la monnaie de plomb.
Elle a en vain cherché à l'entour une société, car son cavalier était ivre et pris de vin dans la vallée de Bâgoûth,
Les oies déposaient sur les côtés de son habitation leurs œufs, tandis que devant elle étaient étendus les monceaux de paille.
N'était le prince dont on espère les présents, le cavalier aurait dit à ses compagnons : « Réunissez-vous et partez. »
Ne ressemble-t-elle pas à un taureau dont le sabot a été blanchi par la boue, dont la peau ait claire, qui a grandi au milieu des sables,
Qui a dressé la tête au moindre murmure, qui a tendu son oreille, bien que l'entrée en soit cachée par la chair de la corne ?
Il sentait le chasseur, qui laisse courir entre ses jambes des chiens dont les dents inférieures sont acérées comme des scies.
Ce cavalier diabolique, pour les flatter, dit : « Il est pour vous, mais la viande des brebis vous est interdite. »
Ici se terminent les poésies choisies parmi celles qui ont été rapportées par Toûsî au nom de ses maîtres, avec la grâce et le secours d'Allah.
[1] Celui qui excellait dans l'art de la poésie était ordinairement appelé à la dignité d'émir de sa tribu.
[2] Ces captifs étaient au nombre de quatre-vingts. Ce fut, selon d'autres, après la journée de 'Ein Obâg. La tradition arabe a confondu ces deux journées, en faisant mourir dans chacune d'elles un Moundhir de Hîra vaincu par un Hârith de Gassân. On peut voir une énumération des diverses opinions qui éloignent ou rapprochent l'époque de ces deux combats, et les réflexions judicieuses, mais trop absolues, que provoquent tous ces textes, dans la préface de M. Socin à son Diwân de 'Alkama.
[3] Nous voyons Nâbiga se rendre à la cour du prince, en compagnie des poètes 'Obeid ben Abras et Bichr ben Abî Hâzim.
[4] Massoudi, Prairies d’or (éd. Barbier de Meynard), III, nous a conservé un récit sur la première entrevue de Nâbiga et de Nomân.
[5] Je rapporte ici la seconde version de l’Aghani.