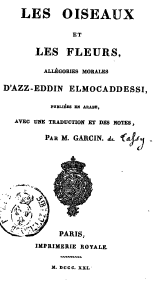
AZZ-EDDIN EL-MOCADDESSI
LES OISEAUX ET LES FLEURS
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
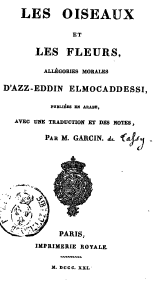
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
I.
Les allégories que je
publie étaient inédites. Hadji-Khalfa, dans sa Bibliographie
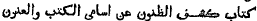 et,
probablement d'après lui, d'Herbelot, dans sa Bibliothèque
orientale, se contentent de donner le titre sans aucun autre
détail ; mais le célèbre William Jones s'exprime ainsi au sujet de
cet ouvrage, dans ses
Poeseos asiatica
Commentarii, p. 447, édit, or. : Inter opera rhetorica
numerari potest libellus, qui appellatur
et,
probablement d'après lui, d'Herbelot, dans sa Bibliothèque
orientale, se contentent de donner le titre sans aucun autre
détail ; mais le célèbre William Jones s'exprime ainsi au sujet de
cet ouvrage, dans ses
Poeseos asiatica
Commentarii, p. 447, édit, or. : Inter opera rhetorica
numerari potest libellus, qui appellatur
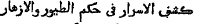 hoc est, Arcanorum patefactio
de avium et florum proprietatibus. Auctor fuit
Ezzo'ddin, qui cognomen
hoc est, Arcanorum patefactio
de avium et florum proprietatibus. Auctor fuit
Ezzo'ddin, qui cognomen  ,
sive Oratoris adeptus est, Argumentum persimile est
Couleii libro, quem Sylvas nominat ; sed non flores
solum atque herbae, verum aves etiam, praeterea apis, aranea, bombyx
et zephyrus etiam, in hoc opusculo loquentes inducuntur, ac de suis
virtutibus venustissime disserentes. Est profecto libellus cum
pulcherrimarum imaginum copia, tum orationis nitore ac venustate
absolutissimus. »
,
sive Oratoris adeptus est, Argumentum persimile est
Couleii libro, quem Sylvas nominat ; sed non flores
solum atque herbae, verum aves etiam, praeterea apis, aranea, bombyx
et zephyrus etiam, in hoc opusculo loquentes inducuntur, ac de suis
virtutibus venustissime disserentes. Est profecto libellus cum
pulcherrimarum imaginum copia, tum orationis nitore ac venustate
absolutissimus. »
Ainsi que l'observe l'orientaliste anglais, l'auteur ne s'est pas borné à mettre en scène des fleurs et des oiseaux, ce que le titre semble annoncer, mais il y fait paraître des insectes, des quadrupèdes, la nue et la bougie même. Du reste, il y a quelques différences entre les titres des manuscrits, comme je l'indiquerai plus bas.
Azz-eddin commence par établir qu'il n'est rien dans la nature qui
ne soit doué de la faculté de se faire entendre d'une manière
sensible ou intellectuelle. A l'homme seul est réservé l'usage de la
parole ; mais les autres créatures animées ou inanimées semblent
aussi s'exprimer dans un langage figuré, dont leur manière d'être,
leurs propriétés, leurs habitudes donnent l'intelligence. L'auteur
nomme cette sorte de langage  ,[1]
langue de l'état ou de la situation ; ce que l'on peut
rendre par langage muet.
,[1]
langue de l'état ou de la situation ; ce que l'on peut
rendre par langage muet.
Partant de cette idée, il se suppose au milieu d'un jardin : là, occupé à étudier les discours emblématiques des objets que la nature offre à nos sens, il s'applique à les interpréter, et.son livre développe tout ce qu'une imagination orientale peut découvrir dans ce langage mystérieux.
Azz-eddin, dans sa préface, expose son plan à peu près comme je viens de le faire ; toutefois il ne s'exprime pas avec la précision que Ton attendrait d'un Européen : d'après les expressions dont il se sert, la dernière partie de son discours préliminaire semblerait devoir en être la première.
Il est évident que, dans ces allégories, l'intention de l'auteur est de tirer, de ce langage muet de la nature, des idées non-seulement morales et religieuses, mais encore spirituelles et mystiques; idées qui sont bien plus naturelles qu'on ne le pense communément. En effet, « ne trouvant rien ici-bas qui lui suffise, l'âme avide cherche ailleurs de quoi la remplir: en s'élevant à la source du sentiment et de l'être, elle y perd sa sécheresse et sa langueur ; elle y renaît, elle s'y ranime, elle y trouve un nouveau ressort, elle y puise une nouvelle vie, elle y prend une autre existence qui ne tient point aux passions du corps; ou plutôt, elle n'est plus en elle-même, elle est toute dans l'être immense qu'elle contemple, et, dégagée un moment de ses entraves, elle se console d'y rentrer par cet essai d'un état plus sublime, qu'elle espère être un jour le sien. » (J. J. Rousseau, Nouvelle Héloïse, t. IV.)
Toutefois, pour enduire de miel les bords de la coupe amère de la morale et de la piété, l'auteur a suivi une marche progressive dans son ouvrage; aussi ses premières allégories sont-elles bien plus gracieuses et bien moins mystiques que les suivantes.
Veluti pueris absinthia tetra medentes
Cum dare conantar, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore,
Ut puerorum aetas improvida ludificetur
Labrorum tenus, interea perpotet amarum
Absinthi laticem, deceptaque non capiatur,
Sed potius tali facto recreata valescat.[2]
Lucrèce, de Rer. nat. I, 935-41.
Le voile du mystère, d'abord épais, s'éclaircit peu à peu, et se soulève même quelquefois; enfin il tombe entièrement, et le nom de Dieu vient, dans la dernière allégorie, expliquer toutes les énigmes.
La mysticité qui règne constamment dans cet ouvrage n'est pas toujours fort intelligible : mais ce qui la rend surtout difficile à comprendre (comme dans tous les livres des auteurs mystiques orientaux), c'est l'emploi d'un grand nombre de mots détournés de leur signification propre, et adaptés au langage spirituel. Quoique je me sois attaché à donner, dans mes notes, l'explication de tout ce qui offre quelque difficulté, je vais cependant présenter ici une idée du mysticisme oriental, pour l'intelligence de l'ensemble de l'ouvrage.
Le mysticisme ou spiritualisme oriental, connu sous le nom de
doctrine des soufis [ ] se
nomme en arabe
] se
nomme en arabe  la
connaissance de Dieu. Il se divise en divers degrés (voyez le
Pend-namèh de M. de Sacy, p. 167 et suiv. et a
Treatise on Sufiism, or Mahomedan mysticism, dans le recueil
intitulé Transactions of the literary Society of Bombay, p. 94.
et suiv.) ; mais il suffit de savoir qu'il consiste, en général,
à se détacher totalement du moi humain, à ne désirer que
Dieu, à ne respirer que pour Dieu, à n'aspirer qu'à jouir d'un état
parfait d'intuition surnaturel et extatique ; et qu'il va
quelquefois jusqu'à se mettre non-seulement au-dessus des préceptes
positifs de la religion, mais encore à être indiffèrent à la foi et
à l'incrédulité, et à oublier le monde présent et le futur. Voici
deux vers de Hafiz à l'appui de ce que je dis :
la
connaissance de Dieu. Il se divise en divers degrés (voyez le
Pend-namèh de M. de Sacy, p. 167 et suiv. et a
Treatise on Sufiism, or Mahomedan mysticism, dans le recueil
intitulé Transactions of the literary Society of Bombay, p. 94.
et suiv.) ; mais il suffit de savoir qu'il consiste, en général,
à se détacher totalement du moi humain, à ne désirer que
Dieu, à ne respirer que pour Dieu, à n'aspirer qu'à jouir d'un état
parfait d'intuition surnaturel et extatique ; et qu'il va
quelquefois jusqu'à se mettre non-seulement au-dessus des préceptes
positifs de la religion, mais encore à être indiffèrent à la foi et
à l'incrédulité, et à oublier le monde présent et le futur. Voici
deux vers de Hafiz à l'appui de ce que je dis :
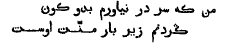
« Moi qui ne daigne pas baisser la tête vers l'un ou l'autre monde, je plie le cou sous le fardeau du désir qui m'oppresse d'obtenir ses faveurs (de Dieu). » Pend-namèh.
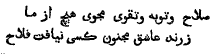
« Ne nous demandez ni vertu, ni pénitence, ni piété: la vertu ne fut jamais le partage d'un libertin que l'amour (de Dieu) agite de ses transports les plus furieux. » Pend-namèh.
Une autre observation très-essentielle à faire, c'est que les
auteurs mystiques parlent toujours de la divinité sous les traits
d'une beauté humaine. Les Arabes emploient communément le mot
 et les Persans, le mot
et les Persans, le mot
 pour désigner la Divinité. Il
est bien rare que les soufis nomment cette amie par son véritable
nom ; leurs poésies sont le plus souvent voluptueuses, quelquefois
même trop libres, et l’on aurait de la peine à les distinguer des
autres poésies, si quelques mots n'échappaient çà et là à ces
fervents adorateurs de Dieu.
pour désigner la Divinité. Il
est bien rare que les soufis nomment cette amie par son véritable
nom ; leurs poésies sont le plus souvent voluptueuses, quelquefois
même trop libres, et l’on aurait de la peine à les distinguer des
autres poésies, si quelques mots n'échappaient çà et là à ces
fervents adorateurs de Dieu.
Azz-eddin Elmocaddessi ne tombe pas dans les excès où bien des quiétistes Persans, Hafiz surtout, sont tombés. Il règne, à la vérité, dans son livre, un ton mystique ; mais ce ton même étant modéré, donne à l'ouvrage une teinte douce et sentimentale qui ne laisse pas d'avoir des attraits pour un lecteur sensible.
Il n'est pas inutile de remarquer que dans ces allégories, les vers
ne se lient presque jamais avec la prose, et qu'ils sont
ordinairement placés dans la bouche de l'auteur, quoiqu'ils viennent
après le discours de la fleur ou de l'animal mis en scène, et qu'ils
semblent souvent, sous certains rapports, être une suite de ce
discours. Dans un des manuscrits, l'auteur place toujours, avant les
vers, les mots 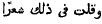 , ce qui est une
preuve de ce que j'avance. Il n'est pas rare que les vers n'aient
même aucune analogie avec ce qui précède.
, ce qui est une
preuve de ce que j'avance. Il n'est pas rare que les vers n'aient
même aucune analogie avec ce qui précède.
Je crains que le jugement qu'on portera de l'ouvrage d'Azz-eddin, ne soit pas très favorable, si on l'établit d'après les règles sévères de notre goût ; mais si on se laisse diriger par le goût asiatique, ce qui paraît des défauts deviendra des beautés réelles, et ce qui semble bizarre ne sera plus que des jeux d'esprit. Toutefois, j'ose dire qu'en jugeant même cet ouvrage conformément au goût européen, on ne peut disconvenir que le style n'en soit facile et élégant, qu'il n'y ait de l'esprit, des idées heureuses, des expressions vraiment poétiques et souvent un agréable parallélisme de pensées et de mots;[3] mais, d'un autre côté, on ne saurait se dissimuler qu'il n'y ait en générai trop de vague, et quelquefois de l'obscurité et peu de liaison dans les idées.
…………………………………………………………………………………………………………..
II.
Je n'ai que peu de
choses à dire sur l'auteur de ces allégories. Son véritable nom [ ]
est inconnu;[4]
car Azz-eddin n'est qu'un titre honorifique
]
est inconnu;[4]
car Azz-eddin n'est qu'un titre honorifique
 , et
, et

 ne
sont que des surnoms []. Quant à l'adjectif relatif
ne
sont que des surnoms []. Quant à l'adjectif relatif
 Elmocaddessi (formé de
Elmocaddessi (formé de
 , sous-entendu
, sous-entendu
 , Jérusalem), il
signifie de Jérusalem, ce qui indique qu'Azz-eddin était
natif ou originaire de cette ville ou du territoire, ou qu'il y
habitait.
, Jérusalem), il
signifie de Jérusalem, ce qui indique qu'Azz-eddin était
natif ou originaire de cette ville ou du territoire, ou qu'il y
habitait.
Hadji-Khalfa, comme je l'ai déjà fait observer, ne dit rien de cet auteur. Abou'lmahassen, dans son Dict. des hommes célèbres, se contente de dire qu'Azz-eddin faisait les fonctions d'iman et de vaez,[5] qu'il était érudit et éloquent, qu'il imitait le style d'Ebn-Elgiouzi, et qu'on l'écoutait avec plaisir; qu'il pérora un jour devant la Kaaba, en présence d'une foule de grands et de savons ; qu'il s'en acquitta parfaitement bien, et que des gens instruits prirent copie exacte de son discours ; que sa mort arriva un mercredi 18 chewâl 678 de l'hégire [21 février 1280 de J. C.], et fut occasionnée par une chiite qu'il fit d'un lieu élevé.
Soyouti, dans son ouvrage sur l'Égypte, parle très au long d'un
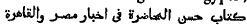 né en 577 ou 78 de l'hégire
[1181-83 de J. C.], et mort le 10 de djoumada Ier, 660
de l'hégire [2 avril 1262 de J. C-]; mais j'ai peine à
croire que ce soit notre Azz-eddin, attendu qu'on ne trouve point
dans Soyouti le
né en 577 ou 78 de l'hégire
[1181-83 de J. C.], et mort le 10 de djoumada Ier, 660
de l'hégire [2 avril 1262 de J. C-]; mais j'ai peine à
croire que ce soit notre Azz-eddin, attendu qu'on ne trouve point
dans Soyouti le  Ebn-Ganem,
ni le Elmocaddessi, et que l'époque de la mort n'est pas la même.
Makrizi, … parle aussi d'un
Ebn-Ganem,
ni le Elmocaddessi, et que l'époque de la mort n'est pas la même.
Makrizi, … parle aussi d'un 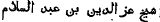 ;
je pense que c'est le même dont Soyouti fait mention.
;
je pense que c'est le même dont Soyouti fait mention.
Outre les allégories que je publie,[6] on connaît encore d'Azz-eddin les ouvrages suivants, qui sont tous mystiques ou ascétiques ………………………
III. Les manuscrits que j'ai consultés pour cette édition, sont au nombre de quatre.
1° Manuscrit de format in-18, écrit avec soin, et vraisemblablement par un homme instruit. J'ai suivi presque constamment ce manuscrit.
2° Manuscrit de format très-petit in-4° ou in-8° Ce manuscrit n'est pas tout écrit de la même main ; le premier quart est d'une autre écriture que le restant du volume. Cette première partie est bonne, et vaut au moins la partie correspondante du ms. in-18 ; aussi m'en suis-je servi utilement quelquefois : mais quant au reste du volume, il est plein d'interpolations de mauvais goût, et ne m'a été de presque aucune utilité.
Ces deux manuscrits appartiennent à M. Varsy, de Marseille, négociant, ancien vice-consul à Rosette, qui possède une collection assez considérable de manuscrits arabes. Ce modeste et savant orientaliste a bien voulu me communiquer de la manière la plus obligeante ces deux manuscrits, avant que j'eusse connaissance des deux autres que j'ai eus depuis à ma disposition, et m'engager lui-même, on ne peut plus amicalement, d'en donner une édition.
3° Manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi, apporté par Pétis de la Croix, coté 966. Ce manuscrit, de format très petit in-4° ou in-8°, est presque illisible, à cause de l'extrême négligence avec laquelle il est écrit. Il y avait une lacune au commencement, qui a 'été réparée, avec aussi peu de soin, par une main européenne. Je n'ai tiré presque aucun secours de ce manuscrit, qui est rempli d'omissions et de fautes graves. .
4° Manuscrit de format très petit in-4° ou in-8°. Ce manuscrit, qui m'appartient, est, après le manuscrit in-18 de M. Varsy, celui qui vaut le mieux; mais la rédaction en est presque toujours beaucoup plus longue que celle des trois autres, surtout dans les dernières allégories, où l'on reconnaît des interpolations manifestes. J'ai donné ces additions dans mes notes, seulement lorsque j'ai cru qu'elles pourraient intéresser le lecteur; du reste, ce manuscrit m'a servi assez utilement.
Outre les différences que l'on remarque dans la rédaction de ces mss., on en voit également quelques légères dans le titre.………………….
Je dois faire observer ici que les vers qui accompagnent plusieurs des dernières allégories, sont tout différents dans les quatre mss., ce qui semble indiquer qu'ils n'appartiennent pas à l'auteur, mais qu'ils ont été ajoutés par les copistes.
IV. Traduire à la lettre un écrivain arabe, c'est s'exposer à écrire de l'arabe en mots français et à ne pas être entendu; traduire trop librement, c'est risquer d'être à côté du sens de l'auteur, de dénaturer ses idées, et de ne point faire connaître la hardiesse des métaphores et l'exagération du style oriental. J'ai tâché de tenir, dans ma traduction; une route intermédiaire. Quand je me suis un peu trop éloigné du mot à mot, j'ai ordinairement donné l'interprétation littérale dans mes notes ; quand j'ai omis quelque chose, j'en ai le plus souvent averti ; quand j'ai déplacé des phrases, j'en ai presque toujours prévenu le lecteur. Mais, pour ne pas multiplier inutilement les notes, je me suis dispensé de ces détails, lorsque j'ai cru pouvoir le faire sans inconvénient. Dans les passages où l'auteur, entraîné par le parallélisme des expressions, a sacrifié la clarté et.la justesse de la pensée à une rime ou à une antithèse, j'ai été forcé d'adopter le sens qui m'a paru le plus plausible : les orientalistes savent combien il est alors difficile d'être certain de celui qu'a en vue l'auteur.
Je n'ai mis dans les notes que les explications qui m'ont paru nécessaires à l'intelligence du texte et de la traduction. Si j'avais voulu m'étendre sur tous les mots peu usités, sur toutes les expressions énigmatiques et figurées, sur toutes les tournures hardies, enfin sur la couleur mystique qui règne partout dans cet ouvrage, mes notes seraient devenues un commentaire perpétuel, et j'aurais outrepassé les bornes que l'on s'impose pour l'ordinaire dans ce genre de travail. Par la même raison, je n'ai fait que les citations que j'ai crues véritablement utiles.
J'ai puisé dans le Seïd Jorjani, Kitab Tarifât, les définitions des termes mystiques, et dans le commentateur Beïdhawi, des développements sur différents textes du Coran, ou sur des allusions à des passages de ce livre. J'ai eu ainsi l'occasion de citer de ces deux auteurs plusieurs fragments qui étaient inédits. Motarrézi, Meïdani &c. m'ont encore fourni quelques autres morceaux qui paraissent aussi pour la première fois.
………………………………………………………………………………………………………….
Sur plusieurs objets d'histoire naturelle descriptive, j'ai eu recours à l'extrême obligeance de M. le Baron Alexandre de Humboldt, qui veut bien m'honorer d'une amitié particulière. Cet illustre savant, pour exécuter plus facilement le plan de son voyage en Asie, se livre avec ardeur, et avec le succès qui couronne toutes ses entreprises, à l'étude des langues orientales : aussi doit-on ajouter le titre d'orientaliste à ceux que lui donne l'universalité de ses connaissances. Je dois à ce célèbre voyageur, et à deux de ses doctes collaborateurs, M. Kunth, correspondant de l'Académie des sciences et professeur de botanique à Berlin, et M. Valenciennes, aide-naturaliste au Muséum du jardin du Roi, des notes intéressantes que j'ai refondues dans les miennes, et qui ne peuvent manquer d'y répandre un intérêt scientifique.
Je présente cet essai de mes travaux sous les auspices de M. le Baron Silvestre de Sacy, qui a la bonté de m'accorder une affectueuse bienveillance, et qui m'a permis de recourir, dans les passages les plus épineux, à la mine également inépuisable de sa complaisance et de son savoir. « Lorsque quelque chose vous paraît embrouillé, dit un poète arabe, consultez un homme habile, et suivez avec docilité ses avis. »

Paris, ce 2 avril 1821.

AU NOM DU DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX.
Louanges à Dieu, dont l'éloignement est proximité, dont la proximité est éloignement; dont la grandeur ne saurait se décrire, ni en style léger, ni en style sérieux; dont la sainteté sublime est au-delà de toutes bornes et de tout calcul. Louanges à Dieu, qui a tiré le Monde du néant; qui a déposé dans chaque être des vues de sagesse qui prouvent l'existence d'un créateur ; et qui a doué l'homme de raison pour juger entre les choses contraires. C'est, par l'inspiration de ce Dieu tout-puissant que l'homme a acquis les connaissances qu'il possède, et qu'il a su distinguer le vrai du faux, la certitude de l'erreur.
Celui qui, dirigé et soutenu par des intentions droites et pures, se livrera à des réflexions sérieuses, ne tardera pas à comprendre que toutes les créatures sont dans les mains de la Providence, qui, ainsi qu'elle condamne les unes au malheur, accorde le bonheur aux autres, et les comble de ses bienfaits et de ses dons les plus précieux, sans que personne puisse arrêter l’effet de la miséricorde de Dieu, ni donner ce qu'il refuse.
Si l'œil de ton intelligence était dégagé de toute matière hétérogène ; si rien ne souillait le miroir de ta conscience, et si tu prêtais l’oreille de l'attention, chaque être saurait t'apprendre ce qui manque à ses désirs, et la peine qu'il endure de cette privation cruelle. Écoute le zéphyr qui murmure dans le feuillage, sur les pleurs des nuées dont les mouvements semblent imiter le flux et le reflux de la mer, et qui gémit sur le doux sourire de l'éclair que suit l’éclat de rire de la foudre. Considère ensuite le printemps : il vient te réjouir par l'heureuse arrivée de ses roses ; il vient t'annoncer que la rigueur du froid, qui l'avait précédé, est passée. Il s'avance vers toi, le sombre hiver se retire, et un manteau diapré vient revêtir la nudité des champs. Le saule d'Egypte se plaint à toi du balancement de ses rameaux ; la marguerite semble te présenter l'armée des fleurs, où règne la plus agréable variété, et qui agitent devant toi leurs étendards empreints de leur bonheur ; le narcisse se lève sur sa tige, comme pour faire sa prière ; l'anémone paraît avec sa robe déchirée ; elle frappe ses joues de rose, comme si elle avait perdu quelqu'un qui lui fût cher ; le grenadier t'exprime ce que lui fait souffrir l'excès du feu ardent qu'ont allumé en lui les cruels dédains et l'éloignement de son amie ; le rossignol, sur le rameau qui le balance, module de tendres accents ; on croirait qu'il flatte les cordes d'une lyre. L'amant, en proie à la mélancolie de l'amour, n'est plus maître de sa passion, et il confie au zéphyr le nom adoré qu'il tenait caché avec tant de soin : troublé par l'odeur suave qui vient de Najd, séjour de sa maîtresse ; il erre ivre de plaisir dans les lieux solitaires, asiles de ses tête-à-tête, et va se réfugier auprès de cette beauté divine, qui connaît ce qu'il exprime de son amour et ce qu'il cache dans son cœur.
Le contemplatif, pénétré de reconnaissance pour les faveurs abondantes qu'il a reçues, s'étudie à creuser la mine de la sagesse, ne veut du lait que la crème la plus pure, et n'ignore pas que Dieu n'a créé aucun être pour l'abandonner dans un état d'inutilité. Chaque créature occupe en effet le rang qu'elle doit tenir; elle ne s'écarte jamais de la route qui lui a été tracée, et elle confesse la vérité des promesses et des menaces de Dieu : il n'est rien, enfin, qui ne paie au Très-haut un tribut de louanges. J'unis mes faibles accents à ce concert unanime des êtres, et je prie ce Dieu tout-puissant de seconder mes efforts et d'inspirer mon génie. Je bénis et salue son Prophète, à qui il a accordé une révélation, pour faire éclater sa gloire, et qu'il a conduit au travers des sphères célestes, dans le célèbre voyage nocturne. Puissent la miséricorde et la faveur de Dieu reposer à jamais sur cet envoyé, sur ses compagnons et sur sa race !
Rempli des pensées que je viens d'exprimer, j'ai jeté sur l'univers le regard de la plus sévère attention, et, éclairé du flambeau du discernement et du secours divin, j'ai vu que tous les êtres publient l'existence du Créateur, et que ceux qui ne peuvent exprimer leurs sentiments par l'organe de la parole, prennent un langage muet pour leur servir d" interprète. J'ai donc examiné scrupuleusement les. allusions que présentent les objets de la nature, j'ai approfondi les allégories qu'ils nous, offrent, et je me suis convaincu que tout est réellement doué de la faculté de se faire entendre, ou d'une manière sensible, ou d'une manière intellectuelle: bien plus, j'ai reconnu que le langage muet est plus éloquent que la parole, et plus essentiellement vrai que quelque discours que ce puisse être. En effet, quand quelqu'un a parlé, on peut convenir.de la justesse de ses observations, ou démentir ce qu'il a dit; au lieu que le langage emblématique repose sur la vérité et sur la certitude. Mais aussi l'être qui s'exprime de cette manière figurée, ne s'adresse-t-il qu'à ceux qui ont des affections toutes surnaturelles, tandis que celui qui communique sa pensée à l'aide de la parole, s'adresse à ceux qui sont dans l'état ordinaire et commun.
J'ai composé mon ouvrage pour expliquer les différentes allégories que les animaux, les végétaux, et même les corps inorganiques, ont offertes à mes méditations : je redirai aussi ce que le merle solitaire m'a raconté, au sujet de son repos et de ses courses dans les champs. Puissent, dans cet écrit, les gens sensés et dociles trouver d'utiles leçons ; les gens profonds et réfléchis, le souvenir de leurs devoirs; tous enfin, des instructions salutaires ! Celui qui entrera dans l’esprit de mes sentences et qui comprendra mes paraboles, lira mon livre avec plaisir; mais celui qui les trouvera étranges, ne saurait le goûter.
Je ne sais quelle pensée m'engagea un jour à aller contempler ce que les mains de l'Eternel ont produit, et ce que la Sagesse divine, qui atteint toujours le but qu'elle se propose, a créé dans une vue d'utilité. Je me rendis, à cet effet, dans un jardin spacieux: un tendre gazon, que courbait l'haleine frémissante du zéphyr, en formait le tapis ; des odeurs balsamiques s'exhalaient du calice des fleurs ; les cimes touffues des arbres s'agitaient en murmurant; les rameaux se balançaient au souffle du vent printanier ; le rossignol gazouillait tendrement, soupirait des airs, balbutiait ses amours. Ici un ruisseau sillonnait la prairie, là une cascade se précipitait irrégulièrement ; plus loin, des fleurs fraîches et brillantes émaillaient la pelouse veloutée ; de toutes parts enfin, la vue se reposait sur des sites pittoresques et variés. Je me dis à cet aspect : « Peut-il y avoir un séjour plus délicieux et une solitude plus agréable! Ah! que n'ai-je un compagnon sincère et affectionné, avec qui je puisse m'entretenir familièrement! » Mais tout-à-coup je crus distinguer ces paroles dans le langage muet et énigmatique de la nature : Peux-tu trouver un ami meilleur que moi, et espères-tu entendre dès réponses plus éloquentes que les miennes ? il n'y a rien de ce qui est en ta présence qui ne s'exprime dans un langage figuré, rien dont la situation et là manière d'être n'annoncent la fin prochaine. Applique-toi donc à comprendre cette voix allégorique, si tu es capable de l'entendre.
Vois le zéphyr du matin, dont le souffle exhale des émanations balsamiques qui s'élèvent dans l'atmosphère. Tantôt, comme l'amant qui a perdu l'objet de sa passion, il fait entendre des sons tristes et plaintifs ; tantôt, comme celui qui retrouve une maîtresse adorée, il se charge de parfums exquis. Les nuées qui répandent leurs ondées rafraîchissantes ; le roucoulement monotone de la colombe; le frémissement de la branche qui la soutient ; le crépuscule de l'aube matinale ; la camomille, lorsque le nuage, chargé de l'éclair et de la foudre, vient agiter sa corolle ; le printemps, qui, accompagné de la rose son interprète, amène de si doux changements dans la nature ; tout ce qui existe et qui est destiné à ton utilité, ô homme insensible aux grâces du Créateur! tout, oui tout célèbre les bienfaits de Dieu, confesse son existence, le remercie, le bénit; oui, de chaque chose, on peut tirer une preuve de son unité.

MON attention fut d'abord réveillée par le gémissement du zéphyr, qui, voulant célébrer la langueur et la volupté de son souffle, semblait par ses soupirs emblématiques moduler ces paroles : Fidèle messager des amants, je porte, sur mes ailes les soupirs brûlants de celui qu'agite la maladie de l'amour, à l'objet qui peut seul remédier à ses maux. Je transmets avec exactitude les secrets que l'on me confie, et je redis les nouvelles telles que je les ai entendues. Si je rencontre un voyageur, mon haleine devient plus douce; ce ne sont que cajoleries, que badinages, que jeux familiers. Je règle cependant ma conduite sur la sienne: s'il est bon, je le caresse d'un souffle voluptueux ; est-il méchant, au contraire, je le moleste de mon vent importun.
Mon haleine légère et odorante donne la santé à l'infirme, et rend paisible et agréable le sommeil du midi. Si mon frémissement agite le feuillage, celui qui aime ne peut retenir ses soupirs ; et il dit sa peine à l'oreille de sa maîtresse, si mon murmure se fait entendre. La douceur et la mollesse composent mon essence : celui qui jouit des faveurs de Dieu, est le seul qui sache m'apprécier. N'est-ce pas à mon souffle vivifiant que l'atmosphère doit la pureté dont elle jouit ! Et ne t'imagine point que la mobilité que tu remarques dans ma nature soit l'effet d'un vain caprice ; c'est pour ton utilité et ton avantage, que mon haleine suit les saisons dans leurs variations diverses. Au printemps, je souffle du côté du nord, je fertilise les arbres, et je rends la nuit égale au jour. Dans l'été, mon souffle, parti de l'orient, favorise le développement des fruits et donne aux arbres le degré le plus parfait de leur beauté. Dans l'automne, je souffle du côté du midi; alors tous les fruits acquièrent leur perfection, et parviennent au dernier terme de leur maturité. Dans l'hiver enfin, je souffle des régions de l'occident ; et c'est ainsi que je soulage les arbres du poids de leurs fruits, et que je fais sécher les feuilles sans altérer les branches. C'est moi qui mûris les fruits, qui donne aux fleurs leur coloris brillant, aux ruisseaux leurs chaînes argentées ; c'est moi qui fais parvenir aux arbres le pollen qui les féconde ; à la maîtresse les soupirs du cœur qu'elle a enflammé ; et c'est encore mon haleine parfumée qui annonce au pèlerin de l'amour qu'il approche de la tente de sa bien-aimée.
Oh! combien est doux ce que le zéphyr est venu rapporter à mon oreille de la beauté de ce site élevé! Il s'est plu à répandre l’odeur balsamique dont il s'était chargé, et à m'enivrer de ce parfum délicieux. Lorsque les premiers soupirs de cet amour qui me consume s'échappèrent de mon sein, le zéphyr semblait les seconder de son haleine mourante. La brise fraîche et embaumée du matin aurait dû étancher la soif de ma passion; mais ayant passé, durant la nuit, auprès de ces pavillons printaniers et de ces tertres élevés, et s'étant imprégnée des émanations musquées qui se répandent de la tente de ma maîtresse, elle a rendu bien plus violent le feu de mon amour et de ma souffrance. Ivre de plaisir, je n'ai pu revenir à moi, ni rappeler mes esprits. Attentif à la voix du zéphyr, j'ai compris le secret que mes rivaux n'ont pu deviner, et j'ai entendu ce qu'ils n'ont pas entendu. J'ai su que, dans un lieu où le vin excitait à la volupté la plus pure, mon amie adorée a laissé voir l'éclat de sa beauté, sans qu'aucun voile vînt dérober ses appas, et a montré à ses amants fidèles ce visage ravissant, inaccessible pour l'ordinaire aux regards les plus avides.
Après que j’eus compris les paroles que semblait proférer le zéphyr, tandis que je cherchais à interpréter le sifflement du merle, et que je réfléchissais sur les couleurs variées des fleurs, la rose en exhalant son parfum m'annonça sa douce venue, et s'exprima ainsi dans son langage muet : Je suis l'hôte qui vient entre l'hiver et l'été, et ma visite est aussi courte que l'apparition du fantôme nocturne : hâtez-vous de jouir du court espace de ma fleuraison, et souvenez-vous que le temps est un glaive tranchant. J'ai à la fois et la couleur de la maîtresse, et l'habit de l'amant : j'embaume celui qui respire mon haleine ; je cause à l'innocente beauté qui me reçoit de la main de son ami une émotion inconnue. Le temps de ma durée est comme une visite que je fais aux hommes ; et celui qui espère me posséder longtemps est dans l'erreur.
Pourquoi faut-il qu'en butte à la fortune contraire qui m'abreuve d'amertume, partout où mon bouton s'épanouit, un cercle d'épines m'entoure et me presse de toutes parts ! Les aiguillons acérés et les flèches aiguës de mes épines me blessent, et, répandant mon sang sur mes pétales, les teignent d'une couleur vermeille. Voilà ce que j'endure; et je suis cependant le plus noble des hôtes, le plus élégant des voyageurs. Mais, hélas ! personne n'est à l'abri des tourments et des peines ; et du moins celui qui saura les supporter, atteindra l'objet de ses vœux. Brillante de fraîcheur, je suis parée du vêtement de la beauté, lorsque, tout-à-coup, la main des hommes me cueille et me fait bientôt passer du milieu des fleurs dans la prison de l'alambic: alors mon corps est liquéfié et mon cœur est brûlé; ma peau est déchirée et ma force se perd; mes larmes coulent, et personne ne les arrête, personne n'a pitié de moi. Mon corps est en proie à l'ardeur du feu, mes larmes à la submersion, et mon cœur à l'agitation. La sueur que je répands est un indice irrécusable des tourments que le feu me fait endurer. Ceux que consume une chaleur brûlante, reçoivent de mon essence du soulagement à leurs maux, et ceux que les désirs agitent, respirent avec plaisir mon odeur musquée. Lorsque mes agréments extérieurs quittent les hommes, mes qualités intérieures restent toujours au milieu d'eux. Les contemplatifs, qui savent tirer de ma beauté passagère une allégorie si instructive, désirent le temps où ma fleur orne les jardins, et les amants voudraient que ce temps durât toujours.
Si je t'ai quittée corporellement, mon esprit n'est-il pas toujours auprès de toi ! Fais-y réflexion, et tu ne mettras aucune différence entre ma présence et mon éloignement. Il a bien raison, celui qui me dit: On peut te comparer à la rose, qui disparaît, mais qui laisse son essence.
A peine le myrte eut-il compris, le langage muet de la rose ; qu'il lui adressa ces mots dans le même langage : Déjà les nuées semblent jouer au trictrac et disséminent des perles éclatantes ; le zéphyr dit son secret ; le béhar répand ses trésors parfumés ; le printemps est fier des guirlandes qui l'embellissent; les fleurs, ne cherchant qu'à plaire, et non contentes d'orner les jardins les plus beaux veulent briller dans d'autres lieux ; le rossignol chante ses amours; le bosquet, rendez-vous, de l’amant, reprend, son éclat printanier. Viens, ô ma compagne, divertissons-nous, et, fiers de notre beauté, saisissons les moments fugitifs de la joie, sans en laisser échapper la plus petite partie.
La rose, surprise des leçons du myrte, reprit aussitôt la parole en ces termes : Peux-tu tenir un pareil langage, toi le prince des végétaux odorants ? non, dussé-je te fâcher, ce n'est pas ainsi que tu devrais t'exprimer; et ton conseil pernicieux te rend indigne, du rang distingué que tu occupes parmi les fleurs. Qui pourra atteindre le but, si tu erres ; qui dirigera, si tu t'égares ? Tu engages tes sujets à venir jouer auprès de toi, et tu les excites à se divertir. Quoi ! celui qui est à la tête des autres doit-il avoir des idées si peu saines! Mais que ta beauté, ne t'enivre point, parce que tes rameaux se balancent mollement, que tes feuilles sont d'un vert harmonieux, et que ton origine est noble. Tu es l'image des jours heureux de la jeunesse, qui fuient et disparaissent avec tant de rapidité. Tels sont les instants toujours si courts que l’on passe auprès d'une amante adorée ; tels sont encore ces prestiges fantastiques qui, durant la nuit, viennent assiéger l'imagination, que rien n'interrompt et qui cependant ne peuvent jamais se terminer.
Déjà, à l'aspect du printemps, les champs se couvrent d’un vêtement de verdure qu'ornent mille fleurs, dont les variétés sont aussi multipliées que celles des animaux qui peuplent la terre. De ces fleurs, les unes font le charme de l’odorat et se fanent ensuite; on tire des autres d'heureuses allusions, et on rapporte leur langage allégorique: celles-ci sont le jouet des rigueurs du sort ; celles-là, privées de vie, sont étalées sur les tertres de la campagne. Parmi les végétaux, il y en a dont on mange les fruits et qui font la base de la nourriture des hommes; mais bien peu échappent aux flammes dévorantes : et cependant, si ce n'était la prédestination et la prémonition, ils seraient tous à l'abri de cette fin cruelle. Mon frère, ne te laisse point séduire par les plaisirs apparents que t’offre le caravansérail de ce monde; les lions du trépas ont la gueule béante pour te recevoir. Voilà l'avis que je crois devoir td donner. Adieu.
Le narcisse, regardant alors le myrte son compagnon, lui expliqua ainsi sa pensée : Toujours auprès des fleurs, je me plais à les considérer ; je m'entretiens avec elles au clair de la lune, et je suis constamment leur camarade : ma beauté me donne le premier rang parmi mes compagnes ; et je suis néanmoins leur serviteur; aussi apprendrai-je à quiconque le désirera, quelles sont les obligations du service.
Je me ceins les reins de la ceinture de l'obéissance, et, toujours prêt à exécuter les ordres, je me tiens humblement debout comme l'esclave. Je ne m'assieds point avec les autres fleurs, et je ne lève pas la tête vers mon commensal ; je ne suis jamais avare de mon parfum pour celui qui désire le respirer; je n'oublie jamais ce que je dois à celui qui fait usage de moi, et je ne suis jamais rebelle à la main qui me cueille. Je me désaltère à chaque instant dans mon calice, qui est pour moi comme un vêtement distingué par sa pureté; une tige d'émeraude me sert de base, et l'or et l'argent forment ma robe. Lorsque je réfléchis sur mes imperfections, je ne puis m'empêcher de baisser avec confusion les yeux vers la terre; et lorsque je médite sur ce que je dois devenir an jour, je pense au moment fixé par le destin pour le terme de mon existence. On sera peut-être étonné que je me livre ainsi à de sombres idées dans le fieu le plus agréable : j’avoue que l'odorat peut bien avoir une juste idée de mon parfum ; mais l'oreille ne pourra point entendre mes paroles allégoriques ni l'esprit en saisir le sens. Je veux, par l'humilité de mes regards, confesser mes défauts ; et si je baisse la tête, c'est pour considérer le moment cruel de ma fin.
Lorsque le terme de ma vie arrivera, pénible instant qui me couvrira de confusion et de honte, je me lèverai, les yeux humblement fixés sur la terre, à cause de mes fautes. Quand même j'aurais fait tous mes efforts et que j'aurais chassé de mes paupières le sommeil de la tiédeur, j'avouerais alors mon impuissance, et je craindrais d’être déçu dans mon espoir: à bien plus forte raison, après avoir précédemment commis des fautes graves, lorsque, au moment de mourir, je serai au nombre des repentants, quel fruit retirerai-je de ma science et de mes actions, puisque ma prunelle n'espérera plus revoir la lumière du jour ! Eh bien ! que dès ce moment une crainte salutaire dirige mes pas! hâtons-nous, la précipitation est inhérente à l'homme
Le nénufar, si remarquable par sa couleur triste et par son air languissant, tînt alors ce langage : Toi qui te repais de chagrin, jette le regard de l’attention sur la pâleur de ma corolle, et vois si je puis échapper aux décrets immuables du destin. Je me soumets à mon malheur; mais je ne renonce pas à l’amour. Si tu es amoureux, toi qui écoutes avec avidité mes leçons, use de ménagements, comporte-toi avec prudence. Les jardins sont mon habitation, et les lieux aquatiques le lit de mon repos; j'aime l’eau limpide et courante et ne m'en sépare ni le matin ni le soir, ni l'hiver, ni l'été. Ce qui est bien plus extraordinaire, c'est que, tourmenté d'amour pour cette eau, je ne cesse de soupirer après elle, et qu'en proie à la soif brûlante du désir qu'elfe m'inspire, je l'accompagne partout: mais as-tu jamais vu rien de pareil ! être dans l'eau, et se sentir dévoré par la soif la plus ardente. Lorsque le jour paraît, je déploie mon calice doré, et mille mains jalouses viennent fondre sur moi: au contraire, lorsque la nuit enveloppe la terre de ses ombres, l'onde m'attire vers elle ; ma corolle quitte sa position et s'incline ; je m'enfonce dans l'eau, qui me recouvre ; je me retire dans mon nid de verdure, et je reviens à mes pensées solitaires. Mon calice, comme un œil vigilant, est submergé dans l'eau, pour contempler ce qui fait son bonheur, et les hommes irréfléchis ne savent plus où je suis. Le censeur importun ne réussira pas à m'éloigner de l'objet de ma flamme. D’ailleurs, quelque part que mes désirs me portent, je vois que l'eau est toujours à mes côtés: si je viens la prier de soulager l'ardeur qui m'enflamme, elle m'abreuve de sa douce liqueur; si je lui demande un asile, elle me reçoit avec complaisance. Mon existence est liée à la sienne, et la durée de ma fleur dépend du séjour qu'elle fait auprès de moi. Enfin, c'est par l'eau seule que je puis acquérir le dernier degré de la perfection ; c'est à ses seules qualités que je dois les propriétés dont je suis pourvue. On ne me verra jamais sans cet objet adoré, car sans lui je ne pourrais exister en aucune manière.
L'amour a couvert mon corps du vêtement décoloré de la langueur ; troublé par la passion qui l'agite, mon esprit s'abandonne au plus noir chagrin. Lorsque l'amour décoche son trait, il semble que c'est moi qu'il veuille frapper de préférence à tout autre. La beauté cruelle que j'adore feint de venir auprès de moi, et elle excite dans mon sein un amour qui l'agite et le brise. Je ne vis que pour elle, et je veux mourir pour elle; oui, l'amour lui-même me préparera cette mort glorieuse. Il me dit : Ne rêve qu'amour, si tu veux jouir du bonheur que je promets. Je défends, par la pointe des lances, l'approche de ce divin objet : ce n'est qu'auprès de mes piques rembrunies que tu trouveras les douceurs que j'accorde. Ne t'afflige donc point de la blessure cuisante des flèches, ni de l’amertume de la peine; le bonheur en est le résultat. Imite ces amants fidèles qui sont morts d'amour pour leur divine maîtresse, mais qui ont obtenu l'objet de leurs désirs. Quand, après avoir traversé la mer Rouge, les ennuis d'Israël, épuisés de fatigue, entendirent sur le mont Sinaï ces douces paroles, « Je suis celui qui suis, » ils ne regrettèrent point leurs peines et leurs travaux.
Lorsque les arbres eurent vu que le saule était le seul d'entre eux dont les rameaux flexibles se balançassent, sans cesse, ils critiquèrent la mollesse de ses mouvements et censurèrent sa fierté et sa complaisance pour lui-même. Alors le saule agita de nouveau ses rameaux légers, et s'exprima ainsi dans son langage muet; A-t-on quelque chose à me reprocher ? pourrait-on blâmer le tremblement de mon feuillage et l’agitation de mes branches! C'est pour moi que la terre déroule ses tapis nuancés, que les prés déploient toute leur parure, et que l'haleine du zéphyr matinal répand ses douces émanations. Lorsque je m'aperçois que les végétaux sont sur le point de ressusciter, que la terre s'agite et se ranime, que la trompette de la promesse que Dieu m'a faite sonne, que l'accomplissement de cette promesse abroge la menace dont j'avais été l'objet, et que mes fleurs vont s'épanouir ; quand, d'un autre côté, je vois que déjà la rose a paru, que les frimas se sont retirés, que les fleurs brillent des plus vives couleurs, que le grain commence à se former, que déjà le rameau dépouillé se couvre de feuilles, que les différents végétaux destinés aux mets et aux boissons de l'homme s'unissent pour lui fournir la substance qui le fait vivre, je m'élève alors à la connaissance du créateur et du maître de toutes ces choses, et je reconnais qu'il est unique, éternel, tout-puissant ; qu'il n'a besoin de personne, et que personne ne peut se passer de lui, bien loin de partager son empire; qu'il n'a point engendré et n'a pas été engendré, et qu'aucun être enfin n'est semblable à lui. C’est par ces considérations que ma cime élevée s'agite pour se réjouir de la vision intuitive qui fait mes délices, et que les rossignols de mon bonheur gazouillent sur mes rameaux tremblants. Ensuite, par un effet de la grâce de Dieu, objet de mon culte, je pense au néant de mon être ; et, de crainte de manquer mon but, je me tourne vers la rose, je lui annonce ma venue, et, tandis que mes fleurs lui forment en tombant comme une robe élégante, je lui demande quel est l'objet de mon existence. Nous nous ressemblons parfaitement en tout, me répond-elle : si tes rameaux paraissent s'incliner pour prier le Très-haut, on dirait que les miens se prosternent pour l'adorer; si ta beauté consiste dans le vert de ton feuillage, la mienne consiste dans l'incarnat de mes joues. Mon frère, n'attendons pas le feu éternel qui doit nous consumer; jetons-nous nous-mêmes dans les flammes, pour nous offrir en holocauste.
Si tel est ton désir, lui répliqué-je, et si tu consens à périr, je ne m'y oppose point et je veux bien ne pas me séparer de toi. On nous arrache donc ensemble du milieu des fleurs nos compagnes ; on nous livre à un feu ardent qui fait monter nos esprits, et qui, sans pitié, fait couler nos larmes. Nos corps périssent, mais nos âmes restent ; notre beauté extérieure s'évanouit, mais nos qualités intérieures demeurent : il est vrai cependant qu'il y a une grande différence entre ce que nous étions et ce que nous devenons.
Déjà la rose était venue ; elle annonçait les propriétés agréables qu'elle possède, lorsque le saule à la taille légère se tourna vers elle pour se plaindre de la violence de l'amour dont il était épris, et s'inclina avec grâce pour respirer le parfum délicieux qu'elle exhalait. La rose, partageant sa douleur, lui dit : Amis intimes, en proie à la même ardeur, nous ne faisons qu'un et nos qualités sont les mêmes. Combien de fois n'avons-nous pas éprouvé les tourments les plus violents des flammes ! Mais jamais mon compagnon n'a perdu de vue l’objet de sa passion, et jamais je n'ai oublié l'objet de la mienne: Combien de fois aussi des mains avides ne nous ont-elles point privés de nos rameaux encore verts ! On ne saurait comprendre à quel point la flamme cruelle tourmente nos entrailles, et dans quel brasier nos cœurs sont consumés. Le feu sépare nos esprits de nos corps, comme il a commencé par nous priver de nos forces. Nous nous plaignons tous deux des mêmes douleurs, quoique chacun nous ayons l'objet particulier de notre amour. Je le jure par celui qui de toute éternité repose sur son trône, et mon serment est véritable, il y a dans l'exposition de ma peine un sujet de réflexion pour les gens sensibles, dont le cœur est éloigné du mal : j'étais hier comme la pleine lune qui se lève, et je suis aujourd'hui comme une étoile qui disparaît.
Alors la violette soupira d'une manière plaintive, comme celui que les peines de l'absence affligent; et, dans son langage emblématique, elle m'adressa ces réflexions : Qu'il est digne d'envie, celui qui a vécu de la vie des heureux et qui est mort martyr ! Pourquoi faut-il que je me fane, consumée de chagrin, et que je paraisse sous le vêtement de la maigreur et de la tristesse. Les décrets immuables du destin m'ont changée et ne m'ont laissé ni peau ni force; les vicissitudes du temps ne m'ont point permis de prolonger mon existence et m'ont fait périr impitoyablement. Qu'ils ont été courts les instants où j'ai joui d'une vie agréable, tandis qu'au contraire je suis restée si longtemps sèche et dépouillée de mes feuilles !
Aussitôt que ma corolle s'ouvre, on vient me cueillir et m'enlever de mes racines, sans me laisser le temps de parvenir au terme de ma croissance; et il ne manque pas de gens qui, abusant de ma faiblesse, me traitent avec violence, sans que mes agréments, ma beauté et ma fraîcheur puissent les arrêter. Je cause du plaisir à ceux qui sont auprès de moi, et je plais à ceux qui m'aperçoivent: mais à peine se passe-t-il un jour, ou même une partie d'un jour, que déjà l’on ne m'estime plus, qu'on me vend au plus bas prix, après avoir fait le plus grand cas de moi, et qu'on finit par me trouver des défauts, après m'avoir comblée d'éloges. Le soir, par l'influence de la fortune ennemie, mes pétales se roulent et se fanent ; et le matin, je suis sèche et sans beauté. C'est alors que les gens studieux et livrés aux sciences naturelles me recueillent : avec mon secours, ils dissipent les tumeurs répandues sur le corps ; ils apaisent les douleurs rebelles ; ils adoucissent les tempéraments secs, et ils éloignent enfin bien des maux qui attaquent l'humanité. Fraîche, je fais jouir les hommes de la douceur de mon parfum et du charme de ma fleur ; sèche, je leur rends la santé. Mais ces mêmes hommes ignorent mes qualités les plus précieuses, et négligent de scruter les vues de sagesse que Dieu a déposées en moi. J'offre cependant un sujet de réflexion bien utile à celui qui, en m'étudiant, cherche à méditer et à s'instruire ; car les leçons que l’on peut tirer de ma manière d'être, suffisent pour retenir celui qui n'est pas sourd à la voix de la raison. Mais, hélas ! tout avertissement est inutile.
J'ai considéré avec admiration la violette, et j'ai vu que ses fleurs, sur leurs pédoncules, ressemblent à une armée dont les voltigeurs, d'émeraude, auraient orné de saphirs leurs lances, et auraient adroitement enlevé avec ces lances les têtes de leurs ennemis.
Alors la giroflée, fière de son coloris, répandit son doux parfum, et sembla dire ces paroles : Pourquoi se laisser séduire par les charmes d'une vie qui nous est arrachée au moment que nous nous y attendons le moins! Pourquoi se réjouir follement d'une existence que mille accidents ne cessent de troubler! Si tu veux prendre une leçon instructive, considère ma tige inclinée, ma couleur qui se passe, ma vie qui finit sitôt, et le petit nombre d'instants que dure ma fraîcheur. Les révolutions du temps ont changé ma couleur première, et en ont formé trois différentes nuances qui constituent autant de variétés.
La première se présente sous le vêtement jaune du mal de l’amour; la seconde s'offre à tes regards, vêtue de la robe blanche de l'inquiétude produite par les tourments de la séparation; la troisième enfin paraît sous un voile bleu, en signe du chagrin qui la consume. Quant à la variété blanche de ma fleur, elle n'a ni éclat, ni parfum ; aussi l'odorat dédaigne-t-il sa corolle, et l’on ne vient point enlever le voile qui couvre ses appas. La raison, c'est qu'elle cache soigneusement son secret, qu'elle renferme en elle-même son parfum, et qu'elle dérobe ses trésors avec tant de soin, que ni les désirs ni les vents ne peuvent en jouir. La variété jaune, au contraire, se promettant de séduire, prend, dans ce dessein, un air de volupté et de langueur ; répand le matin et le soir son odeur musquée ; et à l'aurore ainsi qu'au coucher du soleil, laisse échapper son haleine odorante.
Jamais le doux zéphyr, chargé de vapeurs parfumées, ne s'élève de la plaine où est placée ta tente adorée, sans que des larmes causées par la douleur ne coulent de mes paupières. Hélas ! si ce n'était toi qui habites cet asile sacré, jamais une flèche meurtrière n'aurait percé mon sein. Tu as fait mon cœur esclave; je te l'abandonne, je rende les armes : ah! ne me tourmente point par de cruels chagrins.
Si, pressé par les désirs de mon amour, je confie ma peine au zéphyr, peux-tu m'en faire un reproche!
Ne me blâme point, ô mon frère! quand je découvre la passion qui m'expose à l'ignominie. Va, l'amant qui trahit son secret n'est pas coupable ; il est vaincu par la violence de son ardeur.
Pour ce qui est de ma variété bleue, elle comprime sa passion, elle supporte sa peine avec patience, et jamais elle n'exhale son odeur durant le jour. Tant que le soleil répand sa lumière, dit-elle, je ne manifeste point mon secret à ceux qui m'aiment, et je ne prodigue pas mon arôme à ceux qui viennent le respirer ; mais dès que la nuit m'a couverte de ses ombres, je décèle mes trésors à mes amis et je me plains de mes maux à ceux qui souffrent les mêmes peines que moi. Lorsque les coupes font la ronde, je bois à mon tour; et lorsque l'instant me paraît favorable, j'exhale mes émanations nocturnes et répands un parfum aussi doux, pour ceux qui sont auprès de moi, que la société d'un ami qui console. Toutes les fois que l'on recherche ma présence, je cède avec empressement à l'invitation, et je me contente de me plaindre à Dieu de ce que des cœurs durs me font souffrir. Sais-tu pourquoi je retiens mon parfum durant le jour, et que je n'ôte mon voile que durant la nuit ! C'est parce que ce sont les ténèbres que les amants choisissent pour leur tête-à-tête, et que la maîtresse attend ce moment pour se montrer à son bien-aimé. Dans cet instant heureux, le rival importun est absent et tout facilite l'accès de ta divine amie : aussi, à peine s'est-elle informée des besoins de ses amants, que s’élève vers elle mes soupirs, comme des épîtres amoureuses, et lui présente mon humilité comme intercesseur.
Je dirige vers ma maîtresse les soupirs enflammés de mon amour, et je lui présente le parfum de mon hommage. Pour obtenir le doux instant de bonheur que j’ambitionne, je n'ai d'autre intercesseur que la pureté de mes vues et mon humilité. Que cette amie agrée mon hommage, ou qu'elle le rejette (cruelle alternative qu'il est impossible d'éviter), mon amour n'en est pas moins le même.
Alors le jasmin proclama cette sentence, avec l'éloquence expressive de son langage muet : Le désespoir est une erreur. Mon odeur pénétrante l'emporte sur le parfum des autres fleurs; aussi les amants me choisissent-ils pour m'offrir à leurs maîtresses. On me tire des trésors invisibles de la divinité, et je ne me repose que dans les sortes de pièges que forment sur le sein les plis de la robe. L'homme dont le cœur est sensible aux charmes de la vie contemplative, distingue facilement l'odeur balsamique que j'exhale sans cesse ; et celui qui est en proie à un amour violent, ne méconnaît pas mon mérite. Mon parfum est préférable, je le répète, à celui des autres fleurs, et l'haleine embaumée qui s'échappe de mon sein, est bien au-dessus de celle de mes compagnes. En effet, l'homme dont les qualités sont pures est vraiment bon et religieux; et celui dont les prétentions sont fondées, mérite d'acquérir du lustre et de l'éclat. O toi qui désires parvenir aux degrés les plus élevés du spiritualisme, cherche à acquérir des mérites et des vertus, afin de pouvoir franchir l'échelle de la vie intérieure; mais si tu n'oses approcher de la carrière mystique, n'espère pas jouir de la protection spéciale que Dieu accorde à ceux qui s'y engagent.
Mon nom offre une énigme dont le sens propre ne peut que plaire aux novices dans la vie spirituelle : il est composé de deux mots différents, désespoir et erreur ; or le désespoir est une erreur, et l'erreur, une honte. Quand donc les mots désespoir et erreur sont réunis, ils indiquent la cessation du malheur, et pronostiquent la félicité et la joie.
Je vois l'augure venir m'annoncer le bonheur en me donnant le jasmin. Cesse de te chagriner, le chagrin a quelque chose de honteux ; et ne désespère point, car le désespoir est une erreur.
Voici le moment où ma fleur orne ton jardin, dit alors le basilic ; donne-moi donc tes ordres, et prends-moi pour ton commensal. Mes feuilles fraîches et délicates t'annoncent mes rares qualités : de même que la danse ne saurait être agréable sans le son des instruments, ainsi l'esprit ne saurait être réjoui sans moi qui sers à le fortifier. Je suis promis aux élus dans le paradis; ma couleur est la plus harmonieuse de toutes les couleurs; dans ma forme, je n'ai point d'égal; et mon sein renferme un parfum précieux, qui pénètre jusqu'au fond des cœurs, et que connaît celui qui vient me cueillir dans mon parterre. Je suis l'ami des ruisseaux, et le compagnon des fleurs; je partage les secrets de ceux qui s'entretiennent au clair de la lune, et j'en suis le dépositaire le plus fidèle. Cependant tu auras peut-être entendu dire qu'il existe un délateur (la menthe) parmi les êtres de mon espèce ; mais, je t'en prie, ne lui fais pas de reproches : il ne répand que sa propre odeur ; il ne divulgue qu'un secret qui le regarde ; il ne dévoile enfin que ce qu'il peut découvrir. S'il manifeste ses trésors, il est bien le maître de les produire au jour; s'il exhale son odeur, lui est-il défendu de se faire connaître ? Et voilà cependant l’unique cause qui lui a fait donner le nom injurieux de délateur. Mais celui qui est indiscret pour lui-même, ne peut être assimilé à celui qui révèle des secrets qu'on lut a confiés ; de même que Celui qui prodigue le bien qu'il possède, ne peut être mis en comparaison avec celui que son naturel pervers porte à faire du mal. Quoi qu'il en soit, il est certain que tous les hommes conviennent, d'une manière irrévocable, que rien n'est plus blâmable que la délation. Mon frère, réfléchis là-dessus. Adieu.
O toi qui veux pénétrer le secret de mon amour, cesse tes instances, je t'en conjure, et laisse-moi avec ma passion. J'ai reçu en dépôt le doux secret que m'a confié mon amie; pourquoi veux-tu que je le divulgue ! je ne suis point un indiscret.
La camomille, ravie de sa propre beauté, exalta ainsi son mérite : Voici le temps de ma venue ; voici l'époque où j’embellis les champs, où ma végétation est dans toute sa vigueur, où ma beauté est plus douce et plus agréable. Comment les jours où ma fleur s'épanouit, ne seraient-ils pas délicieux! ces ruisseaux mentionnés si souvent dans le Coran ne viennent-ils pas baigner mes tiges ? Et comment ne paierais-je pas avec reconnaissance ma dîme annuelle, puisque, sans avoir employé la force ni la violence, les bienfaits, au contraire, de tout ce qui m'entoure, me font un devoir de la payer ! Mes pétales blancs servent à me faire connaître de loin, et mon disque jaune imprime une douce langueur sur ma corolle : on peut comparer la différence de ces deux couleurs, à celle qui existe dans les versets du Coran, dont les uns sont clairs et les autres obscurs.
Si tu es en état de comprendre les emblèmes, lève-toi et viens profiter de ceux qui te sont offerts; sinon, dors, puisque tu ne sais pas interpréter la nature qui te déploie ici tous ses charmes : mais, il faut l'avouer, ton ignorance est bien coupable.
Ne me blâme point si tu ne saisis pas le sens caché de ce que je te dis, et si tu ne comprends pas les mystères de mes allégories : c'est par pure compassion pour toi que je te parle dans le langage expressif des emblèmes ; mais c'est en vain ; ton oreille est sourde à mes leçons. Eh quoi ! tu ne sais pas tirer une utile instruction de ma mort apparente, qui a lieu chaque année, et des tourments cruels que les destins me font souffrir ! Tu es souvent venu m'admirer, lorsque ma fleur épanouie brillait du plus doux éclat; tu es venu de nouveau peu après, et tu ne m'as plus trouvée. Lorsque je conte ma peine aux colombes du bosquet touffu, elles calment mes ennuis, et semblent répondre à mes gémissements ; car elles n'ignorent pas que je suis exposée à mille genres de morts. Tu prends ces plaintes douloureuses pour le chant du plaisir et de la volupté, et joyeux tu te divertis sur le gazon émaillé de mes fleurs : hélas ! il est fâcheux que tu ne saches pas distinguer, ma gaieté d'avec ma tristesse.
Lorsque la lavande eut vu les peines et les tourments que souffrent les fleurs, tantôt entassées en gerbes, tantôt étalées, puis abandonnées au mépris : Oh ! que je suis heureuse, dit-elle, de ne pas être au nombre des fleurs qui ornent les parterres ! je ne risque pas de tomber entre des mains viles, et je suis à l'abri des discours du censeur. Contre la coutume de la plupart des plantes, la nature me fait croître loin des ruisseaux et des terrains inclinés et humides. De même que les bêtes sauvages, je me tiens éloignée de la société, et mon séjour est constamment dans les déserts et dans les solitudes : j'aime les lieux isolés; et je ne me mêle jamais dans la foule. Comme personne ne me sème ni ne me cultive, personne n'a à me reprocher les soins qu'il m'aurait donnés. Les mains d'un esclave ne me cueillent pas, et l'on ne me porte jamais ni au joueur, ni à l'homme vain et frivole. Si tu viens à Najd, tu m'y trouveras : là, loin des demeures des hommes, une plaine spacieuse fait tout mon bonheur, et la société de l'absinthe et des gazelles est mon unique plaisir. Le vent se charge de mes émanations balsamiques, et les porte à ces fervents anachorètes qui, retirés du monde comme moi, ne s'occupent qu'à des exercices de piété : aussi puis-je dire que celui-là seul respiré mon odeur, qui, passionné pour la vie contemplative et animé d'un amour ardent et véritable, a la piété du Messie et la patience d’Ismaël. Le matin et le soir, je suis la compagne du pèlerin qui traverse le désert ; je jouis des avantages de la société des bons, et je suis à l'abri de celle des méchants : on ne m'oblige point à paraître dans des réunions illicites, et je ne suis jamais auprès de celui qui boit et qui s'enivre. Je suis semblable à l'homme libre que l'on n'acheta jamais, et ne suis point exposée en vente dans les marchés, comme l'hypocrite qui a contrefait sa religion. Les libertins ne me recherchent point; mais celui-là seul m'estime, qui, formant un dessein inébranlable, se découvre la jambe, s'élance sur le coursier rapide de la résolution, et le pousse dans l'arène du spiritualisme. Je voudrais que tu fusses dans le désert, lorsque la brise du matin erre auprès de moi dans les vallées. Mon odeur fraîche et aromatique parfume le Bédouin solitaire ; mon exhalaison humide réjouit l'odorat de ceux qui se reposent auprès de moi : aussi, lorsque le chamelier vient à décrire mes rares qualités aux gens de la caravane, ne peuvent-ils s'empêcher de reconnaître avec attendrissement mon mérite.
Le zéphyr vient me dire de douces choses de la part de la lavande, et m'apporter le salut de l'absinthe. Mon amour est couronné du succès; je le comprends à ce langage figuré. Heureux état! puisse-t-il durer toujours! La brise s'avance dans le mystère de la nuit, et, tandis que mes compagnons sont plongés dans un profond sommeil, elle me réveille doucement : son souffle rafraîchissant et balsamique excite en moi une émotion qui me rend semblable à celui que trouble l'ivresse. Le zéphyr, toujours chargé d'émanations odorantes, et que la bonté divine a doué des qualités les plus précieuses, m'environne de sa frémissante haleine, comparable aux soupirs de mon amour, et ma passion prend de nouvelles forces. J'erre à la poursuite de ce vent parfumé, plongé dans la joie et dans l'amour le plus pur, et l’éclair semble sourire en voyant mes transports. Le zéphyr passe sur les campagnes de Najd, et les rameaux flexibles s'inclinent devant lui, comme par respect. Les colombes du bocage voisin me rappellent, par leur roucoulement plaintif, ces tentes et ces pavillons chéris, où tant d'amants empressés accourent en foule, pour recevoir le prix de leur amour et de leur constance : c'est là que l'idole qu'appellent mes soupirs, laisse voir ces traits radieux dont la splendeur dissipe les ténèbres de la nuit !
L'ANÉMONE, que l'on distinguait de loin au milieu de ses compagnes, par la teinte de sang qui colore ses pétales, soupira alors, et, soulevant sa tige inclinée, sembla dire ces paroles : Pourquoi ai-je si peu de part aux hommages que l’on rend aux autres fleurs, quoique ma beauté soit éclatante et ma couleur agréable ! Quoi ! personne ne fait l'éloge de mes agréments, personne ne désire me cueillir ! Quelle est donc la cause de cette indifférence marquée! Je m'enorgueillis des riches nuances de mon vêtement, et cependant celui qui m'aperçoit me dédaigne : on ne me place point dans les vases qui décorent les salons ; que dis-je ! je semble rebuter également et la vue et l'odorat; on ne me donne que le dernier rang parmi les fleurs qui ornent les parterres ; on va même jusqu'à me chasser du milieu d'elles, et à m'éloigner de leur douce compagnie. Tout cela n'a lieu, à ce que je m'imagine, que parce que mon cœur est noir; mais que puis-je contre les décrets de la providence! Aussi, en considérant que mon intérieur est plein de défauts, et que mon cœur est souillé de vices, et sachant que le très-haut ne fait pas attention aux formes extérieures, mais seulement aux qualités du cœur, je vois que ma complaisance pour ma beauté apparente est précisément ce qui m'a privée de la faveur divine. Je suis semblable à l’hypocrite, dont la conduite est irréprochable en apparence, mais dont l’âme renferme la turpitude : au dehors, son mérite ne saurait être trop prisé ; mais au fond il est bien petit. Si mon intérieur était conforme à mon extérieur, je ne serais pas obligée de me plaindre, et si Dieu l'eût voulu, j'aurais pu être, estimée et offrir à l’odorat une émanation suave ; mais le bien ne provient que de celui qui est réellement bon. C'est ainsi que les signes de la faveur ne paraissent que sur ceux dont la divine maîtresse a agréé les hommages. Qu'il gémisse douloureusement et qu'il verse des larmes abondantes, celui que les dédains de sa céleste amie plongent dans le chagrin, et qui est privé de connaître l'essence véritable de cette éternelle beauté !
Ne me blâme point si j'ai déchiré mes vêtements; ton reproche aggraverait le mal que l’amour m'a causé. Mes fautes ont noirci mon âme, et le destin contraire a fixé l'arrêt de mon malheur. Ceux qui me voient, m'admirent; mais, hélas ! celui qui m'a formé sait que je renferme un cœur hypocrite: mon extérieur est la beauté même ; mais les vices sont renfermés dans mon sein coupable. Quelle honte, lorsqu'au dernier jour je serai interrogé! hélas! je n'aurai point d'excuse à apporter. Ah ! si tu écartais le voile qui cache mon ignominie, tu verrais la joie sur le visage de ceux qui me haïssent.
Lorsque la nue crut que le moment était favorable pour faire entendre son langage emblématique, elle répandit des pleurs, s'étendit et s'agita dans le vague des airs, et sembla prononcer ces mots : Végétaux, pouvez-vous méconnaître les bienfaits dont je vous comble, moi qui favorise votre croissance de mon ombre et de ma pluie! N'êtes-vous pas les enfants de ma libéralité ? pourriez-vous même exister sans moi ? Grâce à ma bienfaisance, les champs ne se couvrent-ils pas d'épis dorés, la mer ne s'enrichit-elle pas de perles étincelantes ?Je nourris les germes des plantes dans le sein de leur mère, et je les débarrasse peu à peu de ce qui gênait leur croissance. Quand ensuite les graines, comme la femme féconde, ont mis au monde leurs embryons, et que j'ai fait paraître les jeunes plantes hors du creux de sable où elles étaient, je me charge d'en avoir soin et de les élever, et la mamelle de mes bienfaits, comme celle d'une femelle de chameau au lait abondant, ne cesse de leur fournir l’eau nécessaire à leur développement progressif. Mais lorsque le temps de l'allaitement est fini, et que le moment du sevrage arrive, alors je cesse de leur tendre mes mamelles ; aussi se dessèchent-elles bientôt, et ce ne sont que mes larmes abondantes qui les rendent à la vie, et que les gouttes de mes pleurs généreux, qui leur redonnent la fraîcheur. Tous les êtres qui existent sont vraiment mes enfants ; n'a-t-on pas en effet entendu dans toutes les tribus ce passage du Coran : Nous avons donné la vie à chaque être par le moyen de l'eau!
Lorsque je vois ce pavillon printanier, jadis séjour de ma maîtresse, aujourd'hui vide et inhabité, je ne puis m'empêcher de verser des pleurs semblables à ceux que tu répands dans une ondée légère. L'amant laisse échapper des larmes de joie, tandis que l’éclair semble sourire, et que le zéphyr de l'espérance apporte à son oreille de douces nouvelles ; il soupire alors amoureusement, en se tournant vers les vestiges, à demi effacés, de l'habitation de son amie.
Ne lui fais pas de reproches sur son amour, ne blâme point sa passion ; tu n'apporterais aucun remède à ses maux. Pour toi, laisse ces violents désirs ; une ardeur brûlante, un chagrin dévorant, voila ce que tu en retirerais.
Tandis qu'assis sur le bord du ruisseau qui sillonnait ce jardin, je prêtais mon attention au langage muet des fleurs qui l'embellissaient, tout-à-coup des voix éloquentes s'élevèrent des nids suspendus aux cimes des arbres qui me couvraient de leur ombre. J'entendis d'abord la voix mélodieuse du rossignol, qui, se promettant de séduire par la beauté de son chant, laissa échapper les secrets qu'il cachait avec soin, et sembla ; dans son gazouillement emblématique, bégayer ces paroles : Je suis un amant passionné, ivre d'amour, dévoré par la mélancolie et brûlé par la soif du désir. Lorsque tu verras le printemps arriver, et la nature entière reprendre alors un aspect riant, tu me trouveras tout joyeux dans les jardins, ou tu m'apercevras çà et là dans les bosquets, soupirant mes amours, chantant et sautillant sans cesse sur les branches. Si l'on me présente la coupe, je m'y désaltère, et, satisfait du son harmonieux de ma voix, ivre de l'odeur embaumée que je respire, lorsque les feuilles mobiles frémissent au souffle caressant du zéphyr, je me balance sur les rameaux agités: les fleurs, et le ruisseau qui traverse la prairie, occupent tous mes moments, et sont pour moi comme une fête perpétuelle. Tu t'imagines pour cela que je suis un amant folâtre : tu te trompes ; j'en fais le serment et je ne suis point parjure. Mon chant est léchant de la douleur, et non celui de la joie ; les sons que je fais entendre sont les accents de la tristesse, et non ceux du plaisir. Toutes les fois que je voltige dans un jardin, je balbutie l'affliction qui va bientôt remplacer la gaieté qui y règne ; si je suis dans un lieu agréable, je gémis sur sa ruine prochaine ; si j'aperçois une société brillante, je pleure sur sa séparation. En effet, je n'ai jamais vu de félicité durable ; la paix la plus douce est bientôt troublée, la vie la plus délicieuse devient bientôt amère. J'ai lu d'ailleurs dans les écrits allégoriques des sages, ces mots du Coran : Tout passe dans le monde présent. Comment donc ne point gémir sur une situation si peu assurée, sur un temps exposé aux vicissitudes de la fortune, sur une vie qui s'évanouit, sur un instant de volupté qui va finir! Voilà l'explication de ma conduite ; je pense que cela te suffit.
Ce qui seul soutient mon existence, c'est de m'entretenir de ce lieu sacré, séjour inaccessible de celle que j'adore. Ne me blâme point, si tant de fois je répète les chants de mon amour; quel mortel ne serait pas ivre de volupté, en pensant à un jardin où des plantes odorantes embaument l'air de leur parfum, où des vins délicieux excitent au plaisir, où des fleurs dont rien n'égale le charme et la beauté, ornent la terre d'un tapis nuancé, ici d'un blanc pur ou d'un rouge éclatant, la d'un vert tendre, plus loin d'un jaune foncé! Le ruisseau, les fleurs, les rameaux, semblent s'agiter dans l'arène de mon amour, au son des cordes de ma lyre. Les obstacles cessent, et je vois arriver enfin l'heureux moment du bonheur… Douces pensées, vous êtes ma vie, sans vous elle finirait.
Le faucon, du milieu de l'enceinte de la chasse, prenant aussitôt la parole: Quoique tu sois bien petit, dit-il au rossignol, tes torts sont bien grands: ton chant continuel fatigue les oiseaux, et c'est l'intempérance de ta langue qui attire sur toi le malheur, sans pouvoir te procurer aucun avantage. Ne sais-tu donc pas que les fautes dont la langue se rend coupable, sont précisément ce qui perd l'homme. En effet, sans la mobilité de ta langue indiscrète, on ne t'enlèverait point du milieu de tes compagnons ; on ne te retiendrait point captif dans le séjour étroit d'une cage, et la porte de la délivrance ne serait pas irrévocablement fermée pour toi. Réponds, n'est-ce pas à ta langue que tu dois ces malheurs qui couvrent de honte ton éloquence ! Au contraire, si, me prenant pour modèle, tu imitais ma taciturnité, tu serais alors exempt de reproche, et tu verrais que cette qualité précieuse est compagne de la sûreté. Jette un regard sur moi; vois comme je suis fidèle aux règles du silence. Que dis-je ! la discrétion même de ma langue fait mon mérite, et l'observation de mes devoirs, ma perfection. Enlevé du désert par force, et emmené malgré moi dans un pays lointain, jamais je ne découvre le fond de ma pensée; jamais tu ne me verras pleurer sur des vestiges qui me rappelleraient un objet chéri. L'instruction, voilà ce que je recherche dans mon voyage : aussi mérité-je d'être récompensé toutes les fois qu'on me met à l'épreuve; car on connaît le proverbe : C'est l'épreuve qui décide si l'on doit honorer ou mépriser quelqu'un. Lorsque mon maître voit la perfidie du temps, il craint que je ne sois en butte à la haine, et il couvre alors ma vue avec le chaperon qu'indiquent ces mots du Coran : N'étends point la vue ; il enlace ma langue avec le lien qu'ont en vue ces paroles du même livre, Ne remue point la langue; il me serre enfin avec les entraves désignées par cette sentence du même ouvrage, Ne marche pas sur la terre avec pétulance. Je souffre d'être ainsi lié, et cependant je ne me plains point des maux que j'endure. Après que le chaperon a longtemps couvert mes yeux, que j'ai reçu les instructions nécessaires, que l'on m'a assez essayé et que j'ai acquis un certain degré d'habileté, mon maître veut m'employer à la chasse, et, me délivrant de mes liens, il me jette, et m'envoie avec le signal indiqué par ces mots du Coran, où Dieu, s'adressant à Mahomet, lui dit : Nous t'avons envoyé, &c. On n'ôte le chaperon de dessus mes yeux que lorsque je suis en état d'exécuter parfaitement ce qu'on m'a appris ; et c'est alors que les rois deviennent mes serviteurs, et que leur poignet est sous mes pieds orgueilleux.
J'interdis à ma langue l'excès de la parole, et à mes yeux le spectacle du monde : la mort menaçante, qui, chaque jour, s'avance avec plus de rapidité, me fait oublier les voluptés les plus délicieuses. Je ne m'occupe qu'à prendre les manières des princes, et à me former aux belles actions : la main du roi est le point de départ de mon vol ; je me dirige vers ma proie, bientôt je la saisis de mes serres victorieuses, et je reviens, au moindre signal, vers celui qui m'a envoyé.
Par ma vie, voilà quelle doit être la règle de ceux qui s'assujettissent aux lois sacrées de la soumission à la foi.
J'étais encore tout occupé des paroles agréables du faucon, et je méditais sur les leçons de sagesse et de prudence qu'il m'avait données, lorsque je vis devant lui une colombe ornée du collier de l'obéissance. Parle-moi de ton discernement, et de ce que tu aimes, lui dis-je alors ; et révèle-moi les motifs qu'a eus la Providence en te parant de ce beau collier. Je suis chargée, me répondit-elle, de porter les doux messages qui gagnent les cœurs, et ce collier est le signe de ma fidélité à remplir les commissions qu'on me confie ; mais, pour parler avec franchise, car la religion ordonne la sincérité, tous les oiseaux ne méritent pas qu'on se fie à eux, de même que ceux qui prêtent serment, ne sont pas tous véridiques, et que ceux qui s'engagent dans la vie spirituelle, ne sont pas tous du nombre des élus. Les individus seuls de mon espèce rendent exactement ce dont on les charge ; et ce qui prouve mon intégrité, c'est cette sentence : « Les oiseaux bigarrés de noir et de blanc, et ceux qui sont verts, remettent fidèlement ce qu'on leur confie, parce que de même qu'ils sont préférables à l'extérieur, ils le sont aussi en réalité. » Lorsque l’oiseau est noir, il n'est pas propre à l’objet dont il s'agit; s'il est blanc, cette couleur est le signe d'une imperfection naturelle, et indique un manque d'énergie qui le rend incapable de faire ce qu'on désire. (Les vues et les desseins élevés ne se trouvent que dans l’âme pure, noble et droite.) Mais lorsque la couleur de l’oiseau est dans un juste milieu, il est excellent pour les messages, et on doit relever pour cet emploi. On l'achète alors dans les bazars, aux cris, des courtiers qui annoncent les marchandises, et on le dresse peu-à-peu à reconnaître son chemin. Aussi, dès que je m'offre pour quelque message, n'hésite-t-on pas à me confier des lettres pleines de secrets, et à me charger de nouvelles agréables. Je pars; mais bientôt la crainte vient troubler mon esprit ; je veux éviter l’oiseau de proie sanguinaire, le voyageur aux pas rapides, et le chasseur impitoyable : j'accélère donc mon vol, supportant une soif ardente dans les déserts du midi, et une faim cruelle dans les lieux pierreux. Si je voyais un grain de froment, je m'en éloignerais même, malgré le besoin qui me presse, me rappelant le malheur affreux que le blé fit tomber sur Adam ; et, dans la crainte d'être exposée à ne pouvoir porter la lettre à sa destination, et à conclure ainsi le marché de la dupe, j'évite avec grand soin de tomber dans un filet caché sous la poussière, ou d'être prise dans des lacs perfides. Dès que, parvenue au but de mon voyage, je me vois dans un lieu de sûreté, je remets alors ce dont on m'a chargée, et je me comporte de la manière que l’on m'a apprise. Tu vois actuellement pourquoi je suis ornée d'un collier: j'ai été créée pour transmettre de bonnes nouvelles, et je remercie Dieu de m'avoir choisie pour cet emploi.
Chère amie, puis-je espérer d'obtenir de toi la moindre faveur, ou me délaisses-tu! L'esclave de ta beauté ne cessera point, dans l'un ou dans l’autre cas, de t'être fidèle : il n'est pas ébranlé par les paroles du censeur ; rien ne saurait le faire renoncer à sa noble passion. Pour ton amour, je n'ai pas craint d'accepter ce que les monts les plus élevés ont refusé. Oui, je serai fidèle à la foi que je t'ai jurée : la fidélité aux engagements que l'on a contractés, est le plus bel ornement qui puisse décorer l’homme bien né.
Laisse-le se livrer à l'amour de la beauté qui le captive; car ton sort est le même que le sien, ô toi qui lui fais de cruels reproches.
Tandis que je m'entretenais, avec la colombe, des qualités qui constituent la perfection, et de ce qui constitue la perfection de ces qualités, voilà que j'aperçus une hirondelle qui voltigeait autour d'une chaumière: Je suis étonné, lui dis-je aussitôt, de te voir toujours, auprès des maisons, aspirer à l'amitié de l'homme ; ne serait-il pas plus sage de ne point quitter tes semblables, et de préférer la douce liberté des champs à ton emprisonnement dans nos demeures ? Pourquoi ne te fixes-tu donc jamais que dans les endroits cultivés et dans les lieux qu'habite l'espèce humaine ?
Puisque ton esprit est si peu délié et que ton oreille est si dure, me répondit-elle, sache donc quel est le motif de ma conduite, et pourquoi je me sépare ainsi des autres oiseaux : si j'ai abandonné mes pareils ; si j'ai fréquenté des êtres d'une autre nature que la mienne ; si j'ai pris pour mon habitation les toits plutôt que les rameaux et le creux des arbres, c'est qu'à mes yeux il n'y a rien de préférable à la condition d'étranger, et que je veux me faire aux manières élégantes de la société. Je me mêle donc parmi des êtres qui ne sont pas de mon espèce, précisément pour être étrangère au milieu d'eux ; et je recherche le voisinage de celui qui est meilleur que moi, pour recevoir l'influence de son mérite : je vis toujours en voyageuse, et je jouis ainsi de la compagnie des gens instruits. On traite d'ailleurs avec bonté celui qui est loin de sa patrie, et on l'accueille d'une manière obligeante. Lorsque je viens m'établir dans les maisons, je ne me permets pas de faire le moindre tort à ceux qui y demeurent ; je me contente d'y bâtir ma cellule, que je forme de matériaux pris au bord des ruisseaux, et je vais chercher ma nourriture dans des lieux déserts. Jamais d'injustice, jamais de perfidie envers celui auprès de qui je réside ; j'use au contraire avec lui des règles les plus exactes de la complaisance qu'un voisin doit avoir pour son voisin, et cependant il ne pourvoit point à ma subsistance de chaque jour. Comme j'habite dans les maisons, j'augmente le nombre des gens du logis, mais je ne demande point à partager leurs provisions ; aussi le soin que je mets à m'abstenir de ce qu'ils possèdent, me concilie leur attachement ; car, si je voulais prendre part à leur nourriture, ils ne m'admettraient point dans leurs demeures. Je suis auprès d'eux lorsqu'ils sont assemblés ; mais je m'éloigne lorsqu'ils prennent leurs repas : je me joins à eux dans les mo-mens de leurs prières, jamais lorsqu'ils se rendent à la salle des festins ; c'est à leurs bonnes qualités que je désire participer, et non à leurs banquets ; c'est leur état heureux que j'ambitionne, et non leurs richesses ; je recherche leur mérite, et non leur froment; je souhaite leur amitié, et non leur grain; me conformant, dans ma conduite, à ce qu'a dit celui à qui le Très-Haut a daigné révéler ses volontés (que Dieu lui soit propice et lui accorde le salut !) : « Si tu sais te priver des plaisirs de ce monde, tu jouiras de l'amitié de Dieu ; et si tu t'abstiens scrupuleusement de ce que possèdent les hommes, tu auras leur affection.»
Oui, abstiens-toi scrupuleusement de ce que possèdent les autres, et tout le monde t'aimera. Ne vois-tu pas l’hirondelle! elle ne touche jamais à nos provisions ; aussi la recevons-nous dans nos foyers comme un pupille que l’on presse sur son sein.
J'ai entendu avec plaisir ton éloquent discours, dis-je alors à l’hirondelle : que tu es heureuse ! ta conduite sensée est digne de louange ; tes paroles sont sages, j'en profiterai. Adieu.
Le hibou, tristement retiré dans une masure solitaire, m'adressa, bientôt après, la parole en ces termes : Vrai et sincère ami, ne te fie pas au discours de l’hirondelle et n'imite pas sa conduite ; car, quoiqu'on ne la soupçonne point de se nourrir des mets de votre table, il n'en est pas moins vrai qu'elle participe à vos plaisirs, à vos joies, à vos fêtes, et qu'enfin elle habite au milieu de vous : or, tu sais que celui qui se fixe auprès d'une classe quelconque de gens, en fait partie par cela même, et que, n'y fut-il resté qu'un instant, il est dans le cas d'être interrogé sur ces personnes. Tu sais encore que, de même qu'une seule goutte est la source éloignée d'un torrent impétueux, de même la société est la source des crimes ; aussi ne doit-on pas y placer sa félicité. La paix et le bonheur ne se trouvent que dans la retraite : ah ! celui qui s'y réfugie, n'a pas à craindre que l'envie l'éloigne de son emploi. Suis donc mon exemple et imite mon isolement : laisse les palais somptueux et celui qui y fait sa résidence ; les mets délicats et celui qui s'en nourrit. Fais attention à ma conduite : je ne réside point dans vos demeures, et je ne suis jamais dans vos assemblées ; mais un creux dans un vieux mur est mon habitation solitaire, et je préfère, pour mon séjour, des ruines à des lieux soignés par la main de l’homme: là, loin de mes compagnons, de mes amis et de mes proches, je suis à l'abri des tourments et des peines, et je n'ai pas à craindre les envieux. Comment, en effet, celui dont l'habitation doit être un jour la poussière, peut-il demeurer avec les autres hommes ! Chaque jour et chaque nuit viennent empiéter sur sa vie et la détruire sourdement; et il ne se contenterait pas d'une masure ! Celui qui a le bonheur de comprendre que la vie, qui paraît longue, est réellement si courte, et que tout s'avance vers la destruction, celui-là, au lieu de passer la nuit sur un lit voluptueux, prendra pour sa couche une natte dure et inégale, se contentera d'un pain d'orge pour toute nourriture, et ne goûtera que le moins possible des voluptés du monde, en se rappelant qu'une partie des créatures sera placée dans le paradis, et que l'autre sera précipitée dans l’enfer.
Pour moi, j'ai jeté un regard sur la vie présente, et je l'ai vue en proie à la dévastation ; j'ai tourné alors mes yeux vers la vie future, et j'ai vu qu'elle s'approche rapidement. Me rappelant ensuite le compte terrible que Dieu fera rendre au jour de la résurrection, j'ai médité sur l'âme, et j'ai pensé au bien qu'elle peut faire et au mal dont elle peut se rendre coupable: c'est alors que, réfléchissant sur ma situation et faisant une attention sérieuse à moi-même, j'ai conçu de l'éloignement pour un monde qui n'offre qu'un grand vide ; j'ai oublié ce que mes semblables ont droit d'attendre de moi, et ce que j'ai droit d'attendre d'eux ; j'ai abandonné ma famille et mes biens, et j'ai méprisé les châteaux élevés. Bientôt la foi écartant de la vue de mon intelligence le bandeau du doute, j'ai reconnu que ni joie ni plaisir ne demeure ; que tout périt, si ce n'est l’Être par qui tout existe. Je me suis élevé à la connaissance de cet Être, sans pouvoir pénétrer ce qu'il est : son image adorée est tout ce qu'aperçoivent mes yeux, et son nom béni, ce que prononce ma bouche.
Pour cette divine amie j'ai quitté les hommes ; ce n'est qu'elle que je désire, qu'elle seule à qui je veux plaire. Pour elle, je m'isole de toute société, et, guidé par l'intention la plus droite, je m'abandonne à l'amour le plus pur. Je la verrai, je l’espère ; mon amour ne sera point frustré. Mes amis ont réprouvé la noble passion de mon cœur, sans connaître le sentiment qui l’agite. Si l’objet sacré de ma flamme ôtait le voile qui cache ses appas, la pleine lune elle-même en emprunterait son éclat argentin. Je n'ose par respect nommer cette beauté divine que toutes les créatures étonnées admirent ; mais, lorsque mon amour violent ne peut se contenir, mes soupirs font entendre un de ses attributs.
Je saisis avec la plus grande avidité les avis du hibou, et je jetai loin de moi les vêtements de l’amour-propre; mais les passions semblaient me dire : Reste, reste avec nous.
Je me tournai d'un autre côté, et je vis un paon, oiseau qui, après avoir vidé la coupe de la vanité, et s'être couvert du vêtement de la dissimulation, fût associé aux malheurs d’Eblis. Des couleurs variées embellissent ses plumes ; mais sa vie est en proie à mille genres de douleurs, et il ne reverra jamais le paradis (Dieu en sait la raison). Oiseau malheureux, lui dis-je, combien le sort que le destin t'a réparti est différent de celui du hibou! le hibou porte son attention sur les qualités intérieures et réelles, et tu ne t'attaches qu'à ce qui est extérieur ; tu te laisses tromper par une folle sécurité, et tu ne places ta joie que dans ce qui est périssable.
Faible mortel qui viens m'insulter, me répondit-il, laisse tes reproches, et ne rappelle pas à celui que le chagrin accable, ce qui lui a été ravi; car il est dit dans la tradition : Aye pitié de l'homme illustre qui a perdu son rang, et de l'homme riche qui est devenu pauvre. Je voudrais que tu m'eusses vu lorsque je me promenais dans Éden auprès des ruisseaux limpides et des grappes vermeilles qui l'embellissent, et que, le parcourant dans tous les sens, j'entrais dans ses palais superbes et jouissais de la compagnie de ses échansons ravissants et de ses houris voluptueuses. Louer Dieu était mon breuvage ; célébrer sa sainteté, mon aliment : je tins toujours la même conduite, jusqu'à ce que le fatal destin poussa vers moi Eblis, qui me couvrit du vêtement de l'hypocrisie, et changea en défauts mes plus belles qualités. J'eus d'abord horreur de ce qu'il me proposa ; mais, hélas ! le destin plonge, lorsqu'il le veut, dans le malheur et dans l'infortune, et fait fuir les oiseaux de leurs nids pour les livrer au chasseur.
Quant à Eblis, il marchait fièrement, revêtu des habits célestes de la faveur de Dieu ; mais son mauvais destin finit par le porter à refuser avec orgueil de se prosterner devant Adam. C'est précisément dans l'événement qui suivit ce refus, que j'eus, par malheur, quelques relations avec cet ange rebelle. Il m'entraîna dans le crime, me déguisant ce qu'il y avait de pervers dans son dessein ; et, pour tout dire, je lui servis d'introducteur dans Eden, tandis que, de son côté, le serpent machinait pour l'y faire entrer. Après l'événement, Dieu me précipita du séjour de la gloire dans la demeure de l'ignominie, avec Adam, Eve, Eblis et le serpent, en me disant : Voilà la récompense de celui qui sert de guide pour une mauvaise action, et le salaire que l'on mérite pour avoir fréquenté les méchants. Dieu me laissa mon plumage nuancé de mille couleurs, pour que cet ornement, me rappelant les douceurs de la vie que je menais dans Eden, augmentât mes regrets, mes désirs, et mes gémissements ; mais il plaça les signes de sa colère sur mes pattes, afin qu'en y jetant sans cesse des regards involontaires, je me ressouvinsse de la violation de mes engagements. Que j'aime ces vallées, où tous les charmes de la nature semblent être réunis pour donner une idée de ce lieu d'où j'ai été chassé, et d'où mon destin malheureux m'a éloigné pour toujours ! Les jardins agréables me font souvenir des prairies printanières de mon ancienne habitation, sujet des larmes abondantes qui coulent de mes yeux ; et c'est alors surtout que je me reproche ma faute, et que je m'écrie en pensant à mon malheur :
Séjour délicieux, puis-je espérer de te revoir jamais ! goûterai-je encore dans ton sein un instant de sommeil paisible ! Habitants de ces lieux fortunés, lorsqu'au moment cruel de la séparation, je vous dis un dernier adieu, je fus sur le point de mourir de douleur et de tristesse ; n'aurez-vous donc jamais compassion de mon malheureux état ? Vous avez éloigné le sommeil de mes paupières, et vous m'avez uni de la manière la plus étroite à l'affliction : mon corps est loin de vous, mais mon esprit est au milieu de vos tentes ; pourquoi ne pas permettre à mon corps de s'y réunir à mon esprit ? Lorsque je me rappelle les nuits délicieuses que j'ai passées avec ces objets ravissants, sous des pavillons protecteurs, si l'abondance de mes larmes ne soulageait ma peine, je mourrais consumé de désir. J'ai cru, dans mes rêveries, que vous me promettiez de venir voir votre ami fidèle ; hélas ! mon ardeur en a été accrue, et mon désir augmenté. Si je dois cet éloignement pénible à une faute dont j'ai pu me rendre coupable, que ma situation malheureuse soit aujourd'hui mon meilleur intercesseur! Mais, hélas ! ces doux moments sont passés pour toujours, et mon partage doit être la soumission et la modestie.
Pour moi, affligé des malheurs du paon, je répandis des larmes sur ses peines. Je sens, en effet, que rien n'est plus douloureux que l'absence, quand on a joui des avantages de la réunion la plus douce ; et que rien n'est plus triste que le voile qui cache des appas adorés, après qu'on a eu le bonheur de les contempler à découvert.
TANDIS que le paon, tantôt soupirait en promenant la vue sur ses plumes, qui lui rappelaient son bonheur, tantôt, en jetant des regards involontaires sur ses pattes, poussait des cris plaintifs et douloureux ; voilà que je vis à côté de lui une perruche, dont la robe verte figurait celle d'un chérif. Elle s'adressa au paon, et lui dit ces paroles éloquentes : Jusques à quand garderas-tu cet air sombre ! Ton plumage superbe ressemble à la parure d'une jeune mariée ; mais, en réalité, tu es comparable à l'obscurité du sépulcre. Ton jugement faux t'a amené au point d'être chassé du lieu de délices où tu étais ; et tu ne t'es vu traité de la sorte que pour avoir usé de perfidie envers l'homme, qui habitait cette demeure sacrée, et pour avoir troublé un bonheur qui devait être inaltérable. Si tu pensais à ton bannissement, et à f homme, qui en a été la cause, je ne doute pas que tu ne t'occupasses alors à réparer ta faute, et non à te divertir dans un jardin. Puisque tu t'es rendu coupable envers Adam, dans Eden, il faut donc actuellement que tu travailles à t'excuser ; que tu te joignes à lui, lorsque, dans la retraite, il adresse à Dieu de ferventes prières pour implorer sa clémence, et que, dans l'espérance de visiter un jour les demeures célestes avec le père des hommes, tu avoues ta faute, que tu as d'abord refusé de reconnaître: car il retournera immanquablement à son premier état, et les jours de bonheur lui seront rendus. Voici, en effet, ce que l'on dit à Adam, lorsque, chassé d'Eden, il fut placé dans le champ du monde : Sème aujourd'hui ce qui doit être récolté demain; peut-être encore n'en recueilleras-tu pas le fruit : alors, quand tu auras achevé de semer, et que tes plantes auront pris de l’accroissement, tu retourneras dans ton heureux séjour, en dépit de l'ennemi et de l’envieux. Celui qui t'imitera dans ta pénitence, sera fortuné ; et celui qui se comportera comme toi, recevra pour sa récompense la demeure de l’éternité.
Ne vois-tu pas combien je suis estimée lorsque mes idées s'élèvent et s'étendent ï Méprisant ce qui occupe les autres oiseaux, j'ai considéré le monde et ses créatures, et j'ai vu que l'homme est le seul modèle que je doive me proposer. En effet, Dieu a créé tous les êtres pour les hommes, et c'est pour lui qu'il a créé les hommes ; il se les est attachés par des liens indissolubles, et les a comblés des faveurs les plus signalées. Aussi, quoique ma nature soit bien différente, cherché-je à me rapprocher de leurs habitudes, surtout en imitant leur langage, et en me nourrissant des mêmes aliments. Mon bonheur est de leur adresser la parole; je ne recherche qu'eux; et ce sont les efforts que je fais pour me rendre semblable à eux, qui me concilient l'estime qu'ils ont pour moi; car ils me considèrent comme un commensal, et nous sommes unis d'une amitié réciproque. Conformant mes actions aux leurs, je prie comme ils prient, je rends grâce comme ils rendent grâce ; et j'ai droit d'espérer qu'au jour où ils paraîtront devant Dieu, ils se souviendront de moi, me donneront des éloges, et qu'en conséquence, après avoir été du nombre de leurs serviteurs dans le monde présent, je serai aussi leur esclave dans l'autre.
Cherche à me connaître, et tu verras que je suis du nombre de ceux qui sont réellement tels qu'ils paraissent être. L'objet de ma passion est une beauté qui possède des perfections éclatantes et sublimes, que la pureté et la sainteté décorent, et dont le rang suprême est respecté et béni. Oui, je l'espère, mes vœux seront exaucés: Mahomet, la plus excellente des créatures, et dont les paroles ne sauraient être trompeuses, assure que l'amant sera uni à sa maîtresse.
Lorsque la perruche, en exaltant ses propres qualités, se fut ainsi placée dans le cercle des êtres les plus éminents, je me dis à moi-même : Je n'avais jamais étudié l’état emblématique des animaux; mais, que vois-je aujourd'hui ! ils veillent, tandis que je suis dans le sommeil le plus profond de la tiédeur et de l’indifférence. Pourquoi ne point m'approcher de la porte du miséricordieux! peut-être qu'on me permettrait l’accès auprès de ce Dieu clément, et qu'il dirait ces consolantes paroles : « Que celui qui arrive soit le bienvenu ; je pardonne sa faute à celui qui se repent. »
La chauve-souris, engourdie et tremblante, m'adressa bientôt après ces mots : Ne te mêle point dans la foule, si tu veux participer aux faveurs de la beauté divine que tu chéris. Jadis Cham erra longtemps autour de l'asile sacré ; mais Dieu n'en permit rentrée qu'à Sem.
Ce ne sont point les lances noires qui nous rendent maîtres de l'objet de notre désir; ce n'est point le tranchant du glaive qui nous fait atteindre aux choses élevées.
Il faut consacrer des instants à la retraite, et passer les nuits obscures en ferventes prières. Fais attention à ma conduite: dès que le soleil se lève, je me retire dans mon trou solitaire ; et là, mon esprit libre de tout soin se livre à de douces pensées. Tant que dure le jour, isolée, loin des regards, au fond de ma cellule, je ne vais voir personne, personne ne vient me voir ; cependant les gens éclairés m'aiment et me considèrent. Mais lorsque la nuit a répandu ses ombres sur la terre, je sors de ma retraite, et je choisis ce temps pour veiller et pour agir. C’est au sein des ténèbres que la porte sacrée s'ouvre, que le voile importun est écarté, et qu'à l’'insu des rivaux jaloux, la bien-aimée reçoit ses favoris en tête-à-tête. A l’instant où les amants de cette céleste amie, et les malheureux relégués sur cette terre d'exil, baignent de larmes leurs paupières brûlantes, elle entrouvre le rideau et se montre sur ce seuil béni. Elle appelle elle-même ses adorateurs, et leur accorde des entretiens secrets. C'est alors qu'ils lui adressent de ferventes prières qu'interrompent leurs sanglots, et qu'ils ont le bonheur d'entendre ces douces paroles : Messager céleste, endors celui-ci, réveille celui-là. Annonce à l’amant qui a celé l'ardeur dont il brûlait pour moi, qu'il peut maintenant la découvrir avec confiance ; dis à cet amant altéré que la coupe est remplie ; apprends à celui que son amour a jeté dans l'agitation la plus vive, que le moment délicieux de l'union avec l’objet de ses désirs est arrivé.
O toi ! dont la noble passion n'a que moi pour objet, que des reproches ne t'éloignent pas du seuil de ma porte ; les engagements doivent être stables, et l'amour doit être constant. La renommée de ma puissance, de ma beauté et des faveurs que j'accorde, s'est répandue par tout l'univers, et les pèlerins ont commencé leur voyage. Si tu te soumets à ma dignité suprême, les souverains et les monarques se soumettront avec respect à la tienne. O amants! hâtez-vous ; voilà le coursier et l'hippodrome.
Petit et faible oiseau, dis-je alors à la chauve-souris, explique-moi pourquoi, lorsque le soleil paraît sur l'horizon, tu cesses de voir, et ne recouvres la vue qu'au moment de son coucher; cet astre, de qui les autres êtres reçoivent la lumière, te rendrait-il aveugle ?
Pauvre mortel, me répondit-elle, c'est que, jusqu'à présent, je ne me suis occupée qu'à connaître la voie droite, et que je n'ai pas encore acquis les vertus qui en méritent l'entrée: celui qui est dans cet état d'investigation et de crainte, est ébloui par la lueur des astres du spiritualisme; mais celui qui possède les vertus de la vie intérieure, soutient l'aspect des mystères que Dieu veut bien lui communiquer. Mon état de faiblesse, d'hésitation et de doute, tient à ce que je ne remplis qu'imparfaitement mes devoirs ; voilà pourquoi je cache mes imperfections durant le jour, en me dérobant aux regards. Mais lorsque la nuit enveloppe la terre de ses ombres, je parle en secret et avec humilité à mon amie, qui, touchée de ma misère, daigne me retirer généreusement de l’état d'abjection où je suis plongée. La première marque de bonté que cette céleste maîtresse m'a donnée et la première faveur qu'elle a accordée à mes humbles prières, c'est de m'avoir assigné la nuit pour le temps du plus doux tête-à-tête, en me permettant de me réunir alors a ses amants, et d'élever mes regards vers elle. Aussi, lorsque ces précieux instants sont passés, fermé-je les yeux pour ne point voir mes rivaux. Il est d'ailleurs bien juste que celui qui à veillé durant la nuit, dorme pendant le jour ; et ce serait un crime pour un œil qui a joui de la vision divine, de se tourner vers un autre objet.
Un cœur qui se consume d'amour pour sa céleste amie, ne doit palpiter pour aucune autre maîtresse. Pourrais-tu aimer cette beauté divine, et adresser ensuite des vœux à une autre qu'elle l ne sais-tu donc pas que seule dans le monde elle est digne d'être aimée ! Mon frère, puisque celle que tu aimes est incomparable, et si tu l'aimés véritablement, sois sans égal dans ton amour.
Ceux qui jouissent des faveurs particulières de Dieu, me dis-je alors à moi-même, sont les vrais heureux ; ceux dont l'occupation est la prière, méritent d'être distingués des autres, et il est impossible que les indifférents s'approchent jamais de cette divine maîtresse. J'étais dans ces réflexions, lorsque le coq m'adressa ces paroles : Combien de fois ne t'appelé-je point à remplir les devoirs religieux, tandis que tu es dans l'aveuglement des passions et dans l’illusion des sens ! Je me suis engagé à faire l'annonce de la prière, réveillant ainsi ceux qui sont plongés dans un sommeil si profond qu'ils paraissent comme morts, et réjouissant ceux qui invoquent leur Dieu avec humilité et avec crainte. Tu peux observer dans mes actions des allégories charmantes : le battement de mes ailes indique qu'il faut se lever pour faire la prière, et l’éclat de ma voix sert à réveiller ceux qui sont endormis ; j'agite mes ailes pour annoncer le bonheur, et fais entendre mon chant pour appeler au temple du salut. Si la chauve-souris s'est chargée de l'emploi de la nuit, elle dort tout le jour du sommeil le plus profond, en se dérobant par crainte aux regards des hommes : quant à moi, je ne cesse, ni le jour ni la nuit, d'exercer les fonctions de mon ministère, et je ne m'en dispense ni publiquement ni en secret. Je partage les devoirs du service de Dieu entre les différentes heures de la journée, et il ne s'en passe aucune que je n'aie une obligation religieuse à remplir : c'est moi qui te fais connaître les heures fixées pour la prière ; aussi, puis-je dire qu'on ne m'achèterait pas ce que je vaux, quand même on donnerait de moi mon poids en rubis. En outre, plein de tendresse pour mes petits, je suis toujours auprès d'eux; et au milieu des poules, l'amour est le seul objet qui m'occupe. Me conformant aux règles d’une affection véritable, je ne prends jamais sans mes compagnes le moindre aliment ni la moindre boisson : si je vois un grain, loin de m'en emparer, je le leur fais apercevoir et les engage à en faire leur nourriture ; comme aussi je les invite à manger, lorsque je sens l'odeur de ce qu'on a préparé pour nous. Du reste, obéissant aux gens de la maison, je supporte avec patience ce qu'ils me font souffrir: je suis leur tendre ami, et ils ont la cruauté d'immoler mes petits; j'agis pour leur utilité, et ils m'enlèvent mes fidèles suivantes. Tels sont mes qualités et mon bon naturel. D'ailleurs, Dieu me suffit.
Invoque Dieu, et tu seras à l'abri de toute crainte ; espère en lui, et tu trouveras le bonheur. Mais, hélas! quel est celui qui prête une oreille attentive à ce que je dis, qui sait en saisir le véritable sens et le graver dans sa mémoire!
Le canard, en se jouant dans l'eau, adressa bientôt après la parole au coq : O toi dont les pensées sont viles et rampantes, lui dit-il, tu ne saurais t'élever dans l'air comme le reste des oiseaux, ni le conserver en évitant le malheur ; tu es comme un mort qui ne peut parcourir la terre, et ton séjour constant dans un même lieu est la seule cause de tes maux. La bassesse de tes inclinations te fait rechercher les ordures ; et, satisfait de recueillir la rosée, tu laisses la pluie abondante. Ignores-tu donc que celui qui ne voyage pas, ne saurait obtenir des bénéfices dans son négoce, et que celui qui reste sur la grève, ne recueillera jamais des perles ! Si ton mérite spirituel était plus réel, si ta foi était plus vive, tu volerais dans l'atmosphère et tu te soutiendrais sur l'onde. Vois comment, maître de mes désirs, et disposant de l’'air et de l'eau, je marche sur la terre, je nage sur les flots roulants, et je voie librement dans les régions éthérées. C'est surtout la mer qui est le siège de ma puissance et la mine de mon trésor : je m'élance dans son onde limpide et transparente ; je découvre les perles précieuses qu'elle recèle, et je pénètre les mystères et les merveilles de Dieu. Celui-là seul connaît ces choses, qui s'y applique sérieusement ; mais l'indifférent qui demeure sur le rivage, ne peut prétendre qu'à l'écume amère. Celui qui, en se plongeant dans cet océan, ne réfléchira pas à sa profondeur incalculable, sera submergé dans ses gouffres, par le choc impétueux des flots. L'homme prédestiné au bonheur monte l'esquif de la bienveillance de sa divine amie, déploie les voiles de ses supplications, les orientant de manière à recevoir le souffle du zéphyr protecteur; et après avoir franchi les ténèbres épaisses qui cachent les mystères, il fixe enfin le câble de l'espérance, par le moyen des attractions de la divinité, au confluent des deux mers de l’essence et des attributs, et parvient ainsi à la source même de l'existence, où il s'abreuve d'une eau plus douce que le miel le plus pur.
O toi qui veux parvenir aux plus hauts degrés du spiritualisme, tu acquerras difficilement cette perfection à laquelle tu aspires. Si tu avances, tu seras bientôt obligé de te soumettre à l'anéantissement le plus complet, à cet anéantissement qui ne peut devenir doux que pour ceux à qui Dieu a donné une idée de ce qu'il réserve à ses favoris. La pointe des piques défend l'approche de cette céleste maîtresse : telles sont ces citadelles élevées, autour desquelles les lances rembrunies forment un rempart redoutable. Avant de goûter la douceur du miel, il faut endurer une piqûre aussi cuisante que la blessure des flèches. Que de gens d'une naissance illustre errent autour de cet asile sacré! Ils supportent avec patience les peines amères attachées à leur noble passion ; ils jeûnent, ils passent les nuits obscures en humbles prières ; la violence du désir anéantit leur esprit, une ardeur brûlante consume leur corps : mais, hélas ! le divin amour n'aperçoit encore dans leur cœur qu'un vide affreux. Renonce donc aux demeures des braves qui ont vaincu généreusement leurs passions, si tu ne peux vaincre les tiennes.
Quelle prétention! s'écria aussitôt l’abeille. Ce que le canard a dit de ses courses n’est point vrai, et cet oiseau en a imposé. L'homme vraiment religieux est bien différent; son mérite paraît d'une manière évidente, sans qu'il affecte aucune jactance, et la pureté de son intérieur se manifeste par ses actions les plus secrètes: d'ailleurs, celui qui ne s'enorgueillit point, quelque droit qu'il en ait, ajoute le plus grand prix à son mérite. Ne dis donc jamais une parole que ton action démente, et n'élève pas un fils que ta race renierait. Sache connaître le prix des mets sains et légers et des boissons pures et naturelles : vois, en effet, comme ma dignité augmente et s'accroît, et comme mon mérite se perfectionne, lorsque je suis à portée de prendre une nourriture excellente et de me désaltérer dans une eau limpide. Dieu aurait-il daigné m'inspirer, comme le Prophète l'assure dans le Coran, si je ne me fusse nourrie de mets permis ; si je ne me fusse attachée aux qualités les plus nobles, pour marcher ensuite avec humilité, ainsi que les amis de Dieu, dans la voie du Seigneur, et le remercier de ses bienfaits ! Je construis ma ruche dans les collines; je me nourris de ce qu'on peut prendre sans endommager les arbres, et de ce qu'on peut manger sans le moindre scrupule. Aucun architecte ne pourrait imiter la construction de ma cellule ; Euclide lui-même admirerait la forme régulière de mes alvéoles hexagones. Je me pose sur les fleurs et sur les fruits; et sans jamais manger aucun fruit ni gâter aucune fleur, j'en retire seulement une substance aussi légère que la rosée; contente de ce faible butin, je reviens ensuite à ma ruche. Là, faisant trêve à mon travail, je me livre alors à mes réflexions, et, dans mes prières, j'offre constamment à Dieu le tribut de ma reconnaissance. Instruite par l'inspiration divine, je m'abandonne, dans mes travaux, à la grâce qui m'a été prédestinée ; ma cire et mon miel sont le produit de ma science et de mon travail réunis. La cire est le résultat des peines que je me donne; le miel est le fruit de ce qu'on m'a enseigné : la cire éclaire ; le miel guérit : les uns recherchent la-lumière que ma cire procure, les autres le remède salutaire que leur offre la douceur de mon miel ; mais je n'accorde aux premiers l'utilité qu'ils désirent, qu'après leur avoir fait sentir l'amertume de mon aiguillon, et je ne donne mon miel aux seconds, qu'après leur avoir opposé une résistance vigoureuse. Si l'on veut m'arracher de force mes trésors, je les défends avec ardeur contre les attaques, au péril même de ma vie, en me disant: Courage, ô mon âme! J'adresse ensuite ces mots à celui qui veut me faire sortir du jardin que j'habite : Suppôt d'enfer, pourquoi viens-tu me tourmenter !
Si tu recherches les allégories, ma situation t'en offre une bien instructive : réfléchis que tu ne peux jouir de mes faveurs, qu'en souffrant avec patience la blessure de mon aiguillon.
Supporte l'amertume de mes dédains, toi qui désires t'unir à moi; ne pense qu'à mon amour, et laisse celui qui follement voudrait t'éloigner de moi et oserait insulter à ta peine. Si tu veux vivre de cette vie spirituelle que tu ambitionnes, sache mourir en devançant l'heure fixée par le destin. Qu'elle est difficile, la voie étroite de l'amour ! pour s'y engager, il faut briser tous les liens qui nous retiennent au monde. Mais ces peines qui paraissent si amères, sont cependant douces, et l’amour rend léger ce qu'il y a de plus pesant.
Si tu tends au même but que nous, sache saisir les allégories qui te sont offertes : si tu les comprends, avance ; sinon, reste où tu es.
La bougie, en proie à la douleur que lui faisait ressentir un feu dévorant, répandait des larmes en abondance et faisait entendre des plaintes douloureuses. A ces gémissements, l'abeille, touchée de compassion, prêta une oreille attentive, et la bougie lui adressa ces paroles : Pourquoi faut-il que la fortune contraire m'éloigne à jamais de toi qui es ma mère, puisque je te dois l'existence, et qui es ma cause, puisque je suis ton effet. Hélas ! on employa le feu pour nous arracher de ta demeure, moi et le miel mon frère et mon compagnon. J'étais avec lui dans un même asile ; la flamme vint nous en chasser, et, détruisant l'alliance qui nous unissait, mettre entre nous un immense intervalle. Mais ce n'était pas encore assez de cette cruelle séparation ! on me livre de nouveau à la violence du feu ; et, quoique je ne sois pas criminelle, mon cœur est brûlé, et mon corps est dans l'esclavage. A la lueur que je produis en avançant vers ma destruction, les amants se familiarisent, et les softs se livrent à leurs méditations. Répandre ma lumière, brûler, verser des larmes, voilà mon sort. Toujours disposée à servir, et supportant avec patience le mal et la peine, je me consume pour éclairer les autres, et je me tourmente moi-même pour les faire jouir des avantages que je possède. Comment pourrait-on donc me reprocher avec raison ma pâleur et mes larmes ? Ce n'est pas tout : des nuées de papillons veulent éteindre ma flamme et faire disparaître ma clarté. Irritée, je les brûle pour les punir de leur audace ; car on sait que le mat retombe sur son auteur. Du reste, quand les papillons rempliraient la terre, je ne les redouterais pas ; de même que les gens sans principes, le monde en fourmillât-il, ne parviendraient pas à obscurcir le flambeau de la foi. Leurs bouches sacrilèges essaient d'étouffer cette lumière sacrée, mais le miséricordieux par excellence ne le permettra jamais. Voilà une énigme qui se changera en démonstration pour celui qui saura la pénétrer.
Lumière de ma vie, quelle clarté n'ai-je pas reçue de toi ! Que je sois dans le vrai chemin, ou que je m'égare, tout vient de ta main bénie et adorée. Le censeur ne pourra jamais me taxer de fausseté à ton égard ; aucun vent n'éteindra la lumière divine dont tu m'éclaires.
Alors le papillon, à demi consumé par la flamme, se débattant et se retournant en tout sens sur le tapis, se plaignit amèrement à la bougie, en ces termes: Se peut-il qu'au moment où, livrant mon cœur à ton amour, je ne dirige mes vœux que vers toi, tu me traites comme un ennemi ! Qui t'a donné le droit de m'ôter la vie ! qui t'a excitée à me faire périr, moi ton amant sincère, moi ton ami le plus tendre ! Je supporte avec patience l'ardeur de ta flamme, et seul, entre tous tes amants, j'ose-braver la mort : mais, dis-moi, as-tu jamais vu une amie qui se plaise à tourmenter son ami, un médecin qui cherche à aggraver les souffrances de son malade ? Quoi ! je t'aime, et tu me fais du mal ! je m'approche de toi, et tu me perces de tes rayons embrasés : cependant, bien loin de diminuer mon amour, tes mauvais traitements ne font que l'augmenter, et je me précipite vers toi, tout abject que je suis, emporté par le désir de voir notre union consommée ; mais tu me repousses avec cruauté, tu déchires le tissu de gaze de mes ailes. Non, jamais un amant n'a rien éprouvé de pareil ; jamais il n'a enduré ce que j'endure : et malgré tant de rigueurs, c'est toi seule que j'aime, toi seule que j'adore. N'ai-je donc pas assez des maux que je souffre, sans que tu me fasses encore des reproches que je ne mérite point.
Je venais me plaindre des tourments de mon cœur à ma maîtresse et, au lieu de les soulager, elle me repousse loin d'elle avec les verges du châtiment. Ainsi le papillon demande à s'unir à son amie, et elle ne lui répond qu'en l'enveloppant de flammes dévorantes : il tombe auprès de la cruelle, succombant aux atteintes du feu et plongé dans l’abyme de la tristesse. Je me promettais de jouir d'un instant de volupté, mais je ne pensais pas aux peines amères de l'amour. Se consumer de désir et d'ardeur, telle est la loi que doivent subir les amants.
Lorsque le papillon eut exprimé le sujet de sa douleur, et qu'il se fut plaint de ses afflictions et de ses peines, la bougie, touchée de compassion, lui adressa ces paroles : Véritable amant, ne te hâte pas de me condamner ; car j'endure les mêmes tourments que toi, les mêmes peines, les mêmes rigueurs. Ecoute l’histoire la plus extraordinaire, et prends pitié de la douleur la plus violente. Qu'un amant se consume, rien d'étonnant ; mais qu'une maîtresse éprouve le même sort, voilà ce qui doit surprendre. Le feu m'aime, et ses soupirs enflammés me brûlent et me liquéfient ; il veut se rapprocher de moi, et il me dévore : il prétend à mon amour, il veut s'unir à moi ; mais, dès que ses désirs s'ont accomplis, il ne peut exister qu'en me détruisant. Il est étrange sans doute qu'une maîtresse périsse, et que son amant lui survive ; qu'un amant soit en possession du bonheur, et que sa maîtresse soit malheureuse.
O toi, lui répondit le feu, qui, toute interdite au milieu des rayons de ma clarté, es tourmentée par ma flamme, pourquoi te plaindre, puisque tu jouis du doux instant de l’union ? Heureux celui qui boit, tandis que je suis son échanson ! heureuse la vie de celui qui, consumé par ma flamme immortelle, meurt à lui-même, pour obéir aux lois de l'amour.
Je dis à une bougie qui m'éclairait, tandis que la nuit étendait son voile lugubre sur la terre : Mon cœur s'attendrit facilement sur le sort de mes amis, et lorsque je vois répandre des larmes, je ne puis m'empêcher de pleurer. Avant de blâmer ma tristesse, écoute, me dit-elle, l'exposition détaillée de mon histoire. Si l’aveugle fortune t'a déjà fait éprouver le chagrin, sache qu'elle m'a privée de mon frère, d'un frère doué de propriétés salutaires et d'une saveur douce et pure. Tes yeux se mouillent de larmes, en pensant à cette beauté dont les lèvres sont aussi douces et dont la bouche distille une liqueur semblable ; je m'aperçois de ton chagrin. Pourquoi ne veux-tu pas que je sois affligée d'avoir perdu mon frère ? ne serais-je pas blâmable, au contraire, si j'épargnais mes larmes ! C'est le feu qui m'a séparée de ce frère chéri, et c'est par le feu que j'ai juré de terminer mon existence.
J'ÉCOUTAIS encore le discours de la bougie me livrant en même temps aux idées voluptueuses qu'elle m'avait rappelées, lorsque j'entendis le croassement lugubre d'un corbeau qui, entouré de ses amis, annonçait la fatale séparation. Couvert d'un habit de deuil, et seul, au milieu des hommes, vêtu de noir, il gémissait comme celui qui est dans le malheur, et déplorait sa douleur cruelle. O toi, qui ne fais que te lamenter, lui dis-je alors, ton cri importun vient troubler ce qu'il y a de plus pur et rendre amer ce qu'il y a de plus doux : pourquoi ne cesses-tu, dès le malin, d'exciter à la séparation, en n'adressant aux campements printaniers ! Si tu vois un bonheur parfait, tu proclames sa fin prochaine ; si tu aperçois un château magnifique, tu annonces que des ruines vont bientôt lui succéder : tu es de plus mauvais augure que Cacher, pour celui qui se livre aux douceurs de la société et plus sinistre que Jader, pour l'homme prudent et réfléchi.
Le corbeau, prenant alors, pour se défendre, le langage éloquent et expressif de sa situation : Malheureux, me dit-il, tu ne distingues pas le bien d'avec le mal ; ton ennemi et ton ami sincère sont égaux à tes yeux ; tu ne comprends ni l'allégorie, ni la réalité ; les avis que l'on te donne sont pour toi comme le vent qui souffle aux oreilles, et les paroles du sage sont à l'ouïe de tes passions comme l'aboiement du chien. Eh quoi, tu ne réfléchis donc pas à ton départ prochain de la vaste surface de la terre pour les ténèbres du tombeau et pour le réduit étroit du sépulcre ! tu ne penses pas à l'accident qui causa au père des hommes des regrets si cuisants; aux prédications de Noé sur ce séjour où personne ne jouit d'un instant de repos; à l'état d'Abraham, Fami de Dieu, au milieu des flammes où l'avait fait jeter Nemrod! Tu ne sais point te régler sur les exemples instructifs que t'offrent la patience d'Ismaël, sur le point d'être immolé par son père; la pénitence de David, qui pleura son crime si amèrement ; la piété exemplaire et l'abnégation du Messie ! Ignores-tu que le bonheur le plus parfait a un terme, et que la volupté la plus pure s'évanouit ; que la paix s'altère, et que la douceur devient amertume ? Quel est l'espoir que la mort ne détruise, la prudence que le destin ne rende vaine ? Le messager du bonheur n'est-il pas suivi de près par celui du malheur ? ce qui est facile ne devient-il pas difficile? Où trouve-t-on une situation immuable ? quel est l'homme qui ne passe point ? quelle est la fortune qui reste dans les mains de celui qui la possède ? Que sont devenus ce vieillard dont la longue vie étonnait, cet heureux mortel qui nageait dans l'opulence, cette beauté au teint de roses et de lis ? La mort ne vient-elle pas retrancher les hommes, les uns après les autres, du nombre des vivants ? ne met-elle pas au même niveau, dans la poussière, le vil esclave et le maître superbe ? L'inspiration divine n'a-t-elle pas fait entendre au voluptueux, plongé dans le sein du plaisir, ces mots du Coran, où Dieu dit à Mahomet : Annonce que la jouissance de ce monde est peu de chose ? Pourquoi, donc censurer mon gémissement et prendre à mauvais augure mon croassement plaintif, soit au lever de l'aurore, soit aux approches de la nuit ? Si tu connaissais ton bonheur véritable comme je connais le mien, ô toi qui blâmes ma conduite, tu n'hésiterais pas à te couvrir comme moi d'un vêtement noir, et tu me répondrais en tout temps par des lamentations : mais les plaisirs occupent tous tes moments ; ta vanité et ton amour-propre te retiennent. Pour moi, j'avertis le voyageur que les lieux où il s'arrête seront bientôt ravagés; je prémunis celui qui mange, contre les mets nuisibles du monde, et j'annonce au pèlerin qu'il approche du terme. Ton ami sincère est celui qui te parle avec franchise, et non celui qui te croit sur parole ; c'est celui qui te réprimande, et non celui qui t'excuse ; c'est celui qui t'enseigne la vérité, et non celui qui venge tes injures : car quiconque t'adresse des remontrances, réveille en toi la vertu lorsqu'elle s'est endormie ; et en t'inspirant des craintes salutaires, il te fait tenir sur tes gardes. Quant à moi, par la couleur obscure de mes ailes et par mes gémissements prophétiques, j'ai voulu produire sur ton esprit les mêmes impressions ; je t'ai fait même entendre mon cri dans les cercles de la société. Mais on peut m'appliquer ce proverbe : Tu parles à un mort.
Je pleure sur la vie fugitive qui m'échappe, et j'ai sujet de faire entendre des plaintes : je ne puis m'empêcher de gémir toutes les fois que j'aperçois une caravane dont le conducteur accélère la marche. Les gens peu réfléchis me censurent sur mes habits de deuil; mais je leur dis : C'est précisément par ce langage emblématique que je m'efforce de vous instruire; je suis semblable au khâtib, et ce n'est pas une chose nouvelle que les khâtibs soient vêtus de noir. Tu me verras, à l'aspect d'un campement printanier, annoncer dans chaque vallée qu'il changera bientôt de place, et gémir ensuite sur les vestiges à demi effacés, me plaignant de la cruelle absence. Mais ce ne sont que des objets muets et inanimés qui répondent à ma voix. O toi qui as l'oreille dure, réveille-toi enfin, et comprends ce qu'indique la nuée matinale : il n'y a personne sur la terre qui ne doive s'efforcer d'entrevoir quelque chose du monde invisible. Souviens-toi que tous les hommes sont appelés plus tôt ou plus tard. Je me serais fait entendre si j'eusse adressé la parole à un être vivant ; mais, hélas ! celui à qui je parle, est un mort.
Après que le corbeau fut venu troubler les heureux moments que je passais dans ce jardin, et qu'il m'eut engagé a me tenir en garde contre la haine que je pourrais m'attirer, je cessai de faire attention aux riants objets qui m'environnaient, et je retournai à la solitude de mes pensées : alors-une douce rêverie s'étant emparée de moi, je nie sentis comme inspiré, et je crus entendre distinctement ces paroles : O toi qui écoutes le langage énigmatique des oiseaux, et qui te plains que le bonheur semble te fuir, sache que, si le cœur était attentif à s'instruire, l’intelligence pénétrerait le sens des allégories ; le pèlerin de ce monde demeurerait dans la voie, et celui que les plaisirs éblouissent, ne s'égarerait pas. Si l'esprit était bon, il pourrait apercevoir les signes de la vérité ; si la conscience savait comprendre, elle apprendrait sans peine les bonnes nouvelles ; si l’âme s'ouvrait aux influences mystiques, elle recevrait des lumières surnaturelles ; si l’on savait écarter le voile, l'objet caché se montrerait; si l'intérieur était pur, les mystères des choses invisibles paraîtraient à découvert, et la divine maîtresse se laisserait voir. Si tu t'éloignais des choses du monde, la porte du spiritualisme s'ouvrirait pour toi; si tu te dépouillais du vêtement de l'amour-propre, il n'existerait pour toi aucun obstacle ; si tu fuyais le monde de l'erreur, tu verrais le monde spirituel ; si tu coupais les liens qui t'attachent aux plaisirs des sens, les vérités dogmatiques se montreraient à toi sans nuages ; et si tu réformais tes mœurs, tu ne serais point privé de l'aliment divin. Si tu renonçais à tes désirs, tu parviendrais au plus haut degré de la vie contemplative ; si tu subjuguais tes passions, Dieu te rapprocherait de lui ; il te réunirait à lui, si, pour lui plaire, tu te séparais de ton père; enfin si tu renonçais à toi-même, tu trouverais auprès de la divinité la plus douce des demeures. Mais, bien loin de là, captif dans le cachot de tes inclinations, enchaîné par tes habitudes, esclave des voluptés, soumis aux illusions des sens, tu es retenu par la froideur de ta détermination, tandis que le feu de la cupidité te consume, et que l'excès d'une joie insensée t'accable. Une langueur funeste t'aveugle ; les impulsions d'un amour déréglé t'enflamment le sang ; ta faible volonté ne forme que des résolutions tièdes, et ne se livre qu'à des pensées glacées ; ton esprit corrompu te jette dans un état d'hésitation pénible, et ton jugement vicieux te fait paraître mauvais ce qui est bon, et bon ce qui est mauvais.
Tu devrais entrer dans l'hôpital de la piété, et, présentant le vase de l'affliction, exposer le récit de tes souffrances à ce médecin qui connaît ce qu'on tient secret et ce qu'on lui découvre. Tu devrais tendre vers lui le poignet de ta soif brûlante, pour qu'il tâtât le pouls de ta maladie, qu'il examinât la nature de ta fièvre, et qu'après avoir connu exactement ta situation malheureuse, il te livrât à celui qui est chargé d'infliger les peines de la loi, lequel te lierait avec les liens de la crainte, te frapperait avec les verges de l'indécision et de la futurition, en te rafraîchissant en même temps avec l'éventail de l'espérance ; te garderait ensuite dans le sanctuaire de la protection, et écrirait sur le cahier de ton traitement le rétablissement de ta santé. Il préparerait pour toi le myrobalan du refuge, la violette de l'espoir, la scammonée de la confiance, le tamarin de la direction, la jujube de la sollicitude, la sébeste de la correction, la prune de la sincérité et la casse du libre arbitre ; il concasserait le tout sur la terre de l'acceptation, le pilerait dans le mortier de la patience, le tamiserait dans le tamis de l'humilité, le dépurerait par le sucre de l'action de grâces, et t'administrerait ensuite ce médicament, après la veille nocturne, dans la solitude du matin, en présence du médecin spirituel, en tête-à-tête avec la divine amie, à l'insu du rival jaloux, pour voir si ton agitation s'apaiserait, si la chaleur de tés passions se refroidirait, si ton cœur, que les voluptés t'avaient arraché, pourrait reprendre sa place, si ton tempérament acquerrait ce degré d'équilibre qui constitue la santé spirituelle ; si ton oreille pourrait s'ouvrir au langage mystique, et entendre ces douces paroles, Quelqu'un demande-t-il quelque chose ? je suis prêt à l'exaucer ; pour voir enfin si ta vue intérieure ferait des efforts afin d'être éclairée, et si tu serais capable de contempler les choses extraordinaires et merveilleuses du spiritualisme.
Considère la huppe : lorsque sa conduite est régulière et que son cœur est pur, sa vue perçante pénètre dans les entrailles de la terre, y découvre ce qui est caché aux yeux des autres êtres ; elle aperçoit l'eau qui y coule, comme tu pourrais la voir au travers d'un cristal ; et, guidée par l'excellence de son goût et par sa véracité. Voici, dit-elle, de l'eau douce, et en voilà qui est amère. Elle ajoute ensuite : Je puis me vanter de posséder, dans le petit volume de mon corps, ce que Salomon n'a jamais possédé, lui à qui Dieu avait accordé un royaume comme personne n'en a jamais eu ; je veux parler de la science que Dieu m'a départie, science dont jamais ni Salomon, ni aucun des siens, n'ont été doués. Je suivais partout ce grand monarque, soit qu'il marchât lentement, soit qu'il hâtât le pas, et je lui indiquais les lieux où il y avait de l'eau sous terre. Mais un jour je disparus tout à coup, et, durant mon absence, il perdit son pouvoir : alors s'adressant à ses courtisans et aux gens de sa suite, Je ne vois pas la huppe, leur dit-il ; s'est-elle éloignée de moi ? S’il en est ainsi, je lui ferai souffrir un tourment violent, et peut-être l’immolerai-je à ma vengeance, à moins qu'elle ne me donne une excuse légitime. (Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il ne s'informa de moi que lorsqu'il eut besoin de mon secours.) Puis voulant faire sentir l'étendue de son autorité, il répéta les mêmes mots : Je la punirai ; que dis-je ! je l'immolerai. Mais le Destin disait : Je la dirigerai vers toi, je la conduirai moi-même. Lorsque je vins ensuite de Saba, chargée d'une commission pour ce roi puissant, et que je lui dis : Je sais ce que tu ne sais pas, cela augmenta sa colère contre moi, et il s'écria : Toi qui, dans la petitesse de ton corps, renfermes tant de malice, non contente de m'avoir mis en colère, en t'éloignant ainsi de ma présence, tu prétends encore être plus savante que moi ! Grâce, lui dis-je, ô Salomon ! je reconnais que tu as demandé un empire tel qu'aucun souverain n'en aura jamais de semblable ; mais tu dois avouer aussi que tu n'as pas de même demandé une science à laquelle personne ne pût atteindre : je t'ai apporté de Saba une nouvelle que tous les savants ignorent. O huppe, dit-il alors, on peut confier les secrets des rois à celui qui sait se conduire avec prudence ; porte donc ma lettre. Je m'empressai de le faire, et je me hâtai d'en rapporter la réponse. Il me combla alors de ses faveurs ; il me mit au nombre de ses amis, et, je pris rang parmi les gardiens du rideau qui couvrait sa porte, tandis qu'auparavant je n'osais en approcher : pour m'honorer, il me plaça ensuite une couronne sur la tête, et cet ornement ne sert pas peu à m'embellir. D'après cela, la mention de mon immolation a été abrogée, et les versets où il est question de ma louange ont été lus.
Pour toi, si tu es capable d'apprécier mes avis, rectifie ta conduite, purifie ta conscience, redresse ton naturel, crains celui qui t'a tiré du néant, profite des leçons instructives qu’il te donne, quand même il se servirait, pour le faire, du ministère des animaux; et crois que celui qui ne sait pas tirer un sens allégorique du cri aigre de la porte, du bourdonnement de la mouche, de l’aboiement du chien, du mouvement des insectes qui s'agitent dans la poussière; que celui qui ne sait pas comprendre ce qu'indiquent la marche de la nue, la lueur du mirage, la teinte du brouillard, n'est pas du nombre des gens intelligents.
Tu es plus douce à mes yeux que le souffle du zéphyr qui erre la nuit dans les jardins : la moindre idée me trouble et m'agite ; chaque objet agréable me semble être une coupe où j'aperçois tes traits adorés, et dans chaque son je crois entendre ta voix chérie.
Tandis que j'étais plongé dans le charme de la conversation des oiseaux, et que j'attendais la réponse qu'ils feraient à la huppe, un chien, qui était près de la porté, m'adressa ces mots, tout en recueillant des miettes de pain parmi les ordures : O toi qui n'a pas encore soulevé le voile du mystère ; toi qui, tout entier aux choses du monde, ne peux t'élever à la cause première ; toi qui traînes avec pompe la robe de l’amour-propre, imite mes nobles actions, prends mes qualités recommandables, et, sans t'arrêter à l'infériorité de mon rang, écoute ce que je vais te dire de la sagesse de ma conduite. A ne me considérer qu'à l’extérieur, je serai à tes yeux un objet de mépris ; mais pour peu que tu m'examines, tu verras que je suis un vrai fakir. Toujours à la porte de mes maîtres, je ne recherche pas une place plus distinguée ; sans cesse avec les hommes, je ne change point de manière d'agir : on me chasse, et je reviens ; on me frappe, et je ne garde jamais de rancune ; mon amitié est toujours la même, et ma fidélité est à toute épreuve. Je veille, lorsque les hommes sont plongés dans le sommeil, et je fais une garde exacte quand la table est servie. On ne m'assigne cependant ni salaire, ni nourriture, ni même un logement, encore moins une place distinguée. Je témoigne de la reconnaissance lorsqu'on me donne ; je suis patient lorsqu'on me repousse ; et l’on ne me voit nulle part me plaindre, ni pleurer sur les mauvais traitements que j'éprouve. Si je suis malade, personne ne vient me visiter ; si je meurs, on ne me porte point dans un cercueil; si je quitte un lieu pour me rendre dans un autre, on ne me munit d'aucune provision; et je n'ai ni argent dont on puisse hériter, ni champ qu'on puisse labourer. Si je m'absente, on ne désire pas mon retour ; les enfants eux-mêmes ne me regrettent point; personne ne verse une larme; et si l’on me retrouve, on ne me regarde pas. Cependant je fais sans cesse la garde autour de la demeure des hommes, et je leur suis constamment fidèle. Obligé de rester sur les ordures qui sont auprès de leurs portes, je me contente du peu que je reçois, à défaut des bienfaits dont je devrais être comblé. Si mes mœurs te plaisent, suis mon exemple, et conforme-toi à ma conduite ; et si tu veux m'imiter, règle ta vie sur la mienne.
Apprends de moi comment il faut remplir les devoirs de l'amitié, et, à mon exemple, sache t'élever aux vertus les plus nobles. Je ne suis qu'un animal vil et méprisé ; mais mon cœur est exempt de vices. J'ai coutume de garder les habitants du quartier où je me trouve, surtout durant la nuit. Toujours patient, et reconnaissant même, de quelque manière que l’on me traite, je ne me plains jamais des injustices des hommes à mon égard, et je me contente de mettre toute ma confiance en Dieu seul. Malgré ces habitudes précieuses, personne ne fait attention à moi, soit qu'une faim cruelle me fasse expirer, ou que l'infortune m'abreuve de la coupe amère de la peine et de la douleur. Du reste, j'aime mieux supporter les mauvais traitements que j'éprouve, que de perdre ma propre estime et de m'avilir à demander. Oui, je ne crains pas de le dire, mes qualités, malgré le peu de considération dont je jouis, remportent sur celles des autres animaux.
Toi qui désires marcher dans le chemin qui conduit au palais des rois, dit alors le chameau, si tu as pris du chien des leçons d'abstinence et de pauvreté volontaire, je veux t'en donner, actuellement, de fermeté et de patience. Celui, en effet, qui se décide à embrasser la pauvreté volontaire, doit s'appliquer aussi à acquérir la patience ; car le pauvre, doué de cette vertu a droit d'être compté au nombre des riches.
Chargé de pesants fardeaux, j'achève les traites les plus longues, j'affronte les dangers du désert et je souffre avec patience les traitements les plus durs, sans que rien me décourage jamais. Je ne me précipite, point dans ma marche comme un insensé, mais je me laisse conduire même par un jeune enfant, tandis que, si je le voulais, je pourrais résister à l'homme le plus robuste. Doux et obéissant par caractère, je porte les fardeaux et les bagages divisés en deux parties égales. Je ne suis ni perfide ni facile à me rebuter : ayant réussi à vaincre tout obstacle, je n'en suis pas plus présomptueux ; et les difficultés ne me font point rebrousser chemin. Je m'enfonce hardiment dans les routes fangeuses et glissantes, où les voyageurs les plus intrépides eux-mêmes craindraient de s'engager. Je souffre avec constance la soif ardente du midi, et je ne m'écarte jamais de la ligne qui m'est tracée. Après avoir rempli mon devoir envers mon maître, et être arrivé au terme de ma course, je rejette mon licou sur mon dos, et je vais dans les champs, prenant pour ma nourriture ce qui appartient au premier venu et dont on peut s'emparer sans le moindre scrupule : mais si tout-à-coup j'entends la voix du chamelier, je lui livre de nouveau ma bride, en m'interdisant la jouissance du sommeil, et portant le cou en avant, comme pour parvenir plutôt à mon but. Si je m'égare, mon conducteur me dirige ; si je fais un faux pas, il vient à mon secours; si j'ai soif, le nom de mon amie est mon eau et ma nourriture. Destiné au service de l'homme, d'après ce passage du Coran où Dieu dit, il porte vos fardeaux, je ne cesse pas d'être en voyage ou sur pied, jusqu'à ce que je parvienne au point où finit le pèlerinage de la vie.
O Saad ! si tu viens dans ces lieux, interroge un cœur qui a pénétré dans l’asile inviolable où demeure cet objet ravissant; et si tes yeux aperçoivent au loin ce tertre sablonneux, souviens-toi de cet amant passionné que trouble et agite l'amour le plus tendre.
Chameaux, quand nous verrons Médine, arrêtez-vous.... Ne quittons plus cette enceinte sacrée. Mais quoi ! lorsque la vallée d'Alakik paraît devant eux, ils s'éloignent en imitant la marche balancée de l’autruche.
Mon frère, verse avec moi des pleurs de désir pour cette beauté dont le visage ravissant couvre de confusion la pleine lune; et ne manque pas de dire, quand tu seras dans ce jardin béni : Habitant de la tribu, je te salue.
O toi qui es devenu fakir par les leçons que t'a données le chien, et patient par celles que t'a données le chameau, dit ensuite le cheval, si tu désires connaître le sentier qui mène aux actions glorieuses, je t'apprendrai, a mon tour, en quoi consistent les choses distinguées, et ce qui constitue le véritable emploi des efforts pour obtenir le succès. Vois comment, le dos chargé de celui qui m'accable d'injures, je m'élance, dans ma course, avec autant de rapidité que l'oiseau dans son vol, que la nuit lorsqu'elle étend son voile lugubre sur la terre, que le torrent fugitif. Si mon cavalier est celui qui poursuit, il atteindra facilement par mon secours l'objet qu'il désire ; s'il est poursuivi, au contraire, j'empêche alors qu'on ne le joigne, et mon galop précipité le soustrait à son adversaire, qui, atteignant à peine la poussière que mes pieds lui rejettent, me perd bientôt de vue, et ne peut plus s'en tenir qu'à ce qu'il entend dire de moi. Si la patience du chameau est éprouvée, ma reconnaissance pour les bontés qu'on m'accorde est connue: le chameau parvient à la vérité au but qu'il se propose; pour moi je suis toujours au premier rang dans la guerre contre les infidèles. Au jour de la bataille, lorsque l'heure de l'attaque est arrivée, je me précipite avec audace comme le brave que rien ne saurait effrayer, et je précède les coups de ses flèches meurtrières; mais le chameau reste en arrière pour qu'on le charge de pesants fardeaux, ou pour que l'on cherche dans ses bagages. Les obligations qui me sont imposées, ne sont remplies que par celui qui sait tenir ses engagements ; et celui-là seul qui est léger et rapide dans sa marche, peut faire le chemin que je dois parcourir : aussi m'étudié-je à acquérir de l'agilité, me préparant ainsi au jour de la course. Si je vois quelqu'un qui soit plongé par sa folle étourderie dans une ivresse dont il ne peut revenir, et que les agréments de la vie jettent dans l'illusion la plus complète, « Tout ce que vous possédez, lui dis-je, est périssable ; les biens seuls de Dieu sont éternels. » O toi qui es repoussé loin de cet objet que tu désires avec tant d'ardeur, et qui es écarté de ce combat mystérieux, jette sur la nature un regard attentif, comprends quel est le but du Créateur, et ne tarde pas à t'imposer à toi-même des lois sévères, à donner à tes sens des liens étroits. Rappelle-toi que le destin a fixé l'instant de ta mort, qu'il a calculé le nombre de tes respirations; et crains le jour terrible du jugement à venir.
Quant à moi, lorsque le palefrenier m'a couvert de mes harnais, celui qui me monte n'a rien à redouter de ma fougue. Combien de fois ne mange-t-il pas les produits de la chasse que j'ai rendue fructueuse par ma vitesse. Toujours je laisse derrière moi celui qui cherche à me devancer, et je devance toujours celui que je poursuis. On me lie avec des entraves, afin que je n'attaque pas les autres chevaux; on me guide avec des rênes, pour que je ne m'écarte pas de la route que je dois tenir ; on me met un frein, pour que mon encontre élégante ne s'altère pas ; on me serre la bride, de crainte que j'oublie de me tenir droit; et l'on me ferre les pieds, pour que je ne me fatigue pas lorsque je m'élance dans la carrière. Le bonheur m'est promis ; un rang distingué m'est donné : on me traite avec égards, et ce n'est que pour ma propre conservation qu'on m'impose des liens. L'Être bienfaisant par excellence a répandu ses bienfaits sur moi, et, dans sa bonté éternelle, a dicté en ma faveur ses jugements en ces termes : « Jusqu'au jour de la résurrection, le bonheur est lié à la touffe de crins qui orne le front des chevaux. » Fils du vent, j'ai reçu l'inspiration de bénir et de louer Dieu : mon dos procure une sorte de gloire à celui qui le monte ; mon flanc est un trésor pour ceux qui me possèdent ; et ma société, une amulette. Combien de fois ne m'a-t-on pas poussé dans l'arène, sans que j'aie jamais laissé voir de la faiblesse ! combien de fois, ayant remporté la palme de la vitesse dans la course, n'ai-je pas été couvert de la soie, ornement des infidèles l combien de fois aussi n'ai-je point triomphé des hypocrites, et ne les ai-je point fait disparaître de la surface de la terre! Est-il encore question d'eux, et les entends-tu en aucune manière!
Avance d'un pas rapide et léger; tu obtiendras un bonheur d'autant plus précieux, qu'il est plus difficile de s'unir à cet objet chéri. Amants généreux, marchez avec courage à la suite du Prophète que la sainteté la plus parfaite décore. Ceux qui sont parvenus, dans la carrière mystique, aux plus hauts degrés du spiritualisme, ont joui de la vue de ce visage ravissant, qui brille du plus vif éclat. Peut-être atteindras-tu ces hommes heureux qui, dès l’aurore de leur vie, ont goûté ces doux instants de plaisir extatique.
Oui, dis-je alors au cheval, on trouve en toi les plus belles qualités, et tes actions sont les plus recommandables.
J'ETAIS plongé dans la réflexion lorsque le loup-cervier m'adressa ces paroles : Sage admirateur de la nature, apprends de moi la fierté et les manières superbes. Dirigé par l'élévation de mes vues et par la hardiesse de mes desseins, je suis attentif à tout ce qui peut me rapprocher de l’objet de mon amour, et je finis par m'asseoir à ses côtés. Lorsque; je poursuis ma proie, je ne suis pas aussi prompt que le cheval ; et lorsque je l'ai atteinte, je ne la terrasse pas à la manière du lion : mais je cherche à tromper par mes ruses et par mon astuce, l'animal que je veux immoler, et si, dès l'abord, je ne puis y réussir, ma colère s'allume avec violence. Ma famille cherche alors à m'apaiser ; mais je ne veux rien entendre, et le suis insensible aux bonnes manières et à la douceur. La seule cause de mon émotion provient de ma faiblesse et de mon impuissance. Oui, il faut que celui qui veut devenir parfait, et qui n'en a pas la force, qui veut embrasser la vertu, et dont l'âme s'y refuse ; il faut, dis-je, qu'il fasse éclater contre lui-même la colère de l'amour-propre, qu'il prenne ensuite de nouvelles résolutions, qu'il redouble d'efforts, et que, pour réussir, il ne se contente point d'une volonté faible et de projets mal concertés.
On trouve encore dans ma manière d'être une leçon instructive, intelligible seulement pour celui qui a l'esprit propre à saisir les allégories ; c'est que ma gloutonnerie, accroissant la masse naturelle de mon sang et de ma chair, me procure un excessif embonpoint. Appesanti par cette graisse surabondante, je crains d'être atteint, si l'on me poursuivait, et de rester vaincu dans l'arène, si l’on m'attaquait. Tu me verras alors fuir les animaux de mon espèce, et me cacher au fond.de mon repaire, pour mettre ordre à ma conscience. Je me traite moi-même, en quittant mes habitudes et en comprimant mon naturel; je mortifie mon cœur par l'abstinence, qui est la base de la dévotion ; et lorsque mes pensées s'élèvent, que mon ardeur est vraie, que mon corps est purifié de la corruption et mon âme guérie de la langueur, je sors de ma retraite solitaire : mes infirmités sont passées ; je ne suis plus gêné sur le lieu de mon habitation, et je m'établis où je me plais. Si tu te sens capable de m’imiter, parcours la même carrière que moi ; à mon exemple, abandonne pour toujours tes anciennes habitudes.
J'ai vu le loup-cervier s'emporter avec violence, lorsque, attaquant sa proie, il ne peut la terrasser : ainsi doit faire l'homme sage et généreux qui marche dans la voie du spiritualisme, s'il désire acquérir cette douce gaieté d'esprit à laquelle on parvient si difficilement.
Les qualités viriles-ne consistent ni dans les formes athlétiques, ni dans la privation des boissons et des mets, dit alors le ver-à-soie ; et ce n'est point un mérite de prodiguer des choses faites pour être prodiguées. La véritable générosité est celle qui apprend à donner libéralement son nécessaire et sa propre existence. Aussi, en faisant l’énumération des bonnes qualités, trouve-t-on les plus précieuses chez de simples vers. Je fais partie de cette classe innombrable, et je suis susceptible d'attachement envers ceux qui ont de l'amitié pour moi. Graine dans le principe, je suis recueilli comme la semence que l’on veut confier à la terre ; ensuite, tantôt les femmes, tantôt les hommes, m'échauffent dans leur sein. Quand la durée de ces soins vivifiants est parvenue à son terme, et que la puissance divine me permet de naître, je sors alors de cette graine, et je me montre à la lumière; je jette ensuite un regard sur moi-même, le jour de ma naissance, et je vois que je ne suis qu'un pauvre orphelin, mais que l'homme me prodigue ses attentions, qu'il éloigne de moi les mets nuisibles, et qu'il ne me donne jamais que la même nourriture. Mon éducation étant terminée, et dès que je commence à acquérir de la force et de la vigueur, je me hâte de remplir envers mon bienfaiteur, les devoirs qu'exige la reconnaissance, et de rendre ce que je dois à celui qui m'a bien traité. Je me mets donc à travailler d'une manière utile à l'homme, me conformant à cette sentence? La récompense d'un bienfait peut-elle être autre que le bienfait ? Sans la moindre prétention, ni sans me plaindre du travail pénible que je m'impose, je fais avec ma liqueur soyeuse, par l'inspiration du destin, un fil que les gens doués du plus grand discernement ne sauraient produire, et qui, après ma mort, excite envers moi la reconnaissance. Ce fil sert à faire des tissus qui ornent celui qui les porte, et qui flattent les gens les plus sérieux. Les rois eux-mêmes se parent avec orgueil des étoffes que l’on forme de mon cocon, et les empereurs recherchent les vêtements où brille ma soie : c'est elle qui décore les salles de jeu, qui donne un nouvel attrait aux jeunes beautés dont le sein commence à s'arrondir, qui est enfin la parure la plus voluptueuse et la plus élégante.
Après avoir fait pour mon bienfaiteur ce que la reconnaissance exige de moi, et satisfait ainsi aux lois de la réciprocité, je fais mon tombeau de la maison que j'ai tissue, et dans cette enveloppe doit s'opérer ma résurrection; je travaille à rendre ma prison plus étroite, et, me faisant mourir moi-même, je m'y ensevelis comme la veille. Pensant uniquement à l'avantage d'autrui, je donne généreusement tout ce que je possède, et je ne garde pour moi que la peine et les tourments. De plus, exposé aux peines de ce monde, dont les fondements sont le malheur et l'infortune, je suis obligé de supporter ce que me fait souffrir un feu violent, et la jalousie de l'araignée ma voisine, qui est injuste et méchante envers moi. Cette araignée, dont l'emploi est de faire la plus frêle des demeures, non contente de me chagriner par son voisinage importun, ose encore rivaliser avec moi, et me dire : Mon tissu est comme le tien, notre travail a les mêmes défauts, et nous éprouvons également l'ardeur du feu : c'est donc en vain que tu prétendrais avoir la supériorité sur moi. Fi donc ! lui dis-je de mon côté, ta toile est un filet à prendre des mouches et à rassembler la poussière, tandis que mon tissu sert d'ornement aux princes les plus distingués. N'es-tu pas d'ailleurs celle dont le Coran a publié de toute éternité la faiblesse; et ta faiblesse n'est-elle point, par suite, passée en proverbe. Oui, je puis le dire, il y a entre toi et moi la même différence que celle qui existe entre le noir artificiel que donne l'antimoine, et la noirceur naturelle de l'œil ; entre la pleine lune et une étoile a son couchant.
C'est de celui qui dirige dans le sentier de la vertu et qui dispense les bienfaits, que je tiens le secret de filer ma liqueur soyeuse. O toi qui veux imiter mon travail, crois-tu que l'on puisse jamais tirer de ta toile grossière les parures magnifiques que l'on forme avec mon fil précieux ? Peut-on donc sans mentir s'arroger un mérite quelconque, lorsqu'on n'est pas utile à autrui ?
Quoique tu prétendes que ma demeure est la plus frêle des habitations, et qu'on doit m'abandonner au mépris, répliqua l'araignée, ma supériorité sur toi est néanmoins tracée dans le livre de mémoire. Personne ne peut me reprocher de m'avoir donné des soins ; je n'ai pas même été l'objet de la tendresse de ma mère, ni des bontés de mon père. Dès le moment de ma naissance, je m'établis dans un coin de la maison et je commence à y filer. Une masure est ce que je préfère, et j'ai une propension naturelle pour les angles, parce qu'on peut s'y cacher et qu'ils offrent une foule de choses mystérieuses. Aussitôt que j'ai trouvé un lieu où je puisse commodément tendre ma toile, je jette alternativement de l'une à l'autre paroi ma liqueur glutineuse, en évitant avec soin de mêler les fils de mon tissu ; puis je fais sortir par les pores de ma filière, une soie mince qui descend au travers de l'air, et m'y tenant à la renverse, accrochée par les pattes, je laisse pendre celles qui me servent de mains ; aussi, trompé par cette position, croit-on que je suis réellement morte. C'est alors que si la mouche passe, je la prends dans les filets tendus par ma ruse, et je l'emprisonne dans les rets de ma chasse. Je sais que tu es en possession d'un honneur dont je suis privée, en ce que je ne tisse point comme toi des étoffes précieuses pour cette maison de passage : mais où étais-tu, la nuit de la caverne, lorsque de ma toile protectrice je voilai le Prophète choisi de Dieu, que j'éloignai de lui les regards, et le délivrai ainsi des légions infidèles, faisant pour lui ce que ni les fugitifs de la Mecque, ni les Médinois, n'auraient jamais pu faire! Je protégeai de même le respectable vieillard Abou Bekr, qui accompagna Mahomet à Médine et dans la caverne, et qui le suivit dans le chemin de l'honneur et de la gloire. Pour toi, tu n'emploies tes vaines parures qu'à tromper et a séduire ; aussi tes étoffes, destinées à l'ornement des femmes dont l'esprit est si peu solide et à l'amusement des enfants qui n'ont pas de raison, sont interdites aux hommes, parce que l'éclat n'en saurait durer, que leur usage n'est d'aucun profit réel, et qu'on n'en peut tirer aucun avantage pour la vie spirituelle. Hélas ! combien est malheureux celui que sa maîtresse délaisse, en lui ôtant l'espoir de se donner jamais à lui; qu'elle prive de ses faveurs, en lui interdisant même la douceur de la demande; qu'elle éloigne impitoyablement de sa présence, en lui défendant, d'approcher !
O toi qui te complais dans des salons somptueux et magnifiques, tu as donc oublié que ce monde n'est autre chose qu'un temple pour prier et pour adorer Dieu. Après avoir dormi sur ces lits voluptueux, tu descendras demain dans l'étroit et sombre caveau du sépulcre ; tu seras au milieu d'êtres silencieux, mais dont le silence énergique équivaut à des paroles : ah ! qu'un simple habit soit tout ton vêtement, et que quelques bouchées forment ta nourriture ; comme l'araignée, prends une habitation modeste, en te disant à toi-même : Demeurons ici en attendant la mort.
Si la fortune ennemie te décoche ses traits, dit alors la fourmi, oppose-lui un calme inaltérable ; et lorsque tu verras quelqu'un qui se prépare à parcourir la carrière du spiritualisme, pars avant lui, et ne néglige point follement de régler tes actions dans cette vie. Prends leçon de moi, et sens combien il importe de faire des préparatifs et de se munir d'un viatique pour la vie future. Vois le but élevé que j'ai constamment devant les yeux, et considère de quelle manière la main de la Providence a ceint mes reins comme ceux de l'esclave, afin de me dispenser de serrer et de délier tour-à-tour ma ceinture. Dès qu'au sortir du néant j'ouvre les yeux à la lumière, on me voit empressée a me ranger parmi les serviteurs de la céleste amie; je m'occupe ensuite, dirigée par l’assistance divine, à recueillir les provisions nécessaires, et j'ai pour cela un avantage que l'homme le plus intelligent ne possède point, c'est que mon odorat s'étend à la distance de plusieurs parasanges. Je mets en ordre, dans ma cellule, les grains que j'ai ainsi rassemblés pour ma nourriture ; et celui qui fait ouvrir l'amande et le noyau, m'inspire de couper chaque grain en deux parties égales : mais si c'est de la semence de coriandre, je la divise en quatre, guidée par le même instinct ; et cette précaution est nécessaire pour détruire en elle la faculté germinative ; car, partagée en deux, elle ne laisserait pas de se reproduire. Lorsque, dans l'hiver, je crains que l'humidité du sol n'altère mes grains, je les expose à l'air un jour où le soleil luit, afin que sa chaleur les sèche. Tel est constamment mon usage : et tu prétends que ces mesures sont mal prises, qu'elles doivent m'être funestes, et que c'est, d'ailleurs, marquer trop d'attachement pour les biens de ce monde ! Tu te trompes, je te l'assure ; si tu connaissais ce qui me porte à agir de la sorte, tu m'excuserais toi-même, et tu ferais de moi plus de cas que tu n'en fais. Sache que Dieu (qu'il soit béni et loué !) a des armées que lui seul connaît, comme l'attestent ces mots du Coran : Personne ne connaît les armées de ton Seigneur, si ce n'est lui seul. Or il y a sous terre l'armée des fourmis, dont le nombre est incalculable. Nous observons les règles du service de Dieu, nous ne nous attachons qu'à lui, nous ne nous confions qu'en lui, et nous n'avons que lui en vue ; aussi suscite-t-il, du milieu de nous, celles qu'il veut élever sur nous, et il demande que nous soyons soumises, afin que nos chefs nous promettent des bienfaits. Après avoir entendu cette promesse, nous sortons sans contrainte, nous résignant à mourir; et, au moment de notre départ, notre situation semble exprimer ces mots :
Reçois, ô ma bien-aimée, les adieux que je t'adresse, les yeux mouillés des larmes de la douleur, en pensant que je vais être séparé de toi. Nous vivrons, je l'espère, et Dieu couronnera notre amour ; mais si la mort vient nous frapper, nous nous retrouverons ensemble dans une vie plus heureuse.
Nous employons tous nos efforts, amassant sans cesse pour être utiles à d'autres qu'à nous. Mais exposées à mille genres de mort, parmi nous les unes périssent de faim ou de soif, les autres tombent dans un précipice, d'où elles ne peuvent sortir : ici c'est une mouche qui les saisit; là un quadrupède ou un animal quelconque qui les foule aux pieds; plus loin, c'est un oiseau qui en fait sa nourriture. Parmi nous, les unes meurent saintement, tandis que d'autres ne sauraient obtenir le salut; enfin, d'après ces mots du Coran, Il y a des croyants qui ont observé sincèrement ce qu'ils ont promis à Dieu, nous mettons devant nous ce que nous avons, et nous le partageons également entre nous sans aucune partialité et sans aucune injustice. Si tu es du nombre des élus, tu te convertiras par l'autorité du Coran ; mais si l'aile de ta volonté ne peut atteindre aux choses élevées, le destin t'est contraire.
O vous qui savez comprendre les allégories, en voici une qui ne peut manquer de vous être agréable : si vous croyez pouvoir saisir le sens caché de la parabole que je vous présente, écoutez attentivement ces allusions énigmatiques qui renferment mon secret.
On rapporte qu'un jour les oiseaux s'assemblèrent, et qu'ils se dirent les uns aux autres : Nous ne pouvons nous passer d'un roi que nous reconnaissions, et par qui nous soyons reconnus : allons donc en chercher un, attachons-nous à lui, et, soumis à ses lois, nous vivrons à l'abri de tout mal, sous sa protection semblable a l'ombre d'un arbre au feuillage épais. On nous a dit qu'il y a, dans, une des îles de la mer, un oiseau nommé Anca-mogreb, dont l'autorité s'étend de l'orient à l'occident : pleins de confiance en cet être, volons donc vers lui. Mais la mer est profonde, leur dit-on ; la route est difficile et d'une longueur incalculable : vous avez à franchir des montagnes élevées, à traverser un océan orageux et, des flammes dévorantes. Croyez-le, vous ne sauriez parvenir à cette île mystérieuse ; et quand même vous surmonteriez tous les obstacles, la pointe acérée des lances empêche d'approcher de l'objet sacré : restez donc dans vos nids, car votre partage est la faiblesse, et ce puissant monarque n'a pas besoin de vos hommages, comme l'expose ce texte du Coran : Dieu n'a pas besoin des créatures. Le Destin vous avertit d'ailleurs de vous défier de votre ardeur, et Dieu lui-même vous y engage. Cela est vrai, répondirent-ils ; mais les désirs de l'amour ne cessent de nous faire entendre ces mots du Coran : Allez vers Dieu. Ils s'élancèrent donc dans l’air, avec les ailes auxquelles fait allusion ce passage du même livre, Ils pensent à la création dû ciel et de la terre, supportant avec patience la soif brûlante du midi, d'après ces paroles : Celui qui sort de sa maison pour fuir &c. Ils marchèrent sans se détourner jamais de leur route: car, prenaient-ils à droite, le désespoir venait les glacer; prenaient-ils à gauche, l'ardeur de la crainte venait les consumer. Tantôt ils s'efforçaient de se devancer mutuellement ; tantôt ils se suivaient simplement l'un l'autre. Les ténèbres d'une nuit obscure, l'anéantissement, les flammes, la défaillance, les flots irrités, l’éloignement, la séparation, les tourmentaient tour-à-tour. Ils arrivèrent tous enfin à cette île pour laquelle ils avaient abandonné leur patrie, mais l'un après l'autre, sans plumes, maigres et abattus, tandis qu'ils étaient partis surchargés d'embonpoint.
Lorsqu'ils furent entrés dans l’île de ce roi, ils y trouvèrent tout ce que l’âme peut désirer, et tout ce que les yeux peuvent espérer de voir. On dit alors a ceux qui aimaient les délices de la table, ces mots du Coran, Prenez des aliments sains et légers, en récompense du bien que vous avez fait dans l'autre vie ; a ceux qui avaient du goût pour la parure et pour la toilette, ces mots du même livre, Ils seront revêtus de draps précieux et d'habits moirés, et seront placés en face les uns des autres ; à ceux pour qui les plaisirs de l'amour avaient le plus d'attraits, Nous les avons unis aux houris célestes. Mais lorsque les contemplatifs s'aperçurent de ce partage : Quoi ! dirent-ils, ici comme sur la terre notre occupation sera de boire et de manger ! Quand donc l'amant pourra-t-il se consacrer entièrement à l'objet de son culte ! quand obtiendra-t-il l'honneur qu'appellent ses vœux brûlants ! Non, il ne mérite pas la moindre considération, celui qui accepte le marché de la dupe. Quant à nous, nous ne voulons que ce roi pour qui nous avons traversé des lieux pierreux, franchi tant d'obstacles divers, et supporté avec patience la soif ardente du midi, en nous rappelant ce passage du Coran : Celui qui sort de sa maison pour fuir, &c. Nous faisons d'ailleurs peu de cas des parures et des autres agréments. Non, encore une fois, par celui qui seul est Dieu, ce n'est que lui que nous désirons, que lui seul que nous voulons pour nous. Pourquoi donc êtes-vous venus, leur dit alors le roi, et qu'avez-vous apporté! L'humilité qui convient à tes serviteurs, répondirent-ils; et certes, nous osons le dire, tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous désirons. Retournez-vous-en, leur dit-il. Oui, je suis le roi, que cela vous plaise ou non ; et Dieu n'a pas besoin de vous. Seigneur, répliquèrent-ils, nous savons que tu n'as pas besoin de nous; mais personne parmi nous ne peut se passer de toi. Tu es l'être excellent, et nous sommes dans l'abjection ; tu es le fort, et nous sommes la faiblesse même. Comment pourrions-nous retourner aux lieux d'où nous venons! nos forces sont épuisées, nos cohortes sont dans un état de maigreur inexprimable, et les traverses auxquelles nous avons été en proie ont anéanti notre existence corporelle. Par ma gloire et par ma dignité, dit alors le roi, puisque votre pauvreté volontaire est vraie, et que votre humilité est certaine, il est de mon devoir de vous retirer de votre position malheureuse. Guérissez celui qui est malade ; et venez tous dans ce jardin frais et ombragé, goûter le repos le plus voluptueux. Que celui dont l’espoir s'est attiédi, prenne un breuvage où l'on aura mêlé du gingembre; que celui, au contraire, qui s'est laissé emporter par la chaleur brûlante du désir, se désaltère dans une coupe où l'on aura mêlé du camphre. Dites à cet amant fidèle qui a marché dans la voie du spiritualisme, Bois à la fontaine nommée Salsabil. Amenez à son médecin le malade, puisque sa fièvre amoureuse est véritable ; approchez de sa maîtresse l'amant, puisque sa mort mystique est complète. Alors leur seigneur les combla de bonheur et de joie; il les abreuva d'une liqueur qui les purifia ; et aussitôt qu'ils en eurent bu, ils furent plongés dans la plus douce ivresse. Ils dansèrent ensuite au son d'airs mélodieux: ils désirèrent de nouveaux plaisirs, et ils les obtinrent ; ils firent diverses demandes, et ils furent toujours exaucés. Ils prirent leur vol avec les ailes de la familiarité, en présence de Gabriel ; et, pour saisir le grain sans tache du chaste amour, ils descendirent dans le lieu le plus agréable, où était le roi le plus puissant. Aussitôt qu'ils y furent arrivés, ils entrèrent en possession du bonheur, et, jetant avidement leurs regards dans ce lieu sacré, ils virent que rien ne cachait plus le visage de leur maîtresse adorée ; que les coupes étaient disposées; que les amants étaient avec leur divine amie… Ils virent enfin ce que l'œil n'a jamais vu, et ils entendirent ce que l'oreille n'a jamais entendu.
O mon âme, réjouis-toi à l'heureuse nouvelle que je vais t'apprendre : ta maîtresse chérie reçoit de nouveau tes vœux et tes hommages ; sa tente, asile du mystère, est ouverte à ses amants fidèles. Respire avec volupté les parfums enivrants qui s'exhalent de cette tribu sacrée. Vois l'éclair, avant-coureur de l’union la plus tendre, briller au loin dans la nue. Tu vas vivre dans la situation la plus douce ; toujours auprès de ta bien-aimée, toujours avec l'idole de ton cœur, sans que rien puisse jamais t'en séparer. Les larmes de l'absence ne mouilleront plus tes paupières ; une barrière funeste ne t'éloignera plus de ce seuil béni ; un voile importun ne te cachera plus ces traits radieux : tes yeux, ivres d'amour, contempleront, à tout jamais, la beauté ravissante de cet objet dont une foule d'amans désirent si ardemment la vue, et pour qui tant de cœurs sont consumés d'amour.

[1]
Rien n'est si commun, chez les écrivains arabes, que ce
 . On trouve dans la
Vie de Timour, par Ahmed ben-Arabschah, édit. de Manger,
t. II, p. 908, un passage qui explique parfaitement
ce que les Arabes entendent par cette expression. Il y est
dit qu'un des soldats de Tamerlan avait pris une vache, sur
laquelle il avait mis tout ce dont il s'était emparé, et
qu'après deux ou trois jours de marche, cette vache, épuisée
de fatigue, sembla dire, par le langage muet de sa
situation, qu'elle n'avait pas été créée pour cet usage :
. On trouve dans la
Vie de Timour, par Ahmed ben-Arabschah, édit. de Manger,
t. II, p. 908, un passage qui explique parfaitement
ce que les Arabes entendent par cette expression. Il y est
dit qu'un des soldats de Tamerlan avait pris une vache, sur
laquelle il avait mis tout ce dont il s'était emparé, et
qu'après deux ou trois jours de marche, cette vache, épuisée
de fatigue, sembla dire, par le langage muet de sa
situation, qu'elle n'avait pas été créée pour cet usage :
 . Nos langues d'Europe,
quoique bien plus sobres de métaphores que les langues de
l'Orient, mais cependant fertiles en figures, surtout dans
la conversation, peuvent même-nous fournir des exemples qui
feront comprendre le
sens.de
cette expression. Nous disons, par exemple : « Ce gazon
invite à se reposer, ce fauteuil vous attend, » &c. : voilà
ce qu'en arabe on appelle langage de l'état; en
effet, c'est comme si l'on disait : « Ce gazon semble,
par sa manière d'être, vous dire, reposez-vous ; ce
fauteuil semble par sa propriété vous dire, je vous attends,
&c. »
. Nos langues d'Europe,
quoique bien plus sobres de métaphores que les langues de
l'Orient, mais cependant fertiles en figures, surtout dans
la conversation, peuvent même-nous fournir des exemples qui
feront comprendre le
sens.de
cette expression. Nous disons, par exemple : « Ce gazon
invite à se reposer, ce fauteuil vous attend, » &c. : voilà
ce qu'en arabe on appelle langage de l'état; en
effet, c'est comme si l'on disait : « Ce gazon semble,
par sa manière d'être, vous dire, reposez-vous ; ce
fauteuil semble par sa propriété vous dire, je vous attends,
&c. »
[2] Le Tasse a imité ainsi ce passage :
Cosi all' egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gli orli del vaso :
Succhi amari ingannato intanto ei beve,
E dall’ inganno suo vita riceve.
Jér. dél. I, 3.
[3] On peut voir dans le fragment des Poeseos asiat. Comm,, cité ci-devant, que W. Jones, à la vérité un peu enthousiaste quelquefois, n'hésite pas à considérer cet ouvrage comme parfait, tant, à cause du grand nombre de belles figures qui s'y trouvent, qu'à cause de l'élégance et de la grâce du style.
[4]
Cependant Abou'lmahassen le nomme
 ; mais je crains que
ce ne soit une faute du copiste, qui aura oublié de faire
précéder ce mot de
; mais je crains que
ce ne soit une faute du copiste, qui aura oublié de faire
précéder ce mot de  .
.
[5]
Aucun des manuscrits dont, je me suis servi ne porte le
titre de Vaez [ ]
qu'Abou'lmahassen et W. Jones donnent à Azz-eddin : du reste
ce mot signifie prédicateur ; et l'on désigne
ordinairement par ce nom la personne obligée de prêcher,
chaque vendredi, après l'office solennel de midi. Voyez
Mouradgea d'Ohsson, Tabl. de l'Empire ottoman, t. II,
p. 369.
]
qu'Abou'lmahassen et W. Jones donnent à Azz-eddin : du reste
ce mot signifie prédicateur ; et l'on désigne
ordinairement par ce nom la personne obligée de prêcher,
chaque vendredi, après l'office solennel de midi. Voyez
Mouradgea d'Ohsson, Tabl. de l'Empire ottoman, t. II,
p. 369.
[6]
Il paraît que les exemplaires du
 sont rares en Europe
: je n'ai trouvé son indication que dans le Catalogue des
Manuscrits de la Bibliothèque Bodléienne, par J. Uri, p.
184.
sont rares en Europe
: je n'ai trouvé son indication que dans le Catalogue des
Manuscrits de la Bibliothèque Bodléienne, par J. Uri, p.
184.