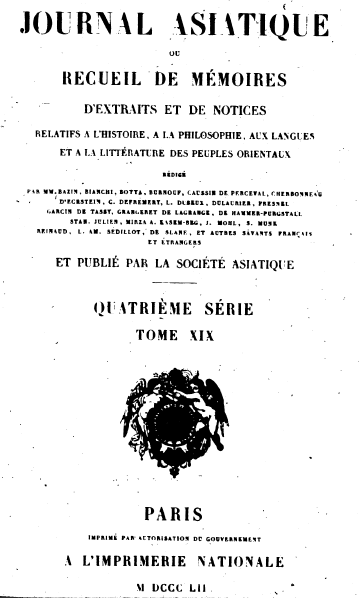
KHONDEMIR
HABIB ESSIIER (extrait)
Traduction française : M. C. DEFREMERY
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
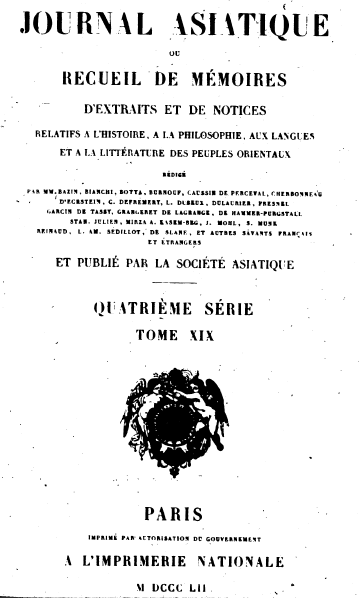
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Extraite du HABIB ESSIIER de
Traduite du Persan et accompagnée de Notes,
PAR M. C. DEFRÉMERY.
Extraits du Journal Asiatique, 1852
Des quatre grandes monarchies entre lesquelles se partagea l’empire fondé par Gengis khan, la première et la dernière nous sont connues jusque dans les moindres détails de leur histoire, grâce aux sources chinoises, arabes et persanes, auxquelles sont venus se joindre, pour certaines portions, les écrits des voyageurs et des missionnaires chrétiens du xiiie et du xive siècles. Il n’en est pas de même de la seconde et surtout de la troisième dynastie.[1] Si, pour ce qui regarde le royaume du Kiptchak ou de la Horde d’or, les chroniques slaves peuvent suppléer en partie à l’insuffisance des documents orientaux, on ne possède aucun secours pour l’histoire du royaume fondé par Djaghataï dans la Transoxiane et dans le Turkestan. Aussi le savant Deguignes avoue-t-il n’avoir trouvé que des listes peu exactes de ces princes[2] et n’a-t-il consacré que trois pages à l’histoire des vingt et un premiers, dont le nombre se trouve même réduit par lui à dix-neuf. M. le baron d’Ohsson a comblé ou rectifié en partie les lacunes et les erreurs de Deguignes. A la fin de sa belle et savante Histoire des Mongols depuis Tchinguiz Khan jusqu’à Tamerlan, il a donné une table des princes djaghatéens beaucoup plus exacte que celle de Deguignes. De plus il a traité, avec les détails nécessaires, les points de l’histoire de ces princes qui se rattachent à celle des grands khans de Karakoroum et des Mongols de la Perse.
Mais il nous manque encore la série chronologique des souverains du Djaghataï, depuis la fondation de cet empire, jusqu’à son démembrement, vers le milieu du xive siècle, ainsi que des détails sur les princes du Turkestan, qui succédèrent à une portion de leur autorité. Le morceau de Khondémir dont j’offre ici le texte, suivi d’une traduction et de notes, peut combler, au moins en partie, cette lacune. L’auteur persan a conduit son travail jusqu’à l’époque où il vivait. (On sait, par son propre aveu, qu’il termina son Habib essiier dans l’année 930 de l’hégire = 1523 de l’ère chrétienne.) Mais son récit est fort inégal; tantôt il entre dans les plus grands détails et consacrera, par exemple plus de deux pages à la description fort ampoulée d’une bataille tantôt, il lui suffira de deux ou trois lignes pour indiquer plusieurs règnes. Malgré ces défauts, qui sont ceux de tous les historiens orientaux, à quelques exceptions près, le chapitre du Habib essiier, que l’auteur a consacré à l’histoire du Mavérannahr et du Turkestan sous les souverains mongols, me paraît digne de l’attention des orientalistes qui ne peuvent recourir à d’autres sources, et notamment à l’Olous Arbau d’Olough-Beig au Turikhi Tachkendi, et au Turikhi Réchidi d’Haïder Doughlat Gourân.
Mon travail a été fait sur le manuscrit 69 du fonds Gentil (supplément persan de la Bibliothèque nationale). Le chapitre que je publie occupe dans le tome III de cet exemplaire, depuis la dernière ligne du feuillet 25 v° jusqu’au bas du feuillet 31 r°. Le manuscrit est copié dans une écriture nestalik, fort nette et assez élégante. Mais il est loin d’être correct, et un grand, nombre de noms propres y sont ou mal écrits ou dépourvus de points diacritiques. J’ai rétabli entre parenthèses la vraie leçon, toutes les fois que j’ai pu la découvrir. Enfin, je me suis attaché à reproduire le sens exact de l’auteur, aussi souvent qu’il m’a été possible de le faire, sans présenter des images trop ridicules ou trop étrangères au goût français.
Cet extrait est le cinquième fragment tant soit peu étendu du Habib essiier, qui soit publié et traduit. Puisse-t-il être accueilli avec autant d’intérêt que ceux dont on doit la connaissance au major général W. Kirkpatrick, à Jourdain, à MM. Charmoy et Bernhard Dorn. Puisse-t-il surtout inspirer à quelque autre orientaliste l’idée de consacrer ses veilles à un ouvrage important et jusqu’ici trop négligé. Khondémir mérite bien d’obtenir une partie de la faveur qui s’est portée presque exclusivement sur l’ouvrage de son père Mirkhond. Je ne crains pas de dire que l’histoire orientale, pendant la seconde moitié du xve siècle et le premier quart du xvie, ne nous sera bien connue que lorsque nous posséderons une édition ou traduction de la partie du Habib essiier qui s étend depuis la mort du sultan Chah-Rok, jusqu’à la fin du règne de Chah Ismaïl, fondateur de la dynastie des Séfis ou Séfévis. Cette portion de l’ouvrage offre d’autant plus d’intérêt, que l’auteur y raconte des événements arrivés de son temps, et dont il a pu recueillir les détails de la bouche des principaux acteurs.
TRADUCTION.
Djaghataï, qui était le second des fils de Djinguiz khan, se distinguait parfaitement de tous ses frères par sa grande sévérité et par sa profonde connaissance des moindres prescriptions du Iaça et du Tourah.[3] Lorsque Djinguiz khan partagea entre ses fils les provinces de son empire, il lui confia le gouvernement du Mavérannahr et d’une partie du Khârezm, pays des Igours, de Cachgar, de Radakhchàn, de Balkh et de Ghiznin, jusqu’à la rive du fleuve Sind. Au moment de sa mort, il établit que Caratchar Noïan, fils de Sougoudjidjen, fils d’Irdemdji-Berlas qui était le cinquième aïeul de l’émir Timour Gourkàn, serait l’administrateur de l’empire de Djaghataï.[4] Celui-ci, après la mort de son père, prit Pich-Baligh pour sa capitale, et laissa entre les mains de l’émir Caratchar les rênes de l’autorité, en ce qui regardait les soldats et les sujets. Quant à lui, il passait la plupart du temps à la cour d’Ogodaï caân. Quoique celui-ci fût son cadet, il mettait un soin extrême à lui témoigner de la considération, à l’honorer et à se soumettre à ses ordres.[5] Comme Djinguiz khan avait confié à la responsabilité de Djaghataï le soin de faire observer les règles de son Iaça de mauvais augure et de son Tourah blâmable; ce prince montrait un zèle excessif et beaucoup d’insistance pour l’accomplissement de cet objet. Des exigences qui étaient complètement opposées à la loi divine, et à la raison, émanaient de lui par rapport aux diverses, classes de la population. C’est ainsi qu’il obligeait les hommes à manger des charognes[6] et ne permettait pas d’entrer en plein jour dans l’eau courante, ou d’égorger les moutons conformément aux prescriptions de la loi. Il avait montré une si grande sévérité en ce qui regardait la manière de tuer les moutons, que, pendant la durée de sa puissance, personne, dans le Khorassan, et, à plus forte raison, dans le Mavérannahr et le Turkestan, ne pouvait enfoncer publiquement le couteau dans la gorge de ces animaux. Il avait également ordonné de mettre à mort quiconque urinerait dans l’eau, ou y jetterait les ordures de son nez.
La révolte et le meurtre de Mahmoud Tarabi arrivèrent sous le règne de Djaghataï khan. Ce prince mourut dans l’année 638 (1240-1241) ou dans l’année 640 (1242-1243). Parmi les hommes distingués de son époque, Abou Iakoub Assekaki vécut pendant quelque temps dans sa société, et Habech-Amid était son vizir. Il est rapporté dans le Djami-Réchidi que Djaghataï khan avait huit fils, savoir:
1° Maoudji, dont la mère était une jeune fille au service de Yiçouloun Khatoun, fille de Kaba-Noïan Kongorat. Yiçouloun Khatoun avait la prééminence sur les autres Khatoun de Djaghataï khan;
2° Mitoukan, qui était né de Yiçouloun Khatoun et qui périt d’un coup de flèche, devant le château de Thalékan[7]
3° Melkéchi qui mourut également du vivant de son père dans sa treizième année; 4° Sarban;[8] 5° Yiçou-monga; 6° Baidar; 7° Karaki; 8° Taldjoud.
Ainsi que nous le raconterons incessamment, après la mort de Djaghataï khan, l’autorité souveraine dans les contrées du Tourân et du Moghoulistân passa successivement à plus de trente de ses descendants et de ses proches. Le terme des jours de leur puissance arriva à l’époque ou fut arboré l’étendard du bonheur de l’émir Timour Gourkân.
Dans l’année 630 (de J. C. 1232-33), dans la bourgade de Tarab, située à trois parasanges de Boukhara, un homme appelé Mahmoud ayant commencé à agir avec ruse et hypocrisie, suivit en apparence le chemin de l’abstinence et de la dévotion. Il prétendit que les génies avaient continuellement des entrevues avec lui et l’instruisaient des choses les plus secrètes. A force d’entendre de pareils contes, beaucoup d’ignorants et de personnes du commun vinrent volontiers trouver Tarabi. Quelques malades cherchèrent à obtenir leur guérison (littérale ment, le succès et un heureux augure) au moyen du souffle de ce méchant. Par hasard, quelques personnes obtinrent une guérison à la même époque. Cela fut cause d’un doublement de confiance de la part de. Populations, et une grande multitude se rassembla de toutes parts auprès de Tarabi. Un des savants de Boukhara, qui était surnommé Chems eddin Mahbôubi, s’était livré à cet ignorant à cause de la haine qu’il portait aux chérifs et aux notables de la ville, lui tint le discours suivant:
« Mon père a dit, dans un de ses ouvrages, qu’il sortirait de Tarab, près de Boukhara, un homme puissant, distingué par, tels et tels attributs, et qui conquerra le monde habité. Ces signes se rencontrent réellement sur la noble personne. » L’orgueil de Mahmoud fut accru par de tels discours, et l’ambition du rang suprême se glissa dans son esprit. Plusieurs émirs mongols qui habitaient à Boukhara, ayant conçu des soupçons, allèrent tous ensemble trouver Tarabi, et, après lui avoir témoigné leur bon vouloir et leur considération, ils lui dirent « Il convient que le cheikh daigne honorer la ville de sa présence, afin qu’elle ne soit pas privée du bonheur de le recevoir. » Tarabi, ayant accueilli cette demande, se dirigea vers Boukhara. Le darogah (lieutenant de police) et les notables de Boukhara convinrent de le tuer, lorsqu’ils seraient arrivés à l’extrémité d’un pont qui se trouvait sur la route. Le rusé cheikh, ayant eu connaissance de ce secret, dit au darogah de la ville, après qu’il fut arrivé en cet endroit: « Renonce à ta mauvaise pensée ou sinon, et sans que la main d’un homme intervienne, j’ordonnerai que l’on arrache tes yeux de leur orbite. » Le darogah et les autres émirs furent remplis de crainte par la découverte de leur secret, et n’osèrent attaquer Mahmoud. Celui-ci descendit à Boukhara dans une maison convenable. L’empressement des grands et des gens du peuple à le visiter dans cette demeure fut tel, que le vent lui-même n’y pouvait passer. Le darogah et les émirs cherchaient une occasion de faire périr. Mais, à cause des nombreuses allées et venues des habitants, ils ne parvenaient pas à leur but. Sur ces entrefaites, un des disciples du cheikh l’instruisit des mauvais desseins des émirs. Tarabi, étant sorti le la maison par porte dérobée, monta à cheval et se rendit en toute hâte à la colline d’Abou Hafs. Lorsque la populace de Boukhara vit le cheikh en cet endroit, elle commença à s’agiter et dit : « Le khodjah s’est envolé de la maison et est arrivé en un clin d’œil à la colline d’Abou Hafs. » Les hommes obscurs et les nobles, ayant alors renoncé à toute prudence, se dirigèrent vers Tarabi.
Lorsque la nuit fut arrivée, celui-ci, adressant la parole à ses partisans, leur dit: « Ô vous qui cherchez la vérité, jusques à quand peut-on pratiquer la négligence et l’incurie ? Il faut purifier la terre de la souillure que lui imprimé la présence de vils infidèles et s’occuper, ainsi qu’il convient, de fortifier la religion évidente. Les ignorants et la populace, qui en obtinrent la permission du cheikh, prirent les armes et se dirigèrent en sa compagnie vers la ville. Le darogah et les émirs mongols préférèrent la fuite au combat. Tarabi s’établit fortement à du, au comble de la puissance. Le vendredi, il récita la khotba en son nom, ordonna de chasser tous ceux dont on soupçonnait les intentions. Il fortifia la main des vagabonds et des vauriens, si bien qu’ils entraient dans les demeures des riches et en enlevaient tout ce qu’ils voulaient. Vers le même temps il lui arriva de dire : « Avant peu nous recevrons des armes du monde invisible.[9] Par hasard, à la même époque, plusieurs marchands de Chiraz,[10] ayant ouverts leurs ballots à Boukhara, en tirèrent quatre kharvars de sabres. Cette rencontre cause de l’augmentation du bon vouloir des habitants en faveur de Tarabi. Quelques jours après l’avènement de Mahmoud au pouvoir, le darogah et les émirs qui étaient sortis de Boukhara, étant revenus avec une armée nombreuse, se préparèrent au combat. Tarabi alla leur rencontre, et, lorsqu’il fut arrivé près des Mongols, il rangea son armée en ordre de bataille. Quant à lui, il se plaça au centre, en compagnie de Chems eddin Mahboubi.
Comme le bruit s’était répandu parmi les hommes que Tarabi, outre ses troupes visibles, possédait une armée de génies, qui volaient entre la terre et le ciel, et que la main de quiconque tirerait l’épée et l’arc contre lui serait desséchée, les Mongols ne portaient qu’avec crainte la main à l’arc, au sabre et à la lance. A la fin, deux flèches mortelles étant parties de la main du destin, atteignirent la poitrine de Tarabi et de Mahboubi, et tous deux tombèrent morts. Mais, à cause de la violence du vent et de la grande intensité de la poussière personne n’eut connaissance de cet événement. L’armée de Djaghataï khan, imputant cet ouragan à un miracle du cheikh, se hâta de prendre la fuite. Les disciples du cheikh se mirent à sa poursuite et tuèrent près de mille personnes. Lorsqu’ils furent de retour dans leur camp et qu’ils ne trouvèrent plus Tarabi vivant, ils dirent: « Le khodjah a fait une absence; » placèrent sur le trône ses frères, Mohammed et Ali, et se soumirent à cette autorité.
Lorsque ces nouvelles furent arrivées à la connaissance de l’émir Karatchar, il désigna pour réprimer ces désordres deux noïans courageux, qu’il plaça à la tête d’une armée considérable. Ces deux chefs parvinrent près de Boukhara, une semaine après la mort de Tarabi. Les frères de Tarabi rangèrent leurs troupes en ordre de bataille vis-à-vis des Mongols. Un violent combat s’étant engagé, près de vingt mille personnes périrent des deux côtés. Les frères de Tarabi succombèrent aussi, et leurs partisans s’enfuirent dans des trous et des endroits retirés. Les Mongols se dirigèrent alors vers Boukhara, dans l’intention de la piller et de la mettre à feu et à sang. Mais une troupe d’hommes respectables allèrent à leur rencontre, avec des dons et des présents, et leur dirent: « Ne vous pressez pas tant de ruiner cette ville, afin que le récit de cet événement arrive à la connaissance de l’émir Karatchar et que vous receviez ses ordres. » Ces émirs ayant accueilli leur demande, lorsque ce noïan juste (Karatchar) fut informé de cette circonstance, il ordonna que les émirs et les soldats revinssent, sans vexer les Boukhariens. C’est ainsi que, grâce à l’intervention de Karatchar-Noïan, les habitants de Boukhara furent délivrés à la fois des maux que leur causait la révolte des Tarabiens et du meurtre et du pillage dont les menaçaient les soldats mongols.
Le savant vertueux Abou Iakoub es-Sékaki (dont le livre intitulé La Clef de la science, de la rhétorique et de l’éloquence est un des ouvrages élégants) était profondément versé dans les sciences merveilleuses et les connaissances étonnantes, dans l’art de soumettre les génies, dans les enchantements, l’invocation des étoiles, les talismans, la magie et les propriétés des corps terrestres et des astres. Cela ayant été révélé à Djaghataï khan, par le moyen d’Habech Amid et d’un autre des officiers attachés à son service, il manda ce savant et en fit son compagnon et son commensal. Sékaki montrait continuellement au roi des choses merveilleuses, ce qui augmentait la bonne opinion et la considération de Djaghataï à son égard. Voici un de ses traits: Un jour que Djaghataï khan était assis sur un siège, il vit plusieurs hérons qui volaient dans le ciel; il porta aussitôt la main à son arc et à ses flèches. Sékaki lui dit : Lequel de ces hérons l’empereur veut-il voir tomber par terre? Djaghataï répondit : « Le premier le dernier et ce qui au trouve au milieu. » Sékaki traça un cercle sur la terre, récita une invocation: magique et fit un signe avec le doigt. Ces trois hérons tombèrent aussitôt par terre. Djaghataï s’en mordit les doigts d’étonnement. Il devint le disciple et l’admirateur d’Abou Iacoub, à un tel point qu’il lui montrait les plus grands égards.[11]
Vers le même temps Sékaki dit à Djaghataï:
« A l’époque où je me trouvais à Bagdad, je fus mécontent du vizir du khalife et j’empêchai par mes enchantements le feu de brûler (littéralement, je liai le feu), de sorte que les habitants avaient beau faire tous leurs efforts, on ne pouvait l’allumer. Au bout de trois jours et autant de nuits, une plainte générale s’éleva. Le khalife sut que cela était un ouvrage de mon art; il me manda, et me dit: « Délie le feu. » Je répondis: « Je le ferai, lorsque l’on aura proclamé dans Bagdad que cet acte a été opéré par Sékaki et lorsque, le vizir aura baisé le « derrière d’un chien. » On agit de la sorte et Sékaki délia le feu. En un mot, la faveur de Sékaki auprès de Djaghataï devint si grande que le feu de la jalousie et de l’envie s’alluma dans l’esprit du vizir, et qu’il mit tous ses soins à détruire ce modèle des hommes de mérite. Sékaki, en ayant eu connaissance, chercha à le prévenir et dit à Djaghataï khan: « Il m’est connu, d’après les indications des astres, que l’étoile de la puissance et du bonheur d’Habech Amid est arrivée au point le plus bas et à la limite de l’infortune. Je crains que son malheur et son infortune ne gâtent ta félicité et ton bonheur. » Djaghataï, ayant ajouté foi à ce discours, destitua sur l’heure Habech Amid du vizirat. Lorsqu’une année se fut écoulée, depuis la destitution du vizir, comme les affaires du royaume et du trésor paraissaient en mauvais état, Djaghataï dit à Sékaki: La faiblesse et la fâcheuse influence de l’astre qui préside aux destinées des hommes ne durent pas éternellement. Il est possible que l’astre du bonheur d’Habech Amid ait repris des forces. » Sékaki craignit la mauvaise issue de sa perfidie et répondit:
« Cela peut être. » En conséquence, Djaghataï confia pour la seconde fois le vizirat à Habech. Celui-ci ayant conçu de mauvais desseins contre Abou Iakoub, ouvrit la bouche pour le calomnier. Sur ces entrefaites, Sékaki soumit à son pouvoir la planète de Mars, et fit paraître dans la tente de Djaghataï une armée de feu, dont les bagages et les armes étaient également de feu. Djaghataï ayant été rempli de crainte à la vue de ce spectacle, Habech trouva le moyen de calomnier Sékaki et dit : « Puisque Sékaki a le pouvoir d’opérer de pareils actes, il peut se faire qu’il ambitionne le rang suprême, et qu’il assemble une armée de feu contre l’empereur. » Ce discours ayant fait impression, Djaghataï khan fit emprisonner Sékaki. Celui-ci mourut, après avoir passé trois ans en prison.
Il est rapporté dans les Prolégomènes du Zafer Nameh, que, après la mort de Djaghataï khan, Karatchar-noïan, qui était l’administrateur du royaume, choisit pour souverain Kara Houlagou, fils de Mitoukan, fils de Djaghataï khan. A l’époque où Koïouk khan monta sur le siège impérial, il destitua Kara Houlagou et établi pour vice-roi dans l’olous Yiçoumonga, fils de Djaghataï. Car, disait-il :
Vers. Tant que le fils existe, comment le petit-fils oserait-il placer le diadème sur sa tête afin de s’asseoir sur le trône ?
La durée du bonheur d’Yiçoumonga ayant pris fin, au bout, de peu de temps, il quitta ce monde, plein d’afflictions et Caratchar-noïan fit asseoir de nouveau Kara Houlagou sur le trône suprême :
Vers. L’eau de son bonheur revint dans le fleuve de la prospérité ; il monta une seconde fois, la tête haute, sur le trône royal.
Sous le règne de Kara Houlagou, dans l’année 652 (1254) correspondant à l’année du lièvre, l’émir Caratchar mourut, laissant pour perpétuer sa mémoire, une épouse, quarante-neuf concubines et dix fils. Il avait vécu soixante et dix-neuf ans. Quelque temps après la mort de Caratchar, Kara Houlagou mourût aussi, et sa Khatoun Arghanah se chargea d’administrer la tribu et l’olous.
D’après le récit des prolégomènes du Zafer Nameh était fille d’Arik Bouka, fils de Touli khan. Selon l’auteur des Quatre olous,[12] elle avait pour père Nour-Iltchi Gourkan. De l’accord des chroniqueurs, Arghanah Khatoun avait de Kara Houlagou un fils en bas âge, nommé Mobarek Chah. Après la mort de son mari, elle plaça sur sa tête la couronne royale, s’appliqua à respecter les droits des musulmans et traita avec faveur la tribu et l’olous. Enfin, elle s’occupa, ainsi qu’il était convenable, à remplir les obligations du rang suprême, jusqu’à ce qu’Alghou s’emparât du pouvoir sur l’olous de Djaghataï khan et épousât Arghanah Khatoun.
Alghou était fils de Baidar fils de Djaghataï khan. Son nom était primitivement Talikou. Mais à cause de la grande fréquence de l’emploi de ce mot, il fut changé en Alghou. Ce prince était célèbre pour sa bravoure et son courage. Dans sa première jeunesse, s’étant trouvé continuellement en la compagnie de Mangou-caân, il lui témoignait son amitié et son dévouement. En conséquence, il fut distingué de tous les autres princes de l’olous de Gengis khan (lisez: de Djaghataï), par la grande bienveillance et la faveur du caân. Lorsque Mangou-caàn fut mort, Arik Bouka[13] choisit Alghou pour compagnon. A l’époque où l’inimitié et la dispute parvinrent entre Coubila-caàn et Arik, celui-ci craignit qu’Houlagou khan n’entrât dans le Mavérannahr et Turkestan, par amitié pour Coubila-caân, et qu’il ne lui déclarât la guerre. En conséquence, il tint conseil avec les émirs. L’avis général fut qu’Arik envoyât un des princes de sang régner dans cette contrée, afin qu’il fût comme une digue entre eux et leurs ennemis. Conformément à cette décision, Arik Bouka confia l’olous de Djaghataï à Alghou dans l’année 658 (1260). Ce prince partit pour sa destination, avec le cortège le plus magnifique. Lorsqu’il fut arrivé près de Bich Baligh, Arghanah Khatoun lui abandonna bon gré mal gré l’exercice de l’autorité. Alghou ayant conquis tout le pays compris depuis Almalik jusqu’au bord du fleuve Djeïhoun, rassembla en peu de temps cent cinquante mille cavaliers redoutables. Vers la même époque, la disette se manifesta dans le camp d’Arik Bouka.[14] Ce prince envoya des ambassadeurs à Alghou et lui demanda du blé. Quoique Alghou eût l’intention de se révolter, cependant, afin que les populations ne l’accusassent pas d’ingratitude, il désigna d’abord des percepteurs qui se rendirent dans les provinces en compagnie des envoyés d’Arik, y rassembla des richesses innombrables et les apportèrent à son camp. Après qu’on eut réuni des sommes, et des provisions considérables, Alghou khan chercha un prétexte, afin de s’en rendre maître. Sur ces entrefaites, il apprit qu’un des ambassadeurs avait dit:
« Nous avons pris ces richesses aux sujets par l’ordre d’Arik Bouka. Qu’est-ce qu’Alghou a de commun avec cela? Alghou, ayant pris prétexte de cette parole, osa emprisonner et enchaîner les ambassadeurs et distribuer les richesses aux soldats. Puis, il envoya un courrier à Coubila-caân, et en obtint un diplôme (iarliqh) et une plaque (païzè).[15] Lorsque
Arik fut informé de ce qui s’était, passé, il partit de Karakoroum pour le Turkestan, avec l’intention de combattre Alghou.[16] Celui-ci, de son côté, d’accord avec Idjel, fils de Caratchar-noïan, qui était son émir des émirs, marcha à la rencontre d’Arik et défit son avant-garde. Mais Arik, étant ensuite arrivé au campement d’Alghou le vainquit. Alghou s’enfuit à Kachgar; et, lorsque Arik fut retourné dans le Khitaï, il revint dans sa capitale et épousa Arghanah Khatoun. Avec l’approbation de cette princesse, il confia le vizirat à Massoud Beig, fils de Mahmoud Ietvadj. Sur ces entrefaites Kaïdou khan,[17] encouragé par les secours de Bérekeh khan,[18] leva l’étendard de la révolte contre Alghou. Deux combats s’engagèrent entre les deux partis; dans le premier, Alghou fut vaincu; mais; à seconde fois, il obtint la victoire, un an après cet événement, dans l’année 662 (1263-1264), il mourut de mort naturelle, après avoir régné quatre ans.
Lorsque Alghou khan fut parti pour l’autre monde Mobarek chah devint roi de l’olous de Djaghataï, en l’année 662, concordant avec l’année du bœuf, grâce aux efforts de sa mère Arghanah Khatoun et aux heureux effets des soins de l’émir Idjel. Mobarek chah était un monarque bon musulman, doux, et de caractère peu tyrannique. Il empêchait constamment les Mongols de commettre des injustices et des actes d’oppression. En conséquence quelques-uns d’entre eux cherchèrent un prétexte pour faire périr ce prince équitable, et pour mettre leurs soins à reconnaître un autre souverain. Sur ces entrefaites, Borak Oghlan, fils de Yiçoun Toua, fils de Mitoukan, fils de Djaghataï khan, fut regardé avec faveur par Koubilaï-kaân et, en ayant obtenu le diplôme de sultan de l’olous de Djaghataï, il s’empressa de se rendre à la capitale de son aïeul. Mais, cause de la crainte que lui inspirait Mobarek chah, il ne trouva pas la possibilité de rendre public cet ordre de Koubilaï. Il usa pendant quelques jours d’humilité et de dissimulation et gagna secrètement à ses projets les émirs de Mobarek chah. Dans un moment où ce prince était au bain, il se révolta avec deux mille cavaliers, le fit tout coup prisonnier et s’empara de la totalité de ses trésors, de ses chevaux, de ses chameaux, de ses troupeaux de ses brebis et de ses cuirasses; mais il respecta sa vie.
De l’accord unanime des chroniqueurs, Borak khan était un prince connu par sa tyrannie et son injustice, et très désireux de s’emparer des richesses de ses sujets. Il était célèbre par sa bravoure et son audace, et cité pour son courage et son orgueil. Au commencement de l’année 663 (fin de 1264), correspondant à l’année de la panthère, il éleva au rang d’émir des émirs Djélaïr-baï, qui se distinguait entre tous les émirs de l’olous de Djaghataï par son extrême bravoure, et confia le vizirat à Massoud beig Ielvad. Au commencement de son règne, des hostilités et une guerre eurent lieu, à deux reprises différentes, entre lui et le prince Kaïdou; mais, enfin la paix fut connue, grâce aux efforts de Kiptchak Oghoul,[19] fils de Kazan, fils d’Ogodaï. Borak khan, ayant en suite rassemblé une armée nombreuse, fit de la conquête du Khorassan et même de celle de l’Irak et de l’Azerbaïdjan, l’objet de toutes ses pensées. Il traversa le fleuve, Aniou engagea la bataille, avec Abaka khan, qui avait succédé à Houlagou et se retira après avoir essuyé une défaite. Lorsqu’il fut de retour à Boukhara, il se fit musulman et reçut le surnom de sultan Ghaïats eddin. Quelques jours après, ayant été attaqué d’une hémiplégie, il se rendit près de Kaïdou khan à la fin de l’année 668 (juillet - août 1270), correspondant à l’an du mouton. Il but un breuvage empoisonné et prit le chemin de l’autre monde. Son règne avait duré six ans.
Il est rapporté dans le Rauzet essefa que, lorsque Borak se fut assis dans l’olous de Djaghataï sur le siège de la souveraineté, il se détourna de la route de la justice et de l’équité et n’empêcha pas les soldats de commettre des injustices et des violences. Les infidèles Mongols, ayant suivi dans le Mavérannahr et le Turkestan leurs coutumes blâmables, les malheureux habitants furent accablés de peines et d’afflictions et devinrent la proie de toutes sortes de calamités. Borak, au commencement de son règne, rassembla une armée et forma le projet de faire une expédition du côté de Khoten. Ayant chassé de cet endroit le préposé de Koubilaï kaân, il se mit à faire des captifs et à piller. Dans ce pays, un Mongol qui avait pénétré dans une habitation y aperçut le nid d’une hirondelle, et, sans aucune raison, il lança une flèche. Des perles magnifiques dégringolèrent de ce lieu-là et tombèrent dans un puits situé précisément sous ce nid. Le Mongol, étant descendu dans le puits, y trouva cent cinquante balich[20] d’or. Plusieurs soldats de Borak entrèrent une certaine nuit dans un jardin, et attachèrent leurs chevaux à un arbre dont l’intérieur était creux. Tout à coup les chevaux ayant eu peur de quelque objet, cet arbre pourri se rompit et laissa voir au milieu de son tronc six mille balich d’argent. L’armée de Borak s’étant procurée, par ce moyen, toutes les provisions dont elle avait besoin, regarda cet événement comme une marque du bonheur de ce prince.
Lorsque Borak fut revenu de Khoten dans sa capitale, il s’adonna plus encore qu’auparavant à l’injustice et la tyrannie. Ces nouvelles étant parvenues à la connaissance de Kaïdou khan, il crut qu’il était de son devoir et digne de sa grandeur d’âme de réprimander la mauvaise conduite de Borak. En conséquence, il marcha contre lui avec une armée nombreuse. De son côté, Borak se disposa à la guerre par de grands préparatifs. Sur le bord du fleuve Sihoun, le feu du combat s’alluma entre les héros des deux empires, et, sous les coups nombreux des épées et des dards, un fleuve de sang aussi considérable que le Djeïhoun coula sur le champ de bataille. Beaucoup de monde périt de chaque côté. A la fin, Borak remporta la victoire, et reprit le chemin de sa capitale avec un butin incalculable. Dans la suite, un second combat eut lieu, sur le bord du fleuve de Khôdjend, entre ces deux puissants princes. Cette fois, Kaïdou khan obtint la vue de la nouvelle épouse de la victoire (c’est-à-dire qu’il fut vainqueur) et Borak, ayant été mis en déroute, n’arrêta pas son coursier, jusqu’à ce qu’il fut arrivé à Samarcande. Il forma le projet de mettre au pillage tout le Mavérannahr, et, après avoir équipé une nouvelle armée, d’arborer une seconde fois l’étendard de la guerre. Mais, avant qu’il eût mis cette pensée à exécution, Kiptchak Oghoul, qui était un des petits-fils d’Ogodaï-kaân, vint le trouver, en qualité d’ambassadeur, de la part de Kaïdou khan, et apaisa sa colère par des conseils utiles et des exhortations agréables, de sorte qu’il renonça à piller le Mavérannahr et à combattre Kaïdou. Un traité de paix et d’amitié fut conclu entre les deux partis, à condition que Kaïdou khan fournirait à Borak des munitions et des troupes et que celui-ci, ayant franchi le fleuve Amouieh, s’occuperait de conquérir l’Irak et le Khorassan.
A la suite de ce traité, les affaires de Borak se trouvant en bon ordre, ce prince envoya, dans le courant de l’année 666 (1267-68) qui concordait avec l’année du serpent, Massoud beg Ielvadj avec le titre d’ambassadeur près d’Abaka khan, fils d’Houlagou khan. Le but avoué de l’ambassade de Massoud beg était de protester de l’amitié de son maître pour Abaka; mais ses instructions secrètes lui recommandaient de s’enquérir de l’état de l’armée de l’Irak et de l’Azerbaïdjan et de recueillir des renseignements touchant les chemins de ces provinces. Massoud beg, avec une résolution aussi ferme que sa foi et un cœur aussi puissant que l’astre des hommes nés sous une heureuse étoile, traversa le fleuve Amouieh, il franchit les stations de poste avec la plus grande promptitude, et, pour satisfaire aux règles de la prudence, il laissa dans chacune de ces stations deux chevaux aussi rapides que le vent d’est et un serviteur affidé. Lorsqu’il arriva près du but de son voyage, le khodjah Chems eddin Mohammed Djoueini, qui était chef de la trésorerie (sahib divan) d’Abaka khan, vint à sa rencontre avec les émirs et les noïans (chefs de dix mille hommes). Quoique le khodjah fût très arrogant (littéralement: eût pour monture le coursier de l’arrogance), au moment de l’entrevue, il satisfit aux obligations que lui imposait la politesse et mit pied à terre. Massoud beg le pressa contre son sein, sans toutefois descendre de cheval, et lui dit, d’un ton méprisant: « Est-ce que tu es le sahib divan? » Le khodjah Chems eddin Mohammed, qui regardait chacun de ses agents comme l’égal d’Assaf, fils de Barakhia,[21] fut très mécontent de cette manière d’agir. Mais, comme l’endroit où il se trouvait ne comportait pas d’explications, il garda le silence. Lorsque Massoud beig fut entré dans la salle d’audience d’Abaka khan, il obtint de ce prince un accueil favorable et s’assit au dessus de tous les émirs. Il s’acquitta ensuite de son message en employant des termes élégants et des allusions agréables, et reçut du monarque de nouvelles grâces et de nouveaux bienfaits. Mais, comme sa conduite avait pour fondements la ruse et la tromperie, il ne tarda pas à voir qu’il était en butte aux soupçons; et, en conséquence, il s’empressa de demander son congé. Abaka khan lui ayant accordé la permission de partir, il monta sans retard sur un coursier aussi prompt que l’éclair, et, comme les cieux, il ne s’arrêta pas un seul instant dans sa marche. Le lendemain de son départ, on reçut du Khorassan l’avis que Borak se préparait à la guerre et que l’ambassade de Massoud beig n’avait eu d’autre but que l’espionnage. En conséquence, Abaka khan envoya un courrier aussi prompt que la lune, pour faire revenir Massoud beig. Mais comment quelqu’un aurait-il pu atteindre Massoud beig? car c’était un homme prudent et expérimenté; il avait disposé dans chaque station des chevaux frais et n’avait pas perdu de temps. Il galopa avec une telle promptitude que le courrier (bérid) du ciel resta stupéfait de la vitesse de ce voyage. D’après l’opinion de l’auteur du Tarikhi vassaf,[22] il arriva en quatre jours au bord du Djeïhoun, et, ayant franchi ce fleuve comme le nuage et comme le vent, il rejoignit la cour de Borak et lui raconta tout ce qu’il avait vu.
Borak prit la résolution de conquérir le Khorassan et l’Irak, et, afin de se procurer les objets nécessaires à son armée et de satisfaire aux dépenses de l’expédition, il conçut le projet de piller Boukhara et Samarcande. Mais Massoud-beig lui fit les représentations suivantes: « Dévaster, un pays qui est entre les mains du roi, dans l’espoir de conquérir un royaume imaginaire, me paraît contraire à ce qu’exigent la sagesse et, la prudence. Au moins, fau t-il observer de telles mesures que, si, ce qu’à Dieu ne plaise! un malheur nous arrive, les sujets de votre empire soient capables de vous procurer des vivres et des contributions. » En entendant ces paroles, Borak se mit en colère et ordonna d’appliquer sept coups de bâton à Massoud beig, mais il s’abstint de mettre à exécution ses projets de pillage.
Kaïdou khan, ayant désigné Kiptchak, fils de Karak (Kadan) ainsi qu’un des fils de Goïouk khan et plusieurs milliers de soldats, pour aller au secours de Borak, dit secrètement aux princes « Il faut que vous reveniez avant qu’Abaka et Borak en viennent aux mains. » Lorsque ces renforts furent arrivés dans le Mavérannahr, Borak franchit le fleuve d’Amouieh (Oxus) à la tête de cent mille cavaliers bien équipés, dans l’année 667 (1268-69), correspondant à l’année du chien. Le trouble et le désordre s’élevèrent dans tout le Khorassan. Mélik Chems eddin Mohammed Curt, qui était alors gouverneur d’Hérat, s’étant soumis à Borak, le prince Tebchin Oghoul[23] et Arghoun Aka, qui séjournaient à Nichahour, furent hors d’état de résister à l’armée du Mavérannahr; et, après avoir essuyé une défaite, ils se retirèrent dans l’Irak. Borak s’empara de la majeure partie du Khorassan. Après qu’Abaka khan eut entendu ces nouvelles, il partit de l’Irak et de l’Azerbaïdjan avec une armée innombrable, afin de combattre les ennemis. Lorsqu’il arriva dans le district de Reï, Tebchin-Oghoul et Arghoun Aka se joignirent à son auguste cortège, et lui firent connaître le véritable état des choses et le grand nombre des soldats de Borak. Abaka et ces deux généraux se dirigèrent d’un commun accord vers la riante province[24] d’Hérat. La nouvelle de la marche d’Abaka ayant été apportée à plusieurs reprises dans le camp de Borak, les princes qui, par l’ordre de Kaïdou khan, étaient venus au secours de l’armée de Borak; saisirent une occasion favorable et tournèrent bride du côté du Mavérannahr.[25] Cette défection découragea l’armée du Djaghataï. Borak envoya trois espions dans le camp d’Abaka, leur enjoignant de s’assurer si le khan avait marché en personne pour le combattre, ou s’il avait chargé de ce soin un des princes du sang avec des émirs et une armée. Les éclaireurs de l’armée d’Azerbaïdjan, ayant fait prisonniers, les espions, les conduisirent à Abaka khan. Après un interrogatoire, un des espions confessa sincèrement le motif de sa venue. Alors Abaka khan fit répandre le bruit que l’Azerbaïdjan était sens dessus dessous, à cause d une incursion de l’armée du Decht (Kiptchak); et il dit en public « L’avantage de notre empire se trouve dans notre retour. » Puis, ayant levé le camp il dit à haute voix, au moment de monter à cheval: « Mettez à mort les espions; mais il ajouta voix basse « Faites évader celui qui a confessé sincèrement le motif de sa venue et tuez les autres. » On exécuta ses ordres ainsi qu’il les avait donné. L’espion que l’on avait épargné retourna près de Borak khan, avec la promptitude de l’éclair et du vent, et rapporta ce qu’il avait vu et entendu. Maintenant ajouta-t-il, la plaine d’Hézar Djérib est ornée de terres, de pavillons, de tapis et d’étoffes, et il n’est resté dans ce pays-ci aucun soldat de l’armée de l’Azerbaïdjan.» Borak ayant été joyeux de cette nouvelle, Mergaoul et Djelairbai, qui étaient les principaux émirs du Mavérannahr entrèrent dans sa salle d’audience, en se carrant et en riant, et le complimentèrent.
Vers. Le superbe et belliqueux Mergaoul s’avança, la bouche remplie de vains discours. Que ton bonheur, dit-il, ô roi, soit durable; que le ciel soit ton esclave, ainsi que nous! N’ai-je pas dit que personne ne serait ton adversaire, que personne n’aurait l’audace de te combattre? Tu viens d’entendre que sans supporter les travaux de la guerre et de la lutte, le monde a pris la fuite
En un mot, sur le seul bruit de cette fausse nouvelle, Borak et ses émirs, avant l’apparition de la véritable aurore,[26] montèrent à cheval, afin de poursuivre Abaka khan, et ne s’arrêtèrent pas avant d’avoir atteint la plaine d’Hézar Djérib. Ayant trouvé ce canton rempli de tentes, de pavillons, ils passèrent la nuit au comble du plaisir et de l’allégresse.
Au matin lorsque le soleil, ce roi de l’Orient, poussa ses chevaux dans le manège du ciel et se mit à la poursuite de l’armée des étoiles, Borak, tel qu’un torrent impétueux, s’ébranla de nouveau, afin de donner la chasse à Abaka khan. Lorsqu’il fut arrivé près de la bourgade de Chékendian, il trouva l’étendue de la plaine du désert aussi brillante que la surface du ciel, à cause de l’éclat des armes des héros de l’Irak et de l’Azerbaïdjan. En conséquence, sa joie se changea en tristesse et son festin de réjouissances fit place au deuil. Borak khan dit, en poussant un soupir: «Notre opinion était erronée. » Les émirs et les courtisans, et en particulier Mergaoul et Djelaïrbai, ayant entrepris de le consoler, employèrent la nuit à se préparer au combat.[27] Le lendemain, lorsque la clameur et le cri avant-coureur de l’attaque[28] s’élevèrent l’orient et à l’occident, et que le soleil orna le ciel de ses rayons aussi brillants que des pointes de lances, les deux monarques belliqueux s’occupèrent de ranger leur armée en bataille. L’oreille du ciel fut assourdie par le bruit des grosses timbales et des tambours, et la terre trembla, à cause du son des trompettes et des clairons. Les dards commencèrent à tomber aussi pressés que les gouttes de pluie au printemps, et le sang coula avec une telle abondance, que le champ de bataille présentait l’aspect du Djeïhoun. Sur ces entrefaites, Borak khan, semblable au tonnerre retentissant, fondit de l’aile droite de son armée sur l’aile gauche de l’ennemi et mit en fuite, à coups de sabre et de poignard, tous ceux qui lui étaient opposés. Peu s’en fallut qu’il ne dispersât entièrement l’armée d’Abaka khan et que ce monarque lui-même ne prit la fuite, à cause de la supériorité de l’armée du Djaghataï. Mais Souhatai Béhadur, ayant mis tous es soins à éloigner ce terrible événement descendit aussitôt de cheval, s’assit sur un coffre, et, haranguant les soldats de l’Irak, les excita à combattre avec courage. Abaka khan en personne poussa son cheval en avant, avec une troupe de braves guerriers, et chargea l’ennemi. Du côté de l’armée de Borak, Mergaoul, ayant voulu s’opposer à Abaka, fut tué dans ce moment, les efforts des héros des deux années et l’effusion du sang devinrent tels, que, depuis que le vindicatif Behram (Mars) est connu pour son habileté a manier le glaive, on n’a pas vu une pareille bataille, et, depuis que le ciel malveillant tout au-dessus du monde et des mortels, on n’a pas entendu parler d’un semblable combat. Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, après avoir donné à l’horizon la couleur de l’anémone, en se teignant des reflets du sang des braves. Borak khan aperçut chez ses soldats des signes de faiblesse et de découragement; et, en conséquence il battit en retraite vers le Mavérannahr.
Après qu’il fut arrivé à Boukhara, le flambeau de la religion unitaire ayant éclairé son cœur, il se fit musulman et reçut le surnom de sultan Ghaïs eddin. Vers la même époque, il fut attaqué d’une hémiplégie et perdit toute sa tranquillité d’esprit. Massoud beig (ben) Ielvadj, s’étant séparé de lui, s’enfuit à l’ordou (résidence) de Kaïdou khan. Borak, de son côté se rendit auprès du prince Kaïdou, dans l’espoir d’en être traité avec compassion. Il passa tranquillement deux ou trois jours; mais enfin, dans l’année 669 (1270-71), il fut empoisonné par le perfide Kaïdou.[29]
Quatrain. La réflexion est étrangère aux révolutions de ce monde; la mort est une coupe qu’il fait goûter à chacun successivement. Lorsque notre tour arrive, nous ne pouvons lutter contre l’échanson de ce festin, car il est loin de commettre une injustice.
Ou rapporte que Borak khan laissa quatre fils, dont l’aîné, était appelé Beigtimour. Ce prince, de concert avec ses frères et avec les fils d’Alghou khan, entreprit une guerre contre Kaïdou; ils allumèrent le feu de l’injustice et de l’oppression dans les contrées situées depuis la limite du territoire de Khodjend jusqu’à Boukhara, et anéantirent par le meurtre et le pillage la famille et les biens des gens qui, grâce aux efforts de Massoud beig Ielvadj, s’étaient réunis dans ces pays. Plusieurs combats ayant été livrés entre les enfants de Borak et Kaïdou, les premiers furent mis en fuite dans toutes les rencontres; et, pour ce motif, leurs malheureux sujets se virent en proie aux exactions et aux avanies. Sur ces entrefaites, Ak-Beig le Turcoman, qui était gouverneur du château d’Amouieh, se rendit auprès d’Abaka khan à l’instigation du khodjah Chems eddin Mohammed, fit connaître au khan une partie de ces événements et lui dit: « Quiconque sera gouverneur de Samarcande et de Boukhara donnera accès dans son esprit à des pensées d’orgueil, ainsi qu’a fait Borak, et attaquera le Khorassan. Il convient donc, maintenant que la chose peut être effectuée sans aucune difficulté, qu’un détachement de l’armée victorieuse se rende sans délai dans cet endroit et agisse de telle sorte qu’il n’y reste pas un seul habitant. » Cet avis fut goûté d’Abaka khan, en conséquence, il désigna pour le mettre à exécution, en compagnie d’Ak-beig. Nikpeï Béhadur, avec un touman (corps de dix mille hommes) de son armée. Ces deux généraux, après avoir franchi la distance intermédiaire, arrivèrent aux environs de Boukhara et s’emparèrent de cette ville. Ils y firent un massacre général et mirent le feu au collège de Massoud beig, qui était le mieux construit des collèges de cette ville. De cet édifice et des livres précieux qui s’y trouvaient, il ne resta rien que des cendres. Lorsque le misérable Ak-beig et le malheureux Nikpeï eurent accompli leur œuvre de désordre et de ruine, ils arborèrent l’étendard du retour, chassant devant eux cinquante mille jeunes gens des deux sexes, qu’ils avaient réduits en captivité. Après que Boukhara fut restée abandonnée pendant sept ans, Massoud beig s’occupa derechef, par l’ordre de Kaidou khan, à la repeupler et fit de cette ville, comme par le passé, le rendez-vous des chérifs et des principaux personnages des diverses classes de la société.
Après le départ de Borak khan, les émirs et les chefs de l’olous (nation) de Djaghataï khan élurent pour roi, d’après l’ordre de Kaïdou khan, Nikpeï khan, qui était petit-fils de Djaghataï et qui, selon un récit, avait pour père Chiramoun ou, d’après une autre version, était fils de Sarman.[30] Après que Nikpeï fut mort, dans l’année 671 (1272-73), ils se soumirent à Boukatimour,[31] fils de Kadami, fils de Bouri, fils de Mitoukan. Lorsque Boukatimour fut mort, un fils de Borak khan, qui, d’après une version, s’appelait Doua Sedjan ou, selon un autre récit, Doua Djidjen devint souverain du Mavérannahr et du Turkestan, dans l’année 690 (1291). Son émir des émirs et son généralissime était l’émir Ilenkir, fils d’Idjel khan. D’après une version, il exerça la souveraineté durant trente ans, ou, selon une autre version, pendant seize ans seulement.
De l’accord de tous les historiens, Doua khan était un monarque puissant et d’un rang élevé, et il paraissait distingué de tous ses pareils et ses égaux par son extrême bravoure. Sous son règne, grâce aux sages mesures de l’émir Ilenkir un grand nombre d’hommes se rassemblèrent à l’ombre de ses drapeaux. Doua se prépara à combattre plusieurs princes du sang qui avaient reçu la mission de garder les frontières du royaume de Timour Kaân,[32] et marcha contre eux en toute hâte. Un soir qu’ils étaient tous occupés à boire, ils apprirent que l’ennemi était arrivé, et, sauf Keurkeuz Goûrkan, qui était gendre de Timour kaân, aucun des généraux ne put s’opposer à Doua khan. Keurkeuz, avec six mille cavaliers, s’étant porté promptement à sa rencontre, fut fait prisonnier après un combat. Doua khan le chargea de liens l’emprisonna et s’en retourna avec un butin considérable. Puis il se livra à la joie avec un esprit libre de tout souci, dans les environs de Karakoroum. Lorsque les fuyards eurent rejoint Timour kaân, ce prince, s’étant mis en colère, fit emprisonner quelques-uns des émirs de la frontière et s’occupa de remédier au mauvais état de son armée.
Sur ces entrefaites, Olous Bouka et Dourdoukai, qui avaient abandonné Doua khan, avec douze mille braves guerriers, vinrent trouver Timour kaân et lui dirent: « Nous connaissons le fort et le faible de l’armée du Djaghataï et nous savons jusqu’où va la bravoure de ces gens-là. Si l’ordre du kaân nous y autorise, nous nous préparerons à les combattre et nous châtierons Doua et ses partisans en les mettant mort et en dévastant leur royaume. Timour, ayant comblé d’orgueil ces deux émirs, en leur donnant un bonnet et une ceinture, jugea qu’il suffirait, pour remédier aux succès de Doua, qu’une troupe d’émirs et de soldats partît avec eux, afin de le combattre. Il donna ses ordres en conséquence;
Obus Bouka et Dourdoukaï servirent de guides à cette armée. Dans un moment où Doua khan venait de faire une marche rapide, dans le dessein de tenter une attaque nocturne sur le camp de quelques princes du sang soumis à Timour kaân, ils arrivèrent près de lui à l’improviste; et, ayant tiré du fourreau le glaive de la vengeance, ils tuèrent un grand nombre de soldats djaghatéens. Doua tourna bride, mais son gendre fut fait prisonnier. Lorsqu’il fut de retour dans sa capitale, il envoya près de Timour kaân des ambassadeurs éloquents et lui fit dire : « Si nous avons commis une impolitesse, nous en avons porté la peine. Maintenant, il convient que l’on me renvoie mon gendre, afin que de mon côté, je relâche Keurkeuz. » Timour kaân, ayant traité favorablement le gendre de Doua khan, lui accorda la permission de partir. Mais, avant son arrivée, Doua khan avait mis fin aux jours de Keurkeuz. Il dit aux gens qui étaient venus le redemander de la part du kaân: « J’avais envoyé Keurkeuz Courkan à la résidence du prince Kaïdou, mais il est mort en chemin.» Après cet événement, ainsi que nous l’avons dit dans le récit du règne de Kaïdou, un autre combat eut lieu entre Doua khan et l’armée de Timour kaân,[33] et cette fois la victoire fut à Kaïdou khan et à Doua khan. Lorsque Doua khan fut mort, son fils Koundjuk khan monta sur le trône. Ce prince, ayant conquis quelques provinces que possédaient les fils de Kaidou khan, les réunit à l’empire de Djaghataï.
Lorsque Koundjuk khan fut mort, Talighou khan, fils de Kadami, fils de Boury, devint roi. A sa mort, Içan Bouka khan, fils de Doua khan, arbora l’étendard de la souveraineté, dans l’année 709 (1309-10).
Lorsque Içan Bouka eut arboré dans l’olous de Djaghataï le drapeau de la royauté, il donna accès dans son esprit à l’espoir de conquérir le Khorassan, et chargea de cette expédition son frère Kepek khan et le prince Yaïçaour, fils d’Ourektimour, fils de Boukatimour, fils de Boury. Ces deux princes, ayant franchi le fleuve d’Amouieh avec une nombreuse armée, se livrèrent au meurtre; au pillage et à la dévastation des villes et des campagnes. Lors que l’émir Yaçaoul et Boudjaï, fils de Danichmend Béhadur, qui séjournaient alors dans le Khorassan en qualité de lieutenants du sultan Mohammed Khodabendeh, apprirent cette nouvelle, ils opérèrent leur jonction et se portèrent en toute hâte sur les bords du fleuve Morghab. Un combat acharné ayant eu lieu en cet endroit entre les armées de l’Iran et du Touran, Képek khan et Yaïçaour obtinrent la victoire, et les soldats du Khorassan tournèrent bride vers l’Irak et l’Azerbaïdjan. L’émir Yeçaoul et Boudjaï tinrent ferme pendant une heure, avec mille cavaliers, et montrèrent la plus grande bravoure. Enfin, l’émir Yéçaoul se retira, lui huitième de ce gouffre de mort. Boudjaï continua de combattre bravement, avec quarante cavaliers d’un courage à toute épreuve, jusqu’à ce que ces cavaliers fussent tous tués. Alors, dans l’excès de son trouble, il se jeta dans le Morghab; mais un des héros du Mavérannahr ensanglanta les eaux de ce fleuve en perçant Boudjaï d’une flèche.
Le prince Képek et Yaïçaour poursuivirent jusqu’à la nuit l’armée du Khorassan, prirent les bagages et immolèrent beaucoup de fuyards. Képek khan voulait même ne pas s’arrêter pendant la nuit. Mais le prince Yaïçaour, l’ayant empêché de mettre ce projet exécution, lui dit:
Vers. Puisque tu as obtenu la victoire, ne t’obstine pas à combattre et ne ferme pas à l’ennemi le chemin de la fuite.
En conséquence, Képek khan renonça à poursuivre le reste des fuyards. Le prince Yaïçaour, ayant fourni des montures et des provisions de route à une troupe de prisonniers, les renvoya dans leurs demeures. Lorsque la nouvelle de la victoire des princes et de la fuite des émirs du Khorassan vint à la connaissance d’Oldjaïtou sultan, il partit avec les armées de l’Irak et de l’Azerbaïdjan, afin de repousser les ennemis. Képek et Yaïçaour, ayant été informés de sa marche, tournèrent bride vers le Mavérannahr et le Turkestan et revinrent à la cour d’Içan Bouka, qui leur fit un accueil favorable. Içan Bouka régna heureusement dans ces contrées, jusqu’à ce que le terme de sa vie fût arrivé.
De l’accord des chroniqueurs. Képek khan montrait des signes de justice et de bienfaisance, et faisait briller sa bonté et sa bienveillance.[34] Après la mort d’Içan Bouka, il monta sur le trône de la souveraineté. Parmi les aventures merveilleuses que l’on rapporte de ce khan digne déloges en voici une: il était monté un jour à cheval avec plusieurs de ses plus familiers serviteurs, dans l’intention de se promener, et parcourait les montagnes et les plaines. Tout à coup se présentent à sa vue des os humains qui étaient répandus dans une fosse et à moitié enfouis sous terre. Ayant retenu les rênes de son cheval, il considéra un instant ces os réduits en pourriture. Puis il se tourna vers ses serviteurs et leur dit Savez-vous ce que me disent ces os ? Ses compagnons baissèrent la tête et gardèrent le silence. Képek khan reprit: « Ce sont de malheureux opprimés, qui demandent justice. Il mit alors tous ses soins à découvrir l’histoire de ces morts, fit venir l’émir de mille ou chiliarque (émir hezareh) à qui cette contrée était confiée, et lui demanda d’où provenaient ces ossements. Cet individu eut recours au chef de cent, et celui-ci se saisit des villageois des environs. Après une enquête sévère, il fut prouvé que, trois ans avant cette époque, une caravane était arrivée du Khorassan en ce lieu; que ces gens avaient tué les hommes qui la composaient et avaient ravi leurs richesses, dont une portion existait encore. Lorsque le juste Képek khan eut appris ces détails, il ordonna de recueillir les richesses et d’enchaîner les meurtriers des marchands. Puis, ayant envoyé un député au gouverneur du Khorassan, il lui transmit cet ordre: Envoie-moi toutes les personnes qui restent de la famille de ces morts.» Quand ces personnes furent arrivées à sa cour, Képek khan leur livra les meurtriers et l’argent.
Vers. Vois combien est grande son équité puisqu’il rendu justice aux os mêmes des morts.
Dans l’année 721 (1321) Képek khan étant mort de mort naturelle, ses frères Iltchi Kédaï khan et Doa Timour khan se chargèrent successivement de l’autorité.[35] Lorsqu’ils furent morts, la souveraineté de l’empire de Djaghataï khan parvint à leur autre frère Thermachîrîn.[36]
Ce dernier était un roi juste, puissant, et un souverain heureux et compatissant. Il illumina le visage de la puissance royale avec le fard (gulgouneh) de la félicité musulmane (c’est-à-dire il se convertit à l’islamisme), et, grâce à l’assistance divine, il acquit dans ce monde périssable les instruments d’une souveraineté éternelle. La plus grande partie de l’olous de Djaghataï khan se convertit sous son règne à l’islamisme, et fit des efforts pour disposer les fondements de la loi auguste et corroborer les bases de la religion brillante.
Masnavi. Lorsqu’il eut allumé le flambeau de son cœur au feu de la religion, il brûla dans cette contrée les racines de l’erreur. Toute la nation conçut de l’inclination pour la religion musulmane; et, pour cela, il convient que je bénisse son nom.
Pendant son règne. Thermachîrîn conduisit une armée dans l’Hindoustan; et, avant fait des courses dans les environs de Dehli et de Guzarate, il revint dans le Turkestan, sain et sauf et chargé de butin. Dans l’année 728 de l’hégire (1327-28), qui correspond à l’année mongole du dragon, son neveu Bouzân,[37] fils de Doua Timour, qui ne professait pas l’islamisme,[38] conduisit une armée, du pays de Djéteh,[39] dans le Mavérannahr; et, ayant livré bataille à son oncle, dans l’endroit appelé Cozi Mendak Il lui fit obtenir la gloire du martyre. Quoique Bouzan ne pût affermir son pouvoir sur l’olous de Djaghataï, il n’en fit pas moins périr injustement un grand nombre de princes, d’émirs et de notables. On lit, dans le Matlaa Saadéïn, que Thermachîrîn khan tomba malade à Nakhcheb, dans l’année 727 (1326-7) et que sa maladie ayant augmenté, il mourut. Après le retour de Bouzân du côté de Djéteh, Djenkchi, fils d’Aboukan,[40] fils de Doua khan, se chargea du gouvernement. Lorsqu’il eut régné quelques jours, son frère Yaïçou Timour s’étant révolté contre lui, le fit périr. Yaïçou Timour était un monarque dont la conduite ressemblait à celle d’un fou. C’est ainsi qu’il fit couper les deux seins de sa mère, sous prétexte qu’elle avait informé Djenkchi de ses projets de révolte. A cause de cela, les nobles et les grands prirent en haine le pouvoir de Yaïçou Timour. Sur ces entrefaites, Ali Sultan, qui descendait d’Ogodaï khan, se révolta, s’empara de l’autorité dans l’olous de Djaghataï, et anéantit le pacte (ahdnameh) de Kabel-khan et de Katchouly Béhadur,[41] qui était orné de l’âltamgha de Noumieh khan, (lisez Toumeneh), et Mir lequel Djinguiz khan et Karatchar-noïan avaient apposé leur signature. Après qu’Ali Sultan eut exercé la souveraineté durant quelque temps, il mourut comme ses prédécesseurs.
Mohammed khan, fils de Poulad, fils de Goundjuk, étant monté sur le trône, après la mort d’Ali Sultan, s’occupa de faire cesser les injustices; et, par son équité, il rendit de nouveau florissant l’empire de Djaghataï.
Vers. C’était un monarque puissant et grâce à la justice de qui l’eau du bonheur revint à la rivière. Il répara les anciens dommages; son règne fut l’aurore qui succède à une longue nuit.
Kazan Sultan était fils de Yaïçaour. Dans l’année 733 (1332-33), qui concordait avec l’année de la brebis, il monta sur le trône, et, ayant arboré l’étendard de l’injustice et de l’oppression, il fit périr un grand nombre d’émirs et de noïans (chefs de tribu). Il exécuta quiconque avait commis la moindre faute. Sa sévérité était telle, que les grands et les notables, en partant chaque matin pour lui faire leur cour, revêtaient un suaire sous leurs habits, à cause de la crainte qu’il leur inspirait, et faisaient leurs adieux à leurs femmes et à leurs enfants. Il inspirait une telle frayeur, chaque soir, lorsque ses courtisans et ses gardes[42] s’étaient acquittés des hommages qu’ils lui devaient et qu’ils revenaient sains et saufs près de leurs enfants, ils rendaient grâces à Dieu et distribuaient des présents et des aumônes à ceux qui y avaient droit. Enfin, le reste des nobles de l’olous de Djaghataï convinrent de se révolter contre Kazan Sultan, avec l’émir Kazaghan, qui était au nombre des principaux émirs Berlas.
L’émir Kazaghan, ayant choisi Sali Séraï pour sa place d’armes, rassembla une armée redoutable. Lorsque Kazan Sultan fut informé de cet événement, il marcha contre les ennemis avec une nombreuse armée. Dans l’année 746 1345-1346), les deux partis en vinrent aux mains, dans, la plaine de Karbeh (Karieh, village) Déréhi Zengui. Pendant la bataille, une flèche ayant atteint l’œil de l’émir Kazaghan, Kazan Sultan obtint la victoire. Il passa l’hiver suivant à Karchi; à cause de la violence du froid et de l’abondance des pluies, la plupart des chevaux de son armée périrent. Lorsque l’émir Kazaghan eut connaissance de la faiblesse de l’ennemi, il arbora une seconde fois l’étendard de la bravoure, et marcha en toute hâte vers ses cantonnements. Un second combat s’engagea entre les deux armées et Kazan Sultan fut tué. L’émir Kazaghan empêcha l’armée de piller et étendit sa compassion et sa bienfaisance sur la famille de Kazan Sultan. On lit, dans les Prolégomènes du Zafer Nameh, que, depuis l’époque où Djaghataï khan monta sur le trône dans le Mavérannahr et le Turkestan, jusqu’à la mort de Kazan Sultan, il s’était écoulé cent vingt-trois ans.
L’émir Kazaghan choisit, en qualité de khan de l’olous de Djaghataï, Danichmendjeh, qui descendait d’Ogodaï-kaân. Lorsque ce prince eut régné deux ans, l’émir Kazaghan le mit à mort; et Bian Couli khan devint roi du Djaghataï. Bian Couli était fils de Sourghadou Oghoul, fils de Doua khan. Sous son règne, le Kazaghan montra de la justice et de la générosité, et gagna par ses bienfaits le cœur de toutes les classes de la population. Dans l’année 760 (1359 de J.C.), un nommé Kotlok Timour, qui avait épousé la sœur de l’émir Kazaghan arbora l’étendard de la révolte contre cet émir, et le tua dans une partie de chasse; après quoi, il s’enfuit du côté de Kondouz. Un des favoris de l’émir assassiné se mit, avec ses serviteurs, à la poursuite du meurtrier, et, l’ayant atteint dans la ville de Kondouz, le mit en pièces à coups de sabre. Puis il s’en retourna heureusement, après avoir prouvé sa fidélité envers son maître. Le fils de l’émir Kazaghan, le mirza Abd-allah, ayant succédé à son père, fit de Samarcande la capitale du royaume. Mais, comme il convoitait la princesse femme de Bian Couli, il assassina ce prince.
Timour Chah khan monta sur le trône, après le meurtre de Bian-Couli, par la volonté de Mirza Abd allah. Il était fils d’Yçoun Timour, fils d’Aboucan, fils de Doua khan. Pendant que le mirza Abdallah exerçait l’autorité, l’émir Bian Seldouz, ayant embrassé le parti de la rébellion, d’accord avec l’émir Hadji Berlas, un des descendants d’Yiçou Monga, fils de Karadjar-noïan, rassembla une armée et marcha vers Samarcande. Timour chah et le mirza Abdallah allèrent à sa rencontre. Un combat acharné s’étant engagé, Timour chah et Abdallah furent tués. L’émir Bian conquit tout le Mavérannahr et se déclara souverain. Comme c’était un homme doux de caractère et peu cruel, et qu’il se livrait avec excès à la boisson et à la société des femmes, le désordre se glissa dans le gouvernement des provinces du Touran. L’ambition et le désir du pouvoir s’introduisirent dans tous les cœurs et dans tous les esprits. L’émir hadji Berlas arbora l’étendard de l’indépendance dans la ville de Kech; il fut imité à Khodjend par l’émir Baïezid; à Balkh, par Ouldjaï Boukaï Seldouz; à Chébourghan, par Mohammed Khodjah Aperdi. D’un autre côté, l’émir Hossein, fils de l’émir Molla, fils de l’émir Kazaghan, et l’émir Khidr Yaïçaouri, ayant réuni une armée, faisaient continuellement des incursions dans ces contrées et se berçaient de l’espoir de s’emparer du commandement.
Après le meurtre de l’émir Kazaghan, Touglouk Timour, fils d’Imel Khodjah,[43] fils de Doua khan, monta sur le trône dans l’olous de Djéteh. Lorsqu’il reçut la nouvelle des troubles du Mavérannahr, il dirigea toutes ses pensées vers la conquête de ce pays. Dans l’année 761 (1360), il marcha sur Samarcande, réduisit sous le joug de l’obéissance la plupart des émirs rebelles et s’en retourna, après avoir placé dans chaque ville un gouverneur et un darogah (prévôt). Après son départ, le feu de la haine et de la dispute s’étant allumé entre les princes du pays, les malheureux sujets furent les victimes de la discorde. Pour ce motif, Toglouk Timour khan, dans l’année 763 (1361-62), conduisit une seconde fois son armée dans ce pays; et, après avoir tué l’émir Bian Seldouz et Baïezid Djélaïr, il laissa son fils Élias Khodjah khan pour gouverner le Mavérannahr et il arbora l’étendard du retour.
Après le départ de son père, il s’adonna, dans Samarcande à remplir les obligations de la royauté. Dans l’année 765 (1363-64), l’émir Hossein, fils de l’émir Mollah et l’émir Timour Gourkan se révoltèrent contre lui. Un combat s’engagea entre les deux partis. Élias Khodjah khan s'enfuit dans le Djéteh, où Kamar eddin Doughlat mit fin à ses jours.
Après la fuite d’Elias Khodjah, il monta sur le trône, avec l’approbation de l’émir Hossein. Après qu’il eut régné en repos durant quelque temps, il aspira à un pouvoir indépendant. L’émir Hossein s’aperçut de son dessein; et, s’étant saisi de sa personne, il le noya dans le fleuve Haska et choisit en qualité de khan, Kaboul Sultan, fils de Dourdji, fils d’Iltchikédaï. Après sa victoire sur l’émir Hossein, l’émir Timour Gourkan fit périr Kaboul Sultan.
A l’époque où Timour arbora l’étendard de l’inimitié contre l’émir Hossein, il éleva au trône de l’olous de Djaghataï Siourghatmich khan, quoique ce prince fût de la race d’Ogodaï. Après la mort de Siourghatmich, Timour lui donna pour successeur son fils Sultan Mahmoud et prescrivit que, selon la coutume, on consignât le nom de ce prince en tête des diplômes. Sultan Mahmoud khan mourut dans l’année 806 (1403-4), dans une localité de l’Asie Mineure, ainsi qu’il sera raconté dans le récit du règne de l’émir Timour Gourkan.
Khidr Khodjah khan monta sur le trône dans le Moghoulistân, sous le règne de l’émir Timour Gourkân. Après que ces deux princes eurent été pendant quelque temps ennemis l’un de l’autre, un traité de paix fut conclu entre eux, et Timour épousa la fille du khan qui s’appelait Tekel Khanum. Après la mort de Khidr Khodjah, son fils Mohammed khan arbora l’étendard de la souveraineté. Lorsqu’il fut mort, Veïs khan,[44] fils de Chir Ah Oghlan, fils de Mohammed khan, devint son successeur. Il mourut, après avoir satisfait pendant quelque temps aux obligations de la royauté, et laissa deux fils, savoir : Içan Bouka et Iounis khan.
Après la mort de Veïs khan, les émirs du Moghoulistân se divisèrent en deux partis; le plus nombreux se soumit à Içan Bouka khan; un petit nombre d’autres émirs, ayant préféré obéir à Iounis khan, conduisirent ce prince auprès de Mirza Oloug-beig Gourkan, dans l’espoir d’obtenir pour leur prétendant des secours et des renforts,[45] car sa soeur était mariée au fils cadet de Mirza Oloug-beig, Abd el Aziz. Malgré cette alliance, le mirza Oloug-beig ne témoigna pas d’intérêt à Iounis khan; et, après avoir dispersé les émirs et les soldats de ce prince, il le congédia et le fit partir pour l’Irak et l’Azerbaïdjan. Iounis khan, étant arrivé à Tabriz, à l’époque où le mirza Djihan chah le Turcoman était gouverneur de cette ville, y séjourna plus d’un an. Après quoi il se rendit à Chiraz et fit une cour assidue à Mirza Ibrahim Sultan. Au bout de cinq ou six mois, Mirza Ibrahim Sultan étant venu à mourir, Iounis khan reconnut l’autorité de son fils et successeur Mirza Abdallah. En un mot, Iounis khan demeura près le dix-huit ans dans les pays étrangers. Lorsque Mirza Sultan Abou Saïd Gourkan[46] fut affermi sur le trône de Samarcande, sur l’invitation de ce monarque fortuné, il poussa son cheval vers sa première demeure. Le motif pour lequel le sultan Abou Saïd manda Iounis khan était que, à l’époque où la guerre s’alluma, sur le bord du fleuve Amouieh, entre Mirza Oloug-beig et son fils Abd el-Latif Mirza, Içan Bouka khan, ayant regardé l’occasion comme une proie facile à saisir, ravagea le pays de Ferghanan, jusqu’à Kendbadam, et fit prisonniers tous les habitants d’Andédjân. Le sultan Abou Saïd, après avoir conquis Samarcande, conduisit une armée dans le Moghoulistan, afin de punir cette injustice; et, ayant défait et mis en fuite Içan Bouka, il fit partir un courrier, afin de mander Iounis khan. Lorsque ce prince fut arrivé à Samarcande, Abou Saïd prépara pour lui un festin royal, lui confia le rang de khan du Moghoulistan et décréta que les émirs du Touman de Saghirdji, qui avaient abandonné Içan Bouka, partiraient pour le Moghoulistan, à l’ombre de l’étendard d’Iounis khan. Chir Hadji beig, qui était le plus puissant de ces noïans (chefs de tribu), maria à Iounis khan sa fille appelée Içan Daulet Bégum. Iounis khan eut de cette princesse trois filles, dont l’aînée était Mihr Nigar Khanurn, que Sultan Abou Saïd Mirza maria à son fils aîné Sultan Ahmed Mirza; la seconde était Kotlok Nigar Khanum, qui épousa Mirza Omar cheikh Gourkân, autre fils d’Abou Saïd. Enfin., la troisième, Khob Nigar khanum, eut pour mari Mohammed Hossein Doughlat.
Après la mort d’Iounis khan, son fils Sultan Mahmoud khan plaça sur sa tête, à Tachkent, le diadème royal. Il est connu, parmi le Mongols sous le nom de Djanikeh. Sultan Mahmoud khan et son frère Sultan Ahmed khan, qui est connu sous le nom d’Aldjeh khan,[47] à l’époque de la révolte de Mohammed khan Cheïbani[48] et pour un motif qui sera consigné ci-après,[49] furent faits prisonniers par ce chef. Après que Cheïbani les eut retenus pendant deux ou trois jours, il s’abstint de répandre le sang de ces deux frères, par la raison qu’il avait pour femme la fille du sultan Mahmoud khan, et il leur donna la permission de se rendre partout où ils voudraient. Djanikèh et Aldjeh khan étant allés du côté de Tourfan, au bout de deux ou trois mois de séjour dans cette contrée, Aldjeh khan mourut. Après que sultan Mahmoud khan eut mené une vie errante dans ces déserts, pendant deux ou trois ans, il se dirigea enfin vers la cour de Cheïbani dans l’espoir d’en être traité avec bonté et commisération. Lorsqu’il fut arrivé dans le pays de Ferghanan, Djani-beig Sultan[50] envoya un courrier à Cheïbani khan et lui annonça que sultan Mahmoud khan était entré dans ce pays et qu’il se rendait à la cour. Cette nouvelle ne s’accordait pas avec les dispositions d’esprit de Cheïbani khan car il s’imagina que les Mongols qui avaient embrassé son service se soumettraient de nouveau[51] à Djanikeh et que ce prince, avec leur aide, se flatterait de l’espoir de recouvrer l’autorité souveraine. En conséquence, il osa rompre le traité, ce qui est contraire à la conduite louable des sultans magnifiques, et il envoya un détachement d’Uzbeks à la rencontre de sultan Mahmoud, afin qu’ils le missent à mort, quel que fût l’endroit où ils le rencontreraient. Ce corps de troupes, ayant atteint à Khodjend le cortège auguste du khan, fit périr ce prince, avec ses trois fils et une troupe de courtisans qui l’accompagnaient. La vie du sultan Mahmoud khan avait duré plus de quarante ans et moins de cinquante.
******************************
Ce qui concerne la personne de Djaghataï et les événements de son règne, et notamment la révolte de Mahmoud Tarabi, est raconté un peu trop brièvement par Khondémir. En revanche, on trouve là-dessus les détails les plu circonstanciés dans deux passages d’un écrivain contemporain, le premier qui se soit spécialement occupé des conquêtes de Gengis Khan, de ses fils et de ses petits-fils. Je veux parler du célèbre gouverneur de Bagdad, de l’Irak-Arabie et de Khouzistan, Alâ Eddin Ata-Mélik Djouveïni. Cet écrivain , dont la vie si agitée est bien connue par les recherches de MM. Quatremère[52] et d’Ohsson,[53] a composé sous le titre de Tarikh i Djihan Cuchaï (Histoire du conquérant du monde), un ouvrage qui, malgré les travaux plus récents et plus étendus de Rachid eddin et de Vassaf, est encore la principale source à consulter pour l’Histoire de Gengis Khan, de ses deux premiers successeurs, des Kharezm-Chah et des Ismaéliens de la Perse. J’ai transcrit et traduit cette dernière portion du Djihan Cuchaï, d’après les trois manuscrits de cet ouvrage que possède notre Bibliothèque impériale, collationnés avec le manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Leyde, copie fort nette, mais peu correcte, exécutée à Constantinople. Il y a près de deux siècles (en 1661), pour le savant Levin Warner.[54] Je dois la communication de ce dernier exemplaire à l’obligeante entremise de MM. Juynboll et R. Dozy, et à la libéralité de MM. les curateurs de l’Université de Leyde. L’Histoire des Ismaéliens, extraite du Djihan Cuchaï, et accompagnée de notes historiques et géographiques, est destinée à entrer dans un travail fort étendu sur les Ismaéliens de la Perse et sur ceux de la Syrie, travail dont tous les matériaux sont réunis depuis longtemps, mais dont la rédaction n’est pas encore fort avancée.[55] Pour le moment, je me contente de donner ici, comme un appendice naturel au morceau de Khondémir que je viens de publier, le texte et la traduction des deux chapitres d’Alâ Eddin Djouveïni relatifs à la révolte de Tarabi et au règne de Djaghataï Khan, de son fils et de son petit-fils. Je me suis servi, pour établir le texte de ces extraits, des manuscrits 36 du fonds Ducaurroy, 69 ancien fonds persan (Bibliothèque impériale), et du manuscrit de la bibliothèque de Leyde.
Tout coup, dans le courant de l’année 636 (1238-39), un habitant de Boukhara, de son métier fabricant de cribles, se révolta sous l’habit des soufis. La populace se rassembla autour de lui, et l’affaire alla si loin que l’ordre fut donné de mettre à mort toute la population de Boukhara. Mais le sahib (vizir) Yelwadj,[56] semblable à la prière du juste, écarta cet arrêt fatal. Grâce sa commisération et à sa sollicitude, il éloigna des Boukhariens ce malheur imprévu qui les menaçait. Leur ville recouvra son éclat et sa splendeur. De jour en jour la grâce de la bienfaisance divine, qui, à cause de sa grande compassion et de sa miséricorde, étend de toutes parts le tapis de la justice et de la générosité, par les mains du compatissant Mahmoud, brilla comme le soleil dans cette vaste et heureuse ville. Maintenant aucune autre cité musulmane n’égale celle-là, par le concours de la population, la quantité des biens et des troupeaux, la réunion des savants, l’éclat de la science et le mérite des étudiants (talibs); enfin, par la solidité des édifices consacrés à la bienfaisance. Deux bâtiments élevés et solides y furent construits à cette époque : le medréceh (collège) Khani, que Serkouteni Bigui[57] a fait bâtir, et le medréceh de Maçoud, dans chacun desquels mille talibs se livrent tous les jours à l’étude, sous des professeurs habiles, choisis parmi les savants les plus distingués de l’époque. En vérité, deux édifices aussi considérables et aussi propres sont une parure et un honneur pour la ville de Boukhara; je dirai plus un ornement et une décoration pour l’islamisme.
Outre tous ces avantages, les habitants de Boukhara jouissent du repos, et leurs dépenses et leurs charges sont très modérées. Que Dieu très haut orne les différentes parties du monde, en prolongeant l’existence du roi juste (Mangou Kan), ainsi que par la splendeur de l’islamisme et de la religion orthodoxe !
Dans le courant de l’année 636, il y avait conjonction de deux astres malheureux dans le signe du Cancer. Les astrologues avaient prédit qu’il s’élèverait des troubles, et qu’il se pouvait faire qu’un novateur se révoltât. Or, à trois parasanges de Boukhara, il y a un village que l’on appelle Tarab, et où vivait un individu nommé Mahmoud, dont le métier consistait à fabriquer des cribles. Ainsi qu’on l’a dit de lui, il n’avait pas son pareil en sottise et en ignorance. Il entreprit de montrer de la piété et de la dévotion, par hypocrisie et par ruse, et prétendit avoir des conversations avec des génies, qui lui révélaient les choses les plus cachées. Dans le Mavérannahr et le Turkestan, beaucoup de personnes, la plupart du sexe féminin, ont cette prétention. Quiconque est dans l’affliction ou souffre d’une maladie, prépare un festin et mande le péridar (celui qui est en communication avec les génies). Les péridars se livrent à des danses et autres pareilles absurdités. Les ignorants et les gens du commun regardent cela comme un article de foi. Comme la sœur de Tarabi l’entretenait de toutes sortes de contes de péridars, et que cet homme les propageait (or, que faut-il aux gens du commun, afin qu’ils deviennent partisans de l’ignorance?), la population venait en foule le trouver. Partout où il y avait un paralytique ou un affligé, il s’adressait à lui. Par hasard, dans le nombre, une ou deux personnes éprouvèrent quelque soulagement. Alors presque tout le monde vint le trouver, tant les personnes distinguées que la plèbe, excepté ceux à qui Dieu avait donné un cœur pur. J’ai entendu dire, à Boukhara même, par quelques personnes considérables et estimées:
« En notre présence, il souffla, dans les yeux d’un ou deux aveugles, des excréments de chien, et ces aveugles furent guéris, » Je répondis : Ceux qui ont vu cela étaient eux-mêmes des aveugles; car c’est là le miracle opéré par Jésus, fils de Marie, dont Dieu a dit: « Il guérit l’aveugle-né et le lépreux. » Si je voyais de mes propres yeux un tel événement, je m’occuperais sans délai de leur guérison. »
Il y avait à Boukhara un savant connu par son rite et sa noblesse. Son surnom était Chems eddin Mahboubi. Par suite d’une inimitié qui existait entre lui et les imams de Boukhara, il embrassa la cause de ce fou, et se joignit à la troupe de ses partisans. « Mon père, dit-il à cet ignorant, a raconté et consigné par écrit, dans un ouvrage, qu’il sortirait de Tarab, près de Boukhara, un fondateur de dynastie qui ferait la conquête du monde, et il a décrit les signes distinctifs de cette personne. Ces signes sont visibles en toi. » L’ignorant et insensé Tarabi fut confirmé dans son illusion par ce rapport; et ce bruit s’accorda avec la prédiction des astrologues. Le rassemblement augmentait de jour en jour; toute la population de la ville et des campagnes vint trouver Tarabi, et des indices de troubles et de désordre se manifestèrent. Des émirs, qui étaient à Boukhara, tinrent conseil touchant les moyens d’éteindre le feu de la discorde et du tumulte; et envoyèrent un ambassadeur à Khodjend, auprès du sahib Yelwadj, pour lui donner avis de cette affaire. Quant à eux, ils se rendirent à Tarab, comme pour jouir de la vue et de la faveur de Mahmoud, et ils le prièrent de se transporter à Boukhara, afin que la ville fût à son tour ornée de sa présence. Mais ils convinrent entre eux que lorsqu’il serait arrivé à l’extrémité du pont de Wézidan, ils feraient pleuvoir sur lui des flèches à l’improviste. Lorsque le cortège se fut mis en marche, Mahmoud aperçut des indices de changement dans la manière d’être de ces émirs. Quand il fut arrivé à l’extrémité du pont, il se tourna vers Temcha, qui était le principal des commissaires mongols, et lui dit : « Renonce à ton mauvais dessein, ou sinon, j’ordonnerai que les yeux te soient arrachés, sans l’intervention de la main d’un homme. » Lorsque les Mongols lui eurent entendu prononcer cette parole, ils se dirent: « Il est certain que personne ne l’a informé de notre dessein, et cependant tous ses discours sont véritables. » En conséquence, ils connurent de la crainte et ne firent subir à Tarabi aucune vexation. Lorsqu’il fut arrivé à Boukhara, il se logea dans le palais du roi Sindjar. Les émirs, les grands et les personnages principaux mettaient le plus grand zèle à lui témoigner leur considération et leur respect; mais leur intention était de le tuer dès qu’ils en trouveraient l’occasion, car la populace de la ville était en force, et le quartier et le bazar où il habitait étaient remplis de inonde, de sorte qu’un chat n’aurait pu y passer. Comme le concours des gens du peuple dépassait toute mesure, qu’ils ne s’en retournaient pas avant d’avoir reçu la bénédiction de Tarabi et qu’il n’y avait plus moyen d’entrer ni de sortir, il montait sur la terrasse et jetait sur eux de l’eau avec sa bouche. Quiconque était atteint par quelques gouttes de ce liquide, s’en allait satisfait et joyeux.
Cependant, un des sectateurs de l’erreur informa Tarabi du dessein des chefs mongols. Il sortit tout à coup par une porte dérobée, et monta sur un des chevaux attachés en cet endroit. Les individus étrangers, ne sachant pas qui il était, ne firent aucune attention à lui. Il arriva, sans s’arrêter, à la colline d’Abou Hafs. En un instant, tout un monde se rassembla auprès de lui. Un moment après sa fuite, on le chercha, mais en vain. Des cavaliers coururent de différents côtés à sa poursuite. Tout à coup ils le découvrirent sur le sommet de la colline déjà citée; ils s’en retournèrent et rapportèrent de ses nouvelles. La populace s’écria « Le Khodjah est arrivé en volant à la colline d’Abou-Hafs. » En un instant, les rênes du libre arbitre sortirent des mains des petits et des grands. La plupart se dirigèrent vers la colline et se réunirent à Tarabi. Au moment de la prière du soir, celui-ci se tourna de leur côté et leur dit: « Ô partisans de la vérité, qu’attendez-vous? Il faut purger le monde des impies; il faut que chacun emploie tout ce qu’il a à sa disposition, armes, instruments de guerre et bâtons. » Tout ce qu’il y avait d’hommes à Boukhara vint le trouver. Ce jour était un vendredi. Le Khodjah se logea dans la ville, dans la maison de Rabi, et manda les chefs de la religion, les grands et les hommes connus de Boukhara. Comme il était totalement dépourvu de sagesse et de mérite, il livra à la risée le chef des sadrs (grands pontifes) de son temps Borhan eddin, descendant de la famille borhanienne, et reste de la maison du Sadri-Djihan; et il nomma sadr ou chef de la religion Chems eddin Mahboubi. Tarabi traita injustement la plupart des personnes distinguées, les diffama et en tua plusieurs. D’autres prirent la fuite. Il s’attacha à gagner la populace et les vagabonds et dit: « Mon armée est de deux espèces; l’une, composée de descendants d’Adam, est visible; l’autre est cachée et se compose de troupes célestes qui volent dans l’air et d’un corps de génies qui marchent sur la terre. Je vais faire paraître à vos yeux cette seconde armée. Regardez dans les cieux et sur la terre, afin de voir la preuve de ce que j’avance. » Ses familiers et ceux qui avaient foi en lui regardaient. « En voici, disait-il alors, qui volent avec des habits verts et d’antres avec des habits blancs. » La populace confirmait son assertion. Si quelqu’un s’avisait de dire : « Je ne vois pas cela, » on le lui faisait voir à coups de bâton. Tarabi disait encore : « Dieu nous envoie des arme, du monde surnaturel. » Sur ces entrefaites, un marchand arriva de Chiraz et apporta quatre charges de sabres. A partir de ce moment, la populace ne douta plus de la victoire. Ce même vendredi, on récita la prière au nom de Tarabi, en qualité de sultan. Lorsqu’on eut fini la prière, on envoya des émissaires dans les demeures des grands personnages pour en apporter des tentes, des pavillons et des tapis. On équipa une armée immense. Les vagabonds et les vauriens s’introduisirent dans les maisons des riches et se mirent à prier. Lorsque la nuit fut arrivée, le nouveau sultan se retira tout à coup en particulier avec des belles semblables à des fées et avec des beautés ravissantes, et mena joyeuse vie. Au matin, il fit ses ablutions dans un bassin d’eau. Ses sectateurs partagèrent entre eux, par petites quantités, l’eau qui lui avait servi à cet usage, s’imaginant par là attirer sur eux les bénédictions du ciel; ils en firent aussi boire aux malades. Tarabi distribua à l’un et à l’autre les sommes que ses partisans avaient amassées, et les partagea entre les soldats et ses propres serviteurs. Lorsque sa sœur le vit s’emparer ainsi des femmes et des richesses d’autrui, elle s’éloigna de lui et dit:
« Son pouvoir, qui s’est établi par mon entremise, a reçu un grand préjudice. » Les émirs et les chefs, qui avaient récité le verset de la fuite, se réunirent dans Kermineh[58] et rassemblèrent les Mongols qui se trouvaient dans les environs. Ils firent les préparatifs que leur permettaient les ressources des provinces adjacentes, et se dirigèrent vers Boukhara. De son côté, Tarabi se disposa au combat et sortit de Boukhara, pour aller au-devant d’eux, avec les habitants du bazar, vêtus seulement de chemises et de caleçons.[59] Des deux parts, on se rangea en ordre de bataille. Tarabi se plaça au premier rang, avec Mahboubi, sans armes et sans cuirasse. Comme le bruit était répandu que toutes les mains qui se lèveraient contre lui seraient aussitôt desséchées, l’armée mongole portait mollement la main à l’arc et au sabre. Enfin, un soldat de cette armée lança une flèche qui, par hasard, blessa mortellement Tarabi. Une autre flèche atteignit Mahboubi. Personne dans les deux armées n’eut connaissance de ce fait. Sur ces entrefaites, il s’éleva un vent violent et la poussière devint si épaisse, que les hommes ne pouvaient s’apercevoir. L’armée ennemie, s’imaginant que c’était l’effet des miracles de Tarabi, battit en retraite et prit la fuite. Les soldats de Tarabi la poursuivirent; les habitants des campagnes sortirent de leurs villages, avec des bûches et des haches, décapitèrent à coups de hache tous les Mongols dont ils s’emparèrent, et notamment les percepteurs et les hommes en place. Ils leur donnèrent la chasse jusqu’à Kermineh, et en tuèrent près de dix mille. Lorsque les partisans de Tarabi revinrent de la poursuite, ils ne trouvèrent plus leur chef. Mais ils dirent : « Le Khodjah a fait une absence; jusqu’à ce qu’il reparaisse, ses deux frères, Mohammed et Ali, le remplaceront. » Ces deux ignorants se conduisirent de la même manière que Tarabi. Les gens du commun et les vauriens leur obéirent et se livrèrent tous ensemble au pillage, sans rencontrer d’obstacle. Au bout d’une semaine, Ildir Noyin et Tchenken Kourtchi arrivèrent, accompagnés d’une nombreuse armée de Mongols. Les deux frères de Tarabi sortirent en rase campagne, avec leurs sectateurs, et se présentèrent tout nus au combat. A la première décharge de flèches, ces deux malheureux furent tués, et environ vingt mille hommes partagèrent leur sort. Le lendemain, au moment où les guerriers du matin fendaient avec leurs sabres le front de la nuit, on chassa dans la campagne toute la population, tant hommes que femmes. Les Mongols avaient aiguisé les dents de la vengeance et ouvert la bouche de l’avidité, et se disaient les uns aux autres: « Levons de nouveau les mains et mettons à exécution notre désir; faisons des habitants l’aliment du réchaud de l’affliction, et livrons au pillage leurs richesses et leurs enfants. » Mais la bonté divine et la grâce céleste terminèrent les troubles, par l’entremise de la commisération de Mahmoud, et cela d’une manière aussi louable que son nom,[60] et rendit aussi heureux qu’autrefois l’astre de Boukhara. En effet, Mahmoud, étant arrivé, empêcha les Mongols de tuer et de piller, et dit: « Comment peut-on tuer tant de milliers d’hommes, à cause de quelques malfaiteurs, et comment, à cause d’un ignorant, peut-on anéantir une ville pour laquelle on a dépensé tant et de si longs efforts, de sorte qu’elle a recommencé à être florissante ! » Après que Mahmoud eut déployé beaucoup d’insistance, il fut convenu que l’on en référerait au kaân et que, quel que fut son ordre, on le mettrait à exécution. En conséquence, Mahmoud envoya des députés et fit de si grands efforts auprès du kaân, que celui-ci pardonna cette faute, dont le pardon était cependant impossible, et épargna la vie des habitants de Boukhara. Le résultat de ces efforts fut donc louable et digne de reconnaissance.
Djaghataï était un souverain plein de courage, de force et de sévérité. Lorsque le Mavérannahr et le Turkestan eurent té conquis, des endroits agréables et délicieux, dignes de servir de séjour aux rois et s’étendant depuis Samarkand jusqu’aux confins de Bich Balik, devinrent la résidence de ses enfants, de son armée et de ses bagages. Ses quartiers, pendant le printemps et l’été, se trouvaient dans Almalik et Koutak, qui, durant ces deux saisons, ressemblaient au jardin d’Irem. Il avait creusé dans leurs environs de grands étangs, que les Mongols appellent Gueul (lac), afin que les oiseaux aquatiques s’y réunissent. Il construisit un village nommé Kila. Il passait tous les hivers à Mérozik Ila. Il avait disposé sur toute la route des greniers, des aliments, et des boissons. Il était constamment occupé à se divertir et s’amuser, en compagnie de jeunes beautés. Ses serviteurs étaient tellement retenus par la crainte du Yaça et par celle de sa sévérité, que, sous son règne, personne, dans quelque passage que ce fût, n’avait besoin de sentinelle ou de garde, tout comme s’il eût été dans le voisinage de son armée. Et ainsi qu’on le dit par métaphore, une femme seule et portant sur sa tête une aiguière d’or, n’aurait pas conçu la moindre inquiétude. Il promulguait des ordonnances minutieuses, et dont il exigeait l’observation, de la part des étrangers, avec une importunité insupportable. C’est ainsi qu’il exigeait que l’on n’égorgeât pas les animaux destinés à être mangés, que l’on n’entrât pas pendant le jour dans une eau courante, etc. Il expédia dans toutes les provinces le règlement qui interdisait de tuer les moutons d’après les règles légales. Pendant un certain temps, personne ne tua publiquement des moutons dans le Khoraçan. Djaghataï obligeait les musulmans à manger des charognes. Lorsque Ogoday kaân fut mort, tout le monde eut recours à Djaghataï; et de toutes parts, de loin comme de près, on se rendit à sa résidence. Mais il s’écoula peu de temps, jusqu’à ce qu’il fut pris d’une violente maladie, qui déjoua tous les remèdes. Le vizir de Djaghataï était un Turc nommé Hédjir, qui s’était élevé au pouvoir sur la fin de son règne et s’était chargé de l’administration du royaume. Lorsque ce prince fut tombé malade, il mit le plus grand zèle à le soigner, ainsi que le médecin Medjd eddin, et lui témoigna beaucoup de dévouement. Mais, après la mort du khan, sa principale épouse, Yiçouloun, ordonna de les mettre tous deux à mort, avec tous leurs enfants et leurs adhérents. L’émir Habech Amid, qui avait embrassé le service de Djaghataï, à l’époque de la conquête du Mavérannahr, et avait obtenu le rang de vizir, fut confirmé dans cet emploi, sous l’autorité de la princesse. Il y avait un homme appelé Sédid Awar (le borgne), le poète, qui, un jour de fête, composa quelques vers conformes à la circonstance, et où il montre son attachement sincère à l’émir Habech Amid.
Il est devenu manifeste pour toi que ce monde impur est un lac d’afflictions; tu as appris que le monde, plein de coquetteries, est le séjour de la perfidie. Ta richesse et ton armée,[61] cette armée irrésistible, à quoi t’ont-elles servi, lorsque la mort a fondu sur toi et t’a entouré à droite et à gauche? Cet homme, par la crainte duquel personne n’entrait dans l’eau, est submergé dans un océan sans bornes.
Djaghataï avait un grand nombre de fils et de petits-fils. Mais, à l’époque de sa mort, il avait perdu son fils aîné, Matigân, tué à Bamian. Kara (Houlagou, fils de ce prince) vint au monde vers le même temps. Djenghiz-khan et, après lui, le kaân (Ogodaï) et Djaghataï, avaient assigné à cet enfant le titre d’héritier présomptif et de successeur de Djaghataï. Conformément à ces dispositions, l’épouse principale de Djaghataï et Habech Amid et les grands de l’Etat reconnurent pour souverain Kara (Houlagou). Lorsque l’on eut élevé la souveraine puissance Goyouk-khan, ce prince, à cause de l’amitié qui l’unissait à Yiçou, propre fils de Djaghataï, s’exprima ainsi : « Comment, du vivant du fils, le petit-fils serait-il le successeur de son aïeul? » En conséquence il mit à sa place Yiçou, et lui confia l’autorité souveraine dans le royaume de Djaghataï. Yiçou était continuellement occupé à boire; il n’avait aucune sagesse et était adonné à l’ivrognerie. Il buvait du vin, depuis le matin jusqu’au soir. Lorsqu’il se vit affermi sur le trône, il témoigna de la colère et du mauvais vouloir à Habech Amid, à cause de son intimité avec Kara (Houlagou). Dès le commencement de sa puissance, Habech Amid avait donné ses fils aux fils de Djaghataï, affectant chacun d’eux au service d’un des princes du sang. Il regardait Béha eddin Merghinany comme un de ses fils, à cause de son mérite et de sa science, et, en conséquence, il l’avait attaché au service d’Yiçou. Lorsque, grâce à ses anciens services auprès de ce prince, son pouvoir eut été affermi, et que le rang de vizir d’Yiçou lui eut été confié, Habech Amid fut congédié. Quoique l’imam Béha eddin observât les règles de la politesse et du respect, et qu’il eût empêché, à plusieurs reprises, Yiçou de mettre à exécution les mauvais desseins qu’il avait conçus à l’égard d’Habech Amid, cependant une vieille haine resta dans le cœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’il trouvât l’occasion de la satisfaire et d’apaiser son cœur. Cependant, Yiçou régnait paisiblement; mais, après que Mangou-kaân se fut assis sur le trône impérial, comme Yiçou ne donna pas son consentement à cette élection,[62] il accorda la place de celui-d à Kara (Houlagou), aux termes de la disposition qui avait eu lieu précédemment, et le renvoya dans ses États, après l’avoir distingué d’une manière signalée, par toute espèce de grâces. Mais la mort (littéralement : la promesse inévitable), l’ayant atteint en chemin, ne lui permit pas d’arriver à sa résidence. Mangou accorda sa place à son fils. Comme celui-ci était encore dans l’enfance, il remit les clefs du pouvoir dans les mains de l’épouse favorite de Kara Houlagou, Arghana. Lorsque le jeune prince parvint à sa résidence, Yiçou venait d’y arriver, avec la permission de Batou-khan.[63] Mais la mort ne l’épargna pas davantage.
L’émir Habech Amid et son fils Narir eddin redevinrent puissants, sous l’autorité de la princesse. A l’époque du retour de Kara, ce prince, à cause de la haine qu’il avait contre Béha eddin Merghinany, le livra à Habech Amid, avec ses richesses et ses enfants. Au moment où l’on arrêta ce personnage et qu’on l’enchaîna, il composa ce quatrain:
Ceux qui ont chargé sur leurs chameaux le bagage de leur vie, ont été délivrés de l’affliction et du chagrin de ce monde. Mon corps a été rompu par mes nombreux péchés, c’est pourquoi l’on a lié ce corps brisé.
Il envoya cet autre quatrain, pour implorer la bienveillance du prince:
Ô roi, prends-moi ma chaîne et ma trame si mon âme peut t’être de quelque utilité, prends-la également. C’est une âme qui est près de s’exhaler et qui aura pour siège le paradis. De ces deux choses, choisis celle que tu voudras.
Lorsqu’il vit qu’aucune ruse ne lui servait et que l’humilité et les plaintes lui étaient inutiles, il composa ces deux vers et les envoya à Habech Amid:
J’ai bien vécu avec mes ennemis et mes amis et je suis parti. J’ai placé sous mon aisselle le vêtement de la vie et je suis parti. La main de la mort m’a donné une pilule qui me fera exhaler mon dernier souffle. J’ai proféré contre Habech cent malédictions de bon aloi et je suis parti.
Habech ordonna de l’envelopper d’une pièce de feutre et de lui écraser les membres et les jointures de la manière dont on foule le feutre. Dans le courant de l’année 649 (1251), à l’époque où il revenait de l’ordou de Gaïmich,[64] l’auteur de ce livre se rendit auprès d’Yiçou, dans la société de l’émir Arghoun.[65] Lorsque j’eus rendu mes hommages à l’émir Béha eddin, aussitôt, avant que ma bouche se fût ouverte pour prononcer une autre parole, il me distingua tout particulièrement par les marques de sa considération et de son respect. Outre la noblesse de son origine, tant du côté de son père, qui était le cheikh el-islam héréditaire de Ferghana, que du côté de sa guère, par laquelle il descendait de Thoghan-khan, qui avait été khan et souverain de ce royaume, son mérite était si distingué, qu’il réunissait à l’élévation du rang de vizir, dont il avait été revêtu, toute sorte de sciences divines et humaines. Je l’ai vu être le centre du reste des hommes distingués de l’univers et le rendez-vous des chefs des diverses contrées. Quiconque possédait pour capital la marchandise du mérite et n’en pouvait tirer aucun parti, lui trouva un cours assuré, du vivant de ce ministre, et fut vivifié par sa bienfaisance et sa tendresse. L’énumération de ses belles qualités et de ses vertus serait très-longue. Mais ce n’est ni le temps, ni le lieu de les exposer ici. Quel homme de mérite la fortune a-t-elle favorisé, sans l’avoir ensuite renversé? L’imam Béha eddin laissa des fils et des filles en bas âge. L’émir Habech Amid voulait envoyer les enfants mâles rejoindre leur père; mais il ne vécut pas assez longtemps pour réaliser ce projet.
[1] Nous n’allons pas toutefois jusqu’à partager les doutes exprimés à ce sujet, il y a un peu plus de vingt ans, par le savant et ingénieux Abel Rémusat: « Il n’y a que la dynastie du Tchakhataï et des enfants de Djoutchi qu’il nous reste peu d’espoir de connaître, parce que, autant que nous pouvons le savoir, elles n’ont pas eu d’historien particulier, et que les traditions qui les regardent en sont devenues plus décharnées, et sujettes à plus de lacunes. » (Mélanges posthumes d’histoire et de littérature orientales, p. 380). Nous espérons bien que la découverte des trois ouvrages spéciaux mentionnés ci-dessous, ne tardera pas à jeter quelque jour sur ces deux branches de l’histoire mongole. Cet espoir est au moins permis en ce qui touche les Tarikh Arbaat Olous, puisqu’un de nos confrères, M. Cl. Schefer à découvert à Constantinople une copie de cet important ouvrage. (Voyez Journal asiatique, janvier 1851 p. 104; cf. ibidem, numéro de novembre - décembre).
[2] Histoire générale des Huns.
[3] Ces deux mots sont mongols et désignent tous deux le célèbre code de Djinguiz khan.
[4] Selon les historiens mahométans postérieurs au fameux Timour, son cinquième aïeul, Caradjar, commandait les troupes de Tchaghataï, possédait la confiance de ce prince et jouissait à sa cour de la plus grande autorité; cependant Caradjar nommé ni par Alaï eddin, ni par Rachid, qui font mention de plusieurs personnages influents sous le règne de Tchaghataï, tels que Massoud bey, Habesch Amid et d’autres. Caradjar mourut en 651 (1254), âgé de soixante et dix neuf ans. (Histoire des Mongols par M.C. d’Ohsson).
[5] En turc les cinq villes. C’est l’Ouroumtsi de nos jours.
[6] On sait que les Mongols ne se faisaient pas scrupule de manger des animaux morts de maladie, ce qu’un musulman ne se permettra jamais de faire.
[7] Mitoukan ou Moatougan fut tué au siège de Bamiân. Voyez ma traduction des Voyages d’Ibn Batouta dans la Perse et dans l’Asie centrale.
[8] C’est le Sirenum ou Serenum (Chiramoun) de Jean du Plan de Carpin (Relation des Mongols ou Tartares).
[9] Cf. sur cette expression, les observations de S. de Sacy. Journal des Savants, 1829. « C’est un fouet qui est tombé du monde invisible entre mes mains. »
[10] Il s’agit ici, non de la célèbre capitale du Fars, mais d’une petite ville du même nom, située cinq ou six lieues au nord de Samarcande, et sur laquelle on peut consulter Abd errezzah (Notices et extraits des manuscrits).
[11] Littéralement « Qu’il s’asseyait devant lui sur les deux genoux de la politesse. » Comme le fait observer Chardin (Voyages) devant les gens à qui ils doivent le respect, « les Persans s’asseyent sur les talons, les genoux et les pieds serrés l’un contre l’autre. (C’est cette posture que notre auteur appelle dou-sanou). Devant ses égaux, ou met plus commodément; car on se met sur son séant, les jambes croisées en dedans et le corps droit. On appelle cette situation tcharzanou, c’est-à-dire: s’asseoir sur les quatre genoux, parce que les genoux st les chevilles des pieds, sont à plat à terre. L’expression se rencontre encore dans un autre passage de Khondémir. On y lit (III, fol. 216 v°) que Mirza Abd-Allatif, fils et successeur d’Oloug Beig s’asseyait, dans les réunions de cheikhs et de savants, sur les deux genoux de la politesse.
[12] C’est le sultan Oloug-Beig, non moins fameux par ses malheurs que par ses connaissances en astronomie, et dont la destinée, sous ce double rapport, ressemble à celle d’Alphonse X le Savant.
[13] Arik Bouka était le frère cadet de Mangou et de Koubilaï. Après la mort du premier de ces princes, il se révolta contre Koubilaï et lui disputa le trône de Karakoroum. (Voyez Habib essiier, t. III)
[14] Cette disette avait pour cause la défense promulguée par Koubilaï, de porter des vivres de la Chine septentrionale dans l’ordou (campement) d’Arik Bouka, à Karakoroum et dans le Kélouran. (Khondémir, Habib, t III)
[15] On nommait ainsi une plaque de métal, avec certaines figures et inscriptions, dont étaient munis les dépositaires de l’autorité et les personnes qui avaient obtenu des franchises.
[16] Le récit de cette guerre se trouve d’une manière plus détaillée dans le chapitre que Khondémir a consacré à l’Histoire des Mongols de la Chine.
[17] D’après notre auteur (fol. 2 r.), Kaidou était fils de Kachin, (Caschi, selon Deguignes, t. III, p. 311, et M. d’Ohsson, t. II, p. 360), et petit-fils d’Ogodaï. Ailleurs (fol. i6 y.’), il donne à Kachin le cinquième rang parmi les fils d’Ogodaï et de Tourakina Khatoun.
[18] Bérékeh khan, fils de Djoutchi, était souverain du Kiptchak. Voyez sur ce prince les extraits de Khondémir dont j’ai donné la traduction dans mes Fragments de géographes et d’historien arabes et persans inédits.
[19] Ce prince est sans doute le même qui est nommé Kadan à deux reprises dans un autre passage de notre auteur.
[20] Le balich était une monnaie de compte. Vassaf (cité par M. d’Ohsson) nous apprend que le balich d’or valait 2000 dinars, le balich d’argent 200 dinars, et le balich tchao, ou en assignats 10 dinars. On lit, dans le grand Livre de l’état du Khan (Journal asiatique, juillet 1830, p. 61), le balism vaut 1000 florins d’or. Il est probable, comme l’a fait observer d’Ohsson que la valeur du balich a subi de fortes variations. (Cf. l’Histoire des Mongols de la Perse).
[21] Les traditions musulmanes donnent ce nom au vizir ou premier ministre de Salomon. Assaf est devenu pour les Orientaux, le prototype et le modèle des ministres; ils se plaisent lui comparer les vizirs célèbres par leurs talents. C’est ainsi que Khondémir, dans un de ses ouvrages (le Destour el-Vouzéra ou Histoire des vizirs), donne à un vizir de Mahmoud le Ghaznévide le surnom de Pareil à Assaf, et que plus loin il dit d’un autre ministre: « Ils ouvrirent la bouche pour blâmer et calomnier cet Assaf (ce ministre) du sultan semblable à Salomon ».
[22] On peut consulter sur cet écrivain nommé Abd Allah, fils de Faz Allah, l’Histoire des Mongols de M. d’Ohsson.
[23] Ce prince était le frère germain de Yachmout et le sixième fils d’Houlagou Son nom est écrit ailleurs (Rachid eddin, Histoire des Mongols de la Perse) Tousin ou Touchin et Tichin.
[24] Le mot signifierait « Une plaine verdoyante et bien arrosée, qui est située au pied d’une montagne. » M. Quatremère le traduit simplement par territoire. Ce mot est maintenant employé en Perse avec le sens de vallée.
[25] M. d’Ohsson a raconté avec de grands détails, et en lui attribuant une cause toute différente de celle indiquée par notre auteur la défection des princes Kiptchak et Tchabat, petit-fils et arrière petit-fils d’Ogodaï que Kaïdou avait placés sous les ordres de Borak.
[26] « Durant nos marches nocturnes... je remarquai environ deux lieues avant l’aurore, une espèce de point du jour, l’horizon s’éclairant pendant un court espace de temps d’une lumière presque aussitôt suivie de l’obscurité la plus profonde. Ainsi, les Persans ont deux matins, le sobhi kazim (lisez kâzib) et le sobhi sâdic, c’est-à-dire, le vrai et le faux point du jour. L’historien arabe Abd el-Wahd el-Marékochi parle d’un imposteur qui s’était révolté à Hisn Martelah (Mertolah) en Espagne, vers le milieu du xiie siècle, et qui fut trahi par les siens et livré à Abd el-Moumin. Le prince Almohade lui ayant dit « J’ai appris que tu prétendais diriger les hommes vers la connaissance de Dieu, cet individu lui ré pondit: « Est-ce qu’il n’y a pas deux aurores, une vraie et une fausse? Abd el-Moumin rit de cette réponse et pardonna à l’imposteur.
[27] Dans un autre chapitre de son ouvrage, Khondémir dit que cette bataille eut lieu dans le mois de dzou’lhiddjeh 668 (juillet - août 1270), à cinq ou six parasanges d’Hérat. Marco Polo a raconté la guerre d’Abaka et de Borak (Voyages). Seulement, dans son récit, c’est Arghoun, et non son père Abaka, qui commande l’armée des Mongols de la Perse; Borak, dont il fait un frère de Kaidou, n’agit que comme lieutenant de celui-ci, et la bataille se livre dans le voisinage du Djeïhoun. Enfin, il place ces événements peu de temps avant la mort d’Abaka.
[28] Souren qui est traduit dans le dictionnaire par assaut, attaque irruption, signifie proprement le « cri avant-coureur du combat. » On peut en voir des exemples dans le Zafer Nameh persan.
[29] Khondémir suit en cet endroit le récit du Tarekhi Vassaf, qui diffère de celui de Rachid eddin, dont on peut voir l’analyse dans M. d’Ohsson
[30] Il faut sans doute lire Sarban.
[31] M. d’Ohsson écrit Toca Timour et Bouzaï.
[32] D’après M. d’Ohsson, Keurgueuz était le beau frère et non le gendre de Timour. Le titre de gourkan ou gourkhazn, comme l’a prouvé Klaproth, désignait les princes alliés par mariage avec les empereurs de la Chine. Les Chinois l’écrivent qoukhan. M. d'Ohsson explique le titre de gourkhan par celui de grand khan, et, ailleurs il le traduit par khan universel. Enfin, dans deux autres endroits, il explique kourkan par gendre.
[33] Ce combat eut lieu sur les bords de l’Irtich.
[34] Un voyageur contemporain, Ibn Batouta, a aussi célébré l’équité de Képék et les égards qu’il témoignait aux musulmans.
[35] Képek et Iltchikédai ne sont pas comptés par Deguignes parmi les khans du Djaghataï. Iltchikédai est mentionné par Ibn Batouta (loc. laudato).
[36] On peut voir, sur ce prince, ce que dit un savant contemporain, l’auteur du Méçalik al-Absar.
[37] Au lieu de Bouzân, Ibn Batouta écrit Bouzoun. M. d’Ohsson lui donne pour père Djagam, fils de Doua khan. Deguignes écrit Butun khan et fait de ce prince un frère de Thermachîrîn.
[38] Ibn Batouta dit au contraire que Bouzoun était musulman, mais que c’était un homme impie et méchant. Le récit du voyageur maghrébin diffère de celui de Khondémir sur plusieurs points importants; il est, d’ailleurs, beaucoup plus détaillé.
[39] On nommait Djiteh ou Djéteh, chez les Turcs Orientaux, l’ancien royaume des Ouïgours, le pays de Kachgar et la Dzoungarie actuelle au pied de l’Altaï. Chez les historiens de Timour et de ses successeurs, les noms de pays de Djéteh et de Moghoulistân désignent l’empire de Djaghataï.
[40] M. d’Ohsson donne pour père à Djinkchi, Djagam et en fait, par conséquent, un frère de Bouzân, ainsi qu’a fait Deguignes, qui, cependant appelle Ulugan le père de Zenkechi (sic).
[41] D’après Mirkhond (Vie de Djinguiz khan) et Khondémir, Kabel khan et Katchouly-Béhadur, fils jumeaux de Toumeneh khan, étaient convenus entre eux, sous la foi du serment, que le titre de khan appartiendrait à Kabel et à ses descendants et que Katchouly et ses enfants seraient investis du commandement des troupes. Les deux frères auraient, toujours selon Mir et notre auteur, scellé cet accord par un acte écrit en caractères ouïgours et sur lequel Toumeneh khan aurait placé son âlm-tagha ou son « cachet vermeil. »
[42] « Il envoya un de ses idjékis auprès d’Oveis. » Je regarde ce mot comme formé du mot turc ichik, seuil. Il y avait à la cour de Perse, sous les monarques soufis, un officier appelé le grand échik agassi ou maître du dehors, sous lequel sont tous les kéchiktchi qui sont gardes du roi, qui gardent sa personne la nuit. Il aura peut-être plus de deux mille personnes sous lui. La charge d’ichik Agassi existe encore à la cour de l’émir de Boukhara; et M. Khanikoff traduit ce titre par celui de maître des cérémonies. Je crois qu’il faut encore lire dans ces passages de notre auteur: « Il mit fin aux profits que faisaient les émirs et les gardes d’Élias Khodjah khan; « A l’instigation d’une troupe de gardes. » « A présent que je suis compris parmi les personnes attachées particulièrement au seuil, aussi noble que le paradis » « Aucun des émirs, des ministres des vizirs, des gardes et des courtisans ne portera à la connaissance du roi aucune affaire relative au gouvernement ou à la perception des tributs, sans en donner préalablement avis au ministre » « La plupart des gardes et des courtisans se ressentirent de ses discours malins. »
[43] Khondémir donne encore ailleurs le nom d’Imelkhodja au père de Tougloul Timour khan. Imel-khodjah paraît avoir été confondu par Abou’l Ghazi Béhadur khan avec son frère Içan Bouka-Iben, dont il été question ci-dessus.
[44] Cf. sur ce prince et sur son fils Iounis khan, un passage d’Haïder Rasi, cité par M. Quatremère (Journal des Savants, janvier 1839). Veis khan y est nommé Awis, ainsi que dans les Notices et Extraits.
[45] Le mot manque dans le dictionnaire; mais M. Senkowski nous apprend que c’est un terme turc djaghatéen signifiant secours, renfort.
[46] Ce prince était petit-fils de Mirza Miran chah, un des fils de Timour. Il fut reconnu roi à Boukhara, après le meurtre de Mirza Abd el-Latif, c’est-à-dire, dans l’année 854 (145o), et s’empara de Samarcande l’année suivante. Il fut fait prisonnier et mis à mort, dans l’année 873 par l’émir Hassan beig, l’Ussum-Cassan des chroniqueurs occidentaux.
[47] Haïder Doughlat dit que les Kalmaks avaient donné à Ahmed khan le surnom d’Alatchi khan, c’est-à-dire, prince sanguinaire, à cause des victoires qu’il avait remportées et des cruautés qu’il avait exercées sur eux et sur les Uzbeks Kazakhs (Cf. Journal des Savants, janvier 1839). Le fils d’Ahmed, appelé Aboul Saïd khan, releva la puissance de son père et de son oncle dans les villes de Kachgar et de Iarkend et porta ses armes dans le Tibet, et dans le Cachemire.
[48] Ainsi qu’on peut le voir dans un précédent chapitre de Khondémir, dont j’ai donné la traduction ailleurs, Mohammed khan Cheïbani était petit-fils d’Abou’l Khaïr khan, souverain de Kiptchak et avec l’aide de qui Mirza Sultan Abou Saïd avait conquis Samarcande. Cheïbani s’empara de cette même ville, au commencement de l’année 906 (1500) et fut le véritable fondateur de la puissance des Uzbeks.
[49] Il est encore question, dans un autre endroit, de Sultan Mahmoud khan à propos d’une expédition qu’il fit contre Sultan Ahmed Mirza, fils de Mirza Sultan Abou Saïd, prince de Samarcande. Les deux armées, s’étant trouvées en présence, furent saisies d’une panique réciproque et s’enfuirent chacune dans son pays. Le sultan Mahmoud khan s’allia par la suite, en l’année 899 (1493-4) avec Ahmed contre le frère de ce prince, Mirza Omar cheikh Gourkan, souverain d’Andédjan et père du fameux Zéhir eddin Mohammed Baber. Dans l’année suivante, Mahmoud khan entreprit une expédition contre Baïsonkor Mina, fils de Mirza Sultan Mahmoud, qui venait de succéder à son père dans la possession de Samarcande et de Boukhara. Il fut défait et perdit 13.000 hommes.
[50] Djani-beig était cousin de Cheïbani beg khan et gouvernait la ville d’Andédjan.
[51] Littéralement : « Prendraient sur l’épaule la housse du service de Djanikeh. » Sur l’espèce de couverture de cheval nommée ghachiah, on peut voir une longue note de M. Quatremère (Histoire des sultans mamlouks). J’ajouterai seulement ici un fait prouvé que l’usage du ghachiah, comme un des insignes de la souveraineté, était antérieur aux époques indiquées par M. Quatremère. On lit dans Ibn Alathir que dans l’année 458 (1066), le sultan Alp-Arslan, ayant fait reconnaître son fils Mélik chah pour son successeur, le fit monter à cheval et marcha devant lui, portant le ghachiah. — Actuellement encore, les palefreniers persans portent sur l’épaule, lorsque leur maître est à cheval, une housse appelée zin pouck dont ils recouvrent la selle, toutes les fois qu’il met pied à terre. Le vrai sens du mot a été ignoré du savant M. d’Ohsson, qui l’a rendu par manteau dans ce passage du Djihan Kuchaï. L’émir de Khodjend était Timour Mélik, guerrier doué d’une telle, bravoure, que si Rustçin avait vécu de son temps, il n’aurait pu que porter son ghachiah (c’est-à-dire se reconnaître son serviteur).
[52] Mines de l’Orient, t. I. p. 220-234; Histoire des Mongols de la Perse, p. LXVII, et p. 69, 170 note; Histoire des sultans mamelouks de l’Egypte, t. I, 2e partie, p. 60, note, et t. II, 1re partie. p. 50, note 45, et p. 58, n° 4; cf. Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges Asiatiques, t. I, p. 436, 437.
[53] Histoire des Mongols, t. I, p. xvii-xxvii, et t. III, passim.
[54] Cette copie présente le même texte que le ms. 69 ancien fonds persan, copié en l’année 938 (1531-2) dans une écriture talik assez lisible. Ces deux exemplaires offrent de fréquentes omissions.
[55] Cet ouvrage aura pour titre : Histoire des Ismaéliens, ou Bathéniens de la Perse, plus connus sous le nom d’Assassins, par le vizir Alâ eddin Djouveïni, publiée en persan, d’après quatre manuscrits, traduite, précédée d’une introduction, et accompagné d’un commentaire et d’un mémoire sur les Ismaéliens de Syrie.
[56] Ce personnage, dont le vrai nom était Mahmoud (Yelwadj est un titre turc qui signifie ambassadeur), fut chargé sous le règne d’Ogoday, de l’administration générale des provinces mongoles en Chine. Après la mort d’Ogoday, il fut disgracié; mais, à son avènement au trône, en 1252, Mangou Kaân le nomma administrateur général des possessions mongoles en Chine. Mahmoud Yelwadj avait un fils, Maçoud bey, qui administra, sous Djaghataï et ses successeurs, le Turkestan et la Transoxiane. Voyez d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 193 et 194, dans la note, et p. 262, 263.) Khondémir attribue à Karatchar Noïan le rôle qu’Alâ eddin fait jouer à Mahmoud Yelwadj et à Haberh-Amid.
[57] Cette princesse, dont le nom est écrit de plusieurs autres manières dans les historiens, était fille de Djakembou, frère d’Ong khan, roi des Kéraïts. Elle épousa Toulouï, quatrième fils de Gengis khan, et en eut cinq fils, parmi lesquels deux (Mangou et Koubilaï) régnèrent successivement à Karakoroum, et le troisième (Houlagou) fonda l’empire des Mongols de la Perse. D’après Jean du Plan de Carpin, qui l’appelle Seroctan, cette princesse était la plus renommée parmi les Tatars, si l’on en exceptait la mère de l’empereur régnant (Koyouk) et la plus puissante de tous, sauf Bali (Batou). (Relation des Mongols ou Tartars, édition d’Avezac, p. 270, 271) Bar-Hebraeus l’appelle Serkouten-Beghi. (Cf. Rachid Eddin, Histoire des Mongols de la Perse, p. 86, 88, 90, et note 7, ibidem; d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 59, 60, 267.)
[58] Telle est l’orthographe de nos trois manuscrits. C’est aussi celle qui est actuellement en usage. (Voyez Meyendorff, Voyage d’Orenbourg à Boukhara, p. 59 et 162; Alexandre Burnes, Voyage à Boukhara, t. III, p. 116 et 140; Izzet Allah, apud Klaproth, Magasin asiatique, t. II, p. 48 et 167.) D’après ce dernier voyageur. Kerminâ (sic) est un lieu considérable dans le Mian Kal, à dix huit heures de marche de Boukhara, et à trente et une de Samarcande. Au lieu de Kermineh, les anciens géographes orientaux écrivent Kerminieh (Voyez le Lobb-al-Lobab de Soyouthi, édition Veth, p. 10, note w, et p. 221, et la Géographie d’Edrisi, traduction de M. Jaubert. t. II, p. 194 à 196.) Mais le sultan Baber, dans ses Mémoires, écrit Kermineh. (Voyez le Journal des Savants, août 1848, p. 359.)
[59] Le mot ou celui du ms. Ducaurroy, désigne ici une sorte de caleçon, avec lequel on couvre les hanches et les parties sexuelles. (Voyez R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, p. 37). Le manuscrit de Greaves porte « Ils se ceignent les reins d’un caleçon de laine, qu’ils appellent asfakas. » Au lieu de ce dernier mot, M. Jaubert (op. supra laud.) écrit, p. 209, esfakis. Puisque j’ai rapporté, d’après Edrisi, un nom berbère de vêtement, je profiterai de cette occasion pour dire quelques mots d’un autre nom de vêtement, usité dans l’Afrique septentrionale, mentionné aussi dans le géographe arabe, ct cependant omis dans nos dictionnaires. On fabrique à Noul Lamta, dit Edrisi (t. I, p. 206), des vêtements appelés sefsarich. Le mot sefsarich a été changé par Peyssonel en sufficieli. C’est, d’après ce savant voyageur, le nom du burnous. (Voyages dans les régences de Tunis et d’Alger, t. I, p. 68, 78, 79, 217, 219.) On lit ce qui suit dans la relation d’un voyageur anglais, qui a exploré avec soin la régence de Tunis: La tête est enveloppée, aussi bien que le corps, d’une draperie de gaze de soie rayée, appelée sefsar, qui est liée autour de la tête par une corde de poil de chameau, repliée en forme de turban; sur le sefsar, est jeté un léger burnous, etc. (Excursions in the Mediterranean, by major sir Grenville Temple, t. II, p. 51). Et plus loin: « le barracan ou sefsar, à la fois par sa forme et par la manière dont il est drapé autour de la figure, correspond indubitablement à la toge. (Ibidem, p. 52.) Et enfin: « A Nefta se trouve une manufacture considérable des sefsars en gaze, qui sont si fameux dans toute la Barbarie. » (Ibidem, p. 172.)
[60] Mahmoud, en arabe, signifie loué, louable.
[61] Le poème s’adresse ici à Djaghataï.
[62] Cf. M. C. d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 251, 253, 272.
[63] Batou était l’un des princes du sang, comme représentant la branche de Djoutchi, fils ainé de Gengis khan; et, à ce titre, il jouissait d’une grande influence parmi les Mongols, et même à la cour de Karakorum. (Voyez Jean du Plan de Carpin, Relation des Mongols ou Tartars, édition d’Avezac, p. 172 et 276, et M. d’Ohsson, t. II, p. 195, 246, 249 et 250; et sur l’Histoire de Batou, cf. l’Extrait de Khondémir, traduit dans mes Fragments de Géographes et d’historiens arabes et persans inédits, p. 212, 216.)
[64] Oghou’l Gaïmich était la principale épouse de Goyouk, et elle fut chargée de la régence après la mort de cet empereur. (Voyez d’Ohsson, t. II. p. 246 et suiv.)
[65] Gouverneur de la Perse, sous la régence de Tourakina et les règnes de Goyouk et de Mangou Khan. (Voyez d’Ohsson, tome II, p. 123 à 129.)