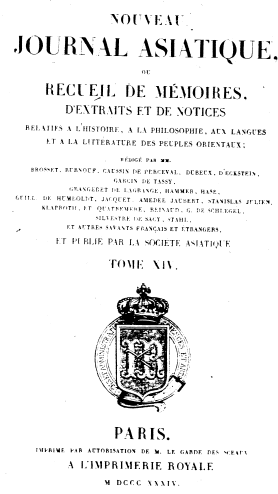
HARIRI
séances
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
.
Traduction de M. Grangeret de Lagrange, Fundgruben des Orients, 5, 1816
Alhareth ben Hammâm a raconté :
Lorsque je traversai le désert pour me rendre à Zébid, j'étais accompagné d'un jeune esclave, que j'avais élevé jusqu'à l'âge de puberté, et que j'avais formé jusqu'à ce que son éducation fût achevée. Il s'était familiarisé avec mes manières et connaissait bien mes façons d'agir. Il se conformait exactement à tous mes désirs et ne manquait jamais le but indiqué. Aussi toutes ses actions me plaisaient infiniment, et je vouloirs l'avoir sans cesse auprès de moi, soit à la ville, soit en voyage. Or il arriva que la fortune ennemie l'enleva de ce monde, lorsque nous fumes arrivés à Zébid. Lors donc qu'il eut rendu le dernier soupir,
[1] je fus pendant un an sans trouver aucun plaisir à prendre de la nourriture, ni sans chercher un autre esclave. Mais enfin les ennuis de la solitude, et les fatigues que j'éprouvais en faisant tout par moi-même, m'obligèrent à remplacer un joyau très précieux par un autre qui n'avait aucune valeur, et à chercher quelqu'un qui me procurât tout ce qui m'était nécessaire. J'allai donc trouver un marchand d'esclaves dans le marché de Zébid, et je lui dis : « Je désire avoir un jeune homme qui soit un sujet d'étonnement pour celui qui l'examine, et qui mérite des louanges lorsqu'on le met à l'épreuve. Je veux que des gens instruits aient pris soin de son éducation, et que le besoin seul l'ait contraint de s'exposer en vente dans le marché. » Alors tous les marchands furent charmés de ma demande, et offrirent de me procurer dans peu de temps ce que je désirais. Cependant les mois avaient achevé leur révolution et la lune avait plusieurs fois parcouru ses diverses phases, et aucune de leurs promesses n'avait été suivie d'aucun effet.[2] Enfin lorsque j'eus vu que les marchands d'esclaves oubliaient, ou faisaient semblant d'oublier ce que je leur avais demandé, je reconnus que tous ceux qui faisaient des promesses n'étaient pas toujours disposés à les remplir,[3] et que personne, excepté moi, ne pourrait prendre soin de mes affaires.[4] Je cessai donc de me reposer sur autrui, et je retournai au marché, la bourse bien garnie. Tandis que j'étais occupé à passer en revue des esclaves et à en demander le prix, tout à coup un personnage inconnu se trouve sur mon passage. Un voile lui couvrait la moitié du visage et il conduisait par la main un jeune esclave. « Qui veut m'acheter, dit-il, un jeune homme plein de mérite, qui se distingue entre ceux de son âge par sa bonne mine et son heureux caractère, qui s'acquitte sans peine de la tâche qu'on lui donne à remplir. Il guérit les plaies de l'âme par son doux langage, il saisit le sens de tout ce qu'on lui dit. S'il vous survient un accident, il ne désire rien tant que de vous voir hors de danger. Il s'élancerait à travers les flammes si vous lui en donniez les ordres. Si vous le prenez à votre service, un jour seulement, il vous sert avec fidélité. Si vous ne lui donnez qu'un fétu,[5] un fétu lui suffira. Quoiqu'il soit infiniment rusé, le mensonge n'est jamais sorti de sa bouche ; et jamais, par vanité, il ne s'est arrogé rien qui pût appartenir à quelqu'un. Il ne s'est jamais rendu aux sollicitations pressantes de ses passions ; et il n'a jamais cru qu'il lui fût permis de divulguer un secret qui lui était confié. Depuis longtemps il montre dans tout ce qu'il fait une habileté merveilleuse, et il excelle en poésie et en éloquence. Ah ! je le jure, si mes enfants n'étaient point nus et mourant de faim, non, je ne le céderais pas au prix même du royaume de Khosroès. »Lorsque j’eus bien considéré la taille éléphante de ce jeune homme et la beauté merveilleuse de ses traits, je crus qu'il était un des jeunes habitants du jardin de délices, et je dis : « Ce n'est point un homme, mais plutôt un ange glorieux. » Je lui demandai ensuite comment il se nommait, non pour connaître qui il était, mais pour voir si son éloquence répondait aux grâces répandues sur toute sa personne. Il ne me répondit ni avec douceur, ni avec amertume, ni ne prononça un seul mot qui décelât le fils d'une esclave ou d’une femme libre. Je détournai donc de lui mon visage et lui dis : « N'as-tu pas honte d'avoir une telle peine à t'exprimer ? » — Alors il lui prit un rire immodéré. Lorsque ses esprits furent calmés, il leva la tête et chanta ces vers :
« O toi dont le courroux s'est enflammé, parce que je ne t'ai point découvert mon nom, sache que ta conduite n'est point celle d'un homme juste. S'il faut absolument, pour te contenter, que je te le dévoile, écoute-le donc avec attention : Je suis Joseph, je suis Joseph.[6] Je t'ai ôté le voile, si tu es intelligent, tu me comprendras, mais je ne crois pas que tu puisses me comprendre. »
La douceur de ces vers mit fin à mes reproches, et mon cœur fut tellement captivé par la magie de son éloquence, que je m'éloignai de la vérité et oubliai l'histoire de Joseph le Croyant. Je ne songeai qu'à terminer mon affaire avec le maître du jeune homme et qu'à lui demander son prix pour le payer. Je croyais qu'il me regarderait de travers et qu'il me ferait un prix excessif ; mais il ne se montra point à mon égard tel que je me l'étais imaginé[7] ; il me dit au contraire : « Lorsque le prix d'un esclave est médiocre, et que la dépense pour son entretien est légère, son maître trouve en lui son bonheur et il conçoit pour lui un vif attachement. Et comme je désire que vous aimiez ce jeune homme, je vous diminuerai sa valeur. Pesez-moi donc deux cents dirhems, si vous le voulez, et rendez-moi des actions de grâce tant que vous vivrez. » Je lui payai sur le champ la somme qu'il me demanda, avec la même célérité que l'on paie un objet qui procure une satisfaction légitime ; et il ne m'était point venu dans l'esprit que tout ce qu'on achète à vil prix, est toujours trop cher. Lorsque le marché fut conclu et que nous fumes sur le point de nous séparer, les yeux du jeune homme répandirent plus de torrents que n'en répandent les nuages. Ensuite il se tourna vers son maître et lui dit :
« Que Dieu te chasse de sa présence. Convient-il qu'un jeune homme tel que moi soit vendu pour que tes enfants assouvissent la faim qui les tourmente ? N'est-ce pas s'écarter du sentier de la justice que de m'imposer une tâche que je ne puis remplir et que de m'éprouver par de continuelles alarmes, bien que les alarmes ne puissent abattre un jeune homme tel que moi ? N'as-tu donc point mis mes vertus à l'épreuve ? Que dis-je ? Tu as toujours reçu de moi des conseils dont la perfidie n'altérait point la sincérité. Combien de fois m'as-tu mis en embuscade pour épier une proie ! je revenais, et la bête fauve était enveloppée dans mes filets. Les pénibles tâches que tu m'as prescrites, je les ai remplies avec succès, et cependant il y avait des obstacles à surmonter. Que de dégoûts n'ai-je point éprouvés ! De quel butin mon bras ne s'est-il pas emparé ? Jamais je n'ai commis de faute qui pût servir de prétexte à ta colère, et rien ne lève le voile qui en cache le motif à mes yeux. Tu n'as jamais, grâce à Dieu, découvert en moi une bassesse dont je me fusse rendu coupable dans le secret ou en public. Comment donc as-tu pu rejeter l'engagement qui te liait à moi, avec la même facilité que l'ouvrier rejeté les copeaux du bois qu'il façonne à son gré ? Pourquoi donc ton âme a-t-elle consenti à mon déshonneur ? Pourquoi a-t-elle souffert que je fusse vendu comme un vil meuble ? D'où vient que tu n'as pas conservé mon honneur, comme je conserve au fond de moi les paroles que tu m'adresses au jour de nos mutuels adieux ? Pourquoi n'as-tu pas dit à cet homme qui me marchandait : Ce jeune homme est un Secab[8] qui ne peut ni être prêté, ni être vendu. Certes, je ne le cède point à ce généreux coursier ; mais celui qui en était le maître te surpassait en grandeur d'âme. Cependant, puisque je suis l'objet d'un vil trafic, je chanterai : Ils m'ont délaissé ! Ah, quel jeune homme ils ont délaissé[9] ! »
Lorsque le vieillard eut entendu les vers que venait de chanter le jeune homme, et qu'il eut bien compris le sens de son discours attendrissant, il poussa de profonds soupirs et pleura jusqu'à tirer des larmes des yeux de ceux qui étaient éloignés de lui ; puis il dit :
« Je regarde ce jeune homme comme mon fils, et je ne le distingue pas des plus chères parties de mon cœur. Ah ! si la misère n'habitait point ma maison, si mes ressources n'étaient point éteintes, il n'aurait quitté mon asile que pour suivre mon cercueil. Vous êtes témoin des douleurs qu'il éprouve en se séparant de moi ; le vrai croyant a un caractère doux et facile. Est-il en votre pouvoir, pour soulager son cœur et dissiper ses alarmes, de me promettre que vous me le remettrez lorsque je le réclamerai, et de ne pas vous offenser de mes importunités ? Au nombre des traditions authentiques et dont la vérité repose sur des autorités respectables, est celle-ci : Dieu remettra les offenses à celui qui rompt un marché dont le vendeur se repent. »
Alhareth ben hammam dit : « La honte fit que je lui promis ce qu'il me demandait, mais j'avais d'autres vues au fond de mon cœur. » Alors il fit approcher de lui le jeune homme, le baisa entre les yeux et chanta.ces vers, les paupières inondées de larmes :
« Calme-toi, mon enfant. Puissé-je, aux dépens de ma vie, te préserver de la douleur et de, la crainte ! Mais j'espère de la bonté du Dieu Tout-Puissant et Créateur que le temps de la séparation ne durera point, et que les chameaux qui doivent nous porter au lieu de notre réunion, ne resteront pas longtemps inactifs, puis il ajouta : Je te confie au meilleur des protecteurs. »
Ensuite il releva le pan de sa robe et s'en alla. Quant au jeune homme, il ne fit que pleurer et soupirer pendant le tiers d'une lieue. Mais, lorsqu'il fut revenu à lui et qu'il eut arrêté le cours de ses larmes, il dit : « Sais-tu bien pourquoi j'ai pleuré et à quoi j'ai uniquement pensé ? » « Je crois, lui dis-je, que l’unique cause de tes larmes est d'être séparé de ton maître. » « Tu vois d'une façon, et moi je vois d'une autre, répondit-il. » « O quelle distance il y a entre celui qui désire et l'objet désiré ! » Et il chanta aussitôt ces vers :
« Ce n'est ni l'éloignement de mon compagnon, j'en prends Dieu à témoin, ni la perte de mes plaisirs, qui fait couler mes pleurs. Mes yeux ne se sont remplis de larmes qu'à cause d'un insensé que la folie de ses regards ambitieux a plongé dans un précipice où il n'a trouvé que fatigue et confusion, et qui a perdu ses dirhems d'une blancheur éblouissante. Que tu es à plaindre ! Ne les as-tu pas comprises ces paroles ingénieuses ? Je suis libre et il n'est pas permis de faire trafic de ma personne, attendu que dans le nom Joseph il y avait un sens qui est clair maintenant. »
Je m'imaginai d'abord qu'il n'avait tenu ce discours que pour rire et pour plaisanter. Mais il appuya, avec la fermeté d'un homme qui a raison, et ne voulut pas absolument devenir mon esclave. Nous nous disputâmes vivement. De la dispute nous en vînmes aux coups. Enfin nous prîmes le parti de porter notre affaire devant le Kady. Lorsque nous eûmes exposé le fait avec toutes ses circonstances, il dit : « Celui qui donne de sages conseils est excusé. Celui qui inspire une crainte salutaire vaut autant que celui qui apporte une bonne nouvelle. Celui qui décille les yeux ne manque en rien à son devoir, D'après tous les détails que vous m'avez donnés l'un et l'autre, je vois, Alhareth ben Hammam, que ce jeune homme a voulu vous tirer de votre erreur, et que vous avez continué à y rester plongé ; qu'il vous a donné de sages conseils, et que vous ne l'avez point écouté. Couvrez donc d'un voile l'infirmité de votre esprit malade, et ne vous en prenez qu'à vous-même, et non à ce jeune homme, de ce qui vous est arrivé. Gardez-vous bien de vous attacher à lui et d'en faire votre esclave, car il est libre et il ne doit pas être exposé en vente. Son père l'a amené hier, un peu avant le coucher du soleil, et il a avoué que ce jeune homme était son fils, qui l'avait élevé jusqu'à ce jour, et qu'il n'avait point d'autre héritier que lui. « Quoi, dis-je au Kady, vous connaissez donc son père ? Que Dieu le confonde ! » « Est-ce qu'Abou Zéid est inconnu, répliqua le Kady, lui qui blesse toujours impunément ? » « Il n'y aucun Kady qui n'en ait entendu parler et qui n'ait quelque trait à citer de lui. » Alors je fus enflammé de dépit et je prononçai la formule : En Dieu seul est la force et la puissance. Je revins de mon erreur, mais lorsqu'il n'était plus temps ; et je vis bien que le voile, dont il s'était couvert la moitié du visage, était le filet de sa perfidie, et que c'était là le plus ingénieux et le plus frappant de ses tours.[10]
La honte d'avoir été joué ainsi me fit baisser les yeux, et je jurai que je ne traiterais plus dorénavant avec quelqu'un qui aurait le visage voilé. Cependant je ne cessai de gémir sur la perte que je venais de faire, et sur le ridicule dont elle me couvrirait aux yeux de mes camarades. Lorsque le Kady eut vu la douleur cruelle qui me dévorait, il me dit : « Alhareth ben hammân, l'argent qui vous a valu un tel avis n'est pas perdu, et celui qui a tenté de vous tirer de votre assoupissement, n'est point coupable envers vous. Que le malheur vous instruise, cachez votre infortune à vos amis, et souvenez-vous toujours de ce qui vous est arrivé, afin de ne plus perdre votre argent. Imitez la conduite de ceux qui éprouvent le malheur, et qui néanmoins prennent patience, de-ceux qui s'instruisent par les exemples qui sont sous leurs yeux. »
Alhareth ben Hammam dit : « Alors je saluai le Kady, couvert du vêtement de la confusion et de la douleur, et traînant après moi la honte d'avoir été dupé et d'avoir conclu un marché si désavantageux. Je pris enfin le parti de rompre pour toujours avec Abou Zéid. Comme je m'éloignais de son habitation, voulant fuir sa présence, voilà qu'il se présente tout-à-coup devant mes yeux, dans un sentier étroit, et me donne un salut amical. Je ne fis rien autre chose que de lui montrer un visage refrogné, et je ne lui dis pas un seul mot. « Qu'as-tu ? dit-il, pourquoi cet air dédaigneux[11] envers ton ami ? » « Quoi ! lui dis-je, as-tu donc oublié ta perfidie et tes mensonges ? » Alors il me railla avec un rire malin, puis, comme pour raccommoder l'affaire, il me récita ces vers :
« O toi qui as montré une humeur sauvage et un visage refrogné, qui t'es armé de reproches plus déchirants que des traits et qui dis : Est-ce qu'un homme libre doit être vendu comme on vend un esclave ? arrête; je ne suis pas le premier qui ait fait une pareille action, comme tu te l'imagines. Les pères des tribus ont vendu avant moi Joseph, et c'étaient les pères des tribus ! Je le jure ! et par le temple de la Mecque, que visite celui qui voyage dans la province de Téhamath, et par ceux qui en font le tour, couverts de poussière et accablés de fatigue. Je ne me serais jamais porté à cette action ignominieuse, si j'avais possédé de l'argent. Excuse donc ton frère et abstiens toi de lui faire des reproches qui ne peuvent sortir que de la bouche d'un insensé. » Ensuite il ajouta : « Tu vois donc bien que mon excuse est claire et valable, et que les pièces d'argent sont perdues. Si tes traits ne se sont refrognés à mon égard, et si tu ne t'éloignes de moi, que par la crainte de prendre le reste de ton argent, sache que tu n'es pas de ceux que je puisse mordre deux fois, ni que je puisse faire marcher deux fois sur des charbons ardents. Si tu persistes à me faire mauvaise mine et à obéir à ton avarice pour arracher ce qui est tombé dans mes filets, eh bien ! que les pleureuses répandent des pleurs sur ton esprit. »
Alhareth ben Hammam dit : Il fit tant par son langage séducteur et par la magie de son éloquence entraînante, que je fus contraint de redevenir son ami sincère, et d'oublier le tour qu'il m'avait joué, quoiqu'il fut exécrable.
[1] Motarrézi observe que ces mots sont employés métaphoriquement pour signifier mourir. Un poète a dit : O, plût à Dieu que notre mère fut partie soit en paradis, soit en enfer. (C.-à-d. : Plut à Dieu que nous fussions débarrassés de notre mère d'une manière ou d'une autre). Antara a dît : le haut de mon pied fut en ce jour ma monture, ce qui signifie qu'il marcha à pied ce jour là.
[2] A la lettre : et la pluie n'était point venue après le tonnerre.
[3] Motarrézy dit que cela signifie : mesurer, prendre des dimensions, et couper pour raccommoder. Le sens de ces mots est donc que tous ceux qui prennent bien la mesure d'une chose ne l'exécutent pas pour cela, et que ceux qui commencent une chose ne la terminent pas toujours bien. Zohéir, de qui ces paroles sont prises, a dit : Toi tu raccommodes ce que tu as fait, et il est bien des gens qui ne réparent jamais ce qu'ils ont fait.
[4] Le texte signifie à la lettre : rien ne pourra mieux gratter ta peau que ton ongle. Ces paroles, dit Motarrézy, font allusion au proverbe, ma main seule peut bien gratter mon dos. Cela signifie qu'il faut renoncer à mettre sa confiance en qui que ce soit. Un poète a rendu cette pensée dans les vers suivants : Il n'est rien qui puisse mieux gratter ta peau que ton ongle ; gouverne donc toi seul toutes tes affaires.
[5] Le mot fétu me paraît être ici l'équivalent de ungula bianca ovis, bovis, qu'on lit dans le texte.
[6] C'est à dire, je suis libre. Abou Zéid rend ce jeune homme comme Joseph a été vendu par ses frères (Motarrézy)
[7] A la lettre : et il ne tourna point en rond où je tournai en rond, et ne s'attacha point à l'endroit où je m'étais attaché. Ces mots sont employés dans un autre sens que le sens propre. C'est une métaphore qui semble prise d'un oiseau vorace, qui, avant de fondre sur sa proie, décrit plusieurs cercles dans les airs. Il serait difficile de rendre ici cette figure en français.
[8] Motarrézy observe que Hariri fait ici allusion à ce vers du Hamaza : Que Dieu te préserve de tout malheur ! Secab est un objet très précieux ; il ne peut ni être prêté ni être vendu. Secab était un cheval qui appartenait à quelqu'un d'entre les Benou Témim. Un roi lui ayant demandé ce cheval, il le refusa en rapportant le vert susdit. On lit aussi dans le Hamaza : « Nous donnerions notre vie pour lui, tant il nous est cher ; nous aimons mieux supporter la faim plutôt que de la lui voir supporter. »
[9] C’est un hémistiche d'Ommiath ben aby Assalt.
[10] J'ai rendu par une idée analogue les mots que Motarrézy explique ainsi : expression proverbiale, pour signifier ce qui est étrange et merveilleux, et pour donner la préférence à une portion d'une chose sur tout le reste de cette même chose. On dit aussi : cette personne est la première de l'assemblée et le vers du poème (le vers principal, le vers d'effet.).
[11] A la lettre : Pourquoi lèves-tu le nez (c'est-à-dire, pourquoi prends-tu un air de hauteur ?) Les mots naso suspendis adunco, qu'Horace a employés dans la 6e satyre.