
Antar (Antara Ibn Chadded el'Absi,
عنترة بن شداد العبسي
Extraits des Mu'allaqāt (المعلقات)
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Extrait de : Caussin de Perceval, Essai sur l’Histoire des Arabes avant l’islamisme, t. II
Antara, vulgairement Antar, poète guerrier de la tribu d'Abs, l'un des héros de la guerre de Dâhis, et auteur d'une moàllaca, était, suivant l'opinion la plus générale, fils de Cheddâd, fils d'Amr, fils de Corâd, etc.[1] On l'appelait souvent, par forme de sobriquet, Antarat-el-feldjâ, Antara à la lèvre fendue. Sa mère était une esclave abyssinienne nommée Zebîbé ; elle avait eu, de son premier maître, avant d'appartenir à Cheddâd, des fils qui étaient noirs comme elle, et qui furent ainsi les frères utérins d'Antara.
Trois personnages célèbres parmi les Arabes païens ont été désignés sous la qualification de Ghorâb, au pluriel Aghriba, c'est-à-dire corbeaux, parce qu'ils étaient fils de négresses et noirs eux-mêmes. Le premier par rang d'âge est Antara; les deux autres sont Khofâf, fils d'Omayr, de la tribu de Soulaym, et Solayk, fils d'Omayr, de la tribu de Sàd, branche de Témîm.[2]
Chez les Arabes, avant l'islamisme, les fils nés d'un père libre et d'une mère esclave demeuraient esclaves ainsi que leur mère ; ils n'étaient avoués par leur père et affranchis de la servitude que s'ils venaient à se distinguer et à se faire un certain renom. Antara fut donc esclave dans sa jeunesse. Il gardait les chameaux de son père Cheddâd. Bientôt, ayant eu occasion de donner des preuves de sa force et de sa bravoure, il fut admis à faire partie des expéditions que les Abs entreprenaient contre d'autres tribus. Il pria alors Cheddâd de lui accorder la liberté, et de le reconnaître pour son fils. Cheddâd s'irrita de cette demande, refusa durement Antara, et le renvoya garder les troupeaux.
Quelque temps après, tandis qu'un grand nombre de cavaliers d'Abs étaient en campagne, leur camp, défendu seulement par la famille de Corâd et quelques autres, fut envahi par une troupe considérable d'ennemis. Dans ce pressant danger, Cheddâd fut obligé d'avoir recours à son fils. « A la charge, Antara ! lui dit-il. — L'esclave, répondit Antara, n'est point fait pour combattre; il n'est bon qu'à traire les chamelles et à soigner les petits. — A la charge ! répéta Cheddâd ; lu n'es plus esclave, tu es libre, tu es mon fils. » Antara n'eut pas plutôt entendu ces paroles, qu'il se précipita sur les assaillants. Il fit des prodiges de valeur, et anima si bien par son exemple les autres guerriers d'Abs, qu'ils mirent l'ennemi en déroute, et lui arrachèrent le butin qu'il avait enlevé.[3]
Désormais homme libre, Antara s'illustra par ses exploits et son talent poétique, sans cependant pouvoir faire oublier le vice de sa naissance, que l'envie lui reprochait souvent.
Un jour les Abs, sous la conduite du prince Cays, fils de Zohayr, ayant attaqué les Bènou-Témîm, furent repoussés et poursuivis par leurs adversaires. Antara couvrit la retraite de ses compagnons, qui, sans lui, auraient été taillés en pièces. Cays dit à ce sujet : « Nous devons notre salut au fils de la négresse. » Cette expression méprisante fut rapportée à Antara. L'indignation qu'il en conçut lui inspira une cacîda dans laquelle, en faisant son propre éloge, il lance d'une manière indirecte quelques sarcasmes contre Cays. C'est dans cette pièce qu'il dit :
« La moitié de ma personne est du plus pur sang de la tribu d'Abs; l'autre moitié, j'ai mon sabre pour la faire respecter.
« Quand nos guerriers en péril faiblissent et se regardent stupéfaits, alors on trouve que je vaux mieux que ceux dont les oncles paternels et maternels sont de haute et noble lignée. »
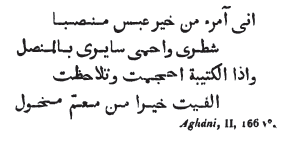
Les aventures d'Antara ont fourni matière à un roman très volumineux et très-intéressant, aujourd'hui si populaire en Syrie et en Egypte, qu'on voit des hommes qualifiés d’Antari (au pluriel Anâtira), dont la profession est d'en lire ou réciter des fragments dans les lieux publics.[4] Cet ouvrage offre une peinture fidèle de la vie des Arabes du désert, dont les mœurs semblent n'avoir reçu du laps des temps presque aucune altération. Leur hospitalité, leurs vengeances, leurs amours, leur libéralité, leur ardeur pour le pillage, leur goût naturel pour la poésie, tout y est décrit avec vérité. L'auteur, Sayyid Youcef,[5] fils d'Ismaïl, a fait entrer dans son cadre les principaux faits et les personnages les plus marquants de l'histoire arabe pendant le siècle où est né Mahomet ; il a emprunté la plupart des matériaux qu'il a mis en œuvre à des écrivains versés dans les traditions des anciens âges, tels qu'Asmaï et Abou-Obayda, et il a orné ce fond d'une multitude de détails et d'épisodes tirés de sa propre imagination ; il a fait, en un mot, une sorte de roman historique.
A défaut de sources plus authentiques de renseignements sur la vie d'Antara, on peut puiser dans ce roman les notions suivantes, qui paraissent mériter confiance, parce qu'elles sont confirmées par divers passages des poésies du héros d'Abs, notamment de sa moàllaca.
Antara était amoureux de sa cousine Abla, fille de Malik, frère de Cheddâd. Par d'importants services rendus à Malik et à son fils Amr, il leur avait arraché la promesse de lui donner Abla en mariage. Mais Malik et Amr détestaient Antara; et, pour se soustraire à une alliance avec le fils d'une esclave, alliance qu'ils regardaient comme un déshonneur, ils mirent à l'accomplissement de leur promesse une condition qui entraîna Antara dans une entreprise périlleuse, où ils espéraient qu'il trouverait la mort. Antara triompha de tous les dangers, et remplit la condition qui lui était imposée. Malik, n'ayant plus alors de prétexte pour éluder sa parole, prit la fuite avec toute sa famille, et alla s'établir loin de la tribu d'Abs. Il éprouva ensuite des malheurs, reçut de nouveaux services d'Antara, et, vaincu par les bienfaits du généreux guerrier, il finit par lui accorder la main de sa fille.
Antara s'était signalé dans la guerre de Dâhis. Il parle dans ses vers de la journée de Dhou-l-Moray-kib, où il tua Dhamdham, et du combat de Forouk. Ses poésies ont été réunies en un diwân ou recueil, dont la bibliographie de Hadji Khalifa fait mention.
Il mourut dans un âge assez avancé, probablement plusieurs années après la fin de la guerre de Dâhis et la naissance de l'islamisme. On raconte diversement sa mort. La version qui est appuyée sur le plus grand nombre de témoignages, et que l'auteur du roman a aussi adoptée, mais en y joignant des circonstances de son invention, est qu'il fut tué d'un coup de flèche par un Arabe de la tribu de Nebhân, branche de Tay, nommé Wizr, fils de Djâbir, et surnommé El-Açad-errahîsy le lion à la patte blessée.
Ibn-el-Kelbi, Mofaddhal, Ibn-el-Arabi et autres rapporteurs de traditions, s'accordent à dire qu'Antara, étant allé faire une incursion sur le territoire des Bènou-Nebhân, leur enleva quelques chameaux, et s'en revint chassant devant lui sa capture. Mais Wizr était à l'affût sur son passage ; il lui lança une flèche en criant : « A toi ! c'est de la main du fils de Selma. » Le trait brisa les reins d'Antara, qui, malgré la douleur du coup, eut encore la force d'arriver à sa tribu; et, quoique blessé à mort, il adressa ces vers aux Abs :
« C'est au fils de Selma, sachez-le, que vous avez à demander compte de mon sang. Mais comment atteindriez-vous le fils de Selma ? comment pourriez-vous me venger ?
« Au milieu des monts de Tay, de ces monts élevés touchant aux Pléiades, il est en sûreté contre toute attaque. » [6]
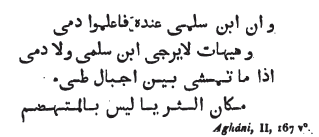
Le sang d'Antara resta en effet sans vengeance, et Wizr, fils de Djâbir, vécut jusqu'à l'époque où les descendants de Tay se firent musulmans. Il était un des députés envoyés, vers 639 de J. C, par les Bènou-Tay à Mahomet, pour lui faire leur soumission.[7]
On prétend que la haute renommée d'Antara inspira au fondateur de l'islamisme le regret de ne l'avoir pas connu, et l'on cite de Mahomet cette parole : « Le guerrier bédouin que sa réputation m'eût fait le « plus désirer de voir, c'est Antara.[8] »
Les poètes ont-ils laissé quelque sujet à chanter?... Mais n'ai-je pas reconnu les lieux qu'habitait ma maîtresse? mes doutes ne sont-ils pas dissipés ?
Salut, demeure d'Abla dans la vallée de Djiwa! Demeure chérie, parle-moi de l'objet que j'aime.
J'ai arrêté ma chamelle, semblable à une tour par la hauteur de sa stature, afin de soulager mon cœur en me livrant à loisir à mes regrets.
Oui, c'est ici qu'Abla faisait son séjour, tandis que nous occupions Hasn, Sammân, et Hotethallem.
Salut, restes d'une habitation depuis longtemps abandonnée, et que le départ d'Oumm-el-Haytham (Abla) a changée en une affreuse solitude!
O fille de Makhrim (Malik), tu résides maintenant sur une terre ennemie : combien il m'est difficile de parvenir jusqu'à toi!
Le hasard d'un instant a donné naissance à l'amour que je ressens pour elle, moi qui fais aujourd'hui la guerre a sa famille; et je nourrirais une flatteuse espérance! Non, Abla, par les jours de ton père! l'espérance n'est pas faite pour moi.
La place que tu occuperas toujours dans mon cœur, garde-toi d'en douter, sera celle d'un objet respecté, adoré.
Mais ta présence, comment pourrais-je en jouir, quand ta famille est établie aux Oneyza, et la mienne à Ghaylam ?
Abla avait résolu de s'éloigner : on prépara les montures dans l'ombre de la nuit.
Quelle fut ma surprise, ma douleur, lorsqu'au malin j'a-perçus au milieu des habitations, broutant les graines dit khimkhim, les chamelles destinées à porter le bagage,
parmi lesquelles on compte quarante-deux mères qui donnent un lait abondant, et se distinguent par une couleur pareille aux plus noires des plumes de l'aile du corbeau !
Quelle fut ma douleur, à moi qu'Abla tient prisonnier par l'éclatante blancheur de ses dents légèrement crénelées, par la beauté de ses lèvres, sur lesquelles le baiser est si doux et si suave !
Avant que la bouche ait effleuré ces lèvres charmantes, on respire son haleine embaumée, dont le parfum est comme celui que le musc exhale d'un vase où il est conservé.
Telle encore est l'odeur des fleurs que les rosées du ciel ont fait croître dans une prairie dont jamais les troupeaux n'approchent, qui n'est pas souillée par le passage des animaux;
une prairie souvent arrosée par des nuées chargées d'une onde pure, qui rendent les petites cavités dans lesquelles l'eau repose semblables à autant de pièces d'argent;
où chaque soir, régulièrement, la terre est humectée d'une pluie bienfaisante;
où la mouche, vivant en paix, fait entendre un murmure de plaisir comme le joyeux buveur qui fredonne,
et frotte en même temps ses pattes l'une contre l'autre, imitant le mouvement d'un homme dont les mains sont mutilées, et qui s'efforce de faire tourner rapidement entre ses poignets une baguette sèche dans l'entaillure d'un autre morceau de bois, pour allumer du feu.
Le soir et le matin, Abla est mollement étendue sur des coussins de duvet ; et moi je passe la nuit sur mon cheval noir, toujours bridé.
Mon lit, c'est la selle de mon coursier, qui a les jambes solides, les flancs pleins, la partie du corps qu'entourent les sangles large et profonde.
Qui me conduira à la demeure d'Abla ? Sera-ce cette robuste chamelle de Chadan condamnée à n'avoir point de lait, frappée de stérilité?
Elle a marché toute la nuit, et cependant elle agite gaiement la queue; son allure est fière; elle ébranle le sol, qu'elle bat d'un pied également ferme et agile.
(Elle poursuit sa route durant la journée entière), et le soir encore elle foule la terre avec la même vigueur. Telle est la course du mâle de l'autruche, qui n'a point d'oreilles, dont les jambes sont peu écartées.
Autour de lui se pressent ses petits, ainsi que de jeunes chameaux du Yaman autour d'un pasteur éthiopien, dont la langue ne forme que des sons confus.
Les petits suivent comme une enseigne la tête de leur père ; ils cheminent sous ses ailes étendues, semblables aux porteurs d'un brancard funèbre, sur lesquels retombent les draps mortuaires.
Au bout d'un col mince s'élève la petite tête du guide. Chaque soir il va visiter les œufs de sa femelle, déposés à Dhou-l-Ochayra. Il est pareil à l'esclave noir qui a les oreilles coupées, et qui est velu d'une longue pelisse.
Ma chamelle s'est désaltérée dans l'étang de Dohroudhâni, et au matin elle était déjà loin des eaux d'un pays ennemi.
(Quand on la touche avec le fouet), elle fait des écarts à gauche, comme si elle voulait éviter un chat terrible qui sur le soir fait retentir l'air de ses miaulements.
Il semble que chaque fois qu'elle se retourne avec colère contre l'animal redoutable qui est à côté d'elle, celui-ci se défend en lui déchirant la peau avec ses dents et ses griffes.
Lorsqu'elle se couche enfin pour se reposer auprès de Ridâ (on entend craquer ses membres fatigués), on croirait qu'elle s'étend sur des roseaux secs qui se brisent avec bruit sous son poids.
Tel que le jus de dattes ou le goudron épais, bouillonnant sur le feu, se répand sur les parois du vase,
ainsi découle la sueur de la tête de ma chamelle aux yeux farouches, qui est aussi robuste, aussi fringante que l'étalon le plus vigoureux.
O Abla, tu baisses ton voile pour dérober ton visage à ma vue. (Pourquoi me dédaigner ?) Ne suis-je pas celui qui sait triompher des guerriers couverts d'armures ?
Tu peux louer en moi des qualités que tu n'ignores pas. Mon caractère est doux et facile avec quiconque est juste a mon égard.
Mais si l'on veut m'opprimer, je deviens moi-même un dur oppresseur; j'abreuve mon ennemi d'humiliations plus amères que les sucs de la coloquinte.
Souvent, lorsque la fraîcheur du soir vient calmer les ardeurs du jour, je bois un vin délicieux, acheté au prix d'un brillant métal marqué d'une empreinte.
Je porte à mes lèvres une coupe de cristal d'un jaune éclatant, artistement taillée, tandis que ma main gauche tient un vase d'argent dont le goulot est fermé d'une toile fine, pour ne verser dans la coupe qu'une liqueur limpide.
Quand je suis animé par les fumées du vin, je me ruine en prodigalités; mais ma gloire reste entière, je ne me laisse emporter à aucune action qui puisse lui donner atteinte.
Lorsque la raison reprend sur moi son empire, ma libéralité n'en souffre pas de diminution. Mes sentiments, tu le sais, Abla, sont nobles et généreux.
Bien des fois j'ai fait mordre la poussière à l'époux d'une jeune beauté, après lui avoir ouvert au-dessous de l'épaule une blessure pareille à une bouche dont la lèvre supérieure est fendue.
Ma main, en le perçant d'un coup prompt et mortel, a fait ruisseler son sang en flots de pourpre.
Fille de Malik, interroge les guerriers, si mes exploits te sont inconnus.
Je suis toujours placé sur la selle d'un puissant cheval, rapide à la course, portant les cicatrices de mille blessures.
Tantôt je le pousse hors des rangs pour combattre un ennemi; tantôt je reviens vers la troupe nombreuse de mes compagnons les redoutables archers.
Ils te diront, ceux qui m'ont vu à la guerre, qu'autant j'ai d'ardeur à affronter le péril, autant je montre de désintéressement quand il s'agit de partager le butin.
Souvent j'ai attaqué un cavalier armé de toutes pièces,
contre lequel les plus courageux n'osaient se mesurer, qui n'était pas homme à fuir ou à se rendre.
Bientôt je lui ai porté un coup terrible avec une lance droite, faite d'un roseau noueux et dur.
Le fer impitoyable a percé son armure et son corps : le fer ne respecte pas le brave.
Je l'ai laissé étendu sur la terre, pour servir de pâture aux bêtes féroces, qui l'ont déchiré, et ont dévoré ses belles mains et ses beaux bras.
Mon sabre s'est frayé un passage à travers la cotte de mailles large et serrée d'un guerrier qui savait défendre sa famille et ses amis, qui s'ornait à la guerre des marques distinctives de la vaillance;
dont la main était prompte à mêler les flèches du hasard, pendant la froide saison; qui vidait les tonneaux des marchands et faisait tomber leurs enseignes;[9] qui ne s'attirait de blâme que par l'excès de sa libéralité.
Lorsqu'il m'a vu descendre de mon coursier, et m'avancer vers lui pour achever de lui donner la mort, un mouvement de lèvres, qui n'était pas un sourire, a mis ses dents à découvert.
Alors je l'ai frappé de ma lance, et je lui ai déchargé un dernier coup de mon glaive tranchant, dont la trempe est excellente.
Au milieu du jour il gisait sur la poussière ; sa tête et ses mains, sur lesquelles le sang était figé, semblaient noircies avec la teinture extraite de l'izhlam.
C'était un guerrier de haute stature ; ses vêtements paraissaient envelopper un grand arbre plutôt qu'un homme; il ne faisait usage pour chaussure que du cuir le mieux préparé, et n'avait point eu de frère jumeau.
O beauté douce comme la brebis, heureux celui qui pourra te posséder ! Ce bonheur m'est interdit ; plût au ciel que je pusse y prétendre!
J'ai envoyé vers Abla une esclave, à laquelle j'ai dit : « Va, épie les nouvelles, informe-toi de ce que fait ma maîtresse. »
L'esclave m'a dit à son retour : « Les ennemis ne sont point sur leurs gardes ; le chasseur peut approcher de la brebis. »
Lorsque ma maîtresse tourne la tête, son col a la grâce et la souplesse de celui de la jeune gazelle blanche.
Je sais qu'Amr est ingrat envers moi : l'ingratitude dégoûte de la bienfaisance.
J'ai exécuté les ordres de mon oncle. Dans ces moments de lutte acharnée où l'on grince des dents, j'ai combattu
au plus fort de la mêlée et des dangers que les braves affrontent sans proférer de plaintes, en poussant des cris belliqueux.
Lorsque mes compagnons, me laissant seul en avant, se sont fait de moi un rempart contre les lances, je n'ai point faibli; je suis resté inébranlable : mais j'avais en face trop d'adversaires pour pouvoir gagner du terrain.
Quand enfin j'ai vu nos gens, s'excitant les uns les autres, s'avancer en masse pour me soutenir, alors je me suis précipité sur l'ennemi avec ardeur.
De tous côtés on criait : « Antara ! » et les lances, semblables à de longues cordes à puits, se plongeaient dans le corps de mon coursier noir.
Il renversait avec son poitrail tout ce qui se présentait à lui, et bientôt il était couvert comme d'une housse de sang.
Atteint de mille coups, il a tourné vers moi un œil humide de larmes, et a poussé un faible hennissement.
S'il eût pu exprimer ses souffrances par des paroles, il se serait plaint douloureusement.
Cependant les juments, les chevaux, aux formes allongées, au poil fin, s'agitent avec fureur dans la mêlée, et enfoncent leurs pieds dans la molle arène.
J'oublie ton les mes peines, je reprends une force nouvelle, quand j'entends ces mots dans la bouche des guerriers : « Courage, Antara ! avance toujours ! »
En quelque lieu que je désire me transporter, mes chamelles dociles m'y conduisent. Pour accomplir les desseins
que je forme, je n'ai pas besoin d'autre aide que de mon esprit, fertile en ressources.
Mon unique crainte est de cesser de vivre avant que les chances de la guerre m'aient fourni l'occasion de punir les fils de Dhamdham,
qui attaquent mon honneur, tandis que je ne les outrage point; qui, loin de ma présence, jurent de verser mon sang.
Leur haine, au reste, ne doit point m'étonner, puisque j'ai arraché la vie à leur père, et l'ai rendu la proie des bêtes féroces et des vautours.
Traduction de W. Mac Guckin de Slane
Selon quelques généalogistes arabes, le poète Antara fut fils d'Amr, fils de Cheddâd. D'autres disent que son père se nommait Cheddâd, fils d'Amr. Amr eut pour père Moawia, lequel fut fils de Karâd, fils de Makhzoum, fils de. ... Abs, fils de Baghîd, fils de Moder. Antara fut aussi nommé Antarat al-Faldjâ, sobriquet qui lui fut donné à cause de ses lèvres fendues. Il reçut plus tard le surnom de corbeau, à cause de la couleur foncée de sa peau. Il eut pour mère une esclave abyssinienne nommée Zébiba, et il fut lui-même tenu pour esclave, bien que né d'un père de condition libre; car dans ces temps-là les Arabes ne reconnaissaient pas leurs enfants nés de mères esclaves, à moins qu'ils ne se lissent remarquer par leurs talents et leur bravoure. Ce fut dans une expédition entreprise par la tribu d'Abs contre celle de Thaï qu'Antara fut déclaré libre et qu'il obtint les droits de tribu. Les cavaliers absites venaient d'enlever les troupeaux de l'ennemi, et ils s'étaient mis à se les partager. Antara, en ayant réclamé sa part, eut la douleur de voir repousser sa demande à cause de sa qualité d'esclave. Pendant la discussion à laquelle cet incident donna lieu, les Thaîites eurent le temps de se rallier et de revenir à l'attaque. Antara, justement piqué de la conduite de ses compagnons, se tint à l'écart, et refusa de combattre de nouveau; « Allez, dit-il; vous êtes en nombre égal à l'ennemi, c'est votre affaire. Les Absites, privés du secours de leur meilleur combattant, furent forcés de fuir en abandonnant aux Thaîites les troupeaux qu'ils venaient de leur enlever. Ce fut dans ce moment que Cheddâd appela son fils au secours de sa tribu : « A la charge, Antara, s'écria-t-il. — L'esclave, reprit Antara, n'est pas fait pour charger l'ennemi ; il n'est bon qu'à traire des chamelles et à en sevrer les petits. — A la charge, répéta son père, tu es libre; l'esclave et toi sont deux.
Antara n'eut pas plutôt entendu ces paroles qu'il se précipita sur les ennemis, les mit en déroute et revint avec les troupeaux qu'ils avaient repris. Désormais homme libre, la gloire et le soutien de sa tribu, Antara vit tous les jours grandir sa réputation; à l'esprit guerrier il réunissait l'amour de la poésie; même au milieu des combats il exprimait en vers les sentiments qui l'animaient, et au retour de ses expéditions il récitait à la tribu assemblée quelques-uns de ces poèmes qui ont contribué à rendre son nom immortel. Dans plusieurs de ses version on retrouve des traits qui décèlent son amour pour la belle Abla, sa cousine; il nous manque, malheureusement, les détails de l'histoire de son amour; car le récit qu'on en trouve dans le roman d'Antar ne paraît pas mériter cette confiance qu'on n'accorde qu'aux documents authentiques. La vie de notre poète se passait donc entre l'amour, la poésie et les combats; sa renommée s'était répandue dans toute l'Arabie, et après sa mort, qui n'arriva que tard, le nom d'Antara était dans toutes les bouches. Mahomet lui-même ne fut pas insensible à tant de mérite; nous apprenons par une tradition que le prophète, en entendant un vers de ce poète, s'écria : « Je n'ai jamais entendu parler d'un homme du désert que j'eusse envie de voir, excepté Antara » ; et c'est peut-être cette parole qui a contribué plus que tout le reste à conserver le souvenir du cavalier absite. Dans un de ses poèmes, Antara dit : « Ce ne sont pas les travaux de la guerre qui ont diminué mes forces, mais bien la longueur du temps que j'ai vécu. »
Nous avons ici une preuve que notre poète atteignit un âge avancé, mais il nous reste des incertitudes sur la cause de sa mort. Le récit qu'en donne le roman d'Antar ne mérite aucune confiance, comme l'a bien senti M. Fresnel, et il ne nous reste sur cet événement que les trois traditions contradictoires recueillies par l'auteur du Kitab el-Aghani, et traduites par M. Fresnel dans le Journal asiatique du mois de février dernier.
Les Bènou-Abs, conduits par Kaïs, fils de Zohaïr, avaient attaqué les Bènou-Temîm; mais ils furent repoussés et poursuivis par leurs adversaires, quand Antara s'arrêta pour couvrir la retraite de sa tribu. Une troupe de cavaliers vint se joindre à lui; et ils réussirent à arrêter l'ennemi. Kaïs, dont la jalousie fut excitée par la conduite d'Antara dans cette journée, dit, au retour de l'expédition : « Il n'y a que le fils de la négresse qui ait protégé notre peuple », voulant par ces paroles rappeler la bassesse de la naissance d'Antara. Or Kaïs était grand mangeur; Antara donc, ayant appris ce que Kaïs avait dit, récita les vers suivants, dans lesquels, en paraissant faire son propre éloge, il fait indirectement la satire de l'homme qui l'avait insulté.
Je me suis arrêté longtemps auprès des traces du camp abandonné qui se trouve entre Al-lakik et Zat Al-harmal.
Tout éperdu, je restai dans ces parages et j'interrogeai sans cesse[10] ces demeures désertes, dans le vain espoir d'apprendre le sort de ma maîtresse.
Les légers zéphyrs, changés depuis en orages, ont fait de ces ruines leur jouet ; les vents y ont amoncelé les sables, et les sombres nuages, trônant à leur suite les arènes, ont passé sans relâche sur ces lieux!
Sont-ce donc les gémissements de la colombe dans le bocage, ô Antarat qui font couler si abondamment tes larmes, qui mouillent jusqu'à ton baudrier,
Et qui tombent comme des perles ou comme les grains d'un collier dont les fils mal attachés viennent de se rompre?
Longtemps je demeurai ainsi, plongé dans mes rêveries; mais, aux cris de Morra, d'Abs et de Mohallel, dans le tumulte du combat,
J'ai fait appel à la tribu d'Abs, qui m'a répondu en brandissant ses lances et ses glaires tranchants, qui n'étaient pas devenus minces à force d'être polis.[11]
Prompte à satisfaire mes désirs, ma tribu a fait main basse sur la famille d'Anf, en chargeant sur elle avec l'épée.et la lance flexible. —
La moitié de mon sang est tout ce qu'il y a de plus pur dans la tribu d'Abs; l'autre moitié, je soutiens sa noblesse avec la pointe de mon glaive.[12]
Si ma tribu est atteinte par l’ennemi, je fais tourner mon coursier pour revenir à l'attaque ; si elle en est entourée, je me précipite à la charge; et si elle est dans un défilé, je mets pied à terre pour mieux la défendre ;
Car c'est le combat corps à corps qui est le seul but de mes efforts, ce combat où l'homme égaré et frappé de terreur cherche son salut dans la fuite.
Combien de nuits et de jours ai-je enduré une faim dévorante, pour obtenir,-au prix de ces souffrances, une noble proie!
Lorsque notre escadron recule et que nos cavaliers se regardent indécis, alors on découvre que je suis plus noble que celui qui met sa gloire dans une nombreuse et illustre parenté.
Ils le savent bien les coursiers, et leurs cavaliers aussi savent que j'ai dispersé leurs rangs en les frappant avec une lance qui sépare l’âme du corps!
Quand mes cavaliers, dans la retraite, traversent un défilé, je ne cours pas me mettre à la tête des fuyards; et c'est alors seulement que je ne me charge pas de conduire l’avant-garde.
Au jour de combat je me place, dès le matin, devant l'étendard du chef favorisé par la victoire, et ce jour-là ce n'est pas sans armes que je me présente. —
Dès le lever de l'aurore une amie importune a cherché à me retenir et à m'inspirer la crainte de la mort; — elle paraissait penser que je pouvais trouver un abri contre les coups des destins ;
Et je lui répondis: « La mort est un abreuvoir, et je dois un jour boire dans la coupe avec laquelle on y puise.
« Respecte-toi, malheureuse ! et sache que je suis homme; ainsi, bien que le glaive m'épargne, la mort m'attend. » —
Si la forme humaine pouvait être revêtue par les destins, ce serait la mienne qu'ils prendraient, tel que je parais quand mes ennemis descendent pour habiter une bien étroite demeure,[13]
Quand les cavaliers sont pâles de figure et que leurs traits contractés par l'effroi feraient croire qu'ils ont bu une décoction de coloquinte.
Lorsque je me jette dans une affaire qui ferait reculer les plus hardis, je ne dis jamais après l'avoir entreprise. Plût au ciel que je ne m'en fusse pas mêlé!
Le poème suivant fut improvisé par Antara en apprenant la mort de Malik, fils de Zohaïr, tué dans la guerre de Dâhis et Ghabrâ, sur laquelle on peut consulter l'article de M. Fresnel dans le Journal asiatique du mois d'avril 1837.
Non, jamais mortel ne verra un second chef tel que Malik devenir victime de la perfidie de certaines gens, et cela parce que deux chevaux sont entrés en lice !
Plût au ciel qu'ils n'eussent jamais parcouru ensemble la moitié d'une portée de flèche! Plût au ciel qu'ils n'eussent jamais été lancés à la course pour décider un pari!
Plût au ciel qu'ils fussent tous deux morts auparavant dans quelque pays éloigné, et que Kaïs les eût perdus pour ne jamais les revoir !
Voilà qu'ils nous ont attiré le malheur et une guerre désastreuse, dans laquelle un chef de la race de Ghatafàn a trouvé la mort !
Un chef, héros du combat, qui soutenait noblement les droits de sa famille, el qui, chaque fois qu'il revenait à la charge, tranchait les mains à ses ennemis !
Il est à regretter qu'aucun des deux manuscrits ne donne de renseignements sur la circonstance à l'occasion de laquelle ce poème fut composé. Le silence des scoliastes est d'autant plus à regretter que ce morceau, dans lequel on reconnaît de la facilité et de l'élégance, paraît avoir été fort apprécié par les littérateurs arabes, qui en ont souvent cité des vers dans leurs ouvrages.
Souvent j'ai enveloppé un escadron ennemi d'un escadron aux armes étincelantes à l'aspect sombre, portant partout l'horrible trépas,
Marchant en silence, faisant briller les instruments de la mort : ainsi reluit le feu dont l'ardeur embrase ce qui l'alimente.
Dans cette troupe on voit des braves, fils de braves; — et quand les lances brisées dans la mêlée embarrassent les pieds des chevaux,
Les armes jettent à l'entour un éclat que la poussière du combat ne voile pas; telle paraît, en domptant les ténèbres, la lueur des torches entre les mains des voyageurs.[14]
Ces cavaliers, supportant avec patience les fatigues, ont toujours prêts des chevaux au poil lisse, aux pieds agiles, des coursiers de pur sang, aux flancs minces et au ventre rétréci.
Ces coursiers, le cou tendu, le front plissé, s'élancent avec leurs cavaliers armés de toutes pièces ; ils s’élancent bien que harassés d'une marche fatigante et souffrant des pieds dont la route a usé la corne;
Ils portent de jeunes braves experts à frapper avec la lance, inébranlables même quand l'étendard de la guerre est entraîner au loin dans une retraite précipitée;.
Des cavaliers beaux à voir, illustres, impétueux, hardis combattants au moment où le cœur manque aux lâches.
Combien de fois ai-je réveillé la nuit, une bande, d'amis aux fronts altiers, dont les têtes se penchaient sous l'influence du sommeil,
Pour me mettre en route avec eux, les menant à travers les épaisses ténèbres jusqu'à ce que je vis se passer la période de la matinée dans laquelle le soleil darde ses premiers rayons.
Avant que l'ardeur du midi ne se fût fait sentir, je rencontrai une troupe de cavalerie et je perçai de ma lance le premier cavalier de son avant-garde ;
Je frappai le chef sur chaque côté de la tête[15] et il tomba à terre ; je poussai mon coursier jeune et vigoureux au milieu de la troupe ennemie, et il la traversa;
Combattant ainsi jusqu'à ce que je vis changée en rouge la noirceur de la peau de nos montures, teintes qu'elles étaient par le sang de leurs blessures.
Les chevaux de l'ennemi, emportés par une fuite rapide, trébuchent dans une mare de sang et foulent aux pieds les morts tombés dans l'acharnement du combat.
Ensuite je revins triomphant avec la tête de leur chef que je jetai là pour servir de pâture au premier animal qui viendrait à la rencontrer.
Jamais, dans aucun lieu, je n'ai recherché une femme sans avoir d'avance remis la dot entière à celui qui lui servait de patron.[16]
Jamais je n'ai consumé le bien de l'homme d'honneur sans mettre en réserve chez moi, pour le lui rendre, le double de ce que j'en ai pris.
C'est seulement en présence des maris que j'entre chez les femmes de notre tribu ; si le mari est parti pour la guerre, je n'entre pas.
Quand la femme étrangère qui est confiée à ma protection s'offre à mes regards, je baisse les yeux jusqu'à ce qu'elle nous cache ses charmes en se retirant dans sa tente.
Je suis d'un naturel facile, d'un caractère noble; je ne laisse pas mon âme s'opiniâtrer à suivre ses passions.
Demande à Abla, elle te dira que je ne veux d'autre femme qu'elle;
Si elle m'invite à entreprendre une affaire sérieuse, je réponds à son appel, je la protège contre tout mal et je m'abstiens de lui en faire éprouver.
[1] On peut voir deux notices sur Antara dans le Journal asiatique (mai 1838, p. 445 et suiv. ; décembre 1840, p. 516 et suiv.). La première est de M. de Slane ; la seconde, de M. Perron; celle-ci est la traduction complète de l'article consacré à Antara par l'auteur de l’Aghani, vol. II, f. 165 v° et suiv.
[2] Il sera question plus loin de Khofaf; mais comme je n'aurai pas dans la suite l'occasion de mentionner Solayk, j'en dirai ici quelques mots.
Solayk appartenait à la famille de Moucaïs. Il est communément appelé Solayk, fils de Solaca, du nom de sa mère. C'était un poète guerrier, et de plus un coureur que les chevaux ne pouvaient atteindre. On cite, parmi ses contemporains, quatre autres coureurs de la même force : ce sont Chanfara, Teabbata-Charran, Amr, fils de Barrak, et Nofayl, fils de Boraca (voyez sur Chanfara et Teabbata-Charran, Chrestomathie de M. de Sacy, II, 337-340; Schultens, Mon. ant. hist. ar., p. 49; Fresnel, Première lettre, p. 92-114). Solayk était un des Saàlik-el-Arab, c. à d., des guerriers pauvres qui vivaient de brigandages et d'expéditions aventureuses. Il n'attaquait jamais les descendants de Modhar, et dirigeait toujours ses entreprises, soit contre la race de Rabîa, soit surtout contre les populations du Yémen, telles que les tribus de Khatham et de Mourad. Pendant la saison des pluies, il remplissait d'eau des œufs d'autruche, et les enterrait dans les déserts ; il savait ensuite les retrouver pendant l'été, lorsqu'il allait faire des expéditions lointaines. Dans une de ses incursions contre les Mourad, il vainquit et fit prisonnier Cays, fils d'Abd-Yaghouth, fils de Mekchouh, personnage que l'on verra figurer dans les derniers livres de cet ouvrage. Dans une autre incursion contre les Khatham, Solayk fut tué par un guerrier de cette tribu, nommé Açad (ou Anas), fils de Moudrik (Aghani, IV, 186 v°-189; Ibn-Nobâta, ap. Rasmussen, Addit. ad hist. ar., p. 25, 26). Sa mort doit avoir précédé de très peu de temps la conversion à l'islamisme de ses contribules les Bènou-Témim, en l'année 630 de J. C.
[3] Aghani, II, 166.
[4] Il existe à la Bibliothèque royale de Paris un exemplaire de cet ouvrage en dix volumes in-fol. J'en ai un en 34 vol. in-4° ; M. Reinaud en possède un autre parfaitement complet.
[5] Son nom ne se trouve que dans l'exemplaire de M. Reinaud.
[6] Aghani, II, 167 v°.
[7] Nowaïri, Nihâyat-el-arab.
[8] Aghani, ii, 167.
[9] Les marchands arabes, lorsqu'ils avaient du vin à vendre, l'annonçaient en plantant devant leur tente un drapeau pour servir d'enseigne. Ils enlevaient ensuite ce drapeau quand ils avaient débité tout leur vin.
[10] Le commentateur explique jLd<Xg par JLwo et par ii)Js>. Ainsi le dernier hémistiche peut signifier : comme fait celui qui n'est pas guéri de son amour.
[11] Mais bien à force de frapper les ennemis.
[12] Le poète fait ici allusion à sa naissance.
[13] C'est-à-dire le tombeau.
[14] Pour éviter une périphrase, j'ai rendu ce mot par voyageurs ; mais ce mot signifie ceux qui cherchent à se procurer du feu, comme les voyageurs dans le désert à l'approche de la nuit. Voyez le Coran, sour. xx, vers. 10.j
[15] A la lettre j'ai frappé leur bouc sur les deux cornes.
[16] Il s'agit ici des femmes qui se trouvent sous la protection d'une tribu qui n'est pas la leur. A cause de leur qualité d'étrangères, il était rare qu'elles fussent traitées avec beaucoup de respect. Notre poète a donc agi avec honneur et générosité eu assignant une dot à la femme étrangère qu'il voulait épouser. Dans une pareille circonstance, beaucoup de compatriotes d'Antara auraient enlevé la femme, sans qu'il fût question ni de dot ni de mariage.
