
ANONYME
LE ROMAN D'ANTAR
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Extrait du Causeur, 1860.
Traduit de l’arabe par L. Marcel Toyrac
Le roi Zohaïr, parti pour une razzia avec la plupart des cavaliers Absiens, n'avait laissé au camp que trois cents guerriers, parmi lesquels étaient les Bènou-Qarad. Les Bènou-Thay profitent de son absence pour faire une attaque contre les Bénou-Abs.
**********************
Les Bènou-Thay arrivaient comme un torrent et se répandaient comme les ténèbres de la nuit. Les Bènou-Abs les reçurent à la pointe des lances. La lutte fut acharnée, les cris retentirent, les corps gémirent sous les blessures douloureuses, la terre trembla sous les sabots des coursiers, et la poussière voila la lumière du matin. Les Bènou-Abs se virent accablés par le nombre, écrasés par la multitude. Ils perdirent courage, et reculèrent jusqu'à la limite du camp, refoulés par la lance et le sabre. Ils tournèrent le dos et ne doutèrent plus de leur perte. Le massacre continua parmi les cordes des tentes, les chevaux foulaient les cadavres des jeunes hommes et des vieillards. En ce moment les jeunes filles sortirent des tentes, les cheveux épars, les vêtements déchiras, criant contre les guerriers et les poussant au combat. Mais les cavaliers étaient sourds à leurs cris. Et le corbeau croassa sur leurs demeures et annonça leur destruction !
Cependant Malik, père d'Abla, dit à Cheddâd : Malheur à toi, mon frère ! Où est ton esclave Antar, et pourquoi n'est-il pas avec nous, en ce jour funeste?
— Mon frère, dit Cheddâd, je l'ai tellement maltraité que je n'ose plus lever la tête devant lui.
En disant ces mots, il se ce tourna et aperçut Antar qui faisait paître les chameaux au sommet d'une colline et observait le combat. Cheddâd piqua vers lui son cheval et monta la colline, suivi de son frère Malik.
— Malheur à toi, esclave du mal ! cria-t-il à son fils. Est-ce aujourd'hui le jour de faire paître les chamelles et de te mettre à l'écart des Bènou-Abs, quand déjà les enfants et les femmes ont été faits prisonniers et que les ennemis ont envahi les tentes?
— Maître, répondit Antar, je souffre de ce qui vous arrive, et plût à Dieu que je pusse être votre rançon ! Mais je ne suis qu'un esclave. Je n'ai ni rang ni valeur. Celui à qui j'appartiendrai m'emmènera avec son butin, je le servirai lui et sa famille, je mènerai ses chameaux au pâturage, et je battrai le lait pour en séparer la crème et le beurre.
Il dit, et laissant la son père et son oncle, il poussa devant lui les brebis et les chamelles. Mais Cheddâd lut cria : Malheur à toi, lâche avili ! Est-ce ainsi que tu réponds à tes maîtres?
— Que veux-tu de moi? dit Antar. Demande-t-on secours aux esclaves, et laisse-t-on les nobles seigneurs, pour qui les esclaves ne sont que des chiens? Va mon maître, va t'adresser aux nobles, fiers de leur généalogie, habitués à pointer la lance et à manier le sabre.
— Je sais, dit Cheddâd, que ton cœur est irrité contre moi, à cause de ma conduite à ton égard. Mais va, monte à cheval, prends les armes, et tu atteindras aujourd'hui le but de tes désirs. Cours au combat, charge les ennemis et dès ce jour tu es libre.
— Non, dit Antar, je ne monterai plus à cheval, je ne combattrai plus. Je ne compte plus au nombre des guerriers, et je ne cesserai de marcher derrière le chameaux, pour éviter les propos à mon sujet.
Cheddâd reprit avec insistance : Combats aujourd'hui, et je te ferai entrer dans ma noblesse, et je t'associerai dans ma généalogie.
— Qu'est-ce que la noblesse et la généalogie? dit Antar.
— Fils de la maudite! cria Cheddâd, je confesserai que tu es mon fils, et que tu es sorti de mes reins.
Et Malik à son tour: Fils de mon frère, dit-il, va, sauve ma famille des calamités descendues sur elle. Abla et toutes les femmes sont captives, et toi, tu les avais accoutumées à compter sur ton secours.
— Maître, répondit Antar, pourquoi ne pas l'adresser à Amara le Magnifique? N’est-il pas le fiancé d'Abla? Prie-le qu'il la sauve de cette calamité.
Tandis qu'Antar, son père et son oncle échangeaient ces propos, les cavaliers du Yémen s'étaient rués sur les tentes; ils en faisaient sortir les belles filles, massacraient les braves et pillaient les habitations des Bènou-Qarad. Abla, les femmes et les vierges étaient entre leurs mains. Et de toutes parts on entendait ces cris : ô malheur ! ô calamité ! o désespoir ! Elles poussaient de longs gémissements, Abla se lamentait, prisonnier d'un cavalier terrible et valeureux, nommé Souar : emportée en croupe derrière lui, elle souffletait ses propres joues qui se teignaient de sang.
A ce spectacle, Malik ne put retenir ses larmes. O Père des cavaliers, dit-il ! vois la bien-aimée Abla, captive entre les mains des ennemis, toi qui l'avais accoutumée au respect et à la protection.
Lorsqu’Antar le vit s'humilier devant lui et l'implorer, il répondit: Si à l'instant je charge l'ennemi, si je combats pour l'amour de ta fille et la sauve, me la donneras-tu en mariage?
— Oui, dit Malik. J'en jure par celui qui l'a créée, qui a étendu la terre et élevé les cieux; si tu sauves Abla, je serai ton serviteur et ma fille sera ton esclave.
A ces mots, le frère d'Antar, Chéiboub, lui amena son cheval Abjer et lui dit : monte à l'instant, mon frère, combats généreusement, et ne refuse plus l'aide de ton bras, puisque tu as atteint le but de ton désir.
Là-dessus, le fils de Cheddâd exigea le serment de son père et de son oncle. Il leur fit jurer par le Créateur Unique qu'ils ne seraient à son égard ni traîtres ni hypocrites. Ensuite il s'approcha d'Abjer dont il baisa le front, revêtit son armure, se mit en selle, arracha sa lance de terre et se rua de la colline sur les ennemis comme l'aigle rapace.
Il atteignit le cavalier qui emmenait Abla et déjà sortait du camp. Abla gémissait comme la colombe de la vallée. Antar pointa sa lance et frappa le ravisseur au roté gauche; la pointe sortit étincelante au côté droit, Snuar fut renversé et demeura gisant sur la face de la terre. Antar calma tes terreurs de la jeune fille, la remit aux mains de son père Malik, et revenant aux escadrons ennemis, il fondit sur eux comme un torrent, désarçonna les cavaliers, massacra les braves et chassa les ennemis des tentes. Chéiboub tournait autour de lui, protégeant Abjer et lançant des flèches dont il atteignait les combattants.
Cependant les Bènou-Abs avaient repris courage à la vue d'Antar. Alors apparurent les terreurs et les longues vies furent abrégées. Antar poussait des cris effroyables qui ébranlaient les montagnes; à ces cris, les chevaux reculaient et jetaient leurs cavaliers à terre. Il aperçut le chef des Bènou-Thay; c'était le cavalier du temps et le héros de l'époque. Antar courut à lui, l'atteignit au milieu du champ de bataille et le frappa d'un coup de lance. L'arme traversa la cuirasse de fer, et le chef renversé tomba de la selle comme une tour.
Quand les Bènou-Thaï virent la mort de leur chef et les coups de lance d'Antar plus rapides que les destins, la frayeur les saisit, ils remirent les sabres aux fourreaux et prirent la fuite, regagnant leurs demeures.
Journal Asiatique, janvier-juin 1845
Episode[1] du roman d'Antar, traduit de l'arabe en français
par J. A. Cherbonneau.
Il arriva qu'un jour, Hârith, fils du roi Zohaïr,[2] étant parti pour la chasse en compagnie de quelques Absites,[3] s'éloigna de la terre de Charabbah.[4] Entraîné par l'ardeur du plaisir, il parcourut en tous sens les plaines rases du désert et les vastes solitudes. Enfin, il entra dans une vallée que l'on appelait Oaudy-en-Nouk,[5] où campait une nombreuse famille de la tribu de Zohrân. Le jeune prince s'adressa à un esclave et lui demanda qui il était. — « Seigneur, répondit celui-ci, nous sommes de la tribu des Bènou-Zohrân, et notre chef est Békir, fils de Mo'tamad.
Le chroniqueur poursuit:[6] Or, tandis qu'ils conversaient, une gazelle vint à passer en fuyant à toutes jambes. Aussitôt Hârith piqua des deux et s'élança à la poursuite de l'animal. La rapidité die sa course l'emporta jusqu'aux bords d'un lac où se trouvait réuni un groupe de femmes de la tribu dont on vient de parler. Voici comment s'explique leur absence du campement.[7]
L'émir Békir avait une fille nommée Labna, plus belle que la pleine lune. Ses adorateurs étaient nombreux, et elle avait été plus d'une fois demandée en mariage. Parmi les prétendants se distinguait son cousin Djérir-ben-Kadim, qui, malgré sa valeur dans les combats et sa supériorité sur les preux de son temps, s'était rendu odieux à Labna à cause de ses manières rudes et grossières. Un jour, il vint trouver l’émir, et lui témoigna le désir d'épouser sa fille ; mais il fut éconduit par un refus. Alors la désunion se mit entre eux, et les choses en vinrent au point qu'on dut se transporter auprès du roi Zohaïr pour invoquer son intervention. Le suzerain assura sa protection aux deux parties.
Donc, au moment où Hârith parcourait les bords du lac à la tête des chasseurs, Labna était entourée de ses compagnes. Ils se virent et s'aimèrent. Le prince, en s’éloignant, sentit s'allumer dans ses veines le feu de la passion, et laissa l'objet de son amour en proie à un trouble difficile à décrire. Alors la noble damoiselle, émue jusqu'au fond de l’âme, récita ce chant.
Vers. Plût à Dieu que mes yeux se fussent détournés de ce gentil chevalier qui passa près de moi en poursuivant la timide gazelle!
« Il est parti ; mais les charmes de sa personne ont captivé ma raison. Il a disparu; mais mon cœur est devenu sa proie.[8]
Le chroniqueur dit : Lorsque Hârith eut entendu ces douces plaintes, il rejoignit ses amis, et gagna la terre de Charabbah sans pouvoir maîtriser son transport amoureux. Sa mère s'approcha de lui : « Cher fils, dit-elle, d'où te vient aujourd'hui cette sombre mélancolie? — O ma mère! répondit le prince, j'ai souffert toute la nuit; mais la cause de mon chagrin n'est connue que de celui qui pénètre nos secrets. » A peine l'épouse de Zohaïr s’était-elle retirée, que Hârith fit appeler sa nourrice, et l'informa de son aventure. Touchée de son malheur, la fidèle confidente lui promit aide et assistance. En même temps elle partit pour la vallée des Chamelles, Ouady-en Nouk, où, parvenue à l'enceinte des tentes, elle pénétra jusqu'au pavillon des femmes sous le prétexte d'une visite. Là, s'approchant de Labna, elle engagea la conversation, sans négliger toutefois de lui faire connaître la passion de Hârith. — « Je désire, ajouta-t-elle, que vous vous rendiez demain, dès le matin, près du lac. » Labna se confondit en remerciements, et la vieille regagna en toute hâte la demeure de son maître, qui l'attendait avec la plus vive inquiétude. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé, parla de l'amour de Labna et du désir qu'elle avait témoigné de le revoir. Ce récit calma les angoisses du prince.
Au déclin du jour, il se mit en route avec sa fidèle nourrice. Quand ils eurent atteint la vallée, ils se cachèrent dans un massif d'arak.[9] De son côté, Labna brûlait d'impatience. Dès que le soir fut venu, elle se dirigea, en compagnie d'une de ses suivantes, vers les bords du lac, où elle aperçut Hârith, et se jeta dans ses bras. Les deux amants restèrent ensemble jusqu'au point du jour, et le bosquet témoin de leurs premiers entretiens devint le lieu de rendez-vous plus délicieux. Chaque nuit ils étaient près l'un de l'autre; chaque matin, ils se séparaient pour aller, dans leur famille, rêver à leur bonheur.
Un soir que le fils de Zohaïr, monté sur son destrier, entrait dans la vallée des Chamelles, il ne vit pas une trace de la tribu de Zohrân. Toutes les tentes avaient disparu. Il resta consterné et comme anéanti, puis retourna vers son habitation plus pâle qu'un spectre vivant.
Le chroniqueur ajoute : La cause de ce départ soudain, c'était l'arrivée d'un message de leur roi Al-Achath-ben-Dharmé, qui, indigné de la défection de Békir, lui adressait d'amers reproches. Il avait appris que l'émir s'était retiré avec toute sa famille sur le territoire des enfants d'Abs et d'Adnan[10] : c'est pourquoi il lui envoya dire que, pour lui donner satisfaction, il s'était saisi de la personne de Djérir-ben-Kadim, et qu'il l'invitait, lui, à rentrer dans sa patrie. A cette nouvelle, le père de Labna plia ses tentes, et se mit en marche avant le lever de l'aurore.
Le chroniqueur dit encore : D'un autre côté, quand Hârith eut fixé son départ, il mit Chéiboub[11] au courant de tout ce qui était arrivé et de sa situation actuelle. Chéiboub fut saisi de pitié. Ils attendirent donc la chute du jour. Alors Hârith sella son cheval, et, selon son habitude, endossa son armure et son corselet ; Chéiboub prit son arc et son carquois, et se munit d'une provision de flèches. Tous deux partirent pour la tribu de Zohrân. A leur arrivée, Chéiboub conseilla à son compagnon de rester caché dans un endroit, et prit lui-même la direction des tentes, sous le costume d'un mendiant infirme. Jouant son rôle avec, adresse, il parvint au pavillon du père de Labna. « Femme, dit-il à une vieille, avez-vous quelque nourriture à me donner? — Oui, répondit-elle, mais attends. » Puis elle sortit un instant, et revint en disant : « Tiens, affamé, prends ces lupins, et fais des vœux en faveur de la dame que je sers. Peut-être que tes prières seront exaucées. — Etes-vous étrangère dans ce pays? demanda Chéiboub. — Non, dit-elle ; mais ma maîtresse a un amant dans la tribu d'Abs, et elle brûle du désir de le voir. — N'est-ce pas le prince Hârith, fils du roi Zohaïr? — C'est lui qu'elle aime, et je vois que tu le connais. — Sans doute, puisqu'il est mon maître. »
Alors Chéiboub raconta toute l'aventure jusqu'à l'arrivée de Hârith. — « Eh bien! dit la vieille, laisse-le dans l'endroit où il se tient ; car l'émir Békir a résolu d'unir sa fille au seigneur Khéita'our, qui a déjà même envoyé le don nuptial. Encore trois jours, et nous verrons célébrer le mariage. » En achevant ces mots, la servante courut rejoindre Labna, et lui fit part de sa conversation avec le mendiant. « Retourne vers lui, dit celle-ci, et engage-le à se rendre au plus vite auprès de son maître. Qu'il sache que mon intention est de partir et de fuir avec lui.[12] »
Aux approches de la nuit, la fille de Békir, profitant du repos de la tribu, alla trouver Chéiboub. Une chamelle portait ses effets les plus précieux. « Conduis cette chamelle vers ton maître, dit-elle. » Celui-ci prit les devants; Labna le suivait. Enfin ils arrivèrent auprès du fils de Zohaïr. « Venez avec nous, dit Chéiboub. » Hârith monta sur son palefroi et Labna sur sa chamelle, dont le fidèle écuyer tenait la bride. C'est dans cet équipage qu'ils traversèrent les déserts.[13]
Le lendemain, à l'aube naissante, Békir et sa femme cherchèrent Labna, mais en vain. Ils l'appelèrent à grands cris, mais leurs voix se perdirent sans réponse. Alors on avertit le seigneur Khéita'our, qui sauta sur son cheval, prit avec lui un détachement d’hommes d'armes, et s'informa de l'événement auprès du père de sa fiancée. « Seigneur, lui dit l'émir, à mon retour de la tribu d'Abs, j'ai appris que Hârith, fils du roi Zohaïr, s'était épris de ma fille. — Par la foi d'un Arabe, s'écria Khéita'our, j'aurai atteint le ravisseur avant le coucher du soleil, et je l'exterminerai, lui et toute la race des Absites. » En conséquence, il aposta des troupes en différents endroits, et partit à la tête de cinq cents guerriers vigoureux.
Quant aux trois personnages qui avaient pris la fuite, Chéiboub, Hârith et Labna, profitant de l'obscurité de la nuit, ils firent route jusqu'à la vallée des Gazelles (Ouady-ez-Zîba), que domine le pic des Précipices (Djebel-es-Senâmir). Cette montagne, d'une élévation prodigieuse, n'était accessible que par un chemin. Arrivés dans la plaine, ils se disposaient à mettre pied à terre, lorsque tout à coup dix noirs, s'élançant des hauteurs voisines, fondirent sur eux avec l'impétuosité du torrent.[14] A leur tête, on remarquait un chef terrible comme un lion. Ces noirs étaient des meurtriers, qui avaient cherché dans la montagne un refuge et l'impunité. Quand on les poursuivait de trop près, ils se retiraient sur les cimes escarpées, d'où ils se défendaient en désespérés. Celui qui commandait la bande était Hâbis. A peine eurent ils aperçu les voyageurs, qu'ils se jetèrent sur eux, dans l'espoir que le cavalier prendrait la fuite et les laisserait libres d'égorger son compagnon, de faire main-basse sur les chameaux et le butin, et d’enlever la damoiselle. Mais ils ignoraient que l'homme qui marchait à pied était un feu dévorant et un foudre de guerre.[15] En effet, dès que Chéiboub les vit descendre des pentes escarpées avec l'élan de la course, il s'avança intrépidement à leur rencontre, et ajustant leur chef, il lui décocha une flèche qui le perça de part en part.
A cet aspect les noirs, transportés de fureur, se ruèrent sur Chéiboub. Alors Hârith arriva près de lui à plein galop; mais une flèche traversa le poitrail de son coursier et l'abattit sur le sable. Sans perdre de temps, le fils de Zohaïr se relève et se place derrière son écuyer, qui déployait toutes les ressources de sa valeur. Ses traits volaient et renversaient les ennemis les uns après les autres, jusqu'à ce que six d'entre eux eurent avalé la coupe du trépas. Les quatre qui restaient firent d'amères réflexions. « Je ne puis pas penser, dit l'un d'eux, que ce personnage soit un fils d'Adam. Ce doit être un diable de la contrée. Notre chef avait coutume de dire qu'il avait vu un Ghoul[16] dans la plaine, et nous le plaisantions toujours sur ses visions. — Ne parle plus de cela, dit un autre. Sauvons-nous en hâte sur le sommet de la montagne. »
Et ils disparurent.
Mais ils s'aperçurent bientôt que Chéiboub les avait devancés à l'entrée du défilé. « Lâches Arabes. leur cria-t-il d'une voix tonnante, espérez-vous m'échapper? Je suis maître de votre vie. » Déjà il avait percé le premier d'un trait sûr et s'élançait sur le second, qu'il frappa au cœur d'un coup de cimeterre. Mais les deux autres s'enfuirent à travers les vastes solitudes. Alors Chéiboub revint auprès de Hârith, qui le félicita de ses prouesses. « O fils du vent,[17] lui dit-il, me voilà réduit à parcourir à pied ce désert, et la route est longue ! »
Asmay dit: Mais un autre danger les attendait; car, tandis qu'ils parlaient, un gros de cavalerie apparut tout à coup dans le lointain. En tête s'avançait Khéita'our, semblable à une tour imprenable ou à une roche détachée du flanc de la montagne. Le père de Labna se tenait à ses côtés. » A cette vue la jeune fille se sentit défaillir. « Notre mort est certaine, dit Hârith. Le seul asile qui nous reste, c'est le pic, dont ces mécréants avaient fait leur repaire. Sur la cime, nous serons en sûreté. — Puisqu'il en est ainsi, dit Chéiboub, je place devant moi mon carquois, et je vais vous montrer mon savoir-faire. Maintenant, dût l'univers entier vous attaquer, j'oserai vous défendre contre tout l'univers. Cette armée, que vous voyez, je veux la disperser comme le vent disperse la poussière. Ne demandons de secours qu'au Seigneur qui veille sur le puits de Zemzem[18] et sur les saintes reliques. — Comme il te plaira, dit-il Hârith. Mais comment parviendrons-nous à cette élévation prodigieuse? Qui sait si nos forces ne seront point paralysées par la crainte — Comptez sur le succès, reprit Chéiboub. » En même temps il prit Labna sur ses épaules, et, chargé de ce précieux fardeau, il gagna le pied de la montagne, qu'il gravit jusqu'au sommet.
Le chroniqueur dit : Le prince Hârith le suivait. Cependant le père de Labna, ainsi que ses compagnons, ne pouvaient revenir de leur étonnement envoyant Chéiboub escalader ces hauteurs escarpées avec la légèreté de l'oiseau. Ils s'élancent à sa poursuite, et, en un instant, Hârith, dont la marche était ralentie par le poids de son armure, est atteint par l'ennemi. Il cherche à se défendre et veut vendre chèrement sa vie; mais la foule l'environne. Enfin il cède au nombre.et demeure prisonnier. La douleur de Chéiboub fut au comble. Alors les hommes d'armes se rangent dans la plaine et montent à l’assaut, les uns après les autres, espérant atteindre l’écuyer et la fille de Békir. Mais Chéiboub les accabla de flèches jusqu'aux approches de la nuit, qui les obligea à retourner au camp, déçus dans leur attente. Plusieurs d'entre eux étaient blessés. Sur ces entrefaites, Khéita'our et l'émir éprouvèrent un moment d'hésitation et s'arrêtèrent dans la crainte des flèches de Chéiboub. — « En vérité, dit le premier, nous sommes complètement déroutés par ce diable. Au point du jour, faisons goûter à Hârith l'amertume de la punition et de la torture, puis nous le pendrons, et nous dirons à son compagnon : Si tu ne veux pas nous rendre la fille de notre chef, Hârith subira le dernier supplice, et la tombe deviendra sa demeure. Nous t'assiégerons sans relâche, nous te prendrons et nous arracherons de tes flancs le souffle qui t'anime. » Aussitôt on garrotte le fils de Zohaïr et il est confié à la garde de deux esclaves noirs. En proie à la plus profonde affliction, le captif se laissa tomber sur la terre. Cependant Chéiboub retourna auprès de Labna rassurer son cœur alarmé en lui jurant qu'il sacrifierait ses jours pour la sauver et la mettre hors de danger; puis il demeura en repos jusqu'au moment où il fut persuadé que le sommeil s'était emparé des ennemis. Alors il descend en se laissant glisser sur le dos et arrive au bas de la montagne. Là, ayant recours à la ruse, il observe à droite et à gauche les postes avancés. Partout régnaient le calme et le silence. Persuadé que les noirs sont endormis, il s'approche, les égorge tous, et, poursuivant son hardi projet, se traîne sur les pieds et sur les mains dans l'intervalle des tentes. Tout à coup il entend Hârith soupirer cette plaintive élégie :
Vers. — O guerriers de ma tribu, je suis entravé par les liens de la captivité, et l'espoir du salut m'abandonne,
« Venez à mon secours avant la fin du jour. Si vous tardez, ma vie sera tranchée par leurs glaives acérés.
« O ma cousine[19] ! à peine m'étais-je réjoui de notre réunion que nous voilà séparés à jamais !
« La fortune m'a frappé d'un trait mortel, et contre ses coups, hélas ! il n'y a point de remède.
« Après mon trépas, ô mes cousins, réclamez le prix de mon sang,[20] vous tous qui volez au combat sur des coursiers de noble race. Annoncez à Antar, fils de Cheddâd, que je ne puis me soustraire à la fureur des ennemis.
« Antar sait vaincre à lui seul une armée quand il lève son cimeterre protecteur, et c'est lui qu'implorent tous les amants.
« Hélas! Après ma mort, que deviendra Labna? Combien de douleurs déchirent son âme depuis que nous sommes séparés !
« Mon rêve chéri, c'était de vivre ensemble dans une heureuse sécurité et de calmer notre flamme amoureuse.
« Et voilà que le sort nous a violemment séparés. Ah ! la fortune est inconstante; on ne doit point compter sur la fortune.[21]
Asmay dit : A ce triste récit, Chéiboub sent son cœur ému. Il s'avance, coupe les liens du captif et l'emmène. Tous deux ne cessèrent pas de marcher à travers les hommes endormis, jusqu'à ce qu'ils furent sortis du camp. Arrivés à la montagne, ils gagnèrent promptement le sommet. En revoyant son cher amant, Labna félicita Chéiboub du succès de son entreprise. Un repas fut préparé, et quelques heures de repos aidèrent les trois aventuriers à rétablir leurs forces.
Le premier soin de Khéita'our, à son réveil, fut de chercher Hârith ; mais ce fut peine inutile. Il ne trouva que ses liens brisés, ses gardes égorgés et nageant dans leur sang.[22] « Misérables, cria-t-il à ses hommes d'armes, voyez ce prisonnier était fortement garrotté, et une seule personne est venue le délivrer au milieu de vous.[23] C'est le même brigand qui a tué hier vos plus braves guerriers. A présent, comment vous défendrez-vous? comment protégerez-vous votre chef? Est-ce là tout votre savoir-faire? » Déjà il voulait les mettre à mort; mais le père de Labna l'en empêcha. « Ces hommes, dit-il, sont innocents. C'est nous qui avons eu tort de ne pas aposter des sentinelles sur le flanc de la montagne. Jamais nous ne réussirons à nous emparer de l'ennemi, si nous ne montons tous à l'assaut en corps d'armée, et si nous n'exterminons ce mauvais génie[24] qui a couché sur le sable cinquante de nos guerriers. Nous serons un exemple de malheur pour la postérité. » L'avis est adopté. Ils partent donc à la tête de leurs troupes et ordonnent l'assaut. Aussitôt les braves s'élancent, les hourras retentissent;[25] mais leurs cœurs sont glacés d'épouvante. Dès que Chéiboub vit cette manœuvre, il remplit son carquois de flèches, tend son arc, met un genou en terre, et lance la mort sur les plus avancés, qui tombent comme des feuilles.[26]
Hârith quitte Labna et fait rouler des quartiers de rocher sur les assaillants. En peu d'instants, plus de cinquante d'entre eux furent immolés. Alors Khéita'our recula, il se frappait la poitrine, grinçait des dents avec une fureur impuissante, Maintenant, disait-il, la tribu de Zohrân est déshonorée aux yeux de la nation. Par la foi d'un Arabe ! j'aimerais mieux avoir affaire à mille cavaliers rangés en bataille que de combattre ce diable terrible. »
Le chroniqueur dit : Puis se tournant vers ses hommes d’armes, il leur ordonna de redoubler de vigueur dans la lutte. Ils continuèrent, dans cet état, jusqu'à ce que la nuit eût laissé tomber les plis de son manteau.[27] Ce jour-là Chéiboub avait épuisé toutes ses flèches, tant il avait tué de soldats et de chefs. Khéita'our mit six hommes en embuscade dans les ravins, avec ordre de se tenir cachés derrière les rochers. Le désespoir le porta même à menacer de la mort quiconque se laisserait aller au sommeil. « Je me tiendrai dans le voisinage, dit-il; car je suis convaincu que cet être maudit a vidé son carquois. Cependant, loin de renoncer à son projet, il est homme à descendre à l'heure du repos, pour vous dérober vos flèches. Tenez-vous donc sur vos gardes; épiez-le, et, dès qu'il descendra, emparez-vous de sa personne. Malheur à vous ! s'il vous échappe, je vous mets tous à mort. Il dépasse les vents en vitesse et pas un seul de nos coursiers ne pourrait l'atteindre.[28] » Tandis qu'il prenait ces mesures, que dictait la prudence, Chéiboub attendait la nuit dans une anxiété terrible. A peine le soleil avait-il disparu derrière les collines, qu'il se leva, courut jusqu'au bas de la montagne d'un seul élan. Mais, tandis qu'il reprenait baleine, les éclaireurs apostés sur son chemin se jetèrent sur lui et l'environnèrent de toutes parts.[29] Sans perdre courage, Chéiboub bondit comme un lion, et, mettant l'épée à la main, fit des prodiges de valeur. Vains efforts ! car il fallut céder au nombre. Il tomba prisonnier entre leurs mains. Aussitôt Khéita'our est prévenu. Déjà les cavaliers sont sur pied et se portent, à la lueur des flambeaux, vers le lieu du combat. « Te voilà pris enfin, maudit génie, dit Khéit'aour, » et il ordonna qu'on le chargeât de liens. Puis le père de Labna se dirigea, à la tête des troupes, vers la montagne.
Hârith vit cette manœuvre et comprit son malheur. Alors, saisissant son épée, il se bat en désespéré. Il abat sous ses coups dix noirs et fait mordre la poussière à deux chefs arabes. A la fin le nombre triompha; on le fit prisonnier, on lia étroitement ses membres épuisés. L'émir Békir s'avança vers sa fille, qui était plus tremblante qu'un roseau, la saisit par les cheveux et la traîna jusqu'au fond de la vallée. Dans sa fureur, il l'aurait immolée, sans les instances de Khéita'our. Sa petite armée se tint en cet endroit jusqu'au lendemain. Alors on attacha Hârith au dos d'un cheval ; une longue corde fut passée autour du cou de Chéiboub, et un esclave le traîna. Le malheureux endura d'abord patiemment ce supplice; mais, étant parvenu jusqu'à son bourreau, il lui assena dans l'estomac un coup de poing qui l'éventra. Ainsi délivré, Chéiboub s'élança à travers la plaine, et tous les soldats partirent au galop ; toutefois, en le poursuivant, ils avaient la précaution de se serrer les uns contre les autres Jusqu'à ce qu'une bande de voleurs qui emmenaient les chevaux d'Antar[30] se précipita sur eux. Après les avoir taillés en pièces et avoir pris leurs chevaux, Khéita'our et ses compagnons retournèrent à la poursuite du prisonnier évadé. Tout à coup ils se trouvent face à face avec Antar. A peine le fils de Kérim l'a-t-il aperçu, qu'il se dispose à l'attaquer, lance son cheval au galop, et fait une charge impétueuse en récitant ce chant de défi :
Vers. Seigneur au noir coursier, seigneur au glaive tranchant et à la lance acérée,
« Si tu as immolé quelqu'un de nos cavaliers, souviens-toi que la fortune trahit quelquefois le héros invincible.[31]
« Quand elle offre à un mortel la coupe des délices, elle le trompe, parce qu'elle ne lui donne à boire qu'une amère infusion de coloquinte.[32]
« Que les hauts faits que tu as vus te servent de leçon, et apprends que mon glaive est invincible dans les révolutions de la fortune.[33]
« Dans toutes les contrées j'ai laisse aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie une mer de sang versée par mon épée.
« Quand je suis dans la mêlée un jour de combat, j'extermine tous les héros formidables ;
« Et même, lorsque j'effectue ma retraite, l'ennemi tremble d'effroi. Alors on pourrait voir l'univers se rétrécir dans la circonférence d'un dirhem.[34]
« Cherche donc un subterfuge pour te dérober à mes coups ; car l'aveu de notre impuissance peut apaiser le plus mortel ressentiment.
Asmaï continue : Les bravades de Khéita'our arrachèrent à Antar un sourire de pitié. Il répondit en ces termes :
« Oui, tu l'as dit, j'ai égorgé les compagnons et j'ai laissé leurs cadavres en pâture aux monstres du désert ;
« Car ma lance est altérée de sang. Enfin voilà le jour où elle doit s'abreuver de carnage.[35]
« Eh quoi! ne connais tu pas ma puissance? Cependant, les héros de la Perse[36] ont baissé pavillon devant moi ;
« Et personne n'ignore que, dans les jours <¥encontre, les preux chevaliers meurent d'épouvante au seul récit de mes exploits et de ma gloire.[37]
« La nuit, quand je parcours l'immensité des déserts, je n'ai d'autre société que mon épée, inévitable comme le destin.[38]
« Jamais elle ne sort du fourreau sans faire couler une mer de sang.
« Mon cheval porte au front une étoile pareille à l'aube du jour, et sa robe luisante dépasse en noirceur le plumage du corbeau. Tels sont mes deux alliés sur le champ de bataille. Le fer de ma lance reluit comme la peau du serpent.
« A combien de batailles n'ai-je pas assisté ! Combien de preux vantés n'ai-je pas livrés comme pâture aux lions et aux vautours séculaires[39] !
Asmaï continue : A peine Antar eut-il récité son chant de guerre, que, faisant retentir l'air de cris sauvages, il courut sur le fils de Kérim, déjà glacé d'épouvante. Sans lui donner le temps de reprendre courage, il le perce de sa lance et retend mort à ses pieds. A cet aspect, les cavaliers de Zohrân fondent de toutes parts sur le vainqueur: qui, la lance en avant, qui, l'épée haute; tous animés d'une égale fureur. Antar a su les prévenir: il fait un bond terrible et s'enfonce dans leurs rangs comme un torrent de flammes. En moins d'un instant, quarante des plus audacieux ont avalé la coupe du néant. Le reste cherche son salut dans la fuite et tache de se rallier à Békir. Alors, maître de la victoire, Antar retourne vers son frère Chéiboub. La colère éclate encore dans ses yeux. Dans ce moment, Orwah et ses compagnons arrivèrent. Leur surprise était grande, et ils avaient peine à modérer leur joie à la vue des chevaux enlevés à l'ennemi. « O père des cavaliers, cria Orwah, à qui avez-vous enlevé ce butin? » Alors Antar raconta les aventures de Chéiboub et la captivité du prince Hârith. A cette nouvelle, les Absites descendent de leurs chameaux, sautent sur les coursiers encore ensanglantés, et courent fêter Chéiboub.
Le chroniqueur dit. Quant aux compagnons de Khéita'our, ils s'étaient débandés et erraient dans le désert, lorsqu'ils aperçurent Békir, fils de Mo'tamad. Ils lui apprirent la mort de leur chef et le massacre de leurs frères d'armes. « Quel est donc, leur cria l'émir, ce guerrier dont le bras redoutable les a tous terrassés ? — C'est un chevalier noir, répondirent-ils ; le cheval noir et à poil ras qui lui sert de monture semble avoir été taillé dans un bloc de marbre noir. Dans sa main étincelle un glaive indien. Tandis qu'il faisait un horrible carnage des enfants de Zohrân, nous l'avons entendu crier : « Arrière, hommes sans courage ! je suis Antar, fils de Cheddâd ! »
A ces mots, le père de Labna se sentit transporté de fureur : « Que Dieu maudisse vos pères entre les hommes, dit-il ! Honte et malheur à vous! »
Un seul cavalier vous a mis en fuite[40] ; et ce n'est qu'un esclave noir[41] sans force et sans puissance. » Alors un des guerriers s'avança et lui dit : « Apprenez que ce cavalier dont mes compagnons vous ont fait la description est un héros capable de résister à mille cavaliers dans la plaine. » Ces paroles ne firent que redoubler la rage de Békir, et il s'écria : « Que signifie ce discours ? Et quand donc a-t-on vu un cavalier fondre seul sur une armée nombreuse ? Reviens avec moi au combat, afin que je te fasse voir mes exploits. » En même temps il donna à ses soldats le signal du départ, et les chevaux furent lancés en avant ; quand, soudain, on vit à l'horizon s'élever un tourbillon de poussière,[42] d'où sortaient mille cris répétés. C'étaient les Bènou-Abs.
Alors se présenta devant Békir un homme qu'on appelait Djifal. Il dit : « Mon avis, ô mon maître, est que tu me laisses partir à travers les vallées, à la tête de dix cavaliers. J'emmènerai dans notre pays ta fille et le prince. De ton coté, tu marcheras contre Antar, avec le reste de l'armée. — Eh bien donc, dit l'émir, prends avec toi les hommes que tu voudras et fais hâte. »
Djifal obéit sans retard et se dirigea vers l'endroit où les deux amants avaient été abandonnés ; mais il ne trouva d'eux ni trace, ni nouvelle. Ils avaient disparu. Se tournant donc vers ses satellites : « Notre espoir est déçu, s'écria-t-il, et Labna nous échappe sans retour ! » Ces mots à peine achevés, la troupe se préparait à continuer sa marche, lorsque les airs retentirent de clameurs effrayantes. Ils se retournèrent pour en connaître la cause, et aperçurent une horde de cavaliers arabes qui fuyaient en désordre. Derrière eux se précipitaient, avec l'impétuosité du destin, les enfants d'Abs et d'Adnan. Plus prompt que l'éclair, Djifal frappa la croupe de son cheval et tourna bride vers son pays et vers la terre de ses aïeux. Ses compagnons le suivirent. Ils ne cessèrent de fendre l'espace, jusqu'à ce que la nuit eût lâché les pans de sa robe. En ce moment, l'émir Antar fit volte-face, avec les guerriers d'Abs et d'Adnan. « O père du blanc, dit-il, en s'adressant à Orwah, fils d'Ouerd, que penses-tu de cette journée? L'ennemi est en pleine déroute. Notre espérance est accomplie et nos vœux exaucés; mais Hârith et Labna demeurent encore prisonniers et gémissent dans les fers. Je ne puis m’empêcher de craindre que les Bènou-Zohrân ne les aient menés sur leur territoire. Une fois entre les mains d'Al-Achâth, le fils de Zohaïr est perdu. Sa mort sera le prix du sang de Khéita'our. Mon frère Chéiboub est parti devant nous, et il n'est pas encore de retour. Un grand danger nous menace. En effet, si je poursuis l'ennemi pour l'exterminer, je me laisserai séparer de mon frère ; d'un autre côté, si je demeure en ce lieu, pour attendre de ses nouvelles, je tremble que Hârith ne succombe, et que nous ne perdions jusqu'aux traces de sa mort. »
Le chroniqueur poursuit : Pendant cet entretien on entendit, du haut des montagnes voisines, éclater des cris perçants : « A nous, braves cavaliers ! à nous ! Le prince Hârith est retrouvé. » Cette heureuse nouvelle répandit la joie et l'allégresse sur le visage d'Antar. Il entraîna Orwah, et tous deux gravirent la montagne. Dès qu'ils furent arrivés au sommet, le fils de Cheddâd s'avança vers Hârith, s'approcha de lui et l'appela. Celui-ci, ouvrant languissamment ses yeux que semblait voiler l'aile de la mort, lui raconta, d'une voix entrecoupée par les sanglots, le malheur qui lui était arrivé et les circonstances affreuses de son supplice. Antar le rassura, le prit dans ses bras et descendit au bas de la montagne.
Asmaï dit : Voici la cause de cet événement : lorsque les fugitifs vinrent apprendre au père de Labna la mort de Khéita'our, l'émir était monté à cheval et s'était élancé avec son armée vers le champ de bataille. Toutefois, il avait eu la précaution de confier Hârith et Labna à la surveillance de son neveu Djérir, fils de Kâdim, escorté de deux esclaves robustes. Mais à peine avait-il fait quelques pas en avant, que, profitant de la circonstance, le perfide Djérir tira son épée et massacra les deux gardes. Au même instant il fondit sur le fils de Zohaïr, lui fit une profonde blessure, et le laissa baigné dans son sang. Alors croyant lui avoir donné le coup mortel, il plaça sa cousine sur le dos d'un coursier de race et l’enleva à la faveur des ténèbres. Son désir était satisfait. Maître enfin de celle qu'il adorait et par qui il avait été dédaigné,[43] il traversa monts et vallées, avec l'intention de se réfugier sous la protection de quelqu'un des rois Arabes.
Le chroniqueur ajoute: Cependant Labna se débattait entre les bras du ravisseur. Elle se tournait de tous côtés en appelant du secours.[44] Quant à l'artificieux Chéiboub, il se mit à la recherche de Hârith, et son ardeur ne se ralentit pas avant qu'il fût parvenu à cet endroit témoin du triple meurtre commis par Djérir. Là il ne trouva d'abord que les cadavres des noirs étendus sur le sable. Puis, s'avançant plus près, il aperçut Hârith à leurs côtés. A cette vue il se sentit consterné et anéanti. « O mon seigneur, dit-il, d'une voix lamentable, qui donc vous a traité si cruellement? De quel côté s'est enfui le meurtrier? » Le fils de Zohaïr lui indiqua la route. Aussitôt Chéiboub court et s'enfonce dans les déserts. Bientôt il a découvert les traces de Djérir ; il le poursuit jusqu'à ce qu'il l'ait atteint au moment de l'aurore. Les cris de Labna frappent son oreille : elle pleurait, soupirait et gémissait comme une colombe de la vallée. Cette rencontre le fait tressaillir de joie. Plus rapide qu'un clin d'œil il fond sur Djérir, décoche une flèche. Le coursier, frappé d'un coup mortel, s'abat et entraîne dans sa chute le cavalier, dont l'occiput frappe la terre. Chéiboub s'élance sur lui, avant qu'il ait eu le temps de se relever, lui déchire les entrailles avec son épée et anéantit son existence.
Cependant Labna était tremblante et éperdue. Lorsque son libérateur s'approcha : « Qui es-tu, lui dit-elle, ô noble Arabe ? — Je suis Chéiboub, répondit-il. » En même temps il lui donna des nouvelles de son amant, rassura son cœur et lui rendit la joie. Ensuite ils allèrent retrouver Antar, auprès duquel ils virent le prince Hârith, qu'on avait descendu de la montagne. A leur arrivée le père des cavaliers[45] éprouva un bonheur ineffable. Son chagrin et sa tristesse s'évanouirent. Labna se jeta dans les bras de Hârith qui se sentit renaître et oublia les souffrances aiguës que lui causait sa blessure. On resta dans cet endroit jusque la fin du jour; et, le lendemain matin, les cavaliers se mirent en marche, regagnant la terre d'Abs et d'Adnan. Antar était à leur tête. Le souvenir d'Abla enflamma son esprit et il se mit à déclamer.
« Est-ce le musc qui s'exhale, est-ce un parfum, est-ce l'aloès ? ou bien le zéphyr qui souffle à travers les collines et révèle sa présence?
« Est-ce l'éclair qui brille, est-ce la blancheur de ses dents[46] qui luit au penchant de la colline ? On croirait voir la splendeur de la lune dans son plein.
« Est-ce la branche du saule[47] qui se balance mollement sur les hauteurs ? Est-ce un bois de lance ou bien la taille effilée d'Abla ?
« Est-ce le narcisse,[48] œil des jardins,[49] ou bien sa joue aussi pure qu'une pomme qui n'a pas encore été cueillie ?
« Mon amour tient du délire. Mes censeurs ne voient-ils pas mes pleurs intarissables ?
« O fille de Malik, pour toi j'endure le plus affreux supplice ! La cruelle séparation[50] et le silence des échos épuisent mon cœur.
« O fille de Malik, cesse de craindre pour moi les coups de l'ennemi : car nul ne peut s'opposer aux volontés de Dieu.[51]
Il dit, et ses compagnons d'armes accueillirent son improvisation par de nombreux applaudissements, ils le félicitèrent de sa brillante poésie et de la richesse de son imagination. Cependant, la troupe victorieuse s'avançait à travers les déserts sous la conduite du héros d'Adnan. On n'était plus qu'à une journée du territoire des Bènou-Abs, lorsqu’Antar donna ordre à son frère de prendre les devants pour apprendre au roi Zohaïr l'heureuse délivrance de son fils Hârith. Dès le matin, Chéiboub partit ; sous ses pas disparurent les vallées pierreuses, et il fut de retour avant le milieu de la journée. Antar lui dit : « O fils de la négresse, il est impossible que tu aies atteint nos foyers, quand je te vois revenu sitôt parmi nous. — Mon frère, reprit Chéiboub, il est vrai cependant que je suis arrivé dans notre patrie. Mais un spectacle singulier s'est offert à ma vue. Une grande agitation animait tous les hommes de la tribu. J'ai vu les cavaliers sauter sur leurs coursiers ; j'ai vu les cavaliers se disperser dans la plaine. Mon premier soin fut d'interroger l'un deux sur le motif de cette agitation générale. On m'a répondu que le roi Zohaïr était allé au-devant de son frère Asied, qui revenait de son pèlerinage à la Mecque.[52] Mais voilà que tout à coup le bruit s'est répandu qu'ils avaient tous été faits prisonniers. On veut les délivrer : telle est la cause de cette levée de boucliers. Quant à l'oppresseur de nos compatriotes c'est un chevalier fameux et un guerrier redoutable, sous les ordres duquel marche une troupe de braves. Ils ont amené les captifs dans la vallée des Arak. — « Il est étrange, dit Antar, que nos princes soient tombés au pouvoir de l'ennemi, et que les catastrophes et la perte se soient abattues sur leurs têtes. Il n'y a qu'un paladin intrépide et au-dessus des atteintes du trépas qui ait tenté une pareille entreprise, quand nos exploits nous ont donné la supériorité sur tous les Arabes. » Le chroniqueur dit : Antar envoya Hârith et Labna avec une escorte de vingt hommes d'armes vers la tribu des enfants d'Abs. Puis il se mit en marche sans crainte et sans hésitation, gagnant, à la tête de son armée, les hauteurs qui dominent la vallée des Arak. Chéiboub l'avait devancé, plus agile que l'autruche.
Journal Asiatique, janvier-juin 1853.
EXTRAIT DU ROMAN D'ANTAR,[53]
TRADUIT DE L'ARABE ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES,
PAR M. GUSTAVE DUGAT.
La plupart des traditions historiques des Arabes avant Mahomet se retrouvent dans le roman d'Antar. L'auteur de ce poème a groupé presque tous les personnages célèbres de ce temps autour de son héros, dont la vie se déroule au désert au milieu des faits les plus saillants de l'histoire. L'époque anté-islamique nous est aujourd'hui connue par le magnifique Essai sur l'histoire des Arabes de M. Caussin de Perceval. En réunissant les fragments épars des poésies historiques, en recueillant les traditions les plus dignes de foi, en classant et mettant en œuvre, dans un ordre et avec un talent admirables les matériaux précieux qu'il avait acquis par quinze années de recherches, M. Caussin de Perceval a créé le véritable musée historique des Arabes avant l'islamisme; et c'est là qu'il faut aller désormais s'instruire de la véritable vie des Arabes du paganisme.
A présent que l'histoire des temps anté-islamiques est constituée, le roman d'Antar, outre son intérêt littéraire et les précieux détails qu'il renferme sur les mœurs des Arabes païens, offre un intérêt de plus, celui de la comparaison qu'il sera permis de faire, entre son histoire pour ainsi dire légendaire et l'histoire réelle, positive, authentique que nous a révélée le savant professeur. Aussi me suis-je proposé, dans la traduction que j'ai entreprise de ce grand poème, d'en mettre à part les extraits susceptibles de ce parallèle, c'est-à-dire ayant un fonds historique, et d'en faire l'objet d'une étude spéciale; c'est ce que j'ai commencé de faire par l'épisode d'Antar en Perse, inséré dans le Journal asiatique (4e série, t. XII, XIII, XIV), et que je continue aujourd'hui par Les jours de bien et les jours de mal du roi Nomân. Le fait historique qui est le sujet de ce nouvel extrait est raconté par M. Caussin de Perceval dans toute sa pureté. Je voudrais pouvoir en transcrire ici le récit complet; mais les bornes de cet article ne me permettent d'en donner, qu'une simple analyse. La voici :
« Moundhir, fils de Mâ-essémâ, avait deux amis, ses convives habituels, Khaled, fils de Moudhallil, et Amr, fils de Maçoud, fils de Calada. Ces deux hommes l'ayant un jour irrité, Moundhir, échauffé par le vin, les fit enterrer vivants. Revenu de son ivresse, il demanda à les voir le lendemain. On lui apprit leur sort. Plein de regrets, il fit construire sur leurs tombes deux mausolées, près desquels il s'imposa la loi de venir chaque année passer deux jours, qu'il nomma, l'un, jour de bien, l'autre, jour de mal. Le jour de bien, il traitait avec honneur le premier individu qui se présentait, et lui donnait cent chameaux noirs. Le jour de mal, tout homme qui s'offrait à sa vue était immolé sur les deux mausolées.
« Dans un de ses mauvais jours, le poète Obayd, fils d'Abras, parut devant lui. Moundhir ordonna de le mettre à mort; on lui ouvrit une artère, et l'on arrosa de son sang les deux tombeaux. Un an après, un Arabe, nommé Hanzhala, ayant passé devant Moundhir dans un de ses mauvais jours, les gardes le saisirent pour le tuer. Hanzhala implora la pitié du roi, et obtint un sursis d'un an, sous la condition de trouver un répondant. Charik, fils d'Amr, jeune chef des Bènou-Chaybân, consentit à l'être. L'année écoulée, Hanzhala ne paraissant pas, Moundhir ordonna d’amener Charik et de lui trancher la tête. Déjà une pleureuse commentait le chant funèbre, lorsque l’on aperçut de loin un voyageur, monté sur un chameau. On l'examine : c'est Hanzhala. Le roi fut surpris de son retour, et admirant sa fidélité à tenir sa promesse, et la généreuse confiance de Charik, les renvoya comblés de présents, et déclara qu'il abolissait la coutume qu'il s'était imposée. »
Ce fait historique est entièrement respecté dans le roman d'Antar; le fond en est absolument le même, les détails sont conservés en grande partie. Seulement l'auteur raconte l’Histoire à sa manières il fait du roman historique.
Quelle est la date de ce fait? A quel roi y a-t il lieu d'attribuer l'usage des sacrifices humains sur les deux mausolées? Quelle est l'époque de la mort du poète Obayd, fils d'Abras? C'est ce qui n'a pas encore été complètement éclairci.
Les divers écrivains qui ont parlé de cette coutume l'attribuent, soit à Nomân Ier El-Akbar[54] ; soit à Moundhir III, fils de Mâ-essémâ[55] ; soit enfin à Nomân Abou-Cabous, peut-fils de Moundhir III.[56] Cazwini et l'auteur du Kitab el-Aghani disent que Moundhir III était contemporain du poète Obayd, et que par conséquent c'est à lui qu'il faut attribuer cet usage. Celle opinion a paru à M. Caussin de Perceval mériter la préférence.
Mais à ces trois noms ne pourrait-on pas ajouter celui de Nomân IV, fils de Moundhir III, et qui, après la mort de son frère Amr III, monta sur le trône de Hîra, en 574, c'est-à-dire douze ans environ après la mort de Moundhir III survenue en 562 ? car si un intervalle de doute ans seulement sépare le règne de Moundhir III de celui de son fils Nomân IV, il ne serait pas invraisemblable que le poète Obayd, contemporain de Moundhir III, l'eut été aussi de son fils Nomân IV, à qui, d'ailleurs, d'après le roman d'Antar et le commentateur de la treizième séance de Hariri,[57] est attribué le fait historique en question. On le voit par ce seul point, le roman d'Antar pourrait aider à l’éclaircissement de l'histoire.
Cet extrait est complètement inédit On ne le trouve pas dans la traduction anglaise que M. Terrick Hamilton a faite du tiers de ce roman; ce qui s'explique par les différences plus ou moins notables qui existent entre les divers manuscrits du poème, J'ai cherché vainement cet épisode dans le manuscrit incomplet de la Bibliothèque impériale, n° 1511 (ancien fonds); il n'est pas non plus dans celui que possède M. Caussin de Perceval, qui a bien voulu y faire pour moi quelques recherches. Je n'ai donc eu à ma disposition que le manuscrit n° 1683. On sait toutes les difficultés qui attendent l'éditeur d'un texte arabe, lorsqu'il n'a qu'un seul manuscrit.
Ce qui m'a donnée le plus de peine à corriger dans le texte de cet extrait, ce sont les vers, trop souvent défigurés par les copistes. On a regardé les vers du roman d'Antar comme inférieurs à la prose. Cela est vrai, si l'on établit ce jugement d'après quelques manuscrits altérés par les copistes ; mais on devra suspendre cette opinion jusqu'au moment où il sera permis de faire disparaître les mutilations, en rétablissant le plus intégralement possible le texte primitif par les collations de plusieurs manuscrits de différentes familles.
Les Mille et une Nuits renferment un grand nombre de vers plus ou moins réguliers, comme ceux du roman d'Antar, et l'on pourrait dire que les vers de ces deux ouvrages ont une certaine parenté de facture. On trouvera aussi dans l'extrait suivant quelques détails que l'on attribuerait volontiers à l'auteur des Mille et une Nuits. Mon intention n'est pas de faire ici la comparaison de deux ouvrages si différents par le fond; l'un, produit de l'imagination pure, l'autre fondé sur des faits historiques, et dont le plan d’ensemble, tracé avec un art admirable, se maintient toujours malgré la longueur du récit.
Maintenant que j'ai terminé la lecture si attrayante de cet ouvrage dans le manuscrit en dix volumes in-fol. de la Bibliothèque impériale, je puis payer mon tribut d'admiration à cette œuvre grandiose, qui n'a pu être conçue et exécutée que par un puissant artiste, un écrivain de génie. J'ose espérer que le Gouvernement me viendra en aide dans la publication de la traduction complète que je prépare ; j’aurai alors l'occasion de faire connaître le résultat de mes études sur ce poème, qui mérite à tant de titres d'être placé au rang des principales productions de l'esprit humain. Si les Grecs ont l’Iliade et l’Odyssée, les Latins l’Enéide, les Italiens la Divine comédie, le Roland furieux et la Jérusalem délivrée, l'Angleterre le Paradis perdu, l'Allemagne les Niebelungen et la Messiade, le Portugal la Lusiade, l'Espagne l’Araucana, la Chine le San-koue-tchi, l'Inde le Mahabharata, la Perse le Chah-nameh, l'Arabie a son Antar.
Le roi Nomân, fils de Moundhir, avait établi dans son royaume une coutume que ne suivit aucun Arabe de ce temps. Il avait consacré deux jours de chaque année : l'un, qu'il appelait jour de mal, et l'autre, jour de bien. Le bruit s'en était répandu par tous les pays. On le voyait, les jours de mal, monté sur un cheval rouge, lui-même tout habillé de rouge, un sabre nu à la main. Mille hommes l'escortaient : c'étaient des guerriers redoutables, des cavaliers arabes; une troupe d'esclaves et de nègres le précédaient, tous armés de sabres tranchants et de javelots mortels. Le premier individu qu'ils rencontraient, voisin ou étranger, noble ou esclave, ils lui arrachaient la vie. Nomân sortait de grand matin, et ne rentrait que le soir dans sa demeure, teint de sang. Les marchés étaient déserts, le pays bouleversé, les transactions arrêtées. Nul ne sortait de sa maison, qu'il ne fût couvert de noirs vêtements de deuil ; quel que fût celui qui s'offrait aux regards du roi sous un autre habillement, il était mis à mort par les cavaliers ou les esclaves. Il n'échappait que celui dont Dieu avait prolongé la vie, ajourné le trépas.
Voilà, dit Asmàyy, ce que Nomân faisait les jours de mal.
Les jours de bien, il apparaissait avec des vêtements verts et la tête ornée d'une couronne d'or rouge ; un groupe de jeunes cavaliers Je précédaient, semblables à des houris du paradis, chargés d'objets précieux, or, argent, habits de soie, qu'ils jetaient aux premiers passants. Nomân, au milieu de la journée, rentrait à son médjless, et faisait apporter devant lui des tables royales chargées des mets les plus exquis, servis sur des plats d'argent, d'or, de cornaline et de topaze. A la fin du repas, les échansons circulaient autour des convives avec des coupes de vin et leur versaient à boire. Le roi Nomân passait ainsi son temps dans la joie et le plaisir.
Asmàyy dit : Je m'informai auprès d'un des grands, de ses commensaux et des plus illustres de ses amis, du motif qui avait déterminé le roi à pratiquer cette coutume. « Asmàyy, me dit-il, l'origine de cette affaire remonte à une époque déjà ancienne. Nomân avait deux familiers d'un caractère aimable, connaissant les usages de la bonne compagnie, éloquents et d'une instruction complète; ils étaient versés dans les lettres et les sciences, savaient des anecdotes, des contes et de très beaux vers, enfin de toute chose ils possédaient ce qu'il y a de mieux. Nomân, pour les éprouver, leur avait confié la garde de ses trésors, et les avait trouvés d'une fidélité et d'une vigilance parfaites.[58] Il les avait attachés à sa personne de préférence aux enfants de sa race, et leur avait découvert tous ses secrets, à l’exclusion même de sa famille; de ses proches et de ses alliés. Il avait pour eux la plus tendre amitié, et ne pouvait s'en séparer un seul instant. Il les trouvait toujours prêts à le servir dans les moments et les conjonctures les plus critiques.
Il se présenta une circonstance extraordinaire que le Dieu puissant et savant avait prévue. Le roi Nomân était assis dans la salle où il buvait ordinairement; ses amis et les grands de la nation s'y trouvaient. Il but et se plongea dans l'ivresse; les chefs et les notables continuèrent à boire jusqu'au soir et se retirèrent. Il ne resta avec lui que les deux familiers.
Nomân avait une favorite d'une beauté incomparable; ses formes étaient pleines de grâce ; elle ressemblait à une branche d'ivoire : c'était une joueuse de luth, une chanteuse à la voix douce et languissante. Son acheteur l'avait payée trois mille dinars. Un marchand l'avait présentée au roi Nomân, à qui il avait inspiré le vif désir de l'acheter et l'avait vendue. Devenu son possesseur, le roi s'en éprit à cause de la beauté de son chant, de la grâce et de la douceur de sa voix, de l'agrément de sa récitation, de son dévouement et de son amour.
Cette nuit-là, lorsque ses intimes, les grands et les gens de sa cour se furent retirés, Nomân, resté seul avec ses deux familiers et voulant profiter de la faveur de la nuit pour mettre le comble à ses plaisirs, fit amener son esclave en sa présence. Dès qu'elle fut venue et qu'elle se fut assise, Nomân ordonna de renouveler le festin. On plaça devant lui la table du vin, sur laquelle on posa des vases[59] de diverses dimensions en argent, or et cristal, et l’on rangea les fleurs et les parfums ; les pages circulèrent avec des coupes. Nomân but avec ses deux familiers, et invita la favorite à chanter. Elle prit alors un luth, poli, sans ornements; l'ouvrier, en le faisant, était attristé de l’oubli de sa maîtresse.[60] Elle en tourna les clefs, accorda les dissonances, serra les cordes et fixa le ton. Puis, en s'accompagnant, elle fit entendre de sa voix langoureuse tant et de si douces modulations, que tous les esprits furent ravis de la beauté et de l'harmonie de son chant, et que les auditeurs croyaient voir le palais lui-même danser de plaisir. La chanteuse s'adressant ensuite à Nomân, récita ces vers:[61]
« O toi, de ton plein gré, attentes à mes jours par tes artifices, à toi, quand je ne serai plus, la vie et l'éternité!
« Ta as tué mon corps, ô toi qui l’habites ; sois miséricordieux pour un amant triste et tourmenté.
« Celui qui, comme moi, a fait des vœux pour l'éternité de ta vie, a vécu; celui qui aime peut-il-vivre longtemps?
« Dieu que la tombe me fut voisine ! plût à Dieu que je n'eusse jamais vu le jour !
« A ces paroles, Nomân tressaillit, et lui dit de chanter une seconde fois.
Elle récita ces vers:[62]
« Aie pitié de mon cœur! il est triste; vois-tu les pleurs qui inondent mes joues ?
« Cette lune que je possède dans vos tentes, je la place sous la protection de Dieu. Tout ce que fera ma bien-aimée sera aimé.
« Elle se plaît à me soumettre à ses caprices. Quelle est douce sa coquetterie! Mon cœur l'adore et elle se cache à mes yeux.
« Elle ressemble à Joseph par la beauté de son visage. Grâce pour un amant qui ressemble à Jacob par sa tristesse.
« Le mal s'est emparé de moi par suite de sa longue absence, comme il s'empara de Job, le prophète de Dieu.
« Louange éternelle à mon seigneur Dieu ; notre séparation était écrite!
Elle avait à peine terminé ces vers, que Nomân, transporté, perdit la tête.[63] Revenu à lui un moment après, il changea ses vêtements et ordonna de faire circuler les coupes. Ils continuèrent à boire. Puis le sommeil ayant vaincu Nomân, il s'endormit. Pendant son sommeil, et au travers de ses doux rêves, il lui sembla voir l'un de ses deux familiers s'approcher de la courtisane, la baiser aux joues et aux seins, la renverser et accomplir ses désirs; qu'après le premier, le second s'était levé et en avait fait autant, et que la courtisane leur disait : « vous êtes de beaux jeunes gens; le roi Nomân ne m'apprécie pas; il faut que je complote sa mort et que je l'égorge comme un mouton. Je vous livrerai les beaux joyaux de ses trésors, je vous ferai rois des Arabes, et vous seconderai tous les deux; car vous êtes jeunes, plus agréables que Nomân et plus experts que lui en amour. Douce a été pour moi votre caresse, et je ne veux d'autres amoureux que vous. — Fais à ton gré, lui répondaient-ils, nous n'y mettrons aucun obstacle. » Alors la courtisane avait pris un couteau et s'apprêtait à égorger Nomân, qui, dans le même moment se réveilla plein d'inquiétude, et vit la courtisane tenant à la main un couteau dont elle allait se servir pour couper un fruit. Nomân crut que son rêve l'avait réveillé, et resta persuadé que dans cet instant même sa favorite allait l'égorger, que ses deux familiers s'étaient succédé auprès de son esclave, à la taille onduleuse, et qu'ils avaient fait avec elle cette coupable action. Il devint furieux. « Quoi! dit-il en lui-même, non contents de ce qu'ils ont fait avec mon esclave, ils cherchent encore à me tuer ! »
Le narrateur dit :
Nomân, sorti de son sommeil, tira son sabre avec violence et coupa le cou des deux convives, puis se dirigeant vers la favorite, il lui fit boire la coupe de la mort. A ce spectacle, les esclaves, craignant pour leur vie, s'enfuirent de tous côtés. Nomân essaya de se tenir debout, mais il ne put pas; il se coucha à sa place, et dormit jusqu'à ce que le matin apparût avec son sourire. A son réveil, les fumées du vin s'étant dissipées, il vit la terre teinte de sang, les deux convives, et la courtisane étendus morts; il frémit de colère, et dit aux serviteurs qui étaient restés : « Quel est l'auteur de cette action ? Quel est le meurtrier? — C’est vous, lui répondirent les esclaves, » et ils lui racontèrent ce qu'il avait fait dans son ivresse. Il ordonna de les enterrer. Profondément affecté et repentant de ce malheur, il regarda ce jour comme un jour de tristesse, et le nomma jour de mal. Chaque année, quand ce jour revenait, il était triste, se revêtait d'habillements rouges et faisait boire la coupe de la mort à tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Ses esclaves, à cheval devant lui, armés de traits et de javelots, faisaient périr tous ceux qu'ils rencontraient.
« Voilà quelle fut la cause des jours de mal.
« Quant à celle des jours de bien, ô Asmàyy, elle vient de l'aventure suivante :
« Un jour le roi Nomân monta à cheval, prit le large dans la plaine, et chassa le gibier pour se divertir. Jusqu'à la moitié du jour, il ne cessa de s'enfoncer dans les déserts. Tout à coup une gazelle s'étant levée devant lui, il la poursuivit avec son cheval, coursier rapide, et s'obstina à courir après elle jusqu'à ce qu'il la perdit de vue au fond d'une vallée. Le roi Nomân s'arrêta déconcerté, ne sachant quelle direction prendre; il poussa son cheval dans les lieux déserts et disparut aux yeux de sa troupe ; il n'avait plus derrière lui aucun de ses cavaliers. La gazelle s'était enfuie. Il grimpa, pour s'orienter, sur la cime d'une montagne, regardant à droite et à gauche. Il vit une vallée où se trouvaient quelques tentes de Bédouins; il y poussa son cheval, et apercevant une tente de poils, fixée en terre, il se jeta devant la porte Le maître de la tente sortit, et voyant ses vêtements dorés, son cheval avec une selle en or, incrustée de perles et de pierreries, il comprit que ce cavalier était d'un rang élevé, un grand roi. Il lui apporta de l’eau et lui en arrosa le visage. Nomân s'assit et recouvra ses sens. Le Bédouin se munit d'un grand vase, et se dirigea vers une chamelle laitière, tira de son lait, le porta au roi et le lui donna à boire. Il prit ensuite du lait à une autre chamelle et en abreuva le cheval, qu'il fit entrer dans sa tente. Puis, saisissant la tête d'un mouton, il l'égorgea, le dépouilla de sa peau et le coupa en morceaux; il en prépara un plat, qu'il plaça devant le roi Nomân, et s'assit pour lui tenir compagnie. Le roi lui raconta tout ce qu'il avait souffert de soif, de chaleur et d'anxiété. Il passa cette nuit chez le cheikh bédouin, jusqu'au matin. Montant alors à cheval, il se dirigea vers Hîra. Le cheikh marcha devant lui jusqu'à ce qu'il lui eût montré le chemin, et lui ayant fait ses adieux, revint vers sa tente. Le roi Nomân lui avait dit : « Cheikh des Arabes, si le destin te visite, viens à Hîra et demande le roi Nomân. — J'ai entendu et j'obéirai, avait répondu le Bédouin. » Nomân partit dans la direction de Hîra.
Le narrateur dit : « Pendant sa marche, Nomân aperçut une lumière dans le lointain, il la suivit et arriva auprès d'elle. C'était une lampe suspendue à la porte d'une caverne. Le roi, ayant mis pied à terre, y entra. Parvenu au fond d'un long vestibule, il vit une grande porte, plaquée de fer, recouverte d'or rouge, et dont la serrure avait la dimension dune jambe de chameau. Sur cette porte étaient écrits ces mots :
« O toi qui viens dans ce lieu, si tu es Nomân, fils de Moundhir, fils de Mâ-essémâ, frappe à la porte trois coups, décline ton rang et ta généalogie; si la porte s'ouvre, tu entreras dans l’intérieur; tu trouveras un appartement magnifique, ayant quatre angles et quatre iwans. Entre dans l’iwan de face; tu y trouveras une planche et une chaîne d'or; agite-la trois fois. Trois jeunes gens, rois des génies, se présenteront à toi : Salkab, Malhab et le roi Madhab, le plus puissant des trois. Ils te diront : « Que veux-tu? Ces richesses sont les tiennes et ce trésor est à toi. Tout ce qu'il y a ici de biens précieux et d'armes est à ta disposition. Le magicien Kahlân, fils de Chaybân le lakhemite y veille en ton nom. Tu leur répondras : « Je veux que vous transportiez ces richesses à tel endroit; ils exécuteront ton ordre. Salut. »
Le roi Nomân ayant lu ces lignes et en ayant compris le sens, devint joyeux et sourit. Arrivé à la porte, il frappa et fit connaître son rang et sa noblesse. La grande porte s'ouvrit, et il entra dans le vestibule et les souterrains. Après une heure de marche, il atteignit la porte de l'appartement. Là il examina avec curiosité la beauté de sa construction, l'élévation de ses murs, sa blancheur et ses ornements. Cet aspect l'éblouit. En circulant dans l'appartement, il trouva douze cabinets. Le premier qu'il ouvrit contenait de l'argent, le second de l'or, le troisième des perles, le quatrième des vêtements et des cuirasses, le cinquième des sabres et des lances, le sixième des vêtements brochés en or et des couronnes incrustées de pierreries, le septième des coffrets et des armes, le huitième des trésors royaux, le neuvième des topazes, le dixième des rubis, le onzième des émeraudes, enfin le douzième des escarboucles. Nomân vit dans l'iwan de face un trône fait de bois de genévrier, plaqué d'or rouge, surmonté d'un dais en soie, au-dessus duquel était suspendue, par une chaîne d'or, une planche d'acier. La planche descendit; il l'agita. Tout à coup[64] trois génies se présentèrent à lui : leurs vêtements étaient dorés, leur aspect imposant. Nomân s'avança vers eux, et leur dit de lui apporter les richesses renfermées dans le trésor. Interrogé sur son nom, il répondit qu'il était Nomân, fils de Moundhir, fils de Mâ-essémâ le lakhemite. « Cela se vérifiera bientôt, lui dirent-ils ; nous sommes préposés à la garde du trésor, et si tu es Nomàn, fils du roi Moundhir, maître du pouvoir et du commandement, cela se verra. » Un de ces rois sortit alors et lui apporta une arbalète et trois balles; ils lui montrèrent une colonne, sur le sommet de laquelle était un croissant d'or rouge ; un oiseau vert, au bec rouge, dormait sur ce croissant, la tête entre ses ailes.
« Nomân, lui dit le génie, lance une de ces trois balles contre cet oiseau; si tu le touches, tu es Nomân ; si tu le manques, des serpents, des scorpions et des oiseaux, avec leur bec d'acier, sortiront contre toi; les rois des génies viendront et te couperont en morceaux. Si tu es Nomân, tu atteindras l'oiseau, qui fera trois tours et jettera de son bec un papier roulé, dans lequel sont renfermés notre délivrance de la garde de ce trésor et notre retour dans le pays. » Nomân, ayant entendu ces paroles, raffermit son courage, prit l'arbalète et les balles dans sa main, et regarda l'oiseau; il le vit perché dans les hauteurs de l'air, sur un croissant d'or. « Je ne pense pas, dit-il en lui-même, que ces balles puissent arriver jusqu'à lui. »
« — Ne te préoccupe pas de cette pensée, lui dit un des trois serviteurs; sache que si tu es Nomân, fils de Moundhir, fils de Mâ-essémâ le lakhemite, l'air portera les balles jusqu'au cou de l'oiseau, qui sera atteint et abattu. »
Nomân ayant entendu ces paroles, «Voyons; dit-il, que je tire; si je l'atteins, mes désirs sont accomplis ; je deviens possesseur des richesses d'un trésor telles que ne peut en avoir aucun roi de la terre et de l’époque, ni même Kesra Anouchirwan. Si je n'en deviens pas possesseur, que je meure. Si ma vie doit être longue, les tranchants de fer ne couperont pas ma peau; si elle est proche de son terme, je goûterai la coupe de la mort; et ranimant son courage, il lança la première balle, qui passa sous l'aile droite de l'oiseau. Des cris alors se firent entendre, et une voix disait : « Tu ne possèdes pas les signes de la puissance; le tiers de ta vie s'est écoulé. » Nomân, attristé par ses paroles, se repentit de ce qu'il avait fait, et voulut s'en retourner; mais il vit que ses pieds étaient cloués à terre.
« Que cet incident et ces clameurs méprisables ne t'épouvantent pas, lui dirent les serviteurs, lance la seconde balle. » Mais l'ayant lancée, elle passa sous l'aile gauche de l'oiseau. Les cris redoublèrent, et, parmi les diverses voix qui se faisaient entendre, l’une d'elles disait : « Le second tiers de ta vie a passé ; ton honneur et ta gloire ont disparu. » Nomân, furieux, s'écria : « Que je lance la troisième balle, afin que je meure et que je sois débarrassé de ce monde, où toute chose doit bientôt périr. » Et, raffermissant son courage, il lança la troisième balle, le cœur agité d'une émotion poignante; elle partit de sa main sans qu'il eût visé ; et, avant d'avoir lâché la corde de l'arc, il était certain de sa mort. Mais la balle, portée sur les airs, frappa le cou de l'oiseau, qui, tournant trois fois sur lui-même, jeta de sa bouche les feuilles de papier dont il a été parié. On entendit alors, mêlé de chants, le son des tambours, des trompettes royales. Les esclaves baisèrent la terre devant lui, et lui dirent : « Prescris-nous ce que tu désires, illustre seigneur. — Je veux, leur répondit-il, que vous transportiez toutes ces richesses dans mes trésors et dans mes arsenaux, et que vous ne laissiez rien ici, pas même la valeur d'un dinar. — Audition et obéissance, dirent-ils, et ils ajoutèrent: « Prends ces papiers que l'oiseau a jetés, et sur lesquels sont écrites les quantités d'or, de pierreries et de joyaux, des vêtements et des cuirasses incrustées. » Nomân prit les feuillets, et y trouva inscrits les quantités d'or et d'argent, le poids des pierres précieuses, le nombre des bijoux, vêtements, casques, cuirasses et cottes de maille.
Les serviteurs donnèrent ensuite l'hospitalité au roi Nomân, qui sortit de l'appartement réservé au trésor, emportant tout ce dont il put se charger. Puis, montant à cheval, il se dirigea vers la terre de Hîra. « La parole des génies, disait-il, s'est réalisée. Ils ont mis le comble à mes désirs, et j'ai sur moi, en pierres précieuses et joyaux, une valeur de cent karras.[65] »
Le narrateur dit :
Nomân partit pour Hîra. Il rencontra ses cavaliers courant ça et là, pleins d'inquiétude de sa disparition. Ils avaient activement parcouru tous les déserts, espérant obtenir des nouvelles du roi. Quand ils l'aperçurent, ils poussèrent de grands cris de joie, et une partie se dirigea vers la ville pour annoncer son arrivée. Les grands et le peuple sortirent au-devant de lui : ce fut pour Nomân un jour qui compta dans sa vie. Il tint secrets les événements qui lui étaient arrivés, et entra dans son palais, le lieu de sa gloire et de sa puissance; puis, se promenant tout autour, il examina ses richesses et son arsenal; tout ce qui faisait partie du trésor avait été transporté chez lui. Il sortit et vint s'asseoir sur son trône. Un chambellan s'avança aussitôt vers lui, baisa la terre, et lui dit :
« O maître, un marchand parmi les infidèles est arrivé, amenant avec lui une esclave qu'il a achetée, dit-il, deux mille dinars ; il veut vous en faire présent. Seulement, en échange, il vous demande un ordre qui enjoigne à tous les habitants des sources de ne prélever sur lui aucune contribution. — « Chambellan, répondit le roi, fais-le venir et qu'il amène l'esclave. — J'entends et j'obéis, dit le chambellan. » Le marchand entra et lui présenta l'esclave. Elle surpassait la pleine lune en beauté, en perfection, en éclat et en justesse de proportions; elle était telle que l’a décrite le poète lorsqu'il dit:[66]
« Si elle s'offrait aux yeux des idolâtres, ils la choisiraient pour déesse, à l'exclusion de leurs divinités.
« Si dans l'Occident elle apparaissait aux yeux d'un moine, il laisserait la prière de l'Orient, et se tournerait vers l'Occident.[67]
« Si elle crachait dans la mer, et elle est salée la mer, sa salive la rendrait douce.
« Si de ses pieds elle foulait de durs rochers, ils se couvriraient de gazon.
« Et son approche rajeunirait le vieillard qui se traîne sur un bâton.
« Sous la brise du matin, elle ondule, balance; elle fait fondre à la fois le corps, le cœur et l'âme.
A sa vue, le roi Nomân en devint amoureux, et en demanda le prix au marchand. « C'est un présent que je vous fais, lui dit celui-ci; je désire seulement que vous me donniez un ordre qui prescrive à tous les rois des Arabes de n'exiger de moi ni profit, ni tribut. » Nomân écrivit de sa main l’écrit demandé et le signa. Il donna au marchand l'hospitalité, le traita avec honneur et le renvoya content; mais voici qu'un jeune homme, nommé Zayd, fils d'Adi,[68] et un autre, Thabit, fils de Hammam, se présentèrent à lui. Nomân les fit approcher et les choisit pour ses familiers. « C'est un jour, dit-il en lui-même, de joie, de bonheur et de fête. Dieu m'a rendu la favorite que j'ai tuée et mes deux familiers, et, de plus, le Très-Haut m'a gratifié de richesses qu'aucun homme ne pourrait avoir. » L'esclave jouait de tous les instruments, comprenait toutes les langues et en parlait sept; elle lisait les livres de science, les anecdotes rares, les historiettes. Nomân, après l'avoir éprouvée, la trouva parfaite dans toutes les connaissances. Elle devint familière à son cœur; elle fut sa joie, son amusement, sa félicité. Il ordonna qu'on pavoisât la ville, qu'on décorât son palais de toutes sortes d'armes, et, faisant aligner à droite et à gauche sa cavalerie, il distribua des présents à tous ses soldats, il se montra bienfaisant envers les veuves et les orphelins, mit en liberté les prisonniers et supprima les taxes, En vérité, dit-il, voilà des jours de bien et des moments de bonheur universel. » Le jour, il se promenait dans les jardins; la nuit, il la passait dans des lieux solitaires; auprès de son esclave, appelée Bahdjat el-Oudjoud. Cet état de choses dura trois jours, qu'il appela jours de joie, de bonheur et de plaisir.
Telle fut, dit le narrateur, la cause des jours de bien et des jours de mal du roi Nomân.
Durant un certain temps le roi suivit cette coutume. Quand les jours de bien arrivaient, son cœur s’abandonnait à la joie; il se revêtait de beaux habillements et buvait du vin. Les jours de mal, il s’habillait de noir, monté sur un cheval nu, précédé d'une troupe de nègres. Celui qui se présentait à lui, étranger ou parent, recevait la mort.
Voilà, dit le narrateur, ce qui se passait les jours de bien et les jours de mal.
Maintenant revenons au Bédouin qui avait rencontré Nomân dans le désert, l'avait recueilli dans sa tente, lui avait donné l'hospitalité, en lui faisant boire du lait et en égorgeant pour lui un de ses moutons. Cela s'était passé dans le désert. Le Bédouin avait rappelé à la vie le roi, près de mourir. Il était ensuite monté à cheval avec lui, et s'était fait son serviteur jusqu'au moment où il lui eut indiqué son chemin. Nomân, lui faisant ses adieux, lui avait dit : « Cheikh des Arabes, si le temps s'appesantit sur toi et te frappe d'humiliation et de malheur, viens dans mon pays, à la terre de Hîra, et, à ton arrivée, demande qu'on t'indique le roi Nomân; je te donnerai tout ce qui te plaira et je t'octroierai le pouvoir sur des rois arabes. » Le cheikh lui avait répondu : « amitié, respect, audition et obéissance. »
Lorsque Nomân eut disparu dans les vallées, le cheikh revint auprès de sa femme et lui apprit ce que le roi lui avait dit; cette nouvelle la tranquillisa. Le cheikh et sa femme avaient vu s'écouler trois années, depuis le départ de Nomân, lorsque des Arabes, ayant fait sur eux une razzia, leur enlevèrent tous leurs biens, leurs chamelles et leurs chameaux. N'ayant pu sauver leurs troupeaux des mains des ravisseurs, ils les suivirent ; mais ils ignoraient quelle direction ils avaient prise et à quelle tribu arabe ils appartenaient.
Le cheikh, découragé, revint vers sa femme : « Fille de mon oncle, lui dit-il, le destin est tombé sur nous; tous nos biens ont disparu, nous ne possédons plus ni chamelle, ni chameau; indique-moi ce qu'il faut faire. » En entendant ces paroles, sa femme s'apitoya sur son sort. « Ne m'as-tu pas dit, lui répondit-elle, que cet homme d'un rang illustre, qui descendit dans ta tente, que tu fis revenir à la vie, que tu traitas avec honneur et en la compagnie de qui tu partis, t'adressa ces paroles : Cheikh, lorsque le destin t'opprimera et que les vicissitudes des événements tomberont sur toi, viens dans mon pays, à la terre de Hîra, et, à ton arrivée, demande le roi Nomân. — Oui, lui répondit le vieillard, c'est ainsi qu'il me parla; il me fit promettre d'aller le voir. »
Le cheikh bédouin monta sa chamelle et partit pour Hîra. Près d'y arriver, il rencontra Nomân dans un de ses jours de mal. En l'apercevant, le roi le reconnut, et s'écria : « O Arabes, qui amène cet homme dans ce jour fatal. » Puis il détourna la tête de son cheval et fit semblant de ne pas le voir. « Arabes, s'écria le Bédouin, est-ce que le roi Nomân ne me reconnaît pas? » Puis, tournant la tête de sa chamelle, il se plaça devant lui : « O roi de l'époque, lui dit-il, je suis Chabib, celui qui vous donna l'hospitalité le jour de la détresse, et vous me dites : Viens me voir dans le lieu de ma gloire. » Puis il lui récita ces vers:[69]
« Je vois Nomân oublier un bienfait et détourner sa tête d'un étranger qui se montra généreux envers lui.
« Dans l'attente du bonheur, je suis accouru vers lui ; mais la mauvaise fortune est mon lot dans ce monde.
« Je le vois, le destin méconnaît l'homme honnête ; il trahit le héros et l'homme intelligent.
« Mais peut-être, après fa voir oublié, Nomân se rappellera le bienfait, il se souviendra de la promesse qu'il fit au triste Chabib.
En entendant ces paroles, Nomân se détourna du Bédouin, et, pour l'éviter, se dirigea d'un autre côté. Chabib, voyant ce mouvement du roi, fit tourner la tête de sa chamelle, et se plaçant en face de Nomân, lui adressa ces vers[70] :
« Le temps et ses vicissitudes passent sur les hommes, laissant sur eux leurs empreintes de misère et de bonheur.
« Il en est ainsi de Nomân, il m'a gratifié d'une promesse, il ne lui convient pas de la violer.
« L'aspect riant de son visage donne le contentement et la richesse, il apaise la soif de celui qui est épuisé.
« O Seigneur, prodigue-lui d'abondantes faveurs, comble-le de tels biens, que rien ne puisse ajouter à son bonheur.
« Si je réussis auprès de lui, je rendrai grâce à mon Dieu, et je serai vengé du rebelle destin.
« De pauvre, devenu riche, je serai l'asile des hôtes et des voyageurs.
Nomân fut fort embarrassé ; son âme était oppressée, il mordait sa poitrine. Mais ne voulant ni abolir sa coutume, ni faire du mal à ce vieillard qui lavait rendu à la vie, il fit tourner la tête de son cheval et partit sans regarder le Bédouin, ni lui parler. Alors Chabib, poussant sa chamelle, s'avança vers lui et lui dit ces vers[71] :
« M'as-tu oublié, ô mon maître, cependant l'homme honnête se souvient. Si tu n'existais pas, je nierais la générosité.
« Un homme comme Nomân n'est point parjure à sa promesse. Je l'ai racheté, et mon âme est dans l'angoisse.
« J'ai supporté longtemps avec patience le malheur que le destin m'envoyait ; mais je ne puis continuer à souffrir.
« Si ma louange est défectueuse, toi aussi n'as-tu pas fait défaut à ta promesse ?
A ces paroles, le roi Nomân s'écria : « Arabes, qui a amené cet homme en ce jour de mal et de colère? » Et il détourna la tête de son cheval. Le Bédouin dit en lui-même : « Il paraît que cet émir ne me reconnaît plus. Je vais encore une fois m'approcher de lui ; s'il me reconnaît, je serai heureux, sinon, je retournerai vers ma famille sans trouble et renoncerai à toute insistance; je ne puis faire davantage. » Il frappa la tête de sa chamelle, et, s'avançant en face du roi Nomân : « O mon maître, dit-il, c'est moi qui suis votre esclave, ce Bédouin auquel vous avez promis des richesses et des faveurs, en récompense du service qu'il vous a rendu, et je vous vois aujourd'hui détournant la tête de moi, comme si vous ne me reconnaissiez plus. » Nomân s'arrêta, gonflé de colère. « Chef des Arabes, lui dit-il, ce n'est pas par avarice que j'ai détourné ma figure, mais pour ne pas te tuer, après le service que j'ai reçu de toi; car je ne changerai pas ma coutume. Chaque année, j'ai trois jours de bien, pendant lesquels je comble de dons, de richesses, de faveurs, celui qui se présente à moi, étranger ou parent; j'ai trois jours de mal, de tristesse et de chagrin, pendant lesquels je suis dans l'état où tu me vois. Si mon frère ou mon enfant tombait alors sous ma main, je le tuerais. Je t'ai rencontré un jour de mal, je t'ai évité, j'ai détourné mes yeux de toi, pour, comme je te l'ai dit, ne pas te conduire à l'abreuvoir de la mort. J'ai repoussé loin de toi la tête de mon cheval, et je t'ai laissé me suivre, me parler, t'attacher à moi; mais, maintenant il faut absolument que je te tue, et que tu boives la coupe de la mort; car, je te le répète, si dans ce moment mon frère ou mon enfant se présentait devant moi, je le tuerais. Choisis ton genre de mort; » et Nomân cria à ses esclaves, qui saisirent le Bédouin, lui lièrent les mains derrière le dos, et remmenèrent pour lui trancher le cou.
En voyant cela, le Bédouin se crut certain de la mort. « O mon maître, dit-il au roi en pleurant, n'ayez pitié de moi, je ne demande plus rien, ni richesses, ni chamelles, ni chameaux, ni dons, ni faveurs, » et il lui récita ces vers:[72]
« Plut à Dieu que ma mère ne m'eut ni porté, ni enfanté, et que je n'eusse étendu vers personne la main de la générosité!
« Sans mon bienfait et la promesse du roi Nomân, je ne serais pas venu de ma tente lointaine vers ton pays.
« J'arrive, accourant sur une robuste chamelle, n'ayant pour compagnes que l’espérance et la louange, mes seules armes.
« Je m'avance vers toi, je te demande de tenir la promesse dont tu m'as gratifié le jour de la chasse dans la solitude du désert;
« Je vois que tu y manques, que direz-vous à ma famille, ô mes mains vides.
« Si je dis : il a été généreux, mon malheureux état me démentira; si je dis : Il ne l'a pas été, mon foie sera brûlé de douleur.
« Malheur à toi, lui dit Nomân, n'en dis pas davantage, il faut que tu périsses. — Ayez pitié de moi, mon maître, roi dit le vieillard, j'ai des filles vierges qui sont dans le dénuement et la détresse. — Il me faut ta mort, lui répondit Nomân, adieu. — Ne faites pas cela, lui dit le cheikh, pitié pour ma vieillesse et l'abondance de mes larmes. » Puis il ajouta : « Laissez-moi retourner pour dire adieu à mes filles, je reviendrai ensuite vers vous, et vous ferez alors de moi ce que vous voudrez. — Vois qui te servira de caution ? » lui dit Nomân.
Le Bédouin jeta les yeux sur les assistants et les arrêta sur un des émirs du roi qui s’appelait Charik, fils de Hassan. Son visage brillait comme la graine de grenade ; il se tenait auprès du roi. Le cheikh se dirigea vers lui, baisa sa main et lui dit : « O mon maître, je n'ai pas de refuge contre la mort, ni rien qui puisse me sauver contre le destin, ô frère de tout infortuné, espoir de celui dont toutes les espérances sont brisées, voulez-vous être mon garant par honneur pour celui qui a élevé le ciel et éclairé les ténèbres? » Puis il pleura, se lamenta et poussa des cris déchirants. « O mon maître, ajouta-t-il, je suis venu comptant sur la promesse du roi, et je suis tombé dans l'abîme du malheur. »
L'émir l'ayant entendu, le plaignit; son cœur s'attendrit à son infortune, et il dit à Nomân : « Roi de l'époque, je serai son garant. — Prenez des témoins de votre engagement, répondit le roi. » Son intention, dans cette circonstance, était de faire éloigner de lui le cheikh. Le Bédouin partit pour se rendre dans sa famille, et il récitait ces vers.[73]
« Mes filles sont dénuées d'appui, elles auraient voulu que je vécusse longtemps,
« Dans la crainte de goûter après moi l'humiliation et de boire une eau troublée.
Le narrateur dit : Le cheikh, chemin faisant, pensa à ce qui lui tétait arrivé jusqu'à ce qu'il fût rendu au milieu de sa famille. Sa femme et ses filles allaient chaque jour dans le désert, et restaient jusqu'au soir sur le chemin en l'attendant, puis elles rentraient dans leur tente. Ce jour-là, le cheikh ayant apparu, elles s'élancèrent à sa rencontre et cherchèrent des veux les richesses qu'il apportait; elles ne virent avec lui que sa chamelle et la tristesse qui était peinte sur sa figure. Elles s'informèrent de sa santé et de sa visite à Nomân. Alors le cheikh, versant des larmes, leur adressa ces vers:[74]
« J’ai demandé un bienfait à un roi puissant, il me présente une prompte mort.
« Charik, fils de Hassan, fils de Bedr, illustre par ses ancêtres et d'une tribu de nobles,
« A répondu de mon prochain retour auprès de Nomân, et que je reviendrais pour périr sous le tranchant du glaive.
« Je dis adieu à ma femme, je retourne vers le roi pour qu'il me tasse boire les coupes de la mort.
« Je suis venu vers mes tilles. Mes larmes coulent et les flammes dévorent mon cœur.
« Ma femme a étendu vers moi ses regards, et a dit à ses filles qui donnaient encore.
« Hâtez-vous, mes tilles, votre père est arrivé avec des richesses innombrables, inespérées.
« Ma femme arriva vers moi la première; mais elle ne vit que mes mains qui cachaient ma ligure.
Il leur raconta alors ce qui s'était passé entre lui et Nomân, et comment il avait échappé à la mort par la caution d'un des chambellans du roi, qui avait répondu de son retour. « Je ne suis venu vers vous, ajouta-t-il, que pour vous faire mes adieux, et je repars. — Eloignons-nous de cette terre, lui dit sa femme, et fuyons dans les plaines et les déserts. Je ne puis faire cela, répondit le Bédouin : non, par la vérité de celui qui connaît les choses visibles et invisibles; car cet homme s'est rendu mon garant, et il m'est impossible de le tromper et d'être la cause que les bienfaits disparaissent d'au milieu des hommes. » Il fit alors un dernier adieu à sa famille et partit pour la terre de Hîra. Il se présenta au roi Nomân, et le trouva dans un jour de bien et de joie. Le roi lui fit des présents, le combla d'honneur. « Tu es donc venu chercher la mort, lui dit-il. — Oui, mon maître, je suis venu accomplir ma promesse et faire cesser les appréhensions de celui qui s'est porté ma caution, afin que les actions généreuses ne périssent pas parmi les hommes. » Le roi Nomân admira sa loyauté, le traita avec distinction, lui fit des présents et le rendit parfaitement heureux. Il lui raconta l'origine des jours de bien et des jours de mal.
Asmàyy dit : Le cheikh fut au comble de l’étonnement et tressaillit de l'excès de sa joie. Il prit les présents et les richesses, et il revint dans « sa famille, élevé au rang des rois.
« Certes, lui répétait Nomân, je m'étonne que tu sois venu, alors que je t'avais promis la mort; et le Bédouin lui redisait : Je ne suis venu que pour celui qui, sans me connaître, avait répondu de moi, et afin que la générosité ne se perdit pas sur la terre. »
Voilà quelle fut la cause des jours de bien et des jours de mal du roi Nomân. L'origine de cette histoire vous est maintenant connue. En Dieu seul est le secours.
Extrait du livre de E. J. Delécluze, Roland ou la chevalerie, II, 1845.
Le roi Caïs, se défiant des mauvais desseins d'Hadifah, avait envoyé de tous côtés des esclaves à la recherche d'Antar. Il arriva que l'un de ces esclaves, de retour auprès du roi, lui dit : « Pour Antar, je n'ai pas même entendu parler de lui ; mais comme je passais près de la tribu de Témim, je dormis sous les tentes de celle de Ryah. Là je vis le plus remarquable des poulains, pour sa beauté. Il appartient à un homme nommé Jabir, fils d'Awef. Jamais je n'ai vu un poulain si beau ni si rapide à la course. » Ce récit fit une vive impression sur le cœur de Caïs.
En effet, ce jeune animal était le miracle de ce temps, et jamais, parmi les Arabes, on n'en avait élevé de plus beau. Il était d'ailleurs généreux et illustre par sa naissance et par sa race, car son père était Ocab et sa mère Helweh, deux animaux qui passaient chez les Arabes, pour être aussi prompts que l'éclair. Toutes les tribus les admiraient pour leurs formes, et celle de Ryah était devenue célèbre parmi toutes les autres, à cause de la jument et de l'étalon qu'elle possédait.
Mais pour en revenir au beau poulain, un jour que son père Ocab était ramené aux demeures, conduit par la fille de Jabir (c'était le long d'un lac, et il était midi), il vit la jument Helweh qui se tenait près de la tente de son maître. Il se mit à hennir et se débarrassa de sa longe. La jeune fille, tout interdite, laissa aller le cheval et se hâta, par modestie, de chercher refuge dans l'une des tentes. L'étalon resta là jusqu'à ce que la demoiselle revînt. Elle reprit sa longe et le ramena à l'écurie.
Mais le père s'aperçut du trouble que sa fille ne pouvait cacher. Il la questionna, et elle dit ce qui s'était passé. A ce récit, le père devint furieux de colère, car il était naturellement violent; il courut aussitôt au milieu des tentes, et levant son turban : « Tribu de Ryah ! tribu de Ryah ! » cria-t-il de toute sa force ; et aussitôt les Arabes accoururent autour de lui. « Parents, leur dit-il, après avoir raconté ce qui avait eu lieu, je ne laisserai pas le sang de mon cheval dans les flancs d'Helweh ; je ne suis nullement disposé à le vendre même au prix des moutons et des chameaux les plus précieux ; et si l'on ne me permet pas d'enlever l'embryon du corps d'Helweh, je chargerai quelqu'un de tuer cette jument. — Allons, dirent tous les Arabes, faites comme il vous plaira, car nous ne pouvons nous y opposer. (Tel était l'usage alors en Arabie.) On amena la jument et on la lia à terre devant le plaignant, qui, après avoir relevé ses manches jusqu'aux épaules, mouilla ses mains dans un vase d'eau, en y mêlant de l'argile, puis se mit à frapper les flancs de la jument dans l'intention de détruire ce dont Dieu avait ordonné l'existence. Cela fait, il retourna plus calme chez lui.
Malgré cela, la jument Helweh conçut heureusement, et au bout d'un an moins quelques jours, elle mit au monde un poulain parfait. En le voyant, le maître de la jument ressentit une grande joie, et lui donna le nom de Dahis (qui est frappé), pour faire allusion à ce que Jabir avait fait.
Le poulain, en grandissant, devint encore plus beau que son père Ocab. Il avait la poitrine large, le cou long, les sabots durs, les narines bien ouvertes; sa queue balayait la terre, et son caractère était doux ; enfin, c'était l'animal le plus parfait que l'on eût jamais vu. On l'éleva avec grand soin, et sa taille fut telle, qu'il devint comme l'arc d'un palais. Enfin, un jour que la jument Helweh, suivie de son poulain, allait du côté du lac, Jabir, le possesseur d'Ocab, les aperçut par hasard. Il s'empara du jeune cheval et l'emmena, laissant sa mère regretter sa perte. Pour Jabir, il disait : « Ce poulain m'appartient, et j'ai sur lui un droit mieux établi que celui de qui que ce soit. »
La nouvelle de cet enlèvement parvint bientôt au maître du jeune cheval. Il convoqua les chefs de la tribu et leur dit ce qui était arrivé. On alla trouver Jabir, auquel on fit des reproches. « Jabir, lui dit-on, vous avez fait à la jument de votre allié, tout ce qu'il vous a convenu, de faire ; c'est un point que nous vous avons accordé, et maintenant vous voulez vous emparer de.ee qui appartient à cet homme et lui faire une injustice. — N'en dites pas plus long, interrompit. Jabir, et ne m'injuriez pas, car, par la foi d'un Arabe, je ne rendrai pas ce poulain à moins que vous ne me le preniez de force; mais alors je vous ferai la guerre. » En ce moment la tribu n'était.pas disposée à se laisser aller aux dissensions, aussi plusieurs dirent-ils à Jabir : « Nous vous aimons trop pour pousser, les choses si loin: nous sommes alliés et parents, nous ne combattrons pas pour ce différend, quand même il s'agirait d'une idole d'or. » Alors Kerim, fils de Wahhab (c'était le nom du maître de la jument et du poulain, homme renommé par sa générosité parmi les Arabes), Kerim voyant l'obstination de Jabir, lui dit: « O mon cousin! pour le poulain, il est à vous, il vous appartient ; quant à la jument que voilà, acceptez-la en présent de ma main, afin que le poulain et sa mère ne soient pas séparés, et ne laissez croire à personne que je puisse être capable de faire tort à mon parent. »
La tribu applaudit hautement à ce procédé, et Jabir fut si humilié de la générosité qui lui était faite, qu'il rendit le poulain et la jument à Kerim, en y joignant encore une paire de chameaux et de chamelles.
Dahis devint bientôt un cheval parfait à tous égards, et lorsque son maître, Kerim, voulait lui faire disputer la course avec un autre, il le montait lui-même et avait coutume de dire à son antagoniste : « Quand vous partiriez devant moi comme un trait de flèche, je vous rattraperais, je vous dépasserais; » ce qui arrivait effectivement.
Dès que le roi Caïs eut entendu parler de ce cheval, il devint comme hors de lui-même et le sommeil l'abandonna. Il envoya quelqu'un à Kerim pour l'engager à lui vendre ce poulain pour autant d'or et d'argent qu'il en désirerait, ajoutant que ces richesses lui seraient envoyées sans délai. Ce message enflamma Kerim de colère, et Caïs n'est-il donc qu'un sot et un homme mal élevé ? s'écria-t-il. Pense-t-il que je suis un marchand qui vend ses chevaux, et supposerait-il que je suis incapable de les monter moi-même? Oui, j'en jure par la foi d'un Arabe, s'il m'eût demandé Dahis en présent, je le lui aurais envoyé tout aussitôt avec un assortiment de chameaux et de chamelles ; mais si c'est par la voie du trafic qu'il compte l'avoir, cela ne sera jamais, dussé-je boire dans la coupe de la mort. »
Le messager retourna vers Caïs, et lui rapporta la réponse de Kerim, ce qui fâcha beaucoup le roi. « Suis-je le roi des tribus d'Abs, d'Adnan, de Fazarah et de Dibyan, s'écria-t-il, et un vil Arabe sera-t-il assez hardi pour me contredire ! » Il fit avertir aussitôt son monde et ses guerriers. A l'instant les armures, les cottes de mailles, les épées et les casques brillèrent ; les héros montèrent leurs coursiers, agitèrent leurs lances, et l’on se mit en marche vers la tribu de Ryah. A peine y furent-ils arrivés dès le matin, qu'ils se jetèrent à travers les pâturages où ils firent un immense butin en troupeaux, que Caïs abandonna à tous ses alliés. De là ils se portèrent vers les tentes et y surprirent les habitants, qui n'étaient nullement préparés à cette attaque, Kerim étant absent et engagé avec tous ses guerriers dans quelque expédition du même genre. Caïs, à la tête des Absiens, pénétra donc dans les habitations où l'on s'empara des épouses et des filles.
Pour Dahis, il était attaché entre les cordes qui maintiennent les tentes, car Kerim ne s'en servait jamais pour combattre, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque accident, ou qu'il ne fût tué. Un des esclaves resté dans les demeures, et qui s'était aperçu des premiers, de l'invasion des Absiens, alla vers Dahis avec l'intention de rompre la corde qui lui liait les pieds; mais il ne put jamais y parvenir. Toutefois il monta dessus, le poussa de ses talons, et le cheval, bien que ses pieds fussent liés, se mit à fuir en sautant et en cabriolant comme un faon, jusqu'à ce qu'il eût atteint le désert. Ce fut en vain que les cavaliers Absiens coururent après lui; ils ne purent même atteindre la trace de poussière qu'il laissait derrière lui.
Aussitôt que Caïs eut aperçu Dahis, il le reconnut, et le désir de le posséder s'augmenta encore. Il s'avança du côté de celui qui le montait, jusqu'à ce que son regret devînt extrêmement vif, parce qu'il s'aperçut qu'il avait beau le suivre, il ne pourrait jamais l'atteindre. Enfin, lorsque l'esclave se vit à une grande distance des Absiens, il mit pied à terre, délia le pied de Dahis, remonta et partit. Caïs, qui le suivait toujours, avait gagné du terrain pendant la halte ; lorsqu'il fut assez près de l'esclave pour se faire entendre : « Arrête, ô Arabe, cria-t-il, ne crains rien, je te donne ma protection, par la foi d'un noble Arabe! » A ces paroles, l'esclave s'arrêta. « As-tu l'intention de vendre ce cheval? dit le roi Gais; dans ce cas tu as rencontré le plus curieux des acheteurs de tous les guerriers arabes. — Je ne veux point le vendre, monseigneur, répondit l'Arabe, à moins que son prix ne soit la restitution de tout le butin. — Je vous l'achète, dit aussitôt Caïs, » et il tendit la main à l'Arabe pour confirmer le marché. L'esclave consentit, et étant descendu de dessus le jeune cheval, il le livra au roi Caïs qui, plein de joie de voir ses souhaits accomplis, sauta dessus et alla retrouver les Absiens auxquels il ordonna de restituer tout le butin qu'ils avaient fait; ce qui fut exécuté strictement.
Le roi Caïs, enchanté du succès de son entreprise et d'être devenu possesseur de Dahis, retourna chez lui. La passion qu'il avait pour ce cheval était telle, qu'il le pansait et lui donnait la nourriture de ses propres mains.
Sitôt qu'Hadifah, chef de la tribu de Fazarah, sut que Gais possédait Dahis, la jalousie entra dans son cœur. De concert avec d'autres chefs, il médita la mort de ce beau cheval…
Il arriva dans ce temps que Hadifah donna une grande fête. Carwash, parent du roi Caïs, y assistait. A la fin du repas, et quand le vin circulait abondamment autour de la table, la conversation tomba sur les plus fameux chefs de ce temps. Ce sujet épuisé, les convives commencèrent à parler de ceux de leurs chevaux qui avaient le plus de célébrité, puis des courses qui se font dans le désert. « Parents, dit Carwash, on n'a jamais vu un cheval comme Dahis, celui de mon allié Caïs. On chercherait en vain son égal, il effraie par sa rapidité ceux qui le voient courir. Il chasse le chagrin de l'esprit de celui qui le regarde, et il protège comme une tour, celui qui le monte. » Carwash ne s'en tint pas là, et il continua à louer le cheval Dahis, en employant des termes si pompeux et si brillants, que tout ceux de la tribu de Fazarah et de la famille de Ziad sentirent leur cœur se gonfler de colère. « L'entendez-vous, mon frère? dit Haml à Hadifah. Allons, en voilà bien assez, ajouta t-il en se tournant du coté de Carwash. Tout ce que vous venez de dire là au sujet de Dahis n'a pas le sens commun, car en ce moment il n'y a ni de meilleurs ni de plus beaux chevaux que les miens ou ceux de mon frère. » Après ces mots, il ordonna à ses esclaves de faire passer ses chevaux devant Carwash, ce qui fut fait. « Allons, Carwash, regarde ici ce cheval. — Il ne vaut pas les herbes sèches qu'on lui donne, » dit l'autre; alors on fit passer ceux de Hadifah, parmi lesquels était une jument nommée Ghabra et un étalon appelé Marik. « Eh bien ! reprit alors Hadifah, regarde donc ceux-ci. — Ils ne valent pas les herbes sèches dont on les nourrit, » répéta Carwash. Hadifah, outré de dépit en entendant ces paroles, s'écria: « Quoi ! pas même Ghabra? — Pas même Ghabra, ni tous les chevaux de la terre, répéta Carwash. — Voulez-vous faire un pari pour le roi Caïs? — Oui, dit Carwash ; que Dahis battra tous les chevaux de la tribu de Fazarah, quand on lui mettrait même un quintal de pierres sur le dos. » Ils se disputèrent longtemps à ce sujet, l'un disant oui, l'autre non, jusqu'à ce que Hadifah mit fin à cette altercation en disant : « Hé bien, soit ; que le vainqueur prenne du vaincu, autant de chameaux et de chamelles qu'il lui plaira. — Vous me jouerez un mauvais tour, dit Carwash, et moi je ne veux pas vous tromper. Je ne gagerai pas avec vous plus de vingt chameaux : ce sera le prix que donnera celui dont le cheval sera vaincu; » et l'affaire fut ainsi réglée. Ils achevèrent la journée à table jusqu'à la nuit, pendant laquelle ils se reposèrent.
Le lendemain, Carwash sortit de ses tentes de bon matin, se rendit à la tribu d'Abs, alla trouver Caïs et lui fit part de tout ce qui avait eu lieu à l'occasion du pari. « Vous avez eu tort, dit Caïs ; vous auriez pu faire un pari avec qui que ce soit, excepté Hadifah qui est l'homme aux prétextes et aux ruses ; et si vous avez arrêté cette gageure, il faut la rompre. » Caïs attendit que quelques personnes qui étaient auprès de lui, se fussent retirées, puis il monta aussitôt après à cheval et se rendit à la tribu de Fazarah où il trouva tout le monde prenant le repas dans les tentes. Caïs descendit de cheval, se débarrassa de ses armes, s'assit auprès d'eux et se mit à manger comme un généreux Arabe. « Cousin, lui dit Hadifah, désirant le plaisanter, quelles grosses bouchées vous prenez! que le ciel nous préserve d'avoir un appétit semblable au vôtre. — Il est vrai que je meurs de faim, dit Caïs; mais par celui qui a toujours duré et qui durera toujours, je ne suis pas venu ici seulement pour manger votre repas. Mon intention est d'annuler la gageure qui a été faite hier entre vous et mon parent Carwash. Je vous prie de rompre cet arrangement, car tout ce qui se fait et se dit au milieu des flacons, ne compte pas et doit être oublié. — Sachez, Caïs, que je ne renoncerai pas à ce défi, à moins que l'on ne me remette les chameaux et les chamelles. Lorsque cette condition sera remplie, le reste me sera parfaitement indifférent. Cependant, si vous le voulez je m'en emparerai de force, ou, si cela vous fait plaisir, j'y renoncerai, mais à titre de grâce. » Malgré tout ce que Caïs put dire et redire, Hadifah resta inébranlable dans sa proposition, et comme le frère de celui-ci se mit à rire en regardant Caïs, Caïs devint furieux, et le visage rouge de colère il demanda à Hadifah : « Qu'avez-vous parié avec mon cousin? — Vingt chamelles, dit Hadifah. — Pour cette première gageure, continua Caïs, je l'annule, et je vous en proposerai une autre : je parie trente chamelles. — Quarante, reprit Hadifah. — Cinquante, dit Caïs. — Soixante, dit Hadifah, » et ils continuèrent ainsi en élevant toujours le nombre des chamelles jusqu'à cent. Le contrat fut passé entre les mains d'un homme nommé Sabic, fils de Wahhab, et en présence d'une foule de vieillards et de jeunes gens rassemblés autour d'eux. « Quel sera l'espace à parcouru'? fit observer Hadifah à Caïs. — Cent portées de trait, répondit Caïs, et nous avons un archer, Ayas, fils de Mansour, qui mesurera le terrain. » Ayas était en effet le plus vigoureux, le plus habile et le plus célèbre archer qu'il y eût alors parmi les Arabes. Le roi Caïs, par le fait, désirait que la course fût longue à cause de la force qu'il connaissait à son cheval, car plus Dahis avait une longue distance à parcourir, plus il gagnait de vivacité dans ses mouvements par l'accroissement de son ardeur. « Eh bien, déterminez maintenant, dit Caïs, à Hadifah, quand la course aura lieu. — Quarante jours sont nécessaires, répondit Hadifah, à ce que je pense, pour dresser les chevaux. — C'est bien, dit Caïs, » et tous deux convinrent que les chevaux seraient dressés pendant quarante jours, que la course aurait lieu près du lac de Zatalirsad, et que le cheval qui arriverait le premier au but, gagnerait. Toutes les conditions étant réglées, Caïs retourna à ses tentes.
Cependant un des cavaliers de la tribu de Fazarah dit à ses voisins : « Parents, soyez assurés que des dissensions s'élèveront entre la tribu d'Abs et celle de Fazarah, à propos de la course de Dahis et de Ghabra. Les deux tribus, soyez-en certains, seront désunies, car le roi Caïs a été là en personne : or il est prince et fils de prince. Il a fait tous ses efforts pour annuler le pari, ce à quoi Hadifah n'a pas voulu consentir. Tout cela est une affaire dont il suivra une guerre qui peut durer cinquante ans, et il y en aura plus d'un qui périra dans les combats. » Hadifah, ayant entendu ces prédictions, dit: « Je m'embarrasse fort peu de tout cela et je méprise cet avis. — O Hadifah, s'écria Ayas, je vais vous apprendre quel sera le résultat de tout ceci et de votre obstination envers Caïs, et il lui parla ainsi en vers :
« En toi, ô Hadifah, il n'y a pas de beauté, et dans la pureté de Caïs il n'y a point de tache. Combien son avis était sincère et honnête! aussi a-t-il en partagé l'à-propos et les convenances. Parie avec un homme qui n'ait pas même un âne en sa possession, et dont le père n'ait jamais acheté un cheval; mais laisse-là Caïs; il a des richesses, des terres, des chevaux, un caractère fier, et ce Dahis enfin qui est toujours le premier le jour de la course, soit qu'il s'élance ou qu'il soit en repos, ce Dahis, animal dont les pieds même, quand la nuit répand son obscurité, se font apercevoir comme des tisons ardents. Ayas, répliqua Hadifah, penserais-tu que je ne tiendrai pas ma parole? Je recevrai les chameaux de Caïs, et je ne souffrirai pas que mon nom soit mis au nombre de ceux qui ont été vaincus. Laisse aller les choses selon leurs cours. »
Aussitôt que le roi Caïs eut rejoint ses tentes, il s'empressa d'ordonner à ses esclaves de dresser les chevaux, mais de donner particulièrement leurs soins à Dahis, puis il raconta à ses parents tout ce qui avait en lieu entre lui et Hadifah. Antar était présent à ce récit, et comme il prenait un intérêt très vif à tout ce qui touchait ce roi, Caïs, lui dit-il, calmez votre cœur, tenez vos yeux bien ouverts, faites la course, et n'ayez aucune crainte. Car, par la foi d'un Arabe, si Hadifah fait naître quelque trouble et quelque mésintelligence, je le tuerai ainsi que toute la tribu de Fazarah. » La conversation dura sur ce sujet jusqu'à ce que l'on arriva près des tentes dans lesquelles Antar ne voulut pas entrer avant d'avoir vu Dahis. Il tourna plusieurs fois autour de cet animal et reconnut qu'en effet il rassemblait en lui des qualités faites pour étonner tous ceux qui le voyaient….
Hadifah ne tarda pas à apprendre le retour d'Antar et sut que ce héros encourageait le roi Caïs à faire la course. Haml, le frère d'Hadifah, était aussi au courant de ces nouvelles et dans le trouble qu'elles lui causaient : « Je crains, dit-il à Hadifah, qu'Antar ne tombe sur moi ou sur quelqu'un de la famille de Beder, qu'il ne nous tue et que nous ne soyons déshonorés. Renoncez à la course, ou nous sommes perdus. Laissez-moi aller vers le roi Caïs, et je ne le quitterai pas que je ne l'aie engagé à venir vers vous pour rompre le contrat. — Faites comme il vous plaira, répondit Hadifah. D'après cela, Haml monta à cheval, et alla à l'instant même chez le roi Caïs. Il le trouva avec son oncle Asyed, homme sage et prudent. Haml s'avança vers Caïs, lui donna le salut en lui baisant la main, et après lui avoir fait entendre qu'il lui portait un grand intérêt, « O mon parent, dit-il, sachez que mon frère Hadifah est un pauvre sujet dont l'esprit est plein d'intrigues. J'ai passé ces trois derniers jours à lui faire mille représentations pour l'engager à abandonner la gageure. Oui, c'est bien, m'a-t-il dit enfin ; si Caïs revient vers moi, s'il désire d'être débarrassé du contrat, je l'annulerai ; mais qu'aucun Arabe ne sache que j'ai abandonné le pari par crainte d'Antar. Maintenant, Caïs, vous savez qu'entre parents, la plus grande preuve d'attachement que l'on puisse se donner, est de céder. Aussi me suis-je rendu ici pour vous prier de venir avec moi chez mon frère Hadifah, afin de lui demander de renoncer à la course avant qu'il ne s'élève aucun trouble et que la tribu ne soit exterminée de ses terres. » À ce discours de. Haml, Caïs devint rouge de honte, car il était confiant et généreux. Il se leva aussitôt, et laissant à son oncle Asyed le soin de ses affaires domestiques, il accompagna Haml au pays de Fazarah. Lorsqu'ils furent à moitié chemin, Haml se mit devant Gais auquel il prodigua des louanges tout en blâmant la conduite de son frère, par ces mots :
« O Caïs, ne vous laissez pas aller à la colère contre Hadifah, car ce n'est qu'un homme obstiné et injuste, dans ses actions. O Caïs, si vous persistez dans le maintien de la gageure, de grands malheurs s'ensuivront. Vous et lui vous êtes vifs et également emportés, ce qui me donne de l'inquiétude sur vous, Caïs. Mettez de côté, je vous prie, vos intérêts privés, soyez bon et généreux avant que l'oppresseur ne devienne l'opprimé. »
Haml continua d'injurier son frère, en flattant Caïs par son admiration, jusque vers le soir où ils arrivèrent à la tribu de Fazarah. Hadifah, qui en ce moment était entouré de plusieurs chefs puissants sur le secours desquels il comptait au besoin, avait changé d'avis depuis le départ de son frère Haml, et au lieu d'entrer en accommodement et de faire la paix avec Caïs, il avait au contraire pris la résolution de ne céder en rien et de maintenir rigoureusement toutes les conditions de la course. Il parlait même de cette affaire avec l'un des chefs au moment où Caïs et Haml se présentèrent, devant lui.
Sitôt qu'Hadifah vit Caïs, il résolut de l'accabler de honte. Se tournant donc vers son frère. « Qui t'a ordonné d'aller vers cet homme? lui demanda-t-il ; par la foi d'un noble Arabe! quand tous les hommes qui couvrent la surface de la terre viendraient m'importuner et me dire : « O Hadifah, abandonne un poil de ces chameaux, je ne l'abandonnerais pas à moins que la lance n'eut percé ma poitrine et que l'épée eut fait sauter ma tête. » Caïs devint rouge et remonta aussitôt à cheval en reprochant à Haml sa conduite. Il revint en toute hâte chez lui, où il trouva ses oncles et ses frère qui l'attendaient avec une anxiété extrême. « O mon fils, lui dit son oncle Asyed sitôt qu'il l'aperçut, tu viens de faire une triste démarche, car elle t'a déshonoré. — Si ce n'eût été quelques chefs qui entourent Hadifah et lui donnent de perfides conseils, j'aurais accommodé toute l'affaire, dit Caïs; mais maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper du pari et de la course. »
Le roi Caïs se reposa toute la nuit. Le lendemain, il ne pensa plus qu'à dresser son cheval pendant les quarante jours déterminés. Tous les Arabes du pays s'étaient promis entre eux de venir aux pâturages pour voir la course, et lorsque les quarante jours furent expirés, les cavaliers des deux tribus vinrent en foule près du lac de Zatarlirsad. Puis arriva l'archer Ayas qui, tournant le dos au lac, point d'où les chevaux devaient partir, tira en marchant vers le nord, cent coups de flèches jusqu'à l'endroit qui devint le but. Bientôt arrivèrent les cavaliers du Ghitfan et du Dibyan, car ils étaient du même pays, et à cause de leurs relations d'amitié et de parenté on les comprenait sous le nom de tribu d'Adnan. Le roi Caïs avait prié Antar de ne pas se montrer en cette occasion, dans la crainte que sa présence ne donnât lieu à quelque dissension. Antar écouta cet avis, mais ne put rester tranquille dans les tentes. L'intérêt qu'il prenait à Caïs et la défiance que lui inspirait la lâcheté des Fazaréens, toujours prêts à user de trahison, l'engagea à se montrer. Ayant donc ceint son épée Dami,[75] et étant monté sur son fameux cheval Abjer, il se fit accompagner de son frère Chéiboub et se rendit à l'endroit désigné pour la course, afin de veiller à la sûreté des fils du roi Zohaïr. En arrivant il apparut à toute cette multitude comme un lion couvert d'une armure. Il tenait son épée nue à la main et ses yeux lançaient des flammes comme des charbons ardents. Dès qu'il eut pénétré au milieu de la foule : « Holà! nobles chefs arabes et hommes fameux rassemblés ici, cria-t-il d'une voix terrible, vous savez tous que je suis celui qui a été soutenu, favorisé par le roi Zohaïr, père du roi Caïs; que je suis l'esclave de sa bonté et de sa munificence; que c'est lui qui m'a fait reconnaître par mes parents, qui m'a donné un rang et qui enfin m'a fait compter au nombre des chefs arabes. Bien qu'il ne vive plus, je veux lui témoigner ma reconnaissance et faire que les rois de la terre, même après sa mort, lui soient soumis. Il a laissé un fils que ses autres frères ont reconnu et qu'ils ont placé sur le siège de son père, Caïs, qu'ils ont distingué à cause de sa raison, de sa droiture et de ses sentiments élevés. Je suis l'esclave de Caïs, je lui appartiens. Je serai l'appui de celui qui l'aime, l'ennemi de celui qui lui résiste. Il ne sera jamais dit, tant que je vivrai, que j'aie pu supporter qu'un ennemi lui fit un affront. Quant au contrat et à la gageure, il est de notre devoir d'en aider l'exécution. Ainsi il n'y a rien de mieux à faire que de laisser courir librement les chevaux, car la victoire vient du créateur du jour et de la nuit. Je jure donc, par la maison sacrée, par le temple, par le Dieu éternel, qui n'oublie jamais ses serviteurs et qui ne dort jamais, que si Hadifah commet quelque acte de violence, je le ferai boire dans la coupe de la vengeance et de la mort, et que je rendrai toute la tribu de Fazarah la fable du monde entier. Et vous, ô chefs arabes, si vous désirez vraiment que la course se fasse, assistez-y avec justice et impartialité; autrement, par les yeux de ma chère Abla! je ferai marcher les chevaux dans le sang! » —Antar a raison, s'écrièrent de tous côtés les cavaliers.
Hadifah choisit alors, pour monter sa jument Ghabra, un écuyer de la tribu de Dibyan. Cet homme avait passé tous les jours et une partie des nuits de sa vie à élever et à soigner les chevaux. Mais Caïs choisit, pour monter son cheval Dahis, un écuyer de la tribu d'Abs, bien plus instruit et bien plus exercé dans son art que le Dibyanien, et quand les deux antagonistes furent montés chacun sur son cheval, le roi Caïs donna cette instruction à son écuyer:
« Ne lâche pas trop les rênes à Dahis ; si tu t'aperçois qu'il sue, tiens-toi sur l'étrier et presse-lui doucement les flancs avec tes jambes ; mais si tu le pousses trop, tu lui ôteras tout son courage. »
Hadifah entendit ce que venait de dire Caïs, et voulant l'imiter, il répéta :
« Ne lâche pas trop les rênes à Ghabra ; si tu t'aperçois qu'elle sue, tiens-toi sur l'étrier et presse lui doucement les flancs aves tes jambes; mais si tu la pousses trop, tu lui ôteras tout son courage. »
Antar se mit à rire. « Par la foi d'un Arabe, dit-il à Hadifah, vous serez vaincu. Eh ! les expressions sont-elles si rares que vous soyez forcé d'employer précisément celles de Caïs ? Mais, au fait, Caïs est un roi, et le fils d'un roi doit toujours être imité; et puisque vous l'avez suivi mot à mot dans ce qu'il a dit, c'est la preuve que votre cheval suivra le sien dans le désert. »
À ces mots, Hadifah, le cœur gonflé de colère et d'indignation, jura par serment qu'il ne laisserait pas courir son cheval en ce jour et qu'il voulait que la course n'eût lieu que le lendemain au lever du soleil. Au fait, ce délai lui paraissait indispensable pour préparer la perfidie qu'il méditait, car il n'eut pas plutôt aperçu Dahis qu'il resta interdît de l’étonnement que lui causèrent la beauté et les perfections de ce cheval.
Les juges étaient donc déjà descendus de cheval et les cavaliers des différentes tribus se préparaient à retourner chez eux, quand Chéiboub se mit à crier d'une voix retentissante : « Tribus d'As, d'Adnan, dé Fazarsh et de Dibyan,; et vous tous qui êtes ici présents, attendez un instant pour moi, et écoutez des paroles qui seront répétées dé génération en génération? » Tous les guerriers s'arrêtèrent: « Parle, dirent-ils, que veux-tu ? Peut-être y aura-t-il quelque chose de bon dans tes paroles. « O illustrés Arabes, dit alors Chéiboub, vous savez ce qui s'est passé à propos du défi entre Dahis et Ghabra ? hé bien, je vous assure sur ma vie, que je les vaincrai tous deux à la course, quand bien même ils iraient plus vite que le vent. Mais voici ma condition : si je suis vainqueur, je prendrai les cent chameaux mis en gage ; que si, au contraire, je suis vaincu, je n'en donnerai que cinquante. » Sur cela un des cheiks de Fazarah se récria, en disant : « Qu'est-ce que tu dis là, vil esclave ? Pourquoi prendrais-tu cent chameaux si tu gagnes et n'en donnerais-tu que cinquante si tu perds ? — Pourquoi? vieux bouc né sur le fumier, pourquoi ? dit Chéiboub, parce que je ne cours que sur deux jambes et qu'un cheval court sur quatre, sans compter qu'il a une queue. » Tous les Arabes se mirent à rire : cependant, comme ils furent très étonnés des conditions que Chéiboub avait faites et qu'ils étaient extrêmement curieux de le voir courir, ils consentirent à ce qu'il tentât cette chanceuse entreprise.
Mais quand on fut rentré dans les tentes, Antar dit à Chéiboub: « Hé bien, toi fils d'une mère maudite, comment as-tu osé dire que tu vaincrais ces deux chevaux, pour lesquels tous les cavaliers des tribus se sont rassemblés et qui, au dire de tout le monde, n'ont point d'égaux à la course, pas même les oiseaux ! — Par celui qui produit les sources dans les rochers et qui sait tout, répondit Chéiboub, je dépasserai les deux chevaux, fussent-ils aussi prompts que les vents. Oui, et il en résultera un grand avantage : car lorsque les Arabes auront entendu parler de cet événement ils n'auront plus l'idée de me suivre quand je courrai à travers le désert. » Antar sourit, car il se douta du projet de Chéiboub. Pour celui-ci, il alla trouver le roi Caïs, ses frères et tous les spectateurs de la course, et devant eux tous, jura sur sa vie qu'il dépasserait les deux chevaux. Tous ceux qui étaient présents se portèrent témoins de ce qu'il venait de dire, et se séparèrent fort étonnés d'une semblable proposition.
Pour le perfide Hadifah, dès le soir même il fit venir un de ses esclaves, nommé Damès, fanfaron s'il en fut. « O Damés, lui dit-il, tu te vantes souvent de ton adresse, mais jusqu'à présent je n'ai pas eu l'occasion de la mettre à l'épreuve. — Mon seigneur, répondit l'esclave, dites-moi en quoi je pourrais vous être utile. — Je désire, dit Hadifah, que tu ailles te poster au grand défilé. Demeure en cet endroit, et va-t'y cacher demain dès le matin. Observe bien les chevaux et vois si Dahis est devant. Dans ce dernier cas, présente-toi subitement à lui, frappe-le à la tête, et fais en sorte qu'il s'arrête, afin que Ghabra passe devant et que nous n'encourions pas la disgrâce d'être vaincus. Car, je l'avoue, dès que j'ai vu Dahis, sa conformation m'a fait naître des doutes sur l'excellence de Ghabra, et j'ai peur que ma jument ne soit vaincue et que nous ne devenions un sujet de dérision parmi les Arabes. — Mais, seigneur, comment distinguerai-je Dahis de Ghabra quand ils s'avanceront tous deux environnés d'un nuage de poussière ? » Hadifah répondit : « Je vais te donner un signe et t'expliquer l'affaire de manière à ne te laisser aucune difficulté. » En disant ces mots il ramassa quelques pierres à terre, et ajouta : « Prends ces pierres avec toi. Quand lu verras le soleil se lever, tu te mettras à les compter et tu les jetteras à terre quatre à quatre. Tu répéteras cette opération cinq fois, c'est à la dernière que doit arriver Ghabra. Tel est le calcul que j'ai fait, que s'il se présentait à toi un nuage de poussière et qu'il te restât encore quelques pierres dans la main, par exemple, un tiers ou la moitié, ce serait la preuve que Dahis aurait gagné du terrain et qu'il serait devant tes yeux. Alors jette-lui une pierre à la tête comme je t'ai dit, arrête-le dans sa course afin que ma jument puisse le dépasser.[76] » L'esclave consentit à tout. S'étant muni de pierres, il alla se cacher au grand défilé, et Hadifah se regarda comme certain de gagner le pari.
Dès l'aube du jour, les Arabes, venus de tous côtés, étaient rassemblés au lieu de la course. Les juges donnèrent le signal pour le départ des chevaux et les deux écuyers poussèrent un grand cri. Les coursiers partirent comme des éclairs qui éblouissent les yeux, et ils ressemblaient au vent lorsqu'à mesure qu'il court il devient plus furieux. Ghabra passa devant Dahis et le laissa derrière. « Te voilà perdu, mon frère de la tribu d'Abs, cria l’écuyer Fazaréen à l'Absien ; ainsi, arrange-toi pour te consoler de ton malheur. — Tu mens, répliqua l'Absien, et dans quelques instants tu verras jusqu'à quel point tu fais mal ton compte. Attends seulement que nous ayons dépassé ce terrain inégal. Les juments vont toujours mieux dans les chemins difficiles qu'en rase campagne. » En effet quand ils arrivèrent à la plaine, Dahis se lança comme un géant, laissant un sillon de poussière derrière lui. On eût dit qu'il n'avait plus de jambes, on n'apercevait que son corps et en un clin d'œil il fut devant Ghabra. » Holà? cria alors l'écuyer Absien au Fazaréen, envoie un courrier de ma part à la famille de Beder, et toi, goûte un peu de l'amertume de la patience derrière moi. « Cependant Chéiboub, rapide comme le vent du nord, gardait son avance sur Dahis en sautant comme un faon et courant avec la persévérance d'une autruche mâle, jusqu'à ce qu'il arriva au grand défilé où Damès était caché. Celui-ci n'avait encore jeté qu'un peu moins du quart de ses cailloux, lorsqu'il regarda et vit Dahis qui venait. Il attendit que le cheval passât près de lui, et se présentant inopinément à lui en criant, il lui jeta avec force une pierre dans les yeux. Le cheval se cabra, s'arrêta un instant et l'écuyer fut sur le point d'être démonté. Chéiboub fut témoin de tout et ayant regardé l'esclave attentivement, il reconnut qu'il appartenait au lâche Hadifah. Dans l'excès de sa rage, il se jeta en passant sur Damès, le tua d'un coup d'épée, puis il alla à Dahis dans l'intention de lui parler pour le flatter et le remettre en carrière, quand, hélas, la jument Ghabra s'avança rasant la terre comme le vent. Alors Chéiboub, craignant d'être vaincu, pensant aux chameaux qu'il aurait à donner, se mit à courir de toute sa force vers le lac, où il arriva en avance de deux portées de trait. Ghabra vint ensuite, puis enfin Dahis portant sur son front la marque du coup qu'il avait reçu ; ses joues étaient couvertes de sang et de pleurs.
Tous les assistants furent stupéfaits à la vue de l'activité et de la force de Chéiboub ; mais sitôt que Ghabra eut atteint le but, les Fazaréens jetèrent tous de grands cris de joie. Dahis fut ramené tout sanglant et son écuyer apprit à ceux de la tribu d'Abs ce que l'esclave avait fait. Caïs regarda la blessure de son cheval et se fit expliquer en détail comment l'accident avait eu lieu. Antar rugissait décolère, portait la main sur son invincible épée Dami, impatient d'anéantir la tribu de Fazarah. Mais les cheiks le retinrent, bien qu'avec peine ; après quoi ils allèrent vers Hadifah pour le couvrir de honte et lui reprocher l'infâme action qu'il avait faite. Hadifah nia, en faisant de faux serments, qu'il sût rien touchant le coup qu'aurait reçu Dahis, puis ajouta : « Je demande les chameaux qui me sont dus, et je n'admettrai pas la lâche excuse que l'on allègue. »
« Ce coup ne peut être que d'un sinistre augure pour la tribu de Fazarah, dit Caïs; Dieu certainement nous rendra triomphants et victorieux et les détruira tous. Car Hadifah n'a désiré faire cette course que dans l'idée de faire naître des troubles et des dissensions ; et la commotion que va donner cette guerre peut exciter les tribus les unes contre les autres, en sorte qu'il y aura beaucoup d'hommes tués et d'enfants orphelins. » Les conversations s'animèrent peu à peu, devinrent violentes, les cris confus se firent entendre de tous côtés et enfin les épées nues brillèrent. On était sur le point de faire usage des armes, quand les cheiks et les sages descendirent de leurs chevaux, découvrirent leurs têtes, pénétrèrent au milieu de la foule, s'humilièrent et parvinrent à arranger cette affaire aussi convenablement qu'il fut possible. Ils décidèrent que Chéiboub recevrait les cent chameaux de la tribu de Fazarah, montant du pari, et qu'Hadifah mettrait fin à toute prétention et à toute dispute. Tels furent les efforts qu'ils firent pour éteindre les animosités et les désordres prêts à se déclarer au milieu des tribus. Alors les différentes familles se retirèrent dans leurs demeures, mais leurs cœurs étaient remplis d'une haine profonde. L'un de ceux dont le ressentiment parut le plus violent était Hadifah, surtout lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de son esclave Damès. Pour Caïs, il était aussi rempli d'une colère sourde et d'une haine enracinée. Cependant Antar cherchait à le remettre : « O roi, lui disait-il, n'abandonnez pas votre cœur au chagrin; car, j'en jure par la tombe du roi Zohaïr votre père, je ferai tomber la disgrâce et l'infamie sur Hadifah, et ce n'est que par égard pour vous que je l'ai ménagé jusqu'à ce moment. » Bientôt chacun alla retrouver ses tentes.
Dès le matin suivant, Chéiboub tua vingt des chameaux qu'il avait gagnés la veille et en fit la distribution aux veuves et aux blessés. Il en égorgea vingt autres avec lesquels il donna des festins à la tribu d'Abs, y compris les esclaves hommes, et femmes. Enfin, le jour d'après, il tua le reste des chameaux et donna un grand repas près du lac de Zatalirsad, auquel il invita les fils du roi Zohaïr et ses plus nobles chefs. A la fin de cette fête et lorsque le vin circula parmi les assistants, tous louèrent la conduite de Chéiboub.
Mais la nouvelle des chameaux égorgés et de toutes ces fêtes fut bientôt sue de la tribu de Fazarah. Tous les insensés de cette tribu s'empressèrent d'aller trouver Hadifah. « Eh quoi ! dirent-ils, c'est nous qui avons été les premiers à la course, et les esclaves de ces traîtres d'Absiens ont mangé nos chameaux ! Envoyez quelqu'un vers Caïs, et demandez ce qui vous est dû. S'il envoie les chameaux, c'est bien; mais s'il les refuse, suscitons une guerre terrible aux Absiens. » Hadifah leva les yeux sur son fils Abou-Firacah : « Monte à cheval sur-le-champ, lui dit-il, et va dire à Caïs: Mon père dit que vous devez lui payer à l'instant la gageure ; qu'autrement il viendra vous en arracher le prix de vive force et vous précipitera dans l'affliction. » Il y avait alors là présent un chef d'entre les Scheiks qui, entendant l'ordre qu'Hadifah venait de donner à son fils, lui dit : « O Hadifah, n'es-tu pas honteux d'envoyer un tel message à la tribu des Absiens ? Ne sont-ils pas nos parents et nos alliés? Ce projet s'accorde-t-il avec la raison, et le désir d'apaiser les dissensions? l'homme rentable se reconnaît à la générosité et à la bienfaisance. Je pense qu'il serait à propos que tu renonçasses à ton obstination, qui n'aboutira qu'à nous faire exterminer. Caïs a montré de l'impartialité, il n'a fait d'outrage à personne; ainsi, entretiens la paix avec les cavaliers de la tribu d'Abs. Fais attention à ce qui est arrivé à ton esclave Damès: il a frappé Dahis, le cheval du roi Caïs, et Dieu l'en a puni sur-le-champ, il est resté baigné dans son sang noir.[77] Je t'ai conseillé de ne prêter, l'oreille qu'aux bons conseils : agis noblement, et renonce à toute vile pratique. Maintenant que te voilà prévenu sur ta situation, jette un regard prudent sur tes affaires. » Ce discours rendit Hadifah furieux : « Méprisable cheik, chien de traître, s'écria-t-il. Eh quoi! j'aurais peur de Caïs et de toute la tribu des Absiens ! Par la foi d'un Arabe! que tous les hommes d'honneur sachent que si Caïs ne m'envoie, pas les chameaux, je ne laisserai pas une de ses tentes debout. » Le Scheik fut choqué, et pour jeter encore plus de crainte dans l'âme d'Hadifah, il lui parla ainsi en vers :
« L'outrage est une lâcheté, car il surprend « celui qui ne s'y attend pas, comme la nuit enveloppe ceux qui errent dans le désert. Quand l'épée sera une fois tirée, prends garde à ses coups ! Sois juste et ne te revêts pas de déshonneur. Interroge ceux qui connaissent le destin de Themoud et de sa tribu, lorsqu'ils commirent des actes de rébellion et de tyrannie ; on te dira comment un ordre du Dieu d'en haut, les a détruits en une nuit ! oui en une nuit. Et le lendemain ils étaient tous gisant sur la terre, les yeux tournés vers le ciel.[78] »
Hadifah non seulement montra du mépris pour ces vers et le cheik qui les avait prononcés, mais il ordonna aussitôt à son fils de retourner vers Caïs au moment même. Abou-Firacah retourna donc à la tribu d'Abs, et sitôt qu'il fut arrivé, il se rendit à la demeure de Caïs qui était absent. L'envoyé demanda alors sa femme Modelilah, fille de Rebia. « Que voulez-vous de mon mari? lui dit-elle. — Je demande ce qui nous est dû, le prix de la course. — Malheur sur toi et sur ce que tu demandes ! répliqua-t-elle, fils d'Hadifah ! ne crains-tu pas les suites d'une telle perfidie? Si Gais était ici, il t'enverrait à l'instant même dans la tombe ! » Abou-Firacah revint vers son père, auquel il rapporta ce que la femme de Caïs lui avait dit. « Eh quoi ! lâche, s'écria Hadifah, tu reviens sans avoir fini cette affaire! est-ce que tu as eu peur de la fille de Rebia? Retourne. »
Cependant Abou-Firacah ayant fait observer à son père qu'il était presque nuit déjà, le message fut remis au lendemain.
Pour Caïs, lorsqu'il rentra chez lui, il apprit de sa femme qu'Abou-Firacah était venu pour lui demander les chameaux. « Par la foi d'un Arabe, dit-il, si j'avais été là, je l'aurais tué. Mais c'est une affaire finie, laissons aller cela ainsi. » Cependant le roi Caïs passa la nuit dans le chagrin et la tristesse jusqu'au lever du soleil, heure à laquelle il se rendait à sa tente. Antar vint le voir; Caïs se leva, puis l'ayant fait asseoir auprès de lui, il lui parla d'Hadifah. « Croiriez-vous, lui dit-il, qu'il a eu l'impudence d'envoyer son fils me demander les chameaux? Ah ! si j'eusse été présent, j'aurais tué ce messager. » Il finissait à peine de prononcer ces mots quand Abou-Firacah se présenta à cheval devant lui. Sans descendre, sans faire ni salut ni avertissement, il dit : « Caïs, mon père désire que vous lui envoyiez ce qui lui est dû ; en agissant ainsi, votre conduite sera celle d'un homme généreux ; mais dans le cas contraire, mon père s'élèvera contre vous, reprendra son bien par la force, et vous plongera dans l'affliction. »
En entendant ces mots, Caïs sentit la lumière se changer en obscurité dans ses yeux : « O toi, fils d'un vil cornard, cria-t-il, comment se fait-il que tu ne sois pas plus respectueux en m'adressant la parole? » Il saisit une javeline et la lança dans la poitrine d'Abou-Firacah. Percé de part en part, le jeune messager se laissa aller sur son coursier, d'où Antar le prit et le jeta à tente. Puis ayant tourné la tête du cheval du côté de Fazarah, il lui donna un coup de houssine dans le flanc. Le cheval prit le chemin de ses pâturages, et rentra enfin dans son. établi tout couvert de sang. Aussitôt les bergers le conduisirent aux tentes, criant : Malheur! malheur!
Hadifah devint furieux. Use frappait la: poitrine en répétant : « Tribu de Fazarah ! aux armes ! aux armes ! aux armes! » et tous les insensés de s'approcher de nouveau d'Hadifah et de l'engager à déclarer la guerre.aux Absiens et à se venger d'eux. « O mes parents, reprit bientôt Hadifah, qu'aucun de nous ne repose cette nuit, que tout armé ! » Ce qui eut lieu.
A la pointe du jour Hadifah était à cheval, les guerriers étaient prêts, et on ne laissa dans les tentes que les enfants et ceux qui n'étaient point en état de combattre.
De son côté, Caïs, après avoir tué Abou-Firacah, pensa bien que les Fazaréens viendraient, l'attaquer, lui et ses guerriers; il se prépara donc au combat. Ce fut Antar qui se chargea de toutes les précautions à prendre en ce cas. Il ne laissa donc dans les tentes que les femmes, les enfants et tous ceux qui.ne pouvaient porter l'épée, puis il se mit à la tête, des héros de Carad. Rien n'était plus resplendissant que tous ces Absiens couverts de leurs cottes de mailles et de leurs armures luisantes. Ces apprêts jurent un terrible moment pour les deux partis. Ils marchaient l'un contre l'autre, et le soleil paraissait à peine, que les cimeterres étincelaient et que toute la contrée était en émoi.
Antar était impatient de se jeter en avant et de soulager son cœur en combattant; mais voilà qu'Hadifah s'avance, vêtu d'une robe noire, le cœur brisé de là mort de son fils. « Fils de Zohaïr, cria-t-il à Caïs; c'est une vilaine action que d'avoir tué un enfant; mais il est bien de se présenter au combat pour décider, par ses lances, qui mérite le commandement de vous ou de moi. » Ces paroles blessèrent Caïs. Entraîné par le ressentiment, il s'échappa de dessous ses étendards et se rua sur Hadifah. Ce rat alors que ces deux chefs, animés par une haine mutuelle, combattirent ensemble de dessus leurs nobles coursiers jusqu'à la nuit. Caïs était monté sur Dahis et Hadifah sur Ghabra. Dans le cours de ce combat il se passa des faits d'armes qui n'avaient jamais été vus avant. Chaque tribu désespérait de son chef, et elles voulaient faire une attaque générale afin de suspendre leurs efforts et diminuer la fureur qu'ils mettaient à se combattre. Alors les cris commencèrent à se faire entendre dans les airs. Les cimeterres furent tirés et les lances s'avançaient entre les oreilles des chevaux arabes. Antar s'approcha de quelques chefs Absiens et leur dit : « Attaquons ces lâches. » Ils allaient partir, quand les anciens des deux tribus s'avancèrent au milieu de la plaine, la tête découverte, les pieds nus et les idoles[79] suspendues à leurs épaules. Placés entre les deux armées, ils parlèrent ainsi : « Parents et alliés, au nom de l'union qui a régné jusqu'ici entre nous, ne faisons rien qui nous rende la fable de nos esclaves. Ne fournissons pas à nos ennemis et à nos envieux, une occasion de nous faire de justes reproches. Oublions tout sujet de dispute et de dissension. Des femmes ne faisons point des veuves, ni des enfants des orphelins. Satisfaites votre ardeur pour les combats en attaquant ceux d'entre les Arabes qui sont vraiment nos ennemis ; et vous, parents de Fazarah, montrez-vous plus humbles envers vos frères les Absiens. Surtout n'oubliez pas que l'outrage a souvent causé la perte de maintes tribus, qui se sont repenties de leur action impie ; qu'il a privé bien des hommes de leurs propriétés, et qu'il en a plongé un grand nombre dans le puits du désespoir et du regret. Attendez donc l'heure fatale de la mort, le jour de la dissolution, car il est là. Alors vous serez déchirés par les aigles menaçantes de la destruction, et vous serez enfermés dans les réduits ténébreux du tombeau. Faites donc en sorte que quand vos corps seront inanimés on ne conserve, en pensant à vous, que le souvenir de vos vertus. » Les cheiks parlèrent longtemps et jusqu'à ce que la flamme des passions qui s'était allumée dans l'âme des héros fût éteinte.
Hadifah se retira du combat, et il fut convenu que Caïs paierait le prix du sang d'Abou-Firacah avec une grande quantité de troupeaux et une file de chameaux. Les Scheiks ne voulurent pas môme quitter le champ de bataille avant que Caïs et Hadifah ne se fussent embrassés et n'eussent consenti à tous les arrangements.
Antar rugissait de fureur : « O roi Caïs, que faites-vous là ? s'écria-t-il. Quoi ! nos épées nues brillent dans nos mains, et la tribu de Fazarah exigera de nous le prix du sang de son mort ! Et nos prisonniers, nous ne pourrons les racheter qu'avec la pointe de nos lances ! Le sang de notre mort aura été versé, et nous ne le vengerons pas? » Hadifah était hors de lui en entendant ces paroles. « Et toi, vil bâtard, lui dit Antar en l'apostrophant, toi, fils d'une vile mère, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse t'honorer, et nous, nous flétrir ? Si ce n'était la présence de ces nobles cheiks, je t'anéantirais, toi et ton monde, sur-le-champ. » Alors l'indignation et la colère d'Hadifah furent portées à leur comble. « Par la foi d'un Arabe, dit-il aux Scheiks, je ne veux plus entendre parler de paix, quand même l'ennemi devrait me percer de ses lances. — Ne parlez pas de la sorte, fils de ma mère, dit Haml à son frère. Ne vous élancez pas sur la route de l'imprudence ; abandonnez ces tristes résolutions. Restez en paix avec nos alliés les Absiens, car ils sont les étoiles brillantes, le soleil resplendissant qui conduit tous les Arabes qui aiment la gloire. Ce n'est que l'autre jour, lorsque vous les avez outragés en faisant frapper leur cheval Dahis, que vous avez commencé, à vous éloigner de la voie de la justice. Quant à votre fils, il a été tué justement, car vous l'avez envoyé demander une chose qui ne vous était pas due. D'après tout cela, il n'y a rien de plus convenable que de faire la paix, car celui qui cherche et provoqué la guerre est un tyran, un oppresseur. Acceptez donc les compensations qui vous sont offertes, ou vous allez faire naître encore autour de nous, une flamme qui nous brûlera des feux de l'enfer, Haml continua en récitant ces vers:
« Par la vérité de celui qui a fortement enraciné les montagnes sans fondation, si vous n'acceptez pas les compensations des Absiens vous êtes dans l'erreur. Ils reconnaissent Hadifah pour un chef; sois donc véritablement un chef, et contente-toi des richesses, et des troupeaux qui te sont offerts. Descends de dessus le cheval de l’outrage et ne le monte plus, car il te conduirait à la mer des chagrins et de l’affliction. Hadifah, renonce en homme généreux à toute violence, mais particulièrement à l'idée de combattre les Absiens. Fais d'eux et de leur supériorité, au contraire, un puissant rempart pour nous, contre les ennemis qui pourraient nous attaquer. Fais d'eux des amis qui nous restent fidèles, car ce sont des hommes qui ont les plus nobles intentions ; ce sont des Absiens enfin, et si Caïs a agi avec toi d’une manière injuste, c’est toi qui le premier lui as donné cet exemple, il y a quelques jours. »
Dès qu’Haml eut achevé de réciter ces vers, les chefs des différentes tribus lui adressèrent des remerciements, et Hadifah ayant consenti à accéder la compensation offerte, les Arabes renoncèrent à la violence et à la guerre. Tous ceux qui portaient les armes rentrèrent chez eux. Caïs envoya à Hadifah deux cents chamelles, dix esclaves mâles, dix femelles et dix têtes de chevaux. Alors la paix fut rétablie, et tout resta tranquille dans le pays.
[1] Extrait du manuscrit de la Bibliothèque royale n° 374, suppl. arabe, IIIe volume, p. 20 et suiv.
[2] Zohaïr est le Nestor de l'épopée d'Antar. Chef des Absites, il était établi dans ses domaines, et les Arabes, ainsi que les rois de ce temps, lui étaient soumis et lui offraient des présents. On prétend qu'il a gouverné despotiquement pendant un temps toutes les peuplades de la tige de Qays-Aylân. Ce qui paraît certain, c'est que les princes des autres tribus, ainsi que les habitants du désert, redoutaient sa puissance et ses déprédations.
[3] Les Absites, ou enfants d'Abs, occupaient le pays de Cahtan.
[4] La terre de Charabbah était limitrophe du territoire des Bènou-Mouhàrib-ibn Khauafah.
[5]
 «
Vallée des chamelles. »
«
Vallée des chamelles. »
[6] On rencontre à tout instant dans le manuscrit ces mots écrits en rouge « kâl er-raoury, kâl en-nàkil, kâl el-Asmay. Le chroniqueur a dit, le transcripteur a dit, El-Asmay a dit. » Ces formules sont l'équivalent d'un simple alinéa. J'ai cru devoir conserver dans la traduction la physionomie du modèle.
[7] Les Arabes Bédouins sont divisés par tribus, qui constituant autant de peuples particuliers. Chacune de ces tribus s'approprie an terrain qui forme son domaine ; elles ne différent à cet égard des nations agricoles qu'en ce que ce terrain exige une étendue plus vaste, pour fournir à la subsistance des troupeaux pendant toute l'année. Chacune de ces tribus compose un ou plusieurs camps, qui sont répartis sur le pays, et qui en parcourent successivement les parties à mesure que les troupeaux les épuisent. (Volney, Voyage en Syrie et en Egypte. tom. II, p. 106 et 107.)
[8] Il y a dans
l'arabe un jeu de mots produit par le rapprochement des expressions
 (venatio)
et
(venatio)
et
 (venatus
fuit),
qu'il est impossible de rendre en
français. A côté du dernier mot, je rappellerai le vers spirituel
d'Ovide :
(venatus
fuit),
qu'il est impossible de rendre en
français. A côté du dernier mot, je rappellerai le vers spirituel
d'Ovide :
................ Quae me nuper praedata puella est.
[9] L'arak est un arbre dont les feuilles servent de nourriture aux chameaux. — Avicenne (1ère part. pag. 372,1. 6) donne une définition très courte de cet arbre :

Selon les poètes arabes, les colombes aiment à se reposer sur les branches de cet arbre, comme le prouvent plusieurs vers que j'ai extraits. Je me contenterai d'en citer un seul, emprunté à l'Anthologie arabe de M. Grangeret de Lagrange, p. 58 :

Colombes qui habitez l'arak, portez le message d'un amant qui ne peut revenir de son ivresse.
[10] Les enfants d’Abs et d’Adnan. «The present arabians, according to their own historians, are sprung from two stocks, Kahhtâu, the same with Joctân, the son of Eber, and Adnan, descended in a direct line from Ismael, the son of Abraham and Hagar. The pos-terity of the former they call al Arab al Ariba, i. e. the genuine or pure Arabs; and those of the latter al Arab al Mostâreba, i. e. naturalized or insititious Arabs. (Sale’s Coran, prelim. disc. p. 7.)
[11] Chéiboub est le frère utérin d'Antar. On se plaît à reconnaître en lui le type primitif des écuyers de nos chevaliers errants. Chéiboub, c'est la ruse et le courage personnifiés. Il est vif, ingénieux, d’une activité infatigable. Il est le compagnon de son frère dans toutes ses entreprises; il le suit à pied, il l'aide de ses conseils, de ses stratagèmes et de son arc, dont il tire avec une adresse prodigieuse. En route, il le console, il le distrait par ses récits; c'est lui qui va à la découverte, qui trompe l'ennemi, qui rapporte des vivres. Là où il faut du secours, il sait arriver à propos et à point; le malheur appelle sa sympathie; les cris de la douleur trouvent un écho dans son cœur; en un mot, il est le bouclier du faible, l’épée de l'opprimé et le sauveur de tous.
[12] Labna, pour appartenir à Hârith sans crainte et sans réserve, lui fait proposer de l'enlever de sa patrie; car les filles, dans les romans arabes, font plus de la moitié du chemin. Chézy dit dans les notes de sa traduction intitulée : Medjnoun et Leila : « La servitude dans laquelle gémissent les femmes asiatiques dans leurs tristes harems n'était pas à beaucoup près aussi rigoureuse autrefois qu’elle l'est aujourd’hui, si nous en jugeons par la peinture des mœurs orientales telles quelles nous sont représentées dans les Mille et une Nuits, ouvrage vraiment précieux sous ce rapport. La facilité de se voir entre les deux sexes devait être encore plus grande parmi les peuplades du désert. »
[13] Les déserts. Quand on lit le roman-épopée des Bédouins, il faut s'habituer à ces expressions fréquentes : Ils traversèrent les déserts et les vastes solitudes. « Pour se peindre ces déserts, dit Volney (Voyage en Egypte et en Syrie, tom. II, p. 94), que l’on se figure, sous un ciel presque toujours ardent et sans nuages, des plaines immenses et à perte de vue, sans maisons, sans arbres, sans ruisseaux, sans montagnes. Quelquefois les yeux s'égarent sur un horizon ras et uni comme la mer; en d'autres endroits, le terrain se courbe en ondulations, ou se hérisse de rocs et de rocailles. Presque toujours également nue, la terre n'offre que des plantes ligneuses clairsemées et des buissons épars. Tel est le pays qui s'étend depuis Alep jusqu'à la mer d'Arabie, et depuis l'Egypte jusqu'au golfe Persique. »
[14] Cette métaphore revient souvent chez les auteurs arabes. Fakr-Eddin qualifie ainsi Yahya et ses fils :
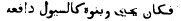
Yahya et ses fils étaient comme des torrents auxquels rien ne résiste. (Chrestomathie arabe de Silvestre de Sacy, tom. I, p. 8.)
[15] ………………………………...…et ipse
Fulmineus Mnestheus.......................................
Virgile. Enéide. l. IX, v. 812.
On lit dans les Chants d'Ossian une métaphore analogue : « Ryno s'avance comme une colonne de feu. » (Tom. II, chant iii.)
[16] Ghoul,
en arabe
 . Voir les Séances de Hariri,
commentaire de la 37e mékamat, p. 416, l. 7. — On lit
dans les Mille et une Nuits, édition de Habicht, tom. IV, p. 245:
. Voir les Séances de Hariri,
commentaire de la 37e mékamat, p. 416, l. 7. — On lit
dans les Mille et une Nuits, édition de Habicht, tom. IV, p. 245:
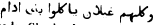
Ce qui prouve que les Ghouls, dans l'imagination des Orientaux, ne sont autre chose que les vampires des superstitions occidentales.
[17] O fils du
vent  . Ce surnom est adressé à
Chéiboub, par allusion à la vélocité de ses pieds, qui lui
permettaient de devancer des chevaux à la course. C'est de lui qu'on
pourrait dire :
. Ce surnom est adressé à
Chéiboub, par allusion à la vélocité de ses pieds, qui lui
permettaient de devancer des chevaux à la course. C'est de lui qu'on
pourrait dire :
Vole au désert, plus prompt que la rafale. (Millevoye, t. Ier, p. 133.)
ou bien :
........................................Levem seu poscat aperto
Aequore inire fugam, pedibusque lacessere ventos. (Jean Commire)
[18] « The well Zemxem on the east side of the Kaaba, is covered with a small building or capola. The Mohammedans are persuaded it is the very spring which gushed out for the relief of Ismael, when Hagar his mother wandered with him in the desert. » (Sale’s Coran, prelim. disc. p. 91.) — Voyage en Arab. Burckhardt, t. Ier, p. 190. — Vie de Mahom. Gaguier, t. Ier p. 27, 78. — D'Herbelot, Bibl. orient.
[19] Voir la
note de M. Marcel sur l'expression
 (Contes
arabes, tom. I, p. 429).
(Contes
arabes, tom. I, p. 429).
[20] L'intérêt de la sûreté commune a dès longtemps établi chez les Arabes une loi générale, qui veut que le sang de tout homme tué soit vengé par celui de son meurtrier ; c'est ce qu'on appelle târ ou talion. Le droit en est dévolu au plus proche parent. Son honneur, devant tous les Arabes, y est tellement compromis, que, s'il néglige de prendre son talion, il est à jamais déshonoré. » (Volney, Voyage en Egypte, t. II, p. 108.)—Burckhardt, Voy. en Arabie, t. III, p. 112.
[21] ……………….O Fortuna potens, quam variabilis,
Nec servare potes muneribus fidem !........... (Lucius Attius).
............. Nulla est mortalibus usquam,
Fortuna titubante, fides. (Stace).
[22] ........................................ ingens concorsus ad ipsa
Corpora, seminecesque viros, tepidaque recentem
Caede locum, et pleno spumantes sanguine rivos.
Virgile, Enéide. liv. IX, v. 454.
[23] ................................Quo deinde fugam ? quo tenditis inquit,
Quos alios muros, quae jam ultra moenia habetis ?
Unus homo, et vestris, o cives, undique septus
Aggeribus, tantas strages impune per urbem
Ediderit? juvenum primos tot misent Orco ?
Virgile, Enéide, liv. IX, v. 781.
[24] Voir l'observ. intéress. de M. Marcel, Contes arabes, t. III, p. 458, et d’Herbelot, à l'article Djan.
[26] Virgile s'exprime ainsi :
Quam multa in silvis autumni frigore primo
Lapsa cadunt folia ;
Virgile, Enéide. liv. VI, v. 309.
Milton emploie la même comparaison :
………………………………… and call'd
His legions, angel forms, who lay intranced,
Thick as automnal leaves that strow the brooks
In Vallombrosa.
Parad. lost, liv. I, v. 399
Le grec dit cela en un seul mot: καταφυλλοπόουσι, mot nombreux qu'on ne peut rendre eu français que par quatre ou cinq qui n'ont pas beaucoup d'harmonie.
[27] La même image se trouve reproduite dans ces deux vers espagnols :
Mientras la noche vecina
Su manto piadoso esparce.
XLVIII romance
[28] Alipedumque fugam cursu tentavit equorum. Virgile, Enéide. liv. XII, v. 481.
Les Arabes citent, comme d'excellents coureurs, Taabbata-Scharran et Chanfarâ, tous deux poètes. Le dernier, dans son poème intitulé : Lamiyat alarab, vante en ces termes son excessive vitesse : « Les qatâs, au plumage cendré, ne parviennent à boire que mes restes, après qu'ils ont volé toute une nuit d’un vol bruyant, pour se désaltérer au matin. Nous partons ensemble, excités par un même désir. C'est à qui arrivera le premier à la citerne. Les qatâs, avec leurs ailes pendantes, ressemblent à des coureurs dont la course est entravée par leurs robes flottantes ; moi, au contraire, de qui la blouse est relevée dans ma ceinture, je les devance sans effort, et deviens le chef de leur troupe. » (Traduction de M. Fresnel.) Voir la Chrestomathie arabe (de Sacy, tom. II, p. 360; Voyage en Arabie (Burckhardt), t. III, p. 71.
[29] … ac videt Euryaluin, quem jam manus omnis
Fraude loci et noctis, subito turbante tumultu,
Oppressum rapit, et conantem plurima frustra.
Virgile. Enéide liv. IX, v. 396.
[30] Les chevaux d Antar. Pour comprendre cet incident, il est indispensable de connaître un fait antérieur, dont je vais donner la traduction : « Antar et ses compagnons se dirigèrent vers la terre du Hedjaz. Leur voyage se prolongea jusqu'à ce qu'ils eurent atteint les frontières de ce pays, où ils s'arrêtèrent pour passer la nuit au bord d'une citerne appelée Kywam. Antar désirait faire la garde; mais Orwah s'y opposa en disant : O père des cavaliers, c'est moi qui, cette nuit, au milieu des déserts, m'acquitterai de ce devoir envers vous. Aussitôt que l'obscurité fut complète, il sortit avec cinq cavaliers d'élite. Ils s'avancèrent dans la plaine, suivant tantôt une direction, tantôt une autre, et ne cessèrent leurs tournées qu'au moment où la nuit leur parut tranquille, et que tout fut plongé dans le repos. Mais comme une brise douce et calme souillait sur eux, l'assoupissement s'empara de leurs yeux, ils s'endormirent, et ne se réveillèrent qu'au lever de l'astre étincelant du jour. Alors ils reprirent la route du camp, et arrachèrent leurs compagnons à la sécurité du sommeil. On se leva, on se prépara au départ : mais on ne put trouver un seul cheval..... » (Manuscrit, t. III, fol. 17.)
[31] Et subito casu, quae valuere, ruunt. Ovide.
[32] Infusion de coloquinte, — On lit dans le Hamaça, p. 166 :
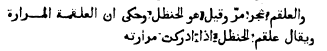
Malgré le peu de connaissances que j'ai acquises en persan, je cède au plaisir de citer quelques vers de Kaschéfi (Anwuri Soheïli. p. 73), dont j'emprunte la traduction à une note de M. Garcin de Tassy (les Oiseaux et les Fleurs), p. 189 :
Mon ami, n'étends pas la main du désir sur la table de ce monde : les mets délicieux qui la couvrent sont empoisonnés.
N'espère point que ce monde te donne jamais un sorbet de miel ; le miel qu'il offre est mêlé avec du poison induit par les apparences, tu crois que c'est véritablement du miel ; mais non, c'est la coupe de la mort.
[34] D'un dirhem. — Hyperbole extraordinaire dont l'énergie surpasse l'orgueil des héros d'Homère, de Virgile et de l’Arioste.
Le dirhem était anciennement une monnaie d'argent équivalant à la vingt-cinquième partie du dinar.
[35] Je retrouve la même idée, mais plus développée, dans ces trois vers de Mouhalhil, traduits par M. Fresnel dans ses Lettres sur l'Histoire des Arabes avant l'islamisme, p. 22 :
Aussi, tandis que la jeune fille teint ses doigts avec le suc du henné, nous n'avons pas un cavalier qui n'ait teint du sang ennemi le fer de sa lance.
Les lances que brandissent les enfants de Taghlib sont de bonnes hampes de l'Inde, aux articles gris-cendré, préparées à Khatt-Hadjar, surmontées d'un fer bleuâtre.
Quand ils les mènent à l'abreuvoir, les fers en sont blancs ; ils sont rouges quand ils les ramènent.
On lit, dans les Amours de Rhodantes et Dosiclès, par le philosophe Prodromus, p. 242, cette expression hardie, (μεθυσθεῖσα σπάθη, ebrius ensis, qui est de la même famille que l'hyperbole arabe.
Plusieurs poètes latins ont dit avec autant d'exagération :
…. Barbaricos sitientia tela cruores. (Claudien.)
…………… Cruorem,
Tela bibunt.
Sil. Italicus.
………….. Satiatur sanguine ferrum. (Lucain).
[36]
 , le pays de la Perse. (Voir la
Chrest. ar. de Sacy,
, le pays de la Perse. (Voir la
Chrest. ar. de Sacy,
t. Ier, p. 454; les Invasions des Sarrasins en France, par M. Reinaud, p. 282.) — Les Grecs ont connu ce nom et l'ont exprimé par Αχεμενίδες. (Volney, Voyage en Ég. t II, p. 84.)
[37] Ce vers d'Abou'lâla renferme la même pensée :

Et comment se mesurera-t-il avec le fils de Hosein, l'adversaire qui tremble au seul récit de ses exploits?
Caroli Riou de Abul Ala vita et carminibus, p. 19.
[38] On lit dans Shakespeare (Coriolan) une expression non moins énergique : his sword death's stamp, « son épée, timbre de mort. »
[39] Les Arabes attribuaient aux vautours une longévité extraordinaire, et c'est à cette notion que se rattache la fable des vautours de Lokman.
[40] Cette allocution de l'émir rappelle le passage de l'Arioste où Charlemagne encourage ses troupes contre Rhodomont:
Sono le forte rostre ont si fruste
Che s'ucciaeste lui, Trojano, e Almonte
Con cento mfla ( or ne temete un solo
Pur di quel tangue, pur di quello stuolo ?
Orlando furioso. ch. XVII, st. xiv.
Hé quoi ! n'êtes-vous plus ces guerriers intrépides !
…………………………………………………
Maintenant, terrassés par d'indignes alarmes,
Vous craignez un seul homme ; un seul aura l'honneur
D'ôter à votre nom sa première splendeur.
[41] Au commencement du roman, Antar est considéré comme fils d'une esclave noire, parce que, lors de sa naissance, Zébiba était en état de servitude; mais, dans la troisième partie de l'ouvrage, le héros de la tribu d'Abs parvient à connaître le mystère de sa généalogie du côté de sa mère. Il porte la guerre dans les tribus et jusque dans les pays les plus éloignés de l'Arabie. Il va à Constantinople et en Europe; il s'empare de cette partie de l'Arabie qui était habitée par les Éthiopiens, parmi lesquels il découvre les parents de sa mère Zébiba, et acquiert la certitude qu'elle est fille d'un puissant monarque, et qu'il descend, par son père et par sa mère, de races royales.
[43] On se rappelle que Djérir, fils de Kâdim, était détesté de Labna, et n'avait pu réussir à l'épouser.
[44] En cet
endroit, la transition est ménagée par l'intercalation du mot
 , qui signifie: « cela avait
lieu, » et que l’on trouve toujours écrit en rouge dans le courant
de l'histoire d'Antar.
, qui signifie: « cela avait
lieu, » et que l’on trouve toujours écrit en rouge dans le courant
de l'histoire d'Antar.
[45] A la fin
d'une guerre où Antar avait fait des prodiges de valeur, le roi
Zohaïr l'appela Abou'lfawaris  ,
surnom qui lui resta, et qui signifie : « le père des cavaliers. »
,
surnom qui lui resta, et qui signifie : « le père des cavaliers. »
Elle rit, et l'on voit briller ses dents : on dirait la lueur d'un éclair autour d'un astre. (Anthologie arabe d’Humbert, p. 65.)
[47] « Le mot que je rends par saule, a été généralement traduit par myrobalanier, mais M. Garcin de Tassy a bien établi, dans l'ouvrage intitulé : Les Oiseaux et les Fleurs, p. 142 et suiv. que l'arbre auquel les poètes arabes d'Egypte ont coutume de Comparer la taille svelte et flexible de leurs maîtresses, est le saule, appelé par Linné salix aegyptiaca. Forskal, qui a vu cet arbre en Egypte, le décrit et lui donne les deux noms. (Flor. aegypt. arab. pl. LXXVI, et centur. vi, n° 63, p. 170.) Ici vient en son lieu cette comparaison d'un poète arabe :
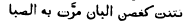
Elle se balance comme une souple tige de myrobalanier (saule), près de laquelle aurait passé le zéphyr. (Anthologie arabe d’Humbert, p. 65.)
[48] On lit
dans le savant ouvrage de M. Garcin de Tassy (Les Oiseaux
et les Fleurs, p. 138) : « il paraît plus
probable que le  est le
narcissus
orientalis,
qui croît dans les campagnes de
l’Orient, que le
narcissus
tazetta,
qui se trouve sauvage en France,
en Espagne et en Portugal. Les deux espèces se ressemblent
d'ailleurs beaucoup, et l’on peut facilement les confondre : leurs
fleurs sont également blanches, à centre jaune, et très
odoriférantes. »
est le
narcissus
orientalis,
qui croît dans les campagnes de
l’Orient, que le
narcissus
tazetta,
qui se trouve sauvage en France,
en Espagne et en Portugal. Les deux espèces se ressemblent
d'ailleurs beaucoup, et l’on peut facilement les confondre : leurs
fleurs sont également blanches, à centre jaune, et très
odoriférantes. »
[49]
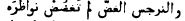 Et le frais narcisse, dont les
yeux ne se ferment jamais. (Anthologie arabe de
Humbert, p. 35.)
Et le frais narcisse, dont les
yeux ne se ferment jamais. (Anthologie arabe de
Humbert, p. 35.)
Les poètes arabes, qui animent tout dans la nature, donnent des doigts au lys, des yeux au narcisse et au souci.
[50] Antar aime sa cousine Abla, fille de Malik, fils de Karâd, et, pour arriver à obtenir sa main, il est obligé d'accomplir une série d'exploits qui l'en éloignent sans cesse.
[51] La même idée se trouve dans un autre chant d'Antar :
Abla, garde la paix du cœur ; il le faut, je t'en conjure. Sache donc bien que je suis homme ; que je ne succombe pas dans les périls de la guerre, n'en dois-je pas moins mourir ? (Lettre de M. Perron, Journal asiatique, 1840, p. 37.)
[52] « The ceremonies of the pilgrimage, by the confession of ibn Mohammedans themselves, were almost all of them observed by the Pagan Arabs many ages before their prophet's appearance. » (Sales Coran. prelim. disc. p. 93.
[53] Manuscrit de la Bibliothèque impériale, n° 1683, suppl. arab. v. 2, fol. 323 v.
[54] Charichi, Commentaire sar la xiiie maqâma de Hariri.
[55] Aghâni, iv, 260 v. et Cazwini, IVe climat, art. Gharyani.
[56] Maydani, au proverbe Atetka bihdînin ridjlâhou. Hamza ap. Rasmussen, p. 15, 38. Ces auteurs ont été cités par M. Caussin de Perceval. (Voyez son ouvrage, t. II, p. 104 et suiv. 144.) L'auteur du roman d'Antar a étendu le récit de Maydani. (Voyez l'explication du proverbe : « Le jour de demain est proche pour qui l'attend. » M. P. A Kunkel, dans sa Notice sur la collection des proverbes arabes de Maydani, a donné la traduction de ce proverbe et du commentaire. (Voyez Journal asiatique, octobre 1826, p. 231.)
[57] Voyez la nouvelle édition des Séances de Hariri, par MM. Reinaud et Derenbourg, p. 150.
[58] 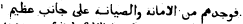 .
Il les trouva, en fait de
fidélité et de vigilance, d'un côté magnifique. Cette expression
tient ici la place du superlatif.
.
Il les trouva, en fait de
fidélité et de vigilance, d'un côté magnifique. Cette expression
tient ici la place du superlatif.
[59] Il y a dans le texte, des longs, des courts, en argent, or et cristal.
[60] Le luth était ainsi propre à rendre les plaintes, les soupirs des amants.
[61] Sur le mètre ramal.
[62] Sur le mètre basith.
[63] Les rimes du roman d'Antar sont, en général, correctes; mais on en rencontre quelques-unes qui, quoique suffisantes pour l'oreille dans la récitation, sont incomplètes dans l’écriture.
[64]  Littér. « Il avait à peine pensé,
que,…. » pour dire : « tout à coup. « C’est là une expression
élégante en arabe ; mais on rencontre plus souvent dans cet ouvrage,
pour exprimer le même sens, l’expression
Littér. « Il avait à peine pensé,
que,…. » pour dire : « tout à coup. « C’est là une expression
élégante en arabe ; mais on rencontre plus souvent dans cet ouvrage,
pour exprimer le même sens, l’expression
 , qui est tout à fait vulgaire.
Le style du roman d'Antar offre un mélange d'expressions choisies et
usuelles. Destiné à être récité devant le peuple, cet outrage a été
rédigé de manière à être compris de tout le monde. On peut appliquer
au roman d’Antar ce que M. Bazin dit au sujet du San-koue-tchi,
dans un de ses remarquables articles sar la littérature chinoise :
« Dans un ouvrage comme le San-koue-tchi, dont le sujet est
l'histoire d'une grande guerre, où les batailles tiennent
naturellement beaucoup de place, le style moderne ne répond pas
aussi bien que le style intermédiaire aux mouvements brusques et
rapides que demande le récit des combats. » (Voyez Le
Siècle des Youén, ou tableau historique de la
littérature chinoise, depuis l'avènement des empereurs mongols
jusqu'à la restauration des Ming. Journal asiatique,
décembre 1850, p. 431.)
, qui est tout à fait vulgaire.
Le style du roman d'Antar offre un mélange d'expressions choisies et
usuelles. Destiné à être récité devant le peuple, cet outrage a été
rédigé de manière à être compris de tout le monde. On peut appliquer
au roman d’Antar ce que M. Bazin dit au sujet du San-koue-tchi,
dans un de ses remarquables articles sar la littérature chinoise :
« Dans un ouvrage comme le San-koue-tchi, dont le sujet est
l'histoire d'une grande guerre, où les batailles tiennent
naturellement beaucoup de place, le style moderne ne répond pas
aussi bien que le style intermédiaire aux mouvements brusques et
rapides que demande le récit des combats. » (Voyez Le
Siècle des Youén, ou tableau historique de la
littérature chinoise, depuis l'avènement des empereurs mongols
jusqu'à la restauration des Ming. Journal asiatique,
décembre 1850, p. 431.)
[65]  .
Le karra est vulgairement usité
eu Syrie pour désigner le nombre 10.000, d'une manière vague, sans
énoncer de valeur réelle.
.
Le karra est vulgairement usité
eu Syrie pour désigner le nombre 10.000, d'une manière vague, sans
énoncer de valeur réelle.
[66] Sur le mètre thawil.
[67] L'orientation vers le temple de la Mekke est une des quatre conditions requises pour la validité de la prière dominicale. Mahomet prescrivit d'abord aux siens de se tourner, en priant, vers le temple de Jérusalem, qui était la Qibla des juifs et des chrétiens. Plus tard, il ordonna aux musulmans d'adresser leurs prières vers la Kaaba, par ce verset du Coran :
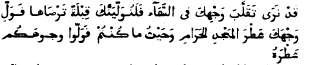
Nous t'avons vu tourner ton visage de tous les côtés du ciel ; maintenant nous le fixons une Qibla qui te plaira ; tourne ton visage vers le côté de l'oratoire sacré, dans quelque lien que tu sois. (Sourate 11, vers. 139.) Cf. d'Herbelot au mot Keblah.
Il était difficile, pour tous les croyants, de faire converger leurs prières, d'une manière sûre, vers la Kaaba. Aussi les jurisconsultes, les imams, ont dit que les habitants de la Mekke étaient obligés de faire la prière, les yeux fixés vers ce sanctuaire; mais que pour les étrangers, il leur suffisait de diriger, pendant la prière, leurs regards vers ce lieu saint. Celui qui ignorerait la position de la Kaaba, doit faire tous ses efforts pour parvenir à la connaître; et après cette sollicitude, quel qu'en soit le succès, la prière est toujours valide, quand même il découvrirait son erreur à la suite de son namas. (Cf. d'Ohsson, Tableau de l'empire ottoman, t. II, p. 73, 74, et le Précis de jurisprudence musulmane, de Khalil ibn Ishaq, traduction de M. Perron, l. I, p. 115.)
La direction du coté de l'est, que l’on donnait à la nef et à l'abside de nos anciennes églises, offre quelque chose d'analogue avec la coutume des musulmans. De nos jours, on bâtit les églises sans faire une grande attention à la direction ; mais, en Orient, les chrétiens, dans la construction de leurs églises, se conforment toujours à l'antique usage, dans leur maison, ils peuvent faire leurs prières dans quelque direction que ce soit il n'en est pas de même des Grecs orthodoxes, qui, soit dans l'église, soit en leur particulier, prient en se tournant vers l'Orient. Un des motifs qui fit établir cet usage, fut de perpétuer le souvenir de la mort sublime du Christ, qui expira la face tournée vers l'Occident. On le voit, la religion musulmane prescrit à ses adeptes de diriger leurs prières vers un point matériel, la Kaaba, tandis que le christianisme indique une idée comme point de ralliement des prières.
On trouve dans la traduction de M. Perron du Précis de jurisprudence musulmane, la note suivante (t. I, p. 529) :
« La Kaaba est, selon les musulmans, le point unique de direction sur lequel doivent s'orienter les prières de tous les hommes. La chose est facile, si l'on admet, avec les musulmans, que la terre habitée est une surface plane. »
Cette croyance que la terre est plane est-elle admise par les musulmans? Il faut distinguer l'opinion des géographes arabes de la croyance dont le Coran a pu être le fondement. (Voyez sourate ii, vers. 10; sour. xii, vers. 3 ; sour. xviii ; vers. 45 ; sour. xl, vers. 66; sour. xliii, vers. 9; sour. lxxi, vers. 18; sour. lxxviii, vers. 6.)
Dans l'introduction générale à la Géographie des peuples orientaux, placée en tête de sa traduction de la Géographie d'Aboulféda (t. I, p. 180, 181, 182), M. Reinaud, mon savant professeur, a traité cette question avec cette clarté et cette érudition large et solide qui distinguent tous ses ouvrages; je citerai les passages suivants :
« En général, les géographes arabes se représentent la terre comme ronde. Ils lui donnent le nom de boule, et Aboulféda, pour prouver sa sphéricité; se sert des mêmes arguments que nous. » Les écrivains qui, sous le khalifat d'Almamoun, furent chargés d'initier les Arabes aux sciences positives, adoptèrent la plupart le système de Ptolémée. Pour Mahomet, il paraît avoir cru, conformément à l'opinion de la plupart des peuples de l'antiquité, que la terre offrait la forme d'un disque et n'avait rien de sphérique. »
Si la multitude ignorante des musulmans a cru que la terre était plane, c'est par une fausse interprétation des paroles de Mahomet; car les hommes instruits, les commentateurs sérieux la repoussent. Ainsi Beïdhâoui, expliquant le verset 20 de la deuxième sourate:
 « C'est lui qui vous a donné la
terre pour lit (tapis) », s'exprime en ces termes :
« C'est lui qui vous a donné la
terre pour lit (tapis) », s'exprime en ces termes :
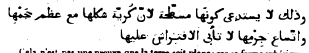
Cela n'est pas une preuve que la terre soit plane ; car sa forme sphérique, malgré la grandeur de son extension et l'expansion de sou volume, ne repousse pas l'aplanissement.
Abou'l-Baqà, écrivain du xvie siècle (?), dans son Koullyyat (p. 29, 30), commente à son tour ce verset du Coran : L'expression du Coran : « il a fait de la terre un tapis, n'est pas une preuve contre la rotondité de la terre, parce que le globe, lorsqu'il est grand, présente l'aspect d'un plancher dans chacune de ses parties. »
On voit, par ce qui précède, que l'opinion de la sphéricité de la terre était, non seulement celle des géographes arabes, mais, en général, cette des musulmans instruits. Tous les mahométans n'admettaient donc pas que la terre était plane, et l'observation de M. Perron à cet égard serait trop générale et devrait être restreinte à la masse ignorante. Nos paysans d'Europe ne sont pas plus éclairés sur ce point : ils croient que la terre est plane et que le soleil tourne.
[68] L’auteur du roman d'Antar mêle à son récit le nom de Zayd, fils d'Adi, sans rien préciser sur ce personnage historique. On sait qu'Adi, chargé de l'éducation de Nomân, fut la cause de son élévation au trône de Hîra. Plus tard, trompé sur le compte de son bienfaiteur, il le fit périr (589 de J. C.). Dans la suite, Nomân se repentit de sa cruauté : ayant rencontré le fils d'Adi, Zayd, il le combla de présents et lui procura une position en Perse. (Cf. Essai sur l’histoire des Arabes de M. Caussin de Perceval, vol. II, p. 139, 144, 149).
[69] Sur le mètre thawil.
[70] Sur le mètre wafir.
[71] Sur le mètre wafir.
[72] Sur le mètre thawil.
[73] Sur le mètre basith.
[74] Sur le mètre wafir.
[75] Chez les Arabes, comme en Europe, à l'époque retracée dans les romans de la Table Ronde, les guerriers donnaient un nom à leur épée. Ils faisaient de même pour leurs chevaux, etc., ainsi qu'on l'a vu.
[76] Il y a des variantes dans les manuscrits d’Antar, à ce passage où Hadifah fait le calcul comparatif du nombre des pierres jetées à terre, avec la vitesse des deux chevaux. La version anglaise est obscure en cet endroit, et la traduction que nous en donnons ici nous a été communiquée obligeamment par M. Reinaud.
[77] Le texte arabe porte seulement que cet esclave était très-noir.
[78] Voyez sur cet événement l'ouvrage de H. Reinaud sur les monuments arabes, persans et turcs du cabinet de H. le duc de Blacas, 1.1, p. 142.
[79] Le texte arabe porte quelquefois leurs enfants en bas-âge.
