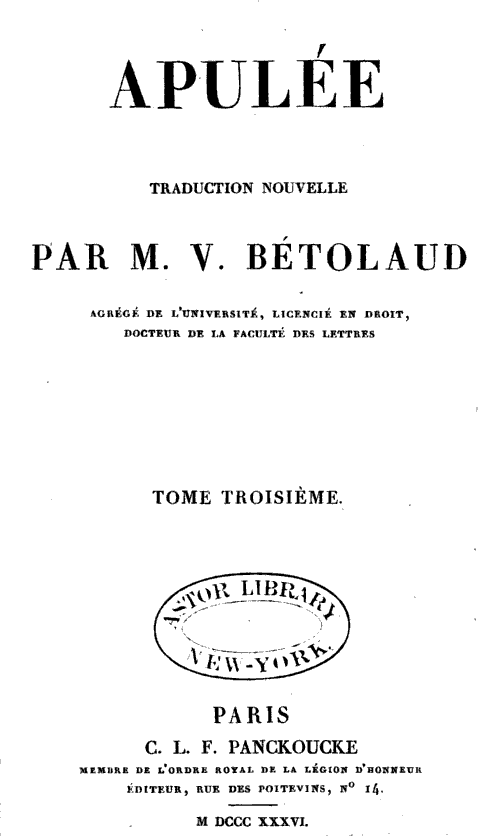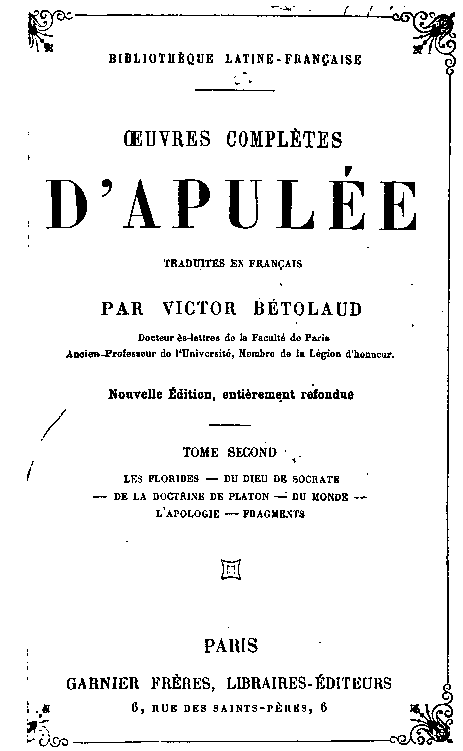|
|
||||||
|
|
||||||
|
APULÉE
DE LA DOCTRINE DE PLATON Oeuvre numérisée et mise en page par Thierry Vebr Relu et corrigé
|
||||||
|
DE LA DOCTRINE DE PLATON Livre I Platon fut ainsi nommé à cause de son extérieur ; car il s'appelait d'abord Aristoclès. On dit qu'il eut pour père Ariston ; et de l'autre côté Périclione, fille de Glaucus, fut sa mère. Ces deux auteurs rendent sa noblesse assez éclatante : car son père, Ariston, tirait par Codrus son origine de Neptune lui-même ; et le sage Solon, qui fonda les lois d'Athènes, était son ancêtre en ligne maternelle. Il en est qui donnent à Platon une généalogie plus auguste encore, prétendant qu'Apollon sous la figure d'un homme avait eu commerce avec Périctione. En outre, le philosophe naquit dans le mois appelé Thargélion chez les Attiques, et le jour où, dit-on, Latone avait enfanté Apollon et Diane dans l'île de Délos. On rapporte qu'il vint au monde le lendemain d'un anniversaire de la naissance de Socrate, et l'on cite même un songe bien remarquable de ce dernier. Il crut voir le petit d'un cygne s'envoler de l'autel qui est consacré à Cupidon dans l'Académie et venir s'abattre dans son propre sein ; ensuite ce cygne s'éleva à tire-d'aile dans les cieux, en charmant de ses accords pleins de mélodie et les dieux et les hommes. Comme Socrate racontait ce songe au milieu de ses disciples, précisément Ariston venait derrière lui pour lui présenter le petit Platon. Dès que le maître eut envisagé cet enfant, et que d'après son extérieur il eut reconnu le fond de sa belle âme : “Voilà, mes amis, dit-il, quel était mon cygne du Cupidon de l'Académie !” Né de tels auteurs et sous de tels auspices, Platon ne s'éleva pas seulement au-dessus de la vertu des demi-dieux ; il atteignit encore à la puissance des dieux eux-mêmes. En effet, Speusippe, qui avait recueilli sur son compte des détails de famille, vante la facilité de perception et l'admirable modestie qui le caractérisaient dans son enfance. Il rapporte que dès sa première jeunesse, Platon s'étant pénétré de l'amour du travail et d'habitudes sérieuses, ces vertus se développèrent chez lui ainsi que toutes les autres quand il fut devenu homme. Il eut deux autres frères germains, Glaucus et Adimante. Ses maîtres furent, pour les premiers principes, Denis ; pour la gymnastique, Ariston d'Argos : et dans ce dernier genre d'exercice il fit de si grands progrès, qu'il disputa le prix de la lutte aux jeux Pythiens et aux jeux Isthmiques. Il ne dédaigna pas l'art de la peinture. Il se mit en état de composer des tragédies et des dithyrambes ; et déjà, encouragé par la confiance qu'il avait dans son talent poétique, il voulait se mettre sur les rangs pour disputer cette palme. Mais Socrate bannit de sa pensée cette ambition misérable, et prit soin de lui inspirer l'amour de la véritable gloire. Il s'était d'abord pénétré des principes de la secte d'Héraclite ; mais quand il se fut livré à Socrate, non seulement il surpassa en génie et en instruction les autres socraticiens, mais son travail et l'élégance de son esprit acquirent plus d'éclat encore à la sagesse qu'il reçut du philosophe : ses efforts tendirent à la populariser ; et l'élégance de son esprit la rehaussa singulièrement par les charmes et par la majesté du style. Mais lorsque Socrate eut quitté les hommes, Platon chercha où il pourrait profiter, et il s'appliqua à la doctrine de Pythagore. Tout en reconnaissant qu'elle était l'ouvrage d'une raison aussi exacte qu'élevée, il se proposait plutôt d'imiter la continence et la chasteté qui la caractérisent. Ainsi, comme il remarquait que les pythagoriciens fortifiaient leur intelligence par d'autres études, il se rendit à Cyrène auprès de Théodore, pour apprendre la géométrie : il alla chercher l'astrologie jusque dans l'Égypte, pour s'y instruire même de la religion des prêtres. Il revint encore en Italie, s'attachant à Euryte de Tarente et au vieil Archytas, tous deux pythagoriciens. Il aurait même tourné ses vues du côté de l'Inde et des mages, s'il n'en eût été empêché par les guerres dont l'Asie était alors le théâtre. C'est pour cela qu'ayant fait des principes de Parménide et de Zénon une étude spéciale, il remplit ses ouvrages de toutes les beautés que ces philosophes offraient isolément à l'admiration. La philosophie jusque-là divisée en trois sections fut réunie par lui en un seul corps : et il démontra que ces diverses parties étaient mutuellement indispensables les unes aux autres ; que non seulement elles ne se combattaient pas, mais qu'encore elles se prêtaient un mutuel secours. En effet, bien qu'il eût emprunté à différents maîtres ces différentes parties de la science philosophique, à savoir, ce qui regardait la nature à Héraclite, la logique à Pythagore, la morale à Socrate même ; de tous ces éléments détachés il sut pourtant faire un seul corps, qui était en quelque sorte sa propre création. Et tandis que les chefs de ces écoles n'avaient livré à leurs auditeurs que des pensées mal polies et ébauchées, lui, en les soumettant à sa critique judicieuse et en les revêtant du charme puissant de son style enchanteur, leur donna une perfection véritablement admirable. Un grand nombre de ses auditeurs de l'un et de l'autre sexe se firent un nom célèbre en philosophie. Le patrimoine qu'il laissa consistait en un petit jardin attenant à l'Académie, en deux esclaves, en une coupe avec laquelle il accomplissait ses dévotions envers les dieux, et en autant d'or qu'en portent comme insigne à leur oreille les enfants de famille noble. Pour ce qui est de ses trois voyages en Sicile, la malveillance les a quelquefois calomniés, et on a cherché à accréditer diverses opinions. Mais la première fois il y alla comme naturaliste, pour étudier la nature de l'Etna et les éruptions de ce volcan ; la deuxième fois, ce fut sur la demande de Denys, pour assister les Syracusains et donner à leur contrée des institutions avec un gouvernement. La troisième, ce fut pour rendre à la Sicile Dion, qui avait été exilé de sa patrie, et dont Denys lui avait accordé la grâce. Nous entreprenons de faire connaître ici les méditations, ou, comme on dirait en grec, les dogmes que ce grand philosophe a laissés pour l'utilité du genre humain, en matière de physique, de morale, et de dialectique. Nous avons déjà dit que le premier il parvint à coordonner entre elles les trois parties constitutives de la philosophie. Nous allons parler de chacune d'elles séparément, en commençant par la philosophie naturelle. Platon pense qu'il existe trois principes de toutes choses, à savoir : Dieu, la matière, et les formes des choses qu'il appelle encore idées, lesquelles ne sont qu'ébauchées, informes, n'ayant ni apparence ni qualités précises et caractéristiques. Son opinion sur Dieu, c'est qu'il est incorporel. Lui seul, dit-il, est incommensurable, ἀπερίμετρος ; c'est lui qui est le créateur de l'univers, qui embellit toutes choses ; toute béatitude réside en lui et part de lui : il est essentiellement parfait ; il n'a besoin de rien, et c'est lui qui donne tout. Il l'appelle être céleste, être ineffable, être sans nom, ἀόρατον, ἀδάμαστον. Il ajoute qu'il est difficile de découvrir sa nature, et que si on y est parvenu on ne saurait la révéler au milieu de beaucoup d'hommes. Ce sont les termes mêmes de Platon : θεὸν εὑρεῖν τε ἔργον, εὑρόντα τὲ εἰς πολλοὺς ἐκϕέρειν ἀδύνατον. Pour la matière, il déclare qu'elle est incréable, incorruptible : n'étant ni feu, ni eau, ni tout autre principe ou élément parfait ; mais que, de ce qui existe, c'est elle qui est avant tout capable de prendre une figure et susceptible d'être modifiée. Primitivement informe et sans configuration caractéristique, elle reçoit de Dieu, l'artiste par excellence, sa conformation générale. Platon la nomme infinie, parce que sa grandeur ne connaît point de bornes. Car le propre de l'infini, c'est de n'être pas borné dans son étendue ; et comme la sienne, en effet, ne l'est pas, il est permis de l'appeler infinie. La matière est-elle corporelle ? est-elle incorporelle ? Il n'accorde ni l'un ni l'autre. Il ne la croit pas corps, parce que tout corps ne saurait se passer d'une apparence quelconque : il ne peut pas non plus dire qu'elle soit sans corps, parce qu'un corps ne présente rien d'incorporel. Si donc quelque considération la lui fait regarder comme corporelle, c'est la force des choses et le raisonnement. Mais par le fait seul et par le seul témoignage des sens, on ne saurait arriver à cette dernière croyance ; en effet les corps, en raison de leur évidence matérielle, sont reconnus au moyen d'un jugement qui lui-même est en quelque sorte matériel ; tandis que ce qui n'a pas une substance corporelle n'est vu que par la pensée. Il faut donc, selon lui, combiner ces deux opinions, et admettre que l'essence de la matière est ambiguë. Pour les idées, autrement dit les types de toutes choses, elles sont simples, éternelles, immatérielles. C'est dans leur nombre que Dieu a pris les modèles de ce qui existe ou qui existera. Entre ces différents modèles on ne peut trouver qu'une seule apparence pour chaque création ; et tout ce qui naît est comme une cire molle qui reçoit de l'empreinte de ces types sa conformation et sa figure. Il existe deux essences, οὐσίαι, comme il les nomme, par la vertu desquelles tout, et le monde lui-même est créé. L'une d'elles n'est conçue que par la pensée, l'autre peut tomber sous les sens. Mais celle qui est saisie par les yeux de l'esprit est toujours une, toujours semblable et pareille à elle-même ; c'est celle qui existe véritablement. L'autre ne peut être reconnue que par les sens, par une perception tout irrationnelle ; c'est celle-là qu'il dit naître et mourir. Et de même que la première est dite exister véritablement, on peut dire de la seconde qu'elle n'existe vraiment point. La première substance, ou première essence, comprend d'abord Dieu, puis la matière, puis les formes des choses, et enfin l'âme. La seconde substance comprend tout ce qui reçoit une forme ; tout ce qui est engendré et qui tire son origine d'un des types de la substance précédente ; tout ce qui peut subir des changements, des métamorphoses ; tout ce qui s'écoule et s'échappe à l'instar de l'eau des fleuves. De plus, la substance intelligente dont j'ai parlé, étant solidement assise, mérite, comme les conséquences qui en découlent, une croyance complète et un respect inébranlable ; la seconde substance, au contraire, qui n'est en quelque sorte que l'ombre et l'image de la précédente, n'a pour base, aussi bien que les arguments et les mots qui la soutiennent, qu'une théorie tout à fait incertaine. Le principe de tous les corps, dit donc notre philosophe, est la matière, laquelle reçoit sa figure de l'empreinte des types. De là sont nés les premiers éléments, l'eau et le feu, la terre et l'air ; et, attendu que ce sont des éléments, ils doivent être simples, et ne sauraient être combinés les uns avec les autres, comme seraient des syllabes ; ce mélange ne pouvant avoir lieu que pour les substances mixtes, dont la composition est le résultat de divers principes. Les quatre éléments, selon notre philosophe, étaient primitivement confus et désordonnés ; ce fut Dieu qui, en construisant l'univers, leur assigna un rang, des nombres, une figure, et décrivit leurs contours. De plus, les divers éléments se ramènent à un même type ; c'est-à-dire que le feu, l'air et l'eau empruntent leur mode de formation au triangle rectangle scalène, et que la terre l'emprunte au triangle rectangle isoscèle. En effet, il existe trois modifications de la première de ces deux figures : la pyramide, l'octaèdre, l'icosaèdre ; or, la forme de la pyramide représente le feu, celle de l'octaèdre l'air, celle de l'icosaèdre l'eau. Pareillement le triangle rectangle isocèle forme le carré ; le carré forme le cube, et celui-ci représente proprement la terre. Maintenant la forme mobile de la pyramide a été donnée au feu, parce que la mobilité de la figure offre de l'analogie avec l'agitation de l'élément. L'octaèdre étant susceptible d'un mouvement moins rapide a été attribué à l'air, dont la rapidité et la légèreté viennent après celle du feu. L'icosaèdre est placé en troisième lieu, parce que sa forme fluide et arrondie a paru se rapprocher davantage de l'eau. Reste la forme cubique ; et cette dernière, en raison de sa fixité, a servi à reproduire celle de notre univers. Il y a peut-être à découvrir encore d'autres principes, connus des dieux ou de celui que les dieux chérissent ; mais c'est des éléments primordiaux, de l'eau, du feu et des autres, que se composent spécialement les êtres animés et les êtres inanimés. Ce monde est fait de toute l'eau, de tout le feu, de tout l'air, de toute la terre qui existent ; et non seulement il n'en reste aucune parcelle hors de cet univers, mais encore l'influence ne s'en retrouve nulle part hors de ce globe. Ces éléments sont entre eux dans des rapports de connexité et de juxtaposition. C'est ce qui explique la localité qu'occupent l'eau, la terre, le feu et l'air. Comme l'air se rapproche du feu par sa similitude, ainsi la terre et l'eau sont juxtaposés. De là, le monde ne fait qu'un ; tout y est contenu ; et il ne reste ni espace où un autre monde trouverait à se placer, ni autres éléments qui pourraient le construire. En outre, une jeunesse éternelle et une vigueur inaltérable lui ont été attribuées. C'est pour cela que rien en dehors du système n'a été laissé qui pût altérer sa constitution ; et même quelque chose eût-il été laissé, l'influence en serait nulle : car l'ensemble est de toutes parts tellement organisé, tellement réglé, que rien ne saurait ou vicier sa nature ou contrarier sa marche. Dans la composition de ce monde, chef-d'oeuvre de perfection et de beauté, figure si belle et si parfaite, Dieu s'est principalement attaché à ce que rien n'y laissât à désirer, à ce qu'il recouvrît tout, contînt tout ; à ce que, dans son admirable beauté, il se ressemblât, se correspondît à lui-même. Or, des sept mouvements selon lesquels on peut se diriger, en avant, en arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin le mouvement circulaire et sphérique, les six premiers ont été par lui écartés, pour qu'il ne restât à l'univers que le mouvement de rotation, mouvement particulier à la raison et à la prudence, et pour que sa révolution même indiquât la sagesse. Platon dit tantôt que ce monde n'a point de commencement, et d'autres fois qu'il a une origine, une naissance. Pour établir qu'il n'a pas eu de commencement, il argumente de ce qu'il a toujours existé ; et pour prouver qu'il a dû naître, il s'appuie sur ce que tout ce qui constitue sa substance et sa nature a lui-même eu une naissance. De là vient qu'il est tangible, visible, et qu'il tombe sous les sens. Mais, en tous cas, parce que c'est de Dieu qu'il tient le principe de sa naissance, il est destiné à jouir d'une durée éternelle. L'âme de tous les animaux est immatérielle ; elle est par dessus tout impérissable, attendu qu'elle est tout à fait distincte du corps, qu'elle est antérieure à tous les objets créés. En conséquence elle domine et dirige ce dont le soin et la surveillance rentrent dans ses attributions. Elle a un mouvement éternel et spontané, qu'elle communique elle-même à la matière inerte et immobile. Mais il existe encore une autre âme céleste, source de toutes les âmes, essentiellement parfaite, essentiellement sage, force génératrice, qui reconnaît à son tour les lois de Dieu son créateur, et se plie à toutes ses combinaisons. La substance de cette âme se compose de nombres, de modes, d'accroissements qui se combinent et se modifient indéfiniment, soit qu'elle les tire d'elle- même ou hors d'elle. C'est le jeu de tous ces ressorts qui fait ainsi mouvoir le monde en musique et avec mélodie. Il y a deux natures pour les choses, l'une qui peut être vue par l'oeil, touchée par la main : Platon l'appelle sensible, δοξαστὴν ; l'autre se révèle à l'esprit : elle est du ressort de la réflexion, de l'intelligence. (Qu'on me pardonne ces alliances de mots commandées par l'obscurité du sujet.) La première de ces natures est sujette aux changements et facile à voir. L'autre, au contraire, qui est reconnue par les yeux de l'esprit, qui est saisie et perçue par la pénétration de l'intelligence, est inaltérable, immuable, constante, éternelle, toujours la même. De là deux raisons, deux logiques, d'après Platon. L'une visible, résultant de perceptions qui ne sont que fortuites et isolées ; l'autre intelligible, dont l'existence s'appuie sur la base vraie, durable et constante de la raison. Le temps, cette image de l'éternité, marche tandis que l'éternité est essentiellement fixe et immobile. Il va s'y réunir, et c'est comme un gouffre immense où il peut s'anéantir et s'abîmer, si telle est jamais la décision du créateur de l'univers. C'est par la mesure du temps que l'on peut apprécier les lois qui président aux révolutions du monde, et qui régissent le globe du soleil, celui de la lune, ainsi que les étoiles, faussement appelées par nous errantes et vagabondes ; car disons en passant que les contradictions de nos théories sur les courses de ces dernières peuvent être attribuées aux erreurs de notre intelligence. Du reste, le grand économe a établi les révolutions des astres, leurs levers, leurs couchers, leurs oscillations, leurs retards, avec une précision telle, qu'il ne saurait y avoir lieu à la moindre erreur. Les jours avec les nuits complètent les mois ; les mois à leur tour s'enferment dans le cercle des années. Ce ne fut que quand ces signaux commencèrent à briller dans la voûte lumineuse du firmament que l'on put assujettir le temps à des calculs. Mais les observations qui se rattachent à ces calculs mêmes auraient été perdues, si un aussi admirable concert avait été suspendu une fois dans le cours antique des âges. En effet, c'est pour que la mesure et la révolution des temps fussent connues, pour que le mouvement de rotation de l'univers fût visible, qu'a été allumé ce brillant soleil ; et, réciproquement, c'est pour qu'un sommeil désiré vînt rafraîchir les créatures, que les ténèbres de la nuit ont été imaginées. Les mois sont complets quand la lune, ayant parcouru sa courbe elliptique, est revenue au point d'où elle était partie. Pour l'année, elle a terminé son cours lorsque le soleil a passé successivement par les quatre saisons et qu’il est revenu au même signe du zodiaque. L'énumération de ces corps lumineux, qui retournent sur eux-mêmes pour repartir ensuite, est du reste une découverte que Platon doit à la force de son intelligence et de son raisonnement. Quant aux étoiles, il pense que leur marche n'est pas moins certaine, et qu'elles conservent sans interruption une route régulière difficilement comprise par l'esprit humain. Grâce à cette régularité, on conçoit ce que c'est que la grande année. C'est celle dont la durée aura été accomplie par cela seul que le cortège mouvant des étoiles aura atteint un seul et même terme, pour recommencer dans les champs de l'espace une nouvelle carrière, un nouveau chemin. Les globes célestes, liés entre eux par une affinité réciproque, reconnaissent pour maître souverain celui qui passe pour n'éprouver aucun égarement. Tous les autres gravitent dans sa sphère d'attraction. Le premier rang a été donné aux astres non errants ; le second à Saturne, le troisième à Jupiter ; Mars occupe le quatrième, Mercure le cinquième, Vénus le sixième ; le septième est celui du Soleil à la course lumineuse, le huitième celui de la ponctuelle Phébé. Après cette première catégorie, les éléments et les principes occupent l'univers. D'abord le feu est placé au dessus des autres : c'est ensuite la place de l'air, puis celle de l'eau ; enfin le globe terrestre est placé exactement au centre, où il est fixe et sans mouvement. Les astres, qui sont placés au ciel, se meuvent d'un cours perpétuel et infatigable. Platon les appelle des dieux animés. C'est le feu qui entre dans la substance et dans la composition de leurs natures. Les espèces d'animaux à leur tour sont divisées en quatre classes. Une d'elles est d'une nature identique au feu que nous voyons dans le Soleil, dans la Lune et dans les étoiles du firmament. Une autre tient de l'air ; c'est celle que notre philosophe appelle encore démons. La troisième et la quatrième se composent d'eau et de terre : ce sont les créatures mortelles qui se subdivisent en êtres territoriaux et êtres terrestres (car il les nomme ainsi : ἔγγειον et ἐπίγειον). Les êtres territoriaux sont les arbres et les autres productions fixées au sol ; les êtres terrestres sont ceux que nourrit et porte la terre. Platon reconnaît trois espèces de dieux : dans la première il fait figurer comme étant seul et unique le dieu souverain, qu'aucun monde ne renferme, que n'enchaîne aucun corps ; c'est lui que nous montrons comme père, comme architecte de ce divin univers. Une autre espèce est celle des astres et des autres puissances que nous appelons divinités célestes. La troisième est celle des dieux que les anciens Romains appellent Médioxymes, attendu que par leur essence, leur place et leur pouvoir, ils sont inférieurs aux dieux souverains, mais incontestablement supérieurs à la nature humaine. Tout ce qui arrive selon les lois de la nature, et par conséquent avec régularité, s'opère par les soins de la providence, et on ne pourrait imputer à Dieu la cause d'aucun mal. Il ne faut donc pas non plus, selon notre philosophe, rapporter tout à la fatalité du destin ; car voici la distinction qu'il établit : La providence est l'expression d'une sympathie toute divine, conservatrice de la prospérité des êtres pour qui elle a entrepris un tel office ; le destin par qui s'accomplissent les inévitables projets et les plans de Dieu, c'est l'expression de sa loi divine. Conséquemment, si une chose est maintenue par la providence, c'est qu'elle est également faite par le destin, et ce que le destin accomplit doit paraître garanti également par la providence. Or, il existe une première providence, celle du premier, du plus excellent de tous les dieux, qui non seulement a créé une hiérarchie entre les dieux du ciel dispersés par lui dans toutes les parties de l'univers pour le protéger et pour l'embellir, mais qui encore a institué pour un temps des dieux mortels qui l'emportassent en sagesse sur les autres créatures terrestres. Ainsi, après avoir fondé les lois, il a laissé aux autres dieux la disposition et le maintien de tout ce qui restait à faire journellement. De là viennent les attributs des dieux d'une providence secondaire ; providence si active, que tout ce qui dans les cieux frappe les regards des mortels, conserve immuablement l'état primitif où l'a placé le père souverain. Les Démons, que nous pouvons appeler Génies et Lares, sont à ses yeux les gardiens et les interprètes des hommes, quand ceux-ci veulent quelque chose des dieux. Platon, nous l'avons dit, est loin de penser pourtant que tout doive être rapporté à l'empire du destin ; mais il croit qu'il y a quelque chose qui dépend de nous, et quelque chose aussi qui dépend de la fortune. Il avoue que les catastrophes imprévues de la fortune sont ignorées de nous, parce que, d'ordinaire, des contretemps irréguliers et soudains viennent se jeter au travers des entreprises les mieux raisonnées et les mieux combinées, pour les empêcher d'arriver à leur fin. Dans le cas où ces incidents proviennent d'une manière utile, cela s'appelle du bonheur ; si au contraire ce sont des obstacles, on dit que c'est du malheur. Mais, de toutes les créatures terrestres, la providence n'a rien créé de supérieur à l'homme. Aussi Platon dit-il avec justesse, que l'âme humaine est la reine du corps. Il existe, selon lui, trois parties de l'âme : le principe raisonnable, à savoir la portion la plus noble, dont le siège est dans la tête ; le principe irascible, qui loin de la raison réside dans le coeur, lequel principe doit obéir à la sagesse et ne répondre qu'à ses appels ; la passion et les appétits sont la dernière portion de l'âme, et occupent les régions inférieures de l'abdomen, espèces de tavernes, de latrines sombres où résident le désordre et la luxure. Si cette partie a été reléguée si loin de la sagesse, il semble que ce soit de peur qu'importunée d'un tel voisinage, la raison, qui de là-haut veille sur la conservation de l'ensemble, n'éprouvât quelque désordre dans l'économie de ses utiles réflexions. L'homme est tout entier dans la tête et dans la face ; car la sagesse et toutes les pensées ne sont contenues nulle part ailleurs que dans cette partie du corps. Les autres membres sont les serviteurs, les esclaves de la tête, lui procurant les aliments et les diverses substances. Le chef est placé en haut comme un maître, un guide, qui par sa prévoyance écarte tous périls. Les différents organes dont les sens sont pourvus, afin d'apprécier, de juger les quantités et les qualités, sont également disposés dans la tête, véritable palais, véritable métropole ; et tous agissent dans les intérêts de la raison, dans le but de seconder la perception et l'intelligence. Les sens eux-mêmes sont admirablement disposés par la nature pour les objets sensibles, et leurs propriétés s'y rattachent par de remarquables analogies. D'abord les deux yeux, qui ont leur prunelle transparente et comme éclairée par la lumière de la vision, sont chargés de voir. L'ouïe, qui participe de la nature aérienne, perçoit les sons par des messagers aériens. Le goût, ne s'appliquant qu'aux objets solubles, ne perçoit que les matières humides et aqueuses. Le toucher, qui est tout positif, tout matériel, s'applique aux corps solides que l'on peut atteindre et heurter. Les objets même qui s'altèrent par corruption ont en leur faveur un mode de perception à part. En effet, au milieu du visage, la nature a placé les narines, par le double conduit desquelles l'odorat circule avec la respiration. Ce sont les modifications et les altérations subies par les corps qui donnent lieu d'exercer ce sens, quand ils sont corrompus, ou brûlés, ou moisis, ou en fermentation, attendu que dans ces différents états il s'en exhale ou de l'air, ou un fumet qui fournit l'occasion de reconnaître et d'apprécier la présence de l'odeur; car, si les corps sont intacts, et que l'atmosphère conserve sa pureté, jamais ces exhalaisons ne se répandent dans les airs. Tels que nous venons de les énumérer, les sens nous sont communs avec les autres animaux. Mais, grâce à un bienfait divin, les facultés spéciales à l'homme ont plus d'énergie et de développement, parce que son ouïe et sa vue ont un degré supérieur de perfection. Avec ses yeux, en effet, l'homme a mesuré le ciel, les révolutions des astres, leur lever, leur coucher, les espaces qu'ils parcourent, l'influence qu'ils exercent ; et ces connaissances sont une source admirable et féconde de philosophie. Pour parler de l'ouïe, l'homme pouvait-il recevoir un plus précieux bienfait ? A l'aide de cette faculté, il peut apprendre la prudence et la sagesse, mesurer le nombre dans le discours, établir la cadence, devenir lui-même tout musique, tout harmonie. Ajoutez la langue, le rempart des dents, les lèvres aux gracieux baisers. Données aux autres animaux pour les aider à assouvir le besoin de manger et à introduire les aliments dans l'estomac, les lèvres et la langue sont plutôt chez l'homme l'organe de la droite raison et l'instrument de cette voix si douce. Grâce à elles, ce que dans sa prudence le cœur a conçu, le discours peut en produire l'expression. L'ensemble de tout le corps se compose d'organes de formes différentes, dont les uns ont un rang plus relevé, les autres des fonctions moins nobles. Les inférieurs reconnaissent la suprématie de ceux qui l'emportent ; et ce sont eux qui se chargent du ministère de l'alimentation. Des pieds jusqu'aux épaules, tout obéit à la tête. Les sourcils sont un rempart qui protège les yeux, afin que d'en haut rien ne tombe qui puisse troubler l'organe de la vue, si délicat et si susceptible. Les poumons, par l'endroit qu'ils occupent et par leur nature, sont de la dernière utilité pour le coeur. Quand celui-ci s'enflamme de colère, et que des palpitations trop accélérées font jaillir à son sommet un sang qui l'inonde, les poumons, toujours altérés, reçoivent ce sang dans leur masse spongieuse et l'y rafraîchissent. Si la rate est placée dans le voisinage du foie, ce n'est pas sans utilité : c'est pour qu'elle remédie à la plénitude de ce dernier par des absorptions réciproques ; pour qu'elle en purifie les liquides et le garantisse de toute lésion, ce qui est absolument indispensable. Le ventre contient les circonvolutions des intestins, et ceux-ci sont roulés en replis nombreux, de peur que les aliments liquides et les solides ne circulent avec trop de promptitude et ne s'évacuent aussitôt, précipités qu'ils seraient par leur pesanteur. Car alors, ils ne pourraient être d'aucune utilité à l'animal par leur introduction ; à chaque instant, nous serions tourmentés du besoin de prendre quelque nourriture, et ce deviendrait nuit et jour notre occupation. La charpente osseuse est recouverte par les viscères, et elle est attachée d'une manière solide par des ligaments. Toutefois, les organes qui sont les intermédiaires du sentiment sont revêtus par ces viscères de façon que l'épaisseur de ces derniers ne neutralise pas leur énergie ; et les parties osseuses, qui sont attachées par des jointures et par des cartilages, ne présentent que peu de ces mêmes viscères, afin de se mouvoir avec promptitude et facilité. Regardez enfin le sommet de la tête elle-même : il est recouvert d'un cuir peu épais, et fourni de cheveux qui le garantissent contre l'excès du froid et celui de la chaleur. Les parties les plus charnues sont celles sur lesquelles porte le poids du corps, comme les cuisses à l'endroit où l'on s'assied. Parlerai-je des aliments eux-mêmes ? Reçus dans différents tubes partis de l'estomac et qui sont joints au foie par des vaisseaux, ils se décomposent en un sang que de ce point la nature fait habilement circuler dans toutes les parties du corps. De la région du coeur partent en effet, comme autant de canaux, des veines qui transportent par les appareils respiratoires des poumons le principe vital qu'elles ont reçu du coeur ; et de nouveau, ces veines se partageant tous les membres par leurs ramifications animent et vivifient le corps entier. De là vient la respiration qui s'exhale et se reprend par alternatives, pour que les deux mouvements opposés ne se contrarient pas. Il est des veines qui ont un autre usage : celui de servir à la procréation ; nées de la région cervicale, elles parcourent le parenchyme des reins, et s'épanouissent aux aines, pour donner issue au sperme générateur qui féconde l'espèce humaine. Platon dit que le corps entier se compose de diverses substances. La première est formée du feu, de l'eau et des autres éléments ; une deuxième, de parties analogues entre elles, des viscères, des os, du sang et des autres parties du corps ; la troisième, de membres à fonctions tout à fait contraires et opposées ; à savoir, de la tête, du ventre, et d'organes fort différents les uns des autres. Il en résulte, que si la substance composée d'éléments simples est du dehors satisfaite en ses besoins de nourriture comme il convient à chaque espèce de ces éléments, elle garantit à l'individu la conservation de sa qualité et de son tempérament. Les parties analogues entre elles lui garantissent la force. Celles qui, comme nous l'avons dit, sont dissemblables, entretiennent sa beauté. C'est cet équilibre du sec et de l'humide, du chaud et du froid, qui donne la santé, la force, la fraîcheur ; de même que, si ces principes sont mélangés irrégulièrement et sans mesure, l'ensemble entier se vicie, et l'individu ne tarde pas à ressentir les funestes effets de cette altération. Platon dit encore que l'âme se compose de trois parties. La première est la partie raisonnable ; la seconde, la partie incandescente ou l'irritabilité ; la troisième, la partie appétitive, que nous pouvons appeler du nom général de passion. La créature jouit de sa santé, de ses forces, de sa beauté, quand la raison gouverne l'âme entière ; quand les deux autres parties secondaires, à savoir la colère et la volupté, s'accordent entre elles, et qu'elles n'ont aucun appétit, aucun élan jugé inutile par la raison. L'âme étant constituée dans un tel équilibre, jamais le corps n'éprouvera de perturbation. Mais il y aura faiblesse, prostration, désordre dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y a inégalité de proportions ; si l'irascibilité et la prudence ont été soumises et dominées par la passion ; enfin, si cette raison qui doit être la reine et la maîtresse se laisse subjuguer par le despotisme de l'irascibilité, la passion restât-elle même obéissante et paisible. L'état de la maladie de l'âme, selon notre philosophe, est la sottise, qu'il classe en deux espèces : il appelle l'une impéritie, l'autre folie. L'impéritie vient d'une prétention orgueilleuse, lorsqu'ignorant une chose on se donne faussement pour la posséder et pour en être instruit. Quant à la folie, elle est d'ordinaire le résultat de mauvaises habitudes et d'une vie débauchée. Elle tient du reste à une constitution vicieuse, comme, par exemple, lorsque ce qui est disposé pour la raison dans les parties supérieures de la tête, se trouve resserré à l'étroit et comprimé d'une manière nuisible. Quand l'homme est-il parfait ? lorsque l'âme et le corps s'harmonisent, se conviennent et s'entendent parfaitement ; lorsque la force de l'intelligence n'est pas inférieure à l'énergie de la matière. Dans cet heureux état le corps prend ses développements naturels, parce que la portion de santé qui lui est nécessaire lui est habilement ménagée et n'a rien d'excessif ; parce que cette santé n'est pas accablée par l'excès de travaux extérieurs, par la trop grande abondance d'une nourriture immodérément répandue et distribuée dans tout l'individu. Alors en effet les membres et les organes conservent dans son activité et dans ses proportions la force qui leur est nécessaire ; tout ce qui doit contribuer à la conservation du corps entier présente une fusion homogène, un équilibre parfait ; mais quand cette régularité n'existe plus, la destruction du corps s'ensuit toujours infailliblement. LIVRE II Le principe de la philosophie morale, mon fils Faustinus, c'est de savoir par quels moyens on peut parvenir à la vie heureuse ; or, j'entreprends de prouver que rien ne saurait mieux nous mettre en possession de cette vie heureuse, complément de tous les biens, que les doctrines professées à cet égard par Platon. D'entre les biens, selon lui, les uns existent par eux- mêmes (et ce sont les premiers et les plus excellents) ; les autres sont les résultats d'une perception. Les premiers sont, le maître souverain de toutes choses, et cette intelligence, que le même Platon appelle νοῦν. Viennent ensuite les biens qui découlent des premiers, et qui sont les vertus : la prudence, la justice, la pudeur, le courage. Mais de toutes celles-ci, la première est la prudence ; la seconde, pour le rang et les effets, c'est la continence ; après elles, vient la justice ; enfin le courage est la quatrième. Platon établit entre les biens cette différence, que les uns ont un caractère divin, sont de premier ordre et essentiellement simples ; les autres tiennent à l'humanité, et ne sont pas regardés comme les mêmes pour tous. Les biens qui ont un caractère divin et qui sont simples, sont les vertus de l'âme. Les biens qui tiennent à l'humanité sont ceux qui n'appartiennent qu'à quelques uns, qui se rattachent aux avantages corporels, et ceux que nous appelons étrangers. Aux yeux des sages, des hommes qui vivent avec raison et mesure, ce sont des biens sans doute ; mais pour les sots, et pour ceux qui en ignorent l'usage, il est inévitable que ce soient des maux. De tous les biens, le premier est celui qui, véritable, divin, et d'une excellence incontestable, mérite tout notre amour, toute notre ambition, bien après la beauté duquel soupirent les âmes raisonnables, portées d'ailleurs à cet amour par un instinct de nature ; et c'est parce que tout le monde ne peut pas y atteindre, ne peut pas avoir la faculté d'atteindre à ce bien, le premier de tous, que l'on se rabat sur ce qui tient à l'humanité. Le second bien n'est pas commun à tous, et n'est même pas un bien pour tous. Car l'activité, les appétits sont mis en mouvement, ou par le véritable bien, ou par ce qui en a l'apparence. La nature a donc établi une affinité réelle entre les biens et cette portion de l'âme qui est raisonnable. Mais Platon regarde comme éventuels les biens qui tiennent au corps et aux choses venant de l'extérieur. Selon lui, le mortel qui songe par nature à rechercher le vrai bien, est né non seulement pour lui-même, mais encore pour l'humanité tout entière ; non pas toutefois avec des obligations égales et semblables : chacun naît d'abord pour la patrie, puis pour ses proches, puis pour les autres hommes avec qui il a des rapports de parenté ou de connaissance. L'homme, en venant au monde, n'est ni absolument bon, ni absolument mauvais ; sa nature le porte aussi bien vers l'un de ces états que vers l'autre. Des germes de ces deux penchants sont inhérents à son être par le fait de sa naissance ; et ce sont les différents modes d'éducation qui doivent développer les uns ou les autres. Aussi ceux qui instruisent les enfants ne doivent-ils s'attacher à rien plus ardemment qu'à leur inspirer l'amour de la vertu ; et, par la morale qu'ils leur prêchent, par les principes dont ils les pénètrent, ils doivent les habituer à obéir, soit comme subordonnés soit comme maîtres, aux lois de la justice. Conséquemment, s'il est un principe auquel il faille surtout les soumettre, c'est à reconnaître que telle chose est à suivre, telle chose à éviter, que ceci est honnête, ceci honteux ; que tels actes sont tout à la fois honneur et plaisir ; tels autres, honte et infamie ; qu'enfin nous devons avec une conviction profonde désirer les biens qui sont honorables. Platon reconnaît trois espèces de naturels. Il en appelle un, supérieur et excellent ; un autre, tout à fait immoral et dépravé ; et le troisième, qui tient des deux premiers, est par lui qualifié de moyen. C'est à cet état moyen qu'il veut voir participer l'enfant docile et l'homme disposé à suivre les voies de la modération en même temps qu'il alliera le mérite et les grâces. Pareillement, il conçoit un troisième état intermédiaire entre celui des vertus et celui des vices, état d'où résultent des moralités louables et d'autres dignes de blâme. Entre la science solide et l'ignorance, il est une troisième catégorie, celle que caractérisent l'audace et la jactance ; entre la pudeur et la débauche, viennent se placer l'abstinence et l'intempérance. Entre le courage et la crainte, se placent la honte et la lâcheté. Car les naturels qui tiennent de cet état mixte n'ont pas de vertus sans mélange ; comme aussi ils ne présentent pas de vices exagérés et portés à l'extrême, et ils sont un composé de l'un et de l'autre. L'état le plus criminel est celui qu'il appelle méchanceté ; malitia. C'est celui de l'homme souillé de tous les vices, de l'homme chez qui la meilleure partie, la partie raisonnable, celle qui doit même commander aux autres, est assujettie à l'esclavage ; attendu que les inspiratrices de tout mal, la colère et la débauche, dominent la raison et conduisent l'attelage. Cette malice est formée de deux éléments contraires, le trop et le moins. Selon notre philosophe, ce n'est pas seulement l'infériorité de nature qui la caractérise, c'est encore un état de dissemblance ; car il ne saurait y avoir la moindre analogie avec le bien dans ce qui diffère de soi-même à tant d'égards, dans ce qui présente non seulement disparité, mais encore désordre. Aussi prétend-il que contre les trois parties de l'âme sont dirigées les attaques de trois vices : la prudence est assaillie par l'indocilité qui, sans prétendre anéantir la science, repousse cependant un enseignement méthodique. Platon nous montre deux variétés de ce défaut, l'impéritie et la fatuité : la première, s'attaquant à la science, la seconde à la réflexion. Le principe irascible a pour antagoniste l'audace, à la suite de laquelle marchent l'indignation et l'insensibilité, appelée en grec ἀοργησία. C'est ainsi que j'appelle une disposition qui ne comprime pas l'élan de la colère, mais qui la remplace par une apathie voisine de la stupeur. Aux passions s'attaque la luxure, c'est-à-dire, l'appétit des voluptés, des désirs, une soif inépuisable de jouissances et de sensualités. De la luxure naissent l'avarice et le désordre : celle-là, procédant en sens inverse de la libéralité ; celui-ci, épuisant par des prodigalités excessives toutes les ressources d'un patrimoine. Suivant Platon, la vertu est l'état le plus noble et le plus parfait de l'âme. Elle garantit au mortel avec qui elle s'est identifiée un accord, un calme, une fermeté, même, qui le maintiendront constamment en une harmonie réelle et non supposée avec lui-même comme avec tout ce qui l'entoure. Or, cet état ne devient que plus facile à acquérir, si la raison, solidement constituée dans le siège de son empire, maîtrise, tient toujours en bride les appétits et l'irascibilité ; et si ces principes tumultueux lui obéissent comme des serviteurs tranquillement dévoués à accomplir leur tâche. La Vertu est une, simple ; parce qu'il est dans l'essence de ce qui est bon de n'avoir pas besoin de secours, et que ce qui est parfait doit être un. Ce n'est pas seulement par son excellence réelle, c'est encore par la régularité de ses formes que la vertu se reconnaît. En effet, elle est si bien en rapport avec elle-même qu'elle trouve en elle ses accords et ses proportions. Secondairement Platon reconnaît des vertus moyennes, et d'autres supérieures : les premières, n'ayant ni excès ni défectuosités ; et les secondes, se trouvant comme sur un terrain limitrophe de celui des vices. Ainsi le courage touche d'un côté à l'audace, de l'autre à la timidité. L'audace est un excès de confiance ; la peur est un autre excès en sens inverse. Il y a des vertus parfaites ; il y en a d'imparfaites : les imparfaites sont celles qui naissent chez tous les individus par le bienfait de la nature réduite à elle seule, ou bien qui ne sont que le fruit de l'étude, que la conquête de la raison. Nous appelons parfaites celles qui se composent de ces éléments réunis. Platon pense que les vertus imparfaites ne se suivent point les unes les autres ; tandis que les parfaites sont indivises et se tiennent entre elles. Or, ce qui le détermine le plus puissamment à penser ainsi, c'est que le mortel doué d'une nature supérieure, s'il appelle à son secours les ressources du travail, de l'habitude, d'une méthode savante fondée sur une haute raison, ne rencontrera rien dont son mérite ne puisse venir à bout. Platon fait concorder les différentes vertus avec les différentes fonctions de l'âme. Sur la raison s'appuie cette vertu, qui contemple, qui discerne les objets ; et il l'appelle prudence et sagesse : sagesse, en tant qu'elle s'applique à la connaissance des choses humaines et des choses divines ; prudence, en tant qu'elle est la science du bien, du mal, et la possession de ce qu'il appelle état moyen. La partie irascible de l'âme est celle où résident le courage, la force d'âme et l'énergie nécessaire pour l'accomplissement des actes que nous impose la sévère autorité des lois. Enfin, la troisième partie de l'âme, celle des désirs et des appétits, est nécessairement le siège de l'abstinence, attendu que celle-ci, par son accession, produit l'équilibre nécessaire entre ce qu'il y a chez l'homme de bons et de mauvais penchants. Car si, d'un côté, la sensualité nous porte à satisfaire nos goûts et à vivre dans un état peu relevé ; de l'autre, l'abstinence est une force raison née et grave, qui tient en bride les voluptés. Sur ces trois parties de l'âme se reflète une quatrième vertu, la justice, qui se répand et se partage entre elles d'une manière égale, et dont la salutaire influence les met toutes à même d'accomplir plus fidèlement leurs diverses attributions. Cette dernière est, par notre divin Platon, tantôt appelée justice, comme nous disons ici, tantôt désignée sous le nom général de vertu ; d'autres fois il la nomme fidélité. Mais dans tous les cas, considérée sous le point de vue de l'utilité qu'elle procure à son possesseur, elle est la bienveillance ; considérée dans les rapports extérieurs et comme s'occupant avec zèle de ce qui est utile aux autres, elle est la justice. Il est encore une autre espèce de justice, qui dans la division ordinaire des vertus tient le quatrième rang ; c'est celle qui se confond avec la sainteté, ὁσιότητι. Cette sainteté se subdivise en connaissance de la liturgie, des choses mystiques ; et en science de maintenir ou de ramener la concorde et l'union parmi les hommes. Deux soins également importants doivent occuper la justice qui préside aux intérêts de la société humaine. Il faut d'abord qu'elle fasse observer les comptes, opérer équitablement les partages ; qu'elle établisse des contrats pour toutes transactions ; qu'elle garantisse l'invariabilité des poids et des mesures, la répartition égale des charges publiques. Il faut encore, mais cela secondairement, que, par un partage auquel du reste l'équité servira de base, les individus soient propriétaires, les uns de plus grandes, les autres de moindres quantités de terrain : les citoyens honnêtes en ayant davantage, les mauvais citoyens n'en possédant que peu. Il faut encore que celui que sa nature ou que son travail a mis en possession d'une supériorité réelle, soit préféré quand il s'agit d'honneurs et de charges ; que les citoyens les moins bons ne soient point mis en évidence et promus aux dignités. En général, quand il s'agit de conférer ou de proroger les charges, le principe de tout citoyen qui veut faire réussir les gens de bien et comprimer les factieux, c'est que tout dans le gouvernement doit être subordonné à l'utilité générale, et que les projets séditieux doivent être frappés d'impuissance ainsi que leurs auteurs. Nous ferons mieux saisir notre pensée, si nous représentons le citoyen honnête et le citoyen pervers par une allégorie : l'un étant l'essence divine qui jouit d'une calme béatitude ; l'autre, l'irréligion à l'humeur farouche et sauvage. Sur ce dernier modèle se réglera celui que son penchant entraîne loin de la justice et de la vertu ; le premier au contraire, type divin et céleste, excitera l'émulation de l'homme vertueux. Passant à la rhétorique, notre philosophe la divise en deux parts : l'une est la science qui enseigne à méditer le bien, à marcher avec fermeté dans les voies de la justice, science parfaitement en rapport avec les plans et les desseins de celui qui veut briller sur la scène politique. L'autre est la science de flatter, de trouver des arguments vraisemblables, exercice dans lequel le raisonnement n'entre pour rien (car c'est ainsi que nous traduisons les mots ἄλογον τριβὴν), “exercice qui veut persuader ce qu'il ne saurait enseigner.” Ce que confirment d'ailleurs ces autres expressions de Platon : δύναμις τοῦ πείθειν ἄνευ τοῦ διδάσκειν. Il l'appelle encore l'ombre, c'est-à-dire l'image, d'une section fort peu importante de la science gouvernementale. Pour cette dernière, qu'il appelle πολιτικὴ, il veut nous la faire considérer comme devant être rangée au nombre des vertus. La prévoyance qu'il exige en politique ne doit pas seulement se manifester par des actes de gouvernement ; mais toutes les vues, toutes les intentions doivent contribuer d'une manière égale à la prospérité et au bonheur du pays. Ainsi, par exemple, cette prévoyance aura deux manières de servir les interêts moraux de la cité, en établissant l'autorité de la loi et l'autorité judiciaire : celle-là, figurant un exercice qui tend à rendre l'âme belle et vigoureuse, comme la gymnastique assure au corps la grâce et la santé ; celle-ci, ayant quelque ressemblance avec la médecine, puisqu'elle tend à prévenir les maladies de l'âme, comme la médecine, celles du corps. Platon appelle science l'étude de ces deux théories, et il proclame leur application comme étant la source d'une foule d'avantages. Il signale deux fausses sciences qui ne les imitent que d'une manière bâtarde, et qui se rapprochent plutôt du métier du cuisinier et de celui du parfumeur. C'est la sophistique d'abord, et ensuite cette jurisprudence toute confite en douceur, pleine d'artifices perfides aussi honteux pour qui les emploie qu'inutiles pour tous. La sophistique est celle qui paraît à Platon se rapprocher le plus de la cuisine. Car comme celle-ci, vantant ses procédés hygiéniques, captive quelquefois la confiance des imprudents, en donnant à croire que ses recettes guérissent les maladies ; de même la sophistique, affectant une parfaite intelligence des lois, persuade aux sots qu'elle se consacre à la justice, quand il est constant qu'elle favorise l'iniquité. D'un autre côté, il y a plusieurs traits de concordance entre le métier de parfumeur et celui de ces soi-disant juristes. Le parfumeur prétend que les produits de son art conservent au corps la force et la beauté ; et loin de là, non seulement ils le rendent moins dispos, mais encore ils l'affaiblissent, l'énervent, et flétrissent la vivacité de la carnation en rendant le sang paresseux ; de même, ces charlatans de justice s'annoncent faussement pour augmenter les facultés de l'âme, tandis qu'ils brisent les ressorts de son énergie native. Platon regarde comme pouvant être enseignées et étudiées les vertus qui tiennent à la rationalité de l'âme, à savoir la sagesse et la prudence. Il range encore au nombre des vertus de rationalité celles qui ont pour but de remédier aux principes vicieux, à savoir la fermeté et la continence. Seulement, les premières de ces vertus sont par lui regardées comme des sciences ; pour les secondes, il ne les appelle des vertus que quand elles sont parfaites ; et quand elles ne sont qu'imparfaites, il leur refuse même le titre de sciences, sans pour cela les exclure à jamais de cette dernière catégorie. La justice, qu'il répartit entre les trois divisions de l'âme, est, selon lui, l'art de vivre, et constitue une science due tantôt à l'étude, tantôt à la pratique et à l'expérience. Parmi les biens il en est qu'il faut rechercher, dit-il, pour eux-mêmes, comme la sérénité parfaite, les joies pures ; il en est d'autres qui ne doivent pas être recherchés pour eux, comme la médecine ; il en est d'une troisième essence qui doivent être recherchés pour ces deux considérations à la fois ; par exemple la prudence et les autres vertus, que nous recherchons d'abord pour elles-mêmes, vu qu'elles sont essentiellement supérieures et honorables, ensuite pour un motif étranger à elles, à savoir pour le bonheur parfait, ce résultat si désirable des vertus. C'est encore dans ce sens que certains maux doivent être évités pour eux-mêmes ; d'autres, pour des motifs étrangers ; d'autres enfin, pour les deux raisons réunies : la sottise, par exemple, et les vices analogues, qui doivent être évités pour eux-mêmes d'abord ; ensuite pour les conséquences fâcheuses qui peuvent en provenir, à savoir la misère et l'infortune. Des choses qui sont à désirer il en est que nous nommons sans restriction des biens : ce sont celles qui en tout temps et pour tous constituent des avantages réels par leur présence seule, comme les vertus dont le résultat est un bonheur parfait. Il en est d'autres dont l'utilité toute spéciale ne s'applique ni à tous les instants ni à tous les individus : comme les forces, la santé, les richesses, et tout ce qui tient au corps et à la fortune. Pareillement dans les choses qui sont à éviter, les unes paraissent des maux dans tous les temps et à tous les yeux quand on en éprouve l'obstacle et la contrariété, comme les vices et les infortunes ; les autres nuisent à quelques personnes seulement, et encore n'est-ce pas toujours, comme la maladie, l'indigence et les autres calamités. La vertu tient essentiellement à notre libre arbitre ; elle dépend de nous, et doit réunir tous les efforts de notre volonté. Les vices ne tiennent pas moins à notre libre arbitre, ne sont pas moins placés en nous ; mais cependant ce n'est pas notre volonté qui nous les impose. En effet. qu'un homme s'applique à la contemplation de la vertu, il se sera bientôt profondément convaincu qu'elle est bonne, que son excellence est incontestable, qu'elle mérite tous efforts et toute recherche pour elle-même. Que d'un autre côté il étudie les conséquences du vice, il reconnaîtra que non seulement pour l'estime personnelle, mais encore sous d'autres considérations, il est extrêmement préjudiciable. Comment donc concevoir alors que cet homme en subisse spontanément le joug ? C'est que, tout en suivant la voie où l'engagent ses passions, tout eu courant après les jouissances dont il espère qu'elles le feront jouir, il est alors même séduit par un fantôme de bien et qu'il se précipite dans le mal avec une sorte de calcul. Car enfin aurait-on le sens commun si, tout en reconnaissant la dissemblance de la pauvreté et de la richesse, tout en ayant les facilités d'échapper à une pauvreté qui n'aurait rien d'honorable et d'obtenir au contraire une opulence qui n'aurait rien d'infamant, on allait préférer à celle-ci la privation complète de tout ce qui est nécessaire ? Pour aller plus loin encore dans l'absurde, concevrait-on un homme qui dédaignât la santé du corps et lui préférât les maladies ? De même le type de la dernière démence ne serait-il pas un homme qui des yeux de l'âme verrait la beauté de la vertu, qui par l'expérience et par le raisonnement reconnaîtrait son utilité, qui n'ignorerait pas tout le déshonneur et tous les désastres qui naissent du contact des vices, et qui pourtant préférerait s'y vouer ? La santé du corps, la vigueur, l'exemption des souffrances et tous les autres biens extérieurs de ce genre, comme encore les richesses et tous les autres avantages que nous attribuons à la fortune, ne doivent donc pas être appelés biens d'une manière absolue. Car si tout en les possédant on en abdique l'usage, ils seront inutiles : d'un autre côté, si on les applique à une direction coupable, ils iront même jusqu'à paraître nuisibles. Enfin si on en abuse, on s'exposera à tomber dans les vices ; et comme l'état d'avoir des vices est incompatible jusqu' au dernier moment avec l'état de jouir de ces biens, il faut rigoureusement en conclure que ces derniers ne méritent pas leur nom d'une manière absolue. D'un autre côté, ce qui constitue une souffrance, comme la pauvreté et. les autres situations de ce genre, ne doit pas être regardé absolument comme mal. En effet qu'un homme possède une très médiocre fortune, s'il sait régler ses dépenses il n'éprouvera aucun dommage ; et celui qui sait habilement ménager sa pauvreté, non seulement ne se trouvera jamais dans la gêne, mais deviendra plus ferme et plus capable de supporter les autres incommodités. Si donc il n'y a pas incompatibilité entre se trouver dans la pauvreté et s'y conduire suivant les règles de la raison, le pauvreté en soi n'est point un mal. La volupté ne saurait non plus être appelée un bien ou un mal d'une manière générale et absolue. Car s'il est une volupté honnête, acquise par des actions honorables et glorieuses et qu'on ne doit pas éviter, il en est une autre que repousse la nature même, parce qu'elle est le fruit de honteux plaisirs et qu'elle doit être proscrite. Les inquiétudes et les travaux dirigés dans les voies de la nature, s'ils naissaient de la vertu même et s'ils étaient acceptés pour quelques glorieuses entreprises, Platon les regardait comme dignes d'envie ; mais si c'était contrairement à la nature et dans des vues honteuses qu'on s'y livrait, il les flétrissait du nom de pervers et de détestables. Car ce ne sont pas seulement les vices, disait-il, qui par suite de notre volonté souillent nos âmes et affligent nos corps ; il y a en outre une sorte d'état moyen, comme quand on n'a pas de tristesse et que néanmoins on ne ressent pas de joie. Des choses qui sont en nous, ce qui avant tout est bon et louable, c'est la vertu. C'est parce qu'elle est un bien pour qui s'y applique qu'elle doit être appelée honorable ; car nous ne qualifions d'honnête que ce qui est bien, comme de honteux que ce qui est mal. Et en effet, ce qui est honteux ne saurait être un bien. L'amitié, selon Platon, est essentiellement sociable, et consiste dans les sympathies ; elle est réciproque, et c'est un échange de rapports délicieux quand il y a retour égal de part et d'autre. Précieux effets de ce sentiment ! L'ami désire que celui qu'il aime jouisse comme lui de la prospérité. Mais une pareille union ne saurait exister que si des analogies de caractère motivent de part et d'autre une égale tendresse. Car comme les natures semblables s'enchaînent par des liens qu'on ne saurait détacher ; de même celles qui diffèrent ne sauraient s'unir et former entre elles des amitiés. Les haines funestes, de leur côté, sont produites par une malveillance qui prend sa source dans l'incompatibilité des humeurs, dans la distance des rangs, dans la divergence des opinions et des systèmes. Platon établit qu'il existe encore d'autres espèces d'amitiés, les unes formées à l'occasion du plaisir, les autres par une loi impérieuse de nature : l'amour de ses proches et de ses enfants tient à cette dernière. Il en est une autre qui est indigne du caractère honorable de l'homme et qu'on appelle vulgairement amour : c'est une concupiscence effrénée, dont la violence inspire de la passion pour les corps seuls ; comme si l'homme n'existait que dans ce qu'il offre aux regards ! De telles pestes des âmes, Platon défend qu'on les appelle même des amitiés, parce qu'elles ne sont pas mutuelles, et qu'elles ne sauraient être payées de retour, puisque celui qui aime ne saurait se faire aimer ; puisqu'en outre elles n'ont pas de constance, pas de durée, et que le résultat où aboutit un semblable commerce est toujours le dégoût et le repentir. Platon compte trois espèces d'amour : le premier est l'amour divin, s'alliant à la pureté de l'âme et avec la vertu raisonnée, lequel n'amène jamais les remords ; le second est d'une âme dégénérée, et a pour but la volupté la moins pure ; le troisième, mélange des deux précédents, tient moitié à l'âme, moitié aux sens. Les âmes les plus impures à leur tour n'obéissent qu'aux plaisirs sensuels ; elles n'ont qu'un but, celui de jouir des corps et d'assouvir leur ardeur par les voluptés et les jouissances du corps. D'autres âmes, douées d'un instinct de noble préférence, aiment les âmes de gens de bien, s'attachent à elles, voudraient faire en sorte de les constituer le plus possible sur de salutaires principes et de les élever au point le plus haut d'excellence et de supériorité. Les âmes moyennes tiennent des deux natures : sans se priver complètement des jouissances du corps, elles peuvent être charmées par les nobles attraits de l'esprit. Conséquemment, comme l'amour impur et indigne de l'homme, l'amour déshonorant, provient non pas de la nature, mais d'un vice et d'une maladie toute corporelle, de même l'amour divin, concédé par la bienveillance et la faveur des dieux, doit être regardé comme ne descendant chez les âmes humaines que par l'inspiration d'une volonté toute céleste. Il existe une troisième espèce d'amour, que nous avons appelée moyenne. Elle doit sa formation au voisinage de l'amour divin et de l'amour terrestre : tenant à cette double alliance, à cette double parenté, en même temps qu'elle participe de la raison comme l'amour divin, elle est esclave des attraits de la volupté comme l'amour terrestre. Les hommes coupables se divisent en quatre catégories. Les premiers sont ceux qui briguent les honneurs, les deuxièmes ceux qui désirent les richesses, les troisièmes sont les démagogues, les derniers sont les tyrans. De ces inclinations coupables, la première se déclare lorsque, la vigueur de la raison s'affaiblissant, l'âme laisse prendre la primauté et l'empire à cette partie d'elle-même où domine la colère. Le système oligarchique se développe de son côté dans une âme, lorsque, par suite de la mauvaise nourriture donnée à la partie de l'âme qui se compose de passions, il y a envahissement, non seulement de cette partie rationnelle et irascible, mais encore de celles qui mettent en mouvement les appétits non nécessaires. C'est ce que Platon a nommé amour du gain et chasse aux honneurs. Le penchant à la démocratie existe lorsque les passions, traitées avec trop d'indulgence, non seulement s'enflamment de désirs légitimes, mais encore s'élancent comme au-devant de ces désirs, de façon que la partie qui doit conseiller l'irascible subisse au contraire sa loi. La tyrannie fait de l'âme comme une ville toute pleine de divagations et de désordres, dominée par l'ascendant de plaisirs aussi nombreux qu'illicites. Mais le dernier degré de dépravation est représenté par l'être aussi ignoble que redoutable qui se déclare contempteur des dieux. Un tel monstre, dit Platon, mène une existence hors de toute règle, une existence subversive de toute humanité et de toute société ; il ne peut sympathiser ni avec ses proches ni avec lui-même, et ainsi il est non seulement l'ennemi des autres, mais encore le sien propre. Ce n'est pas seulement des autres, c'est encore de lui-même qu'il se constitue l'adversaire, et conséquemment, dans un tel état, il n'est pas ami des gens de bien ; il ne l'est de personne, ni même de lui. Ce degré extrême de la dépravation est celui au-delà duquel il semble que rien ne puisse s'élever. Un homme ainsi réprouvé ne saurait se tirer d'affaire dans le commerce habituel de la vie, d'abord à cause de son impéritie, ensuite parce qu'il ne se connaît pas lui-même, et que la dépravation consommée jette le trouble dans les âmes, embarrasse tous projets, toutes méditations, et déconcerte toute volonté. Or, cet être méchant et dépravé doit son exécrable caractère d'abord aux vices qui sont contraires à la nature, comme est la jalousie ou la joie du malheur d'autrui, et ensuite aux impressions que ne désavoue pourtant pas la nature : je veux dire la volupté, le chagrin, le regret, l'amour, la miséricorde, la crainte, la honte, la colère. Cela vient de ce qu'un esprit déréglé, dans quelque direction qu'il se lance, n'a pas de mesure, et que par conséquent il y a toujours en lui insuffisance ou excès. Aussi l'amour conçu par un homme de cette sorte est-il essentiellement corrompu, parce que non seulement dans ses désirs effrénés et dans sa soif inextinguible il désire savourer tous les genres de plaisir, mais parce qu'encore le jugement qu'il porte sur les formes le jette dans les erreurs les plus déraisonnables. Ne connaissant pas la véritable beauté, il n'aime que la beauté corporelle, beauté sans consistance, sans vigueur et sans durée. Ce n'est point aux corps brunis par le soleil ou raffermis par l'exercice qu'un tel homme accorde ses préférences, mais à ceux qui se sont épaissis à l'ombre, amollis dans l'inaction, engraissés par l'excès des soins. Les développements de la malice ne sont pas spontanés, comme la chose se démontre de beaucoup de manières ; car, selon notre philosophe, l'injustice étant une affection désordonnée et une maladie de l'âme, il en conclut qu'évidemment les hommes ne sauraient y être portés de leur propre mouvement. Quel homme d'ailleurs voudrait par simple amour du mal faire entrer sciemment dans la meilleure partie de son âme le crime et le désordre ? Lors donc que l'on se met imprudemment sous l'empire du mal, il faut que ce soit à son insu qu'on en subisse et l'usage et les actes. C'est en ce sens que c'est un pire état de faire du dommage que d'en recevoir ; car, sur quoi tombe le dommage ? sur des choses de peu de prix, sur des corps, sur des objets extérieurs : or, ces objets peuvent subir des altérations ou être anéantis par de frauduleuses manoeuvres, sans qu'il y ait préjudice pour les parties plus nobles qui tiennent à l'âme même. Faire le dommage est donc un état beaucoup plus fâcheux. De là on peut comprendre que c'est le vice qui perd les âmes originellement bonnes, et qu'un homme qui veut en perdre un autre se nuit plus à lui-même qu'il ne fait de tort à celui contre lequel il machine ses coupables complots. Mais si nuire à un autre est un mal funeste entre tous, c'en est un bien plus funeste encore que de causer du dommage et de rester impuni. Oui, c'est un état plus terrible, plus affreux que tous les supplices, lorsqu'un coupable se trouve dans l'impunité et que la vengeance des hommes ne le châtie pas ; de même qu'une situation désespérée c'est de n'avoir pas de secours dans les maladies les plus dangereuses, de voir son état échapper à la médecine, de ne pas être débarrassé par le fer ou par le feu de parties dont la douloureuse amputation garantirait le salut de toutes les autres. Mais de même que les meilleurs médecins, quand ils ont affaire à des malades complètement désespérés, n'emploient point auprès d'eux les ressources de leur art, de peur qu'un traitement qui serait inutile ne contribue à prolonger le temps des souffrances ; de même, lorsque des hommes sont gangrenés de vices à tel point qu'ils ne puissent trouver de guérison dans les remèdes de la sagesse, il vaut mieux qu'ils meurent. Un mortel que ni sa nature ni son amour-propre ne peuvent déterminer à suivre avec ardeur le chemin de la vertu, mérite, selon Platon, d'être rayé du nombre des vivants ; ou, s'il tient à la vie, il faut qu'il soit livré aux sages, dont la morale pourra le familiariser avec les inclinations vertueuses : et bien certainement il est de beaucoup meilleur qu'un tel individu soit gouverné, et qu'il n'ait pas le pouvoir de gouverner les autres. Loin d'être le maître, il faut qu'il soit l'esclave ; et du moment qu'il est dans l'incapacité d'être préposé comme chef à des subordonnés, son rôle est d'obéir bien plutôt que de commander. Quand un homme est dépravé, disait Platon, non seulement il est moralement inférieur aux autres, parce que le désordre de ses vices le bouleverse en tous sens, et qu'il est livré aux orages de ses désirs ; mais encore la multiplicité de ces mêmes désirs augmente son indigence réelle, à ses propres yeux d'abord, et ensuite à ceux des autres ; c'est à peine s'il voit s'accomplir quelques-unes de ses espérances, se réaliser quelques uns de ses souhaits, et encore n'est-ce qu'au prix des plus vives alarmes. Bientôt à ces désirs ardents succèdent des fantaisies plus furieuses, et il est à la fois poignardé par les maux qu'il prévoit et bourrelé par le remords du passé qu'il a derrière lui. Les hommes parfaitement vertueux, comme les scélérats consommés, sont du reste en petit nombre : ils sont fort rares, et, pour me servir de ses expressions, on les compte. Mais pour ceux qui ne sont ni tout à fait vertueux ni parfaitement criminels, c'est-à-dire qui sont d'une moralité moyenne, ceux-là constituent la pluralité. Il faut noter toutefois et que les meilleurs de cette catégorie ne marchent pas toujours bien droit, et que les coupables ne commettent pas constamment le mal. Les vices de ces derniers ne sont ni l'excès de la dépravation, ni le résultat d'un désordre et d'une perversité hors de mesure ; ils naissent d'un excès ou d'une défectuosité dans la nature de l'individu. Ceux chez qui il y a matière à estime parfaite comme à éloge restreint, et qui cheminent entre la louange et le blâme, n'ont jamais de mobile certain dans leur conduite. Ils obéiront tantôt à la voix de la raison, proclamée par les hommes honnêtes et vertueux, tantôt à l'appât que leur présenteront les gains illégitimes et les voluptés honteuses. De tels hommes ne savent point ce que c'est que la persévérance du dévouement en fait d’amitié, sans être précisément criminels, ils ne sont néanmoins pas honorables. La parfaite sagesse ne saurait exister, dit Platon, qu'avec la supériorité du génie, des talents, de la prudence ; supériorité qui a dû être préparée dès l'enfance par une série d'actions et de paroles qui la laissaient pressentir. Pour qu'elle se maintienne, il faut que l'âme soit vierge, pure de la fange des voluptés, qu'une sainte ardeur l'embrase pour le désintéressement, la patience, et pour le mérite que donnent l'éloquence et l'instruction solide. Honneur au mortel animé d'inspirations semblables ! il s'avance d'un pas ferme et confiant dans le sentier de la vertu ; et, fort du système vrai selon lequel il a réglé sa vie, il atteint comme d'un trait à la perfection ; autrement dit, il touche tout d'un coup aux limites les plus extrêmes du passé comme de l'avenir, et il plane en quelque facon au dessus de l'éternité. C'est une âme qui, ayant rompu pour jamais avec le vice, ne se familiarise plus, ne s'identifie plus qu'avec ce qui peut contribuer à la vie heureuse ; et conséquemment le sage, loin de dépendre des autres, de croire qu'il puisse rien recevoir d'eux, croit avec raison que son bonheur est entre ses mains : aussi n'est-il pas plus enorgueilli par la prospérité qu'il n'est abattu par le malheur ; car il se sent pourvu de ressources dont aucune violence ne saurait le priver. Un tel homme s'abstiendra non seulement de faire le mal, mais encore de le rendre. En effet, il ne regarde comme outrageantes ni les injures du méchant ni toutes autres, par cela seul qu'il peut leur opposer une résignation patiente et ferme. Une loi de la nature a gravé dans son âme cette vérité, que rien de ce que le vulgaire croit être du mal ne saurait nuire au sage, et conséquemment, fort de sa bonne conscience, il goûte une sécurité, un calme qui ne l'abandonne pas durant toute sa vie ; d'abord parce qu'il explique ce qui lui arrive selon les théories d'un optimisme absolu, ensuite parce que nul événement n'excite en lui trouble ou colère, et qu'il est convaincu que le soin de sa destinée appartient aux dieux immortels. Pareillement, lorsqu'approche le jour de la mort, il l'attend avec sérénité et sans angoisse, parce qu'il a foi en l'immortalité de l'âme. Dégagée des liens du corps, l'âme, il le sait, retourne au sein des dieux ; et, grâce aux mérites d'une vie chaste et irréprochable, cette vie mortelle même est une épreuve qui lui assure la béatitude céleste. Le sage reçoit encore de Platon le titre d'homme parfait ; notre philosophe proclame sa bonté, sa prudence ; et c'est avec raison, car ses principes sont d'accord avec la vie pratique la plus exemplaire, et la base de sa conduite est l'observance absolue de la justice. Le sage est encore, selon lui, d'un courage à l'épreuve, attendu que par sa fermeté d'âme il est préparé à tout souffrir ; et c'est sous ce point de vue que Platon appelle le courage le nerf, et en quelque sorte la moelle épinière de l'âme, de même qu'il regarde la lâcheté de l'âme comme une véritable infirmité. Il estime que le sage seul est riche ; et il a tout à fait raison, puisqu'en possédant les vertus le sage paraît posséder des richesses plus précieuses que tous les trésors du monde. Et d'ailleurs, comme le sage seul peut indiquer la route à suivre dans les occasions nécessaires, il ne peut manquer de paraître le plus riche ; car, quelle que soit l'opulence des autres, toujours est-il que, faute d'en connaître l'usage ou parce qu'ils les appliquent de la manière la plus extravagante, ils semblent être dans l'indigence. La pauvreté d'ailleurs tient moins à l'absence de l'or qu'à la présence de désirs immodérés. Quelle sera la conduite du philosophe qui veut ne manquer de rien, s'endurcir à tout, se montrer supérieur aux épreuves que les hommes regardent comme pénibles à supporter ? Son étude constante doit être de tenir l'âme séparée du corps ; et c'est en ce sens qu'il devra regarder la sagesse comme un état de mort, comme un moyen de s'habituer à mourir. Tous les gens de bien doivent être amis entre eux, même sans se connaître beaucoup ; et c'est l'ascendant de supériorité qui rapproche leur conduite et leurs principes, qui doit établir entre eux cette amitié ; car les pareils ne se contrarient jamais, et conséquemment entre les gens de bien seuls existe réellement une amitié digne de ce nom. La sagesse garantit la vigueur de l'adolescence à celui qui tout en aimant le bien se sera senti particulièrement porté à la pratique des bons principes par la pureté de son âme ; et il n'y aura pas de difformités corporelles qui puissent exclure ces honorables penchants : car, quand l'âme s'est fait chérir pour elle-même, l'homme tout entier devient aimable, et quand c'est le corps seul qui est désiré, c'est la partie la moins noble de l'être qui se trouve aimée. On est donc fondé en raison à croire que celui qui a la connaissance du bien aspire à ce qui est analogue au bien ; car celui-là seul est enflammé de bons désirs, qui voit ce bien avec les yeux de l'âme : c'est même là ce qui s'appelle être sage, attendu qu'ignorer les vrais biens, c'est les détester ; et, nécessairement, c'est aussi ne pas aimer la vertu. La conséquence ne saurait manquer : un homme qui déteste la vertu laisse prédominer en lui l'amour des voluptés honteuses. Le sage au contraire est tel que la perspective d'un plaisir, quelque vif qu'il doive être, ne le déterminera point à agir s'il ne voit pas pour sa plus belle récompense une satisfaction honorable à sa vertu. Mais aussi, passionné pour de si nobles plaisirs, il ne peut manquer de couler une vie honorable et de se conquérir avec l'admiration générale un tribut certain d'éloges et de gloire. Grâce à ces heureux privilèges, non seulement il aura le pas sur tous les autres, mais encore la joie et la sécurité seront son partage exclusif et perpétuel. Il ne se livrera point au désespoir, quand il sera privé de ses plus chères affections ; et cela, tant parce qu'il tire de lui-même tout ce qui va droit à la félicité, que parce que les principes et la voix de la saine raison lui interdisent de semblables douleurs. D'ailleurs s'il s'affligeait pour un tel motif, ce serait ou à cause de celui qui serait mort parce qu'il le croirait réduit à un état pire, ou par rapport à lui-même parce qu'il s'affligerait d'avoir vu briser une aussi intime liaison. Mais d'abord il faut s'interdire toutes douleurs conçues pour l'amour des morts eux-mêmes, puisqu'on sait qu'ils ne souffrent aucun mal, et que si leurs intentions ont été pures ils ont pris rang parmi des créatures plus parfaites ; ensuite il ne faut pas se livrer à ces douleurs par rapport à soi-même, attendu que quand on place tout en soi il n'y a nulle privation qui puisse entraîner celle de la vertu, ce domaine dont la possession n'échappe jamais : ainsi donc le sage ne sera point triste. Le but de la sagesse est que le sage atteigne au mérite de Dieu ; son travail spécial doit donc être de rivaliser par sa conduite avec la perfection qui caractérise les dieux. Et ce résultat il pourra certainement l'obtenir s'il se montre parfaitement juste, pieux, prudent. En conséquence ce n'est pas seulement par des théories purement contemplatives, mais encore par une laborieuse pratique, qu'il réalisera un plan de conduite également agréé et des dieux et des hommes ; car le souverain des dieux ne se contente pas d'embrasser dans son intelligence le système de ce monde ; il en parcourt encore toute l'immensité, les premières parties comme les dernières, comme les moyennes ; il les connaît intimement ; et c'est sa providence, si admirablement régulière, qui surveille cet immortel ensemble. On ne saurait manquer de paraître heureux, dit Platon, quand on possède les biens et quand on sait comment s'abstenir des vices. Une première espèce de bonheur consiste à pouvoir garantir par la supériorité de son esprit les résultats auxquels on a atteint. L'autre, à ne manquer de rien de ce qui constitue la vie parfaite et à s'en tenir à la contemplation seule : or, ces deux félicités prennent l'une et l'autre leur source dans la vertu ; et pour embellir l'âme ou pour se perfectionner dans la vertu, on n'a besoin d'aucun de ces appuis extérieurs que les hommes regardent comme des biens. Cependant les usages de la vie commune exigent que l'on donne au corps les soins indispensables, et que l'on se mette en possession des ressources qui viennent du dehors ; à ces conditions toutefois qu'on les sanctifie en quelque sorte par la vertu et qu'elles ne deviennent pour nous une occasion de bonheur que par le concours de celle-ci ; sans quoi on ne pourrait en aucune façon les regarder comme des biens. Et ce n'est pas une vaine proposition que celle-ci, que la vertu seule peut procurer le parfait bonheur, puisque sans elle on ne saurait trouver la félicité dans toutes les autres jouissances. Oui, c'est notre intime persuasion, le sage est l'acolyte, l'imitateur de Dieu ; il se dirige sur les traces de Dieu. C'est ce que dit le précepte : ἕπου θεῷ, suis Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans le cours de sa vie que le sage doit parler d'une manière digne des dieux et se garder de ce qui peut déplaire à leur sainte majesté ; il doit en être encore de même quand il dépouille son enveloppe mortelle, ce qu'il ne fera jamais sans le consentement de Dieu. Car bien qu'il tienne en ses mains la puissance de se donner la mort, bien qu'il sache qu'en abandonnant ce séjour terrestre il entrera en possession d'un avenir meilleur, cependant, à moins qu'une loi divine ne lui impose cette détermination comme une nécessité, le sage ne doit pas hâter l'heure de son trépas ; et si la pureté de sa vie antérieure l'honore, il doit tenir à ce qu'il en soit de même de sa fin : il faut que sa réputation le rende jusqu'au dernier moment tranquille sur l'existence de sa postérité. Puis, lorsqu'il rentrera au séjour immortel, la philosophie pour récompense de sa vie pieuse lui promet le séjour des créatures fortunées, où il sera confondu avec les choeurs des dieux et des demi-dieux. Platon parle ensuite sur la constitution des républiques, sur les théories gouvernementales, et voici quelles sont ses prescriptions. D'abord il définit la cité en ces termes : La cité est une agrégation de plusieurs hommes, les uns gouvernants, les autres subordonnés, qui s'assemblent sous les auspices de la concorde pour établir entre eux échange de ressources et de secours et pour régler par des lois communes et équitables leurs rapports mutuels. Une cité, continue-t-il, ne sera une, ne sera bien réellement renfermée dans l'enceinte des mêmes murailles, que si les esprits des habitants se sont accoutumés à vouloir et à ne pas vouloir les mêmes choses. C'est pour cela qu'il conseille aux fondateurs des républiques de ne pas laisser s'accroître démesurément la population, afin que les citoyens puissent toujours être parfaitement connus du chef de l'état en même temps que connus les uns des autres ; car c'est à cette condition que tous pourront se trouver animés d'un même esprit, et voudront que la justice leur soit rendue également à tous. Si une cité est vraiment grande, ce n'est ni la multitude de ses habitants ni l'importance de leurs ressources personnelles qui doivent constituer sa force ; car les forces du corps et la puissance des richesses appliquées au commandement d'une multitude ne méritent aucune estime si le désordre et le despotisme président à leur emploi. Il faut que les citoyens les plus éclairés d'une part et de l'autre tous les citoyens protégés par la loi obéissent à un pacte commun. Mais pour les républiques qui ne seraient pas établies sur ces plans, Platon ne les, regarde pas comme des cités saines ; ce sont à ses yeux des réunions viciées et renfermant des germes funestes. Les républiques dont la raison est la base, disait Platon, sont celles qui sont organisées à l'instar de l'âme, c'est-à-dire dans lesquelles la sagesse et la prudence ayant la primauté, tout le reste de l'être se soumet à l'obéissance ; et de même que l'âme préside exclusivement aux soins de tout le corps, de même le législateur sage doit veiller seul aux intérêts de la république entière. De plus le courage qui est la deuxième partie de la vertu ne se borne pas à maîtriser et à restreindre par son énergie les appétits blâmables, il doit encore veiller dans le sein de l'état. Les hommes en âge de porter les armes doivent, comme de vigilantes sentinelles, se tenir prêts à combattre pour l'utilité de tous. Quant aux esprits remuants, indisciplinés et par conséquent dangereux, le soin de les réprimer, de les contenir, et, s'il le faut même, de les anéantir, appartient à une discipline plus prudente et plus éclairée. Enfin il existe une troisième condition dont l'observance, également désirable selon notre philosophe pour le peuple et pour les gens de la campagne, tient à l'utilité générale, c'est que le gouvernant (et sans cela point de république possible), c'est que le gouvernant ait l'amour de la sagesse ou que l'empire soit déféré à celui que la voix commune proclame le plus sage. Tel doit être, dit-il encore, le fond de la moralité générale, que ceux à la garde et au dévouement de qui est ainsi confiée une république ne soient accessibles à aucun amour de l'or et de l'argent ; qu'ils n'aspirent point sous prétexte des intérêts généraux à s'enrichir personnellement ; que leur hospitalité ne s'exerce pas en faveur de certains privilégiés à l'exclusion des autres ; que leur table et leur intérieur soient réglés de telle façon qu'ils dépensent en repas publics les revenus que leur affectent leurs administrés. Platon parle aussi des mariages qui doivent, dit-il, non pas se conclure comme une affaire privée, mais devenir un acte public ; le droit de fiancer devant être une attribution dévolue aux sages, aux magistrats et à d'autres que la voix du sort aura désignés. Ils veilleront principalement à ce que les mariages ne soient disproportionnés ni sous le rapport de la fortune ni sous celui des sympathies. A ces recommandations notre philosophe en joint une autre non moins utile et nécessaire. Il veut que dès leur première éducation tous les enfants soient confondus sans différence aucune, afin qu'étant ainsi mêlés il devienne difficile aux parents de les reconnaître. De cette manière ceux-ci ne connaissant pas les leurs regarderont comme tels tous ceux qu'ils verront avoir l'âge de leurs enfants, et il n'y aura plus qu'une seule et grande famille. Pour les mariages eux-mêmes, il existe une certaine réunion de circonstances que Platon développe : ainsi un mariage s'annonce avec des conditions de stabilité si les nombres du jour sont en rapport avec certains accords de la musique. Les enfants qui seront nés de tels mariages seront imbus de goûts analogues les uns aux autres, et à l'école des mêmes maîtres ils puiseront les meilleurs principes, aussi bien garçons que filles. Pour ces dernières, Platon veut les voir initiées à tous les arts qu'on regarde comme attributs exclusifs des hommes, aux fatigues mêmes de la guerre : ayant même nature, elles ont mêmes aptitudes. Une cité de ce genre n'aura besoin de rien emprunter aux législations étrangères : la prudence du souverain, soutenue par de telles moeurs et de telles institutions, dispensera de toutes autres lois. Du reste une semblable république n'est en quelque sorte qu'un emblème de la vérité : c'est une conception de son esprit qu'il présente comme un exemple. A côté de cette république, il en est une autre également très morale, très juste, élevée aussi sous les auspices et sous l'inspiration de l'équité, république qui n'est pas comme la précédente une utopie tout idéale, mais qui a réellement quelque consistance. Dans celle-là le philosophe ne procède pas en son nom, il ne règle pas l'ordre et le bien-être de l'état selon des principes et des fondements établis par lui-même. Il se propose à peu près le problème suivant : “Etant donnés un emplacement, une réunion d'hommes, par quels procédés un législateur pourra-t-il, eu égard à la situation des choses et à la nature des habitants, y faire régner les bonnes lois et les bonnes moeurs ?” Or, dans cette seconde république, Platon veut encore que les enfants soient allaités, soient instruits en commun ; mais pour ce qui est des mariages, des enfants, des patrimoines, des intérieurs, il renonce aux plans par lui tracés dans la première république. Ici les mariages sont une affaire toute privée, toute personnelle, ne regardant que les futurs époux. Seulement, tout en laissant aux parties le droit de contracter mariage comme elles l'entendent, il impose aux chefs de l'état le soin de veiller à ce que les intérêts de la chose publique n'en soient pas compromis. Ainsi, il n'y aura pas empêchement à une alliance entre nches et pauvres, et réciproquement ; même, en maintenant des positions égales de fortune, il y aura utilité à ce que les caractères se mélangent ; à ce qu'un homme violent épouse une femme tranquille, un homme d'un tempérament calme, une femme à humeur vive ; parce que, grâce aux correctifs obtenus par cette fusion des sujets, les naturels divers ne pourront que s'améliorer dans les générations subséquentes, et ainsi sera-t-il contribué encore au bien-être de la république. Les enfants conçus par des parents de caractères opposés, tout en conservant des traits de ressemblance avec chacun de leurs auteurs, ne manqueront ni de vigueur pour agir ni cependant de prudence pour prendre une détermination. Les enfants devront être élevés selon les vues adoptées par leurs parents. Les maisons et les propriétés devront être particulières, dans les proportions qui peuvent être permises à un seul individu ; toutefois notre philosophe ne permet pas qu'elles soient démesurément agrandies par avarice, ou dissipées par désordre, ou abandonnées par négligence. Il veut qu'une telle république soit régiée par un code dans la composition duquel le législateur songera surtout à populariser les vertus. Le mode de gouvernement qui lui paraît par dessus tous utile, est celui qui offre un tempérament des trois pouvoirs ; pour l'aristocratique ou le démocratique, exercés seuls et sans restriction, ils lui semblent devoir être funestes. Loin de croire que les fautes des gouvernants puissent rester impunies, il pense qu'ils doivent de leurs actes un compte d'autant plus sévère qu'ils sont placés plus haut par leur pouvoir. D'autres formes de républiques également morales lui semblent pouvoir être imaginées ; mais pour celle qu'il décrit et où il veut faire régner l'ordre il recommande au législateur de suppléer avant tout au déficit des lois ou de corriger celles qui sont vicieuses, et de faire ensuite porter ses améliorations sur les moeurs qui seront dépravées et sur les institutions qui compromettraient les intérêts de l'état. Or, en supposant que les bons conseils et la persuasion ne puissent agir sur une multitude trop dépravée, il faudra l'arracher à ses habitudes par la violence et contre son gré. Mais dans une cité bien active, comme il le remarque, toute la population se laisse naturellement aller à la voix de la justice et de la bonté. De tels citoyens aiment leurs proches, respectent les magistrats, écartent l'intempérance, répriment l'injustice : la pudeur et les autres qualités qui honorent une existence sont les objets de leurs hommages particuliers. Mais ce ne sera pas à l'improviste qu'une multitude assemblée se régularisera en cité aussi savamment régie ; il faudra qu'au préalable elle ait été composée d'hommes à l'éducation desquels auront présidé les meilleures lois et les plus excellents principes, d'hommes qui seront modérés à l'égard des autres, retenus à l'égard d'eux-mêmes. Selon Platon, il y a quatre classes de coupables : la première, celle des hommes constitués en haute dignité ; la deuxième, celle des membres d'un gouvernement oligarchique ; la troisième, celle des démocrates ; la dernière, celle des tyrans. Les premiers se montrent lorsque les plus sages citoyens étant bannis de la ville par des magistrats séditieux, le pouvoir est déféré à ceux qui n'ont que la force matérielle, lorsque ceux qui pourraient gouverner au nom de la persuasion n'occupent plus le pouvoir et l'ont résigné entre des mains turbulentes et brutales. L'oligarchie existe lorsqu'une majorité d'hommes sans ressources et sans aveu se met à la discrétion de quelques riches, se livre à eux corps et âmes, et qu'ainsi la souveraine puissance devient l'apanage non pas d'hommes éclairés mais de quelques parvenus opulents. La démocratie se constitue lorsque la multitude indigente prévaut sur la fortune des riches et que le peuple a pu faire proclamer cette devise, “chances égales pour tous d'arriver aux honneurs.” Enfin le pouvoir tyrannique se développe lorsqu'un homme, s'affranchissant avec audace des entraves de la légitimité, envahit par une agression non moins audacieuse l'empire désormais sans lois, établit pour unique code que la multitude entière des citoyens obéira à ses désirs, à ses caprices, et ne met plus de bornes aux hommages qu'il prétend exiger. LIVRE III L'étude de la sagesse, étude que nous appelons philosophie, paraît généralement embrasser trois spécialités ou parties : une qui s'applique à la nature, une qui s'applique à la morale, et une troisième, dont je me propose de parler maintenant, qui s'applique au raisonnement dans le discours et qui constitue la logique. Puisque nous allons parler du discours, disons d'abord qu'il se produit sous une variété infinie de formes : il commande, il informe, il raconte ; il exprime le courroux, le souhait, le voeu, la colère, la haine, l'envie, la faveur, la pitié, l'admiration, le mépris, le reproche, le repentir, la douleur ; il est tantôt voluptueux, tantôt terrible ; et dans ces genres divers, l'orateur excellent sait restreindre les pensées qui sont trop vastes, développer celles qui ne le sont pas assez ; il met son talent à présenter des idées ordinaires sous une tournure élégante, des idées neuves sous une physionomie qui semble tout habituelle, et réciproquement des idées communes sous une physionomie nouvelle ; à affaiblir les grandes pensées, à faire naître des plus petits moyens les plus grands effets ; son art enfin se compose d'une foule de secrets du même genre. Parmi les différentes formes sous lesquelles se présente le discours, il en est une sur laquelle nous nous proposons d'insister : c'est la forme énontiative, pronuntiabilis. Cette forme procède par sens finis, et elle est la seule pour laquelle on puisse reconnaître erreur ou vérité. Sergius l'appelle effatum (principe), Varron, proloquium (idée première), Cicéron, enuntiatum (énoncé), les Grecs, protase, d'autres fois axiome, ce qui signifie à la lettre protension ou question ; j'emploierai le terme plus usité de proposition. Les propositions donc, comme les conclusions mêmes auxquelles elles aboutissent, sont de deux espèces. Les unes sont positives et en même temps simples, comme quand on dit : Celui qui règne est heureux ; les autres sont subordonnées ou conditionnelles et en même temps composées, comme quand on dit : Celui qui règne, s'il est sage, est heureux ; car on subordonne une condition par laquelle s'il n'y a pas sagesse il n'y aura pas bonheur. Nous allons présentement parler des positives, qui par leur nature sont les premières et sont en quelque sorte l'élément des propositions subordonnées. Il existe encore d'autres différences entre les propositions, selon qu'elles ont ou plus d'extension ou plus de compréhension. Ce qui constitue la différence d'extension, c'est que les unes sont générales, comme : Tout ce qui respire est vivant ; les autres, particulières, comme : Certains animaux ne respirent pas ; d'autres sont indéfinies, comme : Un animal respire ; car on ne précise pas si c'est tout animal, ou certain animal : du reste, ces dernières sont toujours regardées comme particulières, parce que, dans l'incertitude, il est plus prudent de se décider pour ce qui a le moins d'extension. Ce qui constitue leur différence de compréhension, c'est que les unes sont attributives, en ce sens qu'elles attribuent un état à tel ou tel sujet, comme : La vertu est un bien : cette proposition indique que la vertu a le bien pour attribut. Les autres sont négatives, en ce sens qu'elles nient l'existence de tel attribut chez tel ou tel sujet, comme : La volupté n'est point un bien : on nie que le bien soit un attribut inhérent à la volupté. Les stoïciens croient faire aussi une proposition attributive, quand ils disent : Il arrive à certaine volupté de n'être point un bien. C'est indiquer ce qui arrive à la vertu ou indiquer ce qu'elle est. Conséquemment, disent-ils, c'est là une proposition attributive, parce qu'il y est parlé de l'existence d'un attribut à propos d'un sujet dans lequel cet attribut paraît ne pas exister. En un mot les stoïciens n'appellent propositions dénégatives, que celles qui sont précédées de la particule négative. Mais en ce point, comme en d'autres, ils ne peuvent appuyer leur dire ; car, qu'on pose ainsi la formule : Ce qui n'a aucune substance n'est pas, ils seront contraints, d'après leur énoncé, de reconnaître que ce qui n'est pas, ce qui n'a aucune substance, existe pourtant. Du reste, la proposition, comme dit Platon dans le Théétète, se réduit rigoureusement à deux des parties du discours, le nom et le verbe : comme Apulée disserte ; ce qui est vrai ou faux, et par conséquent forme une proposition. Quelques uns même ont cru pouvoir en induire que ce sont les deux parties uniques du discours, parce qu'à elles seules elles peuvent constituer le discours parfait, autrement dit, parce qu'elles renferment un sens complet. Suivant cette opinion, les adverbes, les pronoms, les participes, les conjonctions, et les autres termes énumérés par les grammairiens, ne sont pas plus des parties du discours que les ornements ne font partie intégrante du vaisseau, que les poils ne font partie de l'homme ; ou au moins, le discours étant comparé à un bâtiment, toute cette nomenclature grammaticale n'en représentera que les clous, la poix et le goudron. Quoi qu'il en soit, des deux parties ci-dessus énoncées, l'une est appelée sujet, comme étant effectivement subordonnée : c'est Apulée ; l'autre est l'attribut, disserte, ou bien ne disserte pas : elle attribue effectivement à Apulée tel ou tel fait. Il est permis, en laissant la même valeur à chacun de ces éléments, de développer l'un ou l'autre en un plus grand nombre de mots ; par exemple, au lieu d'Apulée, on peut dire : Le philosophe platonicien de Madaure. De même, au lieu de disserte, on peut dire : Se livre à une dissertation. D'ordinaire, le sujet a moins d'extension, et l'attribut en a davantage, pouvant s'appliquer non seulement au sujet de la proposition mais encore à d'autres ; car Apulée n'est pas le seul qui soit discourant : un grand nombre d'autres sont dans le même cas, et le même attribut peut leur convenir pareillement. Toutefois, l'attribut peut être l'énoncé d'un fait exclusivement propre au sujet, comme quand on dit : L'être appelé cheval a la propriété de hennir. C'est un fait particulier au cheval que celui de hennir ; et dans ces phrases toutes particulières, il y a parité d'extension dans le sujet et dans l'attribut. Ce dernier, contrairement aux autres cas, n'a pas plus d'extension ; si bien qu'il est possible de renverser l'ordre et de mettre pour sujet ce qui était d'abord l'attribut en disant d'une manière inverse : L'être qui a la propriété de hennir est l'être appelé cheval. Or, on ne peut intervertir ainsi quand les deux termes n'ont pas même extension. Effectivement, bien qu'il soit vrai que tout homme est un animal, néanmoins, si vous prenez l'inverse, il ne sera pas vrai pour cela que tout animal soit un homme ; attendu que l'état d'animal n'est pas exclusivement le partage de l'homme, comme l'état de hennissant l'est du cheval, et qu'au contraire il y a outre l'homme une quantité innombrable d'animaux. Conséquemment, lorsque les termes de la proposition sont intervertis, l'attribut se reconnaît à plusieurs traits distinctifs. D'abord, cet attribut peut avoir plus d'extension que le sujet ; ensuite, il n'est jamais exprimé par un nom, il l'est toujours par un verbe, et même cette dernière propriété empêcherait à elle seule de confondre entre eux le sujet et l'attribut, ce dernier se trouvât-il avoir autant d'extension que le sujet. Pareillement, si l'on étudie leurs points de ressemblance, on verra que, comme il y a des propositions déterminées et des propositions indéterminées, de même il est constant que le sujet et l'attribut sont tantôt déterminés, comme animal, homme ; tantôt indéterminés, comme qui n'est pas animal, qui n'est pas homme. En effet, on ne détermine pas ce qu'est tel sujet ou tel attribut, quand il n'est pas animal, quand il n'est pas homme ; on indique seulement qu'il est autre chose que cela. Maintenant, il faut dire quel est le rapport des quatre propositions entre elles, et il sera bon de les considérer d'après une figure linéaire. Soit donc sur une ligne supérieure une proposition générale attributive, et une proposition générale dénégative, comme : Toute volupté est un bien ; - Nulle volupté n'est un bien ; et soient appelées ces deux propositions, propositions contraires. De même, sur une ligne inférieure et au-dessous de chacune des deux générales, plaçons leurs particulières corrélatives : Certaine volupté est un bien ; - Certaine volupté n'est pas un bien ; et appelons ces deux dernières sous-contraires entre elles. Ensuite menons des ligues obliques qui se coupent, l'une allant de la générale attributive à la particulière dénégative ; l'autre, de la particulière attributive à la générale dénégative. De cette manière, nous établirons un nouveau rapport de propositions à extension et à compréhension inverses, que nous appellerons contradictoires. De ces dernières, il faut absolument que l'une ou l'autre soit vraie, ce qui constitue l'entière et parfaite contradiction ; mais entre les deux propositions sous-contraires et entre les deux propositions contraires, il n'y a qu'une demi-contradiction. Sans doute deux contraires ne sont jamais vraies ensemble, mais quelquefois elles sont fausses ensemble ; réciproquement, deux sous-contraires ne sont, à la vérité, jamais fausses ensemble, mais quelquefois elles sont vraies ensemble ; et par conséquent la réfutation de laquelle des deux l'on voudra est précisément la preuve de l'autre, sans que pourtant, par réciproque, la preuve de la vérité de l'une soit la réfutation de l'autre. Démontrer la vérité de laquelle on voudra des contraires, c'est par le fait même nier l'autre, sans que néanmoins la réciproque soit vraie et que réfuter l'une ce soit prouver l'autre. A l'égard des contradictoires, prouver n'importe laquelle c'est toujours réfuter l'autre, et réfuter l'une c'est toujours prouver l'autre. Enfin, chacune des deux propositions générales, quand elle est établie, établit sa particulière, et néanmoins peut être réfutée sans la détruire ; de même que, vice versa, toute proposition particulière infirme par sa réfutation la générale correspondante, et ne l'établit pourtant pas par sa preuve. On vérifiera sans peine tous ces principes, en jetant les yeux sur les propositions elles-mêmes combinées dans la figure que voici :
Il est certain, du reste, qu'il y a concession faite du moment qu'il y a proposition. On détruit l'une ou l'autre des propositions générales de trois manières : en démontrant ou que sa proposition particulière est fausse, ou que sa contraire est vraie, ou encore que sa sub-contraire est vraie ; mais on n'établit cette même proposition générale que d'une seule manière, en démontrant que sa contradictoire est fausse. Pareillement, on détruit la proposition particulière d'une seule manière, en démontrant la vérité de sa contradictoire ; et on l'établit de trois manières, en démontrant ou que la proposition générale correspondante est vraie, ou que l'une des deux autres, à savoir sa sub-contraire ou sa contradictoire, est fausse. Nous observerons la même chose dans les propositions équipollentes. Or, on appelle équipollentes celles qui sous des énoncés différents ont la même valeur : elles sont ou vraies ensemble ou fausses ensemble, et se prouvent conséquemment l'une par l'autre, comme la proposition indéfinie et la proposition particulière. De plus, si une proposition quelconque prend à son commencement la particule négative, elle équivaut à sa contradictoire ; soit, par exemple, la proposition générale affirmative : Toute volupté est un bien : si on la fait précéder d'une négation, on aura : Toute volupté n'est pas un bien ; proposition qui équivaut à la contradictoire de la précédente : Certaine volupté n'est pas un bien. Il faut savoir qu'il en est de même pour les trois autres propositions. Passons maintenant à la conversion. Les propositions qui peuvent être converties sont la générale négative et sa contradictoire, c'est-à-dire la particulière affirmative. Cela tient à ce que les éléments constitutifs de ces propositions, c'est-à-dire le sujet et l'attribut, peuvent toujours changer de place entre eux sans qu'elles cessent d'être vraies ou fausses comme auparavant. En effet, comme cette proposition-ci est vraie : Nul homme sensé n'est impie ; de même, si vous changez les deux membres de place, il sera vrai de dire : Nul impie n'est sensé. Pareillement, comme c'est une proposition fausse que celle-ci : Nul homme n'est animal ; de même, en l'intervertissant, elle sera fausse encore : Nul animal n'est homme. Le même procédé de conversion s'applique à la particulière affirmative : Certain grammairien est homme, et Certain homme est grammairien. On ne peut pas toujours opérer de même sur les deux autres propositions. Ce n'est pas que parfois on ne les intervertisse ; mais néanmoins elles ne sont pas pour cela appelées conversibles ; car il suffit qu'une opération trompe dans quelques cas, pour qu'on la regarde comme incertaine et qu'on la rejette. Il faut donc pour chaque proposition s'assurer par tous les sens qu'elle présente si elle conserve encore son caractère distinctif après la conversion. Ces propositions qui ne se convertissent pas simplement ne sont pas très nombreuses : elles se réduisent à cinq seulement. En effet, on énonce d'un sujet ou sa nature propre, ou son genre, ou sa différence, ou son essence, ou son accident ; hors ces cinq espèces d'attributs, on ne saurait en trouver d'autres pour établir une proposition. Par exemple, que le sujet soit homme, tout ce que vous pourrez dire de lui se rapportera ou à une propriété, comme ayant la faculté d'éclater de rire ; ou au genre, comme animal ; ou à la différence, comme raisonnable ; ou à la définition, comme animal raisonnable mortel ; ou à une circonstance accidentelle, comme orateur. En effet, tout attribut peut à son tour devenir sujet ou bien ne le peut pas ; or, quand il le peut, il exprime ce qu'est la chose, et c'est une définition, ou il ne l'exprime pas, et c'est une propriété. Si au contraire il ne le peut pas, ou il est ce qui doit figurer dans toute définition, c'est-à-dire il est ou genre ou différence ; ou il est ce qui ne doit pas y figurer, et il est une manière d'être purement accidentelle. En appliquant ces principes on reconnaîtra qu'une particulière négative n'est pas susceptible d'être convertie. Une proposition générale affirmative elle-même n'est pas susceptible d'être convertie ; mais pourtant si la proposition, en restant affirmative, devient particulière, elle peut subir ce changement. Ainsi, soit la proposition : Tout homme est un animal, elle ne peut être ainsi convertie : Tout animal est un homme ; et si on en fait une proposition particulière, on pourra dire : Certain animal est un homme. Mais cela n'a lieu que pour la conversion la plus simple de toutes, laquelle en logique se nomme réflexion. En effet il y a une autre manière de convertir les propositions, qui change non seulement l'ordre mais encore la qualité même de leurs parties constitutives. Ainsi un sujet, un attribut particuliers deviennent généraux et vice versa. Or, ce mode de conversion s'applique aux deux propositions qui restent, à savoir, la générale affirmative et la particulière négative ; exemples : Tout homme est un animal ; Tout ce qui n'est pas animal, n'est pas homme ; et encore : Certain animal n'est pas raisonnable ; Certain être non raisonnable est animal. Il en est constamment ainsi, comme on peut s'en convaincre au moyen des cinq espèces d'attributs précitées. Il y a des cas où plusieurs propositions peuvent concourir à former un même raisonnement : c'est quand elles ont un terme commun qui les unit les unes aux autres. Ce terme commun, que l'on nomme moyen terme, peut être ou sujet dans les deux propositions, ou attribut dans chacune d'elles, ou sujet dans l'une et attribut dans l'autre. De là par conséquent, trois formes que les logiciens nomment figures. La première, quand le terme commun est sujet dans une proposition et dans l'autre attribut. Or, nous donnons à cette forme le nom de première, non pas seulement parce que dans l'énumération il faut commencer par une, mais en outre parce qu'elle donne les conclusions les plus importantes. La dernière est la troisième, parce qu'elle ne conclut qu'au particulier ; et la deuxième passe avant elle, parce que si elle n'aboutit, il est vrai, qu'à des conclusions négatives, ces conclusions du moins sont générales. La supériorité de la première tient à ce qu'elle conduit à des conclusions de toute espèce. J'appelle conclusion ou proposition déduite celle qui s'infère et se conclut d'un fait concédé par l'adversaire, d'une concession. Une concession, c'est une proposition dont cet adversaire accorde la vérité. Soit, par exemple, cette phrase : Toute chose honnête est-elle bonne ? Voilà une proposition. Or, si l'adversaire déclare y donner son assentiment, elle devient une concession ; on supprime la forme interrogative, et on a une proposition générale : Toute chose honnête est bonne. Joignez-y une seconde concession, ou, en d'autres termes, une seconde proposition : Toute chose bonne est utile. De ce rapprochement, comme bientôt nous le montrerons, résulte un premier mode de proposition concluante, laquelle est générale si la conclusion est directe ; comme par exemple : Donc toute chose honnête est utile ; et particulière, si la conclusion est formée en convertissant : Donc certaine chose utile est honnête. Car en convertissant des propositions générales affirmatives, on ne peut obtenir que des propositions particulières. Or, je dis qu'il y a conclusion directe quand le sujet est le même aussi bien dans les propositions concédées que dans la proposition concluante ; et pareillement, quand l'attribut est le même dans l'une et dans l'autre. Il y a conclusion indirecte, quand le contraire de ce que nous venons de dire a lieu. Du reste, tout ce raisonnement, qui consiste en propositions concédées et propositions concluantes, s'appelle conclusion ou syllogisme. Suivant Aristote on peut très convenablement définir le syllogisme : Un discours dans lequel certaines choses étant accordées, il en résulte nécessairement quelque autre chose outre ce qui est accordé, mais par suite de ce même qui a été accordé. Dans cette définition il ne s'agit d'autre forme de discours que de la forme assertive, laquelle seule est absolument vraie ou absolument fausse. On y dit exprès au pluriel, certaines choses étant accordées, parce qu'une seule proposition ne suffirait pas pour faire un raisonnement. Nous voulons toujours conclure non à ce qu'on nous accorde, mais à ce qu'on ne nous accorde pas ; c'est pour cela que la définition porte : Il résulte nécessairement quelque autre chose outre ce qui est accordé. Il importe beaucoup de distinguer s'il s'agit d'une chose qui existe actuellement ou d'une chose qui n'arrivera que sous certaines conditions préalables. La définition dit encore : Il résulte nécessairement ; elle s'exprime ainsi, pour qu'on distingue le syllogisme rigoureux de la simple induction qui argumente d'après des similitudes. Car dans l'induction aussi certaines choses sont accordées ; comme, par exemple : L'homme meut sa mâchoire inférieure ; le cheval meut sa mâchoire inférieure : de même le boeuf et le chien. De ces concessions on arrive à quelque autre induction ; à celle-ci, par exemple : Ainsi pareillement tout animal meut sa mâchoire inférieure. Or, c'est ce qui n'est pas vrai à l'égard du crocodile ; on peut, tout en accordant les premières propositions, se refuser ici à leur conséquence ; tandis que s'il y avait eu syllogisme, on n'aurait pu se refuser à cette conclusion, qui existe virtuellement dans ce qu'on a accepté : c'est ce qui motive ces mots, il résulte nécessairement. Enfin, la dernière partie de la définition n'est pas elle-même sans portée : elle montre que c'est par suite de ce qui a été accordé qu'on doit arriver à la conclusion, et qu'autrement celle-ci est illusoire. Mais voilà assez de développements à cet égard. Disons maintenant de quelles manières et par quelles combinaisons on pourra en se renfermant dans un certain nombre de propositions assertives arriver à des conclusions véritables : c'est ce qu'on appelle figures. Par une première figure on trouve seulement neuf modes, dont six sont concluants ; dans la deuxième, quatre modes, dont trois sont concluants ; dans la troisième, six modes, dont cinq sont concluants. Je parlerai prochainement de chacun de ces modes en leur ordre ; mais je dois dire à l'avance que les particulières seules ou les négatives seules ne sauraient donner des conclusions logiquement satisfaisantes, attendu que souvent même elles peuvent en donner de fausses. Pareillement, quel que soit le nombre des propositions affirmatives, si on les combine avec une seule qui soit négative, la conclusion devient non pas affirmative, mais négative ; tant est grande l'influence d'une seule de cette espèce mêlée aux autres ! Semblable est la force des propositions particulières : une d'elles, quelle qu'elle soit, mêlée à des générales, donne pour concluante une proposition particulière. Dans la première figure, le premier mode est celui qui de prémisses générales affirmatives tire directement une conclusion générale affirmative ; exemple : Toute chose juste est honnête : Toute chose honnête est bonne : Donc toute chose juste est bonne. Mais si vous concluez par conversion : Donc certaine chose bonne est juste, la même combinaison donnera le cinquième mode. Car une générale affirmative ne peut être convertie que de cette manière, comme je l'ai indiqué précédemment. Le deuxième mode est celui dans lequel on conclut directement à une négative générale d'une générale affirmative et d'une générale négative ; exemple : Toute chose juste est honnête : Nulle chose honnête n'est honteuse : Donc nulle chose juste n'est honteuse. Mais si vous concluez par conversion, Donc nulle chose honteuse n'est juste, vous obtiendrez le sixième mode. Car, comme nous avons dit, la proposition générale négative se convertit simplement. Seulement, n'oublions pas que c'est de l'affirmative que doit être tiré le sujet de la proposition concluante dans le deuxième mode ; c'est pour cela qu'il faut considérer cette proposition affirmative comme la majeure, quand même on énoncerait d'abord la négative. Et en général c'est la proposition la plus influente du syllogisme qui doit être considérée comme la majeure. Dans le sixième mode, le sujet est tiré d'une proposition négative. Voilà la seule différence qui distingue ces deux modes. Il y a, en outre, le troisième mode dans lequel d'une affirmative particulière et d'une affirmative générale on conclut directement à une particulière affirmative ; exemple : Certaine chose juste est honnête : Toute chose honnête est utile : Donc certaine chose juste est utile. Mais si vous concluez par conversion : Donc certaine chose utile est juste, vous produirez le septième mode, attendu, comme il a été dit, qu'une particulière affirmative se convertit d'elle-même. Le quatrième mode est celui où, d'une particulière affirmative et d'une générale négative, on conclut directement à une particulière négative ; exemple : Certaine chose juste est honnête : Nulle chose honnête n'est honteuse : Donc certaine chose juste n'est pas honteuse. Ce quatrième mode a des propriétés qui sont opposées à celles des précédentes. En effet, le huitième et le neuvième mode auxquels il donne naissance conservent sa conclusion, et cela sans la convertir comme on l'a fait pour les autres modes. Ils convertissent seulement les prémisses elles-mêmes en les remplaçant par des propositions équivalentes, et ils en changent l'ordre, mettant la négative en premier. C'est pourquoi on dit qu'ils concluent par conversion de prémisses. En effet, convertissez la prémisse universelle négative du quatrième mode, faites-la suivre de l'universelle affirmative obtenue par la conversion de la particulière affirmative, et vous aurez le huitième mode qui par conversion tire de deux universelles, l'une négative et l'autre affirmative, une concluante particulière négative ; exemple : Nulle chose honteuse n'est honnête : Toute chose honnête est juste : Donc certaine chose juste n’est pas honteuse. Le neuvième mode est le produit d'une semblable conversion : d'une générale négative et d'une particulière affirmative, il conclut par conversion à une particulière négative : Nulle chose honteuse n'est honnête : Certaine chose honnête est juste : Donc certaine chose juste n'est pas honteuse. Veut-on savoir pourquoi à lui seul le quatrième mode en a formé deux, tandis que tous les autres n'en donnent chacun qu'un seul ? La raison en est que si dans le premier mode les deux prémisses sont converties, il y aura une combinaison de deux particulières qui ne conclura à rien. Si on convertit l'une seulement, on obtiendra la deuxième ou la troisième figure. De même, si dans le deuxième mode on convertit ces deux mêmes prémisses, on aura la combinaison du neuvième, laquelle nous avons déjà démontré naître du quatrième, attendu que la générale affirmative du deuxième mode ne peut se convertir qu'en une particulière ; et si on n'en convertit qu'une, on aura la deuxième figure ou la quatrième. Or, de ces neuf modes contenus dans la première figure, les quatre premiers sont appelés indémontrables ; non pas qu'ils ne puissent se démontrer, comme le pense d'eux tous Ariston, ou qu'on soit à leur égard comme à l'égard de la quadrature du cercle ; mais parce que ces modes sont si simples et si évidents qu'ils n'ont pas besoin de démonstration ; à tel point que ce sont eux qui engendrent les autres, et leur communiquent le caractère d'évidence qu'ils ont eux-mêmes. Maintenant nous allons donner les modes de la deuxième figure : le premier mode, dans la deuxième figure, est celui qui, d'une générale affirmative et d'une générale négative, conclut directement à une générale négative ; exemple : Toute chose juste est honnête : Nulle chose honteuse n'est honnête : Donc nulle chose juste n'est honteuse. Ce mode se ramène au deuxième des modes indémontrables, si on y convertit les termes de la deuxième proposition. Le deuxième mode est celui qui, d'une générale négative et d'une générale affirmative, conclut directement à une générale négative ; exemple : Nulle chose honteuse n'est honnête : Toute chose juste est honnête : Donc nulle chose honteuse n’est juste. Ce mode ne diffère du précédent par sa combinaison qu'en ceci : à savoir, qu'il prend le sujet de la proposition concluante dans la proposition négative ; or, cela tient à ce que l'ordre des prémisses a été interverti, ce qui ne peut avoir lieu dans la première figure. Le troisième mode est celui qui, d'une particulière affirmative et d'une générale négative, conclut directement à une particulière négative ; exemple : Certaine chose juste est honnête : Nulle chose honteuse n'est honnête : Donc certaine chose juste n'est pas honteuse. Intervertissons dans ce syllogisme les deux termes de la générale négative ; nous aurons le quatrième mode indémontrable, d'où naît celui-ci. Le quatrième mode est celui qui, d'une particulière négative et d'une générale affirmative, conclut directement à une particulière négative ; exemple : Certaine chose juste n'est pas honteuse : Toute chose mauvaise est honteuse : Donc certaine chose juste n'est pas mauvaise. Ce mode est le seul qui se démontre par l'impossible, procédé dont nous parlerons quand nous aurons exposé les modes de la troisième figure. Dans la troisième figure, le premier mode est celui qui, de deux générales affirmatives, conclut à une particulière affirmative soit directement soit par conversion ; exemple : Toute chose juste est honnête : Toute chose juste est bonne : Donc certaine chose honnête est bonne ; ou bien ainsi : Donc certaine chose bonne est honnête. Car peu importe à laquelle des deux prémisses vous empruntiez le sujet de la conclusion, parce que peu importe lequel de leurs attributs vous énonciez le premier. Le deuxième mode est celui qui, d'une particulière affirmative et d'une générale aussi affirmative, conclut directement à une particulière affirmative ; exemple : Certaine chose juste est honnête : Toute chose juste est bonne : Donc quelque chose honnête est bonne. Le troisième mode est celui qui, d'une générale affirmative et d'une particulière affirmative, conclut directement à une particulière affirmative ; exemple : Tout ce qui est juste est honnête : Certaine chose juste est bonne : Donc certaine chose bonne est honnête. Le quatrième mode est celui qui, d'une générale affirmative et d'une générale négative, conclut directement à une particulière négative ; exemple : Toute chose juste est honnête : Nulle chose juste n'est mauvaise : Donc certaine chose honnête n'est pas mauvaise. Le cinquième mode est celui qui, d'une particulière affirmative et d'une générale négative, conclut directement à une particulière négative ; exemple : Certaine chose juste est honnête : Nulle chose juste n'est mauvaise : Donc certaine chose honnête n'est pas mauvaise. Le sixième mode est celui qui, d'une générale affirmative et d'une particulière négative, conclut directement à une particulière négative ; exemple : Toute chose juste est honnête : Certaine chose juste n'est pas mauvaise : Donc certaine chose honnête n'est pas mauvaise. De ces six modes, les trois premiers se ramènent au troisième des indémontrables, si on convertit la première proposition du premier et du deuxième ; pour le troisième, il offre la même combinaison que le deuxième, n'en différant qu'en ce qu'il tire son sujet de celle des prémisses du deuxième, qui est une générale. Aussi on le ramène au troisième des indémontrables, en convertissant non seulement une des prémisses, mais encore la conséquente. De même le quatrième et le cinquième naissent du quatrième indémontrable, si on convertit la première de leurs prémisses. Pour le sixième mode, on ne pourra par la conversion ni d'une ni de deux de ses prémisses le ramener à quelqu'un des indémontrables : il ne peut se prouver que par l'impossible. Il a cela de commun avec le quatrième de la deuxième figure ; et c'est pour cela que tous les deux ils sont comptés les derniers. Quant aux autres, leur ordre est disposé, dans toutes les figures, selon l'importance diverse qu'ils prennent en raison des prémisses qui y sont combinées et de leurs conclusions ; car comme l'affirmation s'énonce avant la négation, et que le général a le pas sur le particulier, les propositions générales sont placées avant les particulières, et les propositions affirmatives, soit prémisses ou conséquence, passent avant les négatives. Le mode qu'on, place avant les autres est celui qui se ramène le plus facilement à l'indémontrable, c'est-à-dire qui s'y ramène par une seule conversion ; et du reste, c'est la seule manière de prouver que ces modes arrivent à une conclusion certaine. Il y a encore une manière de prouver commune à tous les modes, même aux indémontrables : c'est celle qui est dite par l'impossible, et que les stoïciens appellent première constitution ou premier exposé. Ils la définissent ainsi : Si de deux prémisses on infère une conclusion, chacune d'elles combinée avec le contraire de la conclusion, inférera nécessairement le contraire de la prémisse restante. Voici maintenant l'ancienne définition : Nier la conséquente d'un syllogisme quelconque en même temps qu'on accepte une des deux prémisses, c'est nier la seconde prémisse. Cet aphorisme a été formulé contre ceux qui en concédant des prémisses se refusent impudemment à la concluante ; car il les réduit à l'absurde, attendu que de ce qu'ils nient on tire une conclusion contraire à ce qu'ils avaient concédé auparavant. Or, il est impossible que deux choses contraires soient simultanément vraies. Ils sont donc, sous peine d'absurdité, contraints d'admettre la conséquence ; et les dialecticiens ont eu raison de déclarer que ce mode est vraiment celui dans lequel le contraire de la conclusion combiné avec une des deux prémisses détruit l'autre. Les stoïciens prétendent qu'une conséquence n'est niée ou qu'une des prémisses n'est réfutée, que si on emploie une particule négative, comme tout est, il n'est pas vrai que tout soit ; certaine chose est, il n'est pas vrai que certaine chose soit. Il se forme donc contre tout syllogisme huit conclusions contraires ; attendu que chaque prémisse est réfutée de deux manières ; et l'on construit deux fois quatre syllogismes, tantôt en faisant précéder d'une particule négative la conséquence, tantôt en prenant la contradictoire de cette conséquence même. Choisissons pour exemple le premier des modes indémontrables : Toute chose juste est honnête : Toute chose honnête est bonne : Donc toute chose juste est bonne. Celui qui se refuserait à cette conclusion après avoir accepté les prémisses, dirait nécessairement : Certaine chose juste n'est pas bonne. Or, si vous faites précéder cette proposition d'une des deux qui sont accordées : Toute chose juste est honnête, vous aurez une conséquence selon le sixième mode de la troisième figure : Donc certaine chose honnête n'est pas bonne ; ce qui est le contraire de la deuxième proposition, laquelle avait accordé : Toute chose honnête est bonne. Pareillement, si les prémisses restant les mêmes nous concluons par l'équivalente, nous aurons cette conséquente-ci, qui est encore tout l'opposé : Donc il n'est pas vrai que toute chose honnête soit bonne. De même, nous ferons deux autres syllogismes, si nous prenons la deuxième proposition comme nous venons de faire la première, à savoir : Certaine chose juste n'est pas bonne : Toute chose honnête est bonne : on arrive à une conclusion double, qui répond au quatrième mode de la deuxième figure : Donc il n'est pas vrai que toute chose juste soit honnête ; ou, Donc certaine chose juste n'est pas honnête. Or, chacune de ces deux conclusions répugne également à la première proposition, qui avait accordé : Toute chose juste est honnête. Maintenant, laissons subsister ces quatre raisonnements ; changeons seulement une prémisse, et, au lieu de celle-ci, Certaine chose juste n'est pas bonne, mettons, Il n'est pas vrai que toute chose juste soit bonne, de manière que la conclusion soit doublement niée ; on obtiendra quatre autres syllogismes avec les mêmes changements. Pareillement, si vous substituez à cette même prémisse la suivante, Nulle chose juste n'est bonne, de manière à réfuter triplement la conclusion, il y aura trois fois quatre raisonnements, mais seulement dans les syllogismes qui concluront par une générale. Car il n'y a qu'une conclusion générale qui puisse être réfutée de trois manières ; et conséquemment les autres formes de syllogisme ne peuvent jamais avoir contre elle plus de huit conclusions. Du reste, de même que, si on le veut, on pourra formuler toutes ces combinaisons séparément selon chaque mode en particulier d'après la marche que nous indiquons ; de même aussi on peut suivre le procédé algébrique, c'est-à-dire employer des lettres pour indiquer l'ordre et le changement des propositions ainsi que de leurs termes ; seulement, on procédera en énumérant les syllogismes par l'ordre d'importance de leurs conclusions. Soit le premier mode des indémontrables représenté par la formule : A est affirmé de tout В : Et В est affirmé de tout С : Donc A est affirmé de tout C. On commence par l'attribut, et par conséquent par. la deuxième proposition. Or, ce deuxième mode, ainsi algébriquement disposé, devient en déplaçant les termes : Tout С est В : Tout В est A : Donc tout С est A. Les stoïciens, au lieu de lettres, emploient des nombres, et formulent ainsi : Si le premier a lieu, pareillement le deuxième : Or le premier a lieu : Donc le deuxième. Aristote ne signale que quatre indémontrables dans la première figure ; Théophraste et les autres en comptent cinq. Cela tient à ce qu'ajoutant la proposition indéterminée, ils y joignent aussi la conclusion indéterminée. Or il est inutile de s'y arrêter, attendu que l'indéterminée est prise comme une particulière, et que les modes seront les mêmes que ceux qui résultent d'une particulière. Pour nous, nous avons déjà montré que dans la première figure il y a quatre modes ; si on veut les doubler en prenant l'indéterminée pour une particulière, et en concluant par une proposition indéterminée, il y aura en tout vingt-neuf modes. Ariston d'Alexandrie et quelques péripatéticiens modernes admettent encore cinq autres modes de conclusions au moyen de générales : dans la première figure, trois ; dans la deuxième, deux, en substituant le particulier au général. Mais quand le plus a été accordé, rien n'est plus absurde que de conclure par le moins. Il reste donc prouvé que les modes certains, dans les trois figures qui sont consacrées, ne s'élèvent pas au-delà des dix-neuf indiqués ci-dessus. Il y a quatre propositions : deux particulières, deux générales. Chacune d'elles, comme dit Aristote, se combine de quatre sortes, pouvant être suivie, soit d'une proposition du même genre qu'elle, soit de chacune des trois autres ; et de cette manière, dans chaque figure il y a seize combinaisons. Six d'entre elles sont également nulles dans toutes les figures ; deux, quand une des négatives, n'importe laquelle, précède une autre négative ; quatre, lorsqu'une des particulières, n'importe laquelle, vient avant ou après une autre particulière. Car il n'y a pas de conclusion possible toutes les fois qu'il y a dans les prémisses deux particulières ou deux négatives. Restent donc pour chaque figure dix combinaisons. Or, de ces dix, tant dans la première que dans la deuxième figure, deux sont nulles, lorsqu'une générale affirmative précède une particulière soit affirmative soit négative. Pareillement encore, dans la première et dans la troisième figure, il faut retrancher deux combinaisons, à savoir celles où une particulière négative précède une affirmative quelle qu'elle soit. Ce qui fait qu'à la première figure il reste pour ses neuf modes six combinaisons ; et aux deux autres figures, huit. Dans ces huit, il y en a une qui ne peut se prouver ni dans l'une ni dans l'autre ; c'est celle où une générale négative précède une particulière affirmative. Des sept qui restent, il y en a dans la deuxième figure quatre qui sont essentiellement fausses ; c'est quand une générale affirmative est jointe à une autre affirmative soit générale soit particulière, et cela quel que soit l'ordre de leurs termes. De même, dans la troisième figure, il y en a deux qui par elles-mêmes n'ont pas de valeur ; c'est quand n'importe quelle négative est placée avant une générale affirmative. Les autres combinaisons certaines qui restent sont au nombre de trois dans la deuxième formule, de cinq dans la troisième, comme nous l'avons fait voir ci-dessus, quand nous les ramenions aux six combinaisons de la première figure. Ainsi des quarante-huit combinaisons, quatorze seulement sont valables. Les trente-quatre autres que j'ai énumérées, sont repoussées et doivent l'être, parce que d'un principe vrai elles peuvent aboutir à une conclusion fausse. C'est ce dont tout le monde peut se convaincre par les cinq espèces d'attributs ci-dessus énoncées, le genre, le propre, etc. De plus, avec ces quatorze que nous admettons, on ne peut pas établir plus de modes que nous n'en avons indiqué, comme il se reconnaît d'après ces conclusions elles-mêmes, soit qu'on les prenne dans leur ordre naturel, soit qu'on les convertisse autant que le permet le bon sens. Conséquemment le nombre de ces modes ne peut être augmenté.
|