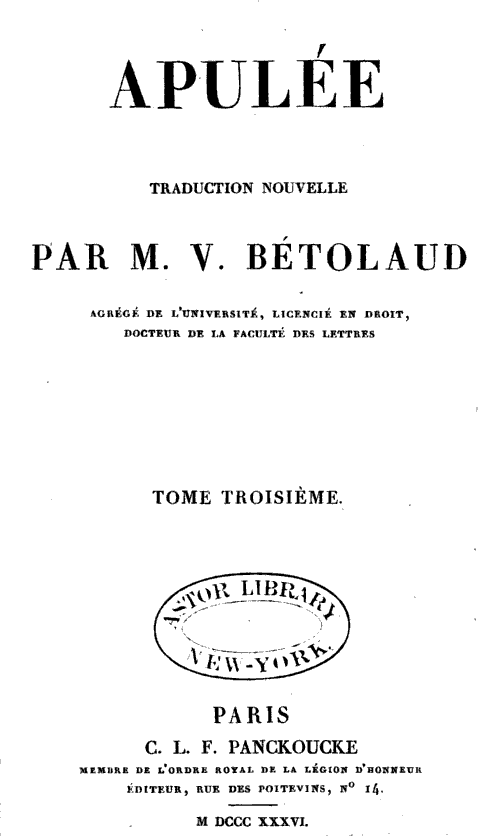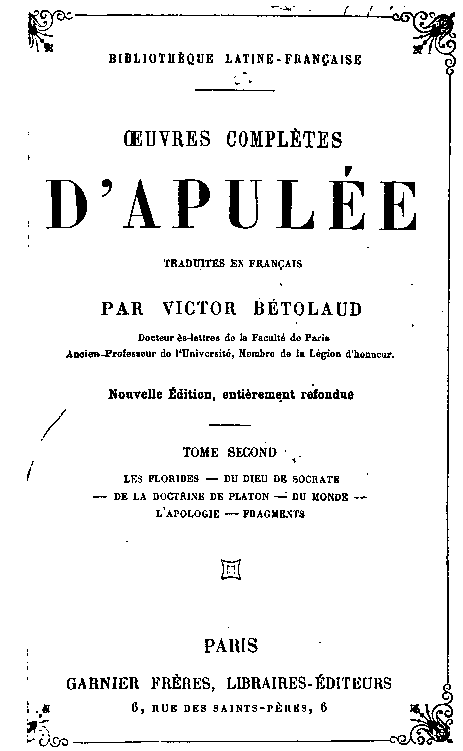|
|
|
|
|
APULÉE
APOLOGIE. Oeuvre numérisée et mise en page par Thierry Vebr
|
|
APOLOGIE Maximus Claudius, et Vous, ses assesseurs, je savais d'avance à n'en pas douter, comment Sicinius Émilianus, vieillard d'une élourderie notoire, procéderait dans son accusation contre moi. Il l'avait déférée devant vous sans se donner la peine d'y réfléchir ; il devait donc, à défaut de griefs véritables, la remplir d'arguments empruntés à la calomnie. Mais si l'homme le plus innocent peut-être accusé, le coupable seul peut être convaincu. Celle unique considération me rassure plus que tout le reste ; et en vérité je rends grâces aux dieux, puisqu'ils m'accordent l'occasion et les moyens, devant votre tribunal, d'abord de justifier la philosophie aux yeux de ceux qui ne la connaissent point, ensuite de me disculper moi-même. Je dois le dire pourtant : outre que ces calomnies semblaient graves au premier aspect, elles ont été si soudaines, qu'elles ont fait de la défense une tâche difficile ; car, vous le savez, cette affaire date seulement de cinq ou six jours. Je m'étais chargé de plaider contre les Granius pour Pudentilla, ma femme, lorsque, par une cabale montée et sans que je m'y attendisse, les avocats de cet Émilianus se mirent à m'attaquer de propos injurieux, à me reprocher des maléfices, et finirent en m'accusant de la mort de mon beau-lils Pontianus. Je compris qu'ils se proposaient bien moins d'entamer un procès criminel que de m'insulter et de faire du scandale ; et je les sommai le premier, à plusieurs reprises, de formuler une accusation. Alors Émilianus, voyant que vous-même, Claudius, étiez fort mécontent et que ses propos constituaient de véritables actes, commence à avoir peur, et cherche quelque moyen pour échapper aux suites de son inconséquence. Que fait-il ? Lui qui, peu auparavant, criait partout que j'avais assassiné Pontianus, fils de son frère, n'est pas plutôt mis en demeure de signer une telle accusation, qu'il oublie tout à coup la perte de son jeune parent, et le voilà soudain muet quand il s'agit de s'expliquer sur un aussi grave attentat. Toutefois, ne voulant pas paraître se désister tout à fait, il se rejette sur la magie ; et comme c'est là un grief plus commode à jeter à la face des gens qu'il n'est facile d'en établir la fausseté, il juge à propos de choisir ce seul texte pour son accusation. Encore même n'ose-t-il le faire ouvertement : il dépose le lendemain un mémoire signé du nom d'un enfant, du nom de mon beau-fils Sicinius Pudens ; et au bas il ajoute qu'il se charge de l'assister : manière nouvelle d'attaquer par l'entremise d'un tiers. Son but était de se mettre à couvert derrière cet enfant, pour éviter des poursuites comme calomniateur ; mais, Seigneur, vous devinâtes judicieusement toutes ses manoeuvres, et vous lui ordonnâtes encore une fois de soutenir en son nom propre, l'accusation qui était portée. Il promet de le faire ; mais alors même on ne peut encore le décider à une attaque franche : déjà il trouve le moyen de lancer contre vous des calomnies indirectes ; et reculant toujours devant le rôle périlleux d'accusateur, il persiste à demander la permission d'assister son neveu. Aussi, même avant que les plaidoiries fussent commencées, a-t-il été facile de pressentir de quelle nature serait l'accusation, quand on a su que celui qui l'avait provoquée et ourdie craignait d'en accepter la responsabilité, surtout quand cet homme était Sicinius Émilianus. Car bien certainement, s'il avait eu appris quelque chose de vrai sur mon compte, il n'aurait pas tant hésité à produire de si nombreuses et de si graves accusations contre un homme étranger à sa famille. N'est-ce pas le même qui a eu l'audace d'arguer de faux le testament de son oncle, bien qu'il en connût l'authenticité ? Et avec quelle opiniâtreté ne l'a-t-il pas fait ! Quand l'honorable Lollius Urbicus, après avoir pris l'avis des autres consulaires, eut prononcé que la pièce était bonne, valable et tenue pour telle, ce forcené ne craignit pas de protester contre cet arrêt solennel en jurant, malgré tout, à haute voix que le testament était faux. Le scandale fut tel, que sans l'extrême modération de Lollius Urbicus le misérable était perdu. Fort de mon innocence et de votre équité, j'espère que la voix de ce même magistrat éclatera encore dans ce jugement. Car c'est sciemment qu'Émilianus calomnie un homme non coupable ; et, en vérité, cela lui est d'autant plus facile que déjà devant le préfet de la ville et dans une affaire extrêmement importante, il a été, comme je l'ai dit, convaincu de mensonge. Or, de même qu'un honnête homme qui a eu un moment d'erreur s'observe ensuite avec plus de sollicitude, de même un esprit dépravé persévère dans le mal avec plus de confiance, et l'audace de ses désordres augmente avec leur nombre. La honte, en effet, est comme un vêtement que l'on ménage avec d'autant moins de soins qu'il est plus usé. Je crois donc nécessaire, pour maintenir mon honneur intact, de n'attaquer le fond de la cause qu'après avoir réfuté toutes ces calomnies. Car ce n'est pas moi seul que j'ai à justifier ; il faut encore que je défende la philosophie, dont la dignité repousse avec dédain la moindre réprimande à l'égal de la plus grave accusation. Je parle ainsi parce que, il y a peu de jours, les avocats d'Émilianus ont prodigué contre ma propre personne une foule de mensonges et se sont livrés contre les philosophes, en général, à ces attaques familières aux ignorants. Ils l'ont fait, je le veux bien, avec cette loquacité de louage qui les caractérise, attendu que chez eux c'est purement une affaire d'intérêt et d'argent : l'usage les autorise en quelque sorte à mettre leur impudence aux gages de qui veut les acheter ; et je compare ces clabaudeurs aux bêtes sauvages qui ont coutume de prêter le venin de leur langue pour faire souffrir les autres. Cependant, ne fût-ce que pour moi-même, je dois en peu de mots répondre à leurs calomnies ; autrement, malgré le soin que j'apporte à ne pas me souiller de la moindre tache ou du moindre déshonneur, si je laissais passer quelque chose de ces insinuations frivoles, je paraîtrais en admettre la vérité plutôt qu'en dédaigner le mensonge. D'ailleurs, je suis intimement convaincu que le propre d'une âme pudique et qui se respecte c'est de supporter avec peine les propos calomniateurs. Voyez ceux même à qui leur conscience reproche quelque méfait : si on les attaque, ils manifestent la colère et l'indignation la plus vive ; et pourtant, par cela même qu'ils se sont engagés dans la roule du vice, ils ont dû s'habituer à entendre mal parler d'eux ; à défaut d'autre voix, leurs remords les avertissent qu'on pourrait à juste titre les accuser. S'il en est ainsi, comment l'homme innocent et juste, dont l'oreille novice, en pareille matière, n est pas accoutumée aux imputations fâcheuses, est trop habitué aux éloges pour l'être aux outrages, comment un tel homme, dis-je, ne serait-il pas doublement ulcéré lorsqu'on l'accuse de ce qu'il aurait bien plutôt le droit de reprocher aux autres ! Que si par hasard je semble vouloir me justifier d'inculpations ineptes et tout à fait frivoles, ce reproche doit tomber sur mes accusateurs : pour eux est la honte de l'attaque ; pour moi, l'honneur de la repousser victorieusement. Or donc, il y a peu de jours vous avez entendu l'accusation débuter ainsi : «Nous accusons devant vous un philosophe d'une beauté remarquable, et très disert (voyez le grand crime !) tant en grec qu'en latin.» C'est bien, si je ne me trompe, clans ces termes mêmes que commençait le réquisitoire de Tannonius Pudens, homme fort peu disert, il est vrai, pour sa part. Plût au ciel que ces accusations si graves de beauté et d'éloquence, il me les eût véritablement intentées ! je n'aurais pas eu de la peine à répondre : je lui aurais dit comme le Paris d'Homère dit à Hector : Nul ne doit rejeter les dons des Immortels : Ne les a pas qui veut... Voilà ce que pour la beauté j'eusse répondu ; j'eusse encore ajouté qu'il est permis, même à des philosophes, d'avoir une figure distinguée : que Pythagore, qui le premier prit le nom de philosophe, était le plus beau de son époque ; que l'antique Zénon, originaire de Vélia, celui qui le premier de tous enseigna par un artitice ingénieux à présenter une question sous deux points de vue opposés, que ce Zénon, dis-je, était aussi d'une beauté incomparable, selon le dire de Platon ; que pareillement beaucoup de philosophes sont connus pour avoir été d'un extérieur charmant, et que tous ils rehaussaient les agréments de leur personne par la dignité de leurs moeurs. Mais ce système de défense, je l'ai dit, ne pourrait me convenir en aucune façon. En effet, outre que je n'ai qu'une ligure médiocrement belle, l'assiduité des travaux littéraires enlève au corps tous ses agréments : elle le rend grêle et chétif, elle diminue l'embonpoint, flétrit les couleurs, affaiblit les forces. Cette chevelure même, que par un impudent mensonge ils ont prétendu ne flotter sur mes épaules que pour ajouter à la beauté de mon visage, cette chevelure, vous voyez, est-elle bien séduisante, bien soignée ? Peut-il y avoir crinière plus hérissée, plus embarrassée, plus enchevêtrée ! Ne ressemble-t-elle pas à de l'étoupe réunie en paquets et par bourres ? C'est un fatras inextricable, tant il y a longtemps que je néglige, non seulement de la peigner, mais encore de la démêler et de la séparer sur mon front. C'en est, je pense, assez pour réfuter cette accusation de cheveux, dont ils faisaient un crime capital. Pour parler maintenant de l'éloquence, admettons que j'en ait ! quelque peu ; y aurait-il donc là quelque chose qui pût paraître, étrange ou blâmable ? Quoi ! dès mes premières années je me suis voué corps et âme à l'étude des belles-lettres ; j'ai méprisé toutes les autres jouissances jusqu'à l'âge où me voici ; j'ai plus travaillé que n'a peut-être jamais fait aucun homme ; j'ai travaillé le jour, j'ai travaillé la nuit ; j'ai prodigué, j'ai sacrifié une constitution des plus vigoureuses, et je n'aurais pas eu le droit d'acquérir quelque talent oratoire ! Mais qu'ils ne craignent rien de cette éloquence : malgré tous mes efforts, j'en suis plutôt encore à l'attendre qu'à la posséder. Pourtant si cette pensée, qu'on rapporte se trouver dans les poésies de Statius Cécilius est vraie, que l'innocence est de l'éloquence, je conviens en effet, à ce point de vue, et je ne m'en cache pas, que je ne me regarde comme inférieur à personne en éloquence. Car à raisonner ainsi, est-il quelqu'un de plus disert que moi ? Jamais je n'ai conçu une pensée que j'aurais rougi de dire hautement. Oui, en ce sens, je me proclame d'une éloquence incomparable ; toute mauvaise action a toujours été pour moi un crime infâme. Oui, je suis très disert : car il n'existe pas de moi un seul mot, un seul acte que je ne puisse soutenir à la face de tous. C'est ce que vais démontrer à propos de certains vers dont je suis l'auteur, et qu'ils m'opposent comme une honte. Vous avez vu, Seigneur, le rire courroucé qu'a excité chez moi le débit absurde et grossier avec lequel ils les prononçaient. Ils ont donc commencé à lire une pièce extraite de mes Oeuvres badines. C'est une petite épître en vers, adressée à un certain Calpurnianus sur une poudre dentifrice. Calpurnianus, du reste, en produisant contre moi cette bluette, n'a pas vu sans doute (tant il avait envie de me nuire !) que s'il devait y avoir là quelque chose qui pût me compromettre, il se compromettait pareillement lui-même ; car c'est lui qui me demandait une composition propre à nettoyer les dents, comme les vers l'attestent : Sur ta demande, avec ces vers, Calpurnianus, je t'adresse Une poudre de rare espèce, Arabique produit de végétaux divers. Peut-être, après tout, mérite-je d'être accusé pour avoir envoyé à Calpurnianus une poudre composée de végétaux de l'Arabie ; car il eût été beaucoup plus convenable qu'il suivît la méthode dégoûtante des Hibériens, et qu'il employât Sa propre urine à nettoyer Son jaune et hideux râtelier, comme dit Catulle. Je continue l'épitre : ... de végétaux divers. Des gencives soudain, grâce à cette merveille, L'enflure disparaît ; toujours fraîche et vermeille, La bouche peut sourire, et ne présente pas Les fétides lambeaux d'un précédent repas. Je le demande : y a-t-il rien là d'obscène, soit par le sujet, soit par l'expression, rien qu'un philosophe n'osât avouer comme sorti de sa plume ? J'ai vu déjà plus d'une personne ne pouvoir s'empêcher de rire de la véhémence avec laquelle ce grand orateur se déchaînait contre une poudre dentifrice : certes jamais rien n'a été dit de si énergique en parlant de poison. Mais enfin, c'est une accusation très acceptable pour un philosophe, que celle d'entendre dire qu'il ne souffre en soi aucune saleté, qu'il veut qu'aucune partie apparente de sa personne ne soit immonde et fétide : la bouche surtout, cet organe dont à chaque instant l'homme se sert, aux regards et à la vue de tous, soit pour donner un baiser, soit pour faire un discours, soit pour disserter devant un auditoire, soit pour prononcer des prières dans un temple. En effet, tout acte humain est précédé de la parole, qui, pour me servir de l'expression d'un grand poète, sort de derrière le rempart des dents. Vous mettriez à ma place un homme à grandes phrases, comme l'avocat de mon accusateur, qu'il vous dirait à sa manière, surtout s'il avait quelque habitude de la parole, que de toutes les parties du corps, nulle ne doit être soignée avec plus de sollicitude que la bouche : car, ajouterait-il, c'est le vestibule de l'âme, c'est la porte du discours, c'est l'atrium de la pensée. Moi, je dirai tout simplement, selon mes humbles moyens, que rien n'est plus indécent pour un homme libre et libéral que la malpropreté de la bouche. C'est la partie de l'homme qui, par sa position élevée, frappe la première les regards et remplit le plus grand nombre de fonctions. Les bêtes sauvages, les animaux domestiques ont le visage tourné vers la terre et rabaissé à leurs pieds, pour qu'il soit plus rapproché du sol qu'ils foulent et de la pâture dont il se nourrissent ; ce n'est presque jamais que quand ils sont morts ou quand ils sont furieux et veulent mordre qu'on voit leur bouche. Chez l'homme, au contraire, c'est ce qui se remarque avant tout lorsqu'il se tait, et le plus fréquemment lorsqu'il parle. Je voudrais bien que mon censeur Émilianus me dît s'il est lui-même dans l'habitude de se laver les pieds. Oui, sans doute, va-t-il me répondre ; or, prétendra-t-il que la propreté des pieds soit plus impérieuse que celle des dents ? Il est pourtant une chose bien vraie : si comme toi, Émilianus, un homme n'ouvre presque jamais la bouche que pour vomir la médisance et la calomnie, je suis d'avis qu'un tel homme ne doit apporter aucun soin à la propreté de cette bouche ; ce n'est pas à lui qu'il convient de nettoyer ses dents avec une poudre exotique : il sera cent fois plus rationnel qu'il les noircisse avec un charbon de bûcher, et que jamais il ne les rince, même avec de l'eau commune. Oui, que toujours cette langue, coupable interprète de mensonges et d'amertumes, croupisse dans ses malpropretés et ses souillures. Car faut-il, ô malheur ! qu'une langue pure et nette serve d'organe à une voix ordurière et corrompue ? Faut-il que, comme chez la vipère, un râtelier d'ivoire distille un noir venin ? Au contraire, quand un homme sait qu'il va émettre une parole destinée à être utile ou agréable, n'a-t-il pas bien raison de se laver auparavant la bouche, comme on lave un vase avant d'y verser quelque bonne liqueur ? Pourquoi même parler si longuement de la créature humaine ? Le crocodile, ce monstre énorme qui naît dans le Nil, ouvre aussi une gueule inoffensive pour se faire nettoyer les dents. Voici du moins ce que j'ai entendu dire : comme cette gueule est d'une dimension énorme, mais privée de langue, et qu'il reste le plus souvent souvent sous l'eau, une grande quantité d'insectes s'embarrassent entre ses dents. Par intervalles donc il s'installe, la bouche béante, sur le rivage ; et là, un des oiseaux du fleuve, -oiseau bien complaisant !- introduit son bec entre les dents du monstre, et les lui gratte sans le moindre danger. Mais laissons ce sujet. Je passe aux autres vers, aux vers d'amours, comme ils les appellent, et que pourtant la manière dure et rustique dont ils les lisent rendrait bien plutôt haïssables. Quel rapport y a-t-il entre de coupables sortilèges et les vers que je consacre à louer les enfants de mon ami Scribonius Létus ? Quoi ! suis-je donc magicien, parce que je suis poète ? A-t-on jamais ouï parler de semblable soupçon ? de rapprochement aussi judicieux ? de conséquence aussi immédiate ? Apulée a fait des vers, soit : s'ils sont mauvais, c'est un tort sans doute, mais tort de poète et non pas de philosophe ; s'ils sont bons, en quoi les accusez-vous ? On insiste, et l'on dit : Ce sont des vers badins, des vers amoureux. Si c'est là mon crime, pourquoi alors vous tromper de termes ? pourquoi me dénoncer comme coupable de magie ? Du reste, bien d'autres en ont fait de pareils ; et, si vous l'ignorez, chez les Grecs il y eut en ce genre un certain habitant du Téos, un de Lacédémone, un de Cio, et une foule innombrable d'autres. Il y eut aussi une Lesbienne ; et les vers passionnés de celle-ci étaient tellement gracieux, que la nouveauté d'un semblable langage chez une femme fut excusée par la douceur de sa poésie. Chez nous il y a Édituus, Portius, Catulus, et avec eux aussi une foule innombrable d'autres. Mais ils n'étaient pas philosophes... Eh bien, nierez-vous que Solon ait été un homme sérieux, un philosophe ? pourtant c'est lui qui a composé ce vers si lascif Sa cuisse faite au tour et sa bouche de rose. Que trouve-t-on de si désordonné dans tous mes vers, si on les compare avec celui-là seul ? Je ne parle pas de ce qu'ont écrit Diogène le Cynique, Zénon le fondateur de la secte des stoïciens et plusieurs du même genre. Je vais, du reste, réciter de nouveau les vers en question, pour qu'on sache bien que je ne les désavoue pas : Il est vrai, Charinus, j'adore Critias ; Mais pour toi mon amour n'en diminuera pas. Critias ! Charinus ! à ce double délire, Entre vous partagé, mon coeur pourra suffire. Comme un autre vous-même, ah ! chérissez tous deux Le mortel fortuné dont vous êtes les yeux. J'en récite maintenant d'autres, qu'ils ont lus en dernier lieu comme dépassant les bornes de toute licence. Accepte ce tribut d'Apollon et de Flore : Les vers, je te les offre afin de célébrer Ton quinzième printemps que ce jour voit éclore, Et des fleurs je veuxx voir ton beau front se parer. Oui, je veux rapprocher les plus exquises choses, Tes grâces, ta fraîcheur, et la fraîcheur des roses. Mais si de leur printemps je dépouille pour toi Mes jardins, mes bosquets ; à ton tour en échange Ton printemps et ta fleur, abandonne-les-moi. Critias, mes amours, Critias, ô mon ange ! A moi tes doux baisers, tes amoureux souris : Que de fleurs et de vers je te dois à ce prix ! Vous connaissez maintenant les pièces incriminées, Maximus : un petit badinage qui parle de vers et de fleurs, ils l'appelent le raffinement de la débauche la plus éhontée. Vous avez remarqué encore que l'on me fait un reproche d'avoir appelé ces enfants Charinus et Critias, tandis qu'ils ont d'autres noms. Par le même système ils doivent donc accuser C. Catulle : car il nomme Lesbie pour Claudia ; Ticidas : car il donnait le nom de Perilla à sa maîtresse qui était Metella ; Properce : car sous le nom de Cynthia il cache Hostie ; Tibulle : car il pense à Plania, en mettant le nom de Délie dans ses vers. Eh bien, moi, au contraire, j'inclinerais à blâmer C. Lucilius, tout poète ïambique qu'il est, pour avoir fait figurer dans son poème le jeune Gentilis et le jeune Macédo sous leurs noms véritables. Enfin, combien est plus réservé le poète de Mantoue ! Faisant comme moi l'éloge du fils de son ami Pollion, dans une de ses Bucoliques, il s'abstient de dire les noms véritables, prenant lui-même le nom de Corydon, il désigne l'enfant sous celui d'Alexis ! Mais Émilianus est un homme qui déliasse les bouviers et les pâtres de Virgile en fait de grossièreté : c'est un brutal fieffé et un rustre. Pourtant il se croit plus austère que les Serranus, les Curius, les Fabricius ; et le voilà qui prétend que ce genre de vers ne saurait convenir à un philosophe platonicien. Mais que diras-tu, Émilianus, si je t'apprends que les miens ont été faits à l'exemple de Platon lui-même ? Ce philosophe n'a écrit, en fait de vers, que des élégies amoureuses ; car pour le reste de ses poésies, sans doute parce qu'elles n'étaient pas assez gracieuses, il les jeta au feu. Apprends donc les vers du philosophe Platon sur le jeune Aster, si toutefois, aussi vieux que tu l'es, tu peux encore apprendre à lire : Je voudrais, tendre Aster, toi, mon astre charmant, Pour te contempler mieux, être le firmament. Aster chez les vivants fut l'étoile du jour, Aujourd'hui c'est Vesper dans le sombre séjour ; Voici encore un quatrain du même Platon, consacré à la fois au jeune Alexis et au jeune Phédrus : De mon bel Alexis en célébrant les charmes Des jaloux contre moi j'excite les alarmes ; À ces chiens dévorants c'est le livrer, hélas ! Car sous leurs dents Phédrus a trouvé le trépas. Enfin, pour ne pas multiplier les citations et pour conclure, je ne dirai plus que son distique sur Dion le Syracusain ; ce sera tout : Syracuse est en pleurs : c'est Dion qui succombe. Mon coeur inconsolé le suivra dans la tombe. Maintenant l'inconvenance, s'il y en a une, vient-elle de moi, qui récite des morceaux de poésie jusque dans le sanctuaire de la justice, ou bien de vous, dont la langue calomniatrice en fait le texte d'une accusation ? Comme si on devait jamais juger la moralité d'un auteur sur un simple badinage poétique ! Vous n'avez donc pas lu ce que répond Catulle à des critiques malveillants ? Poètes, il suffit que nos moeurs soient sans tache ; Nos vers, c'est autre chose... L'empereur Adrien, voulant honorer d'une inscription le tombeau du poêle Voconius son ami, y traça ces mots : Ton vers était lascif, mais ton âme était pure. Distinction que certes il n'eût jamais établie, si des vers trop badins pouvaient servir de base à une accusation d'impudicité ; car de ce même empereur Adrien je me rappelle en avoir lu beaucoup en ce genre. Ose donc, Émilianus, dire que ce soit faire mal que d'imiter un empereur, un censeur, le grand Adrien, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a transmis à la postérité. Du reste, peux-tu penser que jamais Maximus condamne ce qu'il sait avoir été composé par moi à l'exemple de Platon ? Les vers que j'ai cités de ce grand homme, sont d'autant plus chastes qu'ils sont plus clairs, d'autant plus pudiquement écrits qu'ils s'expriment avec plus de franchise. En effet, vouloir en pareille matière tout gazer, tout dissimuler, voilà où est le crime ; mais parler en termes clairs et positifs, c'est badiner. Le langage sans détours est innocent ; user de réticences, c'est penser à mal. Je pourrais encore citer de Platon ces paroles admirables et divines, qui, connues des âmes religieuses, (et le nombre en est rare), ne le sont point des profanes. Il existe, dit ce philosophe, deux Vénus ayant chacune leur amour distinct et leurs différents adorateurs. L'une est la Vénus vulgaire, présidant aux amours de la populace : c'est elle qui pousse aux plaisirs sensuels non seulement les créatures humaines, mais encore les brutes, les bêtes sauvages ; et sous ses puissantes, sous ses brutales étreintes, elle enchaîne comme des esclaves les êtres dont elle s'est emparée. L'autre est la Vénus céleste, présidant au plus noble amour : celle-ci ne règne que parmi les hommes, et ne s'intéresse même qu'à un petit nombre d'entre eux : jamais elle n'excite ses adorateurs à de honteux penchants : elle ne sait point provoquer ou séduire. Son amour n'est ni déréglé ni lascif ; tout en est sérieux, sans apprêt. Elle n'inspire de passion que pour les beautés de la vertu : et, si quelquefois elle recommande les agréments corporels, c'est pour défendre qu'on leur imprime quelque souillure, c'est pour proclamer que dans les corps on doit aimer seulement ce type de beauté pure et immortelle, révélée par avance aux âmes divines dans leur séjour au ciel. Aussi Afranius nous a-t-il laissé ce vers où l'on retrouve son élégance habituelle. Pour le sage l'amour, le désir pour les autres. Et pourtant, si tu veux savoir la vérité, Émilianus, ou si jamais pareil langage peut être compris de toi, l'amour du sage est moins de la passion que du souvenir. Pardonne donc au philosophe Platon ses vers sur l'amour, afin que je ne sois pas dans la nécessité, contrairement à la maxime qu'Ennius met dans la bouche de Néoptolème, de me livrer à une longue dissertation philosophique ; ou bien, si tu me tiens rigueur, je passerai facilement condamnation sur un crime dans lequel j'aurai Platon pour complice. Quant à vous, illustre Maximus, comment vous exprimerai-je ma reconnaissance en termes assez expressifs pour l'attention avec laquelle vous écoutez tous ces appendices de la défense ? appendices nécessaires pourtant, puisqu'ils répondent à mes accusateurs. J'ose encore implorer de vous la même attention pour ce qui me reste à dire avant que j'aborde le chef de l'accusation principale. En effet, vient maintenant cette longue et magistrale sortie contre les miroirs. “Un miroir ! s'est écrié Pudens (et j'ai cru qu'il allait en crever) ; un miroir ! quelle atrocité ! un philosophe se servir d'un miroir ! un philosophe posséder un miroir !” Eh bien ! oui, j'ai un miroir, je te l'accorde : car peut-être croirais-tu m'avoir fait une objection, si je songeais à nier. Mais il n'est pas rigoureusement logique d'inférer de là, que j'aie l'habitude de m'ajuster devant un miroir. Si je possédais une garde-robe de comédien, est-ce que vous en conclueriez par argumentation que j'ai l'habitude de me revêtir du long manteau tragique, de l'habit jaune de l'histrion, ou de la casaque bariolée que porte le mime aux fêtes solennelles de Bacchus ? Je ne le pense pas ; et réciproquement, il y a une foule d'objets dont je n'ai pas la propriété et dont pourtant je me sers. Que si donc l'usage ne prouve pas la possession, la possession ne saurait prouver l'usage ; or, c'est moins la possession d'un miroir qu'on me reproche, que l'habitude de m'y regarder. Il te resterait donc à établir quand et en présence de qui je m'y suis contemplé, puisque tu dénonces l'acte d'un philosophe se regardant au miroir comme un plus abominable sacrilège (et c'est la vérité) que l'introduction furtive d'un profane au milieu des atours de Cérès. Eh bien ! admettons que je confesse m'y être regardé. Quel crime est-ce donc, après tout, que de connaître son image ? de ne pas l'avoir seulement enfermée dans un endroit, mais de la transporter où l'on veut, en la tenant dans un petit miroir ? Ignores-tu que rien ne mérite mieux d'être regardé par une créature humaine que sa figure ? Je sais, moi, qu'un père aime bien mieux parmi ses fils ceux qui lui ressemblent. Aux citoyens qui ont bien mérité d'elles les cités accordent, en récompense, l'érection d'une statue, afin qu'ils se voient eux-mêmes. Ou bien, que signifient les statues, les portraits reproduits par les différents arts d'imitation ? Est-ce à dire que ce qui paraît louable sortant de la main de l'artiste doive être jugé blâmable quand c'est la nature qui l'offre, surtout si l'on songe que la rapidité et l'exactitude da la ressemblance sont bien plus merveilleuses dans le miroir ? En effet, toutes les copies exécutées de main d'bomme exigent un long travail, et pourtant la vérité est loin d'en être aussi satisfaisante. L'argile, le marbre, la toile, peuvent-ils jamais recevoir cette vie, cette fraîcheur, cette fermeté, ce mouvement surtout, qui constituent le véritable mérite de la ressemblance ? Dans le miroir, quelle merveilleuse reproduction de toute la personne ! A la fidélité se joint la mobilité avec l'obéissante exactitude du moindre geste ; l'image est toujours de l'âge de ceux qui la contemplent, depuis les commencements de l'enfance jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Elle suit toutes les phases de l'existence, elle prend les diverses attitudes, elle imite la tristesse aussi bien que la joie. Au contraire, une statue d'argile, de bronze, de marbre, une effigie en cire, un portrait peint sur la toile, ou enfin toute autre représentation obtenue par l'art des hommes se trouve au bout de bien peu de temps privée de ressemblance ; c'est comme un cadavre, avec sa face toujours la même et toujours immobile. Combien donc, quand il s'agit de voir reproduire un visage, doit-on mettre au-dessus des procédés de l'artiste le poli si ingénieux du miroir et son éclat créateur ! Aussi, de deux choses l'une : ou bien il faut nous ranger de l'avis d'Agésilas le Lacédémonien, qui ne souffrit jamais que la peinture ou la sculpture reproduisît ses traits, parce qu'il n'était pas assez content de sa propre figure ; ou bien, si l'on croit pouvoir conserver les habitudes généralement admises, de ne pas proscrire les statues et les portraits, pourquoi penser qu'il soit convenable de contempler son image sur de la pierre plutôt que sur de l'argent, sur une toile plutôt que dans un miroir ? Regardes-tu comme honteux qu'un homme examine assidûment son propre visage ? Mais le sage Socrate, nous dit-on, était le premier à conseiller à ses disciples de se regarder fréquemment au miroir : il voulait que celui qui était content de sa beauté veillât attentivement à ne pas gâter ces avantages corporels par de mauvaises moeurs, et qu'au contraire celui qui se croirait peu favorisé sous le rapport de l'extérieur, s'appliquât sérieusement à cacher cette laideur par la beauté de sa vertu. Homme vraiment sage, qui faisait d'un miroir un précepteur de morale ! Citerai-je Démosthène, ce prince de l'éloquence ? Tout le monde sait que c'était devant son miroir, comme devant un maître, qu'il étudiait ses causes ; et cet excellent orateur, qui déjà avait formé son éloquence à l'école du philosophe Platon, sa logique rigoureuse à celle du dialecticien Eubulide, demanda, en dernier lieu, à son miroir le parfait accord du débit et du geste. Or, crois-tu que le rhéteur qui va prodiguer l'invective doive apporter plus de soin à la bienséance pour prononcer ses discours, que le philosophe qui tonne contre les vices ? C'est devant des juges désignés par le sort que l'avocat va parler pendant quelques instants ; c'est devant toute espèce d'auditeurs que le philosophe disserte sans cesse ; c'est sur les limites d'un champ que plaide le premier ; c'est sur celles du bien et du mal que nous instruit le second. Mais quoi ! ce n'est pas seulement pour ces raisons que le philosophe doit se regarder au miroir : souvent il faut qu'il examine, non pas seulement sa propre ressemblance, mais encore la raison même de cette ressemblance. Est-il vrai, selon que le dit Épicure, que des images partent de nous comme des émanations continuellement échappées des corps ? que venant à rencontrer une surface polie et solide, elles s'y brisent et se réfléchissent de telle sorte qu'elles se reproduisent en arrière et en sens inverse ? Ou bien, comme prétendent d'autres philosophes, les rayons lumineux qui sortent du nos prunelles se mêlent-ils, se confondent-ils avec la lumière externe, comme le pense Platon ? ou bien partent-ils seulement des yeux, sans aucun secours du dehors, comme le veut Archytas ? ou sont-ils rompus par la résistance de l'air, comme le croient les stoïciens ? ou bien, allant tomber sur un solide dont la surface est brillante et polie, font-ils l'angle de réflexion égal à l'angle d'incidence, et reviennent-ils à leur propre image, de manière à pouvoir reproduire dans l'intérieur du miroir ce qu'ils touchent et voient au dehors ? Pensez-vous que les philosophes ne doivent pas curieusement approfondir tous ces phénomènes, et étudier dans une solitude contemplative tous les miroirs, aussi bien solides que liquides ? Outre ces questions que je viens d'énoncer, n'y a-t-il pas lieu de raisonner encore sur les suivantes ? Pourquoi dans les miroirs plans les images apparaissent-elles vis-à-vis de l'observateur avec une parité presque identique ? pourquoi dans les miroirs convexes et sphériques sont-elles rapetissées ? pourquoi sont-elles, au contraire, agrandies dans les miroirs concaves ? Quand et pourquoi dans ces derniers ce qui était à droite se trouve-t-il transposé à gauche ? Dans quel cas l'image se forme-t-elle derrière le même miroir ? dans quel cas se reproduit-elle en avant ? Pourquoi les miroirs concaves, s'ils sont placés en face du soleil, enflamment-ils un corps combustible placé à leur foyer ? Comment se fait-il que souvent apparaissent dans les nuages des arcs de diverses couleurs, et deux soleils qui rivalisent de ressemblance ? Il existe encore en ce genre d'autres questions, qui font la matière d'un gros volume dans les oeuvres du Syracusain Archimède. Génie supérieur que celui-là, dont l'admirable sagacité s'étendait, il est vrai, à toute la géométrie, mais dont pourtant le principal titre peut-être à la célébrité est d'avoir assidûment consulté des miroirs ! Pourquoi n'as-tu pas connu ce livre, Émilianus ? Pourquoi, outre tes champs et tes mottes de terre, n'as-tu pas pratiqué la planche des mathématiciens et son sable menu ? Crois-moi : bien que ta face hideuse ne diffère pas beaucoup de celle du masque tragique de Thyeste, tu devrais pourtant, dans l'intérêt de ton instruction, te regarder au miroir ; tu devrais quitter un instant la charrue pour étudier avec admiration les rides qui te sillonnent la face. Je ne serais pas étonné, du reste, que tu préférasses m'entendre parler de ton visage, tout contrefait qu'il est, plutôt que de ta conduite, beaucoup plus révoltante encore. Mais il faut que je le l'apprenne : outre que je n'aime pas à vomir des injures, je me suis donné jusqu'à ce jour le plaisir d'ignorer si tu es blanc ou si tu es noir ; et même à présent, en vérité, je ne saurais le décider encore parfaitement. Pourquoi cela ? parce que tu vis inconnu au milieu de tes champs, et que moi, je suis plongé dans le sein de l'étude ; toi, ton obscure et ignoble position a été un obstacle à ce que l'on t'observât ; moi, jamais je ne me suis appliqué à rechercher les méfaits de qui que ce fût, ayant toujours pensé qu'il me convient mieux de cacher mes fautes que d'approfondir celles des autres. Il m'est arrivé à ton égard ce qui arrive à un homme qui, d'un endroit bien éclairé, doit être vu par un autre placé dans un endroit obscur. C'est exactement de cette manière que, pendant que j'agis devant tous et au grand jour, je suis facilement vu par toi du fond de tes ténèbres, tandis que, caché par ton obscurité même et fuyant la lumière, tu ne peux à ton tour être aperçu de moi. Aussi ignore-je complètement si tu as des esclaves pour cultiver tes champs, ou si tu fais avec tes voisins une association de travail ; je ne le sais pas, dis-je, et je ne cherche pas à le savoir. Mais toi, tu sais qu'en un même jour, dans la ville d'Oea, j'ai affranchi trois esclaves : entre autres griefs par toi fournis, ton avocat n'a pas oublié celui-là ; et pourtant il venait de dire que j'étais arrivé à Oea en compagnie d'un seul esclave. Or je voudrais bien que tu me répondisses comment sur un esclave j'ai pu en affranchir trois, à moins que ce ne soit encore là un des effets de la magie. Jamais mensonge accusa-t-il plus d'aveuglement, ou peut-être plus d'habitude ? Apulée est venu à Oea avec un seul esclave, dit-on ; puis à quelques mots de là : Apulée, en un seul jour, a affranchi trois esclaves à Oea. Il eût été même peu vraisemblable que si je fusse venu avec trois esclaves je les eusse affranchis tous trois ; mais enfin, pourquoi ce nombre de trois esclaves eût-il prouvé mon indigence à tes yeux plutôt que le nombre de trois affranchis n'aurait prouvé mon opulence ? Tu ignores sans doute, Émilianus, tu ignores que c'est un philosophe que tu accuses, quand tu lui reproches le petit nombre de ses serviteurs ; car fût-ce une erreur, j'aurais dû l'accréditer dans l'intérêt de ma gloire. Ne savais-je pas bien que non seulement les philosophes, dont je me déclare le disciple, mais encore les généraux du peuple romain, se sont glorifiés de n'avoir qu'un petit nombre de serviteurs ? Tes avocats eux-mêmes, au bout du compte, n'ont-ils pas lu que M. Antoine, personnage consulaire, avait chez lui huit esclaves seulement ? que Carbon, qui fut maître de Rome, en avait un de moins ? Faut-il donc que je leur cite Manius Curius, si célèbre par tant de récompenses militaires, qui trois fois entra par la même porte en triomphateur ? Eh bien, Manius Curius n'avait à son service dans les camps que deux valets d'armée. Ainsi ce héros, qui avait triomphé des Sabins, des Samnites et de Pyrrhus, entretenait moins de serviteurs qu'il ne comptait de triomphes. M. Caton, sans attendre que d'autres lissent son éloge, a lui-même, dans un de ses discours écrits, consigné le fait suivant : lorsqu'il partit pour l'Espagne en qualité de consul, il n'avait emmené de Rome que trois esclaves ; arrivé à la Villa Publica, il crut que c'était trop peu de monde pour son usage ; il ordonna qu'on lui en achetât au marché deux autres, que de ses deniers il paya comptant par les mains de son banquier ; et il en conduisit cinq en Espagne. Si Pudens avait lu ces détails, je suis convaincu qu'il se serait dispensé de son méchant propos ; ou du moins, dans ce nombre de trois esclaves qu'il reproche à un philosophe, il aurait plutôt songé à trouver trop de luxe que trop d'économie. Le même, un instant après, m'a fait un crime de ma pauvreté. C'est une accusation qu'accepté un philosophe, et au-devant de laquelle il doit aller le premier. De temps immémorial, en effet, la philosophie est la compagne inséparable de la pauvreté. Économie, frugalité, contentement de peu, amour du devoir, horreur des richesses, sécurité, modestie, bons conseils, on trouve tout au sein de la pauvreté. Jamais inspira-t-elle l'orgueil qui gonfle les hommes, les passions tyranniques qui les dépravent, le despotisme qui les rend farouches ? Les plaisirs de la table ou du lit, elle ne veut, elle ne peut s'y livrer, parce que ces désordres et tant d'autres sont habituels aux nourrissons des richesses. Oui, passe en revue tous les plus grands scélérats dont les humains aient gardé la mémoire, tu n'y trouveras aucun coupable qui soit dans la pauvreté. Et au contraire, que l'on prenne au hasard les personnages illustres, rarement y figure-t-il des riches. Tous ceux qui se recommandent à l'admiration par quelque genre de mérite, ont été dès le berceau nourris au sein de l'indigence. Sublime pauvreté ! dans les premiers âges du monde, nous te voyons fonder toutes les villes, inventer tous les arts, t'abstenir de tous les vices, dispenser toutes les gloires, et conquérir chez toutes les nations un tribut mérité d'éloges unanimes. Chez les Grecs nous te voyons devenir justice dans Aristide, bienveillance dans Phocion, bravoure dans Épaminondas, sagesse dans Socrate, éloquence dans Homère. Chez le peuple romain nous te trouvons à l'origine de la république naissante ; et aujourd'hui encore, pour attirer sur lui la protection des dieux immortels, tu leur sacrifies dans les vases les plus communs et dans des coupes d'argile. Que si pour un instant le tribunal devant lequel je plaide ma cause était occupé par Fabricius, par Scipion, par Manius Curius, ces illustres indigents dont les filles, mariées avec des dots prises sur le trésor public, apportaient à leurs époux la gloire de leur maison et les deniers de l'État ; si Publicola, qui bannit les rois, si Agrippa, qui ramena le peuple, ces deux grands citoyens dont les funérailles, tant ils étaient pauvres, furent organisées par le peuple romain, grâce à l'aumône volontaire de chacun ; si Atilius Regulus, dont le petit domaine, en raison d'une semblable indigence, fut cultivé aux frais de l'État ; si toutes ces antiques familles de consuls, de censeurs, de triomphateurs, un instant rendues à la lumière pour assister à ce jugement, pouvaient entendre tes paroles ; oserais-tu reprocher à un philosophe sa pauvreté devant tant de consuls qui furent pauvres eux-mêmes ? Est-ce à dire que Claudius Maximus te semble un auditeur qui autorise à tourner en dérision la pauvreté, parce que le sort a pourvu ce magistrat d'un riche et puissant patrimoine ? Tu es dans l'erreur, Émilianus, et tu comprends mal cette grande âme, si tu la mesures d'après les faveurs de l'indulgente fortune plutôt que d'après les principes sévères de la philosophie ; si tu crois qu'un personnage habitué à une morale austère, et blanchi dans les camps, ne sympathise pas avec une sage médiocrité plutôt qu'avec une molle opulence. La fortune, il le sait, est comme un vêtement qui plaît mieux quand il est proportionné que quand il est trop long. Si une tunique traîne au lieu d'être portée, elle gêne autant que des haillons qui pendraient en avant sur les jambes et empêcheraient de marcher. En effet, dans les objets d'usage journalier, tout ce qui dépasse la juste mesure est plutôt embarrassant qu'utile. Des richesses immodérées ressemblent à un immense gouvernail sans proportions, plus propre à submerger le vaisseau qu'à le diriger : l'abondance n'en sert à rien, et l'excès en est nuisible. Que dis-je ? parmi les personnes opulentes, je vois qu'on loue de préférence celles qui, sans fracas, avec un train modeste, dissimulent leurs richesses, et les administrent sans ostentation, sans orgueil, se rapprochant des pauvres par la simplicité de leur extérieur. Que si les riches eux-mêmes, pour faire preuve de modération, cherchent à reproduire l'image et en quelque sorte le vernis de la pauvreté, pourquoi rougirions-nous d'elle, nous autres qui, placés bien plus bas, la pratiquons en réalité et non par affectation ? Je pourrais même ici argumenter contre toi sur les mots. Personne de nous, aurais-je à dire, n'est jamais pauvre quand il ne désire pas le superflu et qu'il peut se procurer le nécessaire, lequel du reste, grâce aux bienfaits de la nature, se réduit à peu de chose. Le plus riche sera toujours celui qui aura le moins de besoins ; on aura autant qu'on voudra, quand on voudra le moins possible ; et en ce sens, il est beaucoup moins judicieux de faire consister les richesses d'un homme dans ses propriétés et dans ses revenus que de les évaluer d'après l'esprit même de cet homme. En effet, si l'avarice multiplie ses besoins, si la soif du luxe est insatiable chez lui, des montagnes d'or ne pourront l'assouvir : pour ajouter à ce qu'il possède déjà, il mendiera toujours ; or, n'est-ce pas là le signe incontestable de la pauvreté ? Car enfin, toule envie d'acquérir vient de ce que l'on croit éprouver un manque, quelle que soit d'ailleurs l'importance de ce manque. Philus n'avait pas un patrimoine aussi considérable que Lélius ; Lélius, que Scipion ; Scipion, que le riche Crassus ; et à son tour, le riche Crassus ne trouvait pas le sien aussi opulent qu'il l'aurait voulu ; si bien que, surpassant tout le monde, il était surpassé lui-même par son avidité, et que s'il paraissait riche, c'était aux autres plutôt qu'à lui-même. Bien au contraire, les sages que j'ai cités, ne portant pas leurs désirs au delà de leurs moyens, établissaient une harmonie parfaite entre ce qu'ils souhaitaient et ce qu'ils pouvaient avoir. Ils méritèrent donc bien légitimement leur richesse et leur félicité : car on est pauvre lorsqu'on éprouve un désir, puisqu'un désir est un besoin, et l'on est riche quand on n'a pas de besoins, puisque ce dernier état constitue la satisfaction. En un mot, l'indigence se caractérise par les besoins, et l'opulence par la satiété. Ainsi donc, Émilianus, si tu veux que je passe pour pauvre, il te faut préalablement démontrer que je suis avare. Or, pourvu que rien ne me manque du côté des biens de l'âme, je m'inquiète peu de ce qui me manque en fait de biens extérieurs, parce que l'abondance n'en est pas plus honorable que la privation n'en est honteuse. Mais suppose qu'il en soit autrement, et que ma pauvreté tienne à des revers de fortune ; imaginons, comme c'est le cas le plus ordinaire, un tuteur qui ait diminué mon patrimoine, un ennemi qui me l'ait ravi, un père qui ne m'ait rien laissé. Peut-on faire un crime à une créature humaine de ce qui ne se reproche à aucun animal, tel que l'aigle, le taureau, le lion ? Si un cheval réunit les qualités qui lui sont essentielles, si son allure est bien égale, s'il est bon coureur, personne ne songera à le blâmer de ce qu'il ne possède point de pâturages ; et toi, tu prétendras m'objecter comme un tort grave, non pas quelques actions ou quelques paroles indiquant une âme dépravée, mais la modestie de mon intérieur, le trop petit nombre de mes gens, la frugalité avec laquelle je les nourris, la simplicité avec laquelle je les habille, la rareté des régals que je leur donne. Eh bien précisément, quelque chétif que je te paraisse en tout cela, je trouve que j'ai beaucoup, et même trop ; je désire me restreindre davantage, et je ne me croirai jamais plus heureux que quand je serai réduit au moindre train possible. Car, pour l'âme aussi bien que pour le corps, la santé existe quand il n'y a pas embarras, la faiblesse, quand il y a multiplicité d'accessoires ; et un signe certain d'infirmité, c'est d'avoir besoin de beaucoup de choses. Oui : pour vivre, comme pour nager, celui-là réunit le plus d'avantages, qui est le plus libre de tout fardeau. La vie humaine est comme un océan, où surnagent les corps légers et où ce qui est lourd s'engloutit. Je sais que si les dieux l'emportent sur les hommes, c'est principalement parce qu'ils se suffisent à eux- mêmes. Ainsi donc, celui de nous qui a le moins de besoins ressemble le plus aux dieux. Jugez d'après cela combien j'ai dû être flatté quand vous m'avez dit, croyant m'outrager, que j'avais eu pour tout patrimoine une besace et un bâton. Que n'ai-je assez de grandeur d'âme pour ne rien désirer de plus que ces objets, et pour porter dignement le même appareil, comme Cratès, qui volontairement lui sacrifia ses richesses ! Le croiras-tu, Émilianus ? ce Cratès était cité parmi les premiers personnages de Thèbes à cause de sa fortune et de sa noblesse, lorsque, épris de passion pour l'extérieur modeste dont tu veux me faire honte, il distribua au peuple son opulent et riche patrimoine ; il se débarrassa de ses nombreux esclaves, préférant être réduit à lui-même. Pour un seul bâton, il dédaigna ses nombreux arbres fruitiers ; il changea les plus élégantes maisons de campagne contre une seule besace, dont plus tard même il fit l'éloge en vers, quand il en eut mieux reconnu l'utilité ; et, à cet effet, il parodia le passage où Homère célèbre l'île de Crète. J'en dirai le début, afin que tu n'ailles pas croire que j'ai arrangé tout ceci dans l'intérêt de ma défense : Ma besace, au milieu d'un monde corrompu, C'est ma ville chérie ... Le reste est aussi merveilleux ; et si tu avais lu la pièce, tu m'aurais plutôt envié ma besace que mon mariage avec Pudentilla. A des philosophes tu reproches la besace et le bâton ! mais reproche donc aussi aux cavaliers leur harnais, aux fantassins leurs boucliers, aux porte-drapeaux leurs étendards, aux triomphateurs enfin leurs quadriges blancs et leur toge à palmes ! Ce n'est pas là, j'en conviens, le symbole de l'école platonicienne, mais ce sont les insignes de la secte cynique. Aux yeux de Diogène et d'Antisthène, cette besace et ce bâton furent ce que le diadème est pour un monarque, la cotte d'armes, pour un général, la tiare, pour un pontife, le lituus, pour un augure. Certainement Diogène le Cynique rivalisait avec Alexandre le Grand sur la réalité du pouvoir royal : car son bâton était pour lui aussi glorieux qu'un sceptre. Enfin, je citerai l'invincible Hercule lui-même (aussi bien, la supériorité morale ne te paraît qu'une méprisable défroque de mendiant). Hercule lui-même, qui purifiait l'univers par lui délivré de tant de monstres, qui domptait des nations entières, n'avait pourtant, tout dieu qu'il était, en parcourant ainsi la terre et avant que ses vertus l'eussent appelé au ciel, n'avait, dis-je, qu'une peau de lion pour vêtement et qu'un bâton pour compagnie. Que si tu ne tiens nul compte de ces exemples, et si tu m'as cité ici, non pour que je ne plaidasse ma cause, mais pour que j'eusse à inventorier mes revenus, je veux bien t'apprendre l'état de ma fortune, supposé toutefois que tu ne la connaisses pas. Sache donc qu'à mon frère et à moi, notre père en mourant laissa vingt mille sesterces à peu de chose près ; que, malgré des voyages lointains, des études continuelles, des libéralités sans nombre, je n'ai pas diminué trop sensiblement ma part d'héritage. Et pourtant, j'ai assisté beaucoup d'amis ; j'ai donné des preuves de ma gratitude au plus grand nombre de mes maîtres ; à quelques-uns j'ai fourni une dot pour établir leurs filles. Du reste, je n'aurais pas balancé à sacrifier presque tout mon patrimoine pour acquérir, ce qui me semble bien autrement précieux, le mépris de ce même patrimoine. Toi, au contraire, Émilianus, et les créatures de ton espèce, gens incultes et sauvages, vous ne valez réellement qu'autant que vous possédez ; comme ces arbres stériles et maudits qui ne produisent par eux-mêmes aucun fruit, et dont la valeur se calcule sur la quantité du bois que fournit leur souche. Toutefois, Émilianus, ménage désormais tes diatribes contre la pauvreté. Naguère toute ta fortune consistait en un petit champ près de Zarath ; c'était là uniquement ce que ton père t'avait laissé : au temps des pluies, seul avec ton âne, tu le labourais en trois jours. Car il n'y a pas bien longtemps, que, plusieurs de tes proches étant morts coup sur coup, ta fortune s'est bâtie sur des héritages qui ne devaient pas te revenir : circonstance à laquelle, du reste, plutôt encore qu'à ton infernale figure, tu dois le sobriquet de Caron. Pour ce qui est de ma patrie, tu as rappelé, d'après mes écrits propres, qu'elle est située sur les confins de la Numidie et de la Gétulie ; et tu as répété les expressions de semi-Numide et de semi-Gétule, dont j'ai fait moi-même usage en parlant publiquement devant Lollianus Avitus. Mais je ne vois pas ce qu'il y a là de honteux pour moi, pas plus qu'il ne l'était pour Cyrus le Grand d'être d'une race mixte, à savoir semi-Mède et semi-Perse. Ce n'est pas du lieu où est né, où a séjourné un homme, que l'on doit s'enquérir, mais bien de ses moeurs : ce n'est point le climat, c'est l'ensemble de la vie qu'il faut considérer. On permet, et c'est justice, qu'un jardinier, qu'un cabaretier, recommandent leurs légumes et leurs vins par la bonté du terroir, vantant, l'un ses vins de Thasos, l'autre ses légumes de Phliasie : en effet, ces productions de la terre acquièrent plus de saveur si le sol est fertile, le climat, humide, le vent, doux, le terrain, en bonne exposition, et la végétation, riche en sucs. Mais pour l'âme humaine, véritable hôte dont le corps est en quelque sorte pour les hommes un lieu de passage, que peut-il y avoir dans ces accessoires qui ajoute ou retranche à ses mérites comme à ses démérites ? Toutes les nations n'ont-elles pas fourni des grands hommes dans tous les genres, malgré les distinctions que l'on a faites entre peuples plus ou moins éclairés ? La Scythie, ce pays de glace, donna le jour au sage Anacharsis, Athènes, si célèbre par sa finesse, au stupide Mélitidès. Non pas pourtant que j'aie eu jamais la pensée de rougir de mon pays, dût-il appartenir encore à la domination de Syphax ; mais enfin, lorsque celui-ci eut été vaincu, le peuple romain fit présent de notre province au roi Massinissa. Plus tard, une émigration de vétérans la peupla de nouveau, et nous sommes une très florissante colonie. Or dans cette colonie, mon père occupa les fonctions suprêmes de duumvir, après avoir passé par tous les honneurs ; et moi-même, dès que fus apte aux charges publiques, je conservai son rang dans la ville avec autant d'estime que lui, et sans avoir dérogé, je l'espère, à la considération qui l'entourait. Pourquoi ai-je produit ces faits ? C'est afin de calmer ta bile, Émilianus ; ou plutôt afin d'obtenir grâce devant toi, si par négligence peut-être je n'ai pas pour venir au monde fait élection de domicile dans ta Zarath, cet autre centre de l'atticisme. Et vous autres, n'avez-vous pas eu honte de m'opposer avec tant de persévérance de semblables griefs devant un tel magistrat ? Quoi ! les circonstances à la fois les plus frivoles et les plus opposées entre elles, vous les blâmez également ! Y eut-il jamais accusation plus contradictoire ? Du bâton et de la besace vous avez pris texte pour accuser ma sévérité ; des vers et du miroir, pour stigmatiser mes habitudes dissolues ; de mon seul esclave, pour faire de moi un avare ; des trois que j'ai affranchis, pour me travestir en prodigue ; de mon éloquence de Grec, pour me reprocher mon origine africaine. Mais réveillez-vous donc enfin, et pensez que vous parlez devant Claudius Maximus, devant un personnage grave, dont les moments sont réclamés par les intérêts de toute une province. Supprimez ces vaines diatribes, et produisez les crimes énormes dont vous m'avez accusé, mes sacrilèges infâmes, mes odieux maléfices, mes ténébreuses manoeuvres. Pourquoi tant de mollesse dans les preuves, tant d'énergie quand il ne faut que du tapage ? J'arrive, en effet, maintenant à l'accusation même de magie : immense bûcher qu'on allumait, avec grand fracas, pour me perdre, et qui, contrairement à l'attente de tous, s'est éteint dans je ne sais quels contes de vieilles. Avez-vous jamais vu, Maximus, ces feux de paille qui rendent un bruit clair, jettent une large flamme, se propagent vite, mais où le combustible est si peu de chose, qu'après un incendie de quelques instants il ne reste plus rien ? Je vous donne là une image de cette accusation ; commencée par des injures, nourrie de mots, dénuée de preuves, elle ne laissera après votre sentence nul vestige de ses calomnies. Émilianus la fait reposer tout entière sur ce seul chef : Apulée est un magicien ; et à cette occasion j'ai bien envie.de demander \i ses savants avocats ce que c'est qu'un magicien ; car si, comme j'ai lu dans un grand nombre d'auteurs, ce mot a en Perse la même signification que chez nous le mot prêtre, quel crime est-ce donc, après tout, d'être prêtre ? d'avoir étudié, de connaître et de savoir à fond les lois du rit, les règles des sacrifices, les théories du culte ? La magie est ce que Platon appelle le culte des dieux, lorsqu'il expose les principes d'éducation donnés chez les Perses au futur héritier du trône. Je me rappelle les paroles mêmes de ce divin génie, et vous allez, Maximus, les reconnaître avec moi : “A l'âge de quatorze ans le jeune prince passe aux mains de ceux qu'on nomme les pédagogues royaux ; ce sont les quatre personnages les plus remarquables de l'époque, chacun dans sa spécialité : le plus savant, le plus juste, le plus sage, le plus brave. Un d'entre eux lui enseigne la magie de Zoroastre, fils d'Oromaze, autrement dit, le culte des dieux ; il lui enseigne pareillement les devoirs de la royauté.” Entendez-vous, accusateurs imprudents de la magie ? c’est une science agréée des dieux immortels, qui apprend à les honorer, à les vénérer, une science toute de piété, de divination, constamment illustre depuis Zoroastre et Oromaze, ses premiers fondateurs ; elle représente ici-bas les habitants du ciel. C'est une des premières études que l'on enseigne aux monarques ; et chez les Perses il n'est pas plus permis au premier venu d'être mage qu'il ne lui serait permis d'être roi. Le même Platon, dans un autre traité sur un certain Zalmoxis, Thrace de nation, mais voué à la même science, nous dit encore : “II faut soigner son âme, mon cher ami, au moyen de certains enchantements ; et ces enchantements, ce sont les bons principes.” Que s'il en est ainsi, pourquoi me serait-il défendu de connaître soit les bons principes de Zalmoxis, soit la liturgie de Zoroastre ? Si d'un autre côté, selon le sens vulgaire, mes accusateurs entendent, à proprement parler, par magicien celui qui entretient commerce avec les dieux immortels, et qui par la force incroyable de ses enchantements peut réaliser tout ce qu'il veut, je m'étonne, en vérité, qu'ils n'aient pas craint d'accuser un homme à qui ils reconnaissent une telle puissance. En effet on ne peut se garantir, comme on le ferait en tout autre cas, contre les effets d'une science si occulte et si surnaturelle. Quand on cite en justice un meurtrier, on vient avec une escorte ; quand on accuse un empoisonneur, on fait plus attention à ce qu'on mange ; quand on dénonce des voleurs, on surveille son bien. Mais celui qui intente un procès capital à un magicien, comme ceux-ci m'appellent, pourrait-il avec toutes les escortes, toutes les précautions, toutes les surveillances imaginables, éviter une perte inévitable et cachée ? non, jamais ; et par conséquent accuser un homme de ce crime, c'est ne l'en pas croire coupable. Cependant c'est un des griefs que l'ignorance intente communément aux philosophes. Quelques-uns d'entre eux recherchent-ils les causes pures et simples de l'existence des corps ; on les proclame impies et reniant les dieux, comme Épicure, Anaxagore, Leucippe, Démocrite, et les autres qui prennent la défense de la nature. Quelques-uns choisissent-ils pour objet de leurs curieuses investigations la providence qui a ordonné le monde, et adorent-ils les dieux avec enthousiasme ; on leur donne vulgairement le nom de magiciens : comme si, parce qu'ils savent que ces merveilles s'opèrent, ils savaient les opérer ! De ce nombre furent jadis Épiménide, Orphée, Pythagore, Ostanes ; et plus tard pareillement on suspecta Empédocle à cause de sa Catharmé, Socrate à cause de son Démon, Platon à cause de son Souverain Bien. Je me félicite donc d'être compté parmi tant et de si illustres personnages. Du reste rien de plus vain, de plus inepte, de plus puéril que les preuves avancées par les gens que voici pour établir celte accusation ; et je crains que vous n'y trouviez d'autre caractère d'un grief que celui de m'avoir été imputée. Pourquoi, me dit mon adversaire, avez-vous cherché certaines espèces de poissons ? Comme si, dans le dessein de s'instruire, un philosophe n'avait pas le droit de faire ce qui serait permis à un gourmand pour assouvir sa gloutonnerie ! Pourquoi une femme de condition libre vous a-t-elle épousé après quatorze ans de veuvage ? Comme s'il n'était pas plus merveilleux que pendant si longtemps elle ne se fût pas remariée ! Pourquoi, avant de vous épouser, a-t-elle consigné dans une lettre je ne sais quelle opinion adoptée par elle ? Comme si on avait à rendre compte de la pensée d'autrui ? Mais quoi ! ajoute-t-on, une femme plus âgée n'a pas balancé à épouser un jeune homme. Eh bien ! voilà précisément la preuve qu'il n'y a pas eu besoin de magie, quand on voit une femme être mariée avec un homme, une veuve avec un célibataire, une personne plus âgée avec une plus jeune. Le reste est de la même force. Apulée a chez lui certain objet, qu'il adore mystérieusement. Comme si ce n'était pas plutôt un crime, de ne rien avoir à adorer ! Un enfant est tombé en présence d'Apulée. Mais qu'auriez-vous dit si c'eût été un jeune homme, ou encore un vieillard, qui fût tombé devant moi, soit par indisposition, soit à cause d'un faux pas sur un parquet glissant ? Est-ce par ces arguments que vous me convaincrez de magie : la chute d'un enfant, le mariage d'une femme, un plat de poissons ? Je pourrais, en toute assurance, me contenter de ce que je viens de dire et entamer ma péroraison. Mais enfin, puisque grâce à la longueur de l'accusation j'ai encore une grande partie de la clepsydre à vider, voyons, examinons en détail chacun des griefs. Premièrement, que ce qu'on m'objecte soit vrai ou faux, je ne nierai rien ; j'avouerai tout, comme si tout était vrai. De cette manière, la multitude qui s'est réunie de mille endroits dans cette enceinte reconnaîtra clairement que d'abord contre les philosophes rien ne pourrait être avancé qui fût vrai, et qu'ensuite, en fait d'accusations mensongères, il n'en n'est pas qu'ils ne puissent repousser par de bonnes raisons sans avoir recours au désaveu, tant ils sont forts de leur innocence. Je commencerai donc par réfuter leurs arguments, et je prouverai qu'il n'y a dans tout ces faits rien qui tienne à la magie. Je démontrerai ensuite que, fusse-je le plus grand magicien du monde, je ne leur ai donné aucun motif, aucune occasion de me surprendre au milieu de quelque maléfice. Là je placerai ce que j'ai à dire sur leurs basses calomnies, sur les lectures inexactes qu'ils ont faites des lettres de ma femme, sur leurs interprétations plus odieuses encore. Enfin, je parlerai de mon mariage avec Pudentilla ; et je démontrerai, qu'en contractant cette union j'ai voulu remplir un devoir bien plutôt que ménager mon intérêt. Il est vrai, du reste, que ce mariage a jeté Émilianus dans des angoisses et dans un déplaisir extrêmes : de là sa colère et sa rage ; de là cette accusation, qui est un acte de folie. Je veux jeter sur cette affaire une clarté et une évidence incontestable. Je vous prouverai, illustre Maximus Claudius, ainsi qu'à tout l'auditoire, que ce jeune Sicinius Pudens, mon beau-fils, qui à l'accusation de son oncle prête son nom et sa volonté, a été enlevé tout récemment à mes soins depuis la mort de son frère aîné Pontianus, beaucoup meilleur que lui ; je prouverai qu'ainsi on l'a criminellement irrité contre sa mère et contre moi ; que, sans qu'il y eût de ma faute, il a abandonné les études libérales et secoué le joug de toute discipline : préludes bien coupables de l'accusation que soutient contre moi ce malheureux, destiné à ressembler à son oncle Émilianus plutôt qu'à Pontianus son frère ! Maintenant donc, comme je me le suis promis, je vais suivre pas à pas chacune des absurdes imputations de cet Emilianus, en commençant par ce qui regarde le soupçon de magie. Vous avez remarqué, Seigneur, qu'un des faits qu'il cite dès son début comme son argument le plus vigoureux, c'est qu'à prix d'argent j'ai acheté de certains pêcheurs quelques espèces de poissons. Laquelle donc de ces deux circonstances est de nature à me vendre suspect de magie ? Est-ce parce que des pêcheurs ont cherché pour moi du poisson ? C'est donc à dire qu'il eût fallu charger de cette commission des brodeurs ou des charpentiers ? Pour me dérobera vos calomnies je devais intervertir les attributions de chaque métier : c'eût été au charpentier à me pêcher du poisson ; au pêcheur, à son tour, à dégrossir du bois avec la doloire. Ce qui constitue le maléfice à vos yeux, est-ce parce que j'achetais les poissons à prix d'argent ? Si je les eusse destinés à ma table, on me les aurait apparemment donnés pour rien. Qui vous empêche donc de m'accuser d'une foule d'autres griefs ? car il m'est arrivé mille fois d'acheter du vin, des légumes, des fruits et du pain. A ce compte vous réduisez à la famine tous les marchands de poissons ; car qui osera se fournir chez eux ; s'il est établi que tous les objets de bouche qu'on leur achète à prix d'argent sont destinés, non pas à la table, mais à des opérations de magie ? Que s'il ne reste plus rien de suspect dans l'invitation faite à des pêcheurs d'exercer leur métier habituel, c'est-à-dire de prendre du poisson, (et notez qu'ils n'ont cité en témoignage aucun de ces hommes, attendu qu'ils n'existent pas), rien de suspect non plus dans le prix même de la marchandise achetée (et notez encore qu'ils n'ont pas précisé un chiffre, parce que, trop bas, il eût été une misère, trop élevé, une invraisemblance) ; si dis-je, il ne reste nulle part rien de suspect, je somme Émilianus de développer les inductions vraisemblables qui l'ont amené à m'accuser de magie. Vous vous procurez des poissons, dit-il. Je n'ai garde d'en disconvenir ; mais, je te le demande, pour se procurer des poissons, est-ce à dire que l'on soit magicien ? Pas plus, selon moi, que si l'on voulait se procurer des lièvres, des sangliers ou des volailles. Est-ce que les poissons seuls ont quelques propriétés mystérieuses, inconnues à d'autres et révélées aux magiciens ? Si tu en sais quelque cbose, c'est toi, à coup sûr, qui es le magicien ; si tu l'ignores, te voilà obligé de convenir que tu m'accuses de choses que tu ne connais point. Faut-il que vous soyez assez ignares, assez étrangers enfin à toutes les fables qui courent dans le vulgaire, pour ne pouvoir même formuler cette accusation d'une manière vraisemblable ! Car quel philtre amoureux peut être recelé dans un poisson brut, froid, et en général dans une substance tirée de la mer ? A moins que vous n'ayez cru pouvoir établir votre mensonge sur ce qu'on dit de Vénus, qu'elle naquit du sein des mers ? Apprends, Tannonius Pudens, combien ton ignorance est grande, d'avoir été fonder sur un achat de poissons une accusation de magie. Si tu avais lu Virgile, tu aurais vu infailliblement qu'on se procure à cet effet d'autres matières ; car ce poète, autant que je me rappelle, énumère les bandelettes moelleuses, la grasse verveine, l'encens mâle, les fils de diverses couleurs ; il cite, en outre, le laurier qui se brise facilement, l'argile qui se durcit, la cire qui se fond ; enfin dans son grand poème, il nous dit : ... La prêtresse soudain Exprime un lait impur d'une herbe empoisonnée, Au flambeau de la nuit par l'airain moissonnée. Enfin, pour rendre encore charme plus puissant, Elle y joint la tumeur que le coursier naissant Apporte sur son front, et que pour ce mystère On enlève aussitôt à son avide mère. Mais toi, qui m'accuses à propos de poissons, tu attribues aux magiciens de bien autres instruments : il s'agit, avec toi, non pas du dégarnir des fronts encore tendres, mais de racler des dos écailleux ; non pas d'arracher des substances du sol, mais de les tirer du fond de la mer ; non pas de les moissonner avec la faux, mais de les accrocher avec l'hameçon. Enfin le poète cite parmi les instruments de maléfice le venin, et toi, les mets de nos tables ; il recommande des herbes, des bourgeons ; toi, des écailles, et des arêtes. Il dépouille un champ ; toi, tu fouilles les flots. J'aurais pu t'indiquer encore nombre de passages analogues dans Théocrite, Homère, Orphée ; j'aurais pu t'indiquer des comiques, des tragiques, des historiens grecs ; mais je sais de longue date que tu n'as même pu lire une lettre écrite en grec par Pudentilla. Je ne citerai donc plus qu'un seul auteur, et encore est-ce un poète latin ; ceux qui ont lu Lévius, reconnaîtront le passage : ... Avec mystère De toute part on creuse, et l'on déterre Des charmes sûrs et des philtres brûlants : Ongles brisés, roitelets et rubans. Tiges, bourgeons et racines sans nombre ; Suaires, bandeaux, pierres à reflet sombre, Lambeaux de chair enlevés au poulain ... Voilà ce qu'avec beaucoup plus de vraisemblance tu aurais supposé être l'objet de mes recherches, si tu avais eu la moindre érudition ; car ces fables accréditées dans le vulgaire auraient peut-être donné un air de croyance à tes imputations. Mais à quoi peut servir un poisson que l'on a pris, si ce n'est à être cuit et présenté sur une table ? Autrement, il ne me semble pouvoir en aucune façon être utile à la magie, et je vais dire ce qui me le fait conjecturer. Pythagore, qui passe généralement pour avoir été partisan de Zoroastre et avoir comme lui été habile clans les sciences magiques, se trouvait, dit-on, un jour près de Métaponte, sur le rivage de cette Italie qu'il avait adoptée, et dont il avait fait en quelque sorte une succursale de la Grèce. Ayant aperçu des pêcheurs qui tiraient à eux un filet, il leur acheta la fortune du coup ; et quand il l'eut payée, il ordonna que sur-le-champ les poissons qui étaient pris fussent relâchés de la nasse et rendus à l'abîme. Or, certainement il n'eût pas laissé échapper de ses mains une pareille capture s'il y eût reconnu quelque chose d'utile à la magie. Mais il faut dire que Pythagore était un homme profondément instruit, un imitateur zélé des anciens ; et il se rappelait avoir lu dans Homère, ce génie universel ou plutôt supérieur en quelque genre de connaissances que ce soit, une énumération complète des substances magiques : tout y est dit appartenir à la terre, et rien aux flots. Voici comment Homère s'exprime en parlant d'une magicienne : Hélène recueillit ces philtres précieux : Presque tous ils étaient empruntés à la terre ; Et sa main les tenait d'une femme étrangère, D'une Africaine ... Dans un autre passage on lit ces vers, qui ont à peu près le même sens : Ainsi parle Mercure, et du sein de la terre Il tire au même instant ce charme tutélaire. Enfin, ce n'est jamais une composition empruntée à la mer ou aux poissons que ce poète met entre les mains de ses héros, soit que Prolée exécute ses métamorphoses, qu'Ulysse creuse la fosse, qu'Éole gonfle ses soufflets, qu'Hélène prépare sa coupe, Circé, ses breuvages, Vénus, sa ceinture. Vous êtes, de mémoire humaine, les seuls de votre espèce : la propriété magique était dévolue aux herbes, aux racines, aux bourgeons, aux petites pierres ; et vous, par une sorte de bouleversement de la nature, vous la faites descendre des montagnes dans la mer pour l'introduire dans le ventre des poissons. Jusqu'ici, dans leurs cérémonies mystérieuses, les magiciens invoquaient Mercure comme intermédiaire des enchantements ; Vénus comme séductrice des âmes, la lune comme complice de ces opérations nocturnes ; Trivia comme reine des ombres. Mais, grâce à votre autorité, ce sera désormais Neptune, Salacia, Fortune, et tout le choeur des Néréides, qui, au lieu de soulever des orages sur mer, les soulèveront dans les coeurs amoureux. J'ai dit pourquoi je ne trouve aucun rapport entre la magie et les poissons. Maintenant, si Émilianus le veut, accordons-lui que les poissons aussi aident d'ordinaire dans les opérations magiques. Est-ce à dire pour cela que quiconque cherche des poissons soit magicien ? A ce compte, il suffira de s'être procuré un brigantin pour être un pirate ; un levier, pour être un enfonceur de portes ; une épée, pour être un assassin. En quelque genre que ce soit, on ne saurait citer rien de si inoffensif qui ne puisse nuire par quelque endroit, rien de si agréable qu'on ne puisse y reconnaître un côté dangereux. Cependant malgré cette facilité d'interprétations, on n'a pas l'habitude de tout expliquer suivant les inductions les plus fâcheuses. Un achat d'encens, de cannelle, de myrrhe et d'autres parfums analogues ne laisse pas croire que l'on se propose uniquement une cérémonie funéraire, puisque l'on pourrait encore avoir en vue un médicament ou un sacrifice. Du reste, avec ce même argument de poissons, tu seras amené à établir que les compagnons de Ménélas étaient aussi des magiciens, parce que le grand poète dit que dans l'île de Pharos “ils bannirent la faim avec des hameçons crochus.” Tu rangeras dans la même catégorie les plongeons, les dauphins et les squales, dont les pêcheurs font abondant commerce ; tu y rangeras aussi les pêcheurs eux-mêmes dont l'adresse consiste à se procurer toute espèce de poisson. -Mais dans quel dessein vous aussi vous en procurez-vous ? - II ne me plaît pas, et je n'ai nul besoin de te le dire ; mais accuse-moi de ton chef, si tu le peux, de les avoir achetés comme on achète de l'ellébore ou de la ciguë, ou du suc de pavot, et pareillement d'autres substances dont l'usage modéré est salutaire, mais dont le mélange et l'excès sont nuisibles. Pourrait-on rester maître de soi, si, achetant telles et telles substances, on s'entendait accuser d'empoisonnement, parce qu'elles peuvent faire périr des hommes ? Voyons, pourtant, quelles ont été ces espèces de poissons si nécessaires à posséder, si rares à trouver, que l'on en eût mis, et avec raison, la découverte à prix. Ils en ont nommé trois en tout ; il y a erreur pour un, mensonge pour deux : l'erreur consiste en ce qu'ils ont appelé lièvre marin ce qui était un tout autre animal. C'était notre esclave Thémison, versé dans la médecine, qui me l'avait apporté de lui-même, comme vous l'avez entendu de sa bouche, pour le soumettre à mon observation : car il n'a pas encore trouvé de lièvre marin. Du reste, j'en conviendrai, je ne borne pas là mes recherches ; non seulement à des pêcheurs, mais à mes amis, je donne commission, dans le cas où ils rencontrent un poisson peu connu, de m'en fournir la description, ou de me faire passer le sujet, soit vivant, soit mort s'il ne se peut autrement. Quel est mon but en cela ? je le montrerai tout à l'heure. Il y a eu mensonge de la part de mes accusateurs, qui ne croient pas avoir leur pareil en finesse, quand ils ont prétendu, pour me nuire, que j'avais demandé deux corps marins sous des termes obscènes. Tannonius voulait faire entendre que c'étaient les parties génitales des deux sexes ; mais ce brillant orateur n'a pu venir à bout de s'expliquer clairement et sans longues hésitations ; enfin il est arrivé, après je ne sais quelle périphrase, de nommer en termes aussi impropres que dégoûtants les parties génitales d'un poisson mâle ; quant à celles de la femelle, comme il ne pouvait absolument trouver une expression tant soit peu pudique, il a eu recours à mes écrits ; il s'est rappelé avoir lu dans un de mes livres cette phrase : “Qu'elle cache ses parties sexuelles en ramenant une cuisse et en les voilant de la main ;” et ce grave moraliste m'a fait un reproche de ce que je n'ai pas balancé à exprimer honnêtement des images impudiques. Moi, tout au contraire, je lui reprocherai à bien plus juste titre, à lui qui se prétend passé maître en matière d'éloquence, d'employer de sales circonlocutions pour ce qui est fort simple à dire, de ne parler que du bout des lèvres, ou de garder un silence absolu pour des appellations qui ne présentent pas la moindre difficulté. Car enfin, je le demande, si je n'avais pas eu à parler de la statue de Vénus, et que je n'eusse pas émis le mot “parties sexuelles” interfeminium ; en quels termes aurais-tu donc formulé cette accusation, qui va aussi bien à ta sottise qu'à ta langue ? Est-il rien de plus absurde que de conclure de la ressemblance des mots à celle des choses ? Et peut-être vous figuriez-vous avoir fait là une ingénieuse découverte. Sachez donc que vous auriez dû dire : “Pour faire ses opérations magiques, il s'est procuré en fait de substances marines une pinne-marine et un pucelage.” Apprends en effet l'expression consacrée, et sache que j'ai employé à dessein des synonymes pour te fournir l'occasion de m'accuser de nouveau. Cependant souviens-toi que prétendre qu'un homme se soit servi des parties génitales d'un poisson pour un acte amoureux, c'est lui intenter une accusation aussi dérisoire que si l'on disait : pour arranger ses cheveux, il a pris un peigne marin ; pour attraper des oiseaux, un poisson volant ; pour chasser les monstres des forêts, un sanglier de mer ; pour ressusciter les morts, des crânes marins. A cette partie de votre accusation je réponds donc, que c'est un conte aussi ridicule qu'absurde ; que toutes ces bagatelles marines, tout ce fretin de rivage, je ne me le suis procuré ni à prix d'argent, ni gratis. Je réponds, en outre, que vous ne saviez pas vous-mêmes quels objets vous prétendiez que je m'étais procurés ; car toutes ces frivolités que vous avez dites, on les trouve par tas et par monceaux sur tous les rivages ; et, sans qu'il soit besoin de se donner de peine, il suffit du moindre mouvement des flots pour qu'elles soient rejetées hors de la mer. Que ne dites-vous donc qu'en même temps j'ai prodigué l'or, que j'ai convoqué le ban et l'arrière-ban des pêcheurs pour faire prendre sur le rivage des petites coquilles cannelées, d'autres qui fussent rondes, et des cailloux polis ? Ajoutez aussi que je leur ai demandé des pinces de crabes, des enveloppes d'oursins, des plumes de calmars, enfin des copeaux, des brins de paille, des bouts de ficelle, des morceaux de bois rongés par les vers, ou bien encore de la mousse, de l'algue, et les déjections de la mer qui sont sur tous les rivages, chassées par les vents, vomies par la marée, reprises par le gros temps, laissées sur place par le calme ; car les objets que je viens de citer là peuvent tout aussi bien, en raison du nom, s'accommoder à vos conjectures. Vous dites que pour des actes amoureux il est bon de prendre dans la mer des parties sexuelles de mâles et de femelles ; et vous le dites à cause de la ressemblance des noms. Il serait tout aussi logique de prendre également sur le rivage de petites pierres pour la vessie, des testacés pour les testaments, des cancres pour le cancer, de l'algue pour le frisson. En vérité, Claudius Maximus, vous mettez trop de patience, et, je vous le dirai même, trop de bonté, à supporter si longtemps leurs argumentations. Pour ma part, quand ils présentaient ces faits comme étant de la dernière gravité, comme invincibles, je riais de leur sottise et j'admirais votre indulgence. Du reste, veut-on savoir pourquoi je connais déjà beaucoup de variétés dans la classe des poissons et pourquoi il en est quelques-unes que je ne voudrais pas ignorer encore ? Je vais l'apprendre à Émilianus, puisqu'il s'intéresse tant à ce qui me regarde. Oui, bien qu'il soit déjà sur la pente de l'âge, que sa vieillesse touche au terme, cependant, si bon lui semble, il peut acquérir des connaissances tardives et en quelque sorte posthumes. Qu'il lise les écrits des anciens philosophes pour reconnaître enfin que je ne suis pas le premier qui ait fait des recherches de ce genre, mais que depuis longtemps mes devanciers, Aristote, Théophraste, Eudême, Lycon, et les autres disciples de Platon en ont fait autant ; qu'ils ont laissé un grand nombre de livres sur la génération des animaux, sur leur manière de vivre, sur leur structure intime, sur leurs variétés. Il est heureux que cette cause se plaide devant vous, Maximus, qui, instruit comme vous l'êtes, avez lu certainement les nombreux ouvrages d'Aristote sur la naissance des animaux, sur leur anatomie, sur leur histoire, sans parler d'une foule innombrable de questions du même, ou d'autres écrivains de son école qui ont fait divers traités sur cette matière. Or, si ces recherches, qui leur coûtèrent tant de soin, ce fut pour eux un honneur et une gloire de les rédiger, comment serait-ce une honte pour nous d'en vérifier l'exactitude ? surtout puisque, soit en latin, soit en grec, je tâche d'y mettre plus d'ordre et de brièveté, de suppléer partout aux lacunes ou de combler les omissions. Permettez, Seigneurs, si la chose en vaut la peine, qu'on lise quelques passages de mes élucubrations soi-disant magiques. Je veux prouver à Émilianus que ces recherches et ces explorations consciencieuses vont plus loin qu'il ne le pense. Greffier, passez-moi un volume de mes oeuvres grecques, qui se trouvent peut-être ici entre les mains de mes amis et des amateurs des sciences naturelles. Donnez de préférence celui où je traite longuement des poissons. Pendant que le greffier cherche le passage, je citerai un exemple qui se rapporte à ma situation. Le poète Sophocle, qui fut rival d'Euripide et qui lui survécut, car il atteignit une extrême vieillesse, était accusé de démence par son propre fils : à en croire ce dernier, l'âge avait fait perdre la raison à son père. Sophocle alors présenta son Oedipe à Colone, la plus belle de ses tragédies, que précisément il composait à cette époque ; il en lit la lecture à ses juges, et il n'ajouta rien de plus à sa défense que ces mots : “Ayez le courage de me déclarer en démence, si vous ne goûtez pas ces vers de ma vieillesse.” L'histoire rapporte qu'à ce moment tous les juges se levèrent devant le grand poète, et lui prodiguèrent les éloges les mieux sentis, tant à cause de l'intérêt du sujet que pour le style sublime de cette haute conception tragique ; peu s'en fallut qu'au contraire ils ne déclarassent en état de démence l'accusateur lui- même ... Greffier, avez-vous trouvé le volume ? - Bien : j'en suis charmé. Nous allons voir si moi aussi, devant un tribunal, mes écrits peuvent me défendre. Lisez une petite partie du commencement, et ensuite quelques passages sur les poissons. Vous, pendant que le greffier va lire, arrêtez l'eau de la clepsydre. (Ici devrait se trouver une citation prise dans les ouvrages d'Apulée sur l'histoire naturelle.) Ce que vous venez d'entendre est la reproduction de ce que vous aviez déjà lu en grande partie dans les auteurs anciens ; et n'oubliez pas que dans ces ouvrages je traite seulement des poissons. J'y passe en revue ceux qui sont produits par l'acte du coït, ceux qui naissent de la vase ; je précise combien de fois et à quelles époques de l'année, dans chaque espèce, le besoin de la reproduction s'allume chez les femelles et chez les mâles ; par quelles dispositions des membres et pour quelles causes la nature parmi les poissons a distingué les ovipares et les vivipares : car c'est ainsi que je traduis les mots grecs ᾠοτόκα et ζῳοτόκα. Et pour ne point parcourir toute l'échelle des êtres, pour ne pas traiter de leur différence, de leurs habitudes, de leur structure, de leur longévité, d'une foule d'autres détails aussi importants par eux-mêmes qu'ils sont d'ailleurs étrangers à la cause, je ne réclamerai plus de citations que pour deux de mes ouvrages : ce sont quelques endroits latins qui ont trait à ces mêmes connaissances. Vous y remarquerez, entre autres particularités rares et curieuses, des noms inusités chez les Romains, et qui n'avaient pas, que je sache, passé jusqu'ici dans notre langue ; c'est moi qui, à force d'études et de recherches, ai donné à ces mots grecs un cachet tout national. Car je défie bien tes avocats, Émilianus, de me citer un livre où ils aient vu ces mots latinisés Je ne parlerai que des animaux aquatiques : pour les autres, je signalerai seulement les points communs où ils présentent des différences avec ces derniers. Ainsi donc, écoute ce que je vais dire. Tu vas récrier aussitôt que je débite une kyrielle de mots magiques en grimoire égyptien ou chaldéen : Selacheia, malakia, malacostraca, chondracantha, ostracoderma, carcharodonta, amphibia, lepidota, pholidota, dermoptera, peza, nepoda, moniri, sunaguelastica. Je puis même continuer ; mais ce n'est pas la peine de perdre mes instants à ces nomenclatures : j'aime mieux me ménager le temps d'attaquer les autres imputations. Vous cependant, greffier, lisez ce peu de noms grecs, que je viens de lire, tels que je les ai latinisés. (Ici manquent ces noms grecs latinisés par l'auteur.) Eh bien ! crois-tu que quand un philosophe, loin d'affecter impudemment l'ignorance et la grossièreté d'un cynique, se rappelle avoir été disciple de Platon ; crois tu que ce soit pour lui une honte de connaître plutôt que d'ignorer les sciences naturelles ? de les négliger, plutôt que de les approfondir, que d'apprécier, même dans ces détails, les desseins admirables de la Providence, plutôt que de s'en rapporter à son père et à sa mère sur ce qu'il faut croire des dieux immortels ? Ennius, dans son poème intitulé Hedypathetica, énumère des espèces innombrables de poissons, qu'il avait en effet étudiées avec grand soin. Je me rappelle quelques-uns de ses vers : je vais les réciter : “La mustelle marine l’emporte sur tous les autres poissons aussi bien que sur la clupée. Les meilleurs raspecons se trouvent à Enia ; Abydos fournit en Abondance les huîtres aux valves rugueuses ; Mitylène, les peignes et Ambracie, les crabes. Achetez vos sargues à Brindes, et préférez-les de grande dimension. Que vos sangliers de mer viennent de Tarente ; vos élops esturgeons, de Sorrente ; vos squales bleus, de Cumes. Mais quoi ! j'ai oublié le scarus, qui égale presque le cerveau du maître des dieux, et qui n'est nulle part plus gros et plus friand que dans la patrie de Nestor. J'allais omettre aussi les mélanures, les labres tourds, les labres merles et les ombres de mer ; les polypes de Corcyre, les succulents caviars d'Atarné, les pourpres, les jeunes tortues, les mures et les savoureux oursins.” Il a fait les honneurs de beaucoup de vers à d'autres poissons encore ; et il indique dans quel pays se trouve chacun d'eux, si c'est rôtis ou à la sauce qu'ils sont un manger plus délicat. Pourtant les gens instruits ne l'attaquent point, tandis qu'on veut me faire un crime de naturaliser dans notre langue, avec autant de propriété que d'élégance, des objets qui en grec sont connus d'un très petit nombre d'amateurs. Sans doute j'en ai dit assez ; pourtant écoute encore ceci. Qui vous a dit, puisque j'aime l'art de la médecine et que j'y ai quelque habileté, qui vous a dit que je ne cherche pas des remèdes dans les poissons ? Quand la bienfaisante nature a répandu et prodigué les remèdes dans toute espèce de substances, pourquoi n'en aurait-elle pas mis également dans les poissons ? La connaissance et la recherche des médicaments ne constituent pas plus le magicien que le médecin, ou même après tout, que le philosophe, quand on se propose de les appliquer non pas à son utilité, mais au soulagement de ses semblables. Dans les temps antiques, les médecins n'ignoraient pas les enchantements qui pouvaient guérir les blessures, et nous en avons pour garant l'auteur le plus infaillible en matière d'antiquité, je veux dire Homère : il montre comment d'une blessure d'Ulysse le sang cesse de couler par la vertu d'un charme. Rien de ce qui se fait pour sauver la vie des hommes ne saurait être coupable. Mais, dit-il, dans quel dessein, si ce n'est pas dans un dessein criminel, avez-vous dépiécé le poisson que Thémison, votre esclave, vous avait apporté ? Comme si, en vérité, je ne venais pas de dire à l'instant, que je fais des études sur les organes de tous les animaux, sur la place de ces organes, sur leur nombre, sur leur emploi ; qu'enfin je me propose de vérifier et de développer les ouvrages d'anatomie composés par Aristote ! Je trouve même très étonnant que vous ne connaissiez de moi que cette seule autopsie de poisson. J'en ai opéré à l'infini, partout où j'en ai rencontré des sujets ; d'autant plus que je n'ai pas l'habitude de rien faire en cachette : constamment je procède au grand jour, sous les yeux de tout le monde, même des étrangers. En cela j'obéis aux usages et aux principes de mes maîtres qui disent : qu'un homme libre et généreux doit autant que possible présenter tout d'abord son âme sur son front. Eh bien, la petite espèce de crustacés que vous autres nommez lièvre marin, je la montrai alors à de nombreux spectateurs ; et je ne saurais encore décider quel est son vrai nom sans m'être livré à des recherches plus approfondies, attendu que je ne trouve indiquée chez aucun des anciens philosophes cette espèce de poisson, bien qu'elle soit remarquable entre toutes et assurément fort curieuse. Si je m'y connais un peu, c'est la seule espèce qui, étant d'ailleurs sans os, soit pourvue de douze pièces osseuses unies et enchaînées dans le ventre de l'animal et ressemblant assez à des osselets de porcs. Si Aristote l'eût connue, sans aucun doute il n'eût pas omis d'en faire mention, lui qui a indiqué le merlus comme une variété très remarquable, parce que seul il a le coeur au milieu du ventre. Vous avez disséqué un poisson, dit Émilianus. Est-il supportable d'entendre faire un crime à un philosophe de ce qui n'en serait pas un pour un boucher ou pour un cuisinier ? Vous avez disséqué un poisson. M'accuse-t-on parce qu'il était cru ? si je l'eusse fait cuire avant de lui fouiller le ventre, avant de lui percer le foie, comme apprend à le faire chez toi à ses propres dépens le petit Sicinius Pudens, tu n'aurais donc pas trouvé là texte à une accusation ? Eh bien, pour un philosophe le crime serait-il plus grand de manger des poissons que d'en observer ? Quoi ! des diseurs de bonne aventure pourront interroger des foies d'animaux, et un philosophe n'aura pas le droit d'en examiner, lui qui se reconnaît l'aruspice de tous les êtres animés, le prêtre de tous les dieux ! Tu me fais un crime de ce que Maximus et moi nous admirons dans Aristote. A moins d'avoir banni des bibliothèques les ouvrages de ce grand homme, à moins de les avoir arrachés aux mains des lecteurs studieux, tu ne peux point m'accuser. Mais j'en ai peut-être dit sur ce sujet plus que je n'aurais dû. Voyez maintenant, Seigneur, comment ils se contredisent eux- mêmes. Ils prétendent que par des artifices magiques, par des enchantements empruntés aux flots de la mer, j'ai voulu séduire une femme. A quelle époque, s'il vous plaît ? lorsque précisément je me trouvais dans les montagnes situées au centre de la Gétulie, où l'on ne trouverait de poissons qu'en remontant au déluge de Deucalion. Ils ignorent, je le vois et je m'en félicite, que j'ai lu pareillement l'ouvrage de Théophraste sur les morsures et les dards des animaux, ainsi que les Thériaques de Nicandre. Ils ne manqueraient pas alors de me poursuivre comme empoisonneur : car c'est la lecture d'Aristote et l'émulation qu'elle m'a inspirée qui m'ont porté vers ces études. J'y ai été aussi quelque peu encouragé par mon illustre maître : se livrer à ces études, dit Platon, c'est approfondir la vérité dans les mondes visibles comme dans l'essence incréée. Maintenant que leur affaire de poissons est suffisamment éclaircie, écoutez, Seigneur, un autre chef d'accusation aussi sottement imaginé, mais où ils ont encore fait preuve de plus d'inconséquence et de méchanceté. Ils savaient eux-mêmes que l'argument poissonnier était pitoyable et n'aboutirait à rien ; que la nouveauté, d'ailleurs, en était ridicule. Car a-t-on jamais ouï dire que pour des maléfices magiques ce fût l'usage d'enlever les écailles et le dos des poissons ! Il s'agissait donc d'inventer un fait qui se rattachât à des choses plus répandues et plus vraisemblables. Eh bien, pour se conformer à des opinions reçues et accréditées, ils ont été dire que j'avais fasciné un enfant par certains charmes ; que la scène s'était passée à l'écart, loin de tous les yeux, au pied d'un petit autel, à la lueur d'une lanterne ; que peu de témoins seulement avaient été admis à l'opération ; qu'aussitôt enchanté, l'enfant était tombé par terre ; et qu'ensuite, après qu'il était longtemps resté sans connaissance, je l'avais rappelé à la vie. Ils n'ont pas osé pousser plus loin dans le mensonge. Cependant, pour que la fable fût complète, ils auraient dû ajouter que ce même enfant a prédit et annoncé une foule de choses ; puisque nous savons que le résultat précieux des enchantements ce sont les présages et la divination. Et ce n'est pas seulement sur les croyances populaires, c'est encore sur les plus graves et les plus savants témoignages que s'est confirmé ce miracle au sujet des enfants. Dans le savant Varron, écrivain d'une science et d'une érudition très exacte, je me souviens avoir lu, entre autres faits analogues, celui que je vais raconter. Les Tralliens, à l'occasion de la guerre de Mithridate, avaient eu recours aux divinations par la voie de la magie ; et un enfant, après avoir contemplé dans l'eau une image de Mercure, chanta, dans une prédiction de cent soixante vers, ce qui arriverait. Varron rapporte encore, que Fabius, ayant perdu cinq cents deniers, vint consulter Nigidius ; que celui-ci ensorcela des enfants : dès lors ceux-ci indiquèrent dans quel endroit avait été enfouie une bourse qui contenait une partie de la somme, entre quelles mains les autres écus avaient été dispersés ; ils signalèrent même que Caton le philosophe avait une des pièces ; et, en effet, ce dernier convint qu'il l'avait reçue des mains d'un de ses domestiques pour faire une offrande à Apollon. Voilà, sans parler d'autres faits semblables, ce que j'ai lu dans maints traités sur les enfants magiciens : mais j'hésite, quand il s'agit de déclarer si j'estime ou non que ces choses-là soient possibles. Pourtant je pense, avec Platon, qu'entre les dieux et les hommes se trouvent placées certaines puissances divines, intermédiaires par leur nature comme par l'espace qu'elles occupent, et que ce sont ces êtres qui président à toutes les divinations, à tous les prodiges de la magie. Il y a plus : je suis convaincu qu'une âme humaine, surtout une âme simple comme celle d'un enfant, peut, au moyen de charmes qui la transportent hors d'elle-même, de parfums qui la mettent en extase, être endormie et entièrement enlevée à la conscience des choses de ce monde : qu'insensiblement elle peut oublier les entraves du corps, être ramenée, rendue à sa nature, immortelle et divine comme on sait, et qu'alors, dans une espèce de sommeil, elle peut présager l'avenir. Mais enfin, quoi qu'il en soit, et en supposant qu'il faille croire à de semblables résultats, cet enfant prophète, quel qu'il puisse être, doit, si je suis bien informé, réunir la grâce et la possession de tous ses membres ; il doit être et ingénieux et s'exprimer avec aisance ; sa personne devient comme un sanctuaire auguste où réside la divine puissance, si toutefois elle peut se renfermer dignement dans le corps d'un enfant. Il semble que cette âme d'enfant mette une promptitude particulière à s'enlever, à se réduire à son principe divin, parce que ce principe, récemment déposé dans un corps et que nul oubli n'a encore altéré ou affaibli, a plus de facilité pour se dégager ; car ce n'est pas avec tout bois, comme disait Pythagore, qu'il faut sculpter des Mercures. Or, s'il en est ainsi, précisez donc quel était cet enfant : santé, virginité, esprit, grâces, réunissait-il tous ces avantages, celui que j'ai jugé digne d'être initié à mes enchantements ? Non, certes, car Thallus que vous avez nommé a plutôt besoin d'un médecin que d'un magicien. Le malheureux est, en effet, atteint d'épilepsie, et à un tel degré que, souvent trois ou quatre fois par jour, sans aucun enchantement, hélas ! il tombe par terre et se meurtrit cruellement tous les membres dans ses chutes. Il a la face couverte d'ulcères ; son front et le haut de sa lête sont abîmés de contusions ; son regard est hébété, ses narines sont béantes, sa démarche, incertaine. Je donne pour le plus habile de tous les magiciens celui en présence de qui Thallus resterait longtemps sur ses jambes ; tant sont répétés les accès de ce mal qui l'empêche, comme un homme endormi, de rester droit et de garder son équilibre. Voilà pourtant celui que vous prétendez avoir été renversé par mes enchantements, et cela, parce que le hasard a voulu qu'une fois il tombât pendant que je me trouvais là. Il y a ici un grand nombre d'esclaves, ses camarades, que vous avez assignés : tous peuvent dire s'ils se gênent pour cracher sur Thallus ; pourquoi aucun d'eux n'ose manger au même plat, ou boire dans le même gobelet que lui. Mais que parle-je d'esclaves ? Vous-mêmes, niez, si vous en avez l'audace, niez que, bien longtemps avant mon arrivée à Oea, il eût l'habitude de tomber de ce mal et eût été présenté maintes fois à des médecins ? Je mets pareillement au défi ses camarades d'esclavage qui sont à votre service. Je passerai condamnation sur tous les points, s'il n'est pas vrai que d'un accord général il est depuis longtemps relégué à la campagne dans les terres les plus éloignées, pour ne pas infecter de son mal les autres serviteurs. Il leur serait impossible de nier qu'il en est ainsi, à telles enseignes que c'est pour cela que nous n'avons pas pu le représenter aujourd'hui. En effet, rien n'égale l'inconséquence et la brusquerie apportées à cette accusation : il y a trois jours seulement qu'Emilianus nous sommait de faire comparaître devant vous quinze esclaves ; nous en présentons quatorze, qui se trouvaient dans la ville ; Thallus est le seul que je ne puisse produire, puisqu'il est relégué à la campagne, comme je l'ai dit, et à cent milles d'ici environ. Il ne manque que lui ; mais nous avons envoyé pour qu'on le ramenât en voiture. Demandez, Maximus, aux quatorze serviteurs que nous produisons où est le jeune Thallus, quel est son état de santé ; interrogez les esclaves de mes accusateurs. Ils ne disconviendront pas qu'il est d'une laideur repoussante, d'un corps usé, malade, languissant ; que c'est un grossier personnage, un rustre. En vérité, vous avez choisi là un bel enfant, pour supposer qu'il figure dans un sacrifice, que quelqu'un lui touche la tête, le couvre d'un blanc tissu de lin, attende de sa bouche une réponse ! Je voudrais vraiment le voir ici : je l'aurais remis entre tes mains, Emilianus : je t'aurais chargé de le tenir, de l'interroger. Au milieu même de ta question, ici, devant le tribunal, il aurait tourné contre toi des yeux hagards, il aurait couvert ta figure d'écume et de crachats, il aurait contracté ses mains, secoué sa tête, et aurait fini par tomber sur toi. Les quatorze esclaves que tu as demandés, je les présente ; pourquoi n'en profites-tu pas pour les questionner ? Tu en veux exclusivement un, celui qui tombe du mal caduc, celui que tu sais aussi bien que moi être loin d'ici. Jamais calomnie fut-elle plus évidente ? quatorze esclaves se présentent sur ta requête, tu feins de ne pas les voir ; un seul, et le plus misérable, fait défaut, tu accuses son absence. En définitive, que veux-tu ? Suppose que Thallus soit ici. Veux-tu prouver qu'il est tombé, moi présent ? Je l'accorde tout le premier. Prétends-tu qu'il y ait eu là de l'enchantement ? L'esclave n'en sait rien ; moi, je prétends que c'est une imputation calomnieuse. Maintenant, tu ne saurais nier, pour ta part, qu'il soit sujet à tomber ainsi. Pourquoi donc serait-ce à mes enchantements plutôt qu'à son infirmité qu'il faut attribuer ces chutes ? N'a-t-il pu se faire que par hasard il éprouvât des accès en ma présence, comme il en a éprouvé d'autres fois devant mille personnes ? Que si j'eusse attaché une grande importance à faire tomber celui qui tombe à chaque instant du jour, avais-je besoin d'enchantements, lorsqu'il suffit d'un morceau de jayet échauffé, comme je le lis chez les naturalistes, pour constater celle maladie d'une manière aussi complète que facile ? C'est même avec l'odeur de cette pierre que sur les marchés communément on s'assure de la santé ou de la maladie des esclaves exposés en vente. La roue tournée par le potier de terre provoque aussi très aisément un accès, par sa rotation, chez les sujets atteints de ce mal, tant la vue de ce mouvement rapide ébranle leur imagination déjà frappée ; et pour provoquer leurs chutes un potier de terre vaut mieux qu'un magicien. C'est sans nécessité aucune que tu m'as fait sommation de produire les esclaves ; mais non pas sans motif je te somme, moi, de nommer les témoins qui assistaient à la cérémonie expiatoire où j'ai déterminé la chute de Thallus. Tu n'en indiques absolument qu'un seul : c'est ce petit Sicinius Pudens, sous le nom de qui tu m'accuses ; il soutient, en effet, qu'il était présent. Mais quand son enfance ne protesterait pas contre la gravité de cette déposition, son rôle d'accusateur en infirmerait la bonne foi. Il eût été beaucoup plus avantageux pour toi, Emilianus, et beaucoup plus sérieux et décisif de dire : “J'étais là moi-même,” et de commencer tes extravagances à partir de cette scène mystérieuse, plutôt que d'en donner tous les rôles à des enfants, comme on leur donnerait des joujoux. Un enfant est tombé, un enfant a vu ; est-ce aussi un enfant qui a opéré le charme ? Ici, Tannonius Pudens a montré assez de finesse. Voyant que ce mensonge était reçu froidement, et que les visages, les murmures de toute l'assemblée en faisaient presque déjà justice, il a voulu par des promesses arrêter les soupçons de quelques-uns ; et il s'est fait fort de produire d'autres enfants pareillement enchantés par moi ; de cette manière, il lui a été permis d'aborder une autre apparence de griefs. C'est là une manoeuvre que j'aurais pu passer sous silence ; cependant, comme j'ai fait pour le reste, je veux être le premier à provoquer en ceci mon accusateur. Oui, je demande la comparution de ces esclaves qu'on a engagés à mentir, je le sais, en leur donnant l'espoir de la liberté. Mais je m'explique : je ne demande rien que leur comparution. Je te somme donc, Tannonius Pudens, et je t'adjure d'accomplir ta promesse. Voyons ces enfants en qui vous avez tant de confiance : présente-les, nomme-les ; tu peux user pour cela du temps de ma clepsydre. Allons, dis, Tannonius... Pourquoi ce silence ? pourquoi ces hésitations ? pourquoi ces coups d'oeil jetés derrière toi ? Est-ce qu'il ne sait plus ce qu'il a dit, ou qu'il a oublié les noms ? Eh bien ! à toi, Emilianus : approche ici ; dis ce dont tu avais chargé ton avocat ; montre ces enfants. Pourquoi as-tu pâli ? pourquoi ne dis-tu mot ? Est-ce là se porter accusateur ? est-ce là dénoncer un si horrible forfait ? N'est-ce pas bien plutôt se jouer de Claudius Maximus, d'un si haut personnage, et me poursuivre avec l'arme de la calomnie ? Que si, par hasard, c'est ton défenseur qui s'est trop avancé dans ses paroles ; que si tu n'as pas d'enfants à produire, restent du moins les quatorze esclaves que j'ai exhibés : use d'eux pour quelque chose. Ou bien, dans quelle intention exigeais-tu que l'on fit comparaître un si grand troupeau ? Pour une accusation de magie, tu veux t'appuyer de la déposition de quinze esclaves ; si tu m'accusais de violence, combien donc, en fin de compte, en assignerais-tu ? Mais quoi ! quinze esclaves savent le fait, et ce fait est, dis-tu, occulte ; et d'un autre côté, s'il ne l'est pas, où donc alors est la magie ? De deux choses l'une, et tu es absolument obligé d'en convenir : ou il n'y avait rien d'illicite dans une opération à laquelle je n'ai pas craint d'admettre tant de témoins ; ou elle était illicite, et tant de témoins n'auraient pas dû la connaître La magie, autant que je l'ai entendu dire, est chose livrée à l'action des lois ; et de temps immémorial les Douze Tables en ont proclamé l'interdiction à cause des incroyables enchantements qu'on peut exercer sur les fruits de la terre. Aussi cette science n'est-elle pas moins occulte que sombre et terrible : c'est d'ordinaire pendant la nuit qu'on s'y livre, au milieu des ténèbres, loin de tous témoins et au murmure de certaines paroles mystérieuses : non seulement peu d'esclaves, mais encore peu d'hommes libres y sont admis ; et tu veux que quinze esclaves y aient figuré ! Etait-ce donc une noce, ou quelque autre cérémonie réunissant une foule nombreuse ? était-ce un banquet de fête ? Quinze esclaves participent à un sacrifice magique, comme autant de quindécemvirs chargés de régler le culte de l'Etat. Pourquoi, cependant, aurais-je admis un nombre si considérable ? N'en est-ce pas trop pour garder un secret ? Quinze hommes libres, c'est tout un peuple ; autant d'esclaves, c'est toute une maison ; autant d'enchaînés, c'est tout un bagne. Avais-je besoin de cette multitude pour qu'ils m'aidassent à contenir longtemps les victimes expiatoires ? Mais, en fait de victimes, vous n'avez nommé que des poulets. Etait-ce pour qu'ils comptassent les grains d'encens ? pour qu'ils jetassent Thallus sur le carreau ? Vous dites encore qu'on mena jusque chez moi une femme de condition libre, atteinte de la maladie de Thallus, que je promis de la guérir, et que mes enchantements la firent aussi tomber. A ce que je vois, vous êtes venus pour accuser en moi un lutteur, et non pas un magicien, tant vous tenez à dire que j'ai terrassé tous ceux qui se sont présentés devant moi. Cependant, Maximus, quand vous avez interrogé le médecin Thémison, qui avait amené cette femme pour la soumettre à mon examen, il vous a déclaré que je ne lui avais fait autre chose que de lui demander si elle avait des bourdonnements dans les oreilles, et laquelle bourdonnait le plus ; et dès qu'elle m'a eu dit que c'était la droite qui la tourmentait, elle s'est aussitôt retirée. Ici, Maximus, bien que je m'abstienne soigneusement de votre éloge devant le tribunal, et que dans cette plaidoirie je ne me sois pas montré flatteur un seul instant, je ne puis me défendre de louer l'adresse avec laquelle vous avez formulé vos questions. Le débat n'en finissait pas entre mes accusateurs, soutenant que j'avais ensorcelé la femme, et le médecin, témoin oculaire, leur donnant un démenti complet. Vous avez très habilement demandé quel profit j'avais retiré de cet enchantement. «De faire tomber cette femme,» ont-ils répondu. - «Et après ?» avez-vous ajouté. «Elle est donc morte ?» - «Non.» - «Que dites-vous donc ? quel intérêt aurait eu Apulée à ce qu'elle tombât ?» - C'est ainsi que vous avez insisté trois fois sur cette question en homme d'esprit et en magistrat consommé, sachant bien qu'on ne saurait trop examiner la raison des faits, qu'il faut souvent interroger les causes même en concédant les faits, et que si les avocats des plaideurs sont nommés causidici, c'est parce qu'ils expliquent les causes de telle ou telle action. Car enfin, nier un fait est chose aisée et n'a besoin d'aucun avocat ; démontrer que ce fait est innocent ou criminel, voilà qui est autrement pénible et difficile. C'est donc sans nécessité que l'on recherche si un fait a été accompli, lorsqu'aucune intention coupable ne s'intéressait à ce qu'il eût lieu. Voilà pourquoi un juge éclairé ne soumet point à la question un prévenu, quand celui-ci n'a eu aucun motif pour mal agir. Maintenant qu'ils n'ont pu prouver que cette femme ait été ensorcelée ou jetée par terre, et que d'un autre côté j'avoue l'avoir visitée sur la demande d'un médecin, je vous dirai, Maximus, pourquoi je la questionnais sur ce bourdonnement d'oreilles. Mais je vous le dirai moins dans le désir de me justifier, car vous avez déjà reconnu mon innocence et l'injustice de l'accusation, que pour ne rien taire de ce qui peut être digne d'être entendu d'un homme de votre mérite et de votre savoir. Je serai le plus bref possible ; car je n'ai pas la prétention de vous instruire : je veux seulement vous rappeler ce que vous savez. Le philosophe Platon, dans cet immortel Timée, où le monde entier semble se constituer en quelque sorte à sa parole, après avoir admirablement exposé aussi les trois facultés de notre âme, après avoir démontré d'une manière très précise les différents usages des membres que nous a donnés la Providence céleste, divise en trois classes les causes de toutes nos maladies. La première, il l'attribue aux dieux créateurs du corps, qui dans les éléments dont ils l'ont composé ont fait entrer en proportions inégales l'humide et le froid ou bien le sec et le chaud : ce qui produit l'excès ou le déplacement de ces principes constitutifs. La deuxième cause des maladies tient aux vices dont peuvent être affectés les produits mêmes de ces premiers éléments combinés ensemble : le sang, les viscères, les os, la moelle, et par suite tout ce qui se rattache à ces parties. La troisième cause tient à la concrétion de la bile et du fiel, au trouble des esprits animaux, à l'épaississement de la lymphe. Une des variétés les plus graves que présente cette dernière cause est l'épilepsie (comitialis morbus), de laquelle j'ai déjà commencé à parler. Dans cette maladie, les chairs travaillées par un feu dévorant se résolvent en un liquide épais et écumeux ; des humeurs s'en échappent, et de ce foyer brûlant et comprimé elles sortent sous la forme d'un fluide corrompu, bouillonnant et de couleur blanchâtre. Si ces impuretés se dégagent au dehors, elles sont plus hideuses à voir qu'elles ne sont véritablement nuisibles. Ce n'est que l'épiderme de la poitrine qui en est maculé dans tous les sens et dans toutes les formes ; quand le mal a pris ce cours, on n'est pas exposé désormais à l'épilepsie, et on échange une des plus graves affections qui puissent troubler l'intelligence contre une légère difformité physique. Si au contraire ces matières blanchâtres et malsaines restent à l'intérieur, elles se combinent avec la bile noire. C'est un fléau impitoyable qui envahit toutes les veines ; bientôt il se fraye un chemin jusqu'au sommet de la tête ; il se répand d'une manière terrible dans le cerveau, et frappe d'anéantissement cet organe royal, trône de la raison où l'âme semble siéger et dominer en souveraine. Il porte le trouble et la confusion dans ce merveilleux et divin labyrinthe aux mille et mille voies. Son influence est moins pernicieuse durant le sommeil. Quand le malade est plein de boisson et de nourriture, le mal s'annonce par un léger étouffement. Mais si l'accès persiste jusqu'à gagner la tête du malade même quand celui-ci est réveillé, alors un voile se répand soudain sur sa raison ; il est saisi de torpeur et d'une sorte de paralysie, à la suite de laquelle il tombe sans connaissance. Les Latins appellent à bon droit cette maladie non seulement haut-mal, mal comitial, mais encore mal divin, comme les Grecs, ἱερὰν νόσον ; parce qu'elle attaque le siège de la raison, c'est-à-dire la partie la plus sainte de notre être. Vous reconnaissez, Maximus, les doctrines de Platon ; je les reproduis avec autant de clarté qu'il est possible de le faire en si peu de temps. Eh bien, je partage entièrement cette opinion : je pense que les causes de l'épilepsie tiennent à ce que le mal monte au cerveau. Vous comprenez donc que j'avais mes raisons pour demander à cette femme si elle avait la tête lourde et la nuque engourdie, si elle éprouvait des battements aux tempes, des bourdonnements dans les oreilles. Du reste, de ce que l'oreille droite lui bourdonnait plus que la gauche, c'était un signe que la maladie avait fait d'immenses progrès. Car ce qui dans le corps est à droite a le plus de force, et il ne reste guère d'espoir pour la guérison quand ce côté aussi succombe à une affection. Aristote, dans son livre de Problèmes, ne manque pas de nous apprendre que, toutes choses égales d'ailleurs, celui des deux épileptiques qui est pris par le côté droit est le plus difficile à sauver. Si je ne craignais de m'étendre trop loin, je reproduirais aussi l'opinion de Théophraste sur cette même maladie ; car nous avons de cet écrivain un excellent ouvrage sur les épileptiques. Toutefois, dans un autre livre qu'il a écrit sur les jalousies des animaux, il indique un remère contre l'épilepsie. C'est, dit-il, la peau dont les lézards, à l'exemple d'autres reptiles, se dépouillent à certaines époques comme d'une livrée de vieillesse. Mais il faut prendre cette peau à l'instant ou ils la laissent tomber ; autrement, soit par un pressentiment de jalousie, soit par une affinité de nature, elle change de propriété, et devient une substance qui dévore. Qu'ai-je entendu prouver par ces citations, empruntées à d'illustres philosophes, et auxquelles je n'ai voulu joindre aucune autorité de médecins ou de poètes ? J'ai voulu établir que les philosophes font entrer dans le cercle de leurs études la connaissance des maladies et des remèdes. Ainsi, lorsque j'ai visité une femme malade qu'il s'agissait de guérir (et vous avez entendu la déposition du médecin qui l'avait amenée) J'agissais parfaitement dans la limite de mes attributions. C'est ce que mes adversaires sont obligés de reconnaître, à moins d'établir qu'il y a magie et maléfice à guérir des maladies, ou bien, s'ils l'osent, à moins d'avouer que cette affaire d'enfant et de femme tombés se résout en une accusation calomnieuse qui tombe elle-même à plat. Mais plutôt disons la vérité, Émilianus : si quelqu'un est tombé dans tout ceci, c'est bien plutôt toi, qui as succombé déjà tant de fois sous tes calomnies. Or, il est aussi dangereux de choir au moral qu'au physique : mieux vaut manquer d'équilibre que de bon sens ; mieux vaut être couvert de crachats dans sa chambre que de démentis dans une aussi imposante assemblée. Mais peut-être crois-tu ton état sain, parce qu'on ne te tient pas renfermé chez toi, et que tu suis ton mal partout où il te mené. Eh bien, si tu compares tes accès à ceux de Thallus, tu reconnaîtras qu'il n'y a guère de différence, sinon que la fureur de ce malheureux affecte lui seul et que la tienne s'attaque aux autres. Du reste, si ses yeux se détournent, toi tu retournes la vérité ; si Thallus éprouve des attaques de nerfs, tu en fais éprouver à tes avocats ; Thallus se brise la tête sur les pavés ; toi, tu te cassses le nez contre les tribunaux. Enfin, ce qu'il fait, c'est quand le mal le tient, et il pèche sans le savoir ; mais toi, misérable, c'est sciemment et avec connaissance de cause : tant est violente la maladie qui t'excite ! Ce qui est faux, lu le produis comme vrai ; à ce qui n'existe pas tu veux donner du corps afin d'y trouver un crime ; l'homme dont tu sais parfaitement l'innocence, tu l'accuses cependant comme un coupable ; et même (j'ai négligé d'en faire le rapprochement), il y a telles circonstances que tu confessais avoir ignorées, et dont ensuite tu m'as fait un crime comme si elles eussent été connues de toi. Par exemple, tu dis que lorsque j'habitais chez Pontianus j'avais certain objet enveloppé dans un mouchoir. Quant à cet objet, quant à sa forme, tu conviens que tu l'ignores, que même personne au monde ne l'a jamais vu ; et tu n'en persistes pas moins à dire que c'était quelque instrument de magie. On ne t'adressera pas des compliments, Émilianus : dans ton métier d'accusateur tu ne fais preuve ni d'adresse, ni même d'impudence ; ne va pas te l'imaginer. Que constater donc ? la fureur déplorable d'une âme envieuse, le pitoyable délire d'une vieillesse abrutie. Car enfin voici à peu près en quels termes tu as procédé devant un juge aussi grave et aussi clairvoyant : «Dans la maison de Pontianus, Apulée avait certains objets enveloppés d'un linge ; comme j'ignore ce que c'était, j'en conclus que c'étaient des objets propres à la magie. Croyez-moi donc en ce que je dis, parce que je dis ce que j'ignore.» O les beaux arguments, et qu'ils prouvent victorieusement l'accusation ! Telle chose est, parce que j'ignore ce qu'elle est. Il n'y a que toi au monde, Émilianus, pour savoir ainsi ce que tu ne sais pas. Grâce à ta sottise, voilà que tu t'élèves au-dessus de toutes les intelligences. Les philosophes les plus profonds et les plus pénétrants disent que nous ne devons pas même ajouter foi à ce que nous voyons : mais toi, tu prononces affirmativement sur ce que tu n'as jamais vu ni entendu. Pontianus, s'il vivait et que tu lui demandasses ce qu'il y avait dans ce linge, répondrait qu'il l'ignore. L'affranchi même qui a gardé jusqu'à ce jour les clefs de l'appartement, et qui est de votre parti, déclare n'avoir jamais vu l'objet, quoique lui seul, en qualité de gardien des livres renfermés dans la chambre, l'ouvrit et la fermât journellement. Souvent avec nous, beaucoup plus souvent tout seul, il y entrait, et il voyait ce linge posé sur une table, sans être scellé ni ficelé. La chose n'est-elle pas toute simple ? des instruments de magie y étaient cachés : c'était une raison sans doute pour les garder avec moins de précaution. C'est probablement pour cela que j'exposais le linge à la curiosité et à l'inspection de qui eût voulu même l'emporter ; que je le confiais à la garde d'autrui ; que je le mettais à la discrétion du premier venu ! Mais comment veux-tu qu'ici l'on puisse te croire ? Ce que Pontanius ignorait, lui avec qui et chez qui je vivais, peux-tu le savoir, toi que je n'ai jamais vu si ce n'est devant ce tribunal ? Ce qu'un affranchi sans cesse présent, qui avait toute facilité d'inspection, ce que cet affranchi n'a pas vu, toi, qui n'a jamais mis le pied dans la chambre, tu l'aurais vu ! enfin, ce que tu n'as pas vu, tu prétends dire ce que c'est ! Mais, triple sot, si aujourd'hui tu avais dérobé ce linge, quelque objet que tu vinsses à en tirer, je nierais que ce fût magique. Du reste, je le laisse maître : imagine, ressouviens-toi, invente quelque chose qui puisse sembler en rapport avec de la magie, j'accepte le débat sur ce terrain : ou je soutiendrai qu'il y a eu substitution, ou je dirai que c'est une matière médicamenteuse, un objet sacré, un soporifique. Il y a mille autres suppositions que je pourrai faire d'après les habitudes les plus communes, d'après les observations les plus ordinaires, et tu seras confondu. Même quand tu aurais entre les mains l'objet en question, il ne prouverait rien contre moi devant un juge éclairé. Et pourtant, lorsque tu es réduit à de simples soupçons, à des conjectures, à de l'ignorance, tu veux que je sois condamné ! Je ne sais si tu ne vas pas ajouter encore, selon ton habitude : «Qu'est-ce donc qui était enveloppé d'un linge, et que vous aviez déposé précisément dans le sanctuaire des dieux Lares ?» Fort bien, Émilianus : manière commode d'accuser ! tu demandes tout à celui que tu accuses, et tu ne produis toi-même rien qui soit avéré. «Pourquoi vous procurez-vous des poissons ? pourquoi avez-vous visité une femme malade ? qu'avez-vous enveloppé dans un linge ?» Est-ce pour accuser ou pour interroger que tu es venu ici ? Si c'est pour accuser, formule le premier tes griefs ; si c'est pour interroger, ne prétends pas juger les choses à l'avance, puisque, si tu es forcé d'interroger, c'est parce que tu ne les sais pas. A ce compte, du reste, on mettra sans peine tout le monde en jugement, si après avoir dénoncé quelqu'un on n'est pas obligé de prouver, et qu'au contraire on dit toute facilité pour interroger. En effet, si c'est, par exemple, une accusation de magie que l'on intente, tout ce qu'auront fait les gens leur sera objecté. «Vous avez appendu un ex-voto au genou d'une statue : donc vous êtes magicien ; ou bien, pourquoi l'avez-vous suspendu ? Vous avez adressé tout bas des prières aux dieux dans le temple : donc vous êtes magicien ; ou bien, que leur avez-vous demandé ? Réciproquement, vous n'avez pas fait de prières dans le. temple : donc vous êtes magicien ; ou bien, pourquoi n'avez-vous pas prié les dieux ? Pareillement, si vous avez déposé quelque offrande, fait quelque sacrifice, pris de la verveine...» La journée ne me suffirait pas, si je voulais passer en revue tous les actes dont un calomniateur exigera ainsi qu'il lui soit rendu compte. Par-dessus tout, du moment qu'on gardera chez soi quelque objet qui soit clos ou scellé, ce sera, par suite du même système, quelque talisman magique, qu'il faudra tirer de son armoire pour le présenter au tribunal et devant les juges. Voyez la gravité des conséquences, Maximus, et le vaste champ qu'Émilianus vient d'ouvrir, de cette façon, aux calomnies. Que de sueurs on veut faire essuyer à des innocents avec ce linge ! Je pourrais m'étendre au long sur ce texte ; mais je préfère poursuivre la tâche que je me suis imposée. Quoiqu'il n'y ait pour moi aucune nécessité, j'avouerai tout, et je vais répondre aux questions d'Émilianus. Tu demandes donc, Émilianus, ce que j'avais dans ce linge. Rien ne m'empêcherait du nier que jamais il y ait eu aucun mouchoir à moi dans la bibliothèque de Pontianus ; mais j'accorderai pleinement le fait. Je pourrais encore dire que rien n'y était enveloppé ; si je le disais, il n'y a ni témoignage ni argument qui soit là pour me démentir : car personne n'y a touché, et il n'y a de votre aveu, qu'un seul affranchi qui l'ait vu. Néanmoins, je le déclare, ce ne sera pas moi qui m'opposerai à ce qu'il ait été plein et bourré. Libre à toi, si c'est ton bon plaisir, d'imiter les compagnons d'Ulysse, qui jadis crurent avoir découvert un trésor quand ils avaient dérobé des outres gonflées de vent. Veux-tu que je dise de quelle nature étaient les objets enveloppés dans ce linge et confiés par moi aux I.ares de Pontianus ? On va te satisfaire. J'ai été en Grèce initié à presque tontes les sectes religieuses. Différents signes, différents symboles m'en ont été offerts par leurs prêtres, et je les conserve avec soin. Je ne dis rien là d'insolite, rien d'inoui. Je ne ferai appel qu'à vous, qui dans cette assemblée êtes initiés aux mystères du divin Bacchus : vous savez quel objet vous gardez caché à la maison et vénérez en silence loin de tous les profanes. Mais moi, comme je l'ai dit, animé du zèle de la vérité et d'un sentiment de devoir à l'égard des dieux, j'ai étudié une foule de religions, de pratiques mystérieuses, de cérémonies saintes. Et ce n'est pas là une fable composée pour la circonstance. Il y a environ trois ans, aux premiers jours de mon installation dans la ville d'Oea, parlant en public sur la majesté d'Esculape, j'ai fait la même déclaration, et j'ai énuméré toutes les religions dont j'étais instruit. Mon discours est très répandu ; on le lit partout, il se trouve dans les mains de tout le monde, moins à cause du talent de l'orateur que pour les détails sur Esculape, qui ont intéressé les personnes religieuses d'Oea. Que quelques-uns de vous, s'il en est que leur mémoire puisse servir, récitent l'exorde de ce morceau... Entendez-vous, Maximus ? vingt voix viennent de le murmurer. Tenez : voilà même une main qui offre un exemplaire. Je demanderai qu'on en lise tout haut un passage, car vous montrez par votre air plein de bienveillance que cette lecture ne vous déplaît pas. (Ici manque un fragment du discours d'Apulée aux habitants d'Oea.) Quelqu'un peut-il encore trouver étonnant, s'il a les moindres notions religieuses, qu'un homme initié à tant de mystères sacrés conserve chez lui certains emblèmes de ces mêmes mystères ? qu'il leur donne pour enveloppe un tissu de lin, puisque l'on ne saurait en destiner de plus pur à voiler des objets divins ? En effet la laine, dépouille enlevée à un animal sans énergie, à un vil bétail, est une substance déclarée profane, même dès le temps où Orphée et Pythagore instituaient leur rituel. Le lin au contraire, emblème parfait de propreté, passe pour une des plus excellentes productions de la terre ; et non seulement il sert de vêtement et de costume aux saints prêtres de l'Egypte, mais encore on l'emploie à voiler les choses sacrées. Je sais bien que pour quelques esprits forts, et entre autres pour cet Emilianus, c'est une facétie que de tourner en dérision les choses saintes. Car, si j'en crois une bonne partie des habitants d'Oea qui le connaissent, à l'âge où il est il n'a encore prié aucun dieu, il n'a mis le pied dans aucun temple. Passe-t-il devant quelque lien sain ! ; il croirait faire un crime de porter sa main à ses lèvres en signe d'adoration. Aux dieux des champs même, qui le nourrissent et l'habillent, il n'offre jamais les prémices de ses moissons, de ses vignes, de ses troupeaux ; dans sa ferme, il n'y a pas une seule chapelle, pas une seule enceinte, un seul bosquet consacrés. Et que parle-je bosquet ou chapelle ? de ceux qui sont allés chez lui, nul ne se rappelle y avoir vu, même sur les limites, une seule pierre arrosée d'huile, un seul rameau couronné. Aussi lui a-t-on donné deux sobriquets : celui de Caron, comme je l'ai déjà dit, à cause de sa figure et de son âme infernales ; puis à cause de son mépris pour les dieux, il en a un autre, qu'il entend répéter plus volontiers, celui de Mézence. C'est pourquoi je comprends sans peine que toutes ces énumérations de mystères religieux lui semblent autant de billevesées. Peut-être encore ce superbe ennemi de toute religion ne peut-il croire a la sincérité de mes paroles, ni se figurer que je garde avec ferveur tant de symboles et d'emblèmes pieux. Mais que Mézence pense de moi ce qu'il voudra : peu m'importe. Quant aux autres, je le déclare à haute voix : si par hasard il se trouve ici quelque personne initiée aux mêmes mystères que moi, qu'elle me présente un signe, et elle apprendra de moi quels sont ces objets que je conserve renfermés ; car, du reste, jamais nul péril au monde ne me déterminerait à révéler à des profanes ce qui m'a été communiqué sous le sceau du secret. Si je ne me trompe, Maximus, j'ai fait passer la conviction dans les esprits même les plus défavorablement prévenus ; et pour ce qui est de ce linge, il n'est pas possible de l'avoir rendu plus blanc. Je peux donc en toute assurance passer des imputations d'Émilianus à cette fameuse déposition de Crassus, qu'on a présentée comme étant ce qu'il y avait ensuite de plus grave. Vous avez entendu la lecture d'une plainte écrite et signée par un certain pique-assiette, glouton désespéré, qui a nom Junius Crassus. Il prétend que dans sa maison je me suis occupé de sacrifices nocturnes avec un de mes amis, Appius Quintianus, qui avait loué un appartement chez lui ; et, bien que Crassus à cette époque se trouvât à Alexandrie, il prétend avoir reconnu le fait aux plumes des oiseaux et à la fumée des torches. Il est probable, en effet, que quand il faisait bombance à Alexandrie (car ce Crassus est un homme à se traîner volontiers tout le jour dans les tavernes), il a, du milieu de l'odeur exhalée par des fricassées d'auberge, argumenté en aruspice sur des plumes d'oiseaux qui lui sont arrivées de chez lui ; qu'il a reconnu la fumée de son logis, la voyant à si grande distance sortir du toit natal. S'il l'a reconnue de ses yeux, il a un regard bien autrement perçant que ne le souhaitait pour lui-même Ulysse dans ses voeux ardents. Durant longues années, Ulysse allait sur les bords de la mer, et cherchait, mais en vain, à distinguer de loin la fumée qui s'élevait de sa patrie. Crassus, dans le peu de mois qu'il a été absent, a vu cette même fumée sans fatigue, sans se déranger de sa place, assis dans une taverne d'ivrognes. Que si pareillement il a senti par avance l'odeur de brûlé répandue dans sa maison, il n'y a pas de chiens et de vautours qui soient en état de rivaliser avec lui pour la finesse de l'odorat. En effet, quel chien, quel vautour du ciel d'Alexandrie, pourrait apprécier une odeur quelconque à la distance des frontières d'Oea ? Crassus est un gourmand de première force, et il se connaît en toutes sortes de fumets ; mais bien certainement, fameux comme il est par son goût pour la bouteille, ce serait plutôt l'odeur du vin que celle de la fumée qui lui serait arrivée jusque dans Alexandrie. Il a compris lui-même que le fait paraîtrait incroyable ; car on dit que c'est avant la deuxième heure du jour, quand il était à jeun et n'avait encore rien bu, qu'il a vendu ce témoignage. Voici donc comment il a déclaré par écrit avoir reconnu la chose. Il prétend qu'à son retour d'Alexandrie, il s'est rendu droit à sa maison, que Quintianus avait déjà quittée ; là, dans le vestibule, il vit beaucoup de plumes d'oiseaux et, en outre, les murailles toutes noircies de fumée ; ayant interpellé à ce sujet l'esclave qu'il avait laissé dans Oea, celui-ci déclara que ces désordres provenaient de sacrifices nocturnes accomplis par Quintianus et par moi. Voilà, certes, une fable subtilement ourdie et un mensonge bien vraisemblable ! Si j'eusse voulu faire quelque chose de ce genre, ne le pouvais-je donc pas beaucoup plus facilement dans mon propre logis ? Maintenant pour ce qui est de Quintianus, ici présent à mes côtés, dont l'étroite amitié qui nous unit, dont la rare instruction et la haute éloquence me font ici proclamer son nom avec un véritable sentiment d'orgueil et de fierté ; pour Quintianus, dis-je, s'il avait eu quelques oiseaux à sa table, ou si, comme on le prétend, il en avait tué pour une opération magique, n'aurait-il donc pas eu un esclave qui balayât ces plumes et les rejetât dehors ? De plus, comment supposer une fumée assez abondante pour qu'elle eût rendu les murailles toutes noires ; et Quintianus aurait-il souffert cette malpropreté dans son appartement tout le temps qu'il y demeura ? Tu ne dis rien, Emilianus ; c'est qu'il n'y a pas dans tout ceci la moindre vraisemblance : à moins que tu n'avoues qu'au lieu d'entrer dès son arrivée dans l'appartement, Crassus, suivant ses habitudes, est allé droit à la cuisine. Mais d'où l'esclave de Crassus a-t-il soupçonné que c'était précisément la nuit que les murs avaient été salis ? Est-ce d'après la couleur de la suie ? sans doute la fumée de nuit est la plus noire et ne saurait, ainsi, se confondre avec celle de jour. Pourquoi encore ce serviteur soupçonneux et si diligent a-t-il laissé Quintianus partir avant que celui-ci eût rendu la maison nette ? Les plumes étaient-elles lourdes comme du plomb, pour rester là jusqu'au retour de Crassus ? Pourquoi celui-ci n'en accuserait-il pas son esclave ? c'est parce que c'est lui-même qui a fabriqué ce mensonge, qui a inventé cette suie, ces plumes, (car, même pour donner un témoignage, il ne peut rester longtemps éloigné de la cuisine). Pourquoi maintenant ce témoignage est-il par vous extrait d'une déposition écrite ? Où donc est Crassus lui-même ? Est-il retourné à Alexandrie par dégoût de son logis ? Essuie-t-il ses murailles ? ou, ce qui est plus probable, l'orgie de la veille lui a-t-elle porté à la tête ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que hier, dans Sabrata, je l'ai vu moi-même qui, en plein forum, répondait d'une manière assez distinguée, seigneur Emilianus, à tes hoquets d'ivrogne. Veuillez, Maximus, demander à vos nomenclateurs, quoique le personnage soit plus connu des cabaretiers que des nomenclateurs ; veuillez, dis-je, leur demander cependant s'ils n'y ont pas vu Junius Crassus d'Oea. Leur réponse ne sera pas négative. Qu'Emilianus produise cet honorable jeune homme sur le témoignage duquel il s'appuie. Vous voyez à quelle heure nous sommes de la journée : j'affirme qu'il y a déjà longtemps que Crassus ronfle plein de vin, ou que, se baignant pour la seconde fois, il se met en mesure d'aller prendre place à un lendemain de noces, après avoir laissé dans le bain les lourdeurs affadissantes de l'ivrognerie. Oui, il est on ne peut plus présent ici, quoiqu'il ne parle que par une déposition écrite. Non pas au moins qu'il se tienne écarté par aucun sentiment de pudeur : car sous vos yeux même, Maximus, il mentirait sans rougir un instant ; mais peut-être le forcené buveur n'a-t-il pu se maîtriser assez pour attendre jusqu'à ce moment-ci sans avoir bu ; ou plutôt c'est qu'Emilianus a eu ses raisons pour ne pas le faire paraître devant un regard aussi imposant que le vôtre. Il a craint qu'à voir cette bête brute, à la mâchoire démantibulée, à l'air hideux, vous ne jugeassiez défavorablement de lui sur sa mine seule ; que vous ne fussiez révolté en voyant la tête de cet individu, encore jeune pourtant, dégarnie de barbe et de cheveux, ses yeux humides, ses paupières gonflées, sa bouche et ses lèvres couvertes de bave, sa voix rauque, ses mains qui tremblent toujours. Il y a longtemps qu'il a dévoré tout son patrimoine ; des biens de ses pères il ne lui reste plus rien, si ce n'est une seule maison, sur laquelle on lui prête à charge qu'il calomniera, et dont pourtant la location ne lui a jamais été plus lucrative que le faux témoignage auquel elle vient de donner lieu. En effet, le misérable ivrogne a vendu sa calomnie trois mille sesterces comptant à Emilianus ; et dans Oea personne n'en ignore. Tous, avant que le marché fût conclu, nous en avions connaissance ; et j'aurais pu l'empêcher en le dénonçant, si je n'avais su qu'un mensonge aussi absurde pouvait plutôt nuire à Emilianus, qui l'achetait en pure perte, qu'à moi, qui le méprisais comme je devais le faire. J'ai voulu qu'il y eût dommage pour Emilianus et affront pour Crassus dans cette sale affaire de faux témoignage. Du reste, il y a trois jours que, au logis d'un certain Rufinus, dont je parlerai tout à l'heure, le marché s'est conclu, sans le moindre secret, grâce à l'intermédiaire et aux instances de ce même Rufinus ainsi que de Calpurnianus. Le premier y a d'autant plus volontiers prêté les mains, qu'il savait à l'avance qu'une bonne partie du prix devait revenir par les générosités de Crassus à sa chaste moitié, dont il n'a pas l'air de voir les débordements. Pour ce qui est de vous-même, Maximus, j'ai vu que votre sagesse vous faisait soupçonner de leur part coalition et ligue contre moi ; et, quand on vous a présenté la déposition écrite, ce sentiment s'est traduit sur votre visage par l'expression d'un profond mépris. Aussi, malgré l'excès de leur insolence et de leur brutale effronterie, n'ont-ils osé ni lire eux-mêmes ni invoquer en leur faveur ce témoignage de Crassus, reconnaissant qu'il sentait sa lie. C'est moi qui, précisément à cause de cela, en ai parlé : non pas que ces plumes fussent pour moi un épouvantail, ou que j'eusse peur de me salir à cette suie, surtout devant un juge tel que vous ; mais j'ai voulu que Crassus n'eût pas impunément vendu de la fumée à un grossier campagnard comme Emilianus. Je passe à une autre de leurs accusations. En lisant les lettres que j'adressais à Pudentilla, ils m'ont attaqué à propos d'un certain cachet, que je me suis procuré, disent-ils, pour des maléfices de sorcellerie, cachet d'une fabrication mystérieuse et d'un bois très rare. On prétend qu'il représente un squelette, et que j'adore particulièrement cette hideuse et repoussante image, lui donnant le nom grec de βασιλέα (roi). Si je ne me trompe, je suis bien pas à pas la marche de l'accusation, je reprends un à un chaque détail et je recompose tout ce tissu de calomnies. Comment la fabrication du cachet que vous dites peut-elle avoir été mystérieuse ? Vous connaissez l'ouvrier qui l'a fait, à telles enseignes que vous l'avez assigné à comparaître. Voyez, il est ici : c'est Cornélius Saturninus, homme des plus habiles dans son art et d'une moralité reconnue. Dans un interrogatoire détaillé qu'il a subi dernièrement devant vous, Maximus, il vous a expliqué toute cette affaire avec une franchise et une vérité parfaites. Il a déclaré que j'avais vu chez lui nombre de figures géométriques en buis, exécutées avec beaucoup de talent et de délicatesse, et que, charmé de ces ouvrages, je le priai de me confectionner quelque objet en ce genre, parce que je me proposais d'en faire, selon mes habitudes, un objet de pieuses supplications ; je le laissai maître de choisir et le dieu et la matière, à condition que ce serait du bois. Il commença d'abord sur du buis ; j'étais alors à la campagne. Pendant ce temps, mon beau-fils, Sicinius Pontianus, voulant m'être agréable, obtint de Capitolina, dame d'une vertu exemplaire, un petit meuble en ébène qu'il s'empressa de porter à Saturninus ; il lui recommanda d'employer de préférence cette matière, plus rare et plus durable, et il ajouta que ce cadeau me ferait un grand plaisir. L'artiste suivit son désir, autant que le permettait le meuble en question ; et par son adresse à en combiner tous les morceaux, il réussit à en tirer un petit Mercure. Ce que je dis est conforme à la déposition de Saturninus, que vous avez entendue, Seigneur ; conforme aussi à la manière dont il a été répondu à vos questions par le fils de Capitolina, jeune homme plein d'honneur et ici présent. C'est Pontianus qui avait demandé le meuble, c'est Pontianus qui l'avait porté à l'artiste. On ne nie même pas cette circonstance, que c'est Pontianus qui reçut de Saturninus le cachet quand il fut terminé et qui ensuite m'en fit présent. Toutes ces particularités étant bien et clairement établies, reste-t-il rien à quoi puisse absolument se rattacher le moindre soupçon de magie ? Je vais plus loin : reste-t-il quelque circonstance qui ne vous convainque pleinement d'un mensonge manifeste ? Ce que vous prétendez avoir été fabriqué en cachette avait été commandé par Pontianus, jeune chevalier de haute distinction, et a été exécuté par Saturninus. homme grave, honorablement connu parmi ses confrères ; l'artiste y a travaillé assis dans son atelier et en vue de tout le monde ; une dame de condition y a contribué par son présent ; nombre d'esclaves, nombre d'amis qui venaient journellement chez moi, ont su que l'objet devait se faire, qu'il était fait. Et vous n'avez pas eu honte de dire faussement que j'en avais cherché le bois dans toute la ville avec une peine infinie, quand vous saviez que durant ce temps je n'y ai pas séjourné, et quand il a été démontré que j'avais pour ma part laissé à l'artiste le choix de la matière ! Je passe à votre troisième calomnie. Vous parlez de la fabrication d'une image décharnée, d'un cadavre hideux, d'un spectre infernal et des plus horribles. Si vous étiez convaincus que c'était évidemment un emblème magique, pourquoi ne m'avoir pas sommé de le produire ? Etait-ce pour mentir à votre aise à propos d'un objet qui ne serait pas sous les yeux ? Mais grâce, fort heureusement, à une de mes habitudes, la facilité de débiter des mensonges vous est enlevée ici : car j'ai pour usage, partout où je vais, de porter au milieu de mes papiers le simulacre de quelque dieu, et de lui présenter mes dévotions aux jours de fête avec de l'encens, du vin pur et quelquefois des victimes. Aussi, du moment que j'ai entendu dire que par le plus insigne mensonge on parlait de squelette, j'ai chargé quelqu'un d'aller tout courant à l'hôtellerie où je loge, et de m'en rapporter le petit Mercure que Saturninus a fabriqué pour moi à Oea. Donnez : qu'ils le voient, qu'ils le tiennent, qu'ils le considèrent. Voilà, juges, ce que le scélérat appelait un squelette. Entendez-vous comme tous les assistants se récrient ? entendez-vous comme ils condamnent vos mensonges ? n'avez-vous pas enfin honte de tant de calomnies ? Est-ce là un squelette ? est-ce là un spectre ? est-ce là ce que vous affectiez d'appeler un symbole de démon ? est-ce là un emblème de magie, ou bien une image ordinaire et commune ? Prenez, je vous prie, Maximus, et contemplez : à vos mains si pures et si pieuses on peut confier un objet consacré. Voyez-vous comme cette petite figure est noble et pleine de cette vigueur que donne la palestre ! quelle sérénité dans les traits du dieu ! avec quelle grâce une barbe naissante encadre ses joues ! voyez sur sa tête ces boucles de cheveux frisés s'échappant des coins de son bonnet ! quelle élégance dans ces deux ailes bien symétriques qui ressortent au-dessus de ses tempes ! quelle aisance dans ce manteau qui se rattache au-dessus de ses épaules ! Oser dire que c'est là un squelette, c'est n'avoir jamais vu une image de dieu ou les mépriser toutes ; enfin, prendre cela pour un spectre, c'est en être un soi-même. Oui, Emilianus, puisse un tel mensonge attirer sur toi le courroux de cet intermédiaire divin, qui circule du ciel aux enfers ! puisse-t-il susciter contre toi les deux ordres de divinités ! puisse-t-il présenter sans cesse à tes regards tout ce qu'il y a d'ombres, de spectres, de mânes, de fantômes, et ces visions affreuses qu'on rencontre la nuit, qui font partout l'effroi des bûchers, la terreur des tombeaux ! Il est vrai que, par ton âge et par tes mérites, tu ne seras pas longtemps sans t'aller joindre à eux. Quant à nous, platonicienne famille, nos dogmes ne présentent que des idées de fête, de bonheur ; tout y est, solennel, céleste, divin. Il y a plus : dans nos études sublimes, nous nous élevons au-dessus des cieux-mêmes pour vivre à la surface des mondes extérieurs. Vous savez que je dis vrai, Maximus, vous qui dans le Phèdre avez remarqué cette expression : les espaces qui s'étendent au delà du ciel et sur sa convexité. Vous savez aussi très bien, pour que je réponde également à cette chicane de mots, quelle est la divinité appelée, non par moi le premier, mais par Platon, du nom de roi (βασιλεύς) : c'est la cause première de toutes choses ; c'en est la raison, l'origine essentielle ; c'est le père souverain des intelligences, le conservateur éternel des êtres, l'infatigable ouvrier de ce monde qu'il créa. Mais nul ne voit le travail de cet immortel artisan, la sollicitude de ce conservateur ; nul ne sait les mystères de sa fécondité créatrice ; il n'est assujetti ni aux lieux, ni aux temps, ni à aucune vicissitude : aussi est-il concevable pour peu de mortels, et pour tous, ineffable. Tu vois que je suis le premier à augmenter tes soupçons sur ma sorcellerie, Émilianus : je ne réponds pas à ta question, je ne te dis pas quel est ce roi que j'adore. Il y a plus : si le proconsul lui-même me demande quel est ce dieu, je me tairai. J'ai parlé sur cette affaire de nom autant que la circonstance le demandait. Reste un détail qui, je ne l'ignore pas, pique la curiosité de certaines personnes de l'assistance. Pourquoi ai-je voulu que ce symbole, au lieu d'être en argent ou en or, fût précisément fait en bois ? J'aime à croire que cette curiosité trouve son motif dans le désir que ces personnes éprouvent de s'instruire, plutôt encore que dans celui qu'elles ont de me trouver innocent ; car elles ne doivent plus conserver de doute après les victorieuses réfutations par lesquelles elles m'ont vu pulvériser toutes ces calomnies. J'en appelle donc à l'attention de ceux qui ont à coeur de s'instruire ; mais je réclame d'eux l'intérêt le plus vif et l'attention la plus soutenue, car je vais leur lire des passages empruntés au dernier livre des Lois, ouvrage de la vieillesse de Platon : «L'homme modéré dans sa conduite doit l'être dans les offrandes dont il fait hommage aux dieux. Ainsi, la terre, étant le foyer des domiciles, est sous l'invocation de tous les dieux, et ne doit pas leur être consacrée une seconde fois.» Ce passage a pour but de défendre aux hommes l'érection d'un temple privé : le philosophe pensait que les temples publics suffisent aux citoyens pour l'immolation des victimes. Ensuite il ajoute : «Dans les autres cités l'or et l'argent, chez les particuliers comme dans les temples saints, sont des objets d'envie ; l'ivoire, provenant d'un corps qui a eu vie, n'est pas une offrande convenable ; le fer et l'airain sont des instruments de guerre ; le bois, le bois seul peut servir à toutes les offrandes particulières que l'on voudra, et la pierre, pareillement, pour les temples publics.» L'assentiment général, illustre Maximus, et vous, ses assesseurs, rne prouve l'heureux effet de cette citation. C'est ainsi qu'en étant le guide de ma vie, Platon devient encore mon défenseur devant les tribunaux ; et l'obéissance que vous me voyez apporter à sa loi, fait ici ma sauvegarde. Maintenant il est temps que je passe à ma correspondance avec Pudentilla. Mais d'abord je reprendrai les choses d'un peu plus haut, afin qu'il soit bien démontré pour tous que loin d'avoir envahi la maison de Pudentilla dans des vues cupides comme ceux-ci le prétendent, j'aurais dû constamment fuir cette maison si j'avais songé le moins du monde à mes intérêts ; que, sous les autres rapports, ce mariage n'a pas été avantageux pour moi, et qu'il a fallu toutes les compensations que j'ai trouvées dans les vertus de ma femme pour qu'il ne me devînt pas fatal. Cette union est même l'unique base, à part une stérile jalousie, sur laquelle on ait pu fonder et l'accusation présente et les mille autres calomnies antérieures qui ont attaqué ma conduite. Autrement, quel motif aurait eu l'animosité d'Émilianus, même quand il aurait véritablement reconnu en moi un magicien ? A-t-il à me reprocher, je ne dis pas un seul fait, mais la moindre parole qui ait pu le blesser au point de lui paraître digne de provoquer un juste sentiment de vengeance ? Ce n'est pas non plus dans l'intérêt de sa gloire qu'il m'intente une accusation, comme M. Antoine en dirigea une contre Cn. Carbon ; C. Mutius, contre A. Albutius ; P. Sulpitius, contre Cn. Norbanus ; C. Furius, contre M. Aquilius ; C. Curio, contre Q. Metellus. Ces jeunes gens studieux, jaloux de se préparer une réputation, débutaient de celte manière au barreau, pour qu'un jugement célèbre les fit connaître de leurs concitoyens. Cette habitude, concédée chez nos ancêtres aux jeunes orateurs qui voulaient jeter de l'éclat sur la première fleur de leur talent, est depuis longtemps passée de mode ; et du reste, fût-elle encore en vigueur, Émilianus eût été loin de s'y conformer : c'est bien à un rustre et à un ignorant de faire parade d'éloquence ; à un grossier paysan d'ambitionner la gloire ; au vieillard, qui a déjà un pied dans la tombe, de débuter au barreau ! A moins que par hasard Émilianus, homme de principes austères, n'ait voulu donner l'exemple, et qu'indigné contre les maléfices seuls, il n'ait, en dressant cette accusation, obéi à la voix d'une conscience irréprochable. Mais j'aurais à peine cru à cette noble susceptibilité de la part de l'autre Émilianus, non pas de ce misérable habitant de l'Afrique que voici, mais d'Émilianus Scipion l'Africain, le Numantin, le Censeur ; ce n'est pas pour que j'y croie de la part de cette bûche, incapable je ne dis pas de détester, mais de comprendre ce genre de méfait. Que conclure donc ? c'est qu'il est démontré à tout le monde que l'envie seule, et nul autre motif, a déterminé cet homme, a déterminé Herennius Rufinus, son instigateur dont je parlerai dans un instant, et mes autres ennemis, à ourdir cette accusation calomnieuse de magie. Il est donc cinq points qu'il faut discuter ; car, si j'ai bonne mémoire, voici les griefs que l'on m'impute en ce qui concerne Pudentilla : d'abord, que n'ayant jamais voulu se remarier depuis la mort de son premier époux, ce sont mes enchantements qui l'y ont contrainte ; ensuite, que quelques-unes de ses lettres renferment des aveux à l'égard de mes maléfices ; en troisième lieu, qu'elle s'est remariée à soixante ans par libertinage ; en quatrième, que c'est dans une campagne, et non à la ville, que les publications de mariage ont été faites ; enfin le dernier grief, et le plus perfide de tous, porte sur la dot. C'est sur ce texte qu'ils se sont attachés à exhaler tout le venin de leurs calomnies : c'est là ce qui les suffoquait le plus. Ils ont prétendu que, dans les premiers jours de notre union, je profitai de l'amour de ma femme et de l'absence de tous témoins pour lui extorquer, à la campagne, une donation considérable. Rien n'est plus faux, plus chimérique, plus imaginaire. Je prouverai facilement et sans qu'il y ait réplique possible, qu'en vérité, Maximus, et vous, ses assesseurs, j'aurais plutôt à craindre que vous ne me soupçonnassiez d'avoir aposté un accusateur complaisant, et de lui avoir fait sa leçon pour me ménager une occasion de me justifier en public de soupçons jaloux. Croyez-moi, et les faits le démontreront : j'aurai plus de peine à prouver que ce n'est pas moi qui ai habilement monté une accusation aussi frivole, que je n'en aurai à vous convaincre de la sottise de mes calomniateurs. Maintenant je vais suivre rapidement l'ordre des griefs ; et je prétends forcer Émilianus à reconnaître que sa haine contre moi est sans motif ; il sera obligé de convenir qu'il s'est entièrement éloigné de la vérité. Veuillez donc, comme vous l'avez fait jusqu'ici, et plus religieusement encore s'il est possible, me prêter votre attention. Nous sommes à la source du procès, nous marchons sur le terrain fondamental de l'accusation. Émilia Pudentilla, aujourd'hui ma femme, a eu d'un certain Sicinius Amicus, son premier mari, deux fils, Pontianus et Pudens. Restée veuve avec ses deux enfants en bas âge qui retombaient sous la puissance de leur aïeul paternel, (car le père d'Amicus avait survécu à celui-ci), elle leur prodigua durant environ quatorze années les soins de la tendresse la plus édifiante. Ce n'était pourtant pas de son plein gré qu'à la fleur de ses ans elle se condamnait à un si long veuvage ; mais le grand-père des enfants voulait la donner, malgré elle, à un autre de ses fils, nommé Sicinius Clarus ; aussi écartait-il les autres prétendants, et en outre la menaçait-il, si elle se mariait dans une famille étrangère, de déshériter par testament les deux fils de la fortune de leur père. Voyant que c'était un parti obstinément arrêté dans l'esprit du vieillard, Pudentilla se montra femme de sens et à la fois bonne mère. Pour ne pas nuire de ce côté à ses enfants, elle consentit à des publications de mariage entre elle et ce Sicinius Clarus qu'on lui imposait ; mais en même temps, sous des prétextes imaginaires, elle en éluda toujours l'exécution, si bien que quand le grand-père de ses enfants vint à mourir, il avait institué ses deux petits-fils légataires de sa fortune, et Pontianus, qui était l'aîné, devint tuteur de son frère. Délivrée de ces appréhensions, Pudentilla, dont les hommes les plus importants recherchaient la main, résolut de ne pas vivre plus longtemps dans le veuvage : non qu'elle ne pût en supporter patiemment l'ennuyeuse solitude, mais elle voulait remédier au délabrement de sa santé. C'était une femme d'une sagesse exemplaire, qui durant un si long veuvage n'avait pas commis une seule faute, ni donné matière aux moindres propos ; or, ainsi privée du commerce conjugal, dont elle avait pris l'habitude, cette tempérance trop prolongée lui avait nui ; il y avait eu dépérissement dans ses organes, et souvent elle était prise de douleurs extrêmes qui la mettaient en danger de perdre la vie. Les médecins s'accordaient avec les sages-femmes pour dire que son mal tenait à la privation d'un époux ; que ce mal augmentait de jour en jour, qu'il prenait un caractère alarmant, et que profitant de quelques années qui lui restaient encore, elle devait réparer par le mariage une santé gravement compromise. Notez que ce conseil, unanimement approuvé, le fut par Émilianus entre autres ; et vous l'avez entendu, il n'y a qu'un instant, soutenir avec une fausseté et une impudence sans égales que Pudentilla n'avait jamais songé au mariage avant d'y avoir été contrainte par mes maléfices de sorcellerie ; que, seul, je m'étais trouvé qui eusse osé, par mes charmes et mes poisons, flétrir cette espèce de virginité, cette fleur de veuvage. J'ai souvent, et très judicieusement, entendu dire qu'il est bon pour un menteur d'avoir de la mémoire. Quoi donc, Emilianus, tu ne te souviens pas qu'avant mon arrivée à Oea tu voulais la marier ? que tu écrivis à son fils Pontianus, alors adulte et qui se trouvait à Rome ? Vous, passez-moi la lettre, ou plutôt donnez-la lui : qu'il lise lui-même et qu'il se condamne par ses propres paroles. (Ici, le commencement de la lettre d'Émilianus.) Est-ce bien là une lettre de ta main ? pourquoi cette pâleur ? car tu ne peux même pas rougir. Cette signature est-elle bien la tienne ? Lisez plus haut, je vous prie, afin que tous reconnaissent combien sa langue diffère de sa main, et comment elle est plus en contradiction avec lui-même qu'avec moi. (Suite et fin de la lettre.) As-tu bien écrit, Émilianus, ce qui vient d'être lu ? «Je sais qu'elle veut et doit se marier, mais qui elle choisira, je ne le sais.» Et en effet, tu ne le savais pas ; car Pudentilla, connaissant à merveille ta détestable malice, ne te parlait que de son intention sans te faire aucune confidence sur celui qui demandait sa main ; et toi, bien convaincu qu'elle finirait par épouser ton frère Clarus, et bercé de ce chimérique espoir, tu engageas son propre fils Pontianus à consentir aussi à ce qu'elle se remariât. Ainsi donc, si elle eût épousé Clarus, homme grossier et vieillard décrépit, tu conviendrais que sans l'intervention d'aucune magie il y avait longtemps qu'elle voulait se marier ; et parce qu'elle a choisi un jeune homme (puisque vous appelez ainsi son époux), il faut qu'elle y ait été contrainte, ayant d'ailleurs eu toujours, à ce que tu prétends, le mariage en horreur. Tu ne savais pas, misérable, qu'on possédait une lettre de toi sur cette affaire ; tu ne savais pas que tu serais convaincu par ton propre témoignage. Comme Pudentilla te connaissait aussi léger et capricieux que menteur et inconstant, elle se garda bien de se dessaisir de cette lettre où tu indiquais tes sentiments d'une manière si positive. Du reste, elle écrivit de son côté à Rome à son fils Pontianus touchant cette affaire, et lui développa longuement les motifs de sa résolution. Sa santé, disait-elle, était compromise ; nulle considération ne l'engageait à tarder désormais plus longtemps : pour assurer à ses enfants l'héritage de leur aïeul elle s'était imposé un long veuvage au préjudice de sa propre vie ; ses soins avaient augmenté encore leur fortune ; grâce au ciel, Pontianus était en âge de se marier, et son frère allait prendre la toge virile ; ils ne devaient donc pas trouver mauvais qu'elle mît un terme à son isolement et à ses souffrances. «Vous n'avez d'ailleurs, ajoutait-elle, rien à craindre de ma tendresse et de mes dernières volontés : telle j'étais pour vous durant mon veuvage, telle je serai après m'être remariée.» Je demanderai qu'on lise la copie de cette lettre adressée par elle à son fils. (Ici, la lettre de Pudentilla à son fils Pontianus.) Ces pièces me semblent prouver assez clairement au premier venu, que ce ne sont pas mes enchantements qui ont fait abandonner à Pudentilla ce veuvage obstiné, attendu que d'elle-même, et depuis longtemps, elle n'était pas éloignée d'un nouveau mariage. Peut-être eus-je le don de lui plaire mieux que les autres ; mais, lorsqu'il est question d'un choix si important pour une femme, je ne vois pas pourquoi de cette préférence on me ferait un crime plutôt qu'un honneur. De même je ne comprends pas pourquoi Émilianus et Rufinus seraient plus dépités du choix fait par Pudentilla que ne le furent les prétendants, qui ont su se résigner. D'ailleurs, dans ce choix elle a obéi à son fils plus encore qu'à sa propre inclination et c'est encore ce qu'Émilianus ne pourra nier. En effet, aussitôt que Pontianus eut reçu la lettre de sa mère, il accourut de Rome sans perdre un instant, dans la crainte que, si Pudentilla avait affaire à un homme avide, elle ne fit tout passer, comme souvent il arrive, dans la maison de son mari. Cette inquiétude ne le tourmentait pas médiocrement. Toutes les espérances de son frère et les siennes reposaient sur la fortune maternelle. Leur aïeul ne leur avait laissé que peu de chose, tandis que leur mère possédait quatre millions de sesterces, sur lesquels elle devait une somme à ses enfants, non en vertu d'un engagement écrit, mais sur une simple promesse de bonne foi, comme la chose devait être. Du reste, Pontianus n'exprimait ces craintes que tout bas, et il n'osait faire une opposition ouverte pour ne pas sembler méfiant. Les affaires en étaient là pour les projets de mariage de la mère et pour les inquiétudes du fils, lorsque, me dirigeant vers Alexandrie, le hasard ou ma destinée m'amena dans la ville d'Oea ; et si ce n'était par considération pour ma femme, je délirerais presque n'y être jamais venu. C'était pendant l'hiver, l.a fatigue du voyage m'avait rendu malade, et je passai un temps assez considérable chez d'illustres amis, les Appius (que je nomme ici par amour et par considération pour eux). Là, je reçus la visite de Pontianus ; car, peu d'années auparavant, nous nous étions connus à Athènes par l'entremise d'amis communs, et, ensuite, nous avions logé ensemble et vécu dans une étroite intimité. Déférences honorables, sollicitude pour ma santé, manège adroit pour me rendre amoureux, il employa tout, en homme qui comprenait avoir trouvé pour sa mère un mari comme il lui en fallait un, attendu qu'il n'aurait aucune inquiétude à voir entre mes mains toute celte fortune. D'abord, c'est indirectement qu'il sonde mes intentions. Voyant que je suis décidé à faire des voyages et non pas à me marier, il me prie de tarder au moins quelque peu, disant qu'il veut partir avec moi ; qu'en raison des bêtes féroces et des chaleurs des Syrtes, il vaut mieux attendre à l'hiver prochain, puisque la maladie m'a empêché de profiler de celui-ci. il fait plus : à force de prières il obtient des Appius, mes amis, la permission de me transférer dans la maison de sa mère, qui sera pour moi un séjour plus sain, et d'où je pourrai en outre contempler plus librement la pleine mer, que j'aime tant à voir. A force d'instances, il me fait passer par tout ce qu'il veut. Il me recommande sa mère et son jeune frère, celui qui est ici ; je leur donne quelques conseils pour leurs études communes ; bref, notre intimité ne fait que s'accroître. Cependant j'avais recouvré mes forces ; et, sur les instances de mes amis, je venais de prononcer une dissertation publique. Une foule nombreuse, réunie pour m'entendre, avait rempli la basilique où j'avais dû parler, et, entre autres marques unanimes d'enthousiasme, on m'avait supplié de me fixer dans la ville et de devenir citoyen d'Oea. La séance levée, Pontianus prend occasion de là pour m'attaquer : cet accord de la voix publique est pour lui un avertissement céleste, dit-il ; il a le dessein, si je n'y répugne pas, d'unir à moi sa mère, dont une foule de prétendants se disputent la main, parce que je suis le seul en qui il puisse avoir une entière confiance, une foi absolue. Si je veux me dérober à cette charge parce qu'on me propose, non pas une jeune et belle pupille, mais une femme de médiocre beauté et mère de deux enfants ; si de semblables considérations me déterminent à chercher ailleurs plus de charmes ou plus de richesses, il ne me tiendra ni pour son ami ni pour un vrai philosophe. Je n'en finirais pas si je voulais reproduire ici et mes réponses, et nos combats, et ses nombreuses et pressantes sollicitations. Bref, il ne me quitta que quand il eut triomphé. Ce n'était pas que je n'eusse parfaitement apprécié Pudentilla depuis plus d'un an que je vivais dans l'intimité de cette famille. J'avais reconnu de combien de vertus elle était dotée, mais ma passion dos voyages m'avait jusque-là fait reculer devant les embarras d'un hymen. Bientôt pourtant, je désirai aussi vivement m'unir à Pudentilla que si j'avais pensé à elle de moi-même. Pontianus avait pareillement persuadé sa mère de me préférer à tous les autres, et il brûlait d'une envie indicible de voir cette union se consommer. C'est à peine si nous obtenons de lui quelques jours de délai jusqu'au moment où il se sera lui-même marié le premier, et où son frère aura inauguré sa prise de robe virile. Nous ne voulions nous unir qu'après ces deux cérémonies. Hélas ! pourquoi faut-il que je ne puisse, sans compromettre ma cause, passer sous silence ce qui me reste désormais à dire ? Je ne semblerais pas blâmer la légèreté de Pontianus, au repentir de qui je pardonnai plus tard si sincèrement. Je dois donc convenir d'un fait qu'on m'a objecté. Aussitôt marié, il abjura cette bonne foi parfaite ; ses dispositions changèrent soudain ; et autant il avait mis auparavant de zèle à hâter notre mariage, autant il mit d'opiniâtreté à multiplier les obstacles. Enfin, plutôt que de le voir se consommer, il se montra disposé à tout souffrir, à tout faire. Un changement aussi scandaleux, une telle animosité contre sa mère, était-ce à lui qu'il fallait en reporter la faute ? Non ; c'était à son beau-père, à cet Herennius Rufinus, ici présent, qui n'a pas son pareil dans le monde entier en bassesse, en fourberie, en dépravation ; et je me vois obligé de faire en quelques lignes, et dans les termes les plus modérés qu'il me sera possible, le portrait de cet homme, parce que si je gardais un silence absolu sur son compte, ce ne serait pas le dédommager de toute la peine et des fatigues incroyables qu'il s'est données pour monter contre moi cette accusation. C'est lui, en effet, qui a excité cet enfant, qui a conseillé l'accusation, payé les avocats, soudoyé les témoins. Il est la fournaise où se chauffe toute cette calomnie ; il est le fouet, il est la torche d'Émilianus, et il se glorifie à outrance, auprès de qui veut l'entendre, d'avoir organisé contre moi toutes ces machinations. Et, par le fait, il y a là pour lui de quoi s'applaudir : nul ne rachète mieux des procès, n'invente mieux des mensonges, ne bâtit mieux des contes, n'est plus fécond en expédients maudits. L'âme de cet homme est une espèce de sentine, d'égout, de cloaque, où croupissent toutes sortes de passions et de débauches. Il était à peine né, qu'il était connu au loin pour mille genres d'infamies. Jadis, dans son enfance, avant que la perte de ses cheveux l'eût défiguré, il se prêtait avec une complaisance infâme à tous les désirs de ses amants ; plus tard, étant jeune homme, il figura dans des pantomimes ; sa danse était celle d'un homme qui n'a ni os ni nerfs, mais elle était flasque, sans goût et sans grâce ; car on prétend qu'il n'eut rien de l'histrion, si ce n'est l'impudicité. A l'âge même où le voici (les dieux le confondent, le misérable qui m'oblige à ménager les oreilles par des préambules oratoires !) sa maison n'est qu'un bouge infâme : tous ses esclaves sont corrompus ; lui, il fait le métier d'entremetteur, sa femme est une prostituée, ses fils lui ressemblent. Là, jour et nuit, les jeunes gens se donnent de joyeux rendez-vous ; ce sont des portes enfoncées à coups de pied, des chansons aux fenêtres, des buveurs qui font tapage, des lits dressés pour l'adultère ; car tout le monde peut y entrer hardiment, à charge toutefois de payer une redevance au mari, lequel exploite avec bénéfice le déshonneur de sa couche. Autrefois c'était sa personne, maintenant c'est celle de sa femme qu'il livre. Le plus souvent c'est avec lui-même, oui, avec lui-même, je ne mens pas, qu'on s'arrange pour tant de nuits de Madame. Il y a longtemps que l'on connaît comment elle et lui se partagent les rôles : si vous avez largement payé la femme, personne ne vous a vu, vous sortez quand bon vous semble ; si vous venez la bourse trop plate, à un signal donné l'on vous empoigne en criant à l'adultère, et, comme dans les écoles, vous ne pouvez partir qu'après avoir fait un corps d'écriture. Au fait, quelle autre ressource aurait ce malheureux ? Il a dévoré l'assez jolie fortune que lui avaient pourtant tout à coup fait trouver les escroqueries de son père. Celui-ci, ayant de gros intérêts à servir à ses nombreux créanciers, tint plus à leur argent qu'à son honneur. Comme de toutes parts on le poursuivait pour qu'il acquittât ses engagements, et comme il ne pouvait faire un pas dans la rue sans être arrêté par tout le monde ainsi que les aliénés : «Paix ! dit-il à la fin, je ne puis m'acquitter ; je vous abandonne mes anneaux d'or, les insignes de mon rang ; ça, mes créanciers, transigeons.» Cependant le rusé matois avait fait passer sur la tête de sa femme la plus grande parlie de ses biens ; et, réduit à l'indigence, à la nudité, il se couvrait du manteau de son infamie. C'est ainsi qu'il laissa à ce Rufinus, sans mentir, trois millions de sesterces à dévorer. Car de sa mère il lui était revenu tout ce bien-là parfaitement clair, sans compter ce que l'industrie de sa femme lui rapportait journellement. Et pourtant, au bout de peu d'années, ce glouton eut tout dévoré, tout dilapidé en débauches de tout genre : c'était à faire croire qu'il avait peur de devoir quelque chose aux escroqueries de son père : homme plein de justice et de moralité, il voulait que ce qui avait été mal acquis se dissipât de même. Ainsi, d'une fortune abondante il ne lui reste plus rien, qu'un misérable esprit d'intrigue et une insatiable voracité ; et, d'autre part, sa femme, qui se fait vieille et qui est usée, a dû renoncer enfin à son scandaleux commerce. Il n'avait plus de ressource que dans sa fille. Sur les conseils de sa mère il l'offrit, mais en vain, aux jeunes gens les plus riches, et il la confia même, à l'essai, à quelques prétendants. Avec des débuts pareils, si elle ne fût pas tombée sur un amoureux aussi accommodant que Pontianus, il est probable que, veuve avant d'être mariée, elle serait encore aujourd'hui chez ses parents. Pontianus, au mépris de toutes nos représentations, lui souscrit une promesse de mariage : formule bien illusoire dans l'espèce, car il savait parfaitement que la donzelle, avant qu'il l'épousât, avait été abandonnée par un jeune homme de grande maison à qui elle avait été fiancée et qui l'avait laissée là quand il s'était dégoûté d'elle. Mais enfin il l'épouse, et la voilà qui s'installe chez lui tranquillement et en femme décidée. Qu'as-tu, malheureuse, fait de ta pudeur ? Ta fleur est fanée, ton voile est flétri ; redevenue fille après avoir été récemment : répudiée, tu apportes le nom de vierge sans en avoir la pureté ! Elle arriva dans une litière à huit porteurs. Tous ceux qui étaient présents se la rappelleront : avec quelle impudence elle regardait à la ronde les jeunes gens ! Avec quelle immodestie elle provoquait l'attention ! Comme on reconnaissait bien l'école de la rnère dans le fard du visage de la fille, dans le vermillon de ses joues, dans le jeu agaçant de ses prunelles ! La veille précisément, un créancier avait fait main basse sur les trois quarts de sa dot, qui, du reste, était hors de proportion avec la ruine de cette famille et le nombre des enfants. Mais Rufinus, aussi peu fourni d'argent que de riches espérances, et dont l'avidité égalait la gueuserie, se voyait déjà bien gratuitement maître de la fortune de Pudentilla. Il songe d'abord à m'écarter, afin d'exploiter et la faiblesse de Pontianus et l'isolement de Pudentilla. Ensuite, il reproche à son gendre de m'avoir promis sa mère ; il l'engagea sortir au plus tôt de ce qu'il appelle ce mauvais pas, à veiller lui-même sur la fortune de sa mère plutôt que de la transmettre sans garantie à un étranger. Le vieux roué donne l'alarme au jeune amoureux, et menace, en cas de refus, d'emmener sa fille. Bref, ce jeune homme sans expérience, et qui était tout entier sous l'empire des charmes de sa nouvelle épousée, en passe par tout ce que l'on veut. Il va trouver sa mère, et répète la leçon que lui a faite Rufinus. Mais c'est en vain qu'il cherche à ébranler les résolutions de Pudentilla, qui, en femme grave, lui fait voir au contraire sa légèreté et son inconstance. Il revient mécontent chez le beau-père ; il lui raconte que sa mère, dont l'humeur est pourtant très douce et très égale, s'est mise en colère en entendant sa proposition, et qu'elle n'en persiste qu'avec plus d'opiniâtreté dans ses projets de mariage : «Je n'ignore pas, m'a-t-elle dit, que vous avez cédé aux instigations de Rufinus ; mais c'est une raison de plus pour que je me donne l'appui d'un époux contre son infâme avarice.» Ces paroles qu'on lui rapporte enflamment de rage ce complaisant de sa femme. Il entre dans une telle fureur, qu'en présence même du fils, il vomit sur la plus chaste et la plus pudique des mères des injures dignes du bouge qu'il habite, nous traitant, elle de débauchée, et moi de magicien, d'empoisonneur. Cent personnes, et je pourrai vous les nommer si vous le voulez, Maximus, l'ont de plus entendu crier à tue-tête que je ne périrais que de sa main. En vérité, j'ai peine à maîtriser moi-même ma colère, et l'excès de mon indignation est prêt à déborder. Toi, créature efféminée, toi, menacer un homme de lui donner la mort ! Avec quelle main, s'il te plaît ? Celle de Philomèle, de Médée, de Clytemnestre ? Mais quand tu danses ces rôles, telle est ta lâcheté, ta frayeur, que tu danses même sans l'inoffensif poignard de théâtre ! Mais ne nous laissons pas entraîner plus loin par cette digression. Pudentilla, gémissant de voir contre toute attente son fils si fâcheusement égaré, lui écrit de la campagne où elle était partie : elle lui adresse en forme de reproche cette fameuse lettre dans laquelle, à les entendre, elle avouait que mes enchantements avaient allumé son amour et égaré sa raison. Or, devant le greffier du tribunal, et devant Émilianus qui en faisait autant de son côté, nous avons pris avant-hier, par votre ordre, Maximus, une copie homologuée de cette lettre ; et l'on y trouve à chaque ligne le démenti de ce qu'ils ont avancé contre moi. Mais supposons que Pudentilla m'y traite positivement de magicien ; ne conçoit-on pas bien que, pour s'excuser auprès de son fils, elle ait pu prétexter mon ascendant plutôt que sa passion ? Phèdre est-elle la seule qui ait écrit un billet mensonger pour servir son amour ? n'est-ce pas un artifice habituel à toutes les femmes, d'aimer mieux paraître violentées quand elles ont conçu un désir de ce genre ? Supposons même qu'elle m'ait cru de bonne foi un magicien ; est-ce donc à dire que je serai un magicien parce que Pudentilla l'aura écrit ? Vous, qui multipliez les arguments, les témoins, les paroles, vous ne pouvez pas venir à bout de me convaincre de magie, et elle, d'un seul mot, y réussirait ! Un acte d'accusation est en définitive plus grave qu'une lettre particulière : c'est par mes actes, et non par les paroles d'un autre qu'il faut le justifier. Car enfin bien des hommes, à ce compte, seront traînés en jugement comme coupables de maléfices, si l'on regarde comme concluant tel ou tel passage d'une lettre écrite dans un moment d'amour ou de haine. Pudentilla écrit que vous êtes magicien, donc vous l'êtes. Quoi ! si elle eût écrit que je suis consul, je serais consul ! si elle eût écrit que je suis peintre, médecin ; si elle eût écrit enfin que je suis innocent ; le croiriez vous parce qu'elle l'aurait dit ? Non, sans aucun doute. Or, il est souverainement injuste d'accepter pour le mal un témoignage que l'on récuserait pour la justification ; et si une lettre peut perdre un homme, elle doit aussi pouvoir le sauver. - Mais elle était extrêmement agitée ; elle était folle de vous. - Je l'accorde pour un moment. Est-ce à dire que tous les hommes aimés par des femmes seront magiciens parce que ces femmes l'auront écrit ? D'ailleurs à cette époque Pudentilla ne m'aimait pas, puisqu'elle envoyait une lettre qui devait évidemment me faire du tort. En résumé, que prétends-tu ? était-elle folle ou dans son bon sens lorsqu'elle écrivait cette lettre ? Si elle était dans son bon sens, elle n'avait donc rien éprouvé de l'influence de la magie ; si elle était folle, elle n'a pas su ce qu'elle écrivait, et elle ne mérite aucune confiance. Il y a plus : si elle eût été folle, elle eût ignoré qu'elle l'était ; car comme c'est un trait de démence d'annoncer qu'on taira une chose et en même temps de la dire, de manière à se donner un démenti par le fait même, à plus forte raison est-il absurde de supposer qu'une personne dise : «Je suis folle», ce qui n'est pas vrai, du moment qu'elle le dit en connaissance de cause. C'est avoir son bon sens que de reconnaître la folie, attendu que la folie ne peut pas plus se sentir elle-même que la cécité ne peut se voir. Ainsi Pudentilla avait sa raison, par cela seul qu'elle croyait en avoir perdu l'usage. Je pourrais développer plus longuement cette thèse ; mais coupons court à cette dialectique. Je préfère lire la lettre même : Pudentilla y tient hautement un tout autre langage, et il semble qu'elle l'ait véritablement composée et écrite pour le procès. Prenez, vous, et lisez jusqu'à ce que je vous interrompe. (Le greffier lit la lettre de Pudentilla.) Suspendez un instant, pour ce qui reste à lire. C'est ici qu'il commence à y avoir divergence. En effet, jusqu'à cet endroit, Maximus, si j'ai bien remarqué, Pudentilla n'a prononcé nulle part le mot de magie. Elle a suivi l'ordre dans lequel je procédais tout à l'heure : elle a parlé de son long veuvage, du remède réclamé par sa santé, de son désir de se marier, de mon mérite que lui avait fait connaître Pontianus, des instances de ce dernier pour qu'elle préférât ma main : voilà, dis-je, ce qu'on a lu. Reste la fin de la missive, qui est pareillement rédigée en ma faveur, et que pourtant on retourne contre moi. Elle avait été écrite précisément pour me justifier du crime de magie, et grâce à l'incomparable habileté de Rufinus elle change de destination, et doit servir à confirmer l'opinion malveillante de quelques habitants d'Oea qui me tiennent pour magicien. Dans vos conversations, Maximus, dans vos lectures, par votre propre expérience, vous avez beaucoup appris ; mais pourtant vous conviendrez que jamais vous n'avez vu ruse aussi traîtreusement ourdie, perversité aussi étonnamment conduite. Jamais les Palamède, les Sisyphe, les Eurybate, les Phrynondas auraient-ils mieux inventé ? Oui, tous ces personnages que je viens de nommer, et tous ceux qui ont pu se faire un nom par leur habileté en fait de ruse, ne sont que des lourdauds et des imbéciles, comparés à ce seul Rufinus : c'est la fausseté en personne. Admirable fourberie ! subtilité digne de la prison et du supplice ! Comment croire qu'un écrit où je suis justifié ait pu devenir, sans qu'on y changeât un seul mot, une pièce qui m'accuse. Certes, c'est à n'y pas croire. Mais je veux montrer comment on a réalisé cette invraisemblance. La mère blâmait son fils de ce qu'après m'avoir présenté à elle comme un prétendant aussi recommandable qu'il l'avait fait, tout à coup, pour abonder dans le sens de Rufinus, il me traitait de magicien.Voici en quels termes était conçu le passage : «Apulée est un magicien, et j'ai été par lui ensorcelée. Eh bien, oui, je l'aime ; venez donc à moi, pendant que je conserve encore ma raison.» Or, Rufinus a isolé cette phrase, l'a séparée du reste de la lettre, et il l'a colportée comme un aveu de Pudentilla, la montrant à qui voulait la voir, en même temps qu'il promenait dans le forum Pontianus tout en larmes. Il faisait lire la lettre de la mère précisément a cet endroit. Tout ce qui était écrit au-dessus et plus bas, il le cachait, sous prétexte que c'étaient des turpitudes à ne pas montrer, et qu'il suffisait que l'on connût l'aveu de Pudentilla par rapport à mes maléfices. Que voulez-vous ? tout le monde trouva la chose vraisemblable : ces mêmes lignes qui avaient été écrites dans le dessein de me justifier, devinrent ma condamnation aux yeux des personnes crédules. Ce misérable se démenait d'ailleurs et vociférait en plein forum ; à chaque instant il ouvrait sa lettre en réclamant justice : «Apulée est un magicien, criait-il ; voici l'aveu de sa malheureuse victime. Que vous faut-il de plus ?» Personne ne se portait pour moi, personne ne s'avisait de lui répondre : «Donne la lettre entière, je te prie : permets que je voie tout, que je la lise d'un bout à l'autre. Bien souvent une imputation n'est calomnieuse que parce qu'on la produit isolément. Il n'y a pas de discours qui ne puisse être incriminé, si l'enchaînement en est détruit, si l'on en tronque le début, si l'on en supprime à plaisir telles ou telles phrases, si le passage ainsi dénaturé est lu avec l'accent de la conviction plutôt encore qu'avec celui du reproche.» Je ne saurais mieux démontrer avec quelle exactitude ces distinctions, et d'autres du même genre auraient pu être alléguées alors, qu'en reprenant de plus haut la lettre. Vérifie, Émilianus, si tu as bien exactement transcrit les mots dans ta copie homologuée. «Je voulais, pour les raisons que j'ai dites, prendre un mari ; c'est toi qui m'as engagée à choisir celui-ci de préférence à tout autre : tu ne parlais de lui qu'avec admiration ; tu n'aspirais qu'à le faire entrer par mon intermédiaire dans notre famille. Mais, depuis que des gens pervers et malintentionnés vous ont tourné la tête, voilà que tout à coup Apulée est devenu magicien, et que j'ai été par lui ensorcelée. Eli bien, oui, je l'aime ; venez donc à moi, pendant que je conserve encore ma raison.» En vérité, Maximus, si les lettres qu'on nomme des voyelles allaient d'elles-mêmes se combiner pour former des voix, si les mots volaient, comme disent les poètes, pensez-vous que quand Rufinus morcelait ainsi de mauvaise foi cette épître, n'en lisant qu'un seul passage et en omettant le plus grand nombre qui m'étaient favorables, pensez-vous que les autres lettres n'auraient pas crié qu'on les retenait criminellement ? les mots supprimés ne se seraient-ils pas échappés à tire d'aile des mains de Rufinus ? n'eussent-ils pas jeté le désordre dans le forum ? n'auraient-ils pas dit : «Nous aussi, nous avions été envoyés par Pudentilla pour compléter sa pensée. Cet homme est un traître et un faussaire, qui veut accréditer un mensonge par un témoignage altéré : ne le croyez pas ; fiez-vous plutôt à nous. Apulée n'a pas été accusé de magie par Pudentilla ; au contraire, elle l'a sur ce point justifié contre Rufinus» ? Bien que les voyelles et les mots n'aient pas tenu alors un pareil langage, néanmoins, à l'instant où ils peuvent m'être le plus utiles, vous voyez quelle lumière éclatante ils jettent sur cette correspondance. Oui, Rufinus, tes artifices sont déjoués, tes intrigues, démasquées, tes calomnies, découvertes ; la vérité, jusqu'ici méconnue, se produit en ce jour et se dégage en quelque sorte du fond de cet abîme de calomnies. Vous m'opposiez, en défi, la lettre de Pudentilla ; or cette lettre me donne la victoire ; car si vous voulez aborder le passage qui la finit, ce ne sera pas moi qui m'en plaindrai. Dites, dites comment termine sa lettre cette femme que j'ai ensorcelée, que j'ai rendue furieuse et folle par amour : «Non, je ne suis point ensorcelée : j'aime, et c'est mon destin qui l'a voulu.» En faut-il encore davantage ? Pudentilla vous désavoue ; elle défend d'une manière victorieuse sa propre raison contre vos calomnies. Les motifs raisonnables ou forcés de son mariage, elle les attribue au destin ; et le destin est bien éloigné de la magie, ou plutôt il la supprime entièrement. En effet, quelle puissance reste-t-il aux enchantements et aux maléfices, si la destinée de chaque mortel est un torrent impétueux qu'on ne peut pas plus arrêter que lancer ? Ainsi, par cette phrase, Pudentilla reconnaît non seulement que je ne suis pas magicien, mais encore que la magie n'existe pas. C'est un bonheur, que Pontianus ait gardé entière la lettre de sa mère ; c'est un bonheur, que vous ayez été emportés par votre précipitation à provoquer ce procès, puisque vous ne vous êtes pas laissé le temps de rien altérer dans celte pièce. C'est à vous, Maximus, qu'en est dû le bienfait : dès l'origine votre sagesse avait compris leurs infâmes manoeuvres ; et pour qu'ils n'eussent pas le temps de les affermir, vous en avez accéléré l'explosion : en ne leur accordant aucun délai, vous les avez ruinées. Supposons maintenant que cette mère eût fait par lettre à son fils l'aveu secret de son amour, comme il arrive souvent. Y avait il justice, Rutinus, (je ne parle pas de piété filiale), y avait-il seulement humanité à publier cette lettre ? était-ce à un fils surtout de la proclamer si hautement ? Mais je suis bien mal appris de vouloir que tu ménages la pudeur des autres, quand tu as perdu la tienne. Pourquoi d'ailleurs me plaindre du passé, lorsque le présent n'est pas moins amer ? Faut-il que ce malheureux enfant ait été par vous dépravé à tel point, qu'ayant à sa disposition ce qu'il croit être une épître amoureuse de sa mère, il vienne la lire tout haut devant le tribunal du proconsul, devant un magistrat irréprochable comme l'est Claudius Maximus, devant ces statues de l'empereur Pius ! Est-ce là qu'un fils doit reprocher à sa mère de honteux débordements et lui faire un crime d'aimer ? quel caractère assez doux ne s'en aigrirait ? Oses-tu bien, toi la dernière des créatures, interroger ici les sentiments secrets de ta mère, observer ses regards, compter ses soupirs et les battements de son coeur ? Est-ce bien ici que tu oses intercepter ses lettres et surveiller ses affections ? Prétends-tu donc espionner ce qu'elle fait dans sa chambre ? Mais, quand ce ne serait pas ta mère que tu accuses d'être amoureuse, c'est toujours une femme. Aucun respect ne s'attache-t-il à elle, à défaut même du titre de mère ? Malheureuses sont vos entrailles, ô Pudentilla ! ô que la stérilité serait préférable à une maternité comme celle-là ! Que funestes ont été les dix mois de votre grossesse ! que mal récompensées ont été les quatorze années de votre veuvage ! La vipère, dit-on, dévore les entrailles de sa mère pour venir ramper au jour, et c'est le parricide qui la fait naître ; mais voilà un fils qui, aujourd'hui adulte, vous déchire sans pitié toute vivante et sans craindre votre regard. Il dépèce votre silence, il outrage votre pudicité ; il fouille dans votre coeur ; il arrache et disperse vos entrailles. Ce sont là les actions de grâce que ce fils pieux offre à celle qui lui donna la vie, qui lui acquit un héritage, qui le nourrit et le soutint durant quatorze années. Malheureux ! faut-il que ton oncle t'ait élevé d'une manière telle que, si tu croyais avoir des fils semblables à toi, tu n'oserais pas te marier ! Un poète a dit, dans un vers bien connu : Loin de moi les enfants de précoce savoir. Mais qui n'aurait une haine et une aversion profonde pour un enfant de dépravation précoce ? Quoi de plus hideux qu'un monstre avancé dans le crime avant de l'être dans la vie ; scélérat avant d'être formé ; enfant pour la constitution, vieillard pour la malice ! Ce qui rend un tel être plus dangereux, c'est qu'il l'est impunément, et qu'à l'âge où il n'est pas mûr encore pour subir la peine, il l'est déjà pour commettre l'injustice. Que dis-je, pour commettre l'injustice ! pour se rendre coupable du crime le plus abominable de tous, crime affreux, crime qu'on ne saurait excuser, je veux dire l'impiété filiale. Les Athéniens se montrèrent plus respectueux pour le droit commun de tous les hommes. La correspondance de Philippe de Macédoine, leur ennemi, étant tombée entre leurs mains, elle fut lue en public ; mais ils défendirent la lecture d'une lettre écrite par le monarque à son épouse Olympias. Ils aimèrent mieux ménager un ennemi que de dévoiler les secrets conjugaux, et ils sacrifièrent au droit commun les intérêts de leur propre vengeance. Voilà ce que firent des ennemis à l'égard d'un ennemi ; et ici, que fait un fils à l'égard de sa mère ? Tu vois où je veux en venir par ce rapprochement. Oui, toi, fils, tu viens lire la correspondance de ta mère, une correspondance amoureuse, à ce que tu prétends ; tu viens la lire dans une assemblée où un sentiment de honte t'empêcherait de lire un poète trop lascif, même si l'on t'en donnait l'ordre. Mais tu n'aurais pas touché aux lettres de ta mère, si tu avais jamais goûté le charme des lettres. Parlerai-je maintenant d'une certaine épître écrite par toi-même sur le compte de ta mère, pièce remplie d'inconvenances, d'outrages, de turpitudes, que tu avais secrètement adressée à Pontianus, alors même qu'elle te nourrissait encore dans son sein ? As-tu bien osé livrer cette lettre à une lecture publique ? Tu as eu peur, sans doute, de n'être qu'une fois criminel et de faire perdre de vue ta bonne action. Misérable ! tu ne comprends pas que si ton oncle t'a laissé agir, c'était pour se justifier aux yeux des hommes, en prouvant par tes propres lettres qu'avant même de t'être retiré près de lui, lors même que tu caressais ta mère, tu étais déjà un hypocrite et un fils ingrat ; car, j'en suis convaincu, Emilianus n'est pas assez stupide pour croire que la lettre d'un enfant, le même qui se porte mon accusateur, puisse être une charge contre moi. Il existe encore une autre lettre par laquelle ils voulaient faire voir que j'ai cherché à flatter et à séduire Pudentilla. Je la déclare controuvée : elle n'est pas écrite de ma main ; elle n'a pas l'ombre de la vraisemblance. Pourquoi eusse-je recouru aux séductions, si j'avais confiance dans la magie ? D'ailleurs, par quelle voie leur est arrivée cette épître, que sans aucun doute j'ai dû envoyer à Pudentilla par quelque émissaire fidèle, comme il se fait d'ordinaire en pareil cas ? Pourquoi, en outre, aurais-je employé tant d'expressions vicieuses, de locutions barbares, moi qu'ils disent passablement exercé dans la langue grecque ? Pourquoi enfin aurais-je voulu lui monter l'imagination par des gaillardises inconvenantes et de mauvais lieux, moi qu'ils prétendent si habile en fait de vers amoureux et galants ? Oui, je le répète, l'épître est fabriquée : rien n'est plus visible ; et lui qui ne pouvait pas déchiffrer une lettre de Pudentilla, écrite en bien meilleur grec, a lu celle-ci, comme étant de sa façon, avec une facilité merveilleuse et avec les inflexions les plus capables de la faire valoir. J'en aurai dit assez sur ces lettres, si j'ajoute encore un seul mot. Quand Pudentilla eut envoyé celle où se trouvait cette phrase ironique et railleuse : «Venez pendant que je conserve encore ma raison», elle appela près d'elle ses deux fils et sa bru, et elle vécut avec eux environ deux mois. Qu'il dise, ce fils pieux, si durant ces deux mois il a vu sa mère agir ou parler avec inconséquence, en femme qui a perdu sa raison. Niera-t-il qu'elle vérifiât elle-même, avec une exactitude parfaite, les comptes de ses métayers, de ses bergers, de ses gens d'écurie ? niera-t-il que son frère Pontianus ait été par elle très sérieusement averti de se défier des intrigues du Rufinus ? niera-t-il qu'elle ait adressé à ce fils de trop justes reproches parce qu'il avait colporté une de ses lettres, sans mettre même de la bonne foi en la lisant ? niera- t-il que ce soit après tout cela que sa mère s'est mariée avec moi, dans une campagne dont la désignation avait été arrêtée longtemps à l'avance ? Il faut dire, en effet, que nous avions préféré nous marier ainsi à la campagne pour ne pas voir la population accourir à nos largesses une seconde fois, attendu que, peu de temps auparavant, Pudentilla avait, de son argent, distribué au peuple cinquante mille sesterces, le jour où Pontianus s'était marié et où cet enfant-ci avait revêtu la robe virile. De plus, nous voulions ainsi couper court à ces banquets nombreux et fatigants que, suivant l'usage, de nouveaux époux doivent presque toujours subir. Voilà, Émilianus, l'exposé complet des motifs qui nous déterminèrent, Pudentilla et moi, à signer notre contrat de mariage non à la ville mais à la campagne : nous ne voulions pas jeter encore par la fenêtre cinquante mille sesterces, nous ne voulions pas être obligés de souper avec toi ou chez toi. N'est-ce pas là une raison assez valable ? Je m'étonne, toutefois, de l'aversion si profonde que t'inspire la campagne, à toi qui vis presque toujours aux champs. La loi Julia, sur le mariage des différentes classes, ne prononce nulle part cette interdiction : «Ne vous mariez pas à la campagne.» Il y a plus : si tu veux savoir le vrai, on se marie, en vue d'avoir des enfants, sous des auspices bien plus heureux à la campagne qu'à la ville, sur un terrain fertile que sur un sol infécond, sur la pelouse des prairies que sur le pavé d'une place publique. Oui, que celle qui doit devenir mère prenne le nom d'épouse dans le sein même de la mère commune, parmi des blés mûrs, sur de riches sillons ; qu'elle se rapproche de son époux sous l'ombrage de l'ormeau marié à la vigne, au milieu des symboles de toute maternité, des végétaux qui se multiplient, des vignes qui poussent, des arbres qui germent. C'est bien ici le cas d'appliquer ce vers, si connu, de la comédie : Les enfants les plus beaux naissent à la campagne. Étudiez même les premiers âges de Rome : c'était dans les champs qu'on venait offrir aux Quintius, aux Serranus et à tant d'autres héros, non seulement des épouses, mais encore des consulats et des dictatures. Je m'arrête dans une matière si fertile en développements : je craindrais de te causer trop de plaisir en faisant l'éloge de la campagne. Pour ce qui est de l'âge de Pudentilla, tu as dit, poussant, après toutes tes manoeuvres, le mensonge jusqu'à l'impudence, qu'elle avait soixante ans lorsqu'elle s'est mariée. Je n'ai qu'un mot à répondre ; car dans une question aussi claire une longue discussion est chose superflue. Quand Pudentilla vint au monde, son père déclara sa naissance, suivant l'usage ordinaire ; et l'acte dressé à cette occasion existe aussi bien dans les registres publics que dans les papiers de la famille : on te les met sous tes yeux. Passez à Emilianus cet acte : qu'il en considère le lin, qu'il reconnaisse les cachets qui y sont apposés, qu'il vérifie la date des consuls, et qu'il fasse ses calculs. Il lui donnait soixante ans : qu'il en prouve seulement cinquante-cinq, et il aura déjà menti d'un lustre. Mais c'est peu ; j'agirai plus libéralement, car il a de lui-même gratifié Pudentilla d'un nombre d'années qu'il voudra bien reprendre à son tour. Oui, comme Ulysse, ce Mézence a fait une erreur de dix ans. Je le mets au défi de prouver seulement qu'elle ait la cinquantaine ; bref, poussant à bout ce multiplicateur faussaire, j'irai jusqu'aux vingt ans, et je les retrancherai tout d'une fois. Ordonnez, Maximus, que l'on fasse la supputation des consuls, et si je ne me trompe, vous trouverez qu'aujourd'hui Pudentilla n'a guère plus de quarante ans. O l'insigne fausseté, l'impudent mensonge, qui mériterait pour punition un exil de vingt ans ! Oses-tu bien, Emilianus, grossir de moitié le véritable chiffre, et compter un tiers en sus ! Si tu eusses dit trente pour dix, on aurait pu croire que l'erreur du calcul tenait à celle du geste, parce qu'au lieu d'arrondir les doigts, tu les aurais tenus ouverts. Mais le nombre quarante est celui qui s'exprime le plus facilement, car il s'indique par la main ouverte ; et quand tu l'augmentes de moitié, l'erreur ne peut tenir au geste de tes doigts. Peut-être, après tout, pensais-tu que Pudentilla n'a que trente ans, et n'as-tu compté double les années qu'à cause des deux consuls annuels. Je laisse ce point, et je passe maintenant à la base même de l'accusation, au prétendu crime de maléfice. Je somme Emilianus et Rufinus de répondre seulement à cette question : dans quel intérêt, fusse-je le plus grand magicien du monde, aurais-je, à force d'enchantements et de poisons, poussé Pudentilla à me donner sa main ? Je sais que quand on poursuit un homme pour un forfait et que l'on présente à l'appui quelque motif probable, cet accusé a pour se défendre un argument qui constitue à lui seul une défense suffisante : il peut représenter que sa vie tout entière a été pure de crimes de ce genre ; il peut dire qu'on ne doit pas tirer contre lui une conclusion accablante de ce qu'il a paru se produire quelque intérêt qui le sollicitât à mal faire, parce que tout ce qui peut advenir ne doit pas être considéré comme advenu ; que les chances des événements sont fort diverses en ce monde ; que la moralité d'un homme est le plus sûr indice, et que si quelqu'un a constamment persévéré dans le mal ou dans la vertu, ce doit être la raison la plus solide pour autoriser une accusation ou pour la faire rejeter. J'aurais le droit de me prévaloir de ces considérations ; mais je vous en fais grâce. A mes yeux, ce n'est pas assez de me justifier amplement de tous les griefs que vous m'imputez, si je ne vous empêche aussi d'établir sur une base quelconque le plus léger soupçon de maléfice. Reconnaissez combien je suis fort de mon innocence et combien je méprise vos attaques : si vous trouvez un seul motif, fût-il des plus frivoles, qui ait pu me faire rechercher la main de Pudentilla en prévision d'un intérêt quelconque, si vous prouvez qu'il soit résulté de ce mariage le moindre avantage en ma faveur, eh bien ! je consens à être un Carinondas, un Damigéron, le fameux Moïse, un Jannès, un Apollonius, un Dardanus même, ou n'importe quel autre devenu populaire depuis Zoroastre et Hostanes. (On murmure.) Voyez, je vous prie, Maximus, quel tapage ils viennent de faire, parce que j'ai passé en revue les noms de cinq ou six magiciens. Comment dois-je faire avec des gens si grossiers, si barbares ? Dois-je leur apprendre encore, que ces noms et une foule d'autres ont été tirés par moi des plus illustres auteurs dont les bibliothèques publiques contiennent les ouvrages ? Dois-je faire remarquer qu'autre chose est de connaître les noms, autre chose de se livrer à la même science, et que des citations dues à un peu de mémoire et d'érudition ne sauraient être considérées comme l'aveu d'un crime ? Dois-je (et c'est de beaucoup le parti le plus sage) m'en rapporter à vos lumières, Claudius Maximus, à votre parfaite érudition, et dédaigner de répondre à ces clameurs d'une coterie grossière et ignorante ? C'est à quoi je me déterminerai de préférence : qu'ils pensent ce qu'ils voudront, je ne m'en inquiéterai nullement. Je reprends l'argumentation que j'avais commencée pour établir que je n'ai eu aucun intérêt à solliciter par des enchantements la main de Pudentilla. Ils ont été les premiers à signaler d'une manière désobligeante l'extérieur et l'âge de la femme que j'épousais ; puis, ils m'ont accusé de n'avoir recherché une semblable union que par avidité, et d'avoir conséquemment, dès nos premières entrevues, fait disparaître la dot, qui était des plus considérables. Pour répondre à cela, Maximus, je n'ai pas l'intention de vous fatiguer d'un long discours. A quoi bon les paroles, lorsque les pièces elles-mêmes parlent beaucoup plus éloquemment ? Vous verrez, par les dispositions que j'ai prises pour le présent et par celles que j'ai préparées pour l'avenir, combien mes intentions sont opposées aux vues d'intérêt et de rapacité qu'ils me prêtent. D'abord, celte femme si étonnamment riche ne m'a apporté qu'une modique dot ; encore ne l'a-t-elle pas donnée, mais seulement promise. En outre, il a été convenu que si elle mourait sans avoir eu d'enfants de moi, cette dot retournerait tout entière à ses fils Pontianus et Pudens ; mais que si au jour de sa mort elle laissait un enfant, de l'un ou de l'autre sexe, issu de notre mariage, la moitié de la dot serait pour cet enfant et l'autre moitié pour les deux fils du premier lit. Ce que je dis, je le prouverai en montrant les actes. Peut-être, même à la suite d'une semblable déclaration, Émilianus ne peut-il se résigner à croire qu'il y ait eu trois cent mille sesterces seulement portés au contrat, et qu'il ait été stipulé un droit de retour au profit des fils de Pudentilla ? Eh bien, prends toi-même ces actes ; de tes propres mains ; présente-les à ton conseiller Rufinus, pour qu'il les lise ; qu'il rougisse de son insolence et de son intrigante mendicité, lui qui, gueux et à peine vêtu, a doté sa fille de quatre cent mille sesterces par lui empruntés à un tiers. La riche Pudentilla s'est contentée de trois cent mille ; et le mari qu'elle a, après avoir plus d'une fois dédaigné des dots autrement considérables, s'est trouvé satisfait de cet apport illusoire, attendu qu'il ne voit dans cette union rien autre chose que la femme, attendu qu'à ses yeux tous les plus beaux biens, meubles et immeubles, sont suffisamment remplacés par la sympathie et la vive tendresse de sa compagne. D'ailleurs, pour peu qu'on ait d'expérience, comment oserait-on trouver mauvais que voulant se marier, une veuve, d'une beauté passable et d'un âge qui déjà ne l'est plus, eût proposé une grosse dot et des conditions séduisantes à un homme jeune, dont l'extérieur, l'esprit, la fortune ne sont pas à dédaigner ? Une belle vierge, fût-elle pauvre, est néanmoins assez richement dotée, puisqu'elle offre à son nouvel époux sa candeur native, la grâce de ses charmes, la fleur de sa virginité ; et ce dernier trésor est celui dont tous les maris sont à bon droit le plus jaloux. En effet, quelque autre bien que votre femme vous ait apporté en dot, vous pouvez, s'il vous plaît de ne plus rester enchaîné par un bienfait, le restituer intégralement comme vous l'aviez reçu : l'argent se rembourse, les esclaves se renvoient, on déloge d'une maison, on abandonne un domaine. La virginité seule, une fois qu'elle a été reçue, ne peut plus se rendre : c'est, de tous les biens dotaux, le seul qui reste au pouvoir du mari. Une veuve, au contraire, se sépare de son époux telle qu'elle était venue à lui ; elle ne lui apporte rien qu'elle ne puisse réclamer : c'est une fleur qu'un autre a déjà cueillie. En tout cas, vous n'avez rien à lui apprendre pour les désirs que vous manifestez ; son nouveau séjour lui est aussi suspect qu'elle doit l'être elle-même en raison de son premier mariage. Si c'est la mort qui l'a rendue libre, il semble que ce soit une femme de fâcheux présage, dont l'union porte malheur et dont il ne faut pas rechercher la main ; si c'est un divorce, elle ne peut échapper au dilemme qui la proclame ou insupportable, puisqu'elle a été répudiée son mari, ou trop exigeante, puisqu'elle l'a abandonné. Ces considérations et d'autres expliquent pourquoi les veuves offrent des dots si considérables à qui veut les épouser ; et c'est ce qu'avec un autre prétendu aurait fait Pudentilla, si elle n'avait trouvé un philosophe qui ne s'inquiétait pas de la dot. Mais allons plus loin : si c'eût été par amour de l'argent que je recherchais Pudenlilla, pouvais-je rien faire de mieux, afin de devenir maître chez elle, que de semer des germes de discorde entre la mère et les enfants ? que de lui aliéner la tendresse de ses fils, afin de pouvoir seul, d'une manière plus libre et plus sûre, posséder une femme isolée des siens ? N'est-ce pas la conduite qu'eut tenue un brigand, comme vous voulez me faire paraître ? Eh bien, moi, j'ai toujours prêché la paix et l'union ; j'ai tout fait pour l'établir, pour la prolonger. Loin de semer de nouvelles haines, j'ai extirpé radicalement les vieilles inimitiés. J'ai conseillé à ma femme dont, à les entendre, j'avais dévoré déjà toute la fortune, je lui ai conseillé, dis-je, et je lui ai persuadé de satisfaire sur-le-champ ses deux fils qui redemandaient la somme dont j'ai parlé précédemment, et de les payer en immeubles qui ont été estimés au-dessous de leur valeur et au prix par eux-mêmes fixé. En outre, sur ses propres biens elle leur a donné des champs d'excellent rapport, une vaste maison garnie avec abondance, une grande quantité de blé, d'orge, de vin, d'huile et d'autres denrées ; un nombre d'esclaves qui ne s'élève guère à moins de quatre cents ; de plus, des troupeaux nombreux et d'une grande valeur. C'est sur ma demande qu'elle leur a fait ces largesses, pour les contenter d'abord par ce fait seul, et ensuite pour les rassurer pleinement sur le reste de la succession. Oui, voilà ce que j'ai obtenu de Pudentilla ; et ce ne fut (elle me permettra de dire toute la vérité) ce ne fut qu'avec une peine extrême : il me fallut de très instantes prières pour triompher de sa résistance, de son mécontentement, de son courroux. Ce fut moi qui réconciliai la mère avec ses deux enfants ; et mon premier acte de beau-père fut d'enrichir mes beaux-fils d'une somme considérable. C'est un fait connu de la ville entière. On ne tarissait pas de malédictions contre Rufinus, d'éloges sur mon compte. Il est bon de uavoir qu'avant que cette donation de leur mère fût consommée, Pontianus était venu nous trouver, en compagnie de ce frère qui lui ressemble si peu. Il s'était roulé à nos pieds, en sollicitant le pardon et l'oubli de tous ses torts passés : il fondait en larmes, il nous baisait les mains, il nous exprimait quel était son repentir d'avoir écouté Rufinus et consorts. Après quoi, il me supplia instamment de le justifier aussi dans l'opinion de Lollianus Avitus, à qui je l'avais recommandé peu de temps auparavant à l'occasion de ses débuts au barreau ; car il avait su que j'avais tout récemment fait part de sa conduite à ce magistrat. Il obtient encore de moi cette grâce : je lui donne une lettre, et il part pour Carthage, où Lollianus Avitus, ayant presque terminé le temps de son consulat, attendait votre arrivée, illustre Maximus. A la lecture de ma lettre, Lollianus, dont l'indulgence est sans bornes, félicita Pontianus de n'avoir pas tardé à réparer ses erreurs, et il m'écrivit une réponse dont il le chargea. Quelle lettre, grands dieux ! jamais on ne vit plus d'instruction, d'aménité, plus d'élégance et de grâce dans le choix des mots ; c'était bien le vir bonus dicendi peritus, «l'honnête homme éloquent». Je suis convaincu, Maximus, que vous entendrez cette pièce avec plaisir ; et pour une semblable lecture, je veux la faire moi-même. Qu'on me passe ma correspondance avec Avitus : elle fut toujours un titre d'honneur pour moi ; qu'elle devienne aujourd'hui ma sauvegarde. Greffier, je vous autorise à laisser couler l'eau de la clepsydre ; car, quelque temps que dût prendre cette lecture, je relirais bien volontiers trois et quatre fois les lettres d'un si excellent personnage. (Ici devrait figurer la lettre de Lollianus Avitus.) En vérité, après une pareille lettre d'Avitus je devrais terminer ma défense ; car produirai-je jamais un plus brillant panégyriste, un garant plus sacré de ma vie entière, un avocat plus éloquent ? J'ai connu dans le cours de ma vie bien des personnages du nom romain, dont le talent oratoire était remarquable ; mais je n'ai professé pour personne une pareille admiration. Non, autant que j'en puis juger, il n'y a pas aujourd'hui d'orateur, quel que soit son mérite ou son avenir, qui ne préférât de beaucoup être Avitus, s'il voulait établir entre lui-même et ce dernier un parallèle dégagé de jalousie. Les qualités qui constituent l'art oratoire, et elles sont presque différentes les unes des autres, se trouvent presque toutes réunies en ce personnage. Quel que soit le discours qu'Avitus aura composé, il présentera d'un bout à l'autre les caractères de la perfection la plus accomplie : ce sera la gravité de Caton, la douceur de Lélius, l'entraînement de Gracchus, le pathétique de César, la disposition d'Hortensius, la dialectique de Calvus, la sobre énergie de Salluste, la richesse de Cicéron. Enlin, sans que je passe en revue tous les genres de qualités oratoires, quand on a entendu un discours d'Avitus on ne souffrirait pas que rien y fût ajouté, retranché, ou même légèrement modifié. Je vois, Maximus, avec quelle complaisance vous écoutez l'énumération de ces mérites où vous reconnaissez votre ami Avitus. Votre bonté m'a enhardi à lui consacrer, en passant, cet hommage ; mais je n'abuserai pas plus longtemps de vos dispositions favorables : je ne me permettrai pas, presque épuisé comme je le suis et au moment où mon plaidoyer touche à sa fin, d'entreprendre ici l'éloge de ses rares vertus ; c'est un texte que je réserve pour une circonstance où j'aurai toutes mes forces et tout mon loisir. Maintenant en effet, et c'est ce qui m'afflige, il faut que de la mention d'un si grand homme je descende à ces misérables calomniateurs. Est-ce donc à dire, Émilianus, que tu oses te comparer avec Avitus ? Celui qu'Avitus proclame homme de bien, à la moralité de qui par cette lettre il rend un hommage si complet et si flatteur, toi, tu l'accuseras de maléfices et de magie ! En supposant que j'eusse envahi la maison de Pudentilla et que j'eusse pillé ses biens, as-tu le droit de t'en indigner plus que ne se serait indigné Pontianus ? Or ce dernier, après une inimitié passagère, provoquée, du reste, par vos instigations, me justifia, même sans que je fusse présent, auprès d'Avitus ; il exprima devant ce grand homme toute la gratitude qu'il m'avait vouée. Suppose que j'eusse lu le récit de ce qui s'est passé en présence d'Avitus, et non pas sa lettre : de quoi pourrait-on, toi ou tout autre, m'accuser en cette affaire ? Pontianus lui-même reconnaissait être redevable d'avoir rencontré un beau-père tel que moi. Pourquoi le ciel n'a-t-il pas permis qu'il revînt de Carthage en bonne santé ! ou, si tel était l'arrêt prononcé contre lui par les destins, pourquoi l'as-tu, Rufinus, empêché d'exprimer son suprême jugement ? Quelles vives expressions de reconnaissance, soit en public, soit dans son testament, il m'aurait prodiguées ! Du moins me reste-t-il de lui les lettres qu'il m'adressa de Carthage, au moment où il venait d'y arriver à la suite de son voyage et lorsqu'il était encore robuste ; j'en ai d'autres qu'il m'écrivit aussi lorsqu'il était déjà malade ; toutes sont pleines de respect, pleines de tendresse. Je vous prie, Maximus, d'en autoriser un instant la lecture, pour que ce frère indigne, aujourd'hui mon accusateur, apprécie à quelle lointaine distance il suit dans la route du beau et de l'honnête les traces d'un jeune homme de si vertueuse mémoire. (Le greffier donne lecture de quelques lettres de Pontianus.) As-tu entendu les noms que me donnait ton frère Pontianus, m'appelant son père, son maître souverain, son instituteur ? et c'était surtout vers les derniers temps qu'il me prodiguait ces noms. Je pourrais produire des lettres semblables écrites par toi-même, si je pensais qu'elles valussent les instants qu'exigerait cette recherche. Ce que j'aimerais mieux présenter, ce serait plutôt le testament nouveau de ton frère, tout incomplet qu'il est, testament où il me mentionne dans les termes les plus affectueux et les plus honorables. Mais Rufinus a intercepté cet acte : il n'a permis ni de le produire ni de l'achever : tant il avait de dépit et de honte de voir cet héritage perdu pour lui ! Et certes, pour les quelques mois qu'il a été beau-père de Pontianus, c'était là évaluer à un prix assez honnête les nuits de sa fille. En outre, il avait consulté je ne sais quels Chaldéens sur le moyen le plus avantageux de placer cette même fille ; on m'assure qu'ils lui avaient répondu (hélas ! ils n'ont que trop dit vrai !) que son premier mari mourrait au bout de quelques mois. Quant à l'héritage, ils avaient, suivant leur habitude, arrangé leur réponse d'après le désir de celui qui les consultait. Mais, grâce au ciel, comme un stupide animal, sa gueule s'est vainement ouverte ; car Pontianus ayant, pour le plus grand dommage de la fille de Rufinus, apprécié ce qu'elle était, non seulement se garda bien de l'instituer son héritière, mais encore ne lui réserva pas le moindre legs tant soit peu honorable : il ne l'inscrivit que pour le lot ignominieux de quelque peu de linge, s'élevant à deux cents deniers environ ; et il prouva ainsi que c'était une exhérédation motivée par un mécontentement réel plutôt qu'une omission causée par l'oubli. Dans ce testament, comme dans le premier dont lecture a été faite, il a institué pour ses héritiers sa mère et son frère. C'est pour cela, Maximus, comme vous le voyez, que Rufinus cherche à manoeuvrer auprès de ce frère, qui n'est encore qu'un enfant, et qu'il veut lui donner cette même créature. Elle est de beaucoup plus âgée que lui, elle était tout récemment la femme de son frère : n'importe, il la jette à la tête de ce malheureux enfant et veut la lui mettre dans son lit. Pudens, de son.côté, s'était laissé prendre aux caresses de cette péronnelle ainsi qu'aux lacs tendus par le père entremetteur ; et à peine son frère avait-il rendu le dernier soupir, qu'abandonnant sa mère il alla loger chez son oncle, pour exécuter plus à l'aise, en se débarrassant de nous, un si beau dessein. Car Émilianus favorise le beau-père, et veut une part du gâteau... (Mouvement.) Fort bien ! Vous avez raison de m'avertir. Oui, ce cher oncle aussi ménage et soigne dans son neveu de douces espérances, parce qu'il sait que si Pudens meurt intestat, il héritera de lui, sinon d'après l'équité, du moins aux termes de la loi. Certes, je n'aurais pas voulu qu'une pareille manifestation partît de moi ; j'ai trop de modération pour avoir songé à caractériser d'une manière aussi nette les soupçons que tout le monde a conçus. C'est mal à vous, assistants, de me souffler ainsi. Mais si tu veux savoir la vérité, Emilianus, on s'étonne généralement de la tendresse subite dont tu as été saisi pour cet entant depuis la mort de son frère Pontianus, tandis qu'auparavant tu le connaissais à peine et si peu. Souvent, lorsque vous vous rencontriez, tu ne reconnaissais même pas à son visage le fils de ton frère : aujourd'hui, au contraire, rien n'égale les attentions que tu lui prodigues ; et telle est ta complaisance à le corrompre, ta docilité pour ses moindres fantaisies, que ce changement seul serait de nature à justifier les soupçons. Tu l'as reçu de nous avec l'innocence du premier âge, tu l'as bientôt rendu trop parfaitement instruit. Quand c'était nous qui le dirigions, il allait assidûment aux écoles : il les fuit maintenant du plus loin qu'il les voit, pour entrer dans les mauvais lieux. Il dédaigne l'amitié des personnes sérieuses : c'est avec des jeunes gens du plus bas étage, au milieu des femmes de mauvaise vie et des verres, qu'un enfant de son âge se livre aux plaisirs de la table. Chez toi c'est lui qui règle la maison, qui commande aux esclaves, qui préside aux festins. Il n'y a pas non plus de spectacles de gladiateurs où on ne le voie constamment. Il sait les noms des combattants ; il juge les coups, les blessures, et il profite avec une docilité d'enfant des honorables leçons que lui donne le laniste lui-même. Il ne parle plus jamais qu'en carthaginois, si ce n'est le peu de grec qu'il a retenu du temps où il était auprès de sa mère ; mais pour parler latin, il ne le veut pas, et il n'en est pas capable. Vous l'avez entendu s'exprimer tout a l'heure, Maximus : n'est-il pas scandaleux que mon beau-fils, le frère d'un jeune homme aussi instruit que l'était Pontianus, ait pu bégayer à peine quelques syllabes, quand vous lui demandiez si sa mère leur avait réellement fait donation des biens que je déclarais leur avoir été sur ma demande concédés par elle ? Eh bien, je vous atteste, Claudius Maximus, et vous ses assesseurs, vous tous aussi qui vous trouvez avec moi dans l'enceinte de ce tribunal, je vous atteste que ces déplorables résultats de l'éducation la plus ignoble sont dus à son oncle que vous voyez, et à son beau-père, qui étale ici sa robe blanche. Mais je ne serai plus assez bon pour me désoler dorénavant de ce qu'un pareil beau-fils a secoué le joug de ma tutelle ; désormais je ne supplierai plus sa mère en sa faveur. Car il est une circonstance qui m'était sortie presque tout à fait de la mémoire. Dernièrement, et depuis la mort de son fils Pontianus, Pudentilla se sentant malade fit son testament, et longtemps je m'opposai à ce qu'elle déshéritât son fils pour tant d'outrages et d'injustices. Déjà, je le jure, elle avait écrit tout au long les motifs de cette grave détermination ; à force de prières, j'obtins qu'elle les supprimât, la menaçant même de ne plus rester auprès d'elle si elle n'y consentait pas. «Faites-le pour moi, lui dis-je ; il faut triompher d'un fils ingrat à force de bienfaits, et ôter à mon rôle tout ce que les apparences pourraient me prêter d'odieux.» Je n'eus pas de cesse qu'elle n'eût ainsi fait. Je regrette d'avoir tiré cette épine du pied à Émilianus et de lui avoir indiqué la trace de ce sentier sur lequel il ne comptait pas. Voyez, je vous prie, Maximus, comme mes paroles l'ont soudain frappé de stupeur, et comme il a baissé les yeux à terre. Il était persuadé que les choses s'étaient passées tout autrement, et cela se conçoit : il savait la mère outrée des insolences de son fils et enchaînée à moi par mes bons procédés. De moi pareillement il avait à craindre : tout autre à ma place, même en méprisant comme moi cet héritage, n'aurait pas refusé l'occasion de punir cependant un aussi indigne beau-fils. C'est principalement cette inquiétude qui les a poussés à formuler contre moi une accusation. D'après leur avidité personnelle ils ont conclu, faussement, qu'il avait été disposé de toute la succession en ma faveur. Eh bien, soyez par moi délivrés de vos appréhensions pour ce qui est du passé ; car mes principes ne sont pas de nature à m'avoir jamais fait fléchir devant l'espoir d'un héritage ou devant l'occasion d'une vengeance. Moi, beau-père, j'ai soutenu les intérêts d'un ingrat beau-fils auprès de sa mère irritée, avec autant de chaleur qu'un père l'eût fait pour un excellent fils auprès d'une marâtre. Il y a plus : j'ai comprimé, au delà de ce que l'équité exigeait, les dispositions généreuses manifestées en ma faveur par la plus tendre des épouses. Passez-moi le testament fait par Pudentilla lorsqu'elle avait déjà à se plaindre de son fils, testament dont tous les mots ont été dictés par mes prières, par les prières de celui qu'ils appellent un brigand ! Faites-en rompre les cachets, Maximus : vous verrez que Pudens y figure comme héritier. Quant à moi, il m'est légué je ne sais quelle bagatelle, et seulement par convenance : afin que si un malheur arrive à Pudentilla, je sois du moins inscrit dans le testament avec le titre de son époux. Prends ce testament de ta mère, Pudens ; c'est bien vraiment celui-là qui est inofficieux ; car elle y déshérite un mari dévoué, pour léguer sa fortune à un fils qui la déteste ; ou plutôt, non : ce n'est pas à son fils qu'elle la lègue, c'est aux espérances d'Émilianus, au mariage arrangé par Rufinus, à cette troupe d'ivrognes, tes parasites. Prends, dis-je, ô le meilleur des fils ; laisse un instant de côté les billets amoureux de ta mère, lis de préférence son testament, pour voir si tu ne trouveras pas dans la rédaction quelque preuve de sa folie. Effectivement, tout d'abord on y lit ces mots : «J'institue Sicinius Pudens, mon fils, pour mon héritier.» Je l'avoue, cette disposition seule peut faire croire à sa folie. Quoi ! prendre pour héritier ce fils qui, au moment même des funérailles de son frère, appela une poignée de jeunes libertins et voulut vous chasser de la maison que vous-même lui aviez donnée ! qui se montra mécontent et furieux de ce que son frère vous eût instituée son héritière conjointement avec lui ! qui vous abandonna brusquement, au milieu de vos larmes et de votre désespoir, pour voler de vos bras auprès d'un Rufinus et d'un Émilianus ! qui plus tard vous prodigua les injures en face et vous outragea, assisté de son oncle ! qui a colporté votre nom devant les tribunaux ! qui a cherché à flétrir publiquement votre honneur par votre correspondance intime ! qui a intenté une accusation capitale au mari de votre choix, à l'homme que lui-même proclamait chéri tendrement de vous ! Ouvre donc, je t'en prie, ouvre ce testament, fils dévoué : tu pourras plus facilement ainsi démontrer la folie de ta mère. Pourquoi ces hésitations et ces refus, maintenant que tu as banni toutes tes craintes au sujet de l'héritage maternel ? Pour moi, Maximus, je jette l'acte ici même à vos pieds, et je proteste que je ne m'inquiéterai plus désormais le moins du monde des dispositions testamentaires que pourra prendre Pudentilla. Il se chargera lui-même à l'avenir de désarmer, comme bon lui semblera, le courroux de sa mère. Il m'a mis dans l'impossibilité de pouvoir dorénavant solliciter en sa faveur. C'est à lui maintenant, puisqu'il est son maître, puisqu'il est un homme, de dicter à sa mère les lettres les plus acerbes et de calmer son courroux. Puisqu'il a pu plaider contre moi, il pourra bien la fléchir. Quant à moi, mon but sera atteint si non seulement j'ai repoussé avec un plein succès les accusations qu'on m'intentait, mais encore si j'ai pulvérisé complètement la question qui faisait le fond de ce procès, à savoir l'odieux soupçon d'avoir voulu capter un héritage. Pour ne rien passer sous silence, je prétends encore, avant de terminer, faire voir combien la dernière de vos imputations est calomnieuse. Vous avez dit qu'avec les capitaux considérables de ma femme j'avais acheté sous mon nom une propriété magnifique. Je réponds que cette magnifique propriété est un modique héritage de soixante mille sesterces, et qu'encore elle a été achetée non par moi, mais par Pudentilla, et sous son nom. Oui, je dis que c'est le nom de Pudentilla qui figure dans l'acte ; que les droits de vente sur cet immeuble sont payés au nom de Pudentilla. Ici est présent l'officier public entre les mains de qui en a été fait le payement ; c'est l'honorable Corvinus Celer ; ici pareillement est le tuteur de Pudentilla, celui qui l'a autorisée à cette acquisition, homme grave et consciencieux, que je ne dois nommer qu'avec toutes sortes d'éloges, Cassius Longinus. Demandez à l'un d'eux, Maximus, quel domaine il a autorisé d'acquérir, et à l'autre pour quel prix modique la riche Pudentilla est devenue propriétaire de ce bout de champ. (Ici le témoignage de Cassius Longinus le tuteur, et de Corvinus Clémens le récupérateur des impôts.) Est-ce bien comme ]'ai dit ? Mon nom figure-t-il quelque part dans l'acte d'acquisition ? Le prix de cette mince propriété est-il scandaleux ? M'a-t-elle seulement fait cette modique donation ? Reste-t-il encore quelque imputation qu'à ton sens, Émilianus, je n'aie pas réfutée ? Quel fruit as-tu trouvé que j'aie recueilli de mes opérations magiques ? Dans quels desseins aurais-je cherché à captiver l'âme de Pudentilla par des maléfices ? Quel avantage en devais-je retirer ? Celui, sans doute, de recevoir d'elle une dot plutôt médiocre que considérable. Beaux maléfices, en vérité ! Était-ce pour arriver à ce qu'elle stipulât que sa dot serait réversible sur ses fils au lieu de rester en ma possession ? Qu'ajouter à une semblable magie ! Était-ce pour qu'elle fit à ses enfants l'abandon de la plus grande partie de ses biens, lorsque, avant de m'épouser, elle ne leur avait fait aucun avantage, et pour qu'elle ne me réservât rien ? Est-ce là, je le demande, de la magie ténébreuse, ou un bienfait payé d'une noire ingratitude ? Une mère irritée fait son testament, et néanmoins c'est un fils coupable qu'elle institue son légataire plutôt que moi qui ai lié ma destinée à la sienne. Certes, il a fallu de la magie pour obtenir à grand'peine un semblable résultat ! Supposez que la cause se plaide, non devant Claudius Maximus, magistrat plein d'équité et inébranlable défenseur de la justice, mais devant quelque autre juge pervers et cruel ; supposez à ce magistrat de la partialité pour les accusateurs et une soif de condamnations ; donnez-lui des faits à suivre ; offrez-lui la moindre occasion vraisemblable de rendre un arrêt conforme, à ses désirs ; imaginez du moins, forgez quelque réponse aux questions qu'il vous adresserait en ce sens. Et puisque toute entreprise doit être précédée d'un motif quelconque, répondez vous autres qui dites qu'Apulée a eu l'intention d'agir sur Pudentilla au moyen d'enchantements magiques. Que voulait-il d'elle ? pourquoi a-t-il agi ainsi ? La recherchait-il pour sa beauté ? Non, dites-vous. Était-ce pour sa fortune ? Non, répondent et le contrat de mariage, et l'acte de donation et le testament : toutes ces pièces établissent que, loin d'avoir fait preuve d'avidité, il a repoussé énergiquement les offres libérales de sa femme. Quelle autre cause l'a donc fait agir ?... Vous gardez le silence, vous restez muets. Où est ce début terrible de la plainte formulée par vous au nom de mon beau-fils : «J'entreprends, seigneur Maximus, d'accuser Apulée devant votre tribunal.» Pourquoi ne pas ajouter : «J'entreprends d'accuser mon maître, d'accuser mon beau-père, d'accuser celui qui pour moi a fléchi ma mère» ? Je continue : «de l'accuser d'une foule de maléfices plus évidents les uns que les autres.» Eh bien ! produisez, dans cette foule de maléfices si évidents, produisez-en un seul qui laisse le moindre doute, ou même la moindre obscurité. Quant aux autres griefs que vous m'avez imputés, voyez un peu si mes réponses sont précises : «Vous rendez brillantes vos dents. - J'ai le droit d'être propre. - Vous regardez des miroirs. - Un philosophe le doit. -Tous faites des vers. - C'est permis. - Vous étudiez les poissons. - Aristole l'enseigne. - Vous consacrez du bois. - Platon le conseille. - Vous prenez femme. - Les lois l'ordonnent. - Votre femme est votre aînée. - La chose est commune. - Vous avez agi par cupidité. - Qu'on prenne l'acte de mariage, qu'on se rappelle la donation, qu'on lise le testament.» Si j'ai complètement repoussé toutes les attaques et réfuté toutes les calomnies ; si j'ai placé mon honneur à l'abri, non seulement de toute accusation, mais encore de tout propos injurieux ; si, loin de laisser attenter aux droits de la philosophie, qui me sont plus chers que l'existence, je les ai au contraire entourés d'une barrière inviolable ; si les choses sont comme je le dis, j'ai, dans ma respectueuse confiance, plutôt à espérer, Seigneur, votre estime personnelle qu'à redouter votre toute-puissante décision. Car je regarderais comme moins pénible et moins honteux pour moi d'être ici condamné par le proconsul que d'encourir l'improbation de l'homme éminemment bon et irréprochable. J'AI DIT.
|