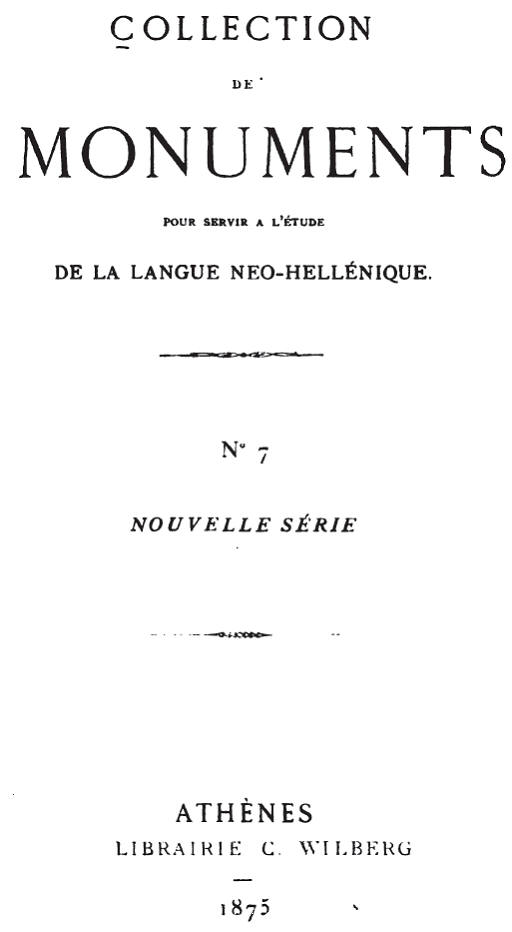
THEODORE PRODROMOS
POEMES
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
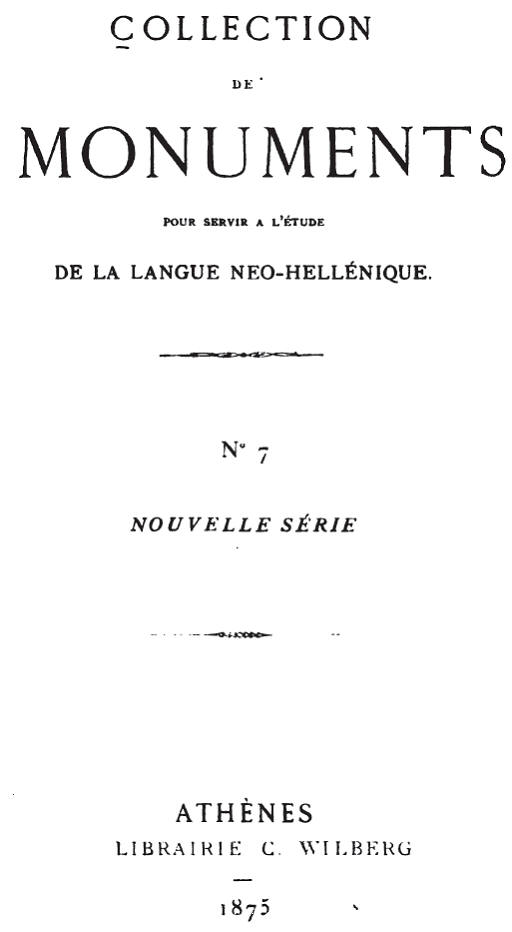
THEODORE PRODROMOS
POEMES
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
On se rappelle cette charmante épître où Marot raconte à François Ier comment il a été volé par son laquais. Je citerai le commencement :
On
dit bien vray, la mauvaise fortune
Ne vient jamais qu'elle n'en apporte une,
Ou deux, ou trois avecques elle, Sire.
Vostre cueur noble en saurait bien que dire.
Et moy chetif, qui ne suis Roy, ne rien,
L'ay esprouvé, et vous compteray bien,
Si vous voulez, comment vint la besongne.
J'avois un jour un valet de Gascongne,
Gourmant, yvrogne, et assuré menteur,
Pipeur, larron, jureur, blasphémateur,
Sentant la hart de cent pas ä la ronde;
Au demeurant, le meilleur filz du monde.
Ce dernier vers, comme on sait, est devenu proverbe.
Non pas que je trouve un rapport quelconque entre la cour de François Ier et celle des Comnènes; encore moins que je veuille comparer Marot avec Théodore Prodrome. J'ai seulement l'intention d'établir qu'à différentes époques, dans les nations civilisées, les souverains ont presque toujours toléré chez leurs poètes favoris une certaine liberté de langage, descendant quelquefois jusqu'à la familiarité. Cette petite précaution oratoire m'a paru nécessaire pour expliquer et même pour justifier les détails qui vont suivre.
On trouvera sans doute que ces détails manquent de noblesse et qu'ils sont même parfois bien vulgaires. Mais nous sommes au xiie siècle, à la cour de Byzance, et il s'agit d'un poêle famélique qui fait bon marché de sa dignité personnelle pour obtenir des secours de son puissant protecteur. Les mœurs et les usages à la connaissance desquels il nous initie permettent d'étudier la nature de ses relations avec le souverain et de comparer sa situation sociale avec celle des poètes de cour dans les temps modernes.
Théodore Prodrome a eu le privilège d'occuper les loisirs de plusieurs éminents critiques : Léon Allatius, La Porte du Theil, Boissonade, le cardinal Maï et surtout le célèbre Coray. Ce dernier lui a même consacré le premier volume tout entier de ses Atacta. Deux poèmes en langue vulgaire de Prodrome, qu'il avait trouvés dans la Bibliothèque nationale de Paris, lui ont fourni l'occasion de faire un travail des plus intéressants au point de vue philologique. On sait combien sont rares les monuments de ce genre, surtout ceux qui remontent au xiie siècle de notre ère. J'ai eu moi-même la bonne fortune d'en découvrir deux, je pourrais dire trois autres, en recueillant de divers côtés les poésies inédites de cet écrivain. Un de ces poèmes présente un intérêt tout particulier, en ce qu'il nous donne des détails curieux et tout à fait nouveaux sur la vie intime du poète byzantin.
Les renseignements biographiques qui le concernent se réduisaient à peu de chose. Coray ne savait même pas que Théodore Prodrome était déjà célèbre du temps de Jean Comnène, père de Manuel. Nous devons la connaissance de ce fait aux pièces de vers publiées par le cardinal Maï, d'après un manuscrit du Vatican. Les nouveaux poèmes, dont je m'occupe en ce moment, viennent le confirmer.
Il y a plus de vingt ans que j'en ai fait la copie. J'étais alors attaché au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. En m'occupant de Théodore Prodrome j'avais été conduit à lire quelques lettres de lui qui ont été publiées par le P. Pierre Lazeri.[1] Comme je n'y avais rien trouvé qui concernât la vie du poète byzantin je voulus m'assurer si le fonds grec de la bibliothèque n'en contenait pas d'autres. La table du Catalogue imprimé ne m'en indiqua point, mais en parcourant les diverses notices qui lui sont consacrées, je trouvai à la fin de celle du n° 396 le dernier article (33°) ainsi conçu : « Theodori Prodromi ad Imperatorem epistolae très, hactenus ineditae. » Je pris ce volume, et je constatai une erreur singulière. Il ne s'agissait pas de lettres, mais de trois poèmes vulgaires dans le genre de ceux qu'a publiés Coray. Les vers sont écrits comme de la prose, c'est ce qui a trompé l'auteur de la notice imprimée dans le Catalogue. Je m'explique comment Coray ne les a pas connus. Ils ne sont pas indiqués dans la table, et l'eussent-ils été sous la désignation de epistolae, il est probable que l'illustre savant n'y aurait pas fait attention.
Ce manuscrit, d'un très petit format, n'a pas moins de 695 pages. Il est en papier coton et paraît avoir été écrit vers la fin du xiiie siècle. Il contient une collection d'opuscules de différents genres, et dont on trouvera le détail dans la notice imprimée, opuscules parmi lesquels figurent d'autres poésies de Théodore Prodrome. Dans quelques parties l'écriture, qui est assez correcte, a disparu par suite de l'humidité.
Les poèmes en question sont adressés :
Le premier à Jean Comnène;
Le second à l'empereur;
Le troisième au Sébastocrator Andronic Comnène, le second des fils de Jean.
Je laisse provisoirement de côté le premier. Le second porte simplement πρὸς τὸν βασιλέα, à l'empereur. Il est naturel de penser qu'il s'agit encore de Jean Comnène, car si ce poème était adressé à Manuel, son fils et son successeur, il est probable qu'on aurait indiqué dans le titre le nom de ce dernier prince. Ajoutons que le Sébastocrator auquel est dédiée la troisième pièce était mort avant le couronnement de Manuel. Tout concourt donc pour nous faire supposer que le second poème est adressé également à Jean Comnène. Nous allons raisonner dans cette hypothèse.
Il commence ainsi : « Quand j'étais petit, mon vieux père me disait : « Mon enfant, apprends les lettres, autant que tu pourras, etc., etc. »
On reconnaît ici la partie du premier poème publiée par Coray, qui commence au v. 55. Il s'agit, en effet, de la même pièce, refaite en grande partie et dédiée à un autre personnage.
Un heureux hasard, en nous conservant deux rédactions différentes du même poème, nous révélerait un détail intéressant. Voici, en effet, ce qui aurait pu arriver. Théodore Prodrome aurait adressé une épître en vers à Jean Comnène, qui mourut d'un accident à la chasse, en 1143. Ce serait la pièce que j'ai retrouvée. Plus tard il la refait, y ajoute de nombreux détails et la dédie au nouveau souverain, Manuel Comnène, qui sans doute ignorait l'hommage fait à son père. C'est le poème publié par Coray. A une époque où l'imprimerie n'existait pas, un pareil fait était possible, bien qu'il s'agît d'un poète alors très célèbre. La pièce aurait pu servir deux fois, parce que probablement elle avait été donnée d'abord confidentiellement, comme celle dont nous nous occuperons bientôt. Elle n'avait pas été publiée, c'est-à-dire des copies n'en avaient point circulé. Théodore Prodrome avait eu une si grande réputation comme poète et comme savant, qu'après sa mort toutes ses poésies, tous ses ouvrages ont été recueillis avec le plus grand soin, et c'est ainsi que nous est parvenue la pièce en question, sous deux formes et avec une destination différente. Le proverbe bien connu Tirer d'un sac deux moutures a toujours trouvé et trouvera toujours son application.
Nous avons raisonné dans l'hypothèse que le poème est adressé à Jean Comnène; mais une difficulté se présente, difficulté grave dont je ne m'étais pas aperçu, parce que je m'en étais tenu d'abord aux premiers vers. Elle m'a été signalée par M. E. Legrand. Th. Prodrome mentionne dans ce poème les μανολάτα, c'est-à-dire les pièces d’or à l'effigie de Manuel. Ce dernier a-t-il pu faire frapper des monnaies à son nom du vivant de son père? Là est toute la question. Sur certaines monnaies il porte le titre de ΔΕΣΠΟΤΗΣ, titre qui à cette époque, il est vrai, était souvent donné aux membres de la famille impériale. Mais Théodore Prodrome, dans le courant du poème, en appelant le souverain δέσποτα, semblerait prouver que ce titre s'appliquait aussi à l'empereur. A moins que ce terme ne doive être pris ici que comme une expression poétique marquant la toute-puissance et qui est aussi très souvent employée quand on s'adresse au Christ. Dans un autre endroit le mot δέσποτα est accompagné de l'épithète στεφηφόρε, ce qui semblerait mettre la question hors de doute.
Une autre supposition peut être faite. Nous ne possédons pas le manuscrit original de Th. Prodrome. Lorsque plus tard il a voulu faire servir une seconde fois le poème en question, il a dû le corriger, et il y avait peut-être d'abord dans la première rédaction un mot rappelant une pièce de monnaie ayant cours pendant le règne de J. Comnène, mot qu'il aura remplacé par le terme μανολάτα, et naturellement un copiste en transcrivant la pièce aura mis la correction et non la première leçon. On pourrait en dire autant de στεφηφόρε. Mais il vaut mieux nous en tenir au fait lui-même.
La numismatique byzantine ne fournit aucune pièce de Manuel Comnène qui puisse être antérieure à son avènement au trône. Aussi il me semble plus probable que βασιλέα, qui se trouve dans le titre de la pièce, s'applique plutôt à ce dernier prince qu'à son père Jean,
Un autre détail à relever. A l'époque où il s'occupait de la première rédaction de ce poème il faisait partie du clergé grec, chez lequel s'étaient réfugiées la science et la littérature. Il était papas et portait les habits ecclésiastiques. Il est singulier qu'il ne parle ni de sa femme ni de ses enfants, car, comme nous le verrons plus loin, il avait été marié et père de famille. La vie de Théodore Prodrome est remplie d'obscurités.
Quoi qu'il en soit, que le poème soit adressé à Jean ou à son fils Manuel, il n'en est pas moins curieux parce qu'il nous donne l'ébauche, la rédaction première de celui qui, plus détaillé et plus complet, a été publié par Coray. La comparaison entre ces deux rédactions présente un grand intérêt au point de vue philologique, je veux dire pour l'étude de la langue vulgaire.
Du reste, nous allons donner le texte avec la traduction française en regard. On pourra la comparer avec la seconde rédaction fort mal publiée par Coray dans ses Atacta, ouvrage qui est devenu d'une excessive rareté.
Je n'ai pas voulu entreprendre un travail de ce genre sans m'aider des conseils et de l'expérience consommée de M. E. Legrand, dont tout le monde connaît les remarquables publications sur la langue et la poésie vulgaires des Grecs. Je savais qu'il s'occupait de traduire en français les deux poèmes publiés par Coray. J'ai pensé que ceux que j'ai découverts lui revenaient de droit. Il s'est empressé d'accepter la lâche que je lui offrais. Il a donc traduit celte première rédaction.
Voici d'abord cette rédaction avec la traduction française en regard. Nous donnerons ensuite de même les deux autres poèmes dont j'ai publié dernièrement[2] une analyse détaillée.
Mais auparavant je dois déclarer que j'assume seul toute la responsabilisé au point de vue du système suivi pour l'élision. M. E. Legrand et moi nous avons des principes différents que nous exposerons ailleurs, chacun de notre côté.
Lorsque j'étais petit, mon vieux père me disait : « Mon enfant, apprends les lettres autant que tu pourras. Tu vois bien un tel, mon enfant? Il allait à pied, et maintenant il possède un cheval à deux pectoraux et se promène sur un mulet gras. Lorsqu'il étudiait, il n'avait pas de chaussures, et maintenant, tu le vois, il porte des souliers à longue pointe. Lorsqu'il étudiait, il ne se peignait jamais, et aujourd'hui c'est un beau cavalier à la chevelure bien soignée. Lorsqu'il étudiait, jamais il ne vit la porte d'un bain, et maintenant il se baigne trois fois la semaine. Son sein était plein de poux gros comme des amandes, et maintenant il est rempli de pièces d'or à l'effigie de Manuel. Suis donc les conseils de ton vieux père et consacre-toi tout entier à l'étude des lettres. »
El j'appris les lettres avec beaucoup de peine ; mais, depuis que je suis un simple ouvrier en littérature, je désire et le pain et la mie du pain. J'insulte la littérature, je dis avec larmes : « O Christ, maudites soient les lettres et maudit celui qui les cultive ! Maudits le temps et le jour où l'on m'envoya à l'école pour apprendre les lettres et tâcher d'en vivre ! »
Si alors on eût fait de moi un ouvrier brodeur en or, un de ceux qui gagnent leur vie à confectionner des habits brodés, si j'eusse appris la profession de brodeur, profession si méprisée, j'ouvrirais mon armoire et j'y trouverais en abondance du pain et du vin, du thon apprêté, des morceaux de palamide, des maquereaux et de leur fretin salé, tandis que, quand je l'ouvre, je regarde toutes les tablettes, et je vois des sacs de papier pleins de papiers. J'ouvre mon petit coffre, espérant y trouver un morceau de pain, et j'y trouve un autre tout petit sac de papier. J'ouvre ma valise, je cherche ma bourse, je la tâte pour voir si elle contient des écus, et elle est bourrée de papiers. Après avoir fouillé dans tous mes recoins, je demeure soucieux et abattu, le cœur me manque, je tombe d'inanition. Et, dans l'excès de ma faim et de ma détresse, je préfère aux lettres et à la grammaire le métier de brodeur.
Par votre chef impérial, Sire, que me répondez-vous à cela? Si j'ai un voisin qui soit père d'un garçon, irai-je lui dire : « Fais-lui apprendre les belles-lettres pour vivre? » Si je ne lui disais pas : « Fais apprendre la cordonnerie à ton enfant, » tout le monde m'appellerait tête sans cervelle.
Oyez le genre de vie d'un cordonnier, et apprenez comment chaque jour il se nourrit et se repose. J'ai pour voisin un savetier, une sorte de pseudo-cordonnier; c'est un amateur de bons morceaux, un joyeux viveur. Aussitôt qu'il voit poindre l'aurore : « Mon fils, dit-il, fais bouillir de l'eau. Tiens, mon enfant, voici de l'argent pour acheter des tripes, en voilà d'autre pour avoir du fromage valaque; puis donne-moi à déjeuner, et alors je vais ressemeler. »
Quand il a bâfré tripes et fromage, on lui donne quatre grandes rasades; il les boit et il rote, puis on lui en verse une autre encore. Mais, Sire, lorsque vient l'heure du dîner, il jette sa forme, il jette sa planchette, l'alène, le tranche! et le tire-pied, et il dit à sa femme : « Maîtresse, dresse la table. Mels pour premier plat du bouilli, pour second une matelote, pour troisième un ragoût, mais veille à ce qu'il ne bouille point. »
Quand on a servi, il se lave et s'assied. Malédiction! Lorsque je me retourne, Sire, et que je le vois assis devant ces victuailles, cela me met la salive en mouvement et elle coule comme un ruisseau. Quant à lui, il s'emplit la bouche et bâfre ce qu'on lui a cuisiné. Moi, je vas et viens, comptant les pieds de mes vers; lui, il boit son saoul de doux vin dans un grand gobelet. Moi, je cherche l'ïambe, je cherche le spondée, je cherche le pyrrhique et les autres mètres. Mais à quoi me servent ces mètres, lorsque la faim me consume? Quel habile artisan que ce cordonnier! Il a dit son Bénédicité, et il s'est mis à triturer. Et moi, infortuné! combien de vers me faudra-t-il dire, combien m'en faudra-t-il écrire et des meilleurs, combien en devrai-je débiter, avant que mon gosier soit complètement guéri?
Et moi aussi, j'ai essayé de la cordonnerie, non pas pour me rassasier de pain de gruau, mais de ce pain bis, dit de moyenne qualité, qui fait envie aux grammairiens et aux versificateurs de talent. Après maintes recherches, j'ai trouvé une menue monnaie, et je l'ai donnée pour prix d'une alène de cordonnier; et, comme mes chaussures étaient toutes déchirées, je me mis à les rapetasser un peu. Je me donnai un coup d'alène à la main, et je déguerpis; mais de ce coup il me vint une enflure à la main, et je passai tout un mois à l'hôpital.
Ma pauvreté est telle, monarque couronné, que, malgré moi, je ne cesse de porter envie aux manouvriers.
Il me semble que, si je savais le métier de tailleur, une aiguille de la valeur d'un tournois, quelques sous de fil et une paire de petits ciseaux feraient de moi un maître de maison. S'il n'y avait pas de couturière de par le monde, et qu'une voisine déchirât sa robe, elle m'appellerait aussitôt : « Ici, l'ouvrier, viens ici! raccommode-moi ma robe, et prends ce qui t'est dû. »
Si j'étais mitron ou domestiquefine fleur de farine, qu'elle tenait à la main. Et moi, la faim m'ayant fait chasser bien loin toute vergogne, j'entrai aussitôt et je lui dis : « Madame, madame la boulangère, je ne sais pas votre nom, allons, donnez-moi aussi à croquer un peu de ce bon pain. » Mais la triple misérable ne me répondit même pas. Alors, à la vue de son indifférence et de son manque d'égards, gémissant et attristé, je pris une autre rue.
Si j'étais marchand de petit-lait, je vendrais du petit-lait; je porterais sur mon dos une calebasse de petit-lait, je dirais, je crierais de toute ma force, en me promenant : « Femmes, prenez du pétillait! » Et, comme elles en ont besoin, je le vendrais promptement.
Si j'eusse appris le métier de teinturier en soieries, si j'étais portefaix, je travaillerais toute la journée comme crocheteur, et, le soir, on me donnerait un bon gros morceau, du vin plein mon petit gobelet blanc et une grasse portion de ragoût; et, même les jours de chômage, je recevrais des fausses-côtes, que je croquerais bruyamment, comme ce serait mon droit.
Si j'eusse appris à faire des tissus et des moulins à poivre, je crierais en marchant, en me promenant par les rues : « Dames et ouvrières, bonnes maîtresses de maison, approchez-vous, prenez des étoffes pour tentures et mes moulins à poivre pour broyer votre poivre. » Et, comme il y a quelques bonnes maîtresses de maison, elles me prendraient mes tissus et mes moulins à poivre ; je les vendrais promptement et je m'en retournerais avec joie. Mais, à bien considérer mes affaires et le bonheur dont je jouis, lors même que je saurais tisser des étoffes, je chercherais encore mon pain !
J'ai pour voisin un fabricant de cribles ; nous ne sommes séparés que par une cloison. Je vois souvent son âtre flamboyer, et il s'en exhale une pénétrante odeur de viandes ; je vois pareillement, Sire, griller des multitudes de poissons sur ce terrible brasier. Et moi, je grille pour du pain ; j'en demande et l'on ne m'en donne pas; mais tout le monde m'insulte et m'injurie; on me dit : « Mange tes livres et t'en rassasie, mon papas. Que les lettres te nourrissent, pauvre hère! Tire ton habit ecclésiastique et fais-toi manœuvre. »
Je vous demande votre avis, Sire ; que me conseillez-vous? Faut- il ôter mon habit ecclésiastique et me faire manœuvre ? J'espère que, grâce à votre pitié, je me débarrasserai de mes dettes, qu'on me laissera tranquille, et que je ferai des vœux du fond de mon cœur pour que, très puissant monarque, vous étendiez sur terre et sur mer le sceptre de votre empire.
La pauvreté me fait souvent blasphémer, et on me dit : « Fais attention de ne pas tant parler, de crainte que, après ta mort, tu ne sois condamné au ver qui ne dort pas, au tartare, aux ténèbres. » Mais, ô maître du monde, ces trois supplices-là, je les endure ici, et avant mon trépas. Ce ver qui ne dort pas, c'est, à mon avis, la pauvreté qui me dévore et me consume sans relâche ; le tartare, c'est le grelottement dont je grelotte maintenant, comme dans les frimas de l'hiver, car je n'ai rien pour me vêtir, et, si l'on n'a rien à se mettre au dos, on grelotte terriblement. Quant aux ténèbres, ô mon maître, c'est le vertige qui me prend toujours, Sire, quand je n'ai pas de pain, car, si je n'ai rien à manger, j'ai la berlue et je tombe. Voilà, mon empereur, mon maître couronné, voilà, comme je l'ai dit, et les ténèbres profondes, et le tartare et le ver.
Puisse le souverain maître, le Christ sauveur des hommes, puisse-t-il, grâce à vos dons généreux, me délivrer de ma misère présenté et vouloir bien être de nouveau mon libérateur !
La seconde épître en vers est adressée au sébastocrator. Cherchons d'abord quel est le personnage désigne sous ce titre.
Jean Comnène avait quatre fils :
1° Alexis, l'aîné, fut revêtu de la pourpre, et, dans la proclamation annuelle, son père l'associa à la [dignité impériale. En 1142, il mourut d'une fièvre aiguë, au moment où l'empereur se disposait à faire la conquête de la Syrie.
2° Andronic, le second fils de Jean, portait le titre de sébastocrator. Il mourut peu de temps après son frère.
3° Isaac, qui hérita des dignités de ce dernier et fut nommé sébastocrator. Après la mort de Jean Comnène, ayant été frustré de la couronne au profit de Manuel, il fut relégué dans un monastère.
4° Manuel, le plus jeune des fils de Jean, était le plus chéri. Son père, au moment de mourir des suites d'un accident à la chasse le désigna comme son successeur.
Des trois princes contemporains de Théodore Prodrome et qui ont porté le titre de sébastocrator, Andronic, fils d'Alexis Ier, pourrait être le personnage que nous cherchons, mais il est probable qu'il s'agit, non pas d'un frère, mais d'un des fils de Jean Comnène, Andronic ou Isaac. Il ne peut être question du dernier, parce qu'il n'était pas en position de soulager la misère de Théodore Prodrome. Reste Andronic Comnène, auquel, en effet, doit être adressée le poème en question. Sa femme, nommée Irène, était la protectrice des hommes de lettres. Après la mort du sébastocrator, c'est à sa veuve que Théodore Prodrome dédia toutes ses pièces de vers. J'en possède un grand nombre d'inédites où l'on voit que Manuel Comnène avait adopté et honorait d'une protection toute particulière les enfants de son frère Andronic. Puisque l'époque de la mort de ce dernier est connue, le poème que nous publions ici serait antérieur à l'année 1142.
Ce poème nous apprend que Th. Prodrome était marié et que son intérieur se composait de treize personnes, y compris sa femme, sa mère et sans doute les serviteurs. Nous verrons dans le dernier poème qu'il avait plusieurs enfants.
Pauvre et dénué de tout, environné, obsédé par une foule de maux, assailli de tout côté par des infortunes sans nombre, je viens, ô mon très auguste maître, ma gloire et mon orgueil, je viens raconter mes affaires à Votre Seigneurie.
Pour un maître tel que vous, que peut un écrivain pareil à moi, si ce n'est de s'asseoir, de tâtonner, de dire et écrire des vers politiques, de faire des compositions en langue vulgaire, remplies de sons gutturaux et d'expressions retentissantes, de se ravaler jusqu'à la prose?
Moi je dis et j'écris tout ce qui éveille la compassion, excite la pitié et porte à la bienfaisance. Écrire en folâtrant et dire des vulgarités, c'est, ce me semble, le fait d'un homme simple, c'est un acte de pur badinage.
J'ai un peu dévié de la ligne droite, et c'est continuellement plongé dans les larmes, les gémissements et les lamentations que j'écris des vers pétillants de gaîté et de bonne humeur. Si j'agis ainsi, ce n'est pas par simplicité d'âme, ni histoire de me divertir. Mais, par la détresse où je suis tombé, mais, par cette course à pied, longue et désespérée, qu'il me faut faire, hélas! pour me rendre au palais et aller à l'église, je veux dire et exposer les choses telles qu'elles sont. Seulement prenez garde, prenez bien garde ne pas avoir à m'enterrer.
Vous me donnez vraiment beaucoup de choses, mais, si je les additionne, cela ne me suffit pas pour quatre mois et ne me procure aucun réconfort. Les douze pauvres misérables boisseaux de blé que vous m'octroyez, je ne sais comment ils rassasient treize personnes durant un mois. On ne ferait que les flairer, c'est à peine s'il y en aurait assez. Indépendamment de l'argent que je reçois, il me faut du bois à brûler, il me faut du charbon, il me faut des provisions de bouche une fois la semaine. Aux miens il faut des chaussures; et moi, n'ai-je pas besoin de souliers d'hiver, de courroies, et d'un justaucorps épais et court pour me garantir du froid? Et à la maison ne faut-il pas du lin, du coton, de quoi teindre, de quoi coudre, du cuir épais, du cuir mince, le salaire du meunier, et ceux du fournier et du baigneur? Ne faut-il pas du savon, du garum et du poivre broyés, du cumin, du carvi, du miel, du vinaigre, du nard, du sel, des champignons, du céleri, des poireaux, de la laitue, du cresson, de l'endive, des épinards, des arroches, des navets, des aubergines, des choux frisés, des bettes, des choux-fleurs? Et pour les collybes des trépassés ne faut-il pas des amandes, des grenades, des noix et des pommes de pin? Ne nous faut-il pas du chènevis et des lentilles, des pois chiches et des raisins secs? Ne veut-on pas des pommades au musc et au safran? Ne faut-il pas à ma femme un jupon pour Pâques? A ma mère un manteau et des chaussures ?
Je laisse de côté les grosses choses et j'entre dans le détail, les marmites et les bouteilles, les ficelles et les broches. C'est, donne par ici, donne par là, donne pour le coquemar, donne pour le crible à sasser, donne à l'éleveur, donne pour le rat-de-cave, les allumettes, l'huile d'olive et l'huile de lin. Parle au poseur de ventouses, fais venir le saigneur. Maître, la corde du puits est cassée, qu'on la change; le tonneau ne tient plus l'eau, qu'on en achète un autre; la porte est démontée, que le serrurier vienne l'arranger; l'enfant s'est blessé, vite qu'on achète de la meilleure huile de camomille, du vinaigre, du verjus sec, du ricin, des cantharides, et autres ingrédients analogues, et qu'on en fasse un onguent pour la blessure, avant qu'elle ne se gangrène.
Vous avez entendu, parfaitement entendu les dépenses que j'ai, eh bien! additionnez toutes mes recettes, mon salaire, mes émoluments mensuels et mes gratifications, les espèces frappées en creux et celles en relief, ce que je reçois par ici et par là, et alors établissez bien le compte de ce que vous me donnez, et, si vous trouvez que j'en fais mauvais usage, alors injuriez-moi, blâmez-moi comme un prodigue et un gaspilleur d'oignons ; si, cédant aux importunités de gens qui m'en veulent, vous me condamnez aussi sans motif, c'est là une mauvaise action, c'est un crime dont vous vous rendez coupable.
Tout ce que je viens d'énumérer, on en a besoin chaque année dans sa maison, riches et pauvres, serviteurs et maîtres, moines et laïques, vieux et jeunes, chacun suivant ses moyens et sa propre condition.
Ceux qui, dès le principe, ont reçu comme héritage paternel le bien-être et la prospérité en toutes choses, les riches revenus leur arrivent de partout, car la terre et surtout la mer sont pour eux une source de dons; elles leur fournissent en abondance toutes sortes de biens.
Mais les pauvres comme moi, les morts de faim, ceux auxquels l'indigence tient lieu de patrimoine, qui ont beaucoup de dépenses et peu de revenus, lorsqu'ils se trouvent dans le dénuement et ne savent où donner de la tête, ils se tournent vers leurs habits, ô Christ ! pitié, alors! et ils les vendent et les mangent, miséricorde, ô Christ ! Et quand, semblables aux ouvriers orfèvres, il les ont fondus (digérés), quand, comme les laveurs de sable, il les ont nettoyés, s'ils marchent, ils tombent de sommeil; s'ils sont assis, ils dorment; s'ils sont levés, ils trébuchent, ils ont le vertige à tout instant; là où il y a des étoiles, ils voient des roues peintes en vert; ils ont l'air pire que des ivrognes, on dirait des gens ensorcelés, ahuris, et frappés de la foudre.
Et moi aussi, atteint de cette maladie de l'indigence, j'ai, dans mon malheur, dévoré toute ma fortune; et, pour peu que cela continue, si la sérénité ne prend pas le dessus, si vous ne m'ouvrez point la porte de votre miséricorde, je crains de passer l'hiver dehors, d'être congédié et d'être réduit à manger mes immeubles, et voilà qui est pire que la mort.
Ne vous méprenez point sur mon surnom de Ptochoprodrome, auguste prince, ne vous imaginez pas que je me nourris d'herbes de montagne; non, je ne mange pas de sauterelles, je n'aime pas les racines, mais un épais ragoût, une sauce relevée où les morceaux sont nombreux et rebondis, et une grasse portion de mouton prise dans le filet.
Ne me regardez pas comme un imbécile, et n'allez pas croire non plus que, si vous me donnez quelque chose, j'en ferai un mauvais usage, mais tâchez de comprendre qu'avec mes dépenses je fais face à tous les besoins du ménage.
Hâtez-vous donc d'aviser, avant que je ne mange mes immeubles, avant que je ne m'alite et ne meure. Mes fautes et mes crimes retomberaient sur vous et vous seriez privé de vos louanges quotidiennes. Puisse le Christ vous être propice, prince auguste, et vous accorder la récompense de vos bienfaits envers moi, une récompense riche et éternelle, comme il sait en octroyer!
Nous arrivons maintenant à la pièce principale, celle que nous avions réservée comme la plus importante. Elle n'a pas moins de deux cent soixante et quatorze vers et est adressée à l'empereur Maurojean. Il s'agit de Jean Comnène, auquel on avait donné ce surnom, parce qu'il avait le teint brun et les cheveux noirs. On l'appelait aussi Calojean, pour indiquer les heureuses qualités dont il était doué.
Du vivant de Jean Comnène, c'est-à-dire avant 1142, Théodore Prodrome était déjà vieux, ainsi qu'il nous le dira lui-même. Comme d'ailleurs, dans ses diverses poésies, il parle des principales expéditions qui ont signalé le règne de Manuel, on peut conclure qu'il est mort dans un âge très avancé.
Cette pièce nous fournit d'autres renseignements certains. Lorsqu'il la composait, il était marié depuis douze ans. Il avait épousé une tille noble dont il avait eu quatre enfants, dont deux filles jau moins. Que s'est-il passé depuis? Qu'est devenue sa famille? C'est ce que nous ignorons. Nous le retrouverons plus tard sous Manuel Comnène, installé dans le monastère de Philothée, sous le nom du moine Hilarion. C'est de là qu'est adressée à l'empereur la seconde pièce publiée par Coray. Il se plaint amèrement de la vie qu'il y mène. Il manque de tout, pendant que les autres moines se moquent de lui et se livrent à toutes les sensualités de la bonne chère. Il demande à changer de couvent. Nous apprenons encore que plus tard l'empereur et l'impératrice lui avaient promis de le placer dans le célèbre monastère de Mangana. Trois pièces inédites, dont je possède la copie, rappellent cette promesse et sollicitent avec beaucoup d'instances la signature qui doit être placée en belle encre pourpre au bas de la bulle impériale.
Ces trois poèmes de Théodore Prodrome, très précieux pour l'étude de la langue vulgaire, sont intéressants chacun à son point de vue. Le dernier surtout, dont certains passages sont très difficiles à comprendre, a cela de particulier qu'il est unique en son genre; car l'antiquité ne nous a rien laissé de pareil. De tout temps la comédie a eu un champ très vaste pour la fiction. Elle a pu, comme plus tard dans la pièce de Molière intitulée : le Médecin malgré lui, elle a pu introduire sur le théâtre des scènes de ménage plus ou moins accentuées. Mais ici il s'agit de la vie réelle. C'est un poêle qui nous raconte, ou plutôt c'est un poète de cour qui raconte à son souverain ses infortunes conjugales, et cela en langage vulgaire, parce que ce genre comporte un innocent badinage. Théodore Prodrome se garde bien de l'employer dans ses pièces officielles. Il se sert alors de la langue hellénique, de la langue d'apparat, et son vers politique se soumet à un mètre plus régulier et plus sévère. On peut reprocher à Th. Prodrome d'être toujours, et avant tout, même dans ses poésies historiques, un poète famélique et insatiable, mais on doit reconnaître qu'il est très instruit et qu'il a un dictionnaire très varié. Quant à ses défauts comme écrivain, ils sont inhérents à son époque qui est celle du faux goût et du bavardage. La décadence littéraire avait commencé de bonne heure dans l'empire d'Orient. Dès les premiers siècles de notre ère, la poésie avait pour ainsi dire disparu en Grèce. Depuis Agathias au vie siècle jusqu'à la prise de Constantinople, c'est-à-dire pendant neuf siècles, on peut à peine citer cinq ou six noms : George Pisidès, Michel Psellus, J. Tzetzès, Théodore Prodrome et Manuel Philé. Et encore hésite-t-on à donner à ces écrivains le nom de poètes. Prodrome a été certainement le plus fécond et le plus célèbre d'entre eux; à ce titre il méritait de fixer l'attention de la postérité.
O mon maître, mon maître couronné, quelle récompense, quelle offrande vous présenterai-je qui soit digne des nombreux et éclatants bienfaits dont me comble votre majesté?
Il y a peu de temps, quelques jours à peine, je n'avais, dans mon malheur, rien de convenable à offrir à votre puissance, à votre bonté, à votre grandeur, à votre grâce, si ce n'est encore quelques vers politiques, sans quantité, modestes, égayés par un badinage qui respecte les convenances. Les vieillards plaisantent, eux aussi, mais c'est avec décence.
Ne vous détournez donc pas de mes vers, ne les repoussez point, mais accueillez-les plutôt comme un condiment, si même ils sont sans parfum, et écoutez avec bienveillance ce que vous écrit un infortuné.
Car, sire, tout en ayant l'air de badiner, je suis en proie à une affliction immense, à un chagrin des plus violents. J'ai une fâcheuse maladie, un mal, mais quel mal ! En entendant le mot de maladie n'allez pas croire qu'il s'agisse d'une hernie ou de quelque autre affection secrète pire encore. Ne vous imaginez pas qu'il me soit poussé une corne au milieu du front, que je souffre d'un priapisme obscène, d'une maladie de cœur, d'une inflammation, d'une péritonite, d'une hydropisie, d'une péripneumonie; non, le mal que j'endure, c'est une femme acariâtre et querelleuse.
Je veux vous dévoiler toute la méchanceté de cette créature. Mais, sire, je crains que des indiscrets ne m'entendent et n'aillent chez moi répéter à ma femme les confidences que je vous fais. J'aimerais mieux, sire, être enseveli tout vif, être porté en terre et enfoui dans le sable que de la savoir instruite de ce que je vous écris là. Car je redoute sa langue, je crains sa colère, j'ai peur de ses menaces et de ses invectives.
Souvent, s'il lui vient une idée, s'il lui passe une lubie, elle ordonne aux valets et à la nourrice de m'empoigner, de m'entraîner et de me jeter au milieu de la rue, puis de me donner mes vers et mes paperasses. Qui viendra me venger? Qui m'arrachera à cette furie?
Cependant, qu'il en soit ainsi ou autrement, il est temps de vous raconter tout ce qui me concerne.
Je ne puis supporter davantage la malice de cette femme, ses moqueries, ses injures quotidiennes : « Monsieur, vous n'êtes pas soigneux. Monsieur, comment dites-vous? Monsieur, qu'avez-vous apporté? Monsieur, qu'avez-vous acheté? Quel habit, quel costume m'avez-vous fait confectionner? De quel jupon me faites-vous cadeau ? Je n'ai jamais vu les fêtes de Pâques! Voilà onze années de privations et de misère que je passe avec vous, et je n'ai pas mis à ma jambe une courroie qui vînt de votre travail, je n'ai pas porté une robe de soie; jamais je n'ai eu de bague à mon doigt, jamais d'anneau, jamais de bracelet dont je pusse me parer. Les étrangers mettent mes vêtements en morceaux, et moi je reste nue et affligée.
« Je ne suis jamais entrée dans un bain, pour ne pas en ressortir attristée. Je ne me suis jamais rassasiée un jour, crainte d'avoir faim pendant deux.
« Sans cesse jbe jaune à grands dessins. Faites-en cadeau à quelqu'un, vendez-les, ou donnez-les à qui vous voudrez. Les ustensiles de bain que vous avez fabriqués et la garniture de lit seront le patrimoine de vos fils. Quant à vos filles, le mobilier de votre père leur constituera une maigre dot. Et vous, tenez-vous tranquille et sans souci.
« O homme, regardez-moi donc un peu, voulez-vous? J'étais considérée et vous portefaix ; j'étais noble et vous un pauvre citoyen. Vous êtes Ptochoprodrome et moi une Mazouchine. Vous couchiez sur une natte et moi dans un lit. J'avais une riche dot et vous un bain de pieds. J'avais de l'or et de l'argent et vous des douves de cuve, un pétrin et une grande chaudière.
« Vous logez dans ma maison et vous n'avez nul souci de notre habitation. Les marbres sont détériorés, le plafond tombé, les tuiles brisées, la toiture pourrie, les murs renversés, le jardin en friche. Pas un ornement n'est resté, plus de plâtre, plus d'enduit, plus de pavés en marbre, plus de (mot effacé). Toutes les portes sont démantibulées, les grillages dégarnis du haut en bas, et les barreaux du côté du jardin sont tombés.
« Vous n'avez pas remplacé une porte, pas remis une planche, même en hiver. Vous n'avez pas fait reposer de tuiles, ni relever le mur, ni fait venir un maçon pour le réparer. Vous n'avez pas acheté un clou pour l'enfoncer dans une planche.
« Mes domestiques vous considèrent et vous traitent comme leur maître. Ils vous craignent, ils vous respectent, ils vous servent, ils vous honorent. Moi, je tiens votre maison et je m'occupe du service. Je sers vos enfants mieux que la meilleure nourrice. Je prends soin de vos affaires; je cours, je me fatigue, je me démène, je tisse moi-même la robe de lin et coton que je porte. Je suis votre curatrice, votre femme de charge. Je fais quenouilles et fuseaux. Je suis fileuse et tisseuse de lin; je fais les chemises et les culottes, je foule le coton. Je fais fonction d'économe et de marguillier, je suis annonceur d'antiennes et notaire rural. Et vous, vous êtes là, comme un animal, plongé dans la mangeaille, attendant chaque jour ce que je vais vous servir. Je ne sais ce que vous exigez de moi, j'ignore à quoi je vous suis utile.
« Si vous n'aviez pas la force de plonger, il ne fallait pas vous faire plongeur, mais rester assis, silencieux et insouciant, gratter votre lèpre et me laisser tranquille. S'il vous plaisait de tromper, de séduire et d'épouser une femme, il fallait vous en prendre à votre égale, à la fille d'un cabaretier, à quelque fille boiteuse et pleine de taches de rousseur, à moitié nue, sans le sou, ou à quelque rustaude de la banlieue. Mais pourquoi m'avoir circonvenue, moi, pauvre orpheline, pourquoi m'avoir poursuivie de vos obsessions et de vos paroles séduisantes? Pourquoi m'avoir accompagnée avec une multitude de paranymphes? »
Bref, ô mon seigneur et maître, je ne vous cite là qu'un fait entre mille, car, si jamais je voulais vous les énumérer tous, j'écrirais un autre catalogue de héros. Ce que j'ai dit est assurément bien suffisant, ce sont choses évidentes et notoires ; et, bien qu'elles soient vraies et pleines de vraisemblance, je n'hésite pas, sire, à les qualifier de fables et de contes, car dans certaines expressions l'amertume déborde.
Ma femme, peu satisfaite de mes réponses, se tient debout, s'arrache les cheveux, se déchire les joues, prend ses enfants avec elle, empoigne sa quenouille, entre dans sa chambre et ferme hermétiquement la porte. Elle boude et se cache, et moi, elle me laisse dehors, comme elle l'a fait naguères, ô mon maître couronné, à mon retour d'une promenade. J'étais à cheval, je franchis la porte, et quand elle vit que j'avais mis pied à terre et étais rentré tranquillement, sans exciter de tumulte et de cris, sans ameuter la foule, sans attroupement de soldats querelleurs, sans hommes pour m'accompagner ou me précéder, sans porte-massue et porte-sceptre, sans le concours de militaires à cuirasses dorées, sans l'intervention des fantassins armés de frondes, elle se mit à chuchoter et à parler tout bas.
Moi, j'étais à jeun, je n'avais pas lampe ma boisson favorite (je ne veux pas cacher mes torts, c'est une faute où je tombe souvent), j'étais de mauvaise humeur, je lui parlai durement, et elle se mit à me rabâcher ses reproches habituels.
« Que prétendez-vous? Qui êtes-vous? Considérez donc qui vous frappez, considérez celle que vous insultez et déshonorez) Je ne suis pas voire esclave, ni votre salariée. Comment avez-vous eu l'audace de lever la main sur moi? Comment n'avez-vous point eu honte? Vous avez consommé comestibles et boissons, tout y a passé, et vous m'avez réduite au dénuement.
« Si jamais je vois mes frères et qu'ils ne vous empoignent pas pour vous donner une bonne leçon, je vous attacherai au cou mes quatre enfants, et tous mes bénéfices iront dans mon estomac. Ensuite je vous chasserai de chez moi avec grande ignominie, puis, prenant vos airs et adoptant vos idées, je ne vous laisserai pas un cheveu sur votre vieux crâne. »
Tandis qu'elle débitait ces paroles insolentes, j'avais envie, Sire, de la gifler; mais, ayant fait un retour sur moi-même, je me dis intérieurement : « Pour ton âme, Prodrome, assieds-toi et garde le silence. Supporte et endure courageusement tout ce qu'elle te dira. Si tu la frappes, si lu la bats, et que cela lui fasse mal, comme tu es petit, vieux et impotent, elle va s'élancer sur toi, te pousser devant elle, et, si elle te frappe, peut-être t'assommer. Si toutefois lu désires lui jouer quelque bonne farce, prends un bâton, pousse un cri, jette ton bonnet à poil, lance-lui une pierre, mais fais attention de ne pas l'atteindre, recule d'un pas, lance-toi sur elle pour la saisir, cours, attaque-la vivement, tape dru. Si lu tombes, relève-toi et te remets à ses trousses. Roule des yeux farouches, lance des regards irrités, mets ton bonnet de travers, rugis comme un lion. »
Mais, dans mon malheur, n'ayant pu trouver un bâton, je prends précipitamment le manche à balai, priant, suppliant, conjurant et disant : « Vierge immaculée, contenez ma femme; Christ, arrêtez-la, de peur qu'elle ne me joue un tour et ne m'arrache ma trique, ne m'en frappe et ne m'éborgne, si le diable l'y pousse. »
Mais, empereur couronné par Dieu, cette femme n'eut rien de plus pressé que de mettre le pain et le vin sous clef. Ensuite elle fuit, se dérobe, se cache, ferme la porte, s'assied insouciante, et me laisse dehors.
Dans mon indignation, je saisis le manche à balai, et je me mis à frapper à la porte avec violence. Ayant trouvé un trou, j'y introduisis le bout de mon manche à balai. Mais ma femme bondit, l'empoigne, le tire en dedans et moi en dehors. Me voyant le plus fort et s'apercevant que je l'amenais vers moi, elle lâche le manche à balai, entrouvre la porte, et, moi, je m'étale soudain de tout mon long par terre.
Quand elle me vit tomber, elle se mit à se moquer de moi. Elle sort et me relève promptement de dessus le plancher, et m'adresse ces paroles caressantes : « Ayez honte, monsieur, et sauvez-vous. Ayez quelque vergogne ! N'êtes-vous pas un vilain petit rustre et un chétif avorton? Laissez à d'autres la vigueur et le courage, vous n'êtes plus jeune, honorez ceux qui sont plus forts que vous! Trêve de forfanteries et de rodomontades! »
Bref, après m'avoir dit tout cela, elle rentre de nouveau, donne un tour de clef, et se rassied. Quant à moi, aussitôt relevé, je cours à ma chambre et je m'étends sur mon lit, en attendant le dîner. Mais, aiguillonné par la faim, je saute du lit, je vais à l'armoire et je la trouve fermée. Je retourne me coucher sur mon lit, je ne cesse de me tourner et retourner sans perdre de vue la porte.
Déjà le soleil inclinait vers son couchant, quand j'entends tout à coup un cri et un grand tumulte : un de mes enfants était tombé par terre d'une chambre haute et il gisait là comme inanimé. Aussitôt les voisines se réunissent pour nous consoler, les vieilles femmes surtout, les vieilles commères, et c'est alors que l'on pouvait entendre du tumulte et du bruit.
Tandis donc que, comme je viens de le dire, les femmes et tout ce monde-là étaient groupés autour de l'enfant, s'entretenait de sa chute et du mal qu'il avait, je dérobe la clef, j'ouvre l'armoire, je me dépêche de manger et de boire, puis, une fois rassasié, je me hâte de sortir et je me mets à me lamenter avec les autres.
Le mal ayant disparu et l'enfant s'étant relevé, l'attroupement se dispersa bien vite, et ma femme, accompagnée de tous les enfants, rentra avec eux et se cacha de nouveau. Quant à moi, je me couchai seul, sans consolation, sans dîner, à tâtons, plein de tristesse. Je fus réveillé de très bonne heure, je montai sur mon lit, et, tenant d'une main la porte d'entrée, je criai à ma femme : « Bonjour, maîtresse; tu ne m'ouvres pas, ô mon âme? Tu ne me regardes pas, mon cœur? » Puis, ayant poussé trois profonds soupirs, sans entendre un mot, une parole, le plus léger murmure, sans percevoir le moindre signe, je m'en retournai et j'allai m'asseoir, baigné de larmes, et, au lieu de déjeuner, Sire, je me couchai et je m'endormis.
Durant mon sommeil, une bonne odeur de ragoût me chatouilla l'odorat, et alors, chassant le sommeil de mes paupières, je fais un saut, je me lève promptement, et, comme un chien de chasse, je suis la piste, et j'aperçois un ragoût dans la chambre.
Les enfants étaient rassemblés et assis pour manger; la table était dressée avec tout son attirail. A cette vue, je fus inondé de joie, car j'espérais qu'on allait m'appeler pour prendre ma place et manger. Mais le temps passa et rien ne parut. Alors je me retire en grande hâte ; je trouve mon habit slavon et je l'endosse, je m'entortille dans mon manteau de Tombritza, et je me coiffe de mon bonnet de laine écarlate; je prends un long bâton, je me dirige vers la chambre que je trouve fermée; je me tiens en dehors et là je me mets à crier sans cesse : « Pitié, madame, miséricorde! la charité, je suis sans gîte! »
Mes enfants, ne comprenant rien à cela, accourent, prennent des triques, des bâtons, des pierres, et descendent précipitamment l'escalier. Mais leur mère, qui comprenait mon langage,[3] cria aux enfants : « Laissez-le, c'est un pauvre, un mendiant, un pèlerin. »
Ces mots me remplirent de joie, car le jeûne m'avait creusé le ventre. Les enfants s'étant radoucis contre mon attente, je montai l'escalier, guidé par eux, et une fois entré, je m'assis, j'attendis qu'on m'invitât à manger. A peine eus-je vu un bol plein de soupe, un peu de petit salé et quelques autres bons morceaux, je m'en emparai avec avidité, et ces copieuses victuailles me mirent le cœur en liesse.
Tels sont, monarque couronné, les maux que m'a fait endurer une femme querelleuse et méchante, en me voyant rentrer à sec à la maison. Si donc, Sire, vous ne me faites pas éprouver votre miséricorde, si vous ne comblez pas de dons el de présents cette femme insatiable, je crains, je redoute, je tremble d'être tué prématurément, et qu'ainsi vous ne perdiez votre Prodrome, le meilleur de vos courtisans.
[1] Voy. .Notic. et extr. des man., t. VI, p. 521.
[2] Voy. la notice intitulée Un poète de la cour des Comnènes, notice lue dans la séance publique des cinq Académies, le 28 octobre de cette année.
[3] Théodore Prodrome s'était exprimé en langue étrangère.