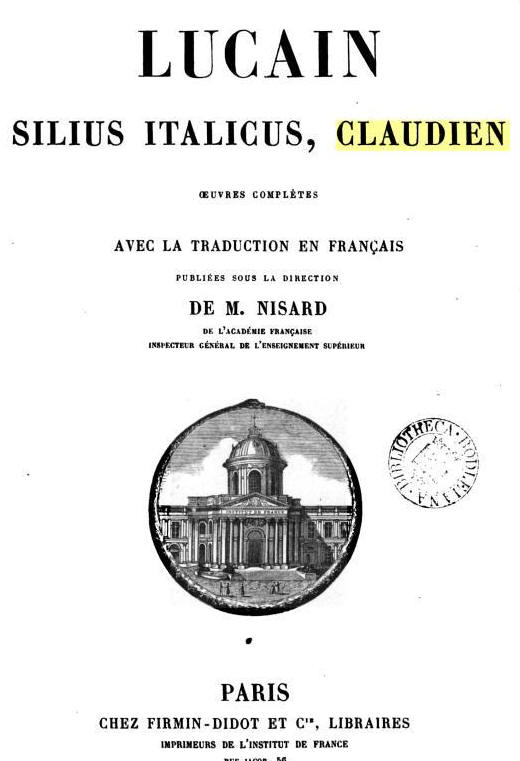
Claudien
Notice sur sa vie et les ouvrages de Claudien.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
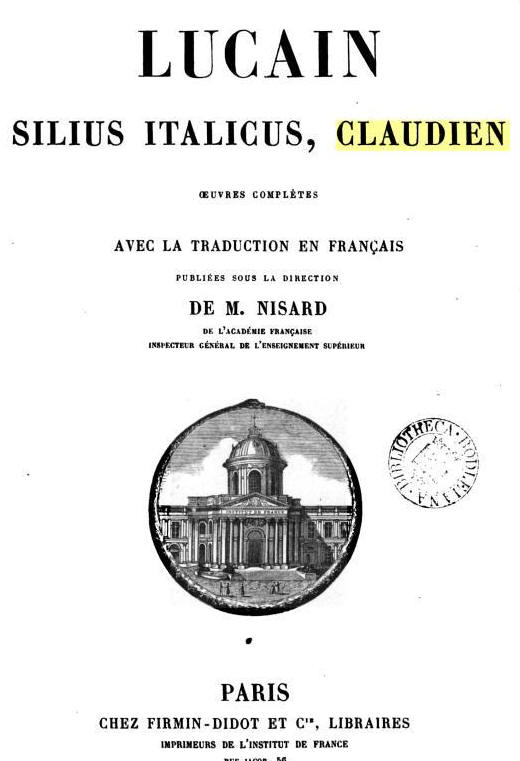
NOTICEsurLA VIE ET LES OUVRAGES DE CLAUDIEN.— —
Claudien (Claudius Claudianus), poète latin, à qui l’on a donné longtemps pour patrie, ou la Gaule, ou l’Italie, ou l’Espagne, naquit à Alexandrie, en Égypte, comme il est permis de le conclure, et de son propre témoignage et de celui de Suidas; on peut, par une autre conjecture non moins vraisemblable, placer sa naissance vers l’an 365 après J.-C. sous le premier Valentinien. Sa langue maternelle était le grec, et, de son aveu, il ne commença d’écrire en vers latins que sous le consulat des deux frères Aniclus Probinus et Olybrius, en 395, lorsqu’il eut visité, on ne sait dans quel but, l’ancienne capitale de l’empire, cette Rome, dont le prestige, malgré tant de catastrophes, n’était pas encore détruit, et Milan, cité moins glorieuse, mais devenue la résidence ordinaire des empereurs d’Occident. Il eut dès lors pour protecteur Flavius Stilicon, tuteur et ministre d’Honorius. Il le chanta plus souvent et avec plus d’éclat que les princes, il lui réserva toutes les hyperboles de l’éloge, et toutes celles du blâme à ses ennemis. On voit, par un des poèmes de Claudien, que, se trouvant à Alexandrie entre 398 et 400, avec des lettres de recommandation de Séréna, femme de Stilicon, il obtint en mariage une riche héritière, dont la famille fut sans doute éblouie par le crédit du poète à la cour d’Honorius. Dans cette cour chrétienne, Il n’avait point renoncé à l’ancien culte de Rome; car les poésies chrétiennes qu’on a sous son nom ne lui appartiennent pas, et sont ou du Gaulois Mamert Claudien, qui écrivit environ cinquante ans après lui, on peut-être de l’Espagnol Flavius Mérobaudès, comme R. Niebuhr le suppose, malgré des difficultés de plusieurs sortes, dans la seconde édition des fragments qu’il a publiés de cet auteur du cinquième siècle, d’après un manuscrit palimpseste de la bibliothèque de Saint-Gall. Si l’on se demande comment un poète tel que Claudien, qui fut courtisan toute sa vie, n’a trouvé que des louanges mythologiques et profanes pour des chrétiens aussi zélés que Théodose et son fils, que Stilicon lui-même, il n’y a rien là de plus étonnant que de voir le panégyrique de Gratien prononcé par Ausone, celui de Théodose par Thémiste et Pacatus; sans que les orateurs eussent fléchi devant la nouvelle croyance de leurs maîtres. En vain des lois rigoureuses, admises bientôt après dans le code Théodosien, menaçaient les dieux et leurs temples: on était encore dans un âge de transition et de tolérance: les sévérités que les évêques parvenaient à introduire dans les lois n’étaient pas encore passées dans les mœurs. On a, des deux côtés, plusieurs preuves frappantes de cette impartialité religieuse, proclamée alors par Symmaque, et qui durait déjà depuis un siècle; car si Constantin avait écouté volontiers les félicitations païennes de Nazaire et d’Eumène, et rempli jusqu’à la fin ses fonctions de grand pontife, Julien avait choisi pour le premier de ses gardes du corps un chrétien fervent, celui qui fut son successeur, Jovien. Voici les principaux poèmes latins qui restent de Claudien, et que nous essaierons de ranger dans l’ordre chronologique de leur composition. Le premier dont la date soit certaine est de 395, année de la mort de Théodose: c’est le panégyrique en l’honneur des deux consuls Probinus et Olybrius, où, mauvais imitateur des flatteries les moins heureuses de Virgile, il propose à l’un de ses héros, à Probinus, d’aller prendre au ciel la place de Castor, et réserve à Olybrius celle de Pollux. Après ce début dans la longue carrière des louanges intéressées, après un assez grand nombre de poésies légères, dont plusieurs paraissent de ces premiers temps, et parmi lesquelles on a remarqué avec raison le Vieillard de Vérone, Claudien devint et resta le poète de Stilicon. Non content des trois grands poèmes où il célébra, en 400, le premier consulat de son patron, et des chants sur la guerre de Gildon , en 398, sur la guerre des Gètes ou des Goths, en 402, chants consacrés à la même gloire, toutes les fois qu’il fait l’éloge d’Honorius, et il y revient très souvent, il n’oublie jamais d’y joindre celui de Stilicon, qu’il ose préférer même à Théodose. Lorsqu’il s’exerce dans l’autre partie du genre démonstratif, dans le blême, où il réussit mieux, c’est encore à Stilicon qu’il veut plaire, et les deux invectives contre Rufin, en 396, les deux invectives contre Eutrope, en 399, s’adressent moins peut-être à des ministres vicieux et inhabiles, qu’à des ennemis de Stilicon. Les autres sujets de ses poèmes sont, ou Séréna, femme de son protecteur, ou Maria, leur fille, dont il chanta l’union avec Honorius, en 398; ou leurs clients, tels que Mallius Théodorus, dont il récita en 390 le panégyrique vraiment divin selon Barthius, et où l’on voit en effet paraître deux déesses, Astrée, pour engager Malius à quitter de nouveau ses études philosophiques, et Uranie, pour décrire les fêtes de cet heureux consulat. Enfin, quand le héros de Claudien, Stilicon, en 408, à la veille de la prise de Rome par Alaric, est assassiné à Ravenne par le lâche Honorius, Claudien se tait: ou il périt avec le dernier défenseur de Rome, ou il s’exila lui-même, soit en Egypte, soit en Orient, ou, s’il fit encore des vers, ils ne sont point venus jusqu’à nous. Ses deux ouvrages proprement épiques, la Gigantomachie, dont il ne reste que peu de vers, et l’Enlèvement de Proserpine, en trois livres, le plus connu des poèmes de Claudien, sont d’une date incertaine. Ceux qui se figurent qu’il y a dans le dernier de ces poèmes quelques allusions aux initiations d’Éleusis, sont plus voisins de la vraisemblance que ceux qui ont cru y reconnaître le secret de la pierre philosophale; mais le poète n’a probablement songé qu’à faire des vers sur une fable qui prêtait à de brillantes descriptions, et dont la poésie et les arts s’étaient déjà emparés plusieurs fois. Ces divers ouvrages de Claudien méritaient-ils la statue de bronze que Stilicon lui fit élever dans le forum de Trajan, avec une inscription latine, que Pomponius Letus, qui en inventa bien d’autres, prétendit avoir retrouvée à Rome en 1493, inscription où l’on imagine pour Claudien l’épithète barre de prœgloriosissimus, et qu’on fait suivre d’un dystique grec qui lui accorde à la fois le goût de Virgile et le génie d’Homère? Méritaient-ils les pompeux éloges dont il a été souvent comblé; les titres qu’on lui donne d’éloquent, d’admirable, de sublime, de divin: l’enthousiasme qui l’a fait proclamer rival d’Homère, et bien supérieur à Virgile ou seulement l’admiration plus calme qui se contente de lui décerner, comme Rollin, la premier place entre les poètes héroïques latins qui ont paru depuis le siècle d’Auguste? A cette question, nous croyons pouvoir répondre qu’il était juste d’admirer au Ve siècle, dans un temps où s’effaçaient de plus en plus les formes régulières et pures de l’ancienne poésie latine, un homme qui avait su en conserver quelque image et dont la versification monotone, mais soignée, vide, mais sonore, produisait quelque illusion; ce qui ne nous empêchera pas d’ajouter que ce poète si favorablement jugé de son temps et même longtemps après, nous semble beaucoup plus précieux aujourd’hui, pour les nombreux témoignages qu’il nous a transmis des faits et des mœurs de son siècle que pour sa véritable valeur littéraire, qui ne peut lui donner qu’un rang assez inférieur parmi le poètes anciens. Sans doute il lui était impossible de faire plus. On est généralement d’accord sur l’insipidité de la plupart des sujets qu’il a choisis, ou qu’il n’a pas eu le courage de refuser, et pour lesquels il recherche avec effort la parure et le luxe, désormais surannés, de la vieille mythologie; sur le plan vague et commun de ses panégyriques et même de ses satires; sur tous ces défauts de composition, qui se retrouvent dans les poèmes historiques de ses contemporains ou de ses successeurs, comme Mérobaudès et Corippus. Il eût fallu, à une telle époque, un génie vraiment rare pour s’élever beaucoup plus haut. Les cœurs et les esprits, tout dégénérait. La puissance et la fortune publique étalent en proie des favoris, à des eunuques, à de lâches ambitieux qui ne s’élevaient que par des assassinats. Théodose qui seul avait soutenu l’empire chancelant, le partage entre deux fils incapables de régner. Honorius dont Claudien a chanté le mariage, le consulat, le chevaux et les présents, établit le siège de son faible pouvoir dans la ville de Ravenne, parce que le roi des Visigoths, Alaric, savait le chemin de Rome. Stilicon, ce vandale protecteur du poète et de l’empire, brave, mais souvent perfide envers ceux qui aspirait à remplacer; Rufin, dont l’affreux portrait semble justifié par l’histoire; un Eutrope non moins odieux; un Gaïnas, qui effraie et humilie son maître; enfin deux princes méprisés, voilà ce que le restes de l’antiquité opposent aux peuples du Nord qui viennent, sur les débris de Rome, élever les monarchies modernes. Goths, Suèves, Alains, Cambres, tous ces conquérants étaient prêts et les grands hommes se trouvaient parmi eux; un courage invincible, un sentiment généreux de la liberté, un noble dédain pour ces maîtres du monde qui ne se défendaient pas, et je ne sais quel instinct de gloire, que le midi ne connaissait plus, allaient abattre à leurs pieds ces Grecs et ces Romains, dont le règne était passé. Le sénat achète la paix, demande la vie, et de toutes parts les royaumes commencent. C’est alors que paraissent les premiers fondateurs de l’empire des Francs dans les Gaules, où Clovis devait bientôt vaincre Siagrius, et faire agenouiller ses hordes farouches devant le labarum de Constantin, comme pour annoncer que les peuples nouveaux étaient venus. Les grandes compositions épiques pouvaient-elles naître dans la vieille société qui périssait? Aussi n’est-ce jamais le talent de créer et de disposer une fable avec intérêt et grandeur qu’on a vanté dans Claudien. On y a le plus souvent admiré le style, où le poète, que son origine grecque avait heureusement obligé d’étudier d’abord le latin dans les anciens modèles, surpasse en effet les écrivains de son temps, et surtout les poètes chrétiens; mais c’est bien peu dire, et il n’a pu vaincre, malgré ses talents et ses efforts, la fatale influence de son siècle. Quelle langue la poésie latine, quoique supérieure à la prose du même temps, pouvait-elle parler encore au milieu de ce mélange des nations? Lucrèce Virgile ont chanté parmi les guerres civiles et les combats; Horace entendit le fracas des armes; mais Rome était debout; le peuple-roi n’avait pas été chassé du Capitole. Au siècle de Claudien, la pureté du langage était corrompue depuis longtemps par tous les jargons des peuples dont il fallait recevoir la loi. L’Occident, que tant d’invasions avaient couvert de ruines, vit disparaître le premier les lumières et le goût, qui ne s’exilèrent que plus tard d’Athènes et de Byzance: on ne saurait comparer pour le style les Augustin et les Ambroise avec les Basile et les Chrysostome. Le latin, quoi qu’on puisse en dire, n’est guère plus correct dans l’Egyptien Claudien que dans les poètes bucoliques, Némésien de Carthage et Calpurnius de Sicile; et peut-être l’est-il moins que dans Rutilius et dans les vers de Boèce, qui n’ont jamais trouvé de si violents admirateurs. Beaucoup d’expressions impropres, de figures incohérentes, de constructions embarrassées ou irrégulières; un chaos, où tous les styles se confondent; nulle variété d’harmonie, nulle simplicité, nulle grâce, nulle vérité: tel est le caractère de ces poètes du Ve et du VIe siècle, que nous pouvons presque regarder comme modernes, et qui semblent ne parler déjà qu’une langue d’imitation, copiée docilement, lorsqu’elle est restée latine, sur les écrivains d’un âge plus heureux. Joseph Scaliger avait raison: Claudianus recentior. Les œuvres de Claudien, négligées par les grammairiens latins qui suivirent, lues et citées au XIIe siècle par Jean de Salisbury, Pierre de Blois et par Alain de Lisle, surnommé le docteur universel, qui, d’après l’invective contre Rufin, composa un Anti-Claudianus, en y rassemblant les vertus au lieu des vices; citées encore au XIIIe siècle, par Vincent de Beauvais, furent imprimées pour la première fois à Vicence en 1482; car personne, excepté Th. Dempster, ne connaît l’édition de Venise, 1470. On distingue ensuite celles de Pulmann, Anvers, 1571; d’Étienne de Clavière, Paris, 1602; de Barthius, Francfort, 1650, avec un immense commentaire; de Nic. Heinsius, Leyde, 1650; de J.-M. Gesner. Leipzig, 1759; de P. Burmann, Amsterdam, 1760; de G.-L. Koenig, Goettingen, 1808, dont il n’a paru que le premier volume, etc. La seule traduction française qui soit complète est celle de M. de La Tour, Paris 1798, 2 vol in-8°. On cite, en italien, celle de Nic. Beregani, Venise, 1716; en allemand, celle de C.-Fr. Kretschmann, Zittau, 1707; en anglais, celle d’A. Hawkins, Londres, 1817. On peut consulter sur Claudien, outre les histoires générales de la littérature latine: Mart. Hankius, de Rom. rer. scriptor. t. 1, p. 171, et t. II, p, 511 ; J.-M. Gesner, G.-L. Kœnig, dans les prolégomènes de leur édition; Th. Mazza, Vita de Claudiano, Vicence, 1668; Tillemont, Hist. des Empereurs, t. V, page 656, in-4°, Baillet, Jugements des Savants, t. IV, page 285; Méria., Discours sur Claudien, dans les Mémoires de l’Académie de Berlin, 1764, page 457, et à la tête de sa traduction française de l’Enlèvement de Proserpine, Berlin, 1777; Bayle, au mot Rufin; Gibbon, Décad. de l’Emp. rom., c. 50, t. V, p. 528, éd. fr. de 1812; Thomas, Essai sur les éloges, c. 25; Arth. Beugnot, Histoire de la destruction du paganisme en Occident, 1855, livre IX, c. 5, t. II, p. 28, V.L.C.
|