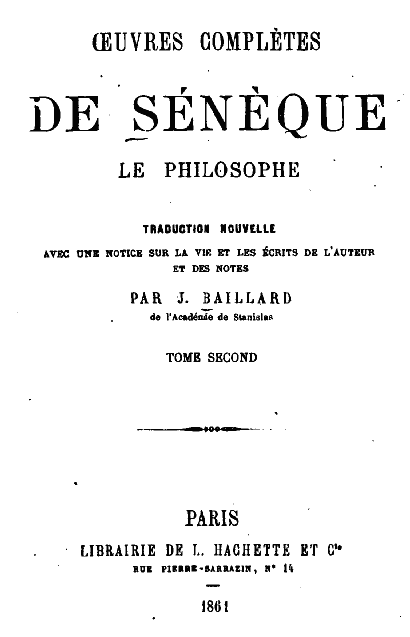|
SÉNÈQUE DE LA TRANQUILLITÉ DE L'ÂME Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
|
SÉNEQUEDE LA TRANQUILLITÉ DE L'AME.
LETTRE DE SÉRÉNUS A SÉNEQUE.
I. En m'examinant bien moi-même, cher Sénèque, j'ai reconnu certains défauts sensibles, patents, que je puis toucher du doigt; d'autres plus obscurs et cachés plus avant; d'autres enfin non habituels, mais qui, reparaissant par intervalles, sont à mon gré les plus incommodes, comme ces ennemis vagabonds qui nous assaillent à leurs moments et ne permettent de garder ni l'attitude vigilante de la guerre ni la sécurité de la paix. Voici toutefois ma situation actuelle telle que je la saisis (car pourquoi taire à son médecin la vérité?). Sans être franchement délivré d'un joug redouté et maudit, je ne m'y vois plus courbé si fortement. Mon état, quoique non désespéré, n'en est pas moins déplorable et cruel : je ne suis ni malade ni guéri. Ne me dis pas que les commencements de toute vertu sont faibles, que le temps lui apporte la consistance et la fermeté. Je n'ignore point que les avantages même que l'on recherche pour l'éclat, les dignités par exemple, le renom d'orateur, et tout ce qui dépend du suffrage d'autrui, grandissent par la durée ; même les travaux qui donnent la vraie force, et jusqu'à ces mérites, qui pour plaire ont besoin de fard, attendent que l'âge et la succession des années les aient consacrés de leur empreinte ; mais j'appréhende que l'habitude, qui consolide tout, ne donne en moi au défaut dont je parle des racines plus profondes. Un long commerce avec le mal comme avec le bien nous fait épouser l'un ou l’autre. Cette fluctuation d'une âme hésitante qui ne se porte résolument ni à la vertu ni au vice, cette infirmité-là est moins facile à peindre d’un seul trait que par détails. Je décrirai les accidents : tu trouveras un nom à la maladie. J'ai la passion de l'économie, je le confesse. Je n'aime[1] ni un fastueux lit de parade, ni ces vêtements qu'on tire d'un précieux coffret, ou que force poids et machines ont tenu sous presse pour leur donner du lustre; ma robe est vulgaire et de tous les jours : je la puis garder et endosser sans tant de précautions. Je n'aime point ces festins où l'on a pour ordonnateurs et pour témoins des bandes d'esclaves, qu'il faut plusieurs jours pour apprêter et une multitude de bras pour servir; je veux des mets simples et communs, ni venus de bien loin ni achetés bien cher, qu'on trouve en tous pays, qui ne pèsent ni à la bourse, ni à l'estomac, qui ne se vomissent pas dès qu'on les a pris. J'aime un échanson sans beau costume et naïf enfant du foyer ; et la lourde argenterie de mon provincial de père, sans ciselure et sans nom d'artiste; et une table que ne distinguent point les bigarrures de ses veines, qu'on ne cite point par la ville pour avoir appartenu successivement à plusieurs maîtres de bon goût : la mienne est faite pour mon usage et non pour arrêter l'œil charmé des convives ou allumer leur convoitise. Tout livré que je suis à ces goûts modestes, je me laisse éblouir à la vue d'une brillante élite de jeunes esclaves, de serviteurs mieux vêtus que ceux de nos pompes triomphales, et chamarrés d'or. Ce superbe cortège de valets, cet édifice où le sol même que l'on foule est tout pavé de matières précieuses, où les plus riches métaux, prodigués dans les moindres recoins, brillent jusque sur les plafonds et ce peuple de courtisans inséparables des grandes fortunes en train de périr, que te di-rai-je? ces eaux transparentes jusqu'au fond de leur canal et qui circulent autour même des tables, et ces banquets où tout répond à la splendeur des lieux, lorsque ces mille magnificences du luxe m'investissent de leur pompe étourdissante, moi qui sors tout rouillé de ma longue frugalité, mes yeux se troublent quelque peu et sont moins à l'épreuve que mon âme. Je m'éloigne alors, sinon moins sage, du moins plus triste, et devant mon chétif mobilier je ne porte plus la tête si haute ; une morsure secrète vient m'atteindre, je me prends à douter si cette vie ne vaudrait pas mieux que la mienne : de tout cela rien qui me change, mais aussi rien qui ne m'ébranle. J'aspire à suivre les énergiques leçons de nos maîtres[2] et à me jeter dans les affaires publiques; j'aspire aux honneurs et aux faisceaux, non que la pourpre ou des verges dorées me séduisent, mais pour mes amis et mes proches, pour mes concitoyens, enfin pour tous les hommes que je dois mieux servir en vivant plus près d'eux. Je me rapproche ainsi docilement de Zénon, de Cléanthe, de Chrysippe, dont aucun pourtant ne prit part au gouvernement, mais qui tous me conseillent d'y entrer. Puis au premier choc qu'essuie mon âme novice à de telles secousses, si je me heurte à l'une de ces indignités trop fréquentes dans la vie humaine, ou à quelque obstacle qui empêche mon action, s'il me faut donner un temps considérable à des futilités, je reprends goût à mon loisir, et pareil au coursier qui, malgré la fatigue, double le pas à l'approche du logis, je brûle de resserrer mon existence dans ses lares protecteurs. Pas un jour ne me sera enlevé par personne ; que me donnerait-on qui m'indemnisât d'une telle perte?[3] Mon âme ne se dévouera qu'à elle-même, ne courtisera qu'elle seule, ne fera rien qui ne soit pour elle, rien en vue de l'opinion : chérissons une vie tranquille, étrangère aux soucis politiques et privés. Mais qu'une lecture mâle m'élève le cœur et que d'illustres exemples viennent à m'aiguillonner, me voilà prêt à voler au forum, à prêter ma voix à tel accusé, à tel autre mon appui, peut-être inefficace, mais dévoué, et à humilier devant tous le superbe, gonflé de ses iniques succès.... Pour composer, je crois qu'en vérité le mieux est d'envisager le sujet en lui-même et d'y conformer son discours ; que du reste les mots se subordonnent aux choses, et que n'importe où celles-ci nous mènent,[4] l'expression suive sans trop se tourmenter. Qu'est-il besoin de composer pour la durée des siècles? Tu veux faire en sorte que la postérité ne taise pas ton nom? N'es-tu pas né pour mourir? N'est-il pas plus commode d'entrer dans la tombe en silence? Ainsi, pour occuper ton temps, pour ton utilité propre, non pour te faire préconiser, rédige quelques pages d'un style simple : il en coûte moins d'efforts à n'étudier que pour sa provision d'un jour. En revanche, si quelques grandes pensées exaltent mon âme, elle se répand en termes pompeux, elle cherche des inspirations plus hautes et des expressions qui y répondent, et mon discours s'élève à la dignité du sujet; oubliant alors les lois d'un goût trop circonscrit, je plane au-dessus de la terre et parle un langage qui n'est plus le mien. Enfin, et pour couper court aux détails, je porte en toutes choses cette même faiblesse de bonne intention : j'ai peur d'y céder à la longue, ou, ce qui est plus inquiétant, de rester toujours comme en suspens sur un abîme, plus profond peut-être que je ne crois le voir. Car on envisage avec complaisance ses défauts personnels, et l'amour-propre altère nos jugements. Beaucoup, je crois, seraient arrivés à la sagesse, s'ils n'eussent imaginé l'avoir atteinte, s'ils ne se fussent dissimulé en partie leurs imperfections ou n'eussent passé sur celles qui frappaient le plus leurs yeux. Car ne crois pas que les flatteries d'autrui nous soient plus mortelles que les nôtres. Qui ose se dire la vérité? Qui, au milieu d'un troupeau de panégyristes et d'adulateurs, n'a pas enchéri à part soi sur tous leurs éloges? Je t'en prie donc, si tu as quelque moyen de fixer cette fluctuation de sentiments, juge-moi digne de l'apprendre : que je te doive ma tranquillité. Ces mouvements de mon âme ne sont pas très-dangereux, n'amènent aucune révolte, je le sais, et pour décrire par une similitude exacte le sujet de mes plaintes, ce n'est peint la tempête, c'est le mal de mer qui me tourmente. Sauve-moi donc de ce malaise, quel qu'il soit ; secours un homme qui, en vue de la terre, s'épuise pour y aborder.
REPONSE DE SENEQUE
II. Depuis longtemps, crois-moi, cher Sérénus, je cherche moi-même en silence à quelle situation je puis comparer la tienne, et je ne trouve rien qui en approche plus que l'exemple d'un homme qui relève d'une longue et sérieuse maladie : quelques frissons, de légers ressentiments l'effleurent par intervalles, et quitte de ses derniers malaises, il forme toujours d'inquiètes conjectures; déjà guéri, il présente son pouls au médecin, il interprète en mal la moindre chaleur qu'il éprouve. Ce n'est pas, Sérénus, que la santé lui manque, mais il n'y est plus accoutumé ; ainsi frémit encore une mer redevenue tranquille ou un lac qui se repose de la tempête. Il n'est donc pas besoin ici de ces remèdes violents par lesquels déjà nous avons passé : il ne s'agit plus de lutter contre toi-même, de te gourmander ou de t'aiguillonner vivement ; il ne faut que ces soins qui viennent en dernier, qu'avoir foi en toi et te croire engagé dans la bonne voie, sans te laisser distraire par les traces multiples de ceux qui la traversent pour se perdre dans mille autres sens, ou de quelques égarés qui la côtoient d'un peu plus près. Mais le but où tu aspires est une chose grande, sublime, et qui rapproche de Dieu, l'impassibilité. Cette ferme assiette de l'âme, appelée chez les Grecs εὐτυμία, et qui fut pour Démocrite le texte d'un bel ouvrage, je l'appellerai tranquillité; car il n'est pas nécessaire d'imiter et de calquer jusqu'aux formes des expressions : la chose dont nous parlons veut être désignée par un terme qui ait la force du mot grec, non sa physionomie. Nous cherchons donc où réside cette constante égalité, cette allure uniforme d'une âme en paix avec elle-même, heureuse et charmée de ses seuls trésors, dont le contentement ininterrompu porte sur une base immuable, une âme enfin que rien ne peut enfler ni abattre : voilà la vraie tranquillité. Les moyens généraux d'y parvenir seront l'objet de mes recherches ; et de ce spécifique universel tu prendras telle dose que tu voudras. Commençons par signaler tous les caractères de la maladie où chacun reconnaîtra ses propres symptômes ; et pour ton compte tu comprendras que dans ce mécontentement de toi-même tu as bien moins à faire que ceux qui, enchaînés à quelque emploi brillant et accablés du poids d'un grand titre, s'obstinent dans leur rôle par mauvaise honte plutôt que par volonté. Rangeons tout à la fois dans la même classe et ces hommes qui, tristes jouets de leur légèreté, de leurs dégoûts, de leurs éternels changements de projets, n'aiment jamais rien tant que ce qu'ils ont quitté, et ceux qui croupissent dans le marasme de l'inertie. Ajoutes-y ceux qui, comme travaillés d'insomnie, s'agitent dans tous les sens, essayent de toutes les postures et ne doivent enfin le repos qu'à l'épuisement, renouvelant sans cesse les formes de leur existence pour s'arrêter où les a surpris, non point la haine du changement, mais la vieillesse, trop paresseuse pour innover; et ceux qui, peu changeants dans leurs plans de vie, persistent moins par constance que par apathie. Ils vivent, non comme ils veulent, mais comme ils ont commencé. Il est mille autres variétés de ce mal : mais uniforme en ses résultats, tout vice se déplaît à lui-même. Cela vient d'une âme privée d'équilibre, passionnée, mais timide ou malheureuse dans son ambition, soit qu'on n'ose pas tout ce qu'on désire, soit qu'on n'y atteigne point, et qu'élancé de plein vol vers ses espérances, on flotte forcément sans appuis ni base, suspendu dans l'espace qui nous sépare de l'objet de nos vœux. La vie n'est plus qu'incertitude, qu'apprentissage et pratique obligée d'artifices dégradants, pénibles ; et quand le succès manque à l'œuvre, on souffre de s'être déshonoré en pure perte, on gémit non d'avoir voulu le mal, mais de l'avoir voulu en vain. Alors viennent nous saisir et le regret de nos entreprises et la peur d'en commencer d'autres; alors grondent ces orages d'une âme qui ne trouve plus à s'épandre au dehors; car elle ne peut ni commander ni obéir à ses passions; l'existence s'arrête sur elle-même faute d'essor suffisant, et au milieu de ses vœux déconcertés une morne langueur la flétrit. Tous ces tourments s'aggravent encore, quand le dépit d'un malheur si chèrement acheté jette l'homme dans la retraite et vers les études solitaires auxquelles ne peut se plier un esprit tendu aux affaires, avide d'action, et inquiet par nature, pauvre qu'il est de ressources personnelles. Aussi, sevré des distractions que la multiplicité même des occupations procure, cet asile, cette solitude, ces murailles lui pèsent; il frémit de se voir livré à lui seul. De là cet ennui, ce mécontentement de soi, cette agitation de pensée qui n'a pas où se reposer, cette chagrine et maladive impatience du loisir, d'autant plus vive qu'on rougit d'en avouer les motifs, que l'amour-propre concentre profondément ses tortures, que les passions à la gêne et captives, faute d'issue se dévorent entre elles. De là ces abattements de corps et d'esprit, ce chaos d'irrésolutions sans fin, ces premiers pas qui laissent en suspens, ces échecs qui désespèrent, cette disposition à maudire notre inutilité, à nous plaindre de n'avoir rien à faire ; de là cette jalousie haineuse de l'agrandissement d'autrui. Car l'aliment de l'envie, c'est l'inertie après l'insuccès : on souhaite la ruine de tous parce qu'on n'a pas pu s'élever; et l'aversion que lui inspire l'avancement des autres, jointe au dépit de ses mécomptes, aigrit l'homme contre sa fortune, il querelle son siècle, il se réfugie dans l'ombre où il couve son propre supplice, seul avec ses dégoûts et sa confusion. En effet l'esprit humain, né pour agir, amoureux du mouvement, embrasse avec joie tout ce qui le réveille et l'entraîne au dehors; mais surtout, plus il est dépravé, plus l'activité le réjouit, même en le consumant. Certains ulcères recherchent le nuisible frottement de la main, et ce contact leur est doux; l'homme atteint de la gale trouve un plaisir bien vif clans tout ce qui envenime son mal hideux : ainsi l'Ame sur laquelle les ulcères des mauvais désirs ont fait éruption se délecte dans la tourmente et le tracas des affaires. Il y a, même pour le corps, certains plaisirs qui ne sont pas exempts d'une sorte de souffrance, comme de se retourner dans un lit et changer de côté pour prévenir la fatigue, ou prendre une position nouvelle pour trouver la fraîcheur. Tel est l'Achille d'Homère, couché tantôt sur le dos, tantôt sur la face, et qui essaye successivement de toutes les postures. C'est là le propre d'un malade : ne pouvoir supporter longtemps le même état et demander son remède au changement. Voilà pourquoi l'on entreprend des voyages sans but, on côtoyé tous les rivages, on promène sur la terre et sur l'onde une inconstance toujours ennemie des objets présents. Allons dans la Campanie. Puis déjà ce séjour de délices nous lasse : il nous faut une contrée sauvage. Parcourons le Brutium et les forêts Lucaniennes. Oui, mais cherchons parmi ces déserts de quoi récréer un peu nos yeux délicats de l'horreur monotone d'une nature repoussante. C'est Tarente : volons-y, voyons son port fameux, ses hivers tempérés, ses opulentes demeures dignes encore de leurs anciens maîtres; et bientôt : vite, retournons à Rome : depuis trop longtemps mes oreilles sont privées des applaudissements, du fracas du cirque ; courons rassasier nos yeux de sang humain. Les voyages se succèdent, les spectacles remplacent les spectacles, et comme dit Lucrèce : Ainsi l'homme toujours se fait lui-même....[5] Mais que sert de fuir, s'il ne se quitte pas? Il est à lui-même son éternel, son insupportable compagnon. Sachons-le donc bien : nos ennuis ne sont pas la faute des lieux, mais la nôtre.[6] L'homme n'a de force pour rien supporter, il ne souffre ni le travail, ni les plaisirs, ni lui-même, ni quoi que ce soit un peu longtemps. Quelques-uns furent poussés au suicide, parce qu'à force de varier leurs projets d'existence ils retombaient dans le même cercle et ne s'étaient plus laissé le moyen de changer encore. Ils ont pris en dégoût la vie et la scène du monde; de là le cri désespéré des hommes de plaisir : « Verrai-je donc toujours les mêmes choses?[7] » III. Contre cette sorte d'ennui tu me demandas le remède à employer? « Le meilleur serait, comme dit Athénodore, de se vouer aux affaires, aux emplois publics, aux devoirs de la vie civile, Si certains hommes passent tout le jour au soleil, dans les exercices et les soins du corps; si pour l'athlète il est essentiel de fortifier ses membres et de consacrer la majeure partie de son temps à entretenir cette force dont il fait son unique profession ; pour nous qui nous destinons aux luttes civiles, le travail de la pensée n'est-il pas une tâche bien plus belle encore? Car en se proposant de servir ses concitoyens et tous les hommes, on s'exerce et l'on profite à la fois dans cette succession des devoirs publics et privés que l'on embrasse selon ses forces. Mais, ajoute-t-il, comme au milieu de cette frénétique ambition des hommes et de ces calomnies sans nombre qui donnent un mauvais tour aux actions les plus droites, la franchise est peu sûre et que toujours les obstacles seraient plus nombreux que les facilités, il faut s'éloigner du forum et des fonctions publiques. « Mais, même au foyer domestique, l'âme trouve encore à déployer sa grandeur. Il n'en est pas d'elle comme du lion et de ces animaux dont la loge arrête les élans, c'est dans l'isolement qu'elle agit le mieux. En quelque lieu toutefois qu'elle se cache et dérobe le mystère de sa retraite, que son vœu soit de servir l'État comme les individus par ses talents, sa voix ou ses conseils. Car celui-là n'est pas seul utile à la république qui produit des candidats, défend des accusés, opine sur la paix et la guerre ; exhorter au bien la jeunesse ; dans une si extrême disette de sages précepteurs, former les âmes à la vertu, et quand elles se ruent vers les richesses et la volupté, les saisir, les ramener et, si l'on ne peut mieux faire, ralentir au moins leur course, voilà au sein de la vie privée faire œuvre d'homme public. « Est-ce que celui qui juge entre les citoyens et les étrangers, ou le préteur urbain qui prononce aux plaideurs l'arrêt dont un assesseur lui dicte la formule, font plus que l'homme qui enseigne ce que c'est que justice, piété, patience, courage, mépris de la mort, connaissance des dieux, quel trésor est une bonne conscience et qu'on ne la doit qu'à soi-même? Oui, si tu donnes ton temps à de telles études, en le dérobant aux foliotions publiques, tu n'as point déserté ni abdiqué ton ministère. Ce qu'on nomme la vie militaire, ce n'est pas seulement faire face à l'ennemi et se battre à la gauche ou à la droite. Ils sont soldats aussi ceux qui gardant les portes des places, dans un poste, moins périlleux, mais nul n'exclut pas l’action, sentinelles vigilantes ou chefs des arsenaux : si leur sang ne coule pas avec leurs sueur, on ne les leur compte pas moins comme services. Réfugie-toi dans l'étude, tu échapperas à tous tes dégoûts de l’existence : l’ennui du jour ne te fera pas soupirer après la nuit, tu ne seras point à charge à toi-même et inutile aux autres, tu t'attireras de nombreux amis, et les plus honnêtes citoyens afflueront vers toi. Jamais en effet, si obscure qu'elle soit, la vertu ne reste cachée;[8] elle exhale au loin ses parfums, et quiconque est digne de l'approcher la devine à la trace. Que si nous rompons tout commerce avec nos semblables, si nous répudions le genre humain pour vivre concentrés en nous seuls, l'effet de cette solitude, désaffectionnée de tout, sera l'absence de motifs d'action. Nous nous mettrons à bâtir ici, à démolir là, à repousser la mer par nos constructions, à faire venir de l'eau en dépit des lieux, à gaspiller ce temps que la nature nous donne pour un meilleur usage. Tel en est trop avare, tel autre, prodigue; ceux-ci le dépensent de manière à s'en rendre compte ; ceux-là ne s'en réservent rien. Et quoi de plus pitoyable qu'un vieillard qui n'a, pour témoigner qu'il a longtemps vécu, que le nombre de ses années![9] » Pour moi, cher Sérénus, Athénodore me semble trop plier sous les circonstances, trop se hâter de faire retraite. Je ne nie point qu'il ne faille parfois reculer, mais insensiblement, pas à pas, en sauvant ses aigles, en sauvant l'honneur militaire. L'ennemi respecte et ménage mieux ceux qui parlementent sous les armes. Ainsi doit faire, selon moi, le sage ou l'homme qui aspire à l'être. Si la fortune prévaut et lui retranche les moyens d'agir, qu'il n'aille pas incontinent tourner le dos, et fuir sans armes, cherchant à cacher, comme s'il était un lieu au monde où le sort ne pût nous poursuivre; qu'il mette seulement plus de réserve à s'engager dans un état et plus d'attention à bien choisir celui où il pourra servir la patrie. On lui ferme la carrière des armes? Qu'il aspire aux honneurs civils; réduit à la vie privée, qu'il soit orateur; condamné à se taire qu'il prête à ses concitoyens sa muette assistance. L'accès même du barreau lui serait-il périlleux? Il peut chez les particuliers, dans les spectacles, dans les repas, agir en homme de bon commerce, en ami fidèle, en convive tempérant. Dépouillé des fonctions de citoyen, qu'il remplisse ses devoirs d'homme. Aussi est-ce une des grandes vues du stoïcisme de ne point nous emprisonner dans l'enceinte d'une seule ville, de nous mettre en rapport avec le monde entier ; et si noua adoptons pour patrie l'univers,[10] ce n'est qu'afin d'ouvrir un champ plus vaste à la vertu. On te ferme le barreau, on te repousse de la tribune, des comices? Regarde derrière toi quelle immense étendue de régions se déploie, quelle multitude de peuples! Jamais une assez grande partie de la terre ne te sera interdite, qu'il ne t'en reste une plus grande encore. Prends garde seulement que tous les torts ne viennent de toi seul: tu ne veux peut-être servir la patrie qu'à titre de consul, ou de prytane, ou de céryx ou de suffète? Ne voudrais-tu donc aussi faire campagne que comme général ou tribun? Si les autres sont aux premiers rangs, si le sort t'a rejeté parmi les triaires, combats de la voix et de l'exemple, par tes exhortations et ton courage. Eût-il les mains coupées, le brave trouve encore à seconder les siens, rien qu'à garder son rang et à les animer de ses cris. Voilà ton rôle : que la Fortune t'éloigne des premiers postes de l'État, reste debout et assiste-nous de ta voix; si l'on étouffe ton cri dans ta gorge, reste debout encore, assiste-nous de ton silence.[11] Rien de ce que fait un bon citoyen n'est perdu : sa façon d'écouter, ses regards, son visage, son geste, son opposition muette, sa démarche même sont utiles. Comme ces substances salutaires qu'il n'est besoin ni de goûter, ni même de toucher, dont le parfum est efficace, la vertu répand de loin et sans qu'on la voie son heureuse influence. Soit que la vertu ait libre carrière et jouisse de ses droits, soit qu'elle n'ait qu'un accès précaire et replie forcément sa voile ; inactive, silencieuse et circonscrite, ou brillant au grand jour, en quelque état qu'elle soit elle sert l'humanité. Crois-tu donc qu'un sage repos soit d'un exemple si peu utile? Concluons que le parti le meilleur est de mêler le loisir aux affaires, lorsque des empêchements fortuits ou la situation politique font obstacle à la vie active. Car toutes les barrières ne sont jamais si bien fermées qu'un acte honorable ne puisse se faire jour Qu'on trouve une ville plus malheureuse qu'Athènes à l'époque où trente tyrans la déchiraient. Treize cents des meilleurs citoyens avaient été immolés par eux ; et leur cruauté, loin de s'assouvir, s'irritait par ses excès même. Cette ville où siégeait l'Aréopage, ce tribunal si vénéré, qui possédait un sénat auguste et un peuple digne de son sénat, voyait chaque jour leurs bourreaux tenir leur sinistre conseil; et la curie profanée était trop étroite pour tous ces tyrans. Quel repos pouvait-il y y avoir pour une cité qui comptait autant de tyrans que de satellites? Nul espoir d’affranchissement ne pouvait même s'offrir aux âmes; on n'entrevoyait nul remède contre tant de fléaux déchaînés. Où eût-elle trouvé, la malheureuse ville, assez d'Harmodius? Socrate cependant était au milieu de ce peuple, de ces sénateurs qui pleuraient et qu'il consolait; qui désespéraient de la république et qu'il rassurait ; au milieu de ces riches qu'effrayait leur opulence et auxquels il reprochait le tardif repentir d'une fatale avarice ; et il offrait à qui voulait l'imiter le grand exemple d'un citoyen qui marche libre en face de trente despotes. Voilà celui que cette même Athènes fit mourir en prison : il avait impunément bravé une légion de tyrans, et la cité libre ne put souffrir la liberté d'un homme. Sachons par là que même dans une patrie esclave l'occasion de payer de sa personne ne manque pas au sage, et que dans une ville florissante et prospère la cupidité, l'envie et mille autres vices, sans gardes armés, n'y sont pas moins rois. Ainsi, selon que le permettent les circonstances politiques ou notre destin personnel, il faut étendre ou resserrer notre sphère d'action, mais agir en toute occurrence sans que la crainte nous retienne engourdis. Et l'homme de cœur est celui qui de toutes parts en butte à d'imminents périls, quand le bruit des armes et des chaînes résonne autour de lui, ne brise point son courage aux écueils, comme aussi ne s'y dérobe pas: s'enterrer n'est point se sauver. « J'aime mieux cesser d'être, disait, je crois, Curius Dentatus, que d'être mort dès cette vie. » Quoi de pire en effet que de se voir effacé du nombre des vivants avant l'heure du trépas? Créons-nous un tout autre sort : si nous tombons sur une époque où la chose publique soit trop peu maniable, sacrifions davantage au loisir et aux lettres; comme dans une traversée périlleuse, prenons terre plus souvent; et sans attendre que les affaires noua quittent, prenons congé d'elles les premiers. IV. Il faut considérer d'abord ce que nous sommes, puis ce que nous voulons entreprendre, enfin les hommes pour lesquels et avec lesquels nous devons agir. Ce que nous sommes, ai-je dit, avant tout! car presque toujours l'amour-propre nous exagère nos forces. L'un échoue pour avoir trop compté sur son éloquence ; l'autre Impose à ses biens plus de charges qu'ils n'en peuvent porter ; l’autre accable son corps débile de fonctions trop laborieuses. Ceux-ci ont une modestie peu propre aux débats civils, qui veulent être abordés avec assurance, ceux-là une raideur malvenue à la cour. Quelques-uns ne sont pas maîtres d'une susceptibilité prompte à s'indigner, à s'échapper en discours imprudents. Il en est qui ne peuvent réprimer leur humeur railleuse ni retenir un bon mot qui peut les perdre. A tous ces gens-là le repos vaut mieux que les affaires : tout caractère indomptable et farouche doit fuir ce qui peut irriter sa dangereuse indépendance. V. Il faut ensuite apprécier nos entreprises et mesurer nos facultés à nos projets. Car il doit toujours y avoir plus de puissance dans le porteur que dans le fardeau, qui nécessairement nous écrase, s'il dépasse nos forces.[12] Il est encore des affaires moins grandes par elles-mêmes que parce qu'elles deviennent le germe fécond de mille autres : celles-là aussi doivent être évitées pour les embarras multiples qu'elles enfantent successivement. N'abordons pas non plus celles dont on n'est plus libre de se retirer; mettons la main aux choses que nous puissions ou terminer, ou du moins espérer voir finir. Renonçons à celles dont nos efforts ne peuvent qu'étendre le cercle et qui ne s'arrêtent point où on l'a voulu. VI. Enfin il faut choisir les hommes, voir s'ils sont dignes que nous leur consacrions une partie de notre existence, si le sacrifice de notre temps leur profitera. Certains nous croient leurs obligés à raison de nos propres services. Athénodore di sait qu'il n'irait point même souper chez qui ne penserait pas lui en avoir obligation. C'était assez dire qu'il irait bien moins encore chez ceux qui prétendent payer d'un dîner un service d'ami et comptent chaque plat pour un cadeau,[13] comme si c'était pour nous faire honneur qu'ils boivent et mangent outre mesure. Qu'on leur ôte témoins et convives, l'orgie à huis clos ne les charmera guère. Demande-toi si c'est à l'action ou aux loisirs studieux et à la contemplation, que la nature t'a fait le plus apte, puis incline où te porte l'instinct de ton génie, Isocrate saisit et entraîna d'autorité Ephorus loin du barreau, lui croyant plus de dispositions pour écrire l'histoire. Car les vacations forcées réussissent mal, tout labeur contre nature est stérile.[14] VII. Mais rien n'est douloureux à l’âme comme une amitié fidèle et tendre. Quel trésor que des cœurs prêts à recevoir sans danger pour nous tous nos secrets, des consciences moins sévères que la nôtre, des hommes dont l’entretien charme nos soucis, dont le prudent conseil nous éclaire dont la gaieté dissipe nos chagrins, dont la vue seule nous réjouit! Choisissons-les ces amis, autant qu'il se peut, libres de passions. Le vice en effet s'insinue, et de proche en proche il se communique; son contact seul est funeste. Si donc en temps de peste on doit prendre garde de s'arrêter auprès des personnes déjà infectées et que le fléau dévore, car nous contracterions leur mal et leur atmosphère seule nous empoisonnerait ; de même dans le choix de nos amis nous tâcherons de nous associer les âmes qui ont le moins perdu de leur pureté. C'est inoculer le fléau que de mêler à ce qui est malade ce qui ne l'est pas; non que je te prescrive de ne chercher, de n'attirer vers toi que le sage : car où le trouver ce mortel que nous poursuivons depuis tant de siècles? Le meilleur, c'est le moins mauvais. A peine aurais-tu la chance d'un plus heureux choix, quand tu chercherais parmi les Platon, les Xénophon et tous les rejetons de la souche socratique, quand tu pourrais puiser au siècle de Caton, qui produisit bien des hommes dignes d'avoir Caton pour contemporain, et bien des artisans de crimes les plus atroces que nulle part on ait vus. Car il fallait l'une et l'autre espèce d'hommes pour que Caton pût être compris. Caton dut avoir affaire aux bons pour en être admiré, et aux méchants, pour mettre sa vertu à l'épreuve. Mais aujourd'hui, par cette grande disette de gens de bien, soyons moins dédaigneux dans nos choix. Toutefois, évitons notamment ces gens moroses qui se lamentent sur tout, qui se complaisent à voir en tout des sujets de plainte. Même constamment fidèle et dévoué, c'est toujours un ennemi de ton repos qu'un compagnon irritable et à tout propos pessimiste. VIII. Passons à la propriété, source la plus féconde des tribulations humaines.[15] Car si tu mets dans la balance d'un côté tous nos autres tourments : morts, maladies, craintes, regrets, douleurs et travaux à subir, et de l’autre les maux qu'enfante l'intérêt, ce dernier côté l'emportera de beaucoup. Il faut songer ici combien c'est un plus léger chagrin de ne pas posséder que de perdre et nous comprendrons que la pauvreté est d'autant moins en butte aux regrets cuisants, qu'elle a moins de dommages à craindre, C'est une erreur de penser que le riche endure plus courageusement les pertes que le pauvre! les plus grands corps sentent aussi bien que les plus petits la souffrance des blessures. Bion dit ingénieusement : « Il est aussi douloureux aux têtes chevelues qu'aux têtes chauves[16] de se sentir épiler. » Il en est de même, sache-le bien, du riche et du pauvre : la perte est pénible à l'un comme à l'autre ; leur argent faisait corps avec eux : la séparation ne s'opère pas sans déchirement. Au reste, il est plus supportable, je le répète, et plus aisé de ne pas acquérir que de se voir dépouiller ; et tu trouveras des visages plus riants chez ceux que la fortune ne visita jamais que chez ceux qu'elle a délaissés. Il l'avait compris, ce Diogène, cette âme grande et virile; et il s'arrangea de manière que rien ne pût lui être ravi. Appelle cela pauvreté, dénuement, détresse, flétris cette sécurité de tel nom que tu voudras, je veux croire que là n'est pas le bonheur, si tu me montres quelque autre état à l'abri des spoliations. Ou je me trompe, ou c'est être roi parmi tant d'hommes cupides et fourbes, parmi tant de larrons et de pirates, que d'être le seul à qui l'on ne puisse faire tort. Si l'on conteste la félicité de Diogène, que l'on doute aussi de la condition des dieux immortels et s'ils peuvent vivre heureux sans métairies, sans jardins, sans riches campagnes peuplées de colons étrangers, sans argent à gros intérêts sur la place. Ne rougis-tu pas, ô homme! de t'ébahir ainsi devant les richesses? Lève tes regards vers le ciel : tu verras les dieux nus, donnant tout, ne se réservant rien. Appelleras-tu pauvre, plutôt que semblable aux dieux, l'homme qui s'est dépouillé des dons du hasard? L'homme heureux, selon toi, sera-ce un Démétrius, cet affranchi de Pompée, qui n'eut pas honte d'être plus opulent que son maître? Chaque jtfur la liste de ses esclaves, comme à un général les rôles de son armée, était apportée à cet homme, qui, dès le principe, eût dû se trouver riche avec deux esclaves suppléants et un bouge moins étroit. Diogène, lui, n'avait qu'un serviteur, lequel prit la fuite : on lui indiqua où il était; il ne parut point que ce fût la peine de se le faire ramener. « Ce serait une honte, dit-il, que Manès pût vivre sans Diogène, et que Diogène ne pût vivre sans Manès. » Je m'imagine l'entendre ajouter ; « Fortune! va faire ailleurs de tes tours! il n'y a plus rien à toi chez Diogène. Mon esclave s'est enfui ; je dis mal : c'est un homme libre qui est parti. » Une troupe d’esclaves exige le vêtement et la nourriture! Il faut fournir aux nombreux estomacs de la plus vorace des engeances, lui acheter des habits, surveiller toutes ces mains si rapaces, enfin tirer parti d’êtres qui ne servent qu’en pleuvant et en maudissant. Combien est plus heureux l'homme qui n'a de frais à faire que pour celui qu'il coûte le moins de refuser, c'est-à-dire que pour lui-même! Mais n'ayant pas cette force en nous, ayons de moins amples patrimoines : nous serons moins exposés aux injures du sort. Les tailles moyennes, qui peuvent se ramasser sous le bouclier, valent mieux à la guerre que celles qui dépassent les autres, et qui offrent en tous sens une grande surface aux blessures. La vraie mesure de fortune est celle qui, sans tomber dans la pauvreté, ne s'en éloigne pas de beaucoup. IX. Cette situation nous plaira, si d'abord nous avons du goût pour l'économie, sans laquelle les plus grandes richesses ne suffisent point, et avec laquelle les plus minces fournissent assez, d'autant que la ressource est à notre portée et que la pauvreté économe peut se tourner en vraie richesse. Habituons-nous à éloigner de nous le faste, et à priser dans les choses l'utilité, non l'éclat. Mangeons pour apaiser la faim, buvons pour éteindre la soif; ne payons au plaisir charnel que le tribut nécessaire. Sachons nous servir de nos jambes, régler notre table et notre costume non sur les exemples modernes, mais comme nous y invitent les mœurs de nos pères. Sachons nous fortifier dans la continence, repousser le luxe, fuir l'intempérance, calmer notre colère, envisager de sang-froid la pauvreté, cultiver la frugalité (dussions-nous avoir quelque honte d'apaiser à peu de frais des appétits naturels), tenons comme à la chaîne nos fougueuses espérances et notre imagination élancée vers l'avenir, et faisons en sorte que nos richesses viennent de nous-mêmes plutôt que de la Fortune. Oui, il est impossible, au milieu des variables et injustes caprices du sort, que de nombreux coups de vent ne frappent pas ceux qui déploient de trop vastes agrès : réduisons nos biens à d'étroites limites, et les coups porteront à faux. Aussi a-t-on vu bien souvent des exils et des disgrâces salutaires ; et de légers malheurs en ont guéri de plus graves, quand l'homme, sourd aux sages conseils, ne comportait pas un traitement plus doux, Eh! ne lui est-il pas utile que la pauvreté, l'ignominie, le renversement de sa position, le sauvent d'un grand mal par un moindre? Accoutumons-nous donc à pouvoir manger sans un peuple de convives, à nous faire servir par moins de valets, à n'avoir d'habits que pour l'usage qui les fit inventer, à être logés moins au large. Ce n'est pas seulement aux courses et aux luttes du cirque, c'est dans la carrière de la vie qu'il faut apprendre à tourner court. Même les dépenses pour les études, les plus nobles de toutes, ne me paraissent raisonnables que si elles sont modérées. Que me font ces immenses quantités de livres, et ces bibliothèques dont le maître en toute sa vie peut à peine lire les titres? Cette masse d'écrits surcharge plutôt qu'elle n'instruit; et il vaut bien mieux t'adonner à un petit nombre d'auteurs que d'en effleurer des milliers. Quatre cent mille volumes furent brûlés à Alexandrie; superbe monument d'opulence royale! répéteront des enthousiastes, après Tite Live, qui appelle cela l'œuvre de la magnificence et de la sollicitude des rois. Il n'y eut là ni magnificence ni sollicitude; il y eut faste littéraire, que dis-je, littéraire? ce n'est pas pour les lettres, c'est pour la montre qu'on fit ces collections ; ainsi, chez le grand nombre, chez des gens qui n'ont même pas l'instruction d'un esclave, les livres, au lieu d'être des moyens d'étude, ne font que parer des salles de festin. Achetons des livres pour le besoin seulement, jamais pour l'étalage. « Mais je dépense plus honorablement de cette manière qu'en vases de Corinthe et en tableaux![17] » C'est un vice en tout que l'excès. Y a-t-il à excuser l'homme qui agence le citre[18] et l'ivoire en bibliothèque, qui va cherchant partout les œuvres bien complètes de tel auteur inconnu ou méprisé, et devant ses milliers de volumes, bâille, admirant par-dessus tout les tranches et les titres? Aussi est-ce chez les moins studieux que tu verras tout ce qu'il y a d'orateurs et d'historiens et des cases superposées du plancher au plafond; jusque dans les bains et les thermes, on a sa bibliothèque d'un poli parfait, comme indispensable ornement de maison. Tu pardonnerais volontiers cette manie, si elle provenait d'un excès d'amour pour l'étude ; mais ces recueils précieux, mais, avec leurs portraits, les écrits de ces divins génies s'achètent pour le coup d'œil. Ils vont décorer des murailles.[19] X. Mais tu es tombé dans une position difficile, et inopinément des malheurs publics ou personnels sont venus t’enlacer d'un réseau que tu ne saurais dénouer ni rompre. Songe que les prisonniers ont d'abord peine à supporter le poids de leurs fers et de leurs entraves : peu à peu le désespoir fait place à des dispositions plus résignées; la nécessité leur enseigne à tout subir avec courage, l'accoutumance le leur rend facile. Point de situation dans la vie qui n'ait ses douceurs, ses heures de relâche, ses plaisirs, pourvu qu'au lieu de se croire à plaindre, on travaille à se faire envier. Le meilleur titre que la nature ait à notre reconnaissance, c'est que sachant pour quelles misères nous naissons, elle a imaginé, comme adoucissement à nos peines, l'habitude qui nous familiarise vite avec ce qu'elles ont de plus rude.[20] Nul n'y résisterait, si les adversités avaient dans leur durée la même violence qu'au premier choc. La fortune nous mène tous en captifs : l'un porte des fers dorés et plus lâches ; ceux de l'autre sont plus serrés et de métal grossier. Mais qu'importe? la même surveillance nous enveloppe tous; ils sont enchaînés aussi ceux qui rivent nos chaînes,[21] à moins qu'on ne juge moins lourde celle qui tient au bras gauche des gardiens. A celui-ci ses honneurs, à celui-là son opulence, à ce troisième sa noblesse, à cet autre son obscurité, sont autant de liens odieux; certains hommes sentent peser sur leur tête le pouvoir d'autrui, quelques-uns le leur propre ; tel a l'exil pour prison, tel autre le sanctuaire. Tout état est un esclavage. Accoutumons-nous donc au nôtre; plaignons-nous-en le moins possible, et sachons saisir tout ce qu'il s'y rattache d'avantages. Il n'est pas de sort si pénible qu'un bon esprit n'y trouve quelque dédommagement. Souvent, par une habile distribution, un très petit espace se prête à une foule d'emplois, et l'enclos le plus resserré devient habitable à qui sait en tirer parti. Oppose la raison à tous les obstacles : devant elle les âpres écueils s'aplanissent, les étroits sentiers s'élargissent, et les fardeaux sont moins lourds à qui sait les porter. Il ne faut pas non plus que nos désirs volent trop loin ; ne leur laissons que l'horizon le plus proche, puisqu'ils ne peuvent souffrir une captivité absolue. Renonçons à ce qui n'est point pour nous ou qui coûte trop de peine ; allons à ce qui appelle notre main et sourit à nos espérances ;[22] mais sachons que toutes choses sont également frivoles; à l'extérieur diverses formes, au fond mêmes vanités. N'envions point ceux qui tiennent les hauts rangs : leur apparente élévation n'est que le penchant d’un précipice. A leur tour ceux qu'un sort perfide a mis sur ces postes glissants auront moins à craindre s'ils dépouillent l'orgueil naturel de leur fortune, s'ils font descendre leur grandeur le plus qu'ils pourront vers le plain-pied des autres hommes. Il en est plus d'un sans doute que la nécessité enchaîne à ces sommets d'où l'on peut tomber, mais d'où l'on ne descend point; qu'ils témoignent du moins que le plus lourd de leur tâche est d'être obligés de peser sur les autres; qu'ils sont bien moins élevés que cloués à leurs charges. A force d'équité, de douceur, d'humanité dans le commandement, de générosité dans leurs grâces, qu'ils se ménagent pour les chutes à venir maint adoucissement, et que, suspendus sur l'abîme, cet espoir les rassure un peu. Mais rien ne préserve mieux de ces orages de l'âme que de fixer toujours quelque limite à son élévation et, au lieu d'attendre que la Fortune nous quitte à sa fantaisie, de s'exhorter soi-même au repos bien en deçà du dernier terme. Ainsi nous ressentirons encore la pointe de quelques désirs, mais bornés, qui ne nous jetteront pas dans l'incertain et l'infini. XI. Ceci s'adresse aux âmes imparfaites, faibles et non encore guéries; je ne parle pas au sage. Celui-là n'a pas à marcher d'un pas timide et par tâtonnements; il a tellement foi en lui-même qu'il avancera sans hésiter à l'encontre de la Fortune et jamais ne lâchera pied devant elle. Car en quoi pourrait-il la craindre? Ses esclaves, son avoir, son rang parmi les hommes, tout son être enfin et ses yeux et ses mains, et le reste des choses qui peuvent rattacher à la vie, le sage met tout cela, met tout son être enfin nombre des objets précaires; il use de la vie comme d'un prêt, qu'il va rendre sans chagrin à la première répétition. Et loin de le rabaisser à ses propres yeux, cette idée qu'il ne s'appartient pas lui fait apporter en toute chose autant de scrupule et de circonspection qu'une conscience religieuse et pure en met dans la conservation d'un dépôt. Sommé de rendre, il ne voudra pas chicaner avec la Fortune, il lui dira : « J'ai possédé, j'ai joui, je te rends grâce. Il m'en a coûté cher pour utiliser ton bien ; mais tu l'ordonnes, je te le remets avec reconnaissance et de grand cœur. Veux-tu me laisser quelque chose de toi, je saurai encore le garder. En disposes-tu autrement, mon argent, soit monnaie, soit ciselures, ma maison, mes esclaves, je rends, je restitue tout cela. » Si c'est la nature, notre première créancière, qui nous appelle à restitution, disons-lui de même : « Reprends cette âme meilleure que tu ne me l'as donnée. Sans tergiverser, ni reculer, je te représente volontairement ce que j'ai reçu de toi sans le savoir ; emporte-le. » Retourner au lieu d'où l'on est venu, qu'y a-t-il là de si terrible? Celui-là vivra mal qui ne saura pas bien mourir. La vie est la première chose qu'il faut réduire à sa vraie valeur : compte-la au nombre de tes servitudes. « On ne peut souffrir, dit Cicéron, les gladiateurs qui s'abaissent à tout pour obtenir la vie ; on s'intéresse à ceux qui portent sur le front le mépris du trépas. » Ainsi de nous : c'est une cause ordinaire de mort que la peur de mourir. Dans les jeux qu'elle se donne à elle-même la Fortune dit au lâche : « Pourquoi t’épargnerais-je, indigne combattant? Tu seras d'autant plus déchiré de coups et de blessures que tu ne sais pas tendre la gorge. Mais tu vivras plus longtemps et ton agonie sera plus courte, toi qui, sans baisser la tête ni te couvrir de tes mains, reçois en brave le fer ennemi. » Qui craint la mort ne fera jamais acte d'homme vivant; mais celui qui sait bien que dès l'heure où il fut conçu son arrêt fut porté, celui-là vivra selon les termes de l'arrêt, et en même temps, par la même force d'âme, fera en sorte que nul événement ne soit imprévu pour lui. En voyant d'avance le possible comme certain, il amortira le choc de tous les maux : car, à l'homme qui s'y tient prêt, qui les attend, ils n'apportent rien de nouveau ; mais celui qui, plein de sécurité, ne prévoit que d'heureuses chances, est accablé lorsqu'ils arrivent. La maladie, la captivité, ma maison qui s'écroule ou s'enflamme, rien de tout cela ne peu; me surprendre. Je savais dans quelle orageuse société m'avait confiné la nature ; j'ai tant de fois ouï dans mon voisinage le cri des funèbres adieux, tant de fois vu passer devant ma porte la torche et les bougies des obsèques prématurées;[23] l'écroulement de quelque haut édifice a tant de fois frappé mon oreille ; tant de liaisons commencées au forum, au sénat, dans les entretiens, ont pour moi disparu dans la nuit qui est venue séparer nos mains unies et heureuses de fraterniser! Puis-je m'étonner jamais de voir fondre sur moi des périls qui n'ont cessé de planer sur moi? Combien cependant s'exposent à la mer sans songer aux tempêtes! Ne rougissons pas de prendre d'un méchant auteur une bonne pensée. Publius, talent plus vigoureux que les tragiques et que les comiques, quand il renonce aux plates bouffonneries et à ces propos qui s'adressent aux derniers rangs de l'amphithéâtre, Publius[24] nous dit, entre autres sentences qui s'élèvent non-seulement au-dessus du brodequin, mais même du cothurne : Le trait qui m'a frappé peut frapper tous les hommes. Si nous gravons cela au fond de notre âme, si nous regardons tous les maux, qui journellement pullulent sous nos yeux, comme ayant le chemin aussi libre vers nous que vers les autres, nous nous trouverons armés bien avant 1'atta.que. Il n'est plus temps de s'aguerrir au péril quand le péril est en présence. « Je ne pansais pas que cela dût être! Je n'aurais jamais cru l'événement possible! » Et pourquoi non? Où sont les richesses que l'indigence, la faim, la mendicité, ne suivent pas de près? Quelle dignité avec sa prétexte, son bâton d'augure et sa chaussure patricienne, ne marche pas voisine de l'accusation, du bannissement, des notes infamantes, de mille flétrissures et du dernier mépris? Quelle est la royauté que n'attendent pas la chute et la dégradation, et le vainqueur et le bourreau? Révolutions que ne séparent point de longs intervalles ; la même heure peut nous voir sur le trône et aux genoux d'un maître.[25] Souviens-toi que toute condition est chancelante, et que les revers d'autrui peuvent aussi t'atteindre. Tu es riche? L'es-tu plus que Pompée? Eh bien, lorsque Caïus, son parent de vieille date, hôte de nouvelle espèce, lui ouvrait le palais de César pour lui fermer sa propre maison, Pompée manqua de pain et d'eau. Il possédait des fleuves entiers qui naissaient et finissaient dans ses domaines, et il mendia l'eau des gouttières, il périt de faim et de soif dans le palais de son parent, de son héritier, qui marchandait les solennelles obsèques de l'affamé.[26] Tu fus honoré des plus hauts emplois? Furent-ils aussi grands, aussi inespérés, aussi illimités que ceux de Séjan? Le jour où le sénat lui avait fait cortège, il fut mis en pièces par le peuple, et, de celui que les dieux et les hommes avaient comblé de toutes les faveurs possibles, il ne resta rien pour h croc du bourreau. Tu es roi? Je ne te renverrai ni à Crésus qui par ordre du vainqueur monta sur le bûcher puis le vit éteindre, survivant ainsi à la royauté et au supplice; ni à Jugurtha qui en une même année fit trembler le peuple romain et reput ses yeux comme captif. Nous avons vu Ptolémée roi d'Afrique, et le roi d'Arménie, un Mithridate, dans les fers de Caligula ; l'un envoyé en exil, l'autre ne souhaitant rien qu'un exil moins perfide. Dans ces énormes vicissitudes de fortunes qui s'élèvent et qui tombent, si l'on n'envisage les maux possibles comme certains, on donne contre soi trop de forces à l'adversité, laquelle est désarmée dès qu'on l'ose voir venir. Une autre règle à suivre est de ne point travailler pour des choses vaines ou vainement, c'est-à-dire de ne pas aspirer à ce qu'on ne peut atteindre, ou à des conquêtes après lesquelles, à notre grande honte, une tardive lumière nous découvre le néant de nos ambitions; en un mot, que nos travaux n'aillent pas échouer sans effet ou que les effets ne soient pas indignes des travaux. Car c'est là presque toujours ce qui contriste : le défaut de succès ou un succès dont on rougit. XII. Retranchons ces allées et venues habituelles au peuple d'oisifs qui court saris cesse maisons, théâtres, places publiques avec des offres de service à tout venant, et l'air toujours affairé.[27] Demande à l'un d'eux sortant de chez lui où il va et ce qu'il compte faire : il te répondra qu'en vérité il n'en sait rien, mais qu'il verra du monde, qu'il fera quelque chose. Ils errent à l'aventure, à la quête des occupations et saisissant, non ce qu'ils auraient projeté de faire, mais ce que leur offre le hasard. Sans objet, sans résultat dans leurs courses, ils sont comme ces fourmis qui grimpent le long des arbustes et montent au sommet pour redescendre à vide jusqu'à terre. Voilà l'image de presque tous ces gens dont on qualifierait à bon droit l'existence de laborieuse inoccupation. C'est pitié de les voir courir comme à un incendie, heurtant ceux qui passent, tombant et faisant tomber; et pourquoi s'évertuent-ils tant? Pour donner un salut qu'on ne leur rendra point, ou grossir le deuil d'un mort qu'ils ne connaissent pas, ou assister au procès d'un plaideur par état, aux fiançailles d'un homme qui change de femme: à tout instant, ou suivre une litière qu'en certains endroits ils portent eux-mêmes. Ils rentrent chez eux excédés de fatigues infructueuses; ils jurent qu'ils ne savent pourquoi ils sont sortis, ni où ils sont allés ; et c'est à recommencer demain sur les mêmes allures qu'aujourd'hui. Que toute peine donc se propose un but, un résultat. A défaut de motifs réels, les esprits inquiets et les fous s'agitent pour de creuses chimères, car il faut même à de telles gens quelque espoir pour se remuer, incités qu'ils sont par des apparences telles quelles, dont l'imagination préoccupée ne reconnaît pas tout le néant. De même chacun de ces hommes, qui ne sortent que pour grossir la foule, a mainte idée frivole et vaine qui le promène par la ville et, sans qu'il ait la moindre affaire devant lui, l'arrache de son lit dès l'aurore, l'envoie heurter à vingt portes différentes, saluer vingt nomenclateurs; et refusé presque partout, la personne qu'il trouve le plus difficilement chez elle, c'est lui-même. De cette maladie procède un vice des plus odieux, la manie d'écouter, de s'enquérir de ce qui serait st de ce qui ne se sait pas, d'apprendre une foule de choses qu'il est dangereux de raconter et dangereux d'entendre. C'est, je crois, à ce propos que Démocrite a dit au début de son livre : « Qui voudra vivre tranquille ne se chargera pas de nombreuses affaires, publiques ou privées, s’entendant par là sans doute celles qui sont superflues, car les nécessaires, soit privées, soit publiques, il faut s'y, vouer, fussent-elles nombreuses, fussent-elles infinies ; mais quand ce n’est pas la voix solennelle du devoir qui commande, il faut s'abstenir d'agir. XIII. Celui qui entreprend beaucoup donne souvent prise à la Fortune ; le plus sûr est de la tenter rarement, de songer sans cesse à ses caprices et de ne se rien promettre de sa constance. Je m'embarquerai, à moins de quelque incident ; je serai préteur, si rien n'y met obstacle ; ma spéculation réussira, s'il ne survient quelque traverse. Voici pourquoi nous soutenons qu'il n'arrive au sage rien d'inattendu : nous l'affranchissons, sinon des accidents, du moins des erreurs communes; toutes choses ne tournent pas comme il l'a voulu, mais comme il l'a prévu. Or il a prévu avant tout que ses plans pouvaient rencontrer des résistances. Et il faut bien que le regret d'avoir désiré en vain soit moindre chez l'homme qui ne s'est pas promis en tout cas le succès. XIV. Prenons aussi cette facilité d'humeur qui n'embrasse pas trop ardemment un premier projet; passons de bonne grâce où le sort nous mène; ne redoutons point de changer de vues ou d'état : seulement ne tombons pas dans cette vicieuse mobilité de plans qui est le plus grand ennemi de notre repos. Car si l'obstination est une cause nécessaire de misère? et d'angoisses, puisque à chaque instant la Fortune lui arrache quelque illusion, un mal bien plus grave, c'est la légèreté qui ne se fixe nulle part. Deux fléaux pour la paix de l'âme : ne pouvoir ni changer ses plans, ni souffrir son sort. Détachons-nous donc entièrement du dehors pour revenir à nous : que sûre d'elle-même, heureuse et fière de ses avantages, notre âme se retire, le plus qu'elle pourra, de ce qui n'est pas elle, et que désormais toute à soi, insensible aux pertes, elle prenne en bonne part jusqu'à l'adversité. A la nouvelle d'un naufrage qui l'avait totalement ruiné, notre Zénon ne dit que ces mots : « La Fortune veut que je philosophe plus à l'aise. » Un tyran menaçait le philosophe Théodore de le faire mourir, de le priver même de sépulture : « Tu peux te satisfaire, répliqua celui-ci ; j'ai une pinte de sang à ton service. Quant à la sépulture, tu es bien simple de croire qu'il m'importe de pourrir dans la terre plutôt que dessus. » Canus Julius, grand homme s'il en fut, et qui n'a rien à perdre de notre admiration pour être né dans ce siècle-ci, venait d'avoir une longue altercation avec Caligula.[28] Le voyant sortir, le nouveau Phalaris lui dit : « Ne te flatte pas d'une fausse espérance, j'ai donné l'ordre de ta mort. — Grand merci! très excellent prince, » fut la réponse de Canus. Quel sens avait-elle? Je ne sais, car elle m'en présente plusieurs. Était-ce un sarcasme, une manière de peindre l'affreuse tyrannie sous laquelle la mort devenait une grâce? Lui reprochait-il ses scènes de frénésie journalière, où il se faisait remercier de ceux même dont il égorgeait les fils ou confisquait les biens? Ou acceptait-il avec joie la mort comme un affranchissement? Quoi qu'il en fût, sa réponse est celle d'une grande âme. Caligula, dira-t-on peut-être, était capable après cela de le condamner à vivre. Canus n'eut pas cette crainte : il savait le tyran fidèle à sa parole quand il promettait le supplice. Croirais-tu que les dix jours qui le séparaient de la mort, il les passa sans le moindre souci? On a peine à concevoir tout ce que dit, tout ce que fit cet homme, et quelle fut sa tranquillité. Il jouait aux échecs, lorsque le centurion, qui traînait au supplice une troupe de condamnés, le fit appeler à son tour. Canus alors compte ses pièces, dit à son adversaire : « N'allez pas après ma mort vous vanter faussement de m'avoir battu ; » et au centurion : « Vous serez témoin que j'ai sur lui l'avantage d'une pièce. » Était-ce là jouer aux échecs? C'était se jouer du tyran. Ses amis étaient consternés de l'immense perte qu'ils allaient faire : « Pourquoi cette tristesse? leur dit-il. Vous cherchez encore si l'âme est immortelle; moi, je vais le savoir tout à l'heure. » Et il ne cessa pas, même au dernier moment, de chercher la vérité, et de demander à sa propre mort une solution. Un philosophe attaché à sa personne l'accompagnait, et déjà ils approchaient du tertre où s'immolaient journellement à notre dieu Caligula des victimes humaines. « A quoi songez-vous en ce moment? demanda-t-il à Canus, et quelle pensée vous occupe? — Je me propose, dit celui-ci, d'épier, dans ce moment si rapide, si mon âme se sentira sortir. » Et il promit, s'il découvrait quelque chose, de venir chez tous ses amis leur révéler l'état des âmes. Voila bien le calme au fort de l'orage. Voilà un homme digne d'être immortel, qui appelle son heure fatale en témoignage de la vérité. Sur l'extrême limite de la vie, il interroge son âme au départ, et veut s'instruire non seulement jusqu'à son trépas, mais par son trépas même. Nul ne philosopha plus avant dans la mort. Aussi n'as-tu pas a craindre notre indifférence, ô grand homme, ô précieuse renommée! Nous te signalerons à la mémoire des siècles, illustre victime, qui tiens ta grande place dans les massacres de Caïus. XV. Mais que sert d'avoir repoussé les causes d'affliction personnelle? Il est des instants où une sorte d'horreur pour le genre humain nous saisit, à la rencontre de tant de crimes heureux, en voyant combien la simplicité de cœur est rare ; l'innocence peu connue; la bonne foi, si elle ne profite, presque nulle part; les gains de la débauche non moins odieux que ses profusions ; la vanité, pressée de franchir ses bornes naturelles jusqu'à vouloir briller par l'infamie. La pensée se perd dans cette nuit ; et de l'écroulement pour ainsi dire des vertus qu'il n'est ni permis d'espérer chez les autres, ni utile de posséder, il ne surgit plus que ténèbres. Il faut donc nous plier à ce tour d'esprit, qui envisage moins l'odieux que le ridicule des vices de l'humanité ; il faut imiter Démocrite plutôt que son adversaire. Héraclite ne pouvait se trouver en public sans verser des laisses, et Démocrite riait sans cesse. Dans tout ce que nous faisons l'on ne voyait que misères, l'autre que puérilités. Il faut tenir peu compte de quoi que ce soit et porter légèrement la vie ; le rire est ici plus humain que les larmes, et c'est mériter mieux de ses semblables de trouver en eux du plaisant que du triste. On leur laisse du moins quelque bon espoir; mais il y a folie à pleurer ce qu'on désespère de réformer; et à tout bien considérer, il est plus noble d'être gagné par le rire que par les pleurs. Le rire soulève une des plus légères affections de l’âme, il ne voit rien de grand, de sévère ni même de sérieux dans tout notre vain appareil. Qu'on réfléchisse sur chacune des choses qui nous font gais ou tristes, on sentira combien est vrai ce mot de Bion : « Toutes les affaires qui occupent les hommes sont de vraies comédies, et leur vie n'est ni plus respectable ni plus sérieuse que des embryons mal formés. » Mais le plus sage sera d'accepter tranquillement les mœurs communes et les vices des hommes sans se laisser aller ni aux rires ni aux larmes. Se tourmenter des misères d'autrui, c'est se vouer à d'éternels chagrins ; en faire un sujet de risée serait une jouissance barbare, tout comme c'est une stérile politesse que de verser des pleurs et composer son visage parce que le voisin enterre son fils. Et aussi, dans tes chagrins personnels, ne donne à la douleur que ce qu'exige non l'usage,[29] mais la raison. Car le grand nombre ne verse de larmes que pour être vu ; elles tarissent quand les témoins s'en vont; on croit malséant de ne pas pleurer quand tout le monde pleure. Elle est tellement invétérée en nous cette fausse honte qui nous assujettit à l'opinion, que la chose la plus naturelle, la douleur, arrive elle-même à l'affectation. Une autre considération bien légitime qui d'ordinaire contriste l'âme et la jette dans l'anxiété, c’est la fin malheureuse des hommes vertueux. C'est Socrate contraint de mourir dans les fers; Rutilius de vivre dans l'exil ; Pompée et Cicéron de tendre la gorge à leurs clients ; Caton, cette vivante image des vertus, se courbant sur son glaive et témoignant que le coup qui l’immole immole aussi la république. Quelle âme n'est torturée de voir là Fortune si inique dans ses récompenses? qu'espérer désormais, nous tous, quand les plus hommes de bien subissent les pires[30] destinées? Que faire donc? Examiner comment chacun d'eux a souffert la sienne : s'ils l'ont fait en héros, souhaiter leur courage ; si c'est lâchement et en femmes qu'ils périrent, leur perte est nulle pour l'humanité. Ou ils sont dignes que leur vertu te fasse envie, ou leurs cœurs pusillanimes ne valent pas un regret. Quelle honte ne serait-ce point, si la mort courageuse d'un grand homme n'enfantait que des lâches? Louons plutôt en lui un héros digne à jamais de nos éloges, et disons : « O l'homme de cœur! O l'homme heureux! te voilà libre des accidents humains, de l'envie, de la maladie, libre de la captivité : ce n'est pas toi que les dieux ont cru digne de la mauvaise fortune; c'est elle qu'ils ont crue indigne de pouvoir jamais rien sur toi. » Quant à ceux qui fuient la lutte et qui du sein de la mort tournent encore les yeux vers la vie, il faut les ramener forcément à l'ennemi. Je ne veux pleurer ni l'homme qui est dans la joie ni celui qui verse des larmes : le premier a séché les miennes; l'autre, s'il en répand, n'est plus digne d'en obtenir de moi. Quoi! je pleurerais Hercule expirant dans les flammes ; Régulus percé de clous qui le déchirent; ou Caton, de son propre fer?[31] Ils ont tous, au prix de quelques jours de vie, acheté une éternelle gloire ; ils sont arrivés par la mort à l'immortalité. Il est encore une source féconde de sollicitudes, c'est le pénible soin qu'on prend de se composer et de ne se jamais montrer tel qu'on est, comme font tant d'hommes dont toute la vie est un mensonge, une représentation de théâtre. Quel supplice que d'avoir sans cesse les yeux sur nous-mêmes, et de trembler qu'on ne nous reconnaisse pour n'être pas ce que nous semblons! Quelle anxiété de tous les instants que de prendre le moindre coup d'œil pour un jugement porté sur nous! Car mille incidents viendront malgré nous nous dévoiler;[32] et dût-on réussir dans un rôle aussi difficile, quelle jouissance ou quelle sécurité, de passer sa vie sous le masque! Mais quelle satisfaction dans cette simplicité franche qui n'a d'ornement qu'elle-même, qui ne jette pas un manteau sur ses mœurs! On court le risque, il est vrai, d'être mésestimé, si tout en nous est sans voile pour tous; car bien des gens dédaignent ce qu'ils abordent de trop prêt. Mais le vrai mérite n'a pas à craindre de rien perdre à un examen trop familier; et, après tout, le dédain que nous attirerait la franchise vaut mieux que le supplice d'une continuelle dissimulation. Prenons toutefois un juste milieu : la distance est grande entre la franchise et le trop d'abandon. Il faut aussi se retirer souvent en soi-même ; la fréquentation d'hommes qui ne nous ressemblent pas trouble l'âme la mieux réglée, réveille les passions et irrite ce qu'il peut y avoir en nous de parties faibles et mal guéries. Entremêlons toutefois les deux choses et cherchons tour à tour la solitude et le monde. L'une fait désirer de revoir les hommes, l'autre d'habiter avec soi ; elles se servent mutuellement de correctif; la solitude guérit du dégoût de la foule, la société dissipe l'ennui de l'isolement. Que l'esprit non plus ne soit pas toujours également tendu : appelons-le parfois aux délassements. Socrate ne rougissait pas de jouer avec des enfants ; et Caton cherchait dans le vin un allégement aux fatigues de la vie publique. Scipion,[33] chargé de triomphes, ne dédaignait point de mouvoir en cadence ses membres aguerris, non pas en affectant ces molles attitude : aujourd'hui à la mode qui donnent à la démarche même un air plus qu'efféminé, mais selon la danse toute virile dont ces hommes antiques égayaient leurs jours de fête, et qui ne leur faisait rien perdre de leur dignité, quand ils eussent eu l'ennemi pour spectateur. Il faut donner du relâche à la pensée : elle se relève, après le repos, plus ferme et plus énergique. Comme on ne doit pas trop exiger du champ le plus fertile qu'épuiserait bientôt une production non interrompue, ainsi l'esprit le plus vigoureux se brise par un labeur trop assidu. Il veut, pour reprendre sa force, être détendu, relâché quelque peu. De la continuité des travaux résulte pour lui une sorte d'émoussement et de langueur. Les hommes ne courraient pas avec tant d'ardeur aux divertissements et aux jeux, si un attrait naturel ne s'y rattachait : mais l'abus en ce genre ôte à l'esprit toute consistance et tout ressort. Ainsi le sommeil est indispensable à la réparation des forces ; cependant le prolonger et le jour et la nuit serait une vraie mort. Grande est la différence entre relâcher et dissoudre. Les législateurs ont institué des fêtes, réjouissances publiques obligées, qu'ils regardaient comme un tempérament et une interruption nécessaire aux travaux. Et de grands hommes, m'a-t-on dit, se sont donné chaque mois leurs jours de vacance; d'autres partageaient chaque journée entre le loisir et les occupations. Par exemple, je me rappelle Asinius Pollion, ce grand orateur ; passé la dixième heure,[34] nulle affaire ne l'aurait retenu; il n'ouvrait plus même ses lettres, crainte d'y trouver matière à de nouveaux tracas, et prenait deux heures pour se remettre des fatigues de tout le jour. D'autres dételaient au milieu de la journée et reportaient sur l'après-midi les affaires de moindre embarras. Nos pères ne voulaient point qu'après la dixième heure on fît de nouveaux rapporte au sénat. A la guerre, le service de nuit est alternatif ; et qui revient d'expédition à sa nuit franche. Ménageons nos forces intellectuelles et donnons-leur par intervalles un repos qui soit pour elles un aliment réparateur. La promenade dans les lieux découverts, sous un ciel libre et au grand air, récrée et retrempe nos facultés. Souvent un voyage en litière, un simple changement de contrée, donnent au moral une vigueur nouvelle, comme ferait encore un repas d'amis, un peu plus de vin que de coutume. Parfois même on peut aller jusqu'à l'ivresse, non pour s'y plonger, mais pour y noyer ses ennuis.[35] Car elle les enlève, elle remue l'âme dans ses profondeurs, et entre autres affections chasse la mélancolie. On appelle Liber l'inventeur du vin, non parce qu'il provoque la licence des paroles, mais parce qu’il délivre l'âme des soucis qui la tyrannisent, parce qu'il lui donne plus d'assurance, de vigueur et d'audace à tout entreprendre. Mais le vin, comme la liberté, n'est salutaire que pris avec mesure. On croit que Solon et Arcésilaüs aimaient à boire ; on a reproché à Caton l'ivrognerie : on arriverait plutôt à rendre ce reproche honorable qu'à ravaler Caton. Mais que le remède ne soit pas trop fréquent : il pourrait tourner en habitude dangereuse ; seulement, à certains jours, convions notre âme à une gaieté franche et libre, et faisons quelque trêve à l'austère sobriété. En effet, si nous en croyons un poète grec,[36] Il est doux par moments de perdre la raison. Vainement il frappe au temple des Muses, l'homme qui reste de sens rassis, dit Pluton; et Aristote : Point de grand génie sans un grain de déraison. L’imagination ne peut s'élever au grandiose et à la majesté du langage, si elle n'est fortement émue. C'est en dédaignant les pensées vulgaires et de tous les jours, c'est quand la souffle sacré l'exalte et la transporte, c'est alors qu'elle fait entendre des accents plus qu'humains. Elle ne peut atteindre à rien de sublime, à aucune œuvre ardue, tant qu'elle demeura en son assiette. Il faut qu'elle s'écarte de la voie commune, que toute à son élan et mordant son frein, elle entraîne son guide et le porte où il eût à lui seul désespéré de monter. Je t'ai montré, cher Sérénus, les moyens de conserver à l'âme sa tranquillité, de la lui rendre, de résister à la subtile contagion des vices. Sache bien toutefois qu'aucun de ces moyens n'est assez puissant pour préserver ce fragile trésor, si une active et continuelle vigilance n'entoure notre âme toujours prête à faillir.
[1] Rousseau semble s'être souvenu de tout ce passage dans son Emile : « Si j'étais riche, je n'irais pas me bâtir une ville à la campagne.... etc. » [2] Les stoïciens. Voy. Le Repos du sage, xii. [3] Voir des Bienfaits, VIII, ii. « Je mets ma liberté à si haut prix que tous les rois du monde ne pourraient me l'acheter, » dit Descartes dans une de ses lettres. [4] « C'est aux paroles à servir et à suivre, et que le Gascon y arrive, si le François n'y peut aller. » (Montaigne.) [5] De natura rerum, III, 1804. [6] Voir lettres II, xxviii, lxix, civ. [7] Voir aussi lettre 24.
Ce
riche qui, d'avance usant tous les plaisirs, [8] Suum sequitur lumen semper innocentiam. [9] Voir Brièveté de la vie, viii.
Que
je plains le vieillard qui n'a que des années [10] Comparer avec le chapitre XXXI du Repos du Sage. [11] Peut-être y a-t-il ici une allusion à Thraséas, dont le silence protestait sous Néron, et représentait l'opinion publique. [12] Voir de la Colère, III, vii. « Ne t'engage pas dans une multiplicité d'actions; si tu entreprends beaucoup d'affaires, tu ne seras pas exempt de fautes; si tu les suis toutes, tu n'y pourras suffire; si tu vas au-devant, tu seras accablé. » {Ecclesiast., xi, 20.)
[13]
Avant tout souviens-toi qu'en valable monnaie
[14]
………….. Ne forçons point notre talent, [15] Voir de la Colère, III, xxxiii. Radix omnium malorum cupiditas. (Saint Paul.) [16] Imité par Bossuet : « C'est une folie de s'imaginer que les richesses guérissent de l'avarice, ni que cette eau puisse étancher cette soif. Nous voyons par expérience que le riche à qui tout abonde n'est pas moins impatient dans les pertes que le pauvre à qui tout manque. Il en est comme des cheveux qui font toujours sentir la même douleur, soit qu'on les arrache d'une tête chauve, soit qu'on les tire d'une tête qui en est couverte. Ainsi chaque petite parcelle du bien que nous possédons tenant dans le fond du cœur par sa racine particulière, il s'ensuit manifestement que l'opulence n'a pas moins d'attache que la disette, au contraire, qu'elle est en ceci et plus captive et plus engagée, qu'elle a plus de liens qui l'enchaînent et un plus grand poids qui l'accable. » (Serm. sur l'impénit.) [17] Voir De la brièveté de la vie, xii. [18] Armarium citro atque ebore aptanti, leçon de quelques manus. préférable au captanti de toutes les éditions. Le citre est ce thuya d'Algérie dont on fait des meubles si élégants. « Le citre aux taches d'or qu'a l'or même on préfère. » (Pétrone, cix.) [19] Voir Pline l'ancien, XXXV, ii. [20] Comparer Montaigne, III, ix.
[21]
Car penser s’affranchir c'est une resverie ;
« Quand la politique humaine attache sa chaîne au cou d'un esclave, la justice divine en rive l'autre bout au cou du tyran. » (Bernardin de Saint-Pierre. Étud. vii.)
Toute puissance est une gêne : [22] « Selon qu'on peut : c'estoit le refrain et le mot favori de Socrate : mot de grande substance : il faut adresser et arrester nos désirs aux choses les plus aisées et voisines. » (Montaigne, III, ii.) [23] Voir Cons. à Polybe, xxix, et à Marcia, ix, et Brièveté de la vie, xx. Sénèque (Herc. furieux, vers 855), donne de cet usage une explication ingénieuse : « Aux enfants seuls, pour qu'ils aient moins peur, on accorde un flambeau qui les précède et éclaircit l'ombre infernale. Les autres s'enfoncent tristement dans les opaques ténèbres. » [24] Voy. sur Publius Syrus, Consol. à Marcia, ii. [25] Comparer avec Massillon : Incertit. de la vie, et Bossuet : Serm. du 5e dim. après l'Épiph. [26] On ignore quel est ce descendant de Pompée. [27] Voir la lxxxviie lettre persane. [28] Sans doute au sujet du complot dont Caligula l'accusait d'être instruit : « Si je l'étais, répondit Canus, lu ne l'aurais jamais su. » (Boèce, De la Consolation philosophique). [29] Voy. Consol. à Marcia, lxiii et xciv.
[30]
Partout des malheureux, des proscrits, des victimes,
[31] Je lis, avec le manusc. Colbert : aut Catonem vulnere suo? au lieu de aut Catonem quod vulnera sua fortiter tulit? leçon faible et plate.
[32]
On a beau se farder aux yeux de l'univers, [33] Il s'agit de Scipion le premier Africain. Cic., De Orat., II; Horace, Sat. II, i. [34] C'est-à-dire quatre heures après midi, selon notre manière de compter. [35] Sénèque, sur ce point, se réfute lui-même : Lettre lxxxiii. [36] Anacréon. Dulce est desipere in loco. Hor., Odes IV, xii. |
|
|