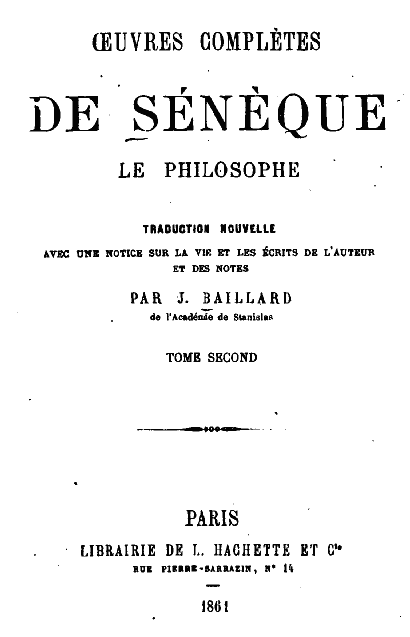|
SÉNÈQUE QUESTIONS NATURELLES
LIVRE V LIVRE I - LIVRE II - LIVRE III - LIVRE IV - LIVRE VI Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
|
LIVRE V
Ce que c'est que le vent. Diverses sortes de vents. Leurs avantages. Comment l'homme en a fait des instruments de malheurs.
I. Le vent est un écoulement d'air. Selon quelques-uns, c'est l'air qui prend cours sur un point. Cette définition semble plus exacte, parce que l'air n'est jamais tellement immobile qu'il n'éprouve quelque agitation. Ainsi l'on dit que la mer est tranquille, quand elle n'est que légèrement émue et qu'elle ne se porte pas tout d'un côté. Lors donc que tu liras : Quand la mer et les vents sommeillaient....,[1] dis-toi bien qu'il n'y a pas là immobilité, mais faible soulèvement ; que l'on nomme calme l'état d'une mer qui ne se meut pas plus fort dans un sens que dans l'autre. Il faut en dire autant de l'air, qui n'est jamais sans mouvement, fût-il même paisible ; et tu vas le concevoir. Quand le soleil s'insinue dans quelque lieu fermé, nous voyons de minimes corpuscules voler à sa rencontre, monter, descendre, s'entrechoquer de mille manières. Ce serait donc donner une définition incomplète que de dire : « Les flots sont une agitation de la mer, » car cette agitation existe même lorsque la mer est tranquille. Pour éviter toute surprise, il faut dire : « Les flots sont une agitation de la mer poussée en un sens. » De même, dans la question actuelle, on échappe aux contradicteurs, si l'on dit : « Le vent est un air qui prend cours vers un point; ou un cours d'air impétueux, ou un effort de l'air vers un seul côté, ou un de ses élans plus fort que de coutume. » Je sais ce qu'on peut répondre à propos de la première définition : qu'est-il besoin d'ajouter que c'est vers un point qu'il prend cours? Nécessairement ce qui court, court vers un point quelconque. Nul ne dit que l'eau court, quand elle se meut sur elle-même; c'est quand elle se porte quelque part; il peut donc y avoir mouvement, sans qu'il y ait cours; et en revanche, il ne peut y avoir cours qui ne tende quelque part. Si cette brève définition est à l'abri de la critique, employons-la; si l'on y veut plus de scrupule, ne lésinons pas sur un mot dont l'addition préviendrait toute chicane. Venons maintenant à la chose même ; c'est assez discuter sur les termes. II. Démocrite dit que le vent se forme lorsque dans un vide étroit sont réunis un grand nombre de corpuscules, qu'il appelle atomes; l'air, au contraire, est calme et paisible, lorsque dans un vide considérable ces corpuscules sont peu nombreux. Dans une place, dans une rue, tant qu'il y a peu de monde, on circule sans embarras; mais si la foule se presse en un passage étroit, les gens qui se renversent les uns sur les autres se prennent de querelle ; ainsi, dans l'atmosphère qui nous environne, qu'un espace exigu soit rempli d'un grand nombre d'atomes, il faudra qu'ils tombent l'un sur l'autre, qu'ils se poussent et repoussent, qu'ils s'entrelacent et se compriment. De là se produit le vent, lorsque ces corps qui luttaient entre eux commencent à céder et à fuir après une longue fluctuation. Dans un espace considérable où nageront quelques atomes, il n'y aura ni choc ni impulsion. III. Cette théorie est fausse ; et ce qui le prouve, c'est que parfois il n'y a pas le moindre vent quand l'air est tout chargé de nuages. Alors pourtant il y a plus de corps pressés et à l'étroit, ce qui produit l'épaisseur et la pesanteur des nuages. Ajoute qu'au-dessus des fleuves et des lacs s'élèvent fréquemment des brouillards dus à l'agglomération de corpuscules condensés, sans que pour cela il y ait du vent. Quelquefois même le brouillard est assez épais pour dérober la vue des objets voisins ; ce qui n'aurait pas lieu sans l'entassement d'une multitude d'atomes sur un petit espace. Jamais pourtant il n'y a moins de vent que par un temps nébuleux ; c'est même le contraire qui arrive : le soleil, au matin, dissout en se montrant, les vapeurs humides qui épaississent l'air. Alors le vent se lève, après que la masse de ces corpuscules, enfin dégagée, se résout et se dissémine. IV. Comment donc se forment les vents, puisque tu nies, qu'ils se forment[2] comme le veut Démocrite? —De plus d'une manière. Tantôt c'est la terre elle-même qui exhale et chasse à grands flots l'air de son sein ; tantôt, lorsqu'une grande et continuelle évaporation a poussé de bas en haut ces exhalaisons, c'est de leur modification et de leur mélange avec l'air que naît le vent. Car je ne puis me résoudre à admettre ni à taire cette idée que, tout comme dans le corps humain la digestion donne lieu à des vents qui offensent vivement l'odorat, et dont nos entrailles se débarrassent tantôt bruyamment, tantôt en silence ; de même cet immense corps de la nature enfante des vents lorsqu'il digéré. Il est heureux pour nous que ses digestions soient toujours bonnes : autrement nous aurions à craindre quelque chose de bien suffoquant. Ne serait-il pas plus vrai de dire que de toutes les parties du globe il s'élève incessamment des niasses de corpuscules qui, d'abord agglomérés, puis raréfiés peu à peu par l'action du soleil, exigent, comme tout corps comprimé qui se dilate, un espace plus considérable, et donnent naissance au vent? V. Eh quoi! n'y aurait-il pas, selon toi, d'autre cause des vents que les évaporations de la terre et des eaux qui, après avoir pesé sur l'atmosphère, se séparent impétueusement, et, de compactes qu'elles étaient, venant à se raréfier, s'étendent nécessairement plus au large? J'admets aussi cette cause. Mais une autre beaucoup plus vraie et la plus puissante, c'est que l'air a naturellement la propriété de se mouvoir, qu'il n'emprunte point d'ailleurs, mais qui est en lui tout comme mainte autre faculté. Peux-tu croire que l'homme ait reçu la puissance de se mouvoir, et que l'air seul demeure inerte et incapable de mouvement? L'eau n'a-t-elle pas le sien, même en l'absence de tout vent? Autrement elle ne produirait aucun être animé. Ne voyons-nous pas la mousse naître dans son sein, et des végétaux flotter à sa surface? VI. Il y a donc un principe vital dans l'eau : que dis-je dans l'eau? Le feu, par qui tout se consume, est lui-même créateur, et, chose invraisemblable, qui pourtant est vraie, certains animaux lui doivent naissance. Il faut donc que l'air possède une vertu analogue ; et c'est pourquoi tantôt il se condense, tantôt se dilate et se purifie; d'autres fois, il rapproche ses parties, puis il les sépare et les dissémine. Il y a donc entre l'air et le vent la même différence qu'entre un lac et un fleuve. Quelquefois le soleil lui seul produit le vent, en raréfiant l'air épaissi, qui perd, pour s'étendre, sa densité et sa cohésion. VII. Nous avons parlé des vents en général; entrons mainte nant dans le détail. Peut-être découvrirons-nous comment ils se forment, si nous découvrons quand et où ils prennent leur origine. Examinons d'abord ceux qui soufflent avant l'aurore et qui viennent des fleuves, des vallées, ou des golfes. Tous ces vents n'ont point de persistance, ils tombent dès que le soleil a pris de la force, et en même vont pas jusqu'où la terre cesse d'être en vue. Ces sortes de vents commencent au printemps et ne durent pas au delà de l'été ; ils viennent surtout des lieux où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de montagnes. Bien que l'eau abonde dans les pays de plaine, ils manquent d'air, je dis de cet air qui peut s'appeler vent. VIII. Comment donc se forme ce vent que les Grecs nomment Encolpias? Toutes les exhalaisons des marais et des fleuves (et elles sont aussi abondantes que continues) alimentent le soleil pendant le jour ; la nuit, elles cessent, d'être pompées ; et renfermées dans les montagnes, elles se concentrent sur le même point. Quand l'espace est rempli et ne peut plus les contenir, elles s'échappent par où elles peuvent, et se portent toutes du même côté ; de là naît le vent. Le vent fait donc effort où il trouve une issue plus libre et une capacité plus grande pour recevoir tout cet amas de vapeurs. La preuve de ce fait, c'est que, durant la première partie de la nuit, il n'y a pas de vent, parce que c'est alors que commencent à s'entasser ces vapeurs qui regorgent déjà vers le point du jour, et cherchent un écoulement pour se décharger ; elles se portent du côté où s'offre le plus de vides et où s'ouvre un champ vaste et libre. Le soleil levant les stimule encore davantage en frappant cette atmosphère froide. Car, avant même qu'il paraisse, sa lumière agit déjà ; ses rayons n'ont pas encore fouetté l'air, que déjà il le harcèle et l'irrite, par cette lumière qu'il envoie devant soi. Mais quand il se montre lui-même, il attire en haut une partie de ces émanations, et dissout l'autre par sa chaleur. Aussi ces courants d'air ne sauraient-ils durer plus tard que l'aurore ; toute leur force tombe en présence du soleil; les plus violents s'alanguissent vers le milieu du jour, et jamais ne se prolongent au delà de midi. Les autres sont plus faibles, moins continus, et en raison des causes plus ou moins puissantes qui les engendrent. IX. Pourquoi les vents de cette espèce ont-ils plus de force au printemps et en été? car ils sont très faibles le reste de l'année et ne vont pas jusqu'à enfler les voiles. C'est que le printemps est une saison humide, et que la grande quantité des eaux et des lieux que sature et arrose l'humidité naturelle de l'atmosphère augmente les évaporations. Mais pourquoi soufflent-ils de même l'été? Parce qu'après le coucher du soleil la chaleur du jour dure encore et persiste une grande partie de la nuit : elle facilite la sortie des vapeurs, et attire puissamment toutes les émissions spontanées de la terre ; après quoi la force lui manque pour les consumer. Ainsi la durée des émanations et des exhalaisons du sol et des eaux est plus longue que dans les temps ordinaires : or le soleil, à son lever, produit du vent non seulement par sa chaleur, mais encore par la percussion. Car la lumière qui, comme je l'ai dit, précède le soleil, n'échauffe pas encore l'atmosphère, elle la frappe seulement. Ainsi frappé, l'air s'écoule latéralement. Je ne saurais pourtant accorder que la lumière soit par elle-même sans chaleur, puisque c'est la chaleur qui la produit. Peut-être n'a-t-elle pas autant de chaleur que son action le ferait croire ; elle n'en a pas moins son effet, en divisant, en atténuant les vapeurs condensées. Les lieux mêmes que la nature jalouse tient pour ainsi dire clos et inaccessibles au soleil sont du moins réchauffés par une lumière louche et sombre, et moins froids de jour que de nuit. D'ailleurs le propre de la chaleur est de chasser, de repousser loin d'elle les brouillards. Le soleil doit donc en faire autant ; d'où quelques-uns se sont figuré que le vent part d'où part le soleil; opinion évidemment fausse, puisque le vent porte les vaisseaux de tous côtés, et qu'on navigue à pleines voiles vers l'orient; ce qui n'aurait pas lieu, si le vent venait toujours du côté du soleil. X. Les vents étésiens, dont on veut tirer un argument, ne prouvent guère ce qu'on avance. Exposons cette opinion avant de donner les motifs qui nous la font rejeter. « Les vents étésiens, dit-on, ne soufflent pas en hiver ; les jours alors étant trop courts, le soleil disparaît avant que le froid soit vaincu ; les neiges peuvent s'amonceler et durcir. Ces vents ne commencent qu'en été, lorsque les jours deviennent plus longs et que le soleil nous darde ses rayons verticalement. Il est donc vraisemblable que les neiges, frappées d'une chaleur plus pénétrante, exhalent plus d'humidité, et qu'à son tour la terre, débarrassée de cette enveloppe, respire plus librement. Il se dégage· donc de la partie nord de l'atmosphère plus de corpuscules, qui refluent dans les régions basses et chaudes. De là l'essor des vents étésiens ; et s'ils commencent dès le solstice et ne tiennent pas au delà du lever de la canicule, c'est que déjà une grande partie des émanations septentrionales a été refoulée vers nous ; au lieu que, quand le soleil changeant de direction est plus perpendiculairement sur nos têtes, il attire à lui une partie de l'atmosphère et repousse l'autre. C'est ainsi que l'haleine des vents étésiens tempère l'été, et nous protège contre la chaleur accablante des mois les plus brûlants. » XI. Maintenant, comme je l'ai promis, expliquons pourquoi ces vents ne sont d'aucun secoure et ne fournissent aucune preuve à la cause que je combats. Nous disons que l'aurore éveille le souffle du vent, qui baisse sitôt que l'air a été touché du soleil : or, les gens de mer nomment les étésiens dormeurs et paresseux, attendu, comme dit Gallion, qu'ils ne sauraient se lever matin; ils ne font acte de présence qu'à l'heure où les vents les plus opiniâtres ont cessé, ce qui n'arriverait pas si le soleil les paralysait comme les autres. Ajoute que, s'ils avaient pour cause la longueur du jour et sa durée, ils souffleraient avant le solstice, temps où les jours sont le plus longs et la fonte des neiges le plus active ; car, au mois de juillet, la terre est tout à fait découverte, ou du moins fort peu d'endroits sont encore cachés sous la neige. XII. Certains vents sortent de nuages qui crèvent et se dissolvent en s'abaissant; les Grecs les appellent Ecnéphies. Voici, je pense, le mode de leur formation : l'évaporation terrestre jette dans les airs une quantité de corpuscules hétérogènes et d'inégales dimensions, les uns secs, les autres humides. Quand toutes ces matières antipathiques et qui luttent entre elles sont réunies en un même ensemble, il est vraisemblable qu'il se forme des nuages creux, entre lesquels s'établissent des intervalles cylindriques, étroits comme le tuyau d'une flûte. Dans ces intervalles est enfermé un air subtil, qui aspire à s'étendre plus au large dès qu'un passage obstrué le comprime, l'échauffé et ainsi le dilate ; alors il déchire son enveloppe, il s'élance : c'est un vent rapide, orageux presque toujours, vu la hauteur dont il descend et l'énergie, la fougue que lui donne sa chute. Car il n'est pas libre ni dégagé dans sa course ; il est contraint, il lutte et s'ouvre de force une route. D'ordinaire cette fureur dure peu. Comme il a brisé les nuages qui lui servaient de retraite et de prison, il arrive avec impétuosité, accompagné quelquefois du tonnerre et de la foudre. Ces sortes de vents sont beaucoup plus forts et durent davantage, quand ils absorbent dans leur cours d'autres vents issus des mêmes causes, et que plusieurs n'en font qu'un seul. Ainsi les torrents n'ont qu'une grandeur médiocre tant qu'ils courent isolés; mais le grana nombre de cours d'eau qu'ils s'approprient les rend plus considérables que des fleuves réglés et permanents. On peut croire qu'il en est de même des ouragans : ils durent peu, tant qu'ils soufflent seuls ; mais dès qu'ils ont associé leurs forces, et que l'air, chassé de plusieurs points de l'atmosphère, se ramasse sur un seul, ils y gagnent plus de fougue et de persistance. XIII. Un nuage qui se dissout produit donc du vent; or, il se dissout de plusieurs manières : ce globe de vapeurs est crevé quelquefois par les efforts d'un air enfermé qui cherche à sortir, quelquefois par la chaleur du soleil, ou par celle que de terminent le choc et le frottement de ces masses énormes. Nous pouvons, si tu le veux, examiner ici comment se forment les tourbillons. Tant qu'un fleuve coule sans obstacle, son cours est uniforme et en droite ligne. S'il rencontre un rocher qui s'avance du rivage dans son lit, ses eaux rebroussent faute de passage, et se replient circulairement. Elles tournent ainsi et s'absorbent sur elles-mêmes : le tourbillon est formé. De même le vent, tant que rien ne le contrarie, déploie ses forces droit devant lui. Repoussé par quelque promontoire, ou resserré par le rapprochement de deux montagnes dans la courbure d'un canal étroit, il se roule sur lui-même à plusieurs reprises, et forme un tourbillon semblable à ceux qu'on voit dans les fleuves, comme nous venons de le dire. Ce vent donc, mû circulaire ment, qui tourne autour du même centre, et s'irrite par son propre tournoiement, s'appelle tourbillon. Avec plus de fougue et plus de durée dans sa circonvolution, il s'enflamme et devient ce que les Grecs nomment prester : c'est le tourbillon de feu. Ces tourbillons sont presque aussi dangereux que le vent qui s'échappe des nuages ; ils emportent les agrès des vaisseaux, ils soulèvent tout un navire dans les airs. Il y a des vents qui en engendrent de tout différents d'eux, et qui chassent et dispersent l'air en des courants tout autres que ceux qu'ils affectent eux-mêmes. Et, à ce propos, une réflexion se présente à moi. De même que la goutte d'eau qui déjà penche et va tomber, ne tombe toutefois que lorsque plusieurs s'ajoutent à elle et la renforcent d'un poids qui enfin la détache et la précipite ; de même, tant que les mouvements de l'air sont légers et répartis sur plusieurs points, il n'y a pas encore de vent; le vent ne commence qu'à l'instant où toutes ces tendances partielles se confondent en un seul essor. Le souffle et le vent ne diffèrent que du plus au moins. Un souffle considérable s'appelle vent ; le souffle proprement dit est un léger écoulement d'air. XIV. Reprenons ce que j'ai dit en premier lieu. Il y a des vents qui sortent des cavernes et des retraites intérieures du globe. Le globe n'est point solide et plein jusqu'en ses profondeurs ; il est creux en maintes parties, .... Et suspendu sur de sombres abîmes.[3] Certaines de ces cavités sont vides et sans eau. Bien que nulle clarté n'y laisse voir les modifications de l'air, je crois pouvoir dire que dans ces ténèbres séjournent des nuages et des brouillards. Car ceux qui sont au-dessus de la terre n'existent pas parce qu'on les voit ; on les voit parce qu'ils existent. Les nuages souterrains n'en existent donc pas moins, pour être invisibles. Tu dois savoir que sous terre il est des fleuves semblables aux nôtres » : les uns coulent paisiblement; les autres roulent et se précipitent avec fracas sur des rochers. Tu m'accorderas aussi, n'est-ce pas, l'existence de lacs souterrains, d'eaux stagnantes et privées d'issue? S'il en est ainsi, nécessairement l'air, dans ces cavités, se charge d'exhalaisons qui, pesant sur les couches inférieures, donnent naissance au vent par cette pression même. Il faut donc reconnaître que des vents couvent dans l'obscurité de ces nuages souterrains, e: qu'après avoir· amassé assez de force ils emportent l'obstacle qu'oppose le terrain, ou s'emparent de quelque passage ouvert à leur fuite, pour s’élancer par ces voies caverneuses jusqu'au séjour de l'homme. Il est en outre manifeste que la terre enferme dans son sein d'énormes quantités de soufre et d'autres substances non moins inflammables. Le vent qui s'y engouffre pour trouver une issue doit, par le seul frottement, allumer la flamme. Bientôt l'incendie gagne au loin; l'air stagnant lui-même se dilate, s'agite et cherche à se faire jour, avec un frémissement terrible et des efforts impétueux. Mais je traiterai ceci avec plus de détail quand il s'agira des tremblements de terre. XV. Permets-moi ici de te raconter une anecdote. Au rapport d'Asclépiodote, Philippe fit descendre un jour nombre d'ouvriers dans une ancienne mine, depuis longtemps abandonnée, pour en explorer les richesses, la situation, et voir si l'avidité des aïeux avait laissé quelque chose à leur postérité.[4] Les ouvriers descendirent avec une provision de flambeaux pour plusieurs jours. Après une longue et fatigante route, ils découvrirent des fleuves immenses, de vastes réservoirs d'eaux dormantes, pareils à nos lacs, et au-dessus {lesquels la terre, loin de s'affaisser, se dégageait, se prolongeait envoûte, spectacle qui les fit frissonner. J'ai lu ce récit avec un bien vif intérêt. J'ai vu par là que les vices de notre siècle ne sont pas d'hier, mais remontent, par une déplorable tradition, aux temps les plus reculés, et que ce n'est pas de nos jours seulement que l'avidité, fouillant les veines de la terre et des rochers, y chercha ce que leurs ténèbres nous cachaient mal. Nos ancêtres aussi, héros dont nous célébrons les louanges, dont nous gémissons d'avoir dégénéré, ont, dans un cupide espoir, coupé des montagnes, ont vu le gain sous leurs pieds et des roches; croulantes sur leurs têtes. Avant le Macédonien Philippe, il s'est trouvé des rois qui, poursuivant l'or jusque dans les plus profonds abîmes, et renonçant à l'air libre, s'enfonçaient dans ces gouffres où n'arrive plus rien qui distingue le jour de la nuit, et laissaient, loin derrière eux la lumière. Quel était donc ce grand espoir? Quelle impérieuse nécessité a courbé, a enfoui l'homme, fait, pour regarder les cieux? Qui l'a pu plonger au sein même et dans les entrailles du globe pour en exhumer l'or non moins dangereux à poursuivre qu'à posséder? C'est pour de l'or qu'il a creusé ces longues galeries, qu'il a rampé dans les boues autour d'une proie incertaine, qu'il a oublié le soleil, oublié cette belle nature dont il s'exilait! Sur quel cadavre la terre pèse-t-elle autant que sur ces malheureux jetés par l'impitoyable avarice sous ces masses gigantesques, déshérités du ciel, ensevelis dans les profondeurs qui recèlent ce poison fatal? Ils ont osé descendre au milieu d'un ordre de choses si nouveau pour· eux, sous ces terres suspendues; des vents qui souillaient au loin dans le vide, d'effrayantes sources dont les eaux ne coulaient pour personne, une épaisse et éternelle nuit; ils ont, tout bravé, et ils craignent encore les enfers![5] XVI. Mais je reviens à la question qui m'occupe. Quatre vents se partagent les quatre points du ciel, le levant, le couchant, le midi et le septentrion. Tous les autres, qu'on appelle da tant de noms divers, se rattachent à ces vents principaux.
Sur le tiède rivage où
va mourir le jour Ou, pour les énumérer en moins de mots, fais ce qui n'est nullement faisable, réunis-les en une seule tempête :
L'Eurus et le Notus, l'Africus
orageux, et le quatrième, quoiqu'il ne fût pas de la mêlée, l'Aquilon. D'autres comptent douze vents : ils subdivisent en trois chacune des quatre parties du ciel, et adjoignent à chaque vent deux subalternes. C'est la théorie du judicieux Varron; et cet ordre est rationnel. Car le soleil ne se lève ni ne se couche pas toujours aux mêmes points. A l'équinoxe, qui a lieu deux fois l'an, son lever, son coucher ne sont pas les mêmes qu'au solstice d'hiver ou au solstice d'été. Le vent qui souffle de l'orient équinoxial s'appelle en notre langue Subsolanus, et en grec Apheliotès. De l'orient d'hiver souffle l'Eurus, qui, chez nous, est Vulturne. Tite Live lui donne ce nom dans le récit de cette bataille funeste aux Romains, où Annibal sut mettre notre armée en face tout à la fois du soleil levant et du Vulturne, et nous vainquit, ayant pour auxiliaires le vent et ces rayons dont l'éclat éblouissait les yeux de ses ennemis. Varron aussi se sert du mot Vulturne. Mais Eurus a déjà droit de cité, et ne se produit plus dans notre idiome à titre d'étranger. De l'orient solsticial nous arrive le Caecias des Grecs, qui, chez nous, n'a point de nom. L'occident équinoxial nous envoie le Favonius, que ceux même qui ne savent pas le grec vous diront s'appeler Zéphyre. L'occident solsticial enfante le Corus, nommé par quelques-uns Argestès, ce qui ne me semble pas juste; car le Corus est un vent violent, qui ne porte ses ravages que dans une seule direction; tandis que l'Argestès est ordinairement doux, et se fait sentir à ceux qui vont comme à ceux qui reviennent. De l'occident d'hiver se rue l'Africus, le vent furibond que les Grecs ont nommé Lips. Dans le flanc septentrional du monde, du tiers le plus élevé souffle l'Aquilon ; du tiers qu'occupe le milieu, le Septentrion; et du tiers le plus bas, le Thrascias, pour lequel nous n'avons pas de nom. Au midi se forment l'Euro-Notus, le Notus, en latin Auster, et le Libo-Notus, innommé chez nous. XVII. J'adopte cette division en douze vents; non qu'il y en ait partout autant, car l'inclinaison du terrain en exclut souvent quelques-uns, mais parce qu'il n'y en a nulle part davantage. Ainsi, quand nous disons qu'il y a six cas, ce n'est pas que chaque nom en ait six, c'est qu'aucun n'en reçoit plus de six. Ceux qui ont reconnu douze vents se sont fondés sur la division analogue du ciel. En effet, le ciel est partagé en cinq zones, dont le centre passe par l'axe du monde. Il y a la zone septentrionale, la solsticiale, l'équinoxiale, la brumale, et la zone opposée à la septentrionale. On en ajoute une sixième qui sépare la région supérieure du ciel de la région inférieure. Car, comme tu sais, toujours une moitié du monde céleste est sur notre tête, et l'autre sous nos pieds. Or, cette ligne qui passe entre la portion visible et la portion invisible, les Grecs l'ont appelée horizon; les Romains finitor ou finiens. Il faut joindre à ce cercle le méridien, qui coupe l'horizon à angles droits. De ces cercles, quelques-uns courent transversalement et coupent les autres par leur rencontre. Par une suite nécessaire, les divisions du ciel égalent en nombre ces coupures. Donc l'horizon, ou cercle finiteur, en coupant les cinq cercles dont je viens de parler, forme dix portions : cinq à l'ouest, et cinq à l'est. Le méridien, qui coupe aussi l'horizon, donne deux régions de plus. Ainsi l'atmosphère admet douze divisions, et fournit même nombre de vents. Quelques-uns sont particuliers à certaines contrées, et ne vont pas plus loin, ou ne se portent que dans le voisinage. Ceux-là ne s'élancent point des parties latérales du monde. L'Atabulus tourmente l'Apulie, l'Iapyx la Calabre, le Sciron Athènes, le Catégis la Pamphylie, le Circius la Gaule. Bien que ce dernier renverse même des édifices, les habitants lui rendent grâces ; ils croient lui devoir la salubrité de leur ciel. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'Auguste, pendant son séjour en Gaule, lui voua un temple qu'il bâtit en effet. Je ne finirais pas si je voulais nommer tous les vents; car il n'est presque aucun pays qui n'en voie quelqu'un naître dans son territoire et mourir dans ses environs. XVIII. Parmi tant d'autres créations de la Providence, celle-ci donc mérite bien l'admiration de l'observateur; car ce n'est pas dans un but unique qu'elle a imaginé et disposé les vents sur tous les points du globe. Ce fut d'abord pour empêcher l'air de croupir; puis ils durent l'agiter sans cesse, pour le rendre utile et propre à entretenir la vie de tout ce qui respire. Ce fut aussi pour envoyer à la terre les eaux du ciel, et prévenir en même temps leur trop grande abondance. Tantôt, en effet, ils entassent les nuages, tantôt ils les disséminent, afin de répartir les pluies sur tous les climats. L'Auster les pousse sur l'Italie : l'Aquilon les refoule en Afrique ; les vents Étésiens ne les laissent pas séjourner sur nos tètes. Ces mêmes vents, à la même époque, versent sur l'Inde et l'Ethiopie des torrents continuels. Ajouterai-je que les récoltes seraient perdues pour l'homme, si le souffle de l'air ne détachait la paille superflue du grain à conserver, s'il n'aidait au développement de l'épi et, entrouvrant l'enveloppe où le froment se cache, ne rompait cette follicule, comme l'appellent les agriculteurs? N'est-ce pas à l'aide des vents que tous les peuples communiquent entre eux, et que se mêlent des races qu'avaient séparées les distances? Immense bienfait de la nature, si l'homme, dans sa démence, ne s'en faisait un instrument de ruine! Hélas! ce qu'on a généralement dit du premier César, ce que Tite-Live a consigné, qu'on ne sait lequel aurait mieux valu pour la république qu'il eût ou n'eût pas existé, on peut aussi l'appliquer aux vents, tant leur utilité, leur nécessité même sont plus que compensées par tout ce que la folie humaine y trouve de moyens homicides. Mais le bien ne change pas de nature, par la faute de qui en abuse pour nuire. Certes, lorsque la Providence, lorsque Dieu, ce grand ordonnateur du monde, a livré l'atmosphère aux vents qui l'agitent et soufflent de tous les points, afin que rien ne dépérisse faute de mouvement; ce n'était pas pour que des flottes, remplies d'armes et de soldats, bordassent presque tous nos rivages et allassent sur l'Océan ou par delà nous chercher un ennemi. Quelle frénésie nous transporte et nous plie à cette tactique d'extermination mutuelle? Nous volons à toutes voiles au-devant des batailles, cherchant le péril pour le péril même.[8] Nous affrontons l'incertaine fortune, la fureur de tempêtes insurmontables à tout effort humain, une mort sans espoir de sépulture. La paix même vaudrait-elle qu'on la poursuivît par de telles voies? Nous, cependant, échappés à tant d'invisibles écueils, aux pièges des bas-fonds, à ces orageux promontoires contre lesquels les vents poussent les navigateurs, à ces ténèbres qui voilent le jour, à ces nuits dont la tempête et la foudre augmentent l'horreur, à ces tourbillons qui brisent en éclats les navires, quel fruit retirerons-nous de tant de peines et d'effrois? Harassés de tant de maux, quel port va nous accueillir? la guerre, un rivage hérissé d'ennemis, des nations à massacrer et qui entraîneront en grande partie le vainqueur dans leur ruine, d'antiques cités à détruire par la flamme. Pourquoi ces peuples levés en masse, ces années qu'on enrôle, qu'on va mettre en ligne au milieu des flots? Pourquoi fatiguons-nous les mers? La terre, sans doute, n'est point assez spacieuse pour s'y égorger. La Fortune nous traite avec trop de tendresse; elle nous donne des corps trop robustes, une santé trop florissante! Le destin ne nous décime pas assez brusquement; chacun peut fixer à l'aise la mesure de ses années, et descendre par une pente douce à la vieillesse! Donc allons sur la mer, provoquons ce destin trop lent à nous atteindre. Malheureux! que cherchez-vous? La mort? elle est partout, elle surabonde. Elle vous arrachera même de votre lit ; que du moins elle vous en arrache innocents ; elle vous saisira jusqu'en vos foyers : ah! qu'elle ne vous saisisse point méditant le crime. Comment appeler autrement que frénésie ce besoin de promener la destruction, de se ruer en furieux sur des inconnus, de s'irriter sans offense, de tout dévaster sur son passage, et, comme la bête féroce, d'égorger sans haïr? Celle-ci, du moins, ne mord jamais que pour se venger ou assouvir sa faim; nous, prodigues du sang d'autrui et du nôtre, nous labourons les mers, nous les couvrons de flottes, nous livrons notre vie aux orages, nous implorons des vents favorables; les plus prospères sont ceux qui nous mènent aux batailles. Race criminelle, jusqu'où nos crimes nous ont-ils emportés? Le continent était trop peu pour nos fureurs. Ainsi cet extravagant roi de Perse envahit la Grèce, que son armée inonde, mais qu'elle ne peut vaincre. Ainsi Alexandre, qui a franchi la Bactriane et les Indes, veut connaître ce qui existe par delà la grande mer, et s'indigne que le monde ait pour lui des limites. Ainsi la cupidité fait de Crassus la victime des Parthes : rien ne l'émeut; ni les imprécations du tribun qui le rappelle, ni les tempêtes d'une si longue traversée, ni les foudres prophétiques qui grondent vers l'Euphrate, ni les dieux qui le repoussent. A travers le courroux des hommes et des dieux, il faut marcher au pays de l'or. On n'aurait donc pas tort de dire que la nature eût mieux fait pour nous d'enchaîner le souffle des vents, de couper court à tant de courses insensées, et d'obliger chacun à demeurer en son pays. N'y gagnât-on rien de plus, on ne porterait malheur qu'à soi et aux siens. Mais non : on n'a pas assez des malheurs domestiques ; on veut· aussi pâtir à l'étranger. Point de terre si lointaine qui ne puisse envoyer quelque partie fléau qu'elle renferme. Que sais-je si aujourd'hui le chef de quelque grand peuple inconnu, gonflé des faveurs de la Fortune, n'aspire pas à porter ses armes au delà de ses frontières et n'équipe pas des flottes dans un but mystérieux? Que sais-je si tel ou tel vent ne va pas m'apporter la guerre? Quel grand pas vers la paix du monde, si les mers nous eussent été closes! Cependant, je le dis encore, nous ne pouvons nous plaindre du divin auteur de notre être, quand nous dénaturons ses bienfaits par un usage contraire à ses desseins. Il a donné les vents pour maintenir la température du ciel et de la terre, pour attirer ou repousser les pluies, pour ; nourrir les moissons et les fruits des arbres; l'agitation même qu'ils produisent hâte, entre autres causes, la maturité ; ils font monter la sève, le mouvement l'empêche de croupir. Il a donné les vents pour qu'on puisse connaître ce qui est au delà des mers; car quel être ignorant que l'homme, et qu'il aurait peu d'expérience des choses, s'il était renfermé dans les limites du sol natal! Il a donné les vents pour que les avantages de chaque contrée du globe deviennent communs à toutes, non pour transporter des légions, de la cavalerie, les armes les plus meurtrières de chaque peuple.[9] A estimer les dons de la nature par l'usage pervers qu'on en fait, nous n'avons rien reçu que pour notre mal. A qui profite le don de la vue, la parole? Pour qui la vie n'est-elle pas un tourment? Trouve-moi une chose tellement utile sous tous les aspects, qu'elle ne soit pas transformée par le crime en arme nuisible. Les vents aussi, la nature les avait créés pour servir au bien; nous en avons fait tout le contraire. Tous nous mènent vers quelque fléau. Les motifs de mettre à la voile ne sont pas les mêmes pour chacun de nous: nul n'en a de légitimes; divers stimulants nous excitent à tenter les hasards de la route; mais toujours est-ce pour obéir à quelque vice. Platon dit ce mot remarquable, et nous finirons par son témoignage : « Ce sont des riens que l'homme achète au prix de sa vie. » Oh! oui, mon cher Lucilius, si tu es bon juge de la folie des hommes, c'est-à-dire de la nôtre (car le même tourbillon nous emporte), tu riras surtout à l'idée qu'on amasse, dans le but de vivre, ce qu'on n'acquiert qu'en usant sa vie! [1] Virg., Eglog., II, 26. [2] Je lis comme Fickert, d'après un ms. : quoniam hoc modo negas fieri? Lemaire : quos non negas fieri? [3] Ovide, Métam., I, 388. [4] Rien n'augmenta la puissance de Philippe comme la découverte de quelques mines d'or qu'il fit exploiter, et dont il retira par an plus de mille talents, près de 6 millions de francs. Il s'en servit pour gagner les chefs des républiques grecques. (Diod., XVI. Strabon, VII.) [5] Voir, sur le même sujet et les mêmes idées, une brillante déclamation de Jean-Jacques. VIIe Rêverie. [6] Ovide, Métam., I, 61. [7] Virg., Enéide, I, 85. [8] Non tam prœmis periculorum quam periculis laetus. (Tac, Hist., II, lxxxvi.) « Ce n'est que la chasse, et non la prise, qu'ils recherchent. » (Pascal, Pensées, édit. Havet.) [9] Voir Horace, I, Ode iii. Properce, III, Eleg. v. Tibulle, II. m. Lucain, III, xcv. Lebrun, I, Ode m. Thomas, Éloge de Duguay-Trouin. Esménard, la Navigation. |
|
|