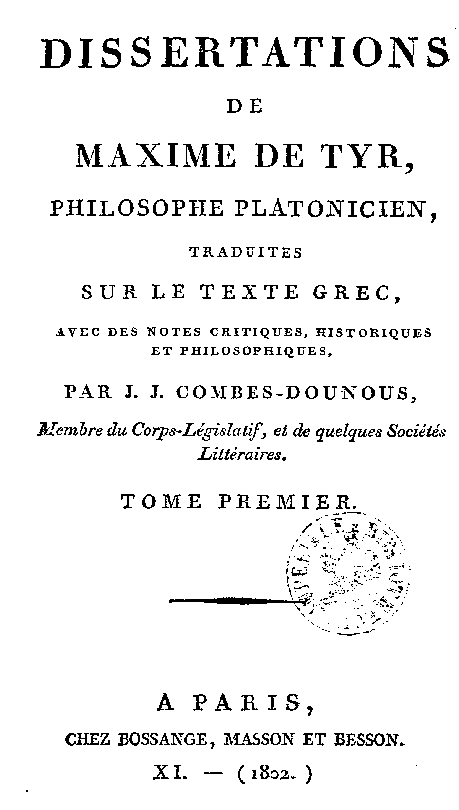|
MAXIME DE TYR
DISSERTATIONS
DISSERTATION IV. Quelle est la fin de la philosophie ? DANS les choses qui appartiennent à la raison, il est difficile de trouver le point réel de la vérité : au milieu de l'abondance qui s'offre à l'entendement, l'âme de l'homme risque de pécher par le jugement. Dans les arts mécaniques, plus on avance, plus on les perfectionne par des inventions successives, chacun à l'égard du genre d'ouvrage qui lui est propre. La philosophie au contraire, lorsqu'elle a fait le plus de progrès, c'est alors surtout qu'on voit abonder dans son sein les opinions indécises et les systèmes contradictoires. Il en est d'elle, comme de ces agriculteurs dont les propriétés deviennent moins productives à mesure qu'ils augmentent leur attirail aratoire. Dans les discussions qui intéressent l'ordre public, le nombre des juges, leur opinion, les discours des orateurs, les suffrages du peuple influent sur les résultats. Mais ici de quels juges emprunterons-nous le secours ? Par quels suffrages discernerons-nous la vérité ? Par celui du raisonnement ? mais il n'est point d'argument auquel on ne puisse opposer un argument contraire. Par celui des passions? mais les passions sont des juges qui ne méritent nulle confiance. Par celui de la multitude ? mais les ignorants font le plus grand nombre. Par celui des préjugés (1) ? mais ils consacrent les opinions les plus erronées. II. Or, dans ce qui est l'objet actuel de notre examen ; dans ce conflit, dans cette comparaison réciproque de la vertu et de la volupté, cette dernière, après avoir éliminé la vertu, ne l'emportera-t-elle point aux yeux du vulgaire, n'aura-t-elle pas pour elle la pluralité des suffrages, n'obtiendra t-elle pas l'empire, à l'aide des passions ? L'unique auxiliaire qui restait à la vertu, la droite raison éprouve des dissentiments, des schismes. Elle fait plus ; elle-même prône quelquefois la volupté (2). On parle avec succès, lorsqu'on parle en faveur de la volupté, lorsqu'on déprime la vertu, et qu'on fait tomber ainsi le sceptre en quenouille (3). On se départ de ce qui constitue le vrai caractère du philosophe. On se contente de l'ascendant qu'en donne le nom (4). Homme, abjure le nom de philosophe, quand tu en abjures les principes (5). Tu pervertis l'intention de ceux qui ont imposé sa dénomination à la philosophie (6). Elle n'a rien de commun avec la volupté. Autre est l'ami de la volupté, autre est l'ami de la philosophie. Distincts l'un de l'autre sous le rapport des noms, ils le sont aussi sous le rapport des choses. Ils diffèrent autant entre eux que les Spartiates différaient des Athéniens, et les Grecs des Barbares. Si tu t'annonces comme un Spartiate, comme un Grec, comme un Dorien, comme un Héraclide, et que tu admires le turban des Mèdes, la table des Barbares, le char des Perses, tu copies les Perses, tu imites les Barbares. Tu n'es plus Pausanias. Tu es un Mède. Tu es Mardonius. Quitte le nom du peuple auquel tu cesses d'appartenir. III. Je conçois donc que le vulgaire préconise la volupté. Son âme est enfoncée dans la matière. Elle est étrangère à l'usage de la droite raison. Cette situation excite la commisération. Cette ignorance doit être excusée. Mais je ne pardonne point à Épicure. Je ne peux supporter qu'on outrage la philosophie. Je n'aime point un Général qui abandonne son poste au milieu de l'action, et qui se met à la tête des fuyards. Je n'aime point un agriculteur qui met le feu à ses moissons, ni un pilote qui ne jette ses regards sur les flots qu'en tremblant. Tu dois naviguer, tu dois commander une armée, tu dois cultiver des champs. Tout cela exige des travaux et des fatigues. Les grandes, les belles actions ne sont point filles de l'inertie. Que la volupté accompagne les belles actions ; j'y consens. Qu'elle les accompagne, mais que les belles actions aient partout la prééminence sur elle. « Que le sceptre ne soit que dans une seule main, que le diadème ne ceigne qu'une seule tète, et que ce soit la tête et la main de celui à qui Jupiter a donné l'empire (7) ». Mais si cet ordre est renversé ; si la volupté commande, et que la droite raison soit subordonnée, on donne à l'âme un tyran impérieux et inexorable. On la réduit à la nécessité d'en être l'esclave, de devenir, malgré elle, l'instrument d'actions de tout genre, quelque honteuses, quelque iniques qu'elles puissent être. Car quelle mesure imposer à la volupté, après qu'elle aura soumis les désirs à sa puissance ? Ce tyran est insatiable. Il dédaigne les biens qui sont à sa disposition. Il se passionne pour ceux qui lui manquent (8). L'abondance l'excite, l'espérance le réconforte, la profusion le jette hors de toute mesure. C'est ce tyran qui porte les affections honteuses à la révolte contre les affections honnêtes. C'est lui qui allume la guerre de l'injustice contre la justice. C'est lui qui donne la victoire contre la modération, au vice qui lui est opposé (9). Et cependant les besoins du corps, à combien peu de frais il est aisé de les satisfaire. A-t-on soif ? on a partout des fontaines ? A-t-on faim? les hêtres croissent en tous lieux. La chaleur du soleil réchauffe bien mieux que celle des vêtements. Le spectacle le plus varié est celui des prairies. Les fleurs dont elles sont émaillées répandent les parfums de la nature. Et jusque-là, il est possible d'assigner à la volupté des limites, savoir, celles du besoin. Si on les franchit, si l'on va plus avant, on donne à la volupté un essor qui n'a point de terme, on donne l'exclusion à la vertu. IV. De là, l'avarice: de là, la tyrannie. Il ne suffit point au Roi de Perse d'avoir le territoire de Pasargade pour apanage. Il ne se contente pas de cresson, comme Cyrus. II faut que toute l'Asie soit mise à contribution pour fournir aux voluptés d'un seul homme. La Médie lui envoie les chevaux de Nisa ; l'Ionie des courtisanes Grecques ; Babylone des eunuques pris parmi les Barbares; l'Égypte les productions des arts de tout genre ; l'Inde son ivoire ; l'Arabie ses parfums. Les fleuves eux-mêmes paient leur tribut (10) aux voluptés de ce Roi, le Pactole avec son or, le Nil avec son froment, le Choaspe avec son cristal limpide. Tout cela ne lui suffit point encore. Des voluptés d'un autre genre excitent sa cupidité ; et c'est pour la satisfaire qu'il passe en Europe, qu'il tente une expédition contre les Scythes, qu'il extermine les Paeons, qu'il s'empare d'Érétrie, qu'il vient débarquer à Marathon, et qu'il erre ainsi de tous les côtés. O pauvreté la plus déplorable du monde ! Car le comble de la pauvreté n'est-il pas dans des désirs qui n'ont point de terme. Du moment que l'âme goûte de la volupté hors de la ligne des besoins, la satiété des premières voluptés arrive, et elle en désire de nouvelles. Voilà, au vrai, le mot de l'énigme de Tantale. C'est une soif continuelle chez l'homme avide de voluptés. Ce sont des flots de volupté qui se présentent et qui disparaissent. C'est un flux et reflux de désirs, entremêlé de douleurs, d'agitations et de craintes. Quand la volupté est là, on craint qu'elle ne s'échappe. Quand on l'attend, on est tourmenté dans la pensée qu'elle ne viendra pas. Il suit de là nécessairement que celui qui attache ses affections à la volupté, ne doit jamais être sans perplexité ni sans angoisse, qu'il ne saurait. la savourer au moment même où il en jouit, et que sa vie n'est qu'un tourbillon d'anxiétés et de sollicitudes. V. Voyez-vous quel tyran vous donnez à l'âme. Ce sont les Athéniens sous Critias après le bannissement de Solon. C'est Lacédémone qui remplace Lycurgue par Pausanias. Quant à moi qui attache mes affections à la liberté, j'ai besoin de loi, il me faut de la raison. Ce sont ces gardiens qui maintiendront mon bonheur dans sa rectitude, dans sa stabilité, dans sa sécurité, qui feront que je me suffirai à moi-même, que je ne m'avilirai point, que je ne me prostituerai point à de honteuses fonctions d'esclave, desquelles je ne recueillerais pour tout avantage important que la volupté, si je mendiais auprès d'elles, non pas un morceau de pain, à l'exemple de cet infortuné dont parle Homère (11), non pas même des épées ou des bassins, mais des choses bien plus absurdes encore, des mets exquis auprès de Mittaecus, des vins excellents auprès de Sarambus, une jeune maîtresse auprès de Connus, une chanson agréable auprès de Milésias. Et où se comblera la mesure de toutes ces choses ? Quelle sera la limite du bonheur produit par la volupté. Où nous arrêterons-nous ? A qui donnerons-nous la palme ? Quel sera l'homme heureux ? Sera-ce celui qui veille et travaille sans relâche pour ne demeurer étranger à aucune volupté ; celui de l'âme duquel la volupté ne s'éloigne, ni la nuit, ni le jour ; celui dont l'âme met, si l'on peut s'exprimer ainsi, tous les sens à l'affût, comme le polype de mer y met ses réseaux, afin d'envelopper de toutes parts toutes les voluptés à la fois (12) ?
VI. Figurons-nous,
si nous le pouvons, un homme heureux du bonheur qui résulte de la volupté,
promenant ses regards sur les couleurs les plus agréables à la vue, prêtant
son oreille au concert le plus harmonieux, embaumé par les parfums les plus
suaves, savourant les mets les plus succulents et les plus variés, et jouissant
à la fois des plaisirs de l'amour et du libertinage (13).
Car si l'on admet des intervalles, si l'on sépare les voluptés, si l'on
établit l'alternative entre les sens, on altère le bonheur. Or, tout ce qui
par sa présence produit une affection de volupté, produit par son absence mie
affection opposée (14). Et quelle est l'âme qui
supporterait de se voir submergée, entraînée, par un semblable torrent de
voluptés, sans avoir un seul instant de repos ou de relâche ? N'est-il pas
probable qu'une pareille situation serait le comble du malheur pour elle,
qu'elle désirerait ardemment quelque moment de répit, qu'elle soupirerait
après quelque intermittence ? Car la volupté trop prolongée enfante le
déplaisir. Est-il donc rien de plus perfide qu'un bonheur qui excite la
commisération ! O Jupiter, et vous, autres Dieux, qui avez fait la terre et la
mer, et qui êtes les pères de tous les êtres qui les habitent, quel est donc
cet être que vous avez placé ici bas, en le destinant à y vivre ? Comme il
est audacieux, insolent, bavard, incapable d'arriver au bien (15),
enclin à l'inertie, et gouverné, sous tous les rapports de son existence, par
la volupté ! « Que n'a-t-elle ou resté dans le néant, ou péri sans
postérité (16) toute cette engeance », si elle
ne devait recevoir de vous rien de mieux que la volupté. VIII. Les poètes parlent d'une espèce d'hommes de race Thessalienne, originaires du mont Pélion, de la forme la plus étrange, ayant de la ceinture en bas la figure d'un cheval. Il fallut de toute nécessité que l'animal, résultant de ce bizarre assemblage de formes, se nourrit à l'instar des brutes. Il parlait comme un homme, mais il pâturait comme une brute. Il éprouvait comme l'homme les désirs de l'amour, mais il ne pouvait les satisfaire que comme une brute. A merveille, ô poètes, et vous qui leur avez succédé, créateurs des ingénieuses fictions de l'antiquité, avec quelle vérité vous nous avez présenté sous le voile mythologique les liens qui nous attachent à la volupté. Lorsque les appétits brutaux ont pris l'empire, et commandent à l'âme, le corps conserve bien ses mêmes formes extérieures, mais les actions déterminées par ces appétits démontrent que chez celui qui s'en laisse gouverner, l'homme a cédé la place à la brute. Telle est l'allégorie des Centaures, des Gorgones, des Chimères, de Géryon, de Cécrops. Ôtez à l'homme les sensualités de la table, il n'y a plus chez lui de partie. brutale. Ôtez-lui ses affections impudiques, la partie brutale n'est plus rien chez lui. Mais tant que ces sensualités et ces affections seront réunies à la partie brutale, et partageront le même aliment ; tant que la partie brutale sera aux ordres de ces affections et de ces sensualités, il faut nécessairement que l'empire appartienne aux appétits dont elles se composent, et que l'âme, si l'on peut s'exprimer ainsi, fasse chorus avec eux. DISSERTATION V. Il est un art de mettre à profit tous les accidents de la vie (19). IL est affligeant de voir que les Dieux aient séparé, pour l'intérêt des hommes, les biens d'avec les maux ; qu'ils aient ordonné les choses humaines de manière à ce qu'il n'existe aucun mélange entre les uns et les autres, qu'ils aient distingué leur essence respective, comme ils ont distingué le jour d'avec la nuit, la lumière d'avec les ténèbres, l'eau d'avec le feu, (car si l'on rapprochait chacune de ces choses de son contraire, et qu'on les mêlât ensemble pour n'en former qu'un tout unique et commun, on détruirait ce que chacune a de propre) ; et que les hommes de leur côté, tout en n'ayant pour but dans le cours de leur vie que de chercher le bonheur, se rendent les volontaires artisans de leur infortune ; et que si quelqu'un des Dieux leur faisait passer la vie au milieu de la brillante et continuelle lumière du jour, sans qu'ils eussent besoin ni de sommeil, ni du repos de la nuit, ils s'indigneraient contre le soleil qui ne bougerait point et qui ne se coucherait jamais. N'allons pas plus loin, de peur qu'en répondant (20), nous ne perdions ce point de vue. S'il était possible que les yeux de l'homme soutinssent perpétuellement la présence de la lumière, s'il était un mécanisme à l'aide duquel on pût fixer le soleil dans son mouvement circulaire, de manière que, toujours immobile au-dessus de la terre, il dirigeât continuellement sur nous ses rayons comme un fanal du haut d'une tour ; si cela était ainsi, que le soleil devint stationnaire, et que les yeux de l'homme, sans cesse tournés vers lui, en pussent soutenir l'éclat ; qui serait assez insensé, assez fantasque, assez malheureusement organisé sous le rapport des affections, pour désirer la nuit, les ténèbres, l'inertie des yeux, et cet affaissement du corps qui le rend si semblable à un cadavre ? Soit donc qu'il fût plus facile à nos yeux de supporter l'insomnie, qu'au soleil de s'arrêter, soit qu'il fût plus facile au soleil de s'arrêter, qu'à nos yeux de supporter l'insomnie nous n'aurions pas besoin de faire des vœux pour demander d'aimer la lumière ; mais le relâche que nous trouvons dans les bras du sommeil ne laisserait pas d'être pour nous un besoin de première nécessité. II. Il en est ainsi de l'amour du bien. L'âme l'aime ; et comment ne l'aimerait-elle pas ? Elle répugne au mal ; et comment n'aurait-elle pas cette répugnance ? Mais il n'est en son pouvoir, ni d'obtenir sans peine ce qu'elle aime, ni de ne pas recevoir de la main de la nécessité ce qu'elle n'aime pas. Non que j'entende parler de l'âme du méchant. Elle ne respire que méchanceté ; et elle est étrangère au bien. Elle ne sourit point à l'espérance, elle ne jouit pas longtemps de sa prospérité. Je parle de l'âme de l'homme de bien, de celle qui possède la prudence. Voyons si nous dirons de cette âme-là, que lorsque dans l'heureux cours de sa carrière, elle est arrivée à la vertu, elle ait pour jamais atteint le comble de la félicité ; ou si nous dirons que cela soit impossible à la nature humaine. Car il en est du chemin de la vie, comme de celui des coureurs de profession. A chaque pas, on rencontre des fossés, des escarpements, de grands creux, des murs de clôture. Si l'on ne connaît point sa route, si l'on est mauvais marcheur, si l'on n'a, ni la force, ni la confiance, nécessaires pour s'élancer, et franchir les obstacles, on bronche, on tombe, on perd courage. Celui au contraire qui est bon marcheur et qui connaît sa route, va en soutenant son essor avec vigueur. L'expérience qu'il a de son chemin l'empêche de s'en écarter. Son art l'empêche de faire de chute. Car il sait où sont les sentiers unis, et où il ne craindra pas de broncher ; où sont les passages difficiles qu'il faut traverser nécessairement, sans qu'il soit possible de les éviter. III. Homère nous offre cet emblème de la vie humaine. « Il est, dit-il, dans le palais de Jupiter deux tonneaux (21) l'un plein de maux, sans aucun mélange de biens ; l'autre, mêlé de biens et de maux.» Mais nulle part il ne parle d'un troisième tonneau qui ne soit rempli que de biens. Jupiter, selon Homère, puise dans ces deux tonneaux ce qu'il doit distribuer au genre humain. Il fait sortir, de l'un, une source non interrompue de maux cruels et violents, de querelles, de fureurs, d'angoisses, de craintes, et la multitude des autres fléaux de ce genre qu'il est impossible d'éviter, et dont rien ne tempère l'amertume. De l'autre, pour parler le langage d'Homère, il fait sortir un mélange de biens et de maux. A la bonne heure, j'admets ce mélange. J'applaudis à cette opinion. Mais je veux présenter, sous une dénomination plus noble et plus relevée, cette dispensation du maître des Dieux, qui me paraît la plus raisonnable. Voici de quelle manière. IV. La vertu et la méchanceté de l'âme représentent les deux tonneaux de Jupiter. L'une, la méchanceté, semblable à un torrent impétueux, répand le trouble et le désordre dans le champ de la vie. C'est le débordement d'un fleuve, qui se jette en hiver sur des terres ensemencées, et sur des plantations ; débordement funeste aux agriculteurs, aux bergers, aux voyageurs même ; fécond en ravages sans rien produire d'utile, il fait périr les semences, et détruit les fruits dans leurs germes. La vie, au contraire, de celui dont l'âme éprouve les bénignes influences de la vertu, offre le spectacle continuel, de la fertilité, de l'abondance, et de la maturité des fruits qu'elle donne. Cependant, l'agriculteur doit se fatiguer, prendre de la peine, avoir des sollicitudes. Car l'agriculteur Égyptien ne se repose pas uniquement sur les eaux du Nil ; il ne sème point, avant d'avoir attelé ses bœufs à sa charrue, avant d'avoir formé ses sillons, avant d'avoir fait un travail long et pénible. Lorsqu'il a fait tout cela, il permet au fleuve de couvrir ses terres. C'est ainsi que se marient les ondes du Nil et les soins de l'agriculture, les espérances avec les travaux, et les fruits avec les sollicitudes. Il en est de même des biens et des maux. Ou bien si ce rapprochement vous choque, ne l'admettes pas. Mais, tenez pour certain, que les biens ne sont pas tellement à notre discrétion que nous n'ayons qu'à les désirer (22). Si nous allons dans un port pour nous embarquer, nous prendrons pour pilote, non pas celui qui n'a jamais vu de tourmente, qui n'a jamais été aux prises avec la tempête, mais celui qui a appris son métier au milieu des naufrages et des accidents de la mer (23). Quant à toi, j'ai une médiocre confiance dans un Général constamment favorisé par la victoire (24). Combien Nicias aurait été précieux pour les Athéniens, s'il eût survécu à sa malheureuse expédition de Sicile (25). Que de leçons de modération et de sagesse aurait rapporté d'Amphipolis le Démagogue Cléon, s'il n'y eût point succombé (26). Mais lorsque je vois les faveurs de la fortune constamment attachées à un Amiral, à un Général d'armée, à un homme privé, à un Magistrat, à un simple Citoyen, à une Cité, tant de prospérité m'inspire de la défiance, comme en inspirèrent Crésus à Solon, et Polycrate à Amasis. V. Crésus régnait sur un pays abondant en excellente cavalerie. Polycrate dominait sur une mer où ses vaisseaux faisaient la loi. Mais ni l'un ni l'autre, ne conserva longtemps son empire, ni Crésus celui de la Lydie, ni Polycrate celui de la mer. Polycrate fut fait prisonnier par Oroète (27), et Crésus par Cyrus. Après une longue prospérité, ils éprouvèrent de longs malheurs. Aussi Solon ne regardait point Crésus comme heureux. Solon était trop sage pour porter un tel jugement. Aussi Amasis renonça à ses liaisons avec Polycrate. Il en prévoyait le danger. Aussi, pour ce qui me concerne, celui qui, dans le cours de sa vie, n'a reçu du malheur qu'une légère impression, qu'une faible atteinte, « celui dont les lèvres en ont effleuré la coupe, sans que le breuvage ait pénétré jusqu'à son gosier (28) », celui qui possède la vertu, et qui sait en faire usage même dans l'adversité, celui-là est l'objet de mes éloges. Dans un tableau, les couleurs les plus éclatantes sont celles qui plaisent le plus à la vue. Mais si l'on ne les tempère point par des ombres, on en détruit l'agrément. Enlacez quelques revers dans le tissu de vos prospérités, vous sentirez mieux le prix de la vertu, vous apprécierez davantage votre bonheur. VI. Dans le corps humain, c'est la soif qui est le véhicule du plaisir qu'on éprouve à boire. C'est la faim qui produit le plaisir qu'on trouve à manger. C'est l'obscurité de la nuit, qui est la source du plaisir qu'ont les yeux à contempler la lumière. D'un autre côté, l'homme désire la nuit après le soleil, la faim après qu'il a beaucoup mangé, la soif après qu'il a beaucoup bu, et lui ôter cette alternative, ce serait empoisonner ses jouissances. C'est ainsi que l'on dit d'Artaxerxès, Roi de Perse, qu'il n'eut jamais le sentiment de son bonheur, tant que ses jours coulèrent dans les bras d'une longue paix, et dans le sein des voluptés de tout genre. L'Asie entière était mise à contribution pour ses repas. Les fleuves les plus limpides lui fournissaient leur cristal ; tous les arts variaient à l'envi les délices de sa table. Mais, lorsque des flottes eurent porté la guerre chez lui, lorsque des milliers de Grecs, commandés par les Généraux les plus habiles, furent venus l'attaquer ; lorsque vaincu, et forcé de se sauver par la fuite au travers d'une petite colline, après avoir pris quelque repos pendant la nuit, il se sentit pressé par la soif pour la première fois de sa vie, il n'eut là, ni le Choaspe, ni le Tigre, ni le Nil, ni des coupes, ni des échansons ; et il se trouva trop heureux de se désaltérer avec l'eau fétide que le Marde son hôte lui tira d'une outre (29). Ce ne fut qu'alors que ce Prince infortuné apprit quel est le besoin de la soif, et en quoi consiste le plaisir de boire. VII. Quoi donc ! les voluptés du corps auront leur satiété, et la prospérité n'aura pas la sienne (30) ? Je la vois cependant plus accablante et plus pénible que celle des jouissances physiques. En effet, ne fut-il pas impossible à Achille de couler ses jours dans le repos, à Nestor de passer sa vie, sans faire usage de son éloquence, à Ulysse de vivre loin des dangers ? Il ne dépendait que d'Achille de rester auprès des Myrmidons, de les rendre heureux sous son règne, de cultiver ses campagnes Thessaliennes, et de choyer Pélée dans ses vieux jours. Nestor était le maître de gouverner en paix à Pylos, et d'y attendre tranquillement la vieillesse. Ulysse pouvait ne pas bouger de chez lui. Il pouvait demeurer auprès du Nérite (31) couvert de forêts, dans son pays fécond en belle jeunesse ; il pouvait ultérieurement ne pas abandonner Calypso, ni cette grotte sombre et fraîche où il était servi par des Nymphes, où la vieillesse ni la mort ne devaient jamais l'atteindre. Mais il ne voulut point d'une immortalité qui devait condamner sa vertu à l'oisiveté, et sa prudence à l'inertie. Il faut donc que celui qui entreprend de pratiquer la vertu, se prépare à s'écrier souvent, lorsqu'il sera aux prises avec les tribulations humaines : «Courage, mon cœur, je me suis trouvé d'autres fois dans des circonstances encore plus critiques (32) ». VIII. Mais quelle sera donc la réputation d'Ulysse, si nous laissons de côté les traverses auxquelles il a été en butte ? Que deviendra la gloire d'Achille, si l'on passe sous silence, Hector, le Scamandre, les douze Cités qu'il saccagea sur le bord de la mer avec ses vaisseaux, les onze autres qu'il détruisit sur le continent (33) ? Ce fut du milieu même de ses travaux et de ses combats, que les hommes enlevèrent Hercule, pour le placer dans l'Olympe à côté de Jupiter. Ôtez les monstres qu'il a terrassés, les brigands qu'il a exterminés, ses longues cours, ses divers voyages, et cette suite non interrompue de périls auxquels il s'est exposé, et vous détruisez sa vertu. Certes, ni aux jeux Olympiques, ni aux jeux Pythiques, on ne décerne ni le rameau d'olivier, ni la pomme, à celui qui s'est présenté seul dans l'arène. Pour être proclamé par le Héraut, il faut avoir combattu. Or, dans l'arène de la vie, dans les combats que l'homme est appelé à soutenir sur la terre, quels seront les antagonistes de l'homme de bien, sinon les circonstances critiques, et l'adversité ? IX. Voyons, appelons des Athlètes : faisons-les entrer dans l'arène. D'Athènes, prenons Socrate pour combattre contre Mélitus, contre les fers, contre le poison. De l'Académie, prenons Platon pour combattre contre la colère d'un tyran (34), contre une mer orageuse, contre les plus grands dangers. Prenons un autre champion dans l'Attique, pour combattre contre le parjure de Tissapherne, contre les embûches d'Ariée, contre la trahison de Ménon, contre la perfidie du grand Roi. Il faut que le Royaume de Pont nous fournisse encore un nouvel Athlète, qui soutienne de rudes combats, contre de vigoureux antagonistes, la pauvreté, l'ignominie, la faim et le froid. Quant à moi, je le loue de s'engager dans une pareille lutte. « Il s'endurcit aux souffrances à force de se faire lui-même des blessures. Il ne se couvre que de haillons (35); aussi n'a-t-il pas grand-peine à triompher ». De là vient que je donne aux hommes la couronne de la vertu, et que je les proclame comme ayant remporté la palme de la victoire. Qu'on cesse de les mettre en butte avec les maux attachés à l'humanité, on leur arrache la couronne, on les rend indignes d'être proclamés vainqueurs. Ôtez aux Athéniens la campagne de Marathon, et la mort qu'ils y trouvèrent ; ôtez à Cynégyre la gloire de s'être fait couper ses deux mains ; ôtez à Polyzèle la vision qui le rendit aveugle (36) ; ôtez à Callimaque ses blessures, vous ne leur laissez rien de recommandable, que leur Érichthon (37) et leur Cécrops (38), vraies fables qui ne méritent aucune foi. Sparte ne conserva longtemps sa liberté, que parce que ses citoyens ne menaient pas en temps de paix une vie oisive. Chez eux, c'étaient toujours les mêmes exercices, les mêmes pratiques, pour se familiariser avec la douleur. C'étaient les mêmes maux avec le mélange des mêmes vertus (39). DISSERTATION VI. Quelle est la source des sentiments philanthropiques (40) ? SI l'on nous demandait quels sont ceux à qui Homère se plaît à donner les brillantes épithètes de semblables aux Dieux, d'enfants des Dieux, de rivaux de Jupiter en sagesse, à qui donc, dirions-nous, les donne-t-il, sinon aux personnages les plus recommandables, à Agamemnon, à Ulysse, à Achille, et à tous ceux auxquels il distribue une portion d'éloges ? Mais si, au lieu de les comparer à Jupiter, il les comparait ou à Machaon le médecin, ou à Calchas savant dans la divination, ou à Nestor habile chef de cavalerie, ou à Menesthée consommé dans la tactique, ou à Aepée distingué dans l'art de forger, ou à Nirée célèbre par sa beauté, ne déterminerait-on pas, sans peine, la cause d'une pareille comparaison ? On ne serait pas embarrassé de trouver là une parfaite ressemblance, et ici, lorsqu'il s'agit d'une comparaison avec Jupiter, on en louera l'Auteur, et on n'en pénétrera point l'objet ? Voyons donc, que je développe la pensée d'Homère ; mais avec de la prose, car je ne suis pas poète. S'il donne à Jupiter le nom de Père des Dieux et des hommes, ce n'est point parce que se dérobant quelquefois clandestinement de l'Olympe, métamorphosé tantôt en oiseau (41), tantôt en pluie d'or (42), tantôt de toute autre manière, il était venu prendre ses ébats avec des femmes mortelles, et « parsemer dé côté et d'autre les premières races de Rois (43) ». S'il fallait l'entendre ainsi, Jupiter n'aurait qu'un très petit nombre d'enfants. Mais Homère lui attribue d'être le créateur et le conservateur de tous (44) les hommes, et il lui donne en conséquence le nom de Père, le plus ancien de tous les noms de tendresse et d'amour. II. A la bonne heure ; c'est bien cela, pour ce qui concerne Jupiter. Mais pensez-vous qu'il en soit de même de ceux qu'on fait semblables à lui? Ne voyez-vous pas que les poètes ne lui ont pas comparé Salmonée, quoiqu'il lançât la foudre, comme il le croyait, et qu'il imitât le bruit du tonnerre et la lueur des éclairs ? En effet, en opérant toutes ces merveilles, Salmonée ne ressemblait qu'à Thersite cherchant à imiter Nestor. Sous quel rapport donc les hommes peuvent-ils devenir semblables à Jupiter ? En imitant sa providence conservatrice, sa tendresse affectueuse, et spécialement sa bienfaisance paternelle. Telle est la ressemblance de la vertu des hommes et de la vertu des Dieux. Ceux-ci donnent à cette dernière le nom de justice, d'équité, ou toute autre dénomination religieuse et mystique. Les hommes donnent à l'autre le nom d'affection, de bienveillance, ou toute autre dénomination agréable, appropriée à leur langage ordinaire. D'ailleurs, ce même sentiment de bienveillance chez l'homme est inférieur à ce même sentiment chez les Dieux, entre autres rapports, sous celui de sa latitude. Car la sensibilité des hommes ne s'étend point à tout ce qui leur ressemble (45). Il en est d'eux comme des troupeaux de quadrupèdes. Il ne se forme d'affection qu'entre ceux qui vivent dans le même pâturage, et même tous ne la partagent pas. On voit quelquefois dans un même troupeau, sous un seul pasteur, des querelles, des agressions, à coups de cornes, à coups de dents. A peine reste-t-il le moindre signe de l'affection antérieurement contractée. Le boire, le manger, les vêtements, et tout ce qui est à l'usage du corps, les hommes l'achètent et le payent avec de l'airain, du fer ; et les choses d'un plus haut prix, ils les payent avec de l'argent et de l'or. Tandis qu'ils pouvaient, laissant de côté tous ces métaux, prendre gratuitement les uns chez les autres ce qui leur était nécessaire, établir entre eux les conditions les plus équitables, savoir, que celui qui aurait besoin de quelque chose le recevrait de celui qui serait en mesure de le lui. fournir, et que ce dernier fournirait ce qui lui serait demandé, à la charge de recevoir à son tour, ce qui pourrait être honnêtement exigé (46). III. Homère reproche à Glaucus, le Lydien, d'avoir donné de l'or pour de l'airain, d'avoir échangé une armure qui valait cent pièces de bétail contre une autre qui n'en valait que neuf (47). Or si, écartant la valeur intrinsèque des deux objets échangés, ils n'étaient appréciés que sous le rapport de l'affection, les deux valeurs seraient en parfait équilibre. Mais maintenant tout est plein de magasins et de boutiques. On ne voit que ventes et emplettes ; que denrées de terre et de mer, domestiques ou foraines, indigènes ou étrangères. On tourmente de toutes les manières les flots et le continent. On va à la chasse des animaux les plus difficiles à prendre, à la recherche de ce qui est le plus dérobé à nos yeux ; on importe les produits des plus lointains climats ; on étale les choses les plus rares ; on creuse la terre pour y cacher ses richesses ; on remplit d'or et d'argent les creux qu'on a faits ; on entasse coffres forts sur coffres forts. La cause de tout cela est dans la défiance où l'on est de la philanthropie; dans la passion de l'avarice, dans la crainte du besoin, dans l'habitude de la méchanceté, dans l'amour de la volupté. D'où il résulte que les sentiments affectueux, éconduits, éliminés, étouffés, conservent à peine quelques faibles, quelques imperceptibles vestiges. Et ces sentiments qui devraient être les plus communs, les plus universels, les plus répandus, le nombre de ceux qui les éprouvent est si peu de chose, que, si l'on dit qu'ils ont existé jadis, soit dans la Grèce, soit chez les Barbares, on n'ajoute aucune foi à ce qui en est raconté : on le regarde comme une fiction poétique : on le met au nombre des fables, et ce n'est pas sans raison. IV. Une flotte Grecque, composée d'un nombre infini de vaisseaux, vient en Asie, amenant ce que la Grèce avait de plus illustres personnages. Pendant dix ans, ils habitent sous les mêmes tentes, ils se nourrissent des mêmes aliments, ils ont à combattre les mêmes ennemis, les mêmes Barbares. La renommée de tous leurs hauts faits présente à Homère le sujet d'un poème ; et au milieu d'une si nombreuse armée, durant le cours d'un si long intervalle, il n'a à nous offrir de la véritable philanthropie qu'un exemple unique, et c'est celui d'un jeune Thessalien et d'un Locrien homme fait (48). De tous les récits d'Homère, il n'en est point de plus délicieux sous le rapport de l'agrément, de plus attrayant sous le rapport de la vertu, de plus recommandable sous le rapport de la renommée. Tous les autres détails d'Homère, si l'on y fait attention, ne présentent que guerres, ressentiments, menaces, fureurs, et ce qui en est le résultat, lamentations, gémissements, meurtres, saccagements et carnages. D'un autre côté, dans les fastes de la République d'Athènes, on cite aussi un exemple bien mémorable d'amitié. Mais il est unique dans la volumineuse histoire des Athéniens. D'ailleurs, il est digne de Minerve, digne de Thésée ; c'est celui de deux hommes de bien (49), unis par l'amour du beau et du juste, sentiment qui les arma l'un et l'autre du même glaive contre un tyran, qui leur fit prendre le même dessein, et braver le même trépas. Hors cet exemple, les annales d'Athènes n'en offrent point d'autre. Tout le reste est ulcéré, gangrené. Ce n'est que perfidie et que corruption. On n'y voit qu'envie, que colère, que crasse ignorance de ce qui est honnête, que cupidité, qu'ambition. V. Si nous parcourons le reste de la Grèce, nous ne trouverons que tableaux hideux, les citoyens en guerre contre les citoyens, les cités aux prises avec les cités, les peuples en hostilité avec les peuples. Non seulement les Doriens contre les Ioniens, non seulement les Béotiens contré les Athéniens, mais encore les Ioniens contre les Ioniens, les Doriens contre les Doriens, les Béotiens contre les Béotiens, les Athéniens contre les Athéniens, les Thébains contre les Thébains, les Corinthiens contre les Corinthiens. On voit se combattre et se déchirer les uns les autres des peuples qui avaient une tige commune, que la même patrie avait enfantés, qui étaient nés sous la même température, sous le même climat, qui vivaient sous les mêmes lois, qui parlaient la même langue, qui cultivaient la même contrée, qui se nourrissaient des mêmes aliments, qui célébraient les mêmes mystères. Ceux qui étaient renfermés dans l'enceinte des mêmes murailles, ceux qui habitaient la même cité, on les voit courir aux armes, après s'être réciproquement promis d'étouffer toute dissension ; violer la solennité des serments par lesquels ils s'étaient liés, rentrer en guerre après être convenus de vivre en paix ; et se faire les plus grands maux sur les plus légers prétextes. Car les sentiments affectueux ne sont pas plutôt éteints entre les hommes, que tout devient entre eux sujet suffisant d'animosité et de trouble. C'est un vaisseau profond qui a perdu son lest. Les moindres écueils le touchent et le font chavirer. VI. Comment s'y prendra donc l'homme amoureux de ces sentiments pour s'en assurer la possession ? Il en coûte à le dire, il faut néanmoins avoir le courage de ne pas le taire. « De même qu'il ne peut point exister de société entre les lions et les hommes, de même qu'il ne peut exister nulle sympathie entre les loups et les agneaux (50) » ; de même aussi il ne peut point exister d'impulsion de sentiments affectueux d'homme à homme, tant que l'or et l'argent auront des attraits à leurs yeux. Parvinssent-ils à en détourner leurs regards, cette victoire ne suffirait pas pour laisser le champ libre à ces sentiments ; la fleur de l'âge dans un beau garçon, les charmes d'une belle femme feraient naître un nouvel obstacle. Éloignassent-ils leur attention de ces objets, ils se laisseraient séduire aux appas de la faveur populaire (51), au désir de jouer un rôle dans les assemblées du peuple, d'acquérir auprès de lui de la renommée, la chose du monde la plus fugitive, et qui s'envole avec le plus de rapidité de tous les lieux dont elle remplissait la sphère (52). Mépriseront-ils cette vaine fumée, ils craindront les tribunaux. Mépriseront-ils les tribunaux, ils craindront la prison. Braveront-ils les fers, ils ne braveront point la mort(53). Il faut se mettre au-dessus d'un grand nombre de voluptés, il faut remporter sur soi-même beaucoup de triomphes (54), pour acquérir un bien qui vaut à lui seul un grand nombre de voluptés, dont le prix est proportionné aux efforts que l'on fait pour lui, un bien plus précieux que les richesses, plus solide que la beauté, plus stable que la renommée, plus réel que tous les résultats de l'ambition ; un bien que chacun peut se donner à soi-même, vers lequel chacun peut spontanément se diriger ; un bien dans l'éloge duquel on n'a pas à redouter la corruption des suffrages ; un bien qui, donnât-il lieu à quelque déplaisir, à quelque fatigue, ne laisse pas de remplir de la satisfaction la plus douce celui qui le met en action, par la pensée du motif qui l'a animé. VII. Il est rare sans doute ce bien-là, tandis qu'on voit de tous les côtés, et sous mille diverses formes, ce qui n'en est que le simulacre, l'adulation avec le nombreux essaim, le long cortège de ses ricaneries, de ses flagorneries, de ses bassesses, ayant toujours sur le bout des lèvres le langage des plus affectueux sentiments, réglé, non d'après les impulsions de la bienveillance, mais calculé sur l'impérieuse loi de l'intérêt personnel ; non marqué du sceau des affections généreuses, mais empreint du cachet des affections mercenaires. Il ne faut pas même espérer de remède à ce mal tant que les hommes ne trouveront pas leur plus grand bien dans l'activité des sentiments d'une affectueuse bienveillance (55). C'est bien là sans doute qu'il réside, mais le plus grand nombre ne le voit, ni sous le rapport public, ni sous le rapport privé. Car s'ils le voyaient, certes ils mettraient bas les armes, ils congédieraient leurs Généraux, ils fermeraient leurs ateliers d'artillerie, ils licencieraient leurs soldats, ils n'auraient plus besoin de drapeaux, ils ne construiraient plus de forteresses, ils ne traceraient plus de lignes de circonvallation, ils stipuleraient d'eux-mêmes un nouveau traité de paix, sous les auspices de Jupiter, qui ne proclamerait point la cessation des hostilités dans les Jeux Olympiques, ni dans les Jeux Isthmiques, mais qui crierait du haut de l'Olympe : « Laissez, mes amis, laissez-moi sortir seul, quoique je vous donne beaucoup de sollicitude (56)» ; que je coure vous sauver, et que je ne souffre pas plus longtemps que vous vous exterminiez les uns les autres (57). Mais les hommes sont en possession de ne faire que des trêves éphémères, des trêves de trente années. Ils ne donnent à leurs calamités que des relâches courts et très peu solides, jusqu'à ce qu'un nouveau prétexte se présente pour tout bouleverser de nouveau. Posent-ils les armes, font-ils la paix, un nouveau genre de guerre s'empare de leur âme. Ce n'est point une guerre publique, c'est une guerre privée. Il ne s'agit point d'une armée qui porte le fer et la flamme, ni de forces navales, ni de cavalerie, c'est une guerre à laquelle les armes, le fer et le feu restent étrangers, mais qui attaque l'âme, qui la saccage, qui la remplit d'envie, d'animosité, de colère, d'acharnement, et de mille autres maux. VIII. De quel côté donc se tourner (58) ? Où trouver au moins quelque trêve ? Où seront nos Jeux Olympiques ? Où aurons-nous des. Jeux Néméens (59) ? Sans doute, on célèbre à Athènes avec un grand éclat les fêtes de Bacchus et les Panathénées. Mais au milieu de ces fêtes, les Athéniens se haïssent les uns les autres. C'est une guerre, ce ne sont point des fêtes. C'est aussi un beau coup d'œil à Lacédémone de voir les jeunes gens dans leur nudité, au milieu de leurs jeux, de leurs danses, de leurs exercices. Mais Agésilas y est jaloux de Lysandre, Agésipolis y est l'ennemi d'Agis, Kinadon y tend des embûches aux Rois Phalante aux Éphores, les Parthéniens aux Spartiates. Je n'ai nulle foi aux fêtes, jusqu'à ce que je voie les senti mens affectueux régner entre ceux qui les célèbrent. Voilà la véritable loi, la véritable stipulation de la trêve, dont les Dieux eux-mêmes ont été les régulateurs, à laquelle resteront constamment étrangers ceux qui ne possèdent pas les sentiments qui en sont la hase, quand même ils multiplieraient les libations, quand même ils se feraient inscrire plusieurs fois aux Jeux Olympiques, Isthmiques, ou Néméens. Il faut que la voix des hérauts proclamateurs de la trêve pénètre jusque dans l'intérieur de l'âme. Tant que la guerre qui y a son siège n'éprouve point les effets de cette proclamation, l'âme se maintient dans le même état d'aliénation, d'animosité, de haine. De là, les Déesses chargées du châtiment des forfaits, de là les Furies, de là les sujets des représentations théâtrales, de là les tragédies. Attachons-nous donc à mettre un terme aux hostilités. Appelons la philanthropie à notre secours : qu'elle vienne, qu'elle règle les conditions du traité, qu'elle en proclame le résultat. NOTES.
(1) Le
grec porte littéralement, par celui de l'opinion. Mais comme l'opinion
dans son sens absolu et abstrait, se compose de principes sains et de principes
erronés, de principes éprouvés au creuset de la raison, et de principes
hasardés sans examen préalable, j'ai pensé que Maxime de Tyr entendait parler
ici des principes de ce dernier genre, et je me suis servi du mot préjugé,
qui est technique en pareil cas.
Paris, le 8 germinal an IX. (29 mars 1801.) NOTES
(19) Formey
a été plus succinct. Il a traduit, sur les avantages de l'adversité.
Mais le mot grec paraît embrasser tous les accidents, toutes les vicissitudes
de la vie. Or, il y a dans ces vicissitudes beaucoup de circonstances critiques
qui ne sont point de l'adversité. Paris, le 12 germinal an IX. (2 avril 1801). NOTES
(40) Si
Formey eût réfléchi sur la matière de cette Dissertation, il n'en aurait pas
rendu le titre par ces mots: « Quelles sont les dispositions préalables à
l'amitié ». D'ailleurs, les traducteurs latins n'ont pas mieux exprimé la
pensée de notre Auteur.
|