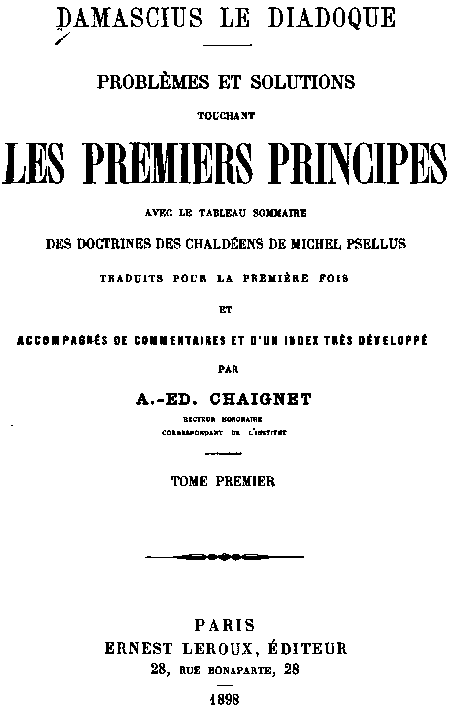|
table des matières de l'œuvre de damascius
DAMASCIUS LE DIADOQUE
PROBLÈMES ET SOLUTIONS TOUCHANT LES PREMIERS PRINCIPES Oeuvre numérisée et mise en page par Marc Szwajcer et PhIlippe Remacle
INTRODUCTION
PRÉFACE § 1. - LA VIE DE DAMASCIUS Nous ne savons presque rien de la vie de Damascius. Suidas nous dit : « Damascius, philosophe stoïcien, était originaire de Syrie, très intimement lié, ὁμιλητής, avec Simplicius et Elamius, originaires de Phrygie ; il vivait au temps de Justinien (527-565). » Photius (01) est plus précis sur le premier point : « Il est né, nous dit-il, à Damas », renseignement qui est d'autant plus sûr qu'il est certainement tiré de Damascius lui-même, dans sa biographie d'Isidore, où il donne à ce propos deux étymologies, plus bizarres l'une que l'autre, du nom de sa ville natale. C'est probablement aussi ce que veut dire Simplicius par ces mots : « Damascius, ὁ ἐκ Δαμασκοῦ φιλόσοφος; » quoiqu'on ait voulu y voir une étymologie de son nom même. Mais l'idée : originaire de Damas, se dit en grec, non Damascius, mais Damascène, et c'est ainsi que Simplicius qualifie de Damascène, Nicolas (02), comme originaire de Damas, et tous les habitants de cette ville et de cette région, les Damascènes, ce que confirme Photius aux premiers mots de sa notice : « J'ai lu la Vie d'Isidore le philosophe par Damascius le Damascène (03). » Damascius était donc son nom propre et il était né à Damas. A quelle époque précise? On l'ignore, aussi bien que la date de sa mort, et par suite la durée de sa vie. On ne peut même les déterminer avec une approximation satisfaisante. Le seul événement de sa vie qu'on peut fixer à une date précise et certaine est son voyage en Perse, qui eut lieu en 531 ou 532 et dura deux ans. Mais quel âge avait-il en ce moment, nous ne le savons pas et n'avons aucun moyen de le conjecturer. Dans sa Vie d'Isidore, à l'occasion d'un phénomène merveilleux relatif à Balémeris (04), il nous parle de Théodoric son fils, qui maintenant, νῦν, est maître de toute l'Italie (05). En pressant un peu le sens du mot maintenant on pourrait croire qu'au moment où il écrivait cet ouvrage, les événements qui avaient rendu le roi des Ostrogoths maître de toute l'Italie, étaient encore assez récents. Ce serait donc vers 493 (06) ou peu d'années après qu'il composa cette biographie d'une étendue considérable, qui pourrait être prise, à quelques égards, pour une œuvre sinon de jeunesse, du moins d'un talent qui n'est pas encore mûr. L'âpreté de ses jugements sur tous les philosophes de son époque, même sur ceux qu'il loue, même sur ses maîtres qu'il ne ménage pas plus que les autres, le ton tranchant du style, un accent d'autorité impérieuse, la recherche d'effets ambitieux, de figures violentes, de métaphores insolites et outrées, l'absence de clarté, de simplicité et de naturel, de mesure, — tandis que ces qualités se retrouvent dans une autre de ses œuvres, les Paradoxes — toute cette mauvaise rhétorique semble annoncer qu'il était encore sous l'empire de son goût pour l'art oratoire qu'il avait étudié à ses débuts dans la vie littéraire pendant trois ans sous Théon, et qu'il enseigna lui-même pendant neuf années (07) jusqu'à prendre le manteau du rhéteur, comme il le dit, qu'il quitta ensuite pour prendre celui du philosophe. On pourra donc placer cet ouvrage vers 495 à 500 après J.-C, et donner à l'auteur, quand il le composa (08), une trentaine d'années, ce qui établirait la date de sa naissance vers 470. — Le titre de diadoque qui lui est constamment attribué est la seule preuve, mais qui semble suffisante, pour le considérer comme le chef de l'Académie, le directeur des travaux scientifiques et l'administrateur des biens de l'École ; il en a été le dernier et aura succédé, dans cette fonction, à Hégias, successeur lui-même d'Isidore, vers 520. Le décret de Justinien en 529 l'en dépouilla au bout de neuf années d'exercice. Quant à sa mort, nous apprenons par Simplicius que son maître ne vivait plus quand il a écrit ses commentaires sur la Physique (09). Mais comme nous ne connaissons pas la date de la composition de cet ouvrage, nous voilà au rouet. Supposant donc qu'il a vécu encore une dizaine d'années après son retour de Perse en 534, c'est-à-dire qu'il est mort vers 544, nous donnerons à sa vie une durée approximative et conjecturale de soixante-quatorze à soixante-quinze ans. Les événements qui ont rempli cette vie assez longue, ne sont pas fort nombreux. Il semble qu'à ses débuts, il ait tenté la carrière administrative et diplomatique. Il ne put se refuser, dit-il, d'accepter d'accompagner, sans doute comme secrétaire, un personnage très peu recommandable par l'indignité de sa vie et de ses mœurs, mais très haut placé et très influent, — qu'il ne nomme pas d'ailleurs, — qui était chargé d'une mission importante à Bostra, en Arabie, qui avait été réduite en province romaine par l'empereur Sévère. Il a fait le récit du voyage de Damas à Bostra, d'une manière assez intéressante, tout en y mêlant des faits merveilleux (10). Leur séjour dans cette ville, frontière de l'empire, dura huit mois, ils revinrent par mer en Grèce et débarquèrent à Samos, d'où sans doute Damascius regagna Damas. Dès ce moment, il se livra tout entier aux lettres d'abord, à la philosophie et aux sciences ensuite. Pendant trois années entières, il étudia la rhétorique, sous Théon, à Alexandrie; — il la professa pendant neuf autres années, on ne sait où, — puis, donnant un autre cours à ses études et quittant le manteau du rhéteur pour revêtir celui du philosophe, il se rend à Athènes, où il étudia sous Marinus (11), successeur de Proclus, la géométrie, l'arithmétique et les autres disciplines mathématiques. Dans les sciences philosophiques, son maître a été Zénodote, le second successeur de Proclus. Puis il retourne à Alexandrie, où il complète ses études philosophiques et mathématiques, sous la direction d'Ammonius, fils d'Hermias, le plus célèbre, dit-il, de tous les philosophes ses contemporains, qui lui interprète les ouvrages de Platon et le grand traité d'astronomie de Ptolémée. Enfin, il est initié à l'art de la dialectique par les leçons et les entretiens d'Isidore, dont la supériorité, sous ce rapport, a éclipsé tous les hommes de sa génération, et l'on peut dire qu'il a bien profité de ses leçons. Élu scholarque de l'École d'Athènes vers 520, succédant à Hégias qui avait laissé tomber la philosophie à un degré d'abaissement qu'on n'avait jamais vu (12), il est dépouillé de cette fonction par le décret de Justinien en 329, et, quelques années après, arrive le grand événement de sa vie. Frappés dans leurs croyances, dans leur profession, dans leurs moyens d'existence, — car, enfermant l'École d'Athènes à l'enseignement, on en avait confisqué les biens et les revenus, — les maîtres, pour échapper aux humiliations et aux haines ardentes qui les poursuivaient, allèrent, et Damascius avec eux, demander un asile à la cour du roi des Perses, Chosroès Nou-Schirwan. Cette résolution leur était inspirée par un précédent. Déjà, sous Constantin, un disciple d'Iamblique, Eustathius de Cappadoce, avait séjourné en Perse, où il avait été envoyé en ambassade par l'empereur (13), et d'ailleurs nos philosophes, presque tous originaires de l'Asie mineure, Damascius surtout, qui était de Damas, pouvaient avoir des relations personnelles ou scientifiques avec l'Orient. — Soit qu'ils n'aient pas trouvé en Perse l'accueil qu'ils avaient espéré, soit plutôt que le regret de la patrie l'ait emporté sur toute autre considération, leur séjour n'y dura que deux années. Mais ces deux ou trois années ne furent pas perdues pour la science. Le roi de Perse profita de leur présence pour faire traduire, soit en pehlvi, soit en syriaque, on l'ignore, — car ces versions sont perdues, — tous les ouvrages de Platon et d'Aristote, même les plus difficiles et les plus transcendants (14). On peut être certain que Damascius ne resta pas étranger à cette grande entreprise, qui entraînait nécessairement le rapprochement et la collaboration des savants orientaux et des savants grecs. C'est ainsi que Damascius pût prendre une connaissance directe des théologies Orientales, particulièrement de celle des Mages ou de Zoroastre. Les renseignements très nombreux qu'il nous donne à cet égard, dans son livre des Principes, puisés aux meilleures sources, sont donc non seulement des plus intéressants mais des plus autorisés. A partir de son retour de Perse, on n'entend plus parler de lui. § 2. — LES OUVRAGES Suidas, dans son article très court, mentionne que Damascius avait écrit des mémoires, ὑπομνήματα, sur Platon, un ouvrage intitulé : Περὶ ἀρχῶν et une φιλόσοφος ἱστορία. Les recherches de Kopp, de Zeller et de M. Ruelle ont permis de compléter et de préciser les renseignements de Suidas. Les ouvrages de Damascius peuvent se diviser en trois classes : 1° ceux qui ont été conservés et édités en tout ou en partie; 2° ceux qui, conservés, n'existent qu'en manuscrit ; 3° ceux qu'on ne connaît que par des citations, et dont on n'a pas, jusqu'ici du moins, retrouvé de traces. Nous en avons donné ailleurs (15) la liste complète, je n'ai à y ajouter que les leçons sur le Timée citées par Damascius lui-même (16); — un commentaire sur la météorologie, si la citation de Philopon (17) sur la nature de la voie lactée, appartient à un ouvrage à part ; — enfin, une épigramme, insérée dans l'Anthologie palatine (VII, 553) et que Grotius affirme avoir été précédée dans un manuscrit de la suscription Δαμασκίου φιλοσόφου. J'ai donné et traduit, dans l'Histoire de la Psychologie des Grecs, des passages étendus du traité, σύγγραμμα, sur le nombre, le lieu et le temps, que nous a conservés Simplicius dans son commentaire sur la Physique. Photius a trois articles sur Damascius : l'un concerne les Παράδοξα, divisés en quatre livres, λόγοι, dont le premier contenait 352 chapitres, et traitait des περὶ παραδόξων ποιημάτων ; — le deuxième, 52 chapitres et traitait : περὶ δαιμονίων διηγημάτων ; — le troisième 63 chapitres, et traitait περὶ τῶν μετὰ θάνατον ἐπιφαινομένων ψυχῶν; — le quatrième, 105 chapitres et traitait περὶ παραδόξων φύσεων. Il s'agissait donc d'une histoire du Merveilleux considéré tour à tour dans les œuvres de l'art des hommes, dans les récits touchant les démons, — dans les phénomènes relatifs à la vie de l'âme après la mort ; — enfin, dans les êtres de la nature. Photius qualifie tous les faits miraculeux rapportés dans cette histoire des miracles des païens, comme impossibles, incroyables, fabriqués avec mauvaise foi et insensés, dignes enfin d'un homme athée et impie. Il n'en reconnaît pas moins que le style en est concis, sobre, clair et non sans élégance. Les deux autres articles sont relatifs à ce que Photius appelle : la Vie d''Isidore, et Suidas l'Histoire philosophique : l'un (18) est une étude toute littéraire et très malveillante sur le style de l'auteur ; l'autre (19) une analyse de l'ouvrage même, faite avec négligence, par extraits sans lien (20), altérés dans leur texte et souvent parfaitement inintelligibles. Photius remarque avec raison que cet ouvrage d'une étendue considérable, πολύστιχος, qu'il divise en 60 chapitres, est moins une biographie d'Isidore, le maître de Damascius, qu'une histoire du mouvement philosophique en Grèce et une appréciation souvent sévère de tous ceux qui y ont pris part ou l'ont dirigé à cette époque, c'est-à-dire depuis la fin du ve siècle et pendant le vie après J.-C. Il est difficile de croire que ce n'est là qu'un défaut de composition et un abus des digressions, qui dépasserait toutes les bornes, comme le dit Photius (21) et qu'on ne peut guère attribuer à un esprit de cet ordre. Je crois plutôt que Suidas a raison d'appeler cet ouvrage : une histoire de la philosophie contemporaine; je le crois d'autant mieux que Suidas, quoique postérieur à Photius, n'a pas emprunté à son analyse, mais au texte même de Damascius, les renseignements qu'il nous donne sur plusieurs des philosophes nommés dans la Vie d'Isidore, comme le prouvent les divergences des détails en ce qui concerne Héraïscus et Sévérus. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage était dédié à une dame, nommée Théodore, adonnée aux cultes helléniques, fort versée dans les sciences philosophiques et mathématiques, et qui n'était pas restée étrangère à la poésie et aux lettres. Elle avait été instruite par Isidore lui-même et par Damascius, avec ses sœurs plus jeunes, à des époques différentes. Elle était fille de Cyrina et de Diogène, fils d'Eusébius, fils de Flavien, qui tenait son origine de Zampsigéramos et de Monime, auxquels remonte aussi Iamblique ; « un des sectateurs les plus célèbres de l'impiété idolâtrique ». C'est sur la prière de cette femme qui avait été son élève, et que recommandait d'ailleurs auprès de lui sa parenté d'origine avec Iamblique, son maître préféré, que Damascius, comme il le témoigne lui-même, entreprit d'écrire la biographie d'Isidore ; mais on comprend aussi pourquoi, trouvant sans doute la matière un peu mince (22), il a élargi son plan et a fait seulement à Isidore, une place, la première sans doute, mais non la plus importante, dans une histoire générale de la philosophie grecque. Le plus important par son contenu comme par ses proportions des ouvrages de Damascius est celui qui est intitulé : Problèmes et solutions touchant les premiers Principes, souvent désigné sous la forme abrégée : des Principes, περὶ ἀρχῶν. Ce titre était assez fréquent pour les traités de haute métaphysique. Origène l'avait donné à son traité sur les fondements de la doctrine chrétienne, et Porphyre, avant lui, à deux livres aujourd'hui perdus. Les manuscrits de cet ouvrage sont très nombreux, M. Ruelle, dans la préface de son édition, en compte 31, dont il établit l'âge, la filiation et pour ainsi dire la généalogie et la valeur absolue ou comparative. Je n'ai aucune compétence en cette matière et j'accepte les résultats de la critique autorisée du savant et laborieux helléniste. De ces manuscrits, Kopp, qui, le premier, en 1827, publia, à Francfort, la première partie du traité des Principes, n'a eu à sa disposition que deux : celui de Munich, désigné par M. Ruelle sous la lettre E, du xvie siècle, et celui de Hambourg, désigné par la lettre F, du même siècle, lequel a appartenu à Lucas Holste (Holstenius). Quoiqu'il ait collationné avec soin et dans son entier le manuscrit de Munich, c'est surtout celui de Hambourg que Kopp a suivi pour établir son texte, et il ne s'en est écarté que là où il présentait des lacunes qu'il comblait avec l'autre, comme il nous l'apprend lui-même dans sa préface : « Ut nusquam neque in lectione constituenda neque in interpunctione ab eo discesserim, nisi quod, ubi Hamburgensis mancus erat, ex Monacensi libro eum explevi. » Malheureusement ce texte est souvent fautif; non seulement Em. Heitz (23), qui est très sévère pour Kopp, mais A. Jordan (24), qui l'est moins, l'ont reconnu ; mais Kopp le sentait lui-même, car il l'a, en maints endroits, changé et corrigé, souvent très heureusement. Il ne faudrait pas trop rabaisser pour cela le mérite de ce premier éditeur, dont M. Ruelle a souvent reproduit les ingénieuses restitutions. D'abord, il a commencé, et le commencement est la moitié du tout, suivant le proverbe grec, reproduit par Damascius. En outre, la première partie de l'ouvrage, qu'il a seule éditée, était déjà assez considérable pour permettre à la critique de porter sur Damascius un jugement suffisamment fondé (25). De plus, il a accompagné le texte, en un petit nombre de passages, d'un commentaire latin que j'ai consulté avec fruit ; — enfin, il a divisé la masse, le bloc chaotique de cette partie, en paragraphes ou sections, qui ne répondent pas toujours aux divisions qu'on pourrait croire plus logiques de la matière, mais qui introduisent des points d'arrêt nécessaires et soulagent le lecteur épuisé par une discussion dialectique trop subtile et trop tendue, dont il ne voit pas toujours la fin. — Le plus grand reproche qu'on puisse faire à Kopp, c'est d'avoir cru trop facilement à l'authenticité d'un ouvrage attribué à Hérennius et intitulé : Ἑρεννίου φιλοσόφου ἐξηγήσεις (ou ἐξήγησις) εἰς τὰ μετὰ τὰ φυσικά, et d'en avoir inséré à la fin de son édition quelques extraits destinés à éclaircir les passages correspondants de Damascius. Il est prouvé, par la décisive discussion d'Em. Heitz, que ce petit ouvrage que Luc. Holste qualifie de Libellus magni pretii et insigne compendium platonicœ théologiαe (26), et qu'il croyait extrait et résumé du περὶ ἀρχών, est un centon fabriqué par un faussaire qui a pris le nom d'Hérennius, disciple de Plotin, et l'a composé d'extraits d'Alexandre d'Aphrodisée, de Philon d'Alexandrie et de Damascius lui-même. Très supérieure à tous égards est l'édition française donnée, en 1889, par M. Ruelle. D'abord l'exécution typographique, confiée à l'imprimerie nationale, est d'une parfaite beauté. Les caractères grecs sont du type qu'on appelle Garamond, du nom du célèbre graveur qui, sur l'ordre de François Ier, les dessina, les grava et les fondit, et qui n'ont jamais été surpassés, depuis le xvie siècle. — La correction du texte ne laisse rien à désirer et je n'y ai relevé qu'un nombre si faible d'erreurs d'impression qu'on peut en considérer la quantité comme négligeable : ce qui fait grand honneur à M. Ruelle d'abord, et ensuite aux protes de l'Imprimerie nationale, qui ont corrigé les épreuves et l'ont fait avec tant de soin, de conscience et de savoir. L'édition de M. Ruelle a d'autres mérites encore, elle est complète, et la partie qu'il a ajoutée est presque aussi étendue que celle déjà éditée par Kopp. De plus, il a eu le bonheur, bonheur justifié, de mettre la main sur un excellent manuscrit (27) du xe ou même peut-être du ixe siècle, de la Bibliothèque Saint-Marc à Venise, coté 246, qui, par conséquent, n'est séparé de l'époque où vivait l'auteur que d'un siècle et demi approximativement, ce qui lui a permis, après avoir consulté et conféré, au cours de ses missions en Italie et en Espagne, d'autres manuscrits encore, de donner au public un texte beaucoup plus pur, beaucoup plus sûr et approchant autant que possible du manuscrit type, aujourd'hui perdu. M. Ruelle a de plus enrichi son édition de notes critiques sur le texte, de très nombreuses et très exactes références aux dialogues de Platon et aux ouvrages de Proclus cités par Damascius; il a, tout en adoptant et poursuivant la division en paragraphes de Kopp que j'ai suivie, donné pour chacun d'eux un sommaire qui en résume le contenu; enfin, il a mis, à la fin de son édition, un Index très étendu, presque complet (28) qui facilite singulièrement les recherches, et qui est une œuvre de temps, de patience et de conscience, singulièrement méritoires. Tous ces services rendus à la philosophie et à l'histoire de la philosophie, et que la critique impartiale reconnaîtra de plus en plus, permettront à l'auteur de supporter avec sérénité les injustes et injurieuses attaques d'un certain M. Kroll (29), et de M. Em. Heitz lui-même (30). § 3. — LE TRAITÉ DES PREMIERS PRINCIPES Nous le considérerons d'abord au point de vue de la forme, et ensuite nous chercherons à donner une analyse sommaire et aussi claire que possible du contenu de ce livre singulier. La manière la plus rationnelle de le diviser, — car aucun plan, ni aucun principe de division, ni aucune division proprement dite, ne s'aperçoit dans le livre lui-même, ou n'y est suggérée (31),—est d'y distinguer deux parties, dont la première comprend les 138 premiers paragraphes de l'édition Ruelle : elle forme une masse dense et compacte, où l'auteur n'introduit aucune coupure logique, aucun point d'arrêt, fondé dans le mouvement des idées, sauf ceux que lui impose à lui-même la fatigue d'une méditation trop intense et trop prolongée, qui lui fait dire naïvement : Arrêtons-nous ici pour respirer un peu. On aperçoit seulement, mais souvent brouillé, parfois brisé, le fil logique qui lie les unes aux autres les diverses parties du développement systématique, et que nous essaierons de renouer plus loin. La seconde partie comprend deux groupes, dont le premier, qui comprend 258 paragraphes, du § 139 au § 396 inclusivement, se rattache étroitement au sujet traité et au système qui l'expose; il se divise en trois triades, division fondée dans les données et les principes du système. Cette Ennéade, nombre cher aux Alexandrins, se compose de trois classes : l'Intelligible — l'Intelligible et intellectuel, — l'Intellectuel, divisées chacune en trois ordres, qui sont, sauf le premier ordre de la première classe qui manque, l'objet, chacun, d'une analyse et d'une exposition spéciales et précédés d'un titre particulier. Le dernier groupe de la seconde partie constitue aussi une Ennéade et est destiné à analyser et à commenter successivement les neuf hypothèses que Damascius, comme Proclus, croit trouver dans le Parménide de Platon. Chose assez étrange et qui prouve déjà combien peu Damascius songeait à faire ici un commentaire proprement dit et un ouvrage à part, de la discussion et de l'interprétation du Parménide, c'est que les deux premières hypothèses, les plus importantes assurément au point de vue de la doctrine, ne font pas partie de ce groupe organisé et sont fondues dans toute la partie antérieure du livre (32) ; de même que le premier ordre de la classe des Intelligibles ne figure pas dans l'Ennéade qui est consacrée à cette classe. Les neuf hypothèses sont organisées elles-mêmes en deux sous-groupes : le premier comprenant les cinq premières; le second les quatre dernières, division arbitraire, toute factice et artificielle, mais ingénieuse et élégante (33). Il est plus important, mais combien plus difficile, de donner une analyse sommaire du contenu du livre, où il serait excessif de dire qu'il n'y a aucune méthode, aucun lien organique entre les thèses qui se succèdent, aucun principe, directeur de l'évolution du système des doctrines, mais où souvent le fil se dérobe et certainement parfois se brise. — Le style lui-même et la langue nous présentent des difficultés parfois insurmontables (34) et telles qu'un savant comme Zeller croit devoir avertir ses lecteurs de ne pas trop se fier à l'exactitude du compte rendu qu'il donne de la doctrine, tant il est peu certain d'en avoir compris tout le sens, par suite de l'obscurité souvent impénétrable de l'exposition (35). C'est assurément un livre mal composé ; on n'y aperçoit aucun plan suivi ni même tracé; aucune division rationnelle de la matière, sauf dans la dernière partie ; il est écrit d'un seul jet, sans coupure ni point d'arrêt, excepté ceux qu'imposent à l'auteur même la fatigue qu'il éprouve et la difficulté de se retrouver au milieu de la trame compliquée de ses raisonnements et des subtilités d'une analyse dialectique poussée aux dernières limites des choses que la raison peut comprendre, et même au-delà. La forme interrogative qu'il donne très fréquemment à sa pensée, fait si souvent hésiter sur le sens de ses propositions qu'on est tenté de croire à des contradictions que n'hésite pas à lui attribuer Ritter (36). La syntaxe très souvent incorrecte, des constructions elliptiques et anacoluthes, contribuent à rendre la lecture pénible, et très difficile l'intelligence du sens vrai dans un texte matériellement altéré très fréquemment. La démonstration procède volontiers sous la forme du raisonnement hypothétique ; mais le second membre, l'apodose ou, suivant le terme stoïcien, l'ἑπόμενον, est parfois si éloigné du premier, il en est séparé par tant d'incises et si longues qu'on n'est pas sûr d'y voir la conclusion. Tous ces défauts, qu'on s'étonne de trouver chez un écrivain qui a étudié et professé pendant douze ans la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler et d'écrire, et qui a donné dans un de ses ouvrages des preuves d'un vrai talent, tous ces défauts se ramènent à un seul : l'obscurité ; Damascius, du moins dans le traité des Principes, est obscur dans l'expression grammaticale ; — obscur dans les procédés de son argumentation ; — obscur dans le fond et les développements de sa pensée, et tellement obscur que personne ne peut se flatter de le comprendre partout et toujours. Et cependant, comme nous le dirons plus loin, et comme l'analyse sommaire de la doctrine qui y est exposée, le prouvera, c'est un livre curieux, intéressant, riche de vues justes, profondes, originales, puissantes, et qui fait penser. Le défaut de composition de cet ouvrage qui ne présente pas un tout organisé, divisé en parties bien proportionnées, a fait naître l'opinion que nous étions en présence de deux ouvrages distincts, dont l'un aurait eu pour sujet la recherche métaphysique des premiers Principes de la philosophie ; dont le second ne serait qu'un commentaire du Parménide de Platon, qu'il aurait voulu, par esprit de rivalité jalouse, opposer au commentaire de Proclus sur ce même dialogue. Mais cette opinion, rejetée par M. Ruelle comme par Kopp, n'est pas soutenable. L'unité de l'ouvrage est tout d'abord et surtout démontrée par l'unité du sujet qui y est exposé : il n'y est question, du commencement à la fin, que des Principes, comme l'indique très exactement le titre, et si les hypothèses du Parménide y sont si amplement commentées et discutées, c'est que Platon, suivant Damascius, n'a traité dans ce dialogue fameux que des Principes (37). Si l'auteur aborde, dans la quatrième hypothèse, la question du quatrième Un, c'est-à-dire des espèces, εἴδη, cause coopérante de la création sublunaire, des espèces selon leur acte ou selon la substance de l'être, c'est-à-dire des espèces psychiques, c'est que l'espèce psychique n'est pas en dehors des Principes (38). La matière elle-même, objet de la cinquième hypothèse, est un principe (39). — Et, d'ailleurs, où ferait-on commencer ce second ouvrage, c'est-à-dire le commentaire spécial du Parménide? Sera-ce au § 397, où l'on voit, pour la première fois, se présenter dans le texte une division, précédée du titre : « De la troisième hypothèse » ? Mais où sont donc traitées les deux premières, assurément les plus considérables de toutes? Nous les voyons visées l'une et l'autre dès le cinquième paragraphe, c'est-à-dire tout au commencement du traité. La seconde, plus amplement développée, est visée et interprétée dans près de quarante paragraphes de la première partie. Il faudrait donc ne voir dans tout l'ouvrage qu'un commentaire du Parménide (40) ; mais dans cette hypothèse même, que personne n'a, je crois, formellement soutenue, nous n'aurions toujours qu'un seul et même ouvrage, et non deux distincts. Si l'on veut faire commencer le second ouvrage au § 126, où intervient la question de la participation, il faut d'abord remarquer, comme l'a fait M. Ruelle, que cette discussion est annoncée et préparée dans le premier (41) ; et ensuite que c'est une bien singulière entrée en matière d'un commentaire que de traiter la question générale et dogmatique de la participation ; — et enfin et surtout, que s'il traite de la participation, c'est par suite du rapport intime de la participation à son sujet : les Principes; car c'est de la participation des premiers principes et de tout l'intelligible (42) qu'il s'agit là, et les mots ἐπὶ τούτοις indiquent bien que ce n'est qu'une suite, une partie de la matière qu'il s'est proposé de traiter. D'un bout à l'autre de l'ouvrage (43) il n'est question que des principes ; M. Ruelle a même fait très justement observer que si la question des ordres dans les trois classes de l'intelligible, intelligible et intellectuel, et de l'intellectuel, est surtout posée dans la seconde partie (44), elle est néanmoins déjà annoncée et visée dans la première (45). L'unique fondement de l'opinion qui veut voir dans la deuxième partie (46) un commentaire faisant pendant et opposition à celui de Proclus, c'est que le manuscrit de Munich, qui est du xvie siècle, porte à son fol. 177, un nouveau titre : Δαμασκίου διαδόχου ἀπορίαι καὶ λύσεις εἰς τὸν Πλάτωνος Παρμενίδην ἀντιπαρατεινόμεναι τοῖς εἰς αὐτὸν ὑπομνήμασί τοῦ φιλοσόφου. Mais cette annotation, dans le ms. A, qui est du xe ou peut-être même du ixe siècle, est tout à la fin avec l'addition, écrite de première main et décisive : Τέλος. C'est de là qu'elle a été transportée au commencement dans le ms. 245, C, de la bibliothèque Saint-Marc, par le cardinal Bessarion, et même dans le ms. A, par une main inconnue, mais dont l'écriture porte l'indice du xiie ou du xiiie siècle, c'est-à-dire d'une date postérieure à la confection du manuscrit lui-même. Quant au fait que Proclus est rarement cité dans la première partie et souvent dans la seconde, la chose a trop peu d'importance pour justifier la conclusion qu'on en tire, et si l'on tient à en avoir l'explication, il n'est pas difficile de la trouver. N'est-il pas naturel que la seconde partie, contenant une exposition et une interprétation de sept hypothèses sur les neuf du Parménide, le nom de Proclus, qui avait fait de cet ouvrage un commentaire spécial, y soit plus fréquemment cité que dans la première, où les deux premières seulement sont analysées et développées ? Il y a, on le sait, entre les mots : κατ' ἀλήθειαν οὐδέ qui terminent le § 126 ter et les mots : τὰς ἀμεθέκτους τοῖς μεθεκταῖς qui commencent le § 127, il y a une interruption manifeste du sens. Cette interruption coïncide, dans certains manuscrits, avec une lacune matérielle qui comprend quatre ou six (47) feuillets vides. Mais cette séparation et ce vide ne se retrouvent pas dans d'autres manuscrits où le texte se continue : κατ' ἀλήθειαν οὐδὲ τὰς ἀμεθέκτους, malgré la rupture évidente du lien des idées et l'impossibilité de faire entrer ces mots dans une phrase grammaticalement construite. Mais on ne peut mesurer l'étendue de cette lacune, qui doit être petite, puisqu'il s'agit toujours, avant la phrase du § 127 comme après, de la participation. Il n'y a donc pas lieu de conclure à une division organique ou même simplement graphique du traité en deux parties distinctes et l'on ne peut que souscrire à l'opinion de Kopp, qui dit : « Hic locorum lacunam esse manifestum est; at non admodum magnam censeo, et insuper commentarium in Parmenidem subsequens arcτissime cum his Dubitationibus (Ἀπορίαι), cohaerere judico. » § 4. — LE SYSTÈME ET LA DOCTRINE Il y a plus d'une analogie entre la Métaphysique d'Aristote et le traité des Premiers Principes de Damascius : la science, ἡ σοφία, la science absolue, est la connaissance cherchée et désirée de tous, ἡ ζητούμενη ἐπιστήμη. Cette connaissance objet du désir et but de la recherche de tout philosophe, est la connaissance des principes, περὶ ἀρχάς )εστι, mais non de tous principes, mais des principes universels (48), des principes premiers. Ces principes premiers pour Aristote sont l'Être et l'Un : car tout est être et un, πάντα γὰρ ὅν τε καὶ ἕv (49). Telle est aussi la science que désire atteindre et cherche à exposer Damascius. Lui aussi aspire à connaître les principes, et les principes premiers, et les premiers de tous. Il le dit dans le titre même de son ouvrage qui est tout entier, depuis le comment jusqu'à la fin, consacré à cet unique objet : il le dit à la première ligne de son traité, où il se demande ce que peut être le principe unique de Tout, ἡ μία πάντων ἀρχή, et si tout ce traité a pu être considéré comme une interprétation, un commentaire du Parménide de Platon, c'est que ce dialogue, au dire de Damascius, a pour objet unique : les Principes (50), ὁ διάλογός ἐστί περὶ ἀρχῶν. Mais, pour Damascius comme pour Platon, tel que l'interprète celui-ci, les principes premiers sont non seulement des lois, des causes, des forces ; ce sont des causes et des forces divines, des dieux : la science désirée et cherchée est donc une Théologie, et le Parménide n'est qu'un traité de théologie. Platon fait rentrer manifestement dans cette science la recherche de l'Être et de l'Un qui font partie des intelligibles, parce qu'ils sont de même essence (51). Mais, comme nous allons le voir, la loi de la procession est une loi fatale, nécessaire, universelle, qui gouverne, dans une acception et sous un mode ineffables, même le monde des intelligibles purs ; il y a donc une filiation des principes, un ordre dans leur succession, qui n'implique pas, il est vrai, un ordre d'antériorité dans le temps ; car ils sont en réalité tous à la fois et ensemble, mais qui n'exclut pas une priorité d'essence et, comme nous dirions : in signo rationis. Il en résulte que Proclus a eu raison de dire que Platon, dans le Parménide, s'était proposé d'écrire une Théogonie (52), l'enchaînement des principes considérés comme forces divines n'étant autre qu'une génération des dieux, et Damascius lui-même à son tour, en écrivant un traité des Premiers Principes, se croit en droit de dire expressément que, lui aussi, écrit une Théogonie (53), ou, suivant la formule chaldaïque, une Théosophie (54). Le traité des Premiers Principes est donc à la fois un système de métaphysique et un système théologique, c'est-à-dire pour les Grecs une mythologie. Néanmoins, quoiqu'il ait, sous ce dernier rapport, une valeur historique très sérieuse, c'est surtout une œuvre de philosophie pure, de pure métaphysique ; un effort d'expliquer rationnellement et scientifiquement l'origine, la nature du système entier des choses (55). Il est même remarquable que la psychologie n'y tient qu'une petite place et accidentelle, que la logique, la physique proprement dite, l'éthique et l'esthétique y font complètement défaut. C'est même ce qui donne à ce livre un ton si froid et si sec. L'auteur n'a de regard que pour les abstractions; il écarte, comme de parti pris, tout ce qui pourrait émouvoir la sensibilité : l'élément moral des choses, leur âme, cette âme infinie, se dérobe pour lui, ou il le dédaigne. Il ne nous dit rien, ni du bonheur, ni du bien, ni de la douleur et de la joie, rien de la vertu, rien du devoir, rien de la vie, rien de la mort, rien du beau ni de l'art, rien de l'avenir après l'existence présente et des espérances éternelles, rien de la prière, rien de l'amour qui est pourtant le vrai mystère de l'unité, sujets qui avaient inspiré à Plotin et à Proclus des pensées si hautes et des accents si touchants et si vrais. Avant d'essayer de donner un exposé sommaire du système, ce qui sera particulièrement difficile, à cause de la substance très riche, mais très confuse, des matières et du caractère tumultueux, irrégulier, presque désordonné de l'exposition, il sera bon de détacher ce qu'on pourrait appeler les principes méthodologiques, qui, dispersés dans tout le corps du livre et mêlés aux développements du contenu, n'en sont pas moins les idées directrices et régulatrices, qui gouvernent les parties du système et les ramènent secrètement à une sorte d'unité latente. Et d'abord il reconnaît que c'est de ce que nous observons en nous-même, quand nous nous interrogeons, c'est de l'analyse de notre raison (56), comme faculté de connaissance, que nous pouvons tirer la notion des principes métaphysiques; c'est ainsi sur l'autorité de la conscience, appelée par lui la voix d'un prophète (57), qu'il affirme un principe suprême, inexplicable et certain, qu'il ne nomme pas parce qu'il ne peut être ni nommé ni pensé. Interrogeons-nous donc nous-même (58). Cette observation de conscience nous montre dans la raison deux axiomes d'une évidence et d'une vérité indiscutables. Le premier est ainsi formulé : ce qui par essence n'a absolument aucun besoin est supérieur et antérieur à ce qui éprouve quelque besoin (59); le second est : ce qui a besoin d'un meilleur est au-dessous de ce meilleur même ; d'où l'on doit conclure cet autre principe, que ce qui est en puissance est, en tout et partout, au-dessous de ce qui est en acte (60). Une suite de vérités de faits nous est acquise ou confirmée à l'aide de ces règles de la raison. De même que le Principe nous est donné par la conscience, de même l'existence du Tout des choses nous est donnée par l'expérience; ce tout, réduit par une opération de la pensée à la simplicité la plus parfaite, nous amène à l'idée de l'Un (61). La procession est une loi des choses visibles et invisibles, humaines et divines, que la raison nous révèle, et nous révèle non seulement comme universelle, mais encore comme nécessaire, Ἀνάγκη προοδική (62). Toute procession a trois moments : le premier, où la chose demeure ce qu'elle est, μονή ; — le deuxième, où elle sort d'elle-même, ou évolue au-dedans d'elle-même par un mouvement d'expansion interne : c'est la procession proprement dite, πρόοδος; — le troisième, où elle se retourne, se replie sur elle-même, revient à son principe pour maintenir intacte son essence : c'est la conversion, ἐπιστροφή (63). La loi de la procession est ainsi réglée par le nombre trois, et tout, par conséquent, est trois, τὰ πάντα τρία. Pour les Intelligibles, cette loi n'est qu'un analogue de la procession, πρόοδος ἀπρόοδος, et néanmoins elle y engendre la distinction, en commençant par la distinction de l'Un et de l'être, qui donne naissance à la série. La série est l'évolution de la substance se déployant de l'Un en pluralité (64). L'évolution sériée a pour effet de mettre entre toutes les choses intelligibles ou sensibles un lien et un ordre réels et vivants, qui font de toutes, universelles ou individuelles, un tout, un monde, κόσμος. La procession, comme la participation, par son mouvement de conversion, amène le contact (65), qui fait de toutes les parties un continu, lequel continu, loin de l'exclure, implique le discret. La nature va par sauts, à l'aide de multiples intermédiaires (66), qui ménagent le passage d'une chose ou d'un état à une autre, sans supprimer l'intervalle infiniment petit qui les sépare. Dans et par ce contact les choses exercent les unes sur les autres une action qui les modifie, πεπόνθησις; c'est ce qu'on appelle la participation, qui est ainsi une passion et un contact. A l'aide de ces sortes de postulats et de ces faits donnés par l'expérience interne ou externe, Damascius aborde les grands problèmes qu'il s'est proposés, sans se faire illusion sur la certitude des résultats qu'il espère. S'il n'est pas un sceptique qui se plaît à détruire les thèses qu'il s'est appliqué si laborieusement à édifier, s'il croit à la vérité et à la possibilité de l'entrevoir (67), sinon de la voir tout entière, il reconnaît que la raison humaine a des limites qu'elle ne saurait franchir : « Quelle sera donc, dit-il, la fin de tous ces raisonnements, sinon un silence absolu, et l'aveu que nous ne connaissons rien du Principe Suprême, et qu'il est même impossible qu'il arrive à notre connaissance? » Certaines des solutions qu'il propose lui font à lui-même l'effet d'apparences vaines, entrevues dans les vagues visions d'un rêve. « De ce que nous venons de dire, qu'il en soit ce qui plaira à Dieu (68). » « La vérité absolue, les Dieux seuls pourraient la connaître ; pour nous, il nous suffira de pousser la recherche aussi loin que nous pourrons (69), de suivre en ces matières l'analogie pour arriver à être clair, et pour présenter une sorte de démonstration qui tentera de s'emparer, quoique obscurément, de la vraie vérité qui est impossible à atteindre parce qu'elle surpasse notre nature (70). » Et si on lui demandait pourquoi il se livre alors à l'étude de problèmes qui, par leur essence, doivent, de son propre aveu, rester éternellement sans réponse, il nous dit : que l'esprit humain est fait de telle sorte qu'il ne peut se délivrer de ce noble tourment, de cette inquiétude sacrée, de cette curiosité divine de pénétrer le mystère (71) et le secret de la nature entière. Ainsi donc le Tout, l'Univers des choses est, et cet Univers a un principe suprême. Ce Principe ne saurait être compris et enfermé dans le Tout, sans quoi il en ferait partie et ne serait pas Principe. Il est donc transcendant, c'est-à-dire au-delà, au dehors, au-dessus du Tout, ἐπέκεινα, supérieur, antérieur et extérieur même au monde intelligible. Mais qu'est-il en soi? Nous pouvons facilement démontrer ce qu'il n'est pas : à savoir qu'il n'est et ne peut être ni la matière, ni le corps, ni la vie, ni l'âme, ni la raison, ni l'être, ni même l'Un, quoique l'Un, par sa simplicité, soit ce qui lui ressemble le plus, et qu'on puisse même lui donner ce nom, en sous-entendant que c'est l'Un avant l'un. Mais ces négations ne nous apprennent rien de son essence (72). Tout ce qui est, tout ce que nous pensons et concevons entre dans une des catégories de l'entendement, et comme il n'entre dans aucune, il se dérobe à notre pensée et encore plus à notre langage ; il nous est plus qu'inconnu, il nous est inconnaissable et ineffable. Bien plus, il est l'Inconnaissable et l'Ineffable même. La seule connaissance que nous ayons à son égard est son incognoscibilité, par où nous ne devons pas entendre quelque chose de lui, mais quelque chose de nous, à savoir l'état de notre raison qui connaît qu'elle est incapable de le connaître (73). C'est l'abîme, βυθός, où la pensée s'abîme. Il ne nous reste qu'à l'adorer dans son insondable profondeur (74). Mais il est le Principe du Tout, et dans le Tout est donné l'Un, qui n'est que le Tout ramené à la plus parfaite simplicité ; car il n'est le Tout qu'à la condition d'être un Tout. Le Principe suprême est donc le Principe de l'Un qui en procède ineffablement par une procession qui n'est pas une procession, et qu'on ne nomme ainsi que parce qu'on n'a pas d'autre nom à donner à ce fait inexplicable et certain. La Création est un mystère. Avec l'Un nous entrons dans la région des Principes, que notre raison peut, plus ou moins, connaître et qu'on peut appeler Premiers, en tant que de tous ceux qui nous sont connaissables, ils sont les premiers. L'Un est la chose la plus simple, le symbole même de la simplicité; c'est la meilleure, la plus puissante que nous pouvons concevoir, celle qui maintient le Tout et chaque chose dans leur état et leur nature, et les sauve de la distinction. Tout est Un ; la triade est aussi monade; trois est aussi un (75). La chose qui ne serait plus un, μηδὲ ἕν, ne serait rien, μηδέν. Il y a deux un ineffables : celui-ci plus noble que l'être, c'est l'Un en soi; celui-là au-dessous de l'être, c'est l'un de la matière. Pas plus que l'Ineffable, pas plus que les plusieurs, comme nous allons le voir, Damascius ne veut dire que l'Un procède ; mais il est cause et principe, cause et principe de tout; il est donc l'Un avant Tout, ἓν πρὸ πάντων; il est Tout même, comme cause de tout, ἓν πάντα. Il est le Tout ensemble, où rien n'est distingué, το πάντα όμου, et plus que le Tout, parce qu'il en est le principe. Le Tout est l'acte de l'Un (76). Il est de l'essence de l'Un de posséder une force interne de diffusion, d'expansion, d'extension qui produit un second principe, le plusieurs, τὸ πολλά : cause de tout, il est nécessairement cause des plusieurs, qu'il nous faut concevoir, non comme distingués entre eux, mais comme une seule et unique nature, μία φύσις, par leur caractère propre : c'est le τὸ πολλά ἔv. Ils ne participent pas de l'Un, puisqu'ils en sont l'opposé contradictoire ; ils n'en procèdent pas, puisqu'on ne peut admettre, à cette région des principes premiers, une distinction et un nombre que la procession implique. De même que le tout est l'acte de l'Un, de même le plusieurs est l'expansion, l'extension de l'Un, ἐκτένεια, sa puissance, δύναμις, sa puissance infinie, τὸ ἀπειροδύναμον, sa faculté génératrice, γονιμότης, sa pluralité interne. La distinction ne pénètre pas en eux ; car ils ne sont qu'un moment de l'Un, gros, par essence, des plusieurs : c'est l'Un plusieurs, ἕv πολλά ; mais ils sont le principe de la distinction de toutes les autres choses. Ils ne sont pas infinis et au contraire veulent être finis; car les plusieurs ne peuvent être que plusieurs Un : πολλὰ ἕv. S'ils sont infinis en tant que plusieurs, ils sont devenus finis en recevant une limite, l'Un. Ils ne sont pas identiques au Tout, mais placés entre l'Un et le Tout (77) avec lesquels ils forment déjà une triade. Ce n'est que lorsque la distinction commence qu'ils se divisent encore en trois : espèces, parties et éléments (78). C'est une procession si l'on veut, mais une procession particulière, interne, la procession de l'Un en lui-même (79). Le second principe de la triade des Principes premiers contribue ainsi à former le tout, qui est le système un des plusieurs étants. Mais les deux principes ne sont pas séparés comme l'abstraction les conçoit et comme le langage les pose : ils sont naturellement, primitivement, essentiellement unis, et leur union produit le troisième membre de la triade suprême, le Un-plusieurs-Tout, τὸ ἓν πολλὰ πάντα, qui s'appelle l'Unifié, το ἡνωμένον, ou encore l'intelligible, ou encore l'Être. Comme il comprend l'Un et les plusieurs, nécessairement il les précède. L'Un, les plusieurs, l'Unifié, même les choses arrivées à la distinction, pris ensemble, ομού, c'est là le Tout-Un indistinct, πάντα ἓv ἀδιάκριτον : il vient donc après l'Un et se développe de l'Intelligible (80). Les principes ont un ordre : les uns sont premiers, les autres deuxièmes, les autres derniers. Tout ce qui vient de l'Un — et tout vient de lui — a un ordre. La loi de la série a son principe dans l'Un. L'Un est non seulement le principe des choses, mais le principe de l'ordre qui les unit toutes les unes aux autres et toutes à lui-même et au principe ineffable. Mais cette loi de l'ordre ne pénètre pas dans le monde supra-intelligible (81). L'intelligible est organisé et forme une triade divisée en trois ordres, τάξεις. Le premier ordre considère l'intelligible comme l'Un-Être ensemble, ἓν ὂν ὁμοῦ ; il échappe par là à la séparation de ses deux moments. L'être y est caché au sein de l'Un, ou plutôt l'Un prédomine et l'être est dans la simplicité la plus parfaite : c'est l'Un avant tout, ἓν πρὸ πάντων, caractérisé et constitué surtout par la persistance, μονή : car l'être même y demeure en lui-même selon l'Un (82). Le second ordre présente l'intelligible, sous un rapport comme un, et sous un autre comme deux, il n'est pas encore deux ; il n'est plus Un. La séparation commence. Cet ordre voit naître la distinction et commence à projeter l'être; principe de toute division, il comprend dans l'intelligible le Tout et les parties: c'est l'Un qui est tout, l'Un rempli de tout, ἓv πάντα, l'un procédant en lui-même. C'est ici qu'il faut placer la totalité, l'éternité et la vie intelligibles (83). Le troisième ordre montre l'intelligible comme distingué en l'Un et l'être; il projette complètement l'être; c'est la multitude infinie, le premier éternel, le premier paradigme du devenir; c'est le moment de l'Un où les autres commencent à apparaître ; c'est l'Un prototype des autres ; il est caractérisé comme tout un, πάντα ἕv. Ces trois ordres de la triade intelligible forment un tout parfait, c'est-à-dire ayant un commencement, un milieu, une fin, s'organisent en premier, moyen, dernier : le premier est l'ordre de la substance ou éternité ; — le second, l'ordre de la vie; — le troisième, l'ordre de la raison, Νοῦς (84). Chez les Chaldéens, ils prennent les noms de Père, — Puissance, — Raison, et dans les Λόγια, ceux d'Hlyparxis, — de Puissance, — et d'Acte, et Damascius prétend que Platon les a connus et les a désignés, dans le Parménide, sous le nom de Un-être, ἓν ὅν, — de Tout et parties, ὅλον καὶ μερή, — et de multiplicité infinie, ἀπειρον πλῆθος. On peut les caractériser et les distinguer encore de la manière suivante : le premier ordre de l'intelligible est celui où domine l'hyparxis, accompagnée de la puissance et de l'acte ; — le deuxième, celui où domine la puissance, accompagnée de l'hyparxis et de l'acte ; — le troisième, celui où domine l'acte, accompagné de l'hyparxis et de la puissance. Une seconde triade, divisée également en trois ordres, se développe de la première, en réunissant le caractère de l'intelligible qui la constitue avec celui de la raison qui en est le troisième membre. C'est la triade de l'intelligible et de l'intellectuel. Elle est caractérisée, dans son tout, selon la procession (85), par la puissance, la différence, la monade, fille de la différence et mère du nombre, qui procède ainsi de la différence : ce qui lui donne un caractère où l'élément féminin domine (86); enfin, par les séries divines qui procèdent du nombre et qui sont les Ἴυγγες, ou puissance du père, les Συνοχεῖς, les Télétarques. Le premier ordre ou sommité, ἀκρότης, des intelligibles et intellectuels, a pour caractère d'être à la fois générateur et rassembleur, γεννητικὴ καὶ συναγωγός (88) ; en lui se manifestent les Ἵυγγες et les Nuits qui sont les symboles sacrés, et apparaît éminemment la Vie, qui est la substance féminine, et le nombre qui est la division des êtres particuliers . Le deuxième ordre ou ordre moyen de cette classe, en tant que placé au milieu des deux extrêmes, en contient les doubles caractères : l'Un y est considéré plutôt comme un tout et dans ses rapports aux plusieurs (89). Cet ordre est caractérisé surtout par la puissance qui a la fonction de rassembler, συνοχική. Il est un et plusieurs, fini et infini : il est le centre de la vie (90). Le troisième ordre des intelligibles et intellectuels est télésiurgique, τελεσουργός ; c'est en lui qu'apparaît le parfait, τὸ τελεῖον, c'est-à-dire le tout qui a commencement, milieu et fin (91). Il est cause de la figure, qui se compose du nombre et du continu (92), est un et aussi plusieurs ; la figure est un milieu avec deux extrêmes (93). Le parfait apporte aux choses le commencement, le milieu et la fin, c'est-à-dire la perfection, dont il est le démiurge ou l'artiste créateur. Il a pour contenu le même et l'autre, et pour caractère de se retourner vers son principe (94). Il y a là aussi une vie, la vie intelligible et intellectuelle, νοητὴ καὶ νοερά (95) La dernière triade est celle des Intellectuels. En succédant, selon la loi de l'évolution sériée, à la classe précédente, d'où il procède, ce diacosme en a perdu un des attributs, l'intelligible, et n'a gardé que l'autre, l'intellectuel, c'est-à-dire la puissance de penser (96) La triade intellectuelle se lie à la précédente, en ce qu'elle a pour substance le même et l'autre, l'identité et la différence qui commencent avec le démiurge et passent de là à travers toutes les générations divines qui se succèdent (97). Ces couples de contraires se manifestent dans tout ce diacosme (99). La conversion avait déjà dans le dernier ordre des intelligibles et intellectuels, donné pour ainsi dire, signe de vie : ici la vie est le caractère éminent, général, essentiel aux trois ordres dont la triade se compose ; elle se retourne, comme la classe intermédiaire avait pour caractère de procéder, comme la classe des intelligibles avait pour caractère de demeurer. C'est la région ou le monde de la raison (100) ; car, dans cette triade, la distinction, sur laquelle toute raison et toute la raison repose, est un fait achevé, accompli, terminé (101). Dans les intelligibles règne la totalité parfaite, ἡ μάλιστα ὁλότης — et la totalité consiste à unifier la somme complète des choses, ἡ παντότης. — La seconde totalité a sa place dans la classe intermédiaire des intellectuels et des intelligibles. — La troisième triade ne constitue pas même de totalité, puisqu'elle repose sur la distinction, à moins qu'on ne dise que c'est une totalité intellectuelle qui fonde le monde intellectuel en lui-même et pousse et aboutit à la multiplicité (102). — On y voit apparaître l'hebdomade des caractères essentiels (103) qui lui est propre, et qui sont, comme on va le voir, répartis dans ses trois ordres. Le premier ordre des intellectuels comprend (I) le dans soi-même et (II) le dans un autre. Le second ordre comprend (III) le repos et (IV) le mouvement ; c'est à lui que commence l'inclination vers les choses d'ici-bas, vers les autres, τὰ ἄλλα, quoique combattue par une résistance à ce penchant. Le troisième ordre comprend (V) l'identité et (VI) la différence, qui constituent comme la substance de la classe entière (104). C'est en lui qu'apparaît le Temps, dont il est impossible à la raison humaine de découvrir la source et la nature (105) ; car en tant qu'il est temps, il n'est pas (106), et en tant qu'il est, il n'est pas temps comme, par exemple, l'instant, τὰ νῦν. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de distinguer un Temps substantiel, οὐσιώδης, qui règne dans le ciel, qui est immuable et toujours le même, et un temps qui change et se compose de nuits et de jours, et règne dans le monde sublunaire, le dernier de tous les mondes. A ce diacosme, en tant que spécifié par le même et l'autre (107), appartient le premier Démiurge (108), qui, comme raison de la raison, est l'artiste créateur du monde de la vie ; il est, pour ainsi dire, l'animal, le vivant en soi, l'αὐτοζῷον. La vie, nous l'avons vu, dans l'intelligible, est placée entre la substance et la raison : c'est la vie intelligible qui est plutôt substance que vie ; mais il est une autre vie, c'est celle à laquelle préside le Démiurge, qui non seulement vit, mais engendre la vie ; c'est la vie zoogone ou la Déesse zoogone (109). Il y a deux vies zoogones : l'une qui donne la vie, telle qu'elle est dans tout ce qui vit : c'est le principe universel de la vie universelle ; l'autre qui donne la vie aux choses individuelles, divisées; car la vie de l'astre n'est pas la vie de la pierre, qui pourtant, elle aussi, vit (110). Le travail démiurgique, ἔργον, est le système des forces qui élaborent la matière (111). C'est un quatrième monde qui apparaît à la limite de l'idéal et du réel. Dans le Démiurge sont contenues les espèces, τὰ εἴδη, dans un état d'union parfaite, qui n'est pas la confusion, et au contraire implique une parfaite distinction (112). Ces espèces ou formes, prototypes de la démiurgie ou de la création, considérées exclusivement selon leur acte propre, sont un élément du genre des Dieux, qui ne vient pas du dehors, οὐκ ἐπεισακτόν, comme la chaleur est introduite dans une pierre, mais comme la chaleur est dans le feu, dont elle est un élément immanent. Elles sont un selon la participation, mais cet un incomposé, tel qu'il est dans l'être et tel qu'on le voit dans l'espèce psychique (113), n'est pas en dehors de la région des Principes ; car il est cause coopérante, συναίτιον, de la création sublunaire. Le Démiurge crée lui-même l'Âme et conçoit par lui-même le Temps, parce qu'il possède en lui-même le Temps-Source, et il le possède parce qu'il est l'Animal en soi, l'αὐτοζῷον, et que le paradigme du Temps n'est pas l'Éternité première, mais l'éternité immanente, σύνων, à l'αύτοζῷον, c'est-à-dire au vivant en soi, qui est le Démiurge même (114). Les vivants se partagent en quatre classes ; c'est la tétractys de la vie : 1° l'animal divin ; 2° l'animal humain ; l'homme qui n'est pas seulement, comme l'a dit Platon, une plante céleste, mais aussi et en même temps une plante de la terre; 3° la bête; 4° les végétaux, qui sont aussi des animaux, quoique les derniers des animaux. On peut ajouter, dans ce diacosme, la nature qui est une sorte de vie dernière, la dernière trace de la vie et plutôt substance que vie. La nature est suspendue à la déesse Zoogone, dont la puissance illuminante ou vivifiante, ἔλλαρψις, s'arrête aux végétaux, tandis que la Vie en soi, la vie intelligible, va jusqu'aux choses sans Âme, ἄψυχα, aux minéraux, pourvu qu'ils se meuvent d'un mouvement naturel (115). Mais si le Démiurge crée lui-même l'Âme, il a des auxiliaires, des subordonnés divisés en trois ordres ou trois gouvernements (116) qui achèvent et complètent l'œuvre démiurgique ; les uns, les yeux fixés sur les espèces, qu'il possède, cherchent à assimiler les choses, qui ne sont ainsi que des images, à leurs divins exemplaires. Ce sont les Dieux ἀφομοιωτικοί (117), appelés aussi ἡγεμόνες ou ἀρχιχοί, quoique ceux-ci se plaisent surtout à diviser et commencent la division des êtres et des choses (118). L'ordre moyen est composé des Dieux indépendants, appelés aussi ἄζωνοι, qui n'ont pas de ceinture. Être ceint, c'est être toujours prêt et disposé à remplir sa fonction (119), ce qui n'est pas le cas de ces dieux, qui parfois s'acquittent de la leur et parfois la négligent. Cette fonction consiste à maintenir l'unité dans la diversité des choses intramondaines, de faire effort pour qu'elles demeurent, en les obligeant à se retourner vers leur cause démiurgique (120). Le troisième ordre auquel Damascius ne donne pas de nom propre et qui termine cette triade ou diacosme des Dieux (121) comprend les Dieux sublunaires et a pour fonction de présider à la génération, au devenir (122). Reprenons rapidement la suite des créations du Démiurge et des puissances divines qui contribuent à son œuvre. C'est d'abord l'âme, qui se divise en plusieurs espèces, ou genres : les âmes divines, les âmes démoniques, les âmes des hommes, et toutes ces âmes sont liées à un corps et sont particulières, individuelles. Puisqu'il y a plusieurs âmes, il y en a nécessairement une unique et universelle, de même que, puisqu'il y a plusieurs Dieux, il y a un Dieu unique, εἷς. Toute pluralité pose l'Un de son espèce ; mais il est insensé de croire qu'une seule et même âme anime tous les êtres vivants, dont le principe de vie ne serait que l'apparence, l'image de l'âme universelle : il n'y a qu'une seule âme pour un seul corps, comme il n'y a qu'une seule raison pour une seule âme. Elle est à la fois hétéromobile et automobile ; dans sa partie automobile, on reconnaît trois éléments : la substance, la vie, la raison ; car elle est une substance qui vit et pensé, quoiqu'il y ait des âmes qui ne pensent pas. Son caractère distinctif est de se retourner sur elle-même (123). Placée entre l'Un et le corps, elle n'a rien de pur et qui soit sans mélange, elle est composée de tous les contraires ; et le type de cette opposition contradictoire, c'est qu'elle est Un et non un; qu'elle descend de son état essentiel et qu'elle y remonte ; elle change et demeure ; elle est un et plusieurs, tout et parties, et ces parties sont premières, médianes ou dernières ; elle est séparable et inséparable ; mortelle et immortelle. L'élément capable de connaître, en elle, τὸ γνωστικόν, contient et possède les notions universelles et pures qu'elle tire et, pour ainsi dire, projette d'elle-même (124), et l'acte de la pensée, en elle, nous y révèle une nature étrange et contradictoire, l'instantané, qui, placé entre le mouvement et le repos, hors du temps et dans le temps, n'en est pas moins la loi de l'activité de l'esprit, et, pour ainsi dire, sa substance. Il y a succession entre le moment où une notion entre dans l'âme et celui où elle en sort pour faire place à une autre ; mais ce repos, cet intervalle n'a pas de durée dans le temps. La substance de notre Âme est un mélange où le temporel, τὸ ἐγχρόνιον, s'éternise, où l'engendré se substantialise, où l'éternel se temporise, où l'être qui, de sa nature, est éternel, est tissé avec le devenir, qui s'écoule sans cesse. Il ne faut pas croire qu'en quittant la région de l'espèce psychique, nous soyons sortis de la région des Principes : nous touchons, il est vrai, à la dernière limite, aux Principes derniers, mais qui sont encore des Principes. C'est d'abord le composé, qui, suivant Proclus, il est vrai, est issu d'un principe, mais n'est pas lui-même principe. Nous en croirons plutôt, dit Damascius, le grand Iamblique qui a eu raison de dire que le composé, le composé des quatre éléments, est le principe des animaux et de tout le monde sublunaire ; car les sphères, composées de ces éléments sont le principe du ciel, et le ciel est le principe et la cause de toute la génération, de tout le devenir (125). Qu'est-ce que le composé? est-il formé de la matière et de la forme, comme l'a dit Aristote, ou est-il l'espèce ou la forme dans la matière, comme l'a dit Platon dans le Timée? Il n'est ni exclusivement forme, ni exclusivement matière, ni uniquement dans la matière, ni uniquement formé de matière : il est à la fois l'un et l'autre. Il imite l'unité du mélange de l'un être ; il est, suivant la formule du Parménide, l'un non être, l'un phénoménal, l'un dans la nature des autres, ou, comme dit Damascius, une sorte d'écoulement de l'un être, ἀπόρροια τις, le mensonge de l'un, ψευδόμενον ἕv (126). Il est au milieu entre les espèces et la dernière nature. Il s'agit donc ici des choses réelles, πράγματα, indivisibles et individuelles, placées dans la région sublunaire. Le corps, qui, par lui-même n'est pas un principe, parce qu'il n'est pas un, qu'il est divisible à l'infini, le devient quand il est qualifié par les espèces, quand il est unifié (127), ramené par la forme à l'ordre, et quand, victorieux de la matière, il en dérobe et en dissimule la laideur (128). Le composé est l'un non être, et il y a, certainement, comme le disent les anciens philosophes et lamblique, un principe à part et de cette nature dans l'univers entier et dans le monde sublunaire (129). C'est ce principe, plérôme composé des quatre éléments, duquel et dans lequel tout naît et périt. Le tout de l'univers entier, τὸ ὅλον τοῦ παντός, est un corps composé des quatre éléments et supérieur à ces éléments qui le constituent (130). C'est ce composé qui est un principe. Car les éléments ne sont jamais ni nulle part existant par eux-mêmes, en soi, καθ' ἑαυτά, ils sont toujours dans l'élémenté et mêlés les uns avec les autres. L'élémenté se sert d'eux comme d'une matière ; mais lui-même, le composé, est pour ainsi dire une espèce, οἷον εἴδος, qui s'ajoute aux éléments, et on voit comment, en tant que forme, il peut être et il est principe (131). Mais cette matière elle-même dans laquelle est le composé et qui est un des éléments dont il se compose, est-elle, comme lui, un principe ? Damascius ne le dit pas expressément, mais cela résulte de cela même qu'elle est une cause, une cause coopérante du composé et aussi des caractères qu'il lui reconnaît. Il y a dans la matière, dit-il (132), quelque chose qui, composé avec la forme, est analogue aux Hénades coordonnées aux êtres. Tout ce qui est à son être dans la nature immuable de la matière, ἐν τῷ ἀκινήτῳ τῆς ὕλης. Il y a dans la matière en puissance une sorte de cause efficiente, ποιοῦν τι, puisque cet élément a pu, ἠδύνατο, produire ce qui devient maintenant (133). Si la forme est analogue à l'être, la matière en puissance est analogue à l'un (134). Elle possède un Ineffable ἀπόρρητον, qui est son élément immuable et immobile, τὸ ἀκίνητον, et c'est lui qui est le réceptacle de l'être, des espèces et des manifestations, ἐμφάσεις, prodromes des espèces et de l'être. Elle est l'opposé contraire du premier principe, πρὸς τὸ πρῶτον ἀντίθετος, et, comme lui, en soi, sans forme, ἀνειδεός. Elle est pour ainsi dire la limite, τὸ πέρας, la trace, la dernière trace (135). Elle n'est pas sans hyparxis, οὐκ ἀνύπαρκτος; elle n'est pas le néant absolu (136) ; elle est la dernière trace du principe suprême, de la première de toutes les causes premières ; elle est ce qu'on appelle tout un, πάντα ἕν, comme dépouillée de tout attribut spécifiant : en soi, en puissance, elle ne participe ni de la pluralité ni de l'infinité; mais en acte, considérée dans sa relation et son opposition à l'uniforme, τὸ ἐνοειδές (137), elle est puriforme et infinie. La matière est un moment de l'évolution par abaissement des choses ; elle est sortie et comme tombée de la vie, et à ce moment même, elle participe de la forme ; en descendant plus bas, elle possède encore la trace imparfaite et grossière de la forme ; — lorsqu'elle vient à perdre même cette trace, elle garde encore le en puissance, τὸ δυνάμει ἔχει; — si elle perd ce caractère elle ne perd pas pour cela l'un, l'un propre de la matière ; — et si enfin cet un même disparaît en elle, elle reste exclusivement ineffable et ne participe plus que de la cause unique de tout ce qui est dans l'univers (138), caractère qu'elle ne peut perdre, puisque tout, et par suite elle-même, est suspendu à la cause unique, au principe absolument premier de tout. La matière tient donc son hyparxis et son hypostase du principe ineffable même, non pas immédiatement, mais par les intermédiaires qui procèdent de lui (139). C'est par là qu'elle reçoit ses propriétés et ses puissances des Hénades, et veut être les Ineffables autres que l'Ineffable. Car si elle subsiste, ὑπέστη, elle ne saurait tirer son hypostase que des principes qui lui sont antérieurs et supérieurs. Différente de la forme, par elle-même sans nom, sans espèces, ἀνειδεός, elle participe des espèces, comme toutes les choses inférieures participent de celles qui les précèdent dans la série (140) ; elle procède dans toutes les espèces, les reçoit toutes et n'est aucune chose en particulier ; n'ayant au-dessous d'elle rien qui elle puisse donner᾿(141), elle se donne au monde, comme le premier principe, mais lui, pour le rendre parfait selon sa perfection propre, elle, pour le rendre imparfait selon son imperfection essentielle. Si la matière est cause et principe, quoique au plus bas degré des principes et des causes, elle a non seulement une cause universelle, suprême, première, elle a des causes prochaines et propres, ἴδιον αἴτιον. Ce sont, dans leur ordre de procession, l'un, la limite et l'infini, le Paradigme et le Démiurge qui, avec tous les autres, produit la matière (142) comme les espèces. Il y a même des dieux de la matière : c'est le dernier règne ou diacosme (μερισμός) des dieux : ces dieux ὑλαῖοι travaillent la matière en tant que matière, et la matière une et universelle, et les matières plusieurs (143) et particulières. J'aurais terminé ce trop long, quoique incomplet, exposé de la métaphysique de Damascius (144), si je ne devais pas dire quelques mots de l'imparticipable et des Hénades, qui ont leur fonction dans toute l'évolution des choses et, par suite, leur place dans le système qui prétend les expliquer scientifiquement. Les choses, πράγματα, deviennent par participation ; la participation n'est guère qu'un aspect de la procession. Ce qui, dans la série, est participé n'est pas participé tout entier; il demeure en lui quelque chose qui non seulement n'est pas participé, mais est incommunicable, c'est-à-dire imparticipable. Sous peine de s'évanouir et de n'être plus lui-même ce qu'il est, le causant ne s'écoule pas tout entier dans le causé, il garde sa propre essence. Il y a donc, dans toutes les choses de la série, un participable et un imparτicipable ; ce dernier toujours purement ce qu'il est, ἁπλώς; le participable, jamais (145). Le participable, c'est la pluralité des Hénades, auxquelles est suspendue la pluralité des substances, substance étant ici entendue dans le sens le plus général. Ce sont les substances qui divisant l'Un en morceaux, en fragments, μόρια, κέρματα, créent les Hénades qui ne sont que ces parties, en nombre considérable (146), de l'Un et de l'Unifié (147), par l'intermédiaire desquelles toutes choses : les animaux, les raisons, les âmes, les corps, participent de l'Un et de l'ineffable (148) qui lui-même ne procède pas et est par là imparticipable en soi. Comme les êtres sont des parties de la substance, comme les nombres plusieurs sont des parties du nombre, de même les hénades sont des parties de l'Un. La première triade des intelligibles étant l'Un, les plusieurs, l'être, chacun aura son hénade, ou sera une hénade, et, par suite, le premier être, la première substance sera la troisième hénade. L'hénade est le premier véhiculé, et ce par quoi elle est véhiculée, c'est la substance (149). Elle est ἀπειρόγονος, d'une fécondité sans limites : c'est les plusieurs intelligibles. Le premier fruit de l'hénade, γέννημα, est la pluralité intelligible, c'est-à-dire l'Unifié (150), qui est non seulement hénade, mais aussi substance. Seules les hénades de l'être sont participables ; les deux autres sont imparticipables (151). L'être est une hénade οὐσιοποιός (152). Les trois hénades les plus universelles sont le Père, la Puissance, le Νοῦς paternel qui n'est pas l'être même, puisqu'il est suspendu au Père, mais est l'hénade ούσιοποιός, et puisqu'il y a trois hénades, il y a trois substances : la substance substantielle, la substance vitale ( la substance intellectuelle. Mais la loi qui interdit la participation immédiate s'applique également aux Hénades; il y en a d'imparticipables et de participables, et, de plus, s'il y a plusieurs hénades, nécessairement il y en aura une unique; car toute pluralité suppose et pose l'Un. L'Un en soi, l'Un au-delà de tout, est le principe des hénades, mais des hénades seules, et non pas aussi des substances et des êtres suspendus à elles. L'hénade est dans la substance, mais elle est quelque chose de séparable, comme l'Idée, de la substance, χωριστόν 153). Les hénades déterminées et les substances déterminées viennent après le purement être qui est tout être, πάντα ὄν, et le purement Un qui est tout un, πάντα ἕv. L'Hénade est la substance uniée, ἐνιαία : la substance même est l'Unifié. L'hénade purement hénade, antérieure aux hénades, est l'imparticipable (154) ou ce qui est à l'état pur. Les Hénades, qui sont suprasubstantielles, ont procédé de la cause ineffable d'une manière ineffable (155) : ce ne sont pas des hypostases indépendantes, mais des irradiations, des divinisations, θεώσεις (156). Les hénades sont partout et projettent, avant le reste, leurs propriétés particulières et les communiquent à leurs véhicules (ou organes) propres (157). Les choses ne sont ainsi que les véhicules des hénades ou des Idées. Les Hénades et les substances, constituées en deux rangées, στίχος, qui se correspondent, viennent après les trois principes, l'Un, les plusieurs et l'être ou l'intelligible. Telles sont, sommairement exposées et disposées, dans un ordre systématique, les idées et les théories principales dont l'ouvrage de Damascius est le développement parfois méthodique, le plus souvent irrégulier, confus, prolixe, tumultueux, mais original, hardi et puissant. Le contenu en est si abondant, la substance si complexe et si riche en détails divers et variés, l'exposition si dense et si touffue, qu'il a été nécessaire d'écarter de cette analyse beaucoup de considérations des plus intéressantes et souvent très neuves et très profondes, dispersées et comme éparpillées dans l'ouvrage, où elles apparaissent épisodiquement; par exemple : les théories sur l'âme, la raison et la connaissance ; les rapports de la connaissance, du connaissant et du connaissable, à l'être; — sur les genres de l'être : le mouvement et le repos, l'identité et la différence ; — sur la nature du composé, du tout et des parties, la totalité, ἡ ὁλότης, et l'universalité, παντότης, qui se distinguent en ce que la première seule implique un ordre des parties déterminé par leurs fonctions (158), et quand cet ordre est parfait, un commencement, un milieu et une fin ; — sur l'infini relatif et absolu,—la matière en acte et en puissance ; — sur la nature de la limite, l'origine et l'essence de la figure et du nombre dont la différence est la mère, — sur les avantages et les défauts respectifs de la démonstration directe et de la démonstration indirecte, ou réduction à l'absurde, — sur la cause, l'hyparxis, l'hypostase, la substance, — la puissance et l'acte, le continu et le discret, — le temps et l'éternité, l'Instant et l'Instantané, — le principe d'extériorisation et d'individuation, la génération naturelle ou univoque, et la génération spontanée, — sur les images et les exemplaires ou paradigmes et leur rapport, —- sur la Bonté qui non seulement est divine, mais l'essence même de la divinité (159) ; enfin des renseignements très curieux, et suffisamment précis, sur les théologies orientales (160) et les théologies helléniques, ces dernières contenues dans les Oracles (Λόγια) chaldaïques et les Poésies orphiques, et leurs rapports avec le système de la métaphysique alexandrine (161). Ce résumé, et un coup d'oeil jeté sur l'Index très étendu et très développé qui termine ma traduction, donnera, je l'espère, une assez haute idée de la valeur philosophique de ce livre singulier, et de l'originalité de son auteur. Son influence sur son temps a dû être profonde. Ce questionneur indiscret, cet intrépide et infatigable ἀπορῶν, a dû, on s'en aperçoit bien aux critiques de ses contemporains, agiter, étonner, troubler et peut-être irriter les esprits ; mais il est certain qu'il les a excités, les a fait travailler et vivre (162), quand ils s'endormaient dans la quiétude d'opinions apprises, respectées et crues comme des vérités indiscutables. Son œuvre a jeté dans la circulation une foule d'idées nouvelles qui n'ont pas tardé à produire leurs fruits. Car, il y a en elles quelque chose de vivant qu'on ne retrouve pas même chez Proclus. C'est véritablement le testament philosophique de la Grèce, et qui nous montre l'état des esprits au viε siècle, le plus complètement et le plus vivement. Il nous aide à pénétrer plus avant dans la philosophie de Platon en nous en découvrant des horizons plus profonds, des aspects inattendus et aussi les périls ; enfin, il nous fait comprendre comment s'est produit ce qu'on appelle le Platonisme des Pères. Le mysticisme alexandrin est le nœud où s'attache le mysticisme du moyen âge. Et, à ce sujet, une question historique se pose, à savoir si les ouvrages du Pseudo Denys l'Aréopagite, qui sont la principale source du mysticisme, ont été écrits sous l'influence de Damascius, ou si au contraire Damascius a connu ces livres et en a été influencé. Il y a entre ces écrits et le Traité des premiers Principes de frappantes analogies. Le Pseudo Denys, qui est manifestement un néoplatonicien, pense, comme Damascius, que les hommes ne pourront jamais, par les seules forces de leur raison, connaître Celui qui a posé l'obscurité, Σκότος, pour s'y cacher (163). La pensée va à l'être, mais ne le dépasse pas, et Dieu est au-dessus de l'être : il échappe ainsi à toute pensée, comme à toute relation; il est au-dessus de toute opposition; il n'est pas seulement l'incompréhensible, l'Ineffable, mais le supra-incompréhensible, le supra-Ineffable. C'est donc par des négations seulement qu'on peut s'en faire une notion approximative; toute affirmation à son égard est par là même fausse et impie. Il est donc non-être et privation. Il est l'unité de tous les contraires, et c'est par là qu'il est le Principe; car aucune dualité ne peut être principe. Ôtez l'Unité et tout est détruit; c'est par leur participation à l'Unité que toutes choses existent. Mais si ces principes sont bien ceux de Damascius et s'ils favorisent et appuient la doctrine mystique des rapports de l'homme à Dieu, on ne trouve pas dans le traité des Premiers Principes ce qui caractérise éminemment le mysticisme : ni la notion de l'amour et l'intuition intellectuelle, professées par Ploτin et Porphyre, ni l'union intime de Proclus, ni l'accent attendri d'une âme vraiment religieuse, encore moins les espérances et les promesses que le christianisme pose en dehors du temps. Le mysticisme a surtout un fondement moral, et l'essence morale des choses comme de la vie échappe à Damascius, tout entier à son austère et froide métaphysique, à sa conception des choses sans tendresse, comme sans grâce. Il y a donc, à côté de ressemblances manifestes, des divergences tout aussi certaines et peut-être plus profondes et plus caractéristiques. Les faits historiques ne nous aident pas à résoudre la question. Damascius cite bien lui-même un philosophe qu'il nomme Dionysos (164) et Proclus, dans son commentaire sur le Parménide (165), fait mention d'une lettre adressée par Platon à Dionysos, nom qu'il faut certainement écrire Dionysios; car il s'agit du tyran de Syracuse, auquel sont adressées plusieurs lettres attribuées à Platon : ce n'est pas assurément celui-là auquel fait allusion Damascius. Mais à propos d'une opinion sur les Hénades hypersubstantielles qui sont « les Sommités et les Fleurs des Hénades », Proclus ajoute (166) : « comme quelqu'un l'a dit », ὥς φησί τις. Qui est ce philosophe inconnu, néoplatonicien, manifestement? Dans une note marginale du manuscrit C. de Proclus, on lit : « Σημείωσαι τοῦ Μεγάλου Διονυσίου. Remarquez : il s'agit ici du Grand Denys », par où l'auteur, quel qu'il soit, de l'observation nous laisse clairement entendre qu'il s'agit de Denys l'Aréopagite et qu'il n'a aucun doute sur l'existence historique de ce personnage ni sur l'authenticité de ses œuvres. Si c'est ce Denys auquel se rapporte le mot de Proclus, il faudrait conclure que c'est également lui que nomme Damascius, qui lui serait manifestement postérieur. Mais qui est l'auteur de cette note marginale et à quelle date la faire remonter? Il est certain que le moyen âge a cru à l'authenticité des œuvres de Denys l'Aréopagite; mais il est certain également qu'il s'est trompé. Ces ouvrages sont l'œuvre d'un faussaire, cela est démontré; mais il reste à savoir à quelle époque ils ont paru et ont pu exercer l'influence considérable qu'ils ont acquise sur les esprits. Baumgarten-Crusius les fait remonter jusqu'au IIIe siècle. H. Ritter pense qu'ils ont été connus aussitôt qu'ils ont été publiés et qu'on ne les trouve cités que vers 532, époque du retour d'exil de Damascius, par les monophysites qui s'en servirent pour appuyer leur doctrine (167). L'auteur des Premiers Principes et l'auteur de la Théologie Mystique auraient donc été contemporains. Ils ont donc pu connaître les écrits l'un de l'autre. Mais comme on ne trouve dans Damascius aucune trace du mysticisme, tel qu'il apparaît dans Denys, et qu'au contraire on retrouve dans celui-ci non seulement les principes communs à toute l'École néoplatonicienne, mais les thèses propres et les formules particulières de la métaphysique de Damascius, le plus vraisemblable est encore de croire que c'est le Pseudo Denys qui les a empruntés à notre philosophe. On peut supposer même qu'ils se sont connus personnellement, du moins qu'ils ont eu, à Athènes, les mêmes maîtres, que l'auteur de ces écrits s'appelait bien Denys, et que c'est lui que désigne, par ce nom, son contemporain et son condisciple : ce qui a fait naître l'erreur tant accréditée plus tard que ce personnage était le sénateur de l'Aréopage converti par S. Paul (168). Si l'influence de Damascius a été grande sur ses contemporains, elle a été plus considérable encore, quoique médiate, sur la philosophie postérieure. Jean Scot Érigène, traducteur de Denys, en divisant « la Nature » ou manifestation de l'Unité divine, y trouve quatre différences ou espèces, dans lesquelles on reconnaît la classification des ordres ou mondes de Damascius. A l'aide de ces écrits et du commentaire de Chalcidius sur le Timée, la scolastique reprendra les Problèmes et acceptera les Solutions du philosophe Alexandrin sur les Premiers Principes. Adhélard de Bath (169), pour ne citer que lui, qui était allé en Égypte et en Arabie, auteur d'un traité intitulé, De Eodem et diverso, et de Perdifficiles QUAESTIONES, dit, comme lui : « Divinae menti praesto est et materiam sine formis et formas sine aliis (ἀδιακρίτως), immo et omnia cum aliis (πάντα ὁμοῦ) distincte (διακρίτως) cognoscere. Nam et antequam convincta essent (liées et unifiées) universa (πάντα) quae vides in ipsa Noy (Νοῖ) simplicia erant (170). » Mais la veine théosophique ne s'épuise pas avec le moyen âge; on la revoit très manifeste et très puissante dans le groupe des Néoplatoniciens italiens et anglais, particulièrement dans les universités de Cambridge et surtout d'Oxford qui en est le centre le plus actif : Samuel Parker, Théophile Gale, Henri Moore, Ralph Cudworth, Shaftesbury, enfin Van Helmont qui l'intitule lui-même « le Philosophe par l'Un dans lequel est Tout ». Arthur Collier (171), dit : « Il faut admettre une substance universelle de toutes choses. — Toutes choses sont liées à Dieu, non pas immédiatement, mais par une série plus ou moins grande d'intermédiaires, de là leur degré plus ou moins élevé de perfection. Plus une chose est éloignée de la substance première, plus elle est imparfaite; plus elle en est proche, plus elle a de perfection (172). » Même dans Georges Berkeley, nous rencontrons les thèses les plus mystiques : nous pouvons concevoir Dieu comme une essence universelle qui embrasse tout. — Toutes choses qui vivent et se meuvent sont en Dieu, mais non comme des parties; elles sont enveloppées en lui, d'une manière tout intelligible (νοήτως). Le principe : Tout est un, ne conduit pas à l'Athéisme (173). — La vie et l'âme sont partout dans la nature. L'esprit pur emploie l'âme comme moyen de se manifester (ὄχημα). — L'atmosphère entière semble être vivante. — Tous les animaux procèdent nécessairement de germes préexistants, dont le développement est gouverné par une force universelle qui régit l'ensemble du monde (174). C'est bien là la loi de procession et d'évolution sériée que proclame aussi universelle notre Damascius. Au cours de l'ouvrage on retrouvera signalés, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera, les nombreux et caractéristiques rapprochements des doctrines de Leibniz avec celles du Traité des Principes; bornons-nous à citer ici ce mot à la fois si hardi et si prudent : « Dire que Dieu est au-dessus du monde, ἐπέκεινα, ce n'est pas nier qu'il est dans le monde (175). » Je ne puis m'empêcher, à propos de ces influences, de signaler un fait très singulier et très caractéristique, concernant les rapports de la philosophie et de la théologie chrétienne. Dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens ont une tendance très marquée à se séparer des païens pour fonder une vie et une société absolument nouvelles et rompre avec tout le passé qu'ils ont en horreur. Cette tendance est sans doute moins vive dans les commencements. Les Gnostiques, qui sont assurément des hérétiques, mais cependant des chrétiens, sont versés dans la connaissance de la philosophie platonicienne et néo-platonicienne (176). Les Pères Grecs en sont pénétrés (177), et les Apologistes, par le point de vue même et la position polémique où ils se placent, sont bien obligés de connaître les doctrines qu'ils veulent réfuter. Mais à mesure que le christianisme se fortifie et se répand, la tendance à se séparer de tout ce qui n'est pas lui, s'accentue et s'exaspère, et, dès ce moment, il y a deux mondes dans l'humanité qui ne parviennent pas à se concilier, ni même à se réconcilier, et dont chacun voudrait supprimer l'autre. L'Église ne se borne plus à vouloir gagner les hommes à ses idées, elle veut les subjuguer. Elle se retranche en elle-même, ce qui est une force ; mais, en même temps, elle coupe les liens qui l'attachent à la vie générale, — ce qui est une faiblesse, — car, en s'ensevelissant dans ses formules rigides et immuables, elle perd ainsi les forces nécessaires au développement de sa propre vie. Ce qu'il y a de plus étrange encore peut-être, c'est que la philosophie et les historiens de la philosophie ont accepté cette opposition comme irréductible. La Théologie et la Philosophie ont chacune leur histoire, à part, isolée, comme s'il se pouvait que des hommes vivant à la même époque, dans les mêmes lieux, parlant la même langue, n'eussent plus aucune relation intellectuelle et scientifique commune, comme s'il n'était pas nécessaire que le mouvement général des idées, une certaine suite de principes, supérieure et antérieure à toute division, enveloppât dans son ensemble, ce particularisme exagéré et violent. Zeller lui-même, à la fin de son grand ouvrage sur la philosophie des Grecs, rencontrant, comme par hasard, les noms de S. Augustin et de Claudien Mamert, se dérobe en disant : « Ce n'est pas ici le lieu d'étudier plus profondément le caractère philosophique de ces écrivains », et s'il dit quelques mots de Boèce, il a soin d'ajouter : « Comme écrivain, Boèce n'est pas un chrétien, c'est exclusivement un philosophe (178). » § 5. — LA TRADUCTION Si l'on peut dire avec Lucas Holste, que le traité des Premiers Principes n'est pas un livre que tout le monde puisse goûter et comprendre, et qu'au contraire il n'est pas facilement accessible au public lettré habituel (179), c'est une exagération et une injustice de prétendre que son œuvre n'aboutit à aucune conclusion ferme et claire, qu'elle se meut uniquement dans une série sans fin d'abstractions d'une subtilité sophistique, qui ne peuvent plus trouver d'expression naturelle dans le langage philosophique et se réfugient dans une rhétorique ampoulée qui s'efforce de rivaliser avec la splendeur du style de Platon, et tombe dans un degré incroyable d'insipide prolixité ; enfin que l'auteur, dans la seconde partie de son livre, n'a pour but que de surpasser la subtilité de Proclus, en ajoutant aux questions posées par celui-ci sur le Parménide, une série de questions plus subtiles encore (180). Ritter n'émet pas un jugement plus favorable; il rapproche Damascius de Boèce son contemporain, par une certaine parenté d'esprit, et trouve dans leurs formules dogmatiques, pour s'élever au transcendant, une tendance au scepticisme. Dans Damascius, le scepticisme est un point de départ et revêt les formes de langage les plus grossières. Comme Denys l'Aréopagite, il s'agite irrésolu dans des formules stériles qui se détruisent mutuellement (181). Telle est encore l'opinion de M. H. Weil, qui ne paraît pas avoir grand goût pour la spéculation métaphysique. Après avoir signalé dans l'édition de M. Ruelle quelques erreurs, il ajoute : « Il est inutile de multiplier les exemples.... Nous admirons sincèrement la patience et le courage d'un éditeur qui s'est condamné à vivre pendant des années dans un monde peuplé d'abstractions, de fantômes créés par des esprits subtils, milieu où l'on respire difficilement (182). » On peut appeler de ces jugements sévères : Simplicius appelle Damascius son guide, et constate que cet esprit curieux et passionnément critique, a soulevé un grand nombre de problèmes philosophiques : ce qui est peut-être la fonction la plus haute de la philosophie (183), et après avoir constaté que les philosophes venus après Proclus n'ont guère fait que marcher dans ses traces, fait exception pour Asclépiodote et pour Damascius, notre Damascius, comme il l'appelle, qui, soit par indépendance d'esprit, soit par sympathie pour Iamblique, n'hésite pas à s'écarter des doctrines du philosophe Lycien (184). — Olympiodore préfère même son autorité en philosophie à celle de Proclus (185). La critique française a été plus favorable, c'est-à-dire, à mon sens, plus équitable. M. J. Simon (186) rappelle que « ces subtilités trop méprisées cachent un fond très sérieux », et il aurait pu mentionner, à l'appui de cette observation, le mot de Geulinx, « Abstrahentium non estmendacium (187) ». L'abstraction n'est pas nécessairement ni une erreur, ni une chimère. M. Vacherot, tout en émettant l'avis que Damascius ne fait que reproduire avec précision, sans y rien ajouter au fond, la doctrine de Proclus, ce qui est excessif, reconnaît qu'il soulève et résout, avec une certaine force, les principales difficultés de la théologie Alexandrine et que la théorie sur la nature de l'Un et ses rapports avec le Tout est une partie originale. M. Levêque voit en lui autre chose et plus qu'un commentateur : c'est un théoricien, un penseur, un penseur passionné et courageux (188). M. Ravaisson nomme son ouvrage un monument considérable et lui attribue le mérite d'avoir accentué le mouvement philosophique qui ramène à Aristote la science égarée dans les rêves d'un platonisme exagéré, — ce qui, dans la bouche de ce maître incomparable de la critique philosophique, n'est pas un faible éloge (189). Enfin, M. Renan, acceptant et exagérant cette manière de voir, l'appelle nettement un péripatéticien, et le nomme avec Porphyre, Maxime, Proclus, comme un de ceux par lesquels Platon fut dépossédé de son influence, Aristote remis à la première place, et par lesquels fut inauguré l'avènement du péripatétisme à la domination universelle, par la philosophie arabe et la scolastique (190) : conclusion à laquelle, je ne saurais d'ailleurs m'associer, et contre laquelle proteste l'histoire même de la scolastique, où toute l'École réaliste, si nombreuse et longtemps si puissante, maintient les thèses platoniciennes sur la substance, et emprunte ses arguments, surtout à Jean Scot Érigène, c'est-à-dire à Denys l'Aréopagite, c'est-à-dire encore à Damascius. Comment se fait-il donc qu'un tel philosophe et un tel livre soient restés si longtemps, pendant treize cents années, oubliés dans les catalogues des manuscrits des bibliothèques, inconnus du monde savant lui-même, sauf quelques rares curieux (191) ; qu'il n'ait été ni édité, ni commenté, ni traduit dans aucune langue, pas même en latin? Une des causes est sans doute, beaucoup plus que le fond de la doctrine, le désordre, au moins apparent, de la composition, et la technologie philosophique assez particulière ; c'est, dis-je, l'obscurité de sa langue qui était plus grande encore, quand on ne pouvait le lire que dans des manuscrits remplis de fautes et d'erreurs. Mais quoi! Hegel et Kant sont-ils donc si clairs, et Aristote dans sa Métaphysique au moins et sa Psychologie, n'est-il pas lui aussi obscur et très obscur? Alexandre d'Aphrodisée, un de ses plus grands commentateurs, lui reproche sa langue elliptique ; Simplicius, son extrême concision (192). Michel d'Éphèse trouve que son style est noir comme l'encre (193). Bonitz, dans son commentaire sur la Métaphysique, avoue fréquemment qu'il ne peut comprendre le sens de tel ou tel passage, et que c'est à peine si on peut deviner ce que l'auteur a voulu dire. Non seulement Aristote est obscur, mais il est subtil, et si subtil qu'il commet parfois des pétitions de principes, comme lorsqu'en réfutant ceux qui nient le principe de contradiction, il a au moins l'apparence d'employer ce principe même dans sa démonstration (194). Qui donc, après tant de commentaires et tant de traductions, depuis tant de siècles, en toutes les langues, qui peut se vanter de tout comprendre dans Aristote? Quoi d'étonnant que l'on ne puisse tout comprendre dans Damascius, qui n'a trouvé qu'au xixe siècle, deux éditeurs seulement et n'a trouvé encore ni un commentateur, ni un traducteur? Je suis bien loin de comparer ces deux esprits d'ordre et de grandeur si différents, mais il est incontestable, que le Traité des Premiers Principes est un monument considérable et d'autant plus intéressant qu'il est le dernier monument de la philosophie grecque et l'exposé, sinon le plus vrai et le plus profond, du moins le plus systématique, le plus vaste et le plus complet d'une métaphysique générale. Il méritait bien l'honneur d'être tiré du long oubli, où il a été comme enseveli pendant tant de siècles, et certes, M. Ruelle et Kopp ont bien mérité, à leur tour, de la philosophie, en en publiant l'un partiellement, l'autre complètement le texte grec. La publication de ce texte suffisait-elle ? J'ai cru qu'une traduction (195), accompagnée de commentaires, en serait un complément utile et peut-être nécessaire, pour rendre plus accessible un livre qui présente de nombreuses et graves difficultés. Je n'ai pas la prétention de les avoir écartées toutes. Une première traduction d'un pareil ouvrage ne peut être qu'un essai et un essai imparfait. Plus d'une fois, comme Bonitz, sur la Métaphysique, comme Kopp sur notre auteur, j'ai dû me dire : Quid hœc verba sibi velint, fateor me nescire ; plus souvent encore : « Voilà ce qui me semble être le sens. » Mais enfin, malgré toutes les imperfections de ma traduction et les erreurs qu'il sera facile d'y relever, j'espère, cependant, n'avoir pas fait une œuvre absolument inutile. C'est, du moins, le désir et le vœu que je forme, en répétant, avec les obscurs copistes de nos vieux manuscrits, à la fin de ce long et laborieux travail : Utere féliciter, qui leges.
Poitiers, 1er décembre 1897. |
|
(01) Vie d'Isidore, § 200. (02) Simplic, in Phys., éd. Diels, 23, 14 : Νικόλαος ὁ Δαμασκηνός; id., id., 875, 22 : Ἄραβες καὶ Δαμασκηνοί. On connaît d'ailleurs Jean Damascène. (03) Phot., Cod. 181. (04) Walamir, sans doute, qu'il fait, par erreur, père de Théodoric, qui était fils de Théodemir, frère de Walamir. (05) Vit. Isid.., Phot., Cod. 242 : ὃς νῦν τὸ μέγιστον ἔχει κράτος Ἰταλίας ἁπάσης. (06) 3. Théodoric commence la guerre contre Odoacre en 489, et la soumission de Rome et de toute l'Italie est achevée en 493. Il règne Jusqu'en 526. (07) Phot., Cod. 181, Vit. Isid., § 201 et 295. (08) Il n'y fait aucune allusion à son grand ouvrage des Principes, qui est sans doute postérieur, et que, chose singulière, Photius, qui s'est tant occupé de Damascius, ne semble pas avoir connu. (09) Simplic, in Phys., p. 775, 32, éd. Diels. « Ces raisons me semblent moins fortes que celles qu'il m'a souvent, quand il vivait encore, καὶ ζῶν ἔτι, exposées de vive voix, sans toutefois me persuader. » (10) Vit. Isid., § 194, 201, 217 : τερατολογεῖ, dit Photius. (11) Qui se montra, dit-il, incapable de comprendre l'interprétation que Proclus donnait du Parménide. (12) Vit. Isid., § 221. (13) Ammo. Marcell, XVII, § 15, ch. 14. (14). Agathias, Hist., 11, 31, Conf. J. Quicherat, Dissertation sur ce sujet insérée à la suite du Plotin de Didot, p. 549. (15) Hist, de la Psychol. des Grecs, t. V, p. 322. Quant à la suite et au complément du Commentaire de Proclus sur le Parménide, il ne saurait, malgré quelques apparences spécieuses, lui être attribué : il est d'une main chrétienne ou juive, comme le prouve une citation de la Genèse, avec le nom de Moyse. (16) De Princip., § 413. (17) In Meteor., éd. Ideler, 1, 217. (18) Phot, Cod. 181 et 130. (19) Id. Cod. 242, imprimé à la suite du Diogène de Laërte de Didot. (20) « Disjecta membra », dit avec raison l'éditeur. (21) Cod. 181 : πλείστῃ χρώμενος καὶ κατὰ κόρον τῇ παρεκδρόμῃ. — « Ce n'est pas plus la vie d'Isidore que celle de beaucoup d'autres philosophes, ses contemporains ou antérieurs à lui, qu'il nous raconte. » (22) Il ne lui accorde qu'une qualité qu'il appelle εύμοιρία et qui consiste dans une sorte d'illumination d'en haut qui ravit l'esprit ; mais il lui refuse une imagination pénétrante et vive, et le don naturel d'une conception rapide des choses. En revanche, il vante sa connaissance profonde des philosophèmes égyptiens (Vit. Isid., 243). (23) Der Philosoph Damascius. Abhandl. z. Philosophie, Strasbourg, 1884, pp. 1-20. (24) Zur Kritik d. sp¨αter. Philosophen, Hermès, t. XIV, 1879, p. 268. (25) Ritter, Zeller, MM. Ravaisson et Vacherot n'en ont pas eu d'autres, pour leurs analyses et leurs appréciations. (26) Edité par A. Mai (Classici Auctores, VIIe vol., 1857) qui a ignoré tous ces faits. — Conf. Heitz, Die angebliche Meiaphysik des Herennius (Compte rendu des séances de l'Académie de Berlin, 1889, p. 1173). (27) Malheureusement, les signes de ponctuation sont rares. Le manuscrit B, où le signe interrogatif manque fréquemment, contient en revanche des notes marginales qui, comme le ms. Α., résument sommairement le contenu des chapitres : il est regrettable qu'elles ne soient pas plus nombreuses. (28) 1. Je lui signale quelques omissions que j'ai relevées au hasard ἀγαθάτης — ὅλωσις — συμπάθεια — δεσμός — ὅρος, en logique, θεογονία — λογκχή (ὑπόστασις) — ἀδιαιρετά — ἀπ´πρροια — βίος. (29) Auteur d'une étude sur les Oracula Chaldaïca, Breslau, 1894. A la p. 10, il dit : « Damascium edidit Ruellius... qui nihil fere intellexit. codicemque prastantem (Marc. 246) negligenter contulit, » — id., p. 15 : « Ruellium... pro reliqua hominis inscitia, non miraberis, etc. » Il ne traite pas plus impartialement du reste l'auteur lui-même, id., p. 10: « Nam Damascius... nihil fere novi attulit, qua est ingenii sterilitale. » (30) Il va sans dire que l'édition de M. Ruelle n'est pas parfaite et qu'il s'y est glissé des erreurs, particulièrement au point de vue de la ponctuation. M. H. Weil en a relevé quelques-unes, et il termine sa notice, un peu ironique, en disant que l'éditeur les a laissées par politesse et courtoisie, afin que ceux qui viendront après lui, aient quelque chose à faire. (31) C'est une œuvre d'une seule pièce, au fond, quoique en apparence décousue, et de pièces et de morceaux. (32) La discussion des hypothèses, avec des titres spéciaux, commence au § 397 par la troisième. Mais on voit la deuxième commentée et interprétée depuis le § 13, jusqu'au § 378, dans plus de quarante paragraphes. La première est visée dès le § 5, c'est-à-dire tout au commencement de l'ouvrage et aux §§ 79-217 — et elle est mêlée avec la deuxième, visée avec elle aux §§ 198-209 et § 8. Ce fait seul prouverait l'unité de l'ouvrage. M. Ruelle fait commencer l'examen de la deuxième hypothèse au § 91, lequel continue jusqu'au fol. 381 du Venetus, c'est-à-dire au § 381. Cet examen commence plus tôt, comme on vient de le voir. (33) Voir à ce sujet mon mémoire Damascius, Fragm. de son Comment, sur la troisième hypothèse, et§ 3, p. 11. (34). Luc. Holste, de lib. optim. Bibl. Mediceœ, 1715, p. 111. « Neque enim publici haec saporis sunt, aut quœ vulgus eruditorum facile attingat », cité par E. Heitz, Der Philosoph Damascius, Ahhandl. z. Philosophie, p. 3.. (35) Zeller, Gesch. d. Phil. d. Griechen, t. V, p. 761. « Die Darstellung dieser Lehren ist freilich bey Damascius so undurchsichtig, dass ich fur die Richtigkeit der obigen Auffassung kaum einsehen kann. » Id. p. 758 : « Das Dunkle, oft fast unverstandliche seiner Darstellung. » (36) Init. Phil. Gr., p. 552. « Quidquid ponitur a Damascio, in subsequentibus rursum toili solet », et dans son Histoire de la philosophie grecque (t. IV, p. 558), il en fait nettement « un sceptique absolu ». (37) Damascius, § 430 : ὁ διάλογός ἐστιν περὶ ἀρχῶν; id., 449 : ἵνα μὴ ἀκοστῶμεν τοῦ περὶ ἀρχῶν λέγειν. (38) § 438. (39) Id. (40) C'est ce qu'on pourrait conclure de l'observation, exacte en soi, de M. Ruelle (Mélanges Graux, pp. 547 sqq.) : « Une étude attentive de la partie éditée (par Kopp) fera découvrir des allusions directes tendant à établir que Damascius a suivi pas à pas le dialogue qu'il commente. » (41) § 19 : ἀναβάλλομαι εἰς τὸν περὶ τῶν μεθέξεων λόγον. (42) § 126 : ἐπὶ τούτοις περὶ μεθέξεως πραγματευτέον τῶν πρώτων ἀρχῶν καὶ τοῦ νοητοῦ πάντος. (43) « An initio usque ad finem », comme dit Ruelle, préface, p. xix. (44) A partir du § 139. (45) Au § 117, t I, p. 303. Ruelle : περὶ δὲ τάξεως τῶν τριῶν τριάδων. (46) Et c'est à tort qu'on parle de deuxième partie : ce sont les éditeurs qui en font deux ; l'auteur n'indique aucune division. (47) M. Ruelle dit six dans la préface (p. vi) : « Duas in partes divisum esse textum ad exemplum Codicis A, sex foliis vacuis ibidem separatas », et à la note 1 de la page 4 de son second volume, il dit quatre : « Codex autem A, folia quatuor vacua hic reliquit. » (48) Met., XI, 1059, a, 18 : ἡ σοφία περὶ ἀρχὰς ἐπιστήμη τις... b, 24 : μᾶλλον δ' ἂν δόξειε τῶν καθόλου δεῖν εἶναι τὴν ζητουμένην ἐπιστήμην... id., XIII, 1086, a, 21 : περὶ δὲ τῶν πρώτων ἀρχῶν. (49) Met., XI, 1059, b, 31. (50) Dam., § 430. (51) Dam., § 247 : συνανεφέρετο καὶ αὐτὸ (τὸ ὄν) τῇ θεολογία. (52) Dam., § 247 : λέγει καλώς (Proclus) ὅτι θεογονίαν προὔκειτο (à Platon) γράψαι. Conf. Procl., Plat. TheoL, I, 1, 2, 3. (53) § 370 : θεογονίαν γράφοντας. (54) § 350 : κατὰ τὴν Χαλδαϊκὴν θεοσοφιαν, (55) C'est aussi ce que se propose Descartes (Disc, sur la Méthode, VIe partie) : « J'ai tâché de trouver en général les principes ou premières causes de tout ce gui est ou peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu qui Ta créé ni les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vérités qui sont naturellement dans nos âmes. » L'idéalisme de Damascius est beaucoup moins absolu, au moins dans sa méthode, qui ne dédaigne pas de consulter les données de l'expérience. (56) § 56 : ἀπὸ γὰρ τοῦ voῦ ἕλκομεν. (57) § 2 : μαντεύεται ἡ ψυχή. (58) § 413 : ἐρωτητέον ἡμας αὐτούς. (59) § 9 : τὸ ἀνειδεὲς φύσει πάντως εἶναι πρὸ τοῦ ἐνδεοῦς. Cet axiome est souvent reproduit, par exemple, dans la Lettre à Diognète, d'un auteur inconnu, dans Athénagore et Théophile, et dans les auteurs scolastiques. Conf. Ritter, Philos. Chrét, t. I, p. 259. (60) § 14. (61) § 7 : τὸ ἓν ἐννοοῦμεν, οὐ συναιροΰντες, ἀλλὰ ἀναπλοῦντες τὰ πάντα. (62) § 105 et 215. (63) § 39. (64) § 55-96-206. (65) § 27 : toute conversion est un contact. (66) La loi des intermédiaires est appliquée par S. Thomas (Somm. Theol., 2, 2, qu. 172, art. 2) : « Habet autem hoc divinitatis ordo, sicut Dionysius (l'Aréopagite) dicit, ut inflma per media disponat. » (67) § 89 : « Voilà une vérité dont je suis plus profondément convaincu que de toute autre. » Id., § 102 : « Nous avons démontré ailleurs, avec plus de rigueur, la vérité de ces propositions. » (68) 1. Dam., § 388. (69) Id., § 89, id., § 118 : « Je prie les Dieux de pardonner à la faiblesse de ces conceptions, et encore plus aux termes qui les expriment. » Id., § 60 : « Prions Dieu de venir à notre secours. » Id., § 95 : « Peut-être, malgré la longueur de ces développements, n'avons-nous abouti à rien, οὐδὲν ἠνύσαμεν. » (70) § III, p. 289, t. 1, Ruelle : τῆς ἀμήχανου καὶ ὑπερφυοῦς ὄντως ἀληθιίας. Mallebranche (Corresp. inéd., p. 118, sq. et 139) : « Les idées de notre entendement nous abandonnent ici, parce que nous ne trouvons en nous rien d'analogue. » (71) § 106, p. 275, t. I, Ruelle : τὰς ἡμετέρας (νοήσεις) μηδ' ἀππαλλαγήναι δυνάμενος τῆς περὶ τὸ νοητόν θεωρίας, πόθῳ τῶν ἀρχαίων αἰτίων τῆς ὅλης φύσεως. M. Renouvier appelle ce désir puissant et toujours inassouvi une maladie de l'esprit humain. C'est, du moins, une maladie incurable et constitutionnelle. Kant, dont il se sépare sur ce point, comme sur plusieurs autres, disait que la métaphysique est aussi indispensable à la vie de la raison que l'air respirable au fonctionnement de nos poumons. Origène (de Princip. II, 11, 4) estime aussi que nous tenons de la nature l'insatiable désir de connaître le principe caché des choses, et qu'il n'a pu nous être donné en vain : « Accepimus autem a Deo istud desiderium, non ad hoc ut nec debeat unquam nec possit expleri. »
(72)
S. Clément veut et peut dire de Dieu non
ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas; il est au-dessus de toutes
choses, de tout nom, de toute pensée; il n'est ni le bien, ni l'Un, ni
esprit, ni substance, ni Père. Ritter. Philos. Chret., t. I, p.
398. (74) C'est le mot de tous les mystiques et de saint Augustin : « Melius scitur nesciendo quam sciendo. » De Ord,, II, 44. Isidore, le maître de Damascius avait déjà dit (Dam., Vit. Isid., 35-38) que Dieu est caché : ἐν ἀπορρήτῳ τῆς παντελοΰς ἀγνωσίας. Ce que, pour changer et dépasser la subtilité de son maître, Damascius appellera l'ὑπεράγνοιαν, que des manuscrits lisent en un seul mot, d'autres en deux, § 29. I. Scot Erigone, de divis. Nat., 1. V, c. xxvi : « Cognoscitur esse Deus et invenitur non quid est, sed quia solummodo est, quoniam ipsa Dei natura nec dicitur nec intelligitur : superat namque omnem intellectum Lux inaccessibilis. » (75) C'est cette contradiction que ne peut admettre Descartes, qui le met en opposition avec lui-même, dans la question de l'union de l'âme et du corps : il dit tantôt (Epist. I, 33) qu'ils doivent être unis substantiellement, — car l'union de deux choses ne se peut concevoir qu'en concevant les deux comme quelque chose d'un : « Duarum enim rerum conjunctionem concipere aliud non est quam illas ut unum quid concipere », et, d'un autre côté, comme il répugne qu'ils soient en même temps un et deux, il est obligé de conclure avec Régis, son disciple, qu'ils ne sont, ni l'une ni l'autre, des substances complètes... Ep. I, 90. « Animam et corpus ratione hominis esse substantias incompletas. » Car autrement (Ep. I, 30) il faudrait conclure : « Ut unum quid et simul ut duo diversa, quod repugnat. » (76) Tὰ πάντα... ἐνέργιια παντοῦχος τοῦ ἑνός. (77) § 68. Ils sont un, mais non encore unifiés, πολλὰ ὡς ἄv. — Id., § 117. Le tout étant considéré comme l'union de toutes choses, sans aucune distinction, πάντα ὁμοῦ πάντων ἔνωσις. (78) § 85. (79) § 91 bis : τοῦ ἑνὸς ἴδιος πρόοδος. (80) Ἐχμηρύεται. (81) § 31 : ἐκεῖ δὲ ἄνευ τάξεως. (82) §§ 241 et 283. (83) § 149 : ἐκεῖ τίθεμεν... τὴν ὁλότητα, τὸν αἰῶνα, τὴν ζωήν. (84) § 136, t. II, p. 15. R. : τρεῖς εἰσιν φύσεις αὕται πραγμάτων οὐσία - ζωή - νοῦς. (85) § 243. (86) §§ 204, 200, 112, 191. (88) § 204 (89) § 201. (90) § 249. (91) § 240. (92) § 242. (93) § 244, fin. (94) §§ 251, 246. (95) § 246, t. II. p. 117. Ruelle : τῆς δ' τρίτης τὸ ἐπιστρέφον εἰς τὴν ἀρχήν. (96) § 112, ρ. 180. R. (97) § 188, t II, p. 188. R. (98) §§ 188 et 320. (99) § 299. (100) Ainsi la raison, la pensée a pour caractère la faculté de se replier sur elle-même. (101) § 160 : τὰ μὲν νοητά πάντη ἥνωτο... τὰ δὲ νοερὰ διεκέκριτο.. (102) § 160. (103) §§ 266-267 : παντὶ τῷ νοερῷ διακοσμῷ ἡ ἑβδομὰς οἰκεῖα φαίνεται. Dans les intelligibles il y a également une hebdomade qui leur est propre : Damascius, du moins, veut la voir dans les Antithèses du Parménide ; le premier groupe antithétique formé de (I) : L'Un et (II) de l'être, le deuxième formé de (IIII) : le tout et (IV), les parties, le troisième formé de (V) : l'un être un tout, τὸ ἓν ὂν ὅλον et (VI), la multitude infinie des êtres Un. — Il faut y joindre la monade, qui les réunit tous (VII) en Un. (104) § 320, t. II, p. 188, R. (105) § 388 : οὐκ' ἔστιν ἀφορίσασθαι διανοίας ἀνθρωπινής. (106) § 378 et 390. (107) § 340. (108) Car les intelligibles et intellectuels s'arrêtaient à lui. (109) § 318. (110) § 351. (111) § 96. (112) § 340. (113) § 438. (114) § 388. (115) § 278. Damascius, comme Plotin, croit que les pierres sont pourvues d'un mouvement d'accroissement spontané et augmentent de volume par elles-mêmes. (116) § 377 : διακοσμήσεις τῶν θεῶν. (117) Le Démiurge lui-même est un Dieu ἀφομοιωτικός; car il crée le monde tel qu'il est lui-même, se l'assimile et le substantifie. § 337 : πρὸς ἑαυτὸν ἐξομοιοῖ, μᾶλλον δὲ οὐσιοῖ. (118) § 339. (119) On sait que chez les anciens, pour se livrer à des travaux de force, on relevait la robe à la ceinture et on l'y attachait pour avoir les mouvements libres. (120) § 361 : συναιρεῖν ἐθελοῦσι τὴν ἐγχόσμιον ποιχιλίαν... ἔοικασι καὶ ἐπιστροφὴν ἑστάναι πρὸς τὴν δημιουργικὴν μονήν. (121) § 377 : τὴν ἐσχάτην διακόσμησιν τῶν θεῶν. (122). § 378 :προεστῶσι τῆς γενέσεως. (123) § 12, t. I, p. 23 : εἰς ἑαυτὸ ἐπιστρεφόμενον. (124) § 18, t. I, p. 34 : τὰς κοινὰς ἐννοίας προβεβλημένη ἀδιαστρόφους. (125) §430, t. II, p. 286 R. (126) § 438, t. Il, pp. 298 sqq. (127) § 9, οὐχ ἕν... ἀλλὰ ἡνωμένον. Le corps est par nature plusieurs, et est la dernière espèce, εἶδος, de toute la génération ; il a besoin de l'Un pour le maintenir et l'embrasser ; il est, en quelque sorte, une matière ; quand il est sans âme, il ne saurait participer à la divinité. (128) § 438 : τὸ σῶμα ἤδη τεταγμένον... καλύπτει τὸ τῆς ὕλης αἴσχος. (129) § 435 : ἔστι τις... καὶ τοιάδε τις ἀρχή. (130) § 435, t. II, ρ. 292 et § 85. (131) § 85. (132) § 438, t. Il, p. 299. (133) § 444, p. 312 : δυνάμει ἐν τῇ ὕλῃ τὸ ποιοῦν τι. (134) § 438, p. 299 : ἡ δυνάμει ὕλη. (135) § 36. (136) § 426 : οὐ... τὸ μηδαμῆ μηδαμῶς. (137) Qui ressemble à l'Un, sans être l'Un même. (138) § 445. (139) § 408, p. 284... ἡ ὕλη... ἑστώσα κατὰ (dans le sens causal) αὐτὸ τὸ προελθὸν ἀπὸ τῆς μιᾶς... La matière est donc créée, quoique non directement par Dieu. (140) § 126 bis, § 425, p. 281. (141) § 34, t.1, p. 69. Je change le texte et, au lieu de ὅτι δοίη, je lis ᾧ τι δοίη. (142) § 134, t. II, p. 13 : τὸ δὲ ἓν, καὶ τὸ πέρας καὶ τὸ ἄπειρον, καὶ τὸ παράδειγμα καὶ ὁ δημιουργὸς μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ὕλην παράγει. (143) Id., id. : τῆς ὕλης ὡς ὕλης ἐργάται, τῆς τε μιᾶς καὶ τῶν πολλῶν. (144) Dont j'ai exclu, avec intention, toute la théologie mythologique et mystique. (145) § 108. (146) § 437 : πολὺς γὰρ ἤδη πέφηνεν τῶν ἐνάβων ἀριθμός. (147) § 107. (148) § 427 : ἐν ταῖς ἐνάσιν οἰστικὸν τῶν ῥητῶν τὸ ἀπόρρητον ὡς ἐν τῇ ὕλῃ δεικτικόν. (149) § 99, ρ. 255. (150) § 99, p. 255. (151) Ruelle, p. 287. (152) Ruelle, 2e vol., p. 10. (153) § 237, p. 112. (154) § 108. (155) T. II, p. 298. (156) T. I, p. 258. (157) § 103, p. 268. (158) Dam., § 145 : καὶ γὰρ ἐν αὐτῷ (τὸ ὅλον) ἔστι μερῶν τάξις. (159) Telle est aussi la notion de Dieu, pour le Gnostique Ptolémée : « Son essence est la Bonté (S. Epiph., Hœr., XXXIII, 3). » — Tertullien la reproduit en la fondant rationnellement (adv. Marcion., II, 6) : « La Bonté est une propriété de Dieu en soi, parce qu'elle est inséparablement liée à la raison, et que la raison est essentiellement Dieu. » Les influences gnostiques sont manifestes dans Damascius. Saturnin met au nombre des puissances spirituelles créées par Dieu, les sept gouverneurs du monde, les sept κοσμοκράτορβς de Damascius, et Valentin appelle Dieu, la Profondeur, βυθός, et le place, comme le fera notre philosophe, au-dessus de la substance et de l'être, et cette profondeur enfante, dans le silence qui règne avec elle, la raison. (160) Qu'il a pu connaître directement et immédiatement pendant son séjour à la cour de Chosroès. (161) Damascius (§ 123) nous explique lui-même pourquoi il expose les doctrines religieuses et les mythes de l'Orient et de la Grèce. C'est, dit-il, pour éclaircir la matière obscure de l'intelligible par des comparaisons, pour purifier nos propres pensées et prendre de l'Ineffable une conception plus haute et plus conforme à sa majesté : τῆς περὶ τῶν νοητῶν προβολῆς (ou plutôt παραβολῆς) ἕνεκα καὶ διακαθάρσεως τῶν ἡμετέρων ἐννοιῶν, εἴ τι καὶ ἀπὸ τούτων δυνάμεθα σέβας ἀναλαβεῖν ἔτι μεῖζον. Mais on doit y voir quelque chose de plus, je veux dire un effort curieux et intéressant de faire rentrer dans les cadres de la métaphysique néo-platonicienne les principes derniers de toutes les théologies connues de son temps et de montrer ainsi sur les grands problèmes de la nature, de l'homme et de Dieu, et de leurs rapports, l'unité essentielle des croyances ou des opinions humaines. — Peut-être aussi, à l'imitation du christianisme, a-t-il voulu appeler en témoignage de la vérité scientifique et philosophique, un fondement historique et positif, la foi aux croyances du passé, c'est-à-dire pour un Grec, la mythologie hellénique : ce qui paraît à Ritter une véritable parodie de la foi chrétienne. (162) Simplic. in Phys., 146 r. 30 : καὶ πολλοὺς πόνους εἰσαγαγὼν φιλοσοφίας. (163) De myst. Theol., 1. 2 : τὸν θέμενον σκότος, ἀποκρυφὴν αὐτοῦ. (164) Damasc, § 453. M. Ruelle propose d'écrire ici Dionysios, et veut faire de ce personnage un Épicurien. Mais on connaît deux philosophes de ce nom : l'un qui reçut l'épithète de transfuge, ὁ μετατιθέμενος, parce qu'il avait abandonné l'École Stoïcienne; l'autre, successeur d'Hypokleidès, dont on ne peut fixer la date, et que Zumpt conjecture être contemporain de Ptolémée Philopator (222-204 av. J.-Ch.). On ne voit pas bien pourquoi Damascius aurait cité ou l'un ou l'autre de ces philosophes profondément inconnus. (165) In Parm., t. IV, p. 84, éd. Cous. : πρὸς Δώνυσον. (166) In Parm., t. VI, p. 16 : ἄνθη καὶ ἀκρότητις. (167) Jean Philopon les cite avec grands éloges ; mais quoi qu'il soit à peu près impossible de déterminer exactement la date précise de sa vie, nous savons qu'il a dédié plusieurs de ses ouvrages à Justinien (de 527 à 565); il est donc contemporain de Damascius. (168) Act Apost., c. XVIII, 34. (169) Du xie siècle. (170) B. Haureau, Hist, de la Scolast., t.1, p. 350. (171) Spécimen de vraie philosophie, p. 119. (172) Ritter, Hist, de la Philos, moderne, t. III, p. 23. (173) Siris, pp. 210 et 287. (174) Siris, 141, 233, 267; Ritter, t. III, pp. 71 sqq. (175) Théodic, § 217. (176) Ritter (Phil. Chrét, t. II, p. 70), cite d'Eunomius l'Arien (Greg. Nys., c. Eun., XII, 713 et 725) les formules : ὑπερκύψας, ἐπέκεινα, βυθός, πάθος, τὸ πρῶτον, γλίχεσθαι. (177) Basile le Grand et Grégoire de Nysse, son frère, encore au ivε siècle, ont passé cinq ans à Athènes pour y faire leurs hautes études sous la direction de philosophes Platoniciens. Grégoire est plein d'imitations de Platon ; tout un chapitre du De hominis Opificio est composé de ces réminiscences. Les formules : purifier, simplifier, isoler l'âme, sont des formules empruntées. La parenté entre les Apologistes et les savants Alexandrins est des plus étroites, et c'est même sur ces affinités qu'on fonde la tradition, douteuse d'ailleurs, qui fait d'Athénagore le premier directeur de l'École cathéchétique d'Alexandrie (Conf. Guericke, de Schola quœ Alexandriœ floruit Caihechetica). (178) « Als Schrifsteller ist er nicht Christ, sondern nur Philosoph. » (179) De Libris Optt. Biblioth. Mediceœ, dans les Selecta Hstorica de M. Lilienthal, 1715, p. 111 : « Neque enim publici hœc saporis surit, aut quae vulgus eruditorum facile attingat », cité par Em. Heitz, der Philosoph Damascius, p. 3. (180) Em. Heitz. (181) Philos. Chrét., t. II, p. 343. (182) Journal des Savants, 1890, p. 271. (183) Simplic, in Ar. Phys. I, p. 624, éd. Diels : πολλοὺς πόνους εἴσαγαγὼν φιλοσοφίας. (184) Simpl., in Phys., 188 b. (185) Voir Cous. Olympiod. (186) Hist, de l'École d'Alexandrie, t. II, p. 603, et Dictionnaire des sciences philosophiques. (187) Metaphys., pp. 59 et 67. (188) Journal des Savants, 1891, pp. 17 sqq. (189) Ess. sur la met d'Ar., t. II, p. 540. (190) Averr. et l'Averr., éd., 1867, p. 92. (191) Tels que J. Christ Wolf, qui, dans ses Anecdota Graeca, t. III, p. 195 (1722-1724), en a cité le commencement et la fin avec des extraits d'après les manuscrits dOxford ; — Th. Hyde, de Religione Persarum; —Th. Gale, de mysteriis Aegypt ; — Théophile Gale, dOxford, platonicien, versé dans les idées mystiques et théologiques des néo-platoniciens Italiens au xvie siècle et visant à l'épuration du platonisme ; —J. G. Thomson, Parmenides, qui en a produit des passages d'après les mêmes manuscrits ; — Luc. Holste, dans son Traité, cité plus haut, p. 39 ; — Fr. Patrizzi enfin et Bessarion, dont le premier l'avait peut-être annoté et certainement lu tout entier, si c'est lui, comme le suppose M. Ruelle, qui a écrit à la fin d'un manuscrit de l'Ambroisienne (Hb) les mots : Finito di vedere a di II guigno. (192) Schol. Ar. 497 b. 30. (193) Id., 565, 30 ; — 789-20 : μελελανωμένον τῆς λέξεως. (194). Bonitz, ad. Met., Ε (ou V ou VI), p. 284 et 285... et p. 524 : « Proxima verba, quomodo vel explicem, vel emendem non habeo. » Sur combien de points Bonitz s'écarte de Schwegler, et MM. Pierron et Zevort de M. Barthélemy-Saint-Hilaire! Cicéron disait : « Il faut faire un grand effort d'attention pour entendre Aristote. » Cité par Barthélémy Saint-Hilaire, préface de la Métaphysique.
(195)
Je n'ai pas besoin de dire qu'il ne faudra
pas y chercher l'élégance du style ; j'ai tout sacrifié à la précision
et à la fidélité; j'ai voulu donner une reproduction exacte de la
physionomie de l'ouvrage, du caractère de l'argumentation, des formes de
l'exposition. C'est ainsi que, sans hésiter, j'ai ajouté au nom de
l'auteur, son titre de Diadoque, qui est caractéristique de l'École, et
qu'il a le dernier porté. J'aurais même hasardé le mot d'Apories au lieu
de Problèmes, que d'ailleurs Damascius emploie aussi au .cours de son
ouvrage; mais j'ai reculé devant le brusque rapprochement avec le mot
français qui suit immédiatement, et qui aurait rendu le néologisme plus
choquant. |
|
FIN DE L'INTRODUCTION. |