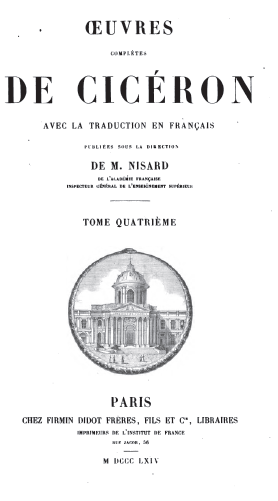|
DE RE PUBLICA - LIBER PRIMUS.
I. - - -
<im>petu liberauissent, nec C. Duelius A. Atilius L. Metellus terrore
Karthaginis, non duo Scipiones oriens incendium belli Punici secundi sanguine
suo restinxissent, nec id excitatum maioribus copiis aut Q. Maximus
eneruauisset, aut M. Marcellus contudisset, aut a portis huius urbis auolsum P.
Africanus compulisset intra hostium moenia. M. uero Catoni
homini ignoto et nouo, quo omnes qui isdem rebus studemus quasi exemplari ad
industriam uirtutemque ducimur, certe licuit Tusculi se in otio delectare,
salubri et propinquo loco. sed homo
demens ut isti putant, cum cogeret
eum necessitas nulla, in his undis et tempestatibus ad summam senectutem maluit
iactari, quam in illa tranquillitate atque otio iucundissime uiuere. omitto
innumerabilis uiros, quorum singuli saluti huic ciuitati fuerunt,
et qui sunt <haut> procul ab aetatis
huius; memoria, commemorare eos desino, ne quis se aut suorum aliquem
praetermissum queratur. unum hoc definio, tantam esse necessitatem uirtutis
generi hominum a natura tantumque amorem ad communem salutem defendendam datum,
ut ea uis omnia blandimenta uoluptatis otique uicerit.
II. Nec uero habere uirtutem satis est quasi artem
aliquam nisi utare; etsi ars quidem cum ea non utare scientia tamen ipsa teneri
potest, uirtus in usu sui tota posita est; usus autem eius est maximus ciuitatis
gubernatio, et earum ipsarum rerum quas isti in angulis personant, reapse non
oratione perfectio. nihil enim dicitur a philosophis, quod quidem recte
honesteque dicatur, quod <non> ab iis partum confirmatumque sit, a quibus
ciuitatibus iura discripta sunt. unde enim pietas, aut a quibus religio? unde
ius aut gentium aut hoc ipsum ciuile quod dicitur? unde iustitia fides aequitas?
unde pudor continentia fuga turpi<tu>dinis adpetentia laudis et honestatis? unde
in laboribus et periculis fortitudo? nempe ab iis qui haec disciplinis informata
alia moribus confirmarunt, sanxerunt autem alia legibus. quin etiam Xenocraten
ferunt, nobilem in primis philosophum, cum quaereretur ex eo quid adsequerentur
eius discipuli, respondisse ut id sua
sponte facerent quod cogerentur facere legibus. ergo ille, ciuis qui id
cogit omnis imperio legumque poena, quod uix paucis persuadere oratione
philosophi possunt, etiam iis qui illa disputant ipsis est praeferendus
doctoribus. quae est enim istorum oratio tam exquisita, quae sit anteponenda
bene constitutae ciuitati publico iure et moribus? equidem quem ad modum 'urbes
magnas atque inperiosas', ut appellat Ennius, uiculis et castellis praeferendas
puto, sic eos qui his urbibus consilio atque auctoritate praesunt, iis qui omnis
negotii publici expertes sint, longe duco sapientia ipsa esse anteponendos. et
quoniam maxime rapimur ad opes augendas generis humani, studemusque nostris
consiliis et laboribus tutiorem et opulentiorem uitam hominum reddere, et ad
hanc uoluptatem ipsius naturae stimulis incitamur, teneamus eum cursum qui
semper fuit optimi cuiusque, neque ea signa audiamus quae receptui canunt, ut
eos etiam reuocent qui iam processerint.
III.His rationibus tam certis tamque inlustribus
opponuntur ab iis qui contra disputant primum labores qui sint re publica
defendenda sustinendi, leue sane inpedimentum uigilanti et industrio, neque
solum in tantis rebus sed etiam in mediocribus uel studiis uel officiis uel uero
etiam negotiis contemnendum. adiunguntur pericula uitae, turpisque ab his
formido mortis fortibus uiris opponitur, quibus magis id miserum uideri solet,
natura se consumi et senectute, quam sibi dari tempus ut possint eam uitam, quae
tamen esset reddenda naturae, pro patria potissimum reddere. illo uero se loco
copiosos et disertos putant, cum calamitates clarissimorum uirorum iniuriasque
iis ab ingratis inpositas ciuibus colligunt. hinc enim illa et apud Graecos
exempla, Miltiadem uictorem domitoremque Persarum,
nondum sanatis uolneribus iis quae
corpore aduerso in clarissima uictoria accepisset, uitam ex hostium telis
seruatam in ciuium uinclis profudisse, et Themistoclem patria quam liberauisset
pulsum atque proterritum, non in Graeciae portus per se seruatos sed in
barbariae sinus confugisse quam adflixerat, nec uero leuitatis Atheniensium
crudelitatisque in amplissimos ciuis exempla deficiunt. quae nata et frequentata
apud illos etiam in grauissumam ciuitatem nostram dicunt redundasse; nam
uel exilium Camilli uel offensio
commemoratur Ahalae Vel
inuidia Nasicae uel expulsio Laenatis uel Opimi damnatio uel fuga Metelli
uel acerbissima C. Mari clades --- principum caedes, uel eorum multorum pestes
quae paulo post secutae sunt. nec uero iam <meo> nomine abstinent, et credo quia
nostro consilio ac periculo sese in illa uita atque otio conseruatos putant,
grauius etiam de nobis queruntur et amantius. sed haud facile dixerim, cur cum
ipsi discendi aut uisendi causa maria tramittant - - -. (- - -)
IV. Saluam esse consulatu
abiens in contione populo Romano idem
iurante iurassem, facile iniuriarum omnium compensarem curam et molestiam.
quamquam nostri casus plus honoris habuerunt quam laboris, neque tantum
molestiae quantum gloriae, maioremque laetitiam ex desiderio bonorum percepimus,
quam ex laetitia inproborum dolorem. sed si aliter ut
dixi accidisset, qui possem queri? cum mihi nihil inprouiso nec grauius quam
expectauissem pro tantis meis factis euenisset. is enim fueram, cui cum liceret
aut maiores ex otio fructus capere quam ceteris propter uariam suauitatem
studiorum in quibus a pueritia uixeram, aut si quid accideret acerbius
uniuersis, non praecipuam sed parem cum ceteris fortunae condicionem subire, non
dubitauerim me grauissimis tempestatibus ac paene fulminibus ipsis obuium ferre
conseruandorum ciuium causa, meisque
propriis periculis parere commune reliquis otium. neque enim hac nos patria
lege genuit aut educauit, ut nulla quasi alimenta exspectaret a nobis, ac
tantummodo nostris ipsa commodis seruiens tutum perfugium otio nostro
suppeditaret et tranquillum ad quietem locum, sed ut plurimas et maximas nostri
animi ingenii consilii partis ipsa sibi ad utilitatem suam pigneraretur,
tantumque nobis in nostrum priuatum usum quantum ipsi superesse posset
remitteret.
V. Iam illa, perfugia quae sumunt sibi ad
excusationem quo facilius otio perfruantur, certe minime sunt audienda, cum ita
dicunt accedere ad rem publicam plerumque homines nulla re bona dignos, cum
quibus comparari sordidum, confligere autem multitudine praesertim incitata
miserum et periculosum sit. quam ob rem neque sapientis esse accipere habenas
cum insanos atque indomitos impetus uolgi cohibere non possit, neque liberi cum
inpuris atque inmanibus aduersariis decertantem uel contumeliarum uerbera
subire, uel expectare sapienti non ferendas iniurias:
proinde quasi bonis et fortibus et
magno animo praeditis ulla sit ad rem publicam adeundi causa iustior, quam
ne pareant inprobis, neue ab isdem lacerari rem publicam patiantur, cum ipsi
auxilium ferre si cupiant non queant.
VI. Illa autem exceptio cui probari tandem potest,
quod negant sapientem suscepturum ullam rei publicae partem, extra quam si eum
tempus et necessitas coegerit? quasi uero maior cuiquam necessitas accidere
possit quam accidit nobis; in qua quid facere potuissem, nisi tum consul
fuissem? consul autem esse qui potui, nisi eum uitae cursum tenuissem a
pueritia, per quem equestri loco natus peruenirem ad honorem amplissimum? non
igitur potestas est ex tempore aut cum uelis opitulandi rei publicae, quamuis ea
prematur periculis, nisi eo loco sis ut tibi id facere liceat. maximeque hoc in
hominum doctorum oratione mihi mirum uideri solet, quod qui tranquillo mari
gubernare se negent posse, quod nec didicerint nec umquam scire curauerint,
iidem ad gubernacula se accessuros profiteantur excitatis maximis fluctibus.
isti enim palam dicere atque in eo multum etiam gloriari solent, se de
rationibus rerum publicarum aut constituendarum aut tuendarum nihil nec
didicisse umquam nec docere, earumque rerum scientiam non doctis hominibus ac
sapientibus, sed in illo genere exercitatis concedendam putant. quare qui
conuenit polliceri operam suam rei publicae tum denique si necessitate cogantur?
cum, quod est multo procliuius, nulla necessitate premente rem publicam regere
nesciant. equidem, ut uerum esset sua uoluntate sapientem descendere ad rationes
ciuitatis non solere, sin autem temporibus cogeretur, tum id munus denique non
recusare, tamen arbitrarer hanc rerum ciuilium minime neglegendam scientiam
sapienti propterea, quod omnia essent ei praeparanda, quibus nesciret an
aliquando uti necesse esset.
VII. Haec plurimis a me uerbis dicta sunt ob eam
causam, quod his libris erat instituta et suscepta mihi de re publica
disputatio; quae ne frustra haberetur, dubitationem ad rem publicam adeundi in
primis debui tollere. ac tamen si qui sunt qui philosophorum auctoritate
moueantur, dent operam parumper atque audiant eos quorum summa est auctoritas
apud doctissimos homines et gloria; quos ego existimo, etiamsi qui ipsi rem
publicam non gesserint, tamen quoniam de re publica multa quaesierint et
scripserint, functos esse aliquo rei
publicae munere. eos uero septem quos Graeci sapientis nominauerunt, omnis
paene uideo in media re publica esse uersatos. neque enim est ulla res in qua
propius ad deorum numen uirtus accedat humana, quam ciuitatis aut condere nouas
aut conseruare iam conditas.
VIII. Quibus de rebus, quoniam nobis contigit ut
idem et in gerenda re publica aliquid essemus memoria dignum consecuti, et in
explicandis rationibus rerum ciuilium quandam facultatem, non modo usu sed etiam
studio discendi et docendi - - - essemus auctores, cum superiores ali fuissent
in disputationibus perpoliti, quorum res gestae nullae inuenirentur, ali in
gerendo probabiles, in disserendo rudes. nec uero nostra quaedam est instituenda
noua et a nobis inuenta ratio, sed unius aetatis clarissimorum ac
sapientissimorum nostrae ciuitatis uirorum disputatio repetenda memoria est,
quae mihi tibique quondam
adulescentulo est a P. Rutilio Rufo,
Smyrnae cum simul essemus compluris dies, exposita, in qua nihil fere quod magno
opere ad rationes omnium <harum> rerum pertineret praetermissam puto.
IX. Nam cum P. Africanus hic Pauli filius
feriis Latinis Tuditano cons- et
Aquilio constituisset in hortis esse, familiarissimique eius ad eum frequenter
per eos dies uentitaturos se esse dixissent, Latinis ipsis mane ad eum primus
sororis filius uenit Q. Tubero. quem cum comiter Scipio adpellauisset
libenterque uidisset, 'quid tu' inquit 'tam mane Tubero? dabant enim hae feriae
tibi opportunam sane facultatem ad explicandas tuas litteras'. tum ille
(Tubero): 'mihi uero omne tempus est ad meos libros uacuum; numquam enim sunt
illi occupati; te autem permagnum est nancisci otiosum, hoc praesertim motu rei
publicae'. tum Scipio: 'atqui nactus es, sed mehercule otiosiorem opera quam
animo'. et ille (Tubero): 'at uero animum quoque relaxes oportet; sumus enim
multi ut constituimus parati, si tuo commodo fieri potest, abuti tecum hoc
otio'. SCIPIO 'libente me uero, ut aliquid aliquando de doctrinae studiis
admoneamur'.
X. Tum ille (Tubero): 'uisne igitur, quoniam et me
quodam modo inuitas et tui spem das, hoc primum Africane uideamus, ante quam
ueniunt alii, quidnam sit de isto altero sole quod nuntiatum est in senatu?
neque enim pauci neque leues sunt qui
se duo soles uidisse dicant, ut non tam fides non habenda quam ratio
quaerenda sit'. hic Scipio: 'quam
uellem Panaetium nostrum nobiscum haberemus! qui cum cetera tum haec
caelestia uel studiosissime solet quaerere. sed ego Tubero - nam tecum aperte
quod sentio loquar - non nimis adsentior in omni isto genere nostro illi
familiari, qui quae uix coniectura qualia sint possumus suspicari, sic adfirmat
ut oculis ea cernere uideatur aut tractare plane manu. quo etiam sapientiorem
Socratem soleo iudicare, qui omnem eius modi curam deposuerit, eaque quae de
natura quaererentur, aut maiora quam hominum ratio consequi possit, aut nihil
omnino ad uitam hominum adtinere dixerit'. Dein Tubero: 'nescio Africane
cur ita memoriae proditum sit, Socratem omnem istam disputationem reiecisse, et
tantum de uita et de moribus solitum esse quaerere. quem enim auctorem de illo
locupletiorem Platone laudare possumus? cuius in libris multis locis ita
loquitur Socrates, ut etiam cum de moribus de uirtutibus denique de re publica
disputet, numeros tamen et geometriam et harmoniam studeat
Pythagorae more coniungere'. tum
Scipio: 'sunt ista ut dicis; sed audisse te credo Tubero, Platonem Socrate
mortuo primum in Aegyptum discendi causa, post in Italiam et in Siciliam
contendisse, ut Pythagorae inuenta perdisceret, eumque et cum Archyta Tarentino
et cum Timaeo Locro multum fuisse et
Philolai commentarios esse nanctum, cumque eo tempore in his locis
Pythagorae nomen uigeret, illum se et hominibus Pythagoreis et studiis illis
dedisse. itaque cum Socratem unice dilexisset, eique omnia tribuere uoluisset,
leporem Socraticum subtilitatemque sermonis cum obscuritate Pythagorae et cum
illa plurimarum artium grauitate contexuit'.
XI. Haec Scipio cum dixisset, L. Furium repente
uenientem aspexit, eumque ut salutauit, amicissime adprehendit et in lecto suo
conlocauit. et cum simul P. Rutilius uenisset, qui est nobis huius sermonis
auctor, eum quoque ut salutauit, propter Tuberonem iussit adsidere. tum Furius:
'quid uos agitis? num sermonem uestrum aliquem diremit noster interuentus?'
'minime uero', Africanus; 'soles enim tu haec studiose inuestigare quae sunt in
hoc genere de quo instituerat paulo ante Tubero quaerere;
Rutilius quidem noster etiam, sub ipsis Numantiae moenibus solebat mecum
interdum eius modi aliquid conquirere'. 'quae res tandem inciderat?' inquit
Philus. tum ille SCIPIO: 'de solibus istis duobus; de quo studeo, Phile, ex te
audire quid sentias'.
XII. Dixerat hoc ille, cum puer nuntiauit
uenire ad eum Laelium domoque iam
exisse. tum Scipio calceis et
uestimentis sumptis e cubiculo est egressus, et cum paululum inambulauisset
in porticu, Laelium aduenientem salutauit et eos, qui una uenerant, Spurium
Mummium, quem in primis diligebat, et C. Fannium et Quintum Scaeuolam, generos
Laeli, doctos adulescentes, iam
aetate quaestorios; quos cum omnis salutauisset, conuertit se in porticu et
coniecit in medium Laelium; fuit enim hoc in amicitia quasi quoddam ius inter
illos, ut militiae propter eximiam belli gloriam Africanum ut deum coleret
Laelius, domi uicissim Laelium, quod
aetate antecedebat, obseruaret in parentis loco Scipio. dein cum essent
perpauca inter se uno aut altero spatio conlocuti, Scipionique eorum aduentus
periucundus et pergratus fuisset, placitum est ut in aprico maxime pratuli loco,
quod erat hibernum tempus anni, considerent; quod cum facere uellent, interuenit
uir prudens omnibusque illis et iucundus et carus, M. Manilius qui a Scipione
ceterisque amicissime consalutatus adsedit proximus Laelio.
XIII. Tum Philus: 'non mihi uidetur' inquit 'quod
hi uenerunt alius nobis sermo esse quaerendus, sed agendum accuratius et
dicendum dignum aliquid horum auribus'. hic Laelius: 'quid tandem agebatis, aut
cui sermoni nos interuenimus?' (Philus) 'quaesierat ex me Scipio quidnam
sentirem de hoc quod duo soles uisos esse constaret'. LAELIUS 'ain uero, Phile?
iam explorata nobis sunt ea quae ad domos nostras quaeque ad rem publicam
pertinent? siquidem quid agatur in caelo quaerimus'. et ille (Philus): 'an tu ad
domos nostras non censes pertinere scire quid agatur et quid fiat domi? quae non
ea est quam parietes nostri cingunt, sed mundus hic totus, quod domicilium
quamque patriam di nobis communem secum dederunt, cum praesertim si haec
ignoremus, multa nobis et magna ignoranda sint. ac me quidem ut hercule etiam te
ipsum Laeli omnisque auidos sapientiae cognitio ipsa rerum consideratioque
delectat'. (20) tum Laelius: 'non inpedio, praesertim quoniam feriati sumus; sed
possumus audire aliquid an serius uenimus?' (Philus) nihil est adhuc disputatum,
et quoniam est integrum, libenter tibi, Laeli, ut de eo disseras equidem
concessero'. LAELIUS 'immo uero te audiamus, nisi forte Manilius interdictum
aliquod inter duos soles putat esse componendum,
ut ita caelum possideant ut uterque
possederit'. tum Manilius: 'pergisne eam, Laeli, artem inludere, in qua
primum excellis ipse, deinde sine qua
scire nemo potest quid sit suum quid alienum? sed ista mox; nunc audiamus
Philum, quem uideo maioribus iam de rebus quam me aut quam P. Mucium consuli'.
XIV. Tum Philus: 'nihil noui uobis adferam, neque
quod a me sit <ex>cogitatum aut inuentum; nam memoria teneo
C. Sulpicium Gallum, doctissimum
ut scitis hominem, cum idem hoc uisum
diceretur et esset casu apud M. Marcellum, qui cum eo consul fuerat,
sphaeram quam M. Marcelli auus captis Syracusis ex urbe locupletissima atque
ornatissima sustulisset, cum aliud nihil ex tanta praeda domum suam
deportauisset, iussisse proferri;
cuius ego sphaerae cum persaepe propter Archimedi gloriam nomen audissem,
speciem ipsam non sum tanto opere admiratus; erat enim illa uenustior et
nobilior in uolgus, quam ab eodem Archimede factam posuerat in templo Virtutis
Marcellus idem. Sed posteaquam coepit rationem huius operis scientissime Gallus
exponere, plus in illo Siculo ingenii quam uideretur natura humana ferre
potuisse iudicabam fuisse. dicebat enim Gallus sphaerae illius alterius solidae
atque plenae uetus esse inuentum, et eam a Thalete Milesio primum esse tornatam,
post autem ab Eudoxo Cnidio,
discipulo ut ferebat Platonis, eandem illam astris quae caelo inhaererent
esse descriptam; cuius omnem ornatum et descriptionem sumptam ab Eudoxo multis
annis post non astrologiae scientia sed poetica quadam facultate uersibus Aratum
extulisse. hoc autem sphaerae genus, in quo solis et lunae motus inessent et
earum quinque stellarum quae errantes et quasi uagae nominarentur,
in illa sphaera solida non potuisse
finiri, atque in eo admirandum esse inuentum Archimedi, quod excogitasset
quem ad modum in dissimillimis motibus inaequabiles et uarios cursus seruaret
una conuersio. hanc sphaeram Gallus cum moueret, fiebat ut soli luna totidem
conuersionibus in aere illo quot diebus in ipso caelo succederet, ex quo et in
<caelo> sphaera solis fieret eadem illa defectio, et incideret luna tum in eam
metam quae esset umbra terrae, cum sol e regione - - -.
XV. - - - SCIPIO 'fuit, quod et ipse hominem
diligebam et in primis patri meo Paulo probatum et carum fuisse cognoueram.
memini me admodum adulescentulo,
cum pater in Macedonia consul esset et essemus in castris perturbari exercitum
nostrum religione et metu, quod serena nocte subito candens et plena luna
defecisset. tum ille cum legatus noster esset anno fere ante quam consul est
declaratus, haud dubitauit postridie palam in castris docere
nullum esse prodigium, idque et tum factum esse et certis temporibus esse
semper futurum, cum sol ita locatus fuisset ut lunam suo lumine non posset
attingere'. 'ain tandem?' inquit Tubero; 'docere hoc poterat ille homines paene
agrestes, et apud imperitos audebat haec dicere?' SCIPIO 'ille uero, et magna
quidem cum- - -. (- - -) (24) SCIPIO <neque in>solens ostentatio neque oratio
abhorrens a persona hominis grauissimi; rem enim magnam <erat> adsecutus, quod
hominibus perturbatis inanem religionem timoremque deiecerat.
XVI. Atque eiusmodi quiddam etiam bello illo
maximo quod Athenienses et Lacedaemonii summa inter se contentione gesserunt,
Pericles ille et auctoritate et eloquentia et consilio princeps ciuitatis suae,
cum obscurato sole tenebrae factae essent repente, Atheniensiumque animos summus
timor occupauisset, docuisse ciuis suos dicitur, id quod ipse ab Anaxagora cuius
auditor fuerat acceperat, certo illud tempore fieri et necessario, cum tota se
luna sub orbem solis subiecisset; itaque etsi non omni intermenstruo, tamen id
fieri non posse nisi intermenstruo tempore. quod cum disputando rationibusque
docuisset, populum liberauit metu;
erat enim tum haec noua et ignota ratio, solem lunae oppositu solere deficere,
quod Thaletem Milesium primum uidisse dicunt. id autem postea ne nostrum quidem
Ennium fugit; qui ut scribit, anno quinquagesimo <et> CCC. fere post Romam
conditam 'Nonis Iunis soli luna obstitit et nox'. atque hac in re tanta inest
ratio atque sollertia, ut ex hoc die quem apud Ennium et
in maximis annalibus consignatum uidemus, superiores solis defectiones
reputatae sint usque ad illam quae Nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo;
quibus quidem Romulum tenebris etiamsi natura ad humanum exitum abripuit, uirtus
tamen in caelum dicitur sustulisse'.
XVII. Tum Tubero: 'uidesne, Africane, quod paulo
ante secus tibi uidebatur, doc- - - -. ( - - -) SCIPIO - - -lis, quae uideant
ceteri. quid porro aut praeclarum putet in rebus humanis, qui haec deorum regna
perspexerit, aut diuturnum, qui cognouerit quid sit aeternum, aut gloriosum, qui
uiderit quam parua sit terra, primum uniuersa, deinde ea pars eius quam homines
incolant, quamque nos in exigua eius parte adfixi, plurimis ignotissimi
gentibus, speremus tamen nostrum nomen uolitare et uagari latissime? agros uero
et aedificia et pecudes et inmensum argenti pondus atque auri qui bona nec
putare nec appellare soleat, quod earum rerum uideatur ei leuis fructus, exiguus
usus, incertus dominatus, saepe etiam taeterrimorum hominum inmensa possessio,
quam est hic fortunatus putandus! cui soli uere liceat omnia non Quiritium sed
sapientium iure pro suis uindicare, nec ciuili nexo sed communi lege naturae,
quae uetat ullam rem esse cuiusquam, nisi eius qui tractare et uti sciat; qui
inperia consulatusque nostros in necessariis, non in expetendis rebus, muneris
fungendi gratia subeundos, non praemiorum aut gloriae causa adpetendos putet;
qui denique, ut Africanum auum meum scribit Cato solitum esse dicere, possit
idem de se praedicare, numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam
minus solum esse quam cum solus esset. Quis enim putare uere potest, plus egisse
Dionysium tum cum omnia moliendo eripuerit ciuibus suis libertatem, quam eius
ciuem Archimedem cum istam ipsam sphaeram, nihil cum agere uideretur, de qua
modo dicebatur effecerit? quis autem non magis solos esse, qui in foro turbaque
quicum conloqui libeat non habeant, quam qui nullo arbitro uel secum ipsi
loquantur, uel quasi doctissimorum hominum in concilio adsint, cum eorum
inuentis scriptisque se oblectent? quis uero diuitiorem quemquam putet quam eum
cui nihil desit quod quidem natura desideret, aut potentiorem quam illum qui
omnia quae expetat consequatur, aut beatiorem quam qui sit omni perturbatione
animi liberatus, aut firmiore fortuna quam qui ea possideat quae secum ut aiunt
uel e naufragio possit ecferre? quod autem imperium, qui magistratus, quod
regnum potest esse praestantius, quam despicientem omnia humana et inferiora
sapientia ducentem nihil umquam nisi sempiternum et diuinum animo uolutare? cui
persuasum sit appellari ceteros homines,esse solos eos qui essent politi
propriis humanitatis artibus? Vt mihi Platonis illud,
seu quis dixit alius, perelegans
esse uideatur: quem cum ex alto ignotas ad terras tempestas et in desertum litus
detulisset, timentibus ceteris propter ignorationem locorum, animaduertisse
dicunt in arena geometricas formas quasdam esse descriptas; quas ut uidisset,
exclamauisse ut bono essent animo; uidere enim se hominum uestigia; quae
uidelicet ille non ex agri consitura quam cernebat, sed ex doctrinae indiciis
interpretabatur. quam ob rem Tubero semper mihi et doctrina et eruditi homines
et tua ista studia placuerunt'.
XVIII. Tum Laelius: 'non audeo quidem' inquit 'ad
ista Scipio dicere, neque tam te aut Philum aut Manilium - - -. (- - -) LAELIUS
in ipsius paterno genere fuit noster ille amicus, dignus huic ad imitandum, 'Egregie
cordatus homo, catus Aelius
Sextus' qui 'egregie cordatus' et 'catus' fuit et ab Ennio dictus est, non
quod ea quaerebat quae numquam inueniret, sed quod ea respondebat quae eos qui
quaesissent et cura et negotio soluerent, cuique contra Galli studia disputanti
in ore semper erat ille de Iphigenia
Achilles: 'Astrologorum signa in caelo - quid sit obseruationis, Cum capra
aut nepa aut exoritur nomen aliquod beluarum -, Quod est ante pedes nemo
spectat, caeli scrutantur plagas'. atque idem - multum enim illum audiebam et
libenter - Zethum illum Pacuui nimis inimicam doctrinae esse dicebat; magis eum
delectabat Neoptolemus Ennii, qui se ait 'philosophari uelle, sed paucis; nam
omnino haud placere'. quodsi studia Graecorum uos tanto opere delectant, sunt
alia liberiora et transfusa latius, quae uel ad usum uitae uel etiam ad ipsam
rem publicam conferre possumus. istae quidem artes, si modo aliquid, <id>
ualent, ut paulum acuant et tamquam inritent ingenia puerorum, quo facilius
possint maiora discere'.
XIX. Tum Tubero: 'non dissentio a te, Laeli, sed
quaero quae tu esse maiora intellegas. LAELIUS dicam mehercule et contemnar a te
fortasse, cum tu ista caelestia de Scipione quaesieris, ego autem haec quae
uidentur ante oculos esse magis putem quaerenda. quid enim mihi L. Pauli nepos,
hoc auunculo, nobilissima in familia atque in hac tam clara re publica natus,
quaerit quo modo duo soles uisi sint, non quaerit cur in una re publica duo
senatus et duo paene iam populi sint? nam ut uidetis mors Tiberii Gracchi et iam
ante tota illius ratio tribunatus diuisit populum unum in duas partis;
obtrectatores autem et inuidi Scipionis,
initiis factis a P. Crasso et Appio Claudio, tenent nihilo minus illis
mortuis senatus alteram partem, dissidentem a uobis auctore Metello et P. Mucio,
neque hunc qui unus potest, concitatis sociis et nomine Latino, foederibus
uiolatis, triumuiris seditiosissimis aliquid cotidie noui molientibus, bonis
uiris locupletibus perturbatis, his tam periculosis rebus subuenire patiuntur.
Quam ob rem si me audietis adulescentes, solem alterum ne metueritis; aut enim
nullus esse potest, aut sit sane ut uisus est, modo ne sit molestus, aut scire
istarum rerum nihil, aut etiamsi maxime sciemus, nec meliores ob eam scientiam
nec beatiores esse possumus; senatum uero et populum ut unum habeamus et fieri
potest, et permolestum est nisi fit, et secus esse scimus, et uidemus si id
effectum sit et melius nos esse uicturos et beatius'.
XX. Tum Mucius: 'quid esse igitur censes Laeli
discendum nobis, ut istud efficere possimus ipsum quod postulas?' LAELIUS 'eas
artis quae efficiant ut usui ciuitati simus; id enim esse praeclarissimum
sapientiae munus maximumque uirtutis uel documentum uel officium puto. quam ob
rem ut hae feriae nobis ad utilissimos rei publicae sermones potissimum
conferantur, Scipionem rogemus, ut explicet quem existimet esse optimum statum
ciuitatis; deinde alia quaeremus. quibus cognitis spero nos ad haec ipsa uia
peruenturos, earumque rerum rationem quae nunc instant explicaturos'.
XXI. Cum id et Philus et Manilius et Mummius
admodum adproba<uissent> (- - -) nullum est exemplum cui malimus adsimulare rem
publicam. (- - - ) LAELIUS 'non solum ob eam causam fieri uolui, quod erat
aequum de re publica potissimum principem rei publicae dicere, sed etiam quod
memineram persaepe te cum Panaetio disserere solitum coram Polybio, duobus
Graecis uel peritissimis rerum ciuilium, multaque colligere ac docere, optimum
longe statum ciuitatis esse eum quem maiores nostri nobis reliquissent. qua in
disputatione quoniam tu paratior es, feceris - ut etiam pro his dicam - si de re
publica quid sentias explicaris, nobis gratum omnibus'.
XXII. Tum ille SCIPIO: 'non possum equidem dicere
me ulla in cogitatione acrius aut diligentius solere uersari, quam in ista ipsa
quae mihi Laeli a te proponitur. etenim cum in suo quemque opere artificem, qui
quidem excellat, nihil aliud cogitare meditari curare uideam, nisi quo sit in
illo genere melior, ego cum mihi sit unum opus hoc a parentibus maioribusque
meis relictum, procuratio atque administratio rei publicae, non me inertiorem
esse confitear quam opificem quemquam, si minus in maxima arte quam illi in
minimis operae consumpserim? Sed neque iis contentus sum quae de ista
consultatione scripta nobis summi ex Graecia sapientissimique homines
reliquerunt, neque ea quae mihi uidentur anteferre illis audeo. quam ob rem peto
a uobis ut me sic audiatis: neque ut omnino expertem Graecarum rerum, neque ut
eas nostris in hoc praesertim genere anteponentem, sed ut unum e togatis
patris diligentia non inliberaliter
institutum, studioque discendi a pueritia incensum, usu tamen et domesticis
praeceptis multo magis eruditum quam litteris'.
XXIII. Hic Philus: 'non hercule' inquit 'Scipio
dubito, quin tibi ingenio praestiterit nemo, usuque idem in re publica rerum
maximarum facile omnis uiceris, quibus autem studiis semper fueris tenemus. quam
ob rem si ut dicis animum quoque contulisti in istam rationem et quasi artem,
habeo maximam gratiam Laelio; spero enim multo uberiora fore quae a te dicentur,
quam illa quae a Graecis nobis scripta sunt omnia'. tum ille SCIPIO 'permagnam
tu quidem expectationem, quod onus est ei qui magnis de rebus dicturus est
grauissimum, inponis orationi meae'. Et Philus: 'quamuis sit magna, tamen eam
uinces ut soles; neque enim est periculum ne te 'e re publica disserentem
deficiat oratio'.
XXIV. Hic Scipio: 'faciam quod uultis ut potero,
et ingrediar in disputationem ea lege, qua credo omnibus in rebus disserendis
utendam esse si errorem uelis tollere, ut eius rei de qua quaeretur si nomen
quod sit conueniat, explicetur quid declaretur eo nomine; quod si conuenerit,
tum demum decebit ingredi in sermonem; numquam enim quale sit illud de quo
disputabitur intellegi poterit, nisi quod sit fuerit intellectum prius. quare
quoniam de re publica quaerimus, hoc primum uideamus quid sit id ipsum quod
quaerimus'. cum adprobauisset Laelius, 'nec uero' inquit Africanus 'ita disseram
de re tam inlustri tamque nota, ut ad illa elementa reuoluar quibus uti docti
homines his in rebus solent, ut a prima congressione maris et feminae, deinde
a progenie et cognatione ordiar,
uerbisque quid sit et quot modis quidque dicatur definiam saepius; apud
prudentes enim homines et in maxima re publica summa cum gloria belli domique
uersatos cum loquar, non committam ut sit inlustrior illa ipsa res de qua
disputem, quam oratio mea; nec enim hoc suscepi ut tamquam magister persequerer
omnia, neque hoc polliceor me effecturum ut ne qua particula in hoc sermone
praetermissa sit'. tum Laelius: 'ego uero istud ipsum genus orationis quod
polliceris expecto'.
XXV. Est igitur, inquit Africanus, res publica res
populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed
coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. eius autem
prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum
quasi congregatio; non est enim singulare nec soliuagum genus hoc, sed ita
generatum ut ne in omnium quidem rerum affluen<tia> - - - . (- - -) - - -.
XXVI. SCIPIO - - - <quae>dam quasi semina, neque
reliquarum uirtutum nec ipsius rei publicae reperiatur ulla institutio. hi
coetus igitur hac de qua exposui causa instituti, sedem primum certo loco
domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eius modi
coniunctionem tectorum oppidum uel urbem appellauerunt, delubris distinctam
spatiisque communibus. omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis
qualem exposui, omnis ciuitas, quae est constitutio populi, omnis res publica,
quae ut dixi populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. id
autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit
ciuitatem. deinde aut uni tribuendum
est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omnibus.
quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum uocamus, et regnum
eius rei publicae statum. cum autem est penes delectos, tum illa ciuitas
optimatium arbitrio regi dicitur. illa autem est ciuitas popularis - sic enim
appellant -, in qua in populo sunt omnia. atque horum trium generum quoduis, si
teneat illud uinculum quod primum homines inter se rei publicae societate
deuinxit, non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum, sed tolerabile
tamen, et aliud <ut> alio possit esse praestantius. nam uel rex aequus ac
sapiens, uel delecti ac principes ciues, uel ipse populus, quamquam id est
minime probandum, tamen nullis interiectis iniquitatibus aut cupiditatibus posse
uidetur aliquo esse non incerto statu.
XXVII. Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri
communis iuris et consilii, et in optimatium dominatu uix particeps libertatis
potest esse multitudo, cum omni consilio communi ac potestate careat, et cum
omnia per populum geruntur quamuis iustum atque moderatum, tamen ipsa
aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis. itaque si Cyrus
ille Perses iustissimus fuit sapientissimusque rex, tamen mihi populi res - ea
enim est ut dixi antea publica - non maxime expetenda fuisse illa uidetur, cum
regeretur unius nutu (Text zerstört) ac modo; si
Massilienses nostri clientes per
delectos et principes ciues summa iustitia reguntur, inest tamen in ea
condicione populi similitudo quaedam seruitutis; si Athenienses quibusdam
temporibus sublato Areopago nihil nisi populi scitis ac decretis agebant,
quoniam distinctos dignitatis gradus non habebant, non tenebat ornatum suum
ciuitas.
XXVIII. Atque hoc loquor de tribus his generibus
rerum publicarum non turbatis atque permixtis, sed suum statum tenentibus. quae
genera primum sunt in iis singula uitiis quae ante dixi, deinde habent
perniciosa alia uitia; nullum est enim genus illarum rerum publicarum, quod non
habeat iter ad finitimum quoddam malum praeceps ac lubricum. nam illi regi, ut
eum potissimum nominem, tolerabili aut si uoltis etiam amabili Cyro subest ad
inmutandi animi licentiam crudelissimus ille Phalaris, cuius in similitudinem
dominatus unius procliui cursu et facile delabitur. illi autem
Massiliensium paucorum et principum
administrationi ciuitatis finitimus est qui fuit quodam tempore apud Athenienses
triginta <uirorum illorum> consensus et factio. iam Atheniensium populi
potestatem omnium rerum ipsi, ne alios requiramus, ad furorem multitudinis
licentiamque conuersam pesti - - -. (- - -)
XXIX. SCIPIO - - - 'taeterrimus, et ex hac uel
optimatium uel factiosa tyrannica illa uel regia uel etiam persaepe popularis,
itemque ex ea genus aliquod ecflorescere ex illis quae ante dixi solet, mirique
sunt orbes et quasi circuitus in rebus publicis commutationum et uicissitudinum;
quos cum cognosse sapientis est, tum uero prospicere inpendentis, in gubernanda
re publica moderantem cursum atque in sua potestate retinentem, magni cuiusdam
ciuis et diuini paene est uiri. itaque quartum quoddam genus rei publicae maxime
probandum esse sentio, quod est ex his quae prima dixi moderatum et permixtum
tribus'.
XXX. Hic Laelius: 'scio tibi ita placere Africane:
saepe enim ex te audiui; sed tamen, nisi molestum est, ex tribus istis modis
rerum publicarum uelim scire quod optimum iudices. nam uel profuerit aliquid ad
cog- - - -. (- - -)
XXXI. SCIPIO - - - 'et talis est quaeque res
publica, qualis eius aut natura aut uoluntas qui illam regit. itaque nulla alia
in ciuitate, nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas
habet; qua quidem certe nihil potest esse dulcius, et quae si aequa non est ne
libertas quidem est. qui autem aequa potest esse - omitto dicere in regno, ubi
ne obscura quidem est aut dubia seruitus, sed in istis ciuitatibus in quibus
uerbo sunt liberi omnes? ferunt enim suffragia, mandant inperia magistratus,
ambiuntur, rogantur, sed ea dant {magis} quae etiamsi nolint danda sint, et quae
ipsi non habent unde ali petunt;sunt enim expertes imperii, consilii publici,
iudicii delectorum iudicum, quae familiarum uetustatibus aut pecuniis
ponderantur. in libero autem populo, ut Rhodi, ut Athenis, nemo est ciuium qui -
- - .
XXXII. SCIPIO - - - <po>pulo aliquis unus pluresue
diuitiores opulentioresque extitissent, tum ex eorum fastidio et superbia nata
esse commemorant, cedentibus ignauis et inbecillis et adrogantiae diuitum
succumbentibus. si uero ius suum populi teneant, negant quicquam esse
praestantius, liberius, beatius, quippe qui domini sint legum, iudiciorum,
belli, pacis, foederum, capitis unius cuiusque, pecuniae. hanc unam rite rem
publicam, id est rem populi, appellari putant. itaque et a regum et a patrum
dominatione solere in libertatem rem populi uindicari, non ex liberis populis
reges requiri aut potestatem atque opes optimatium. et uero negant oportere
indomiti populi uitio genus hoc totum liberi populi repudiari: concordi populo
et omnia referente ad incolumitatem et ad libertatem suam nihil esse
inmutabilius, nihil firmius; facillimam autem in ea re publica esse posse
concordiam, in qua idem conducat omnibus; ex utilitatis uarietatibus, cum aliis
aliud expediat, nasci discordias; itaque cum patres rerum potirentur, numquam
constitisse ciuitatis statum; multo iam id in regnis minus, quorum, ut ait
Ennius, 'nulla {regni} sancta societas nec fides est'. quare cum lex sit ciuilis
societatis uinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas ciuium teneri
potest, cum par non sit condicio ciuium? si enim pecunias aequari non placet, si
ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter
se qui sunt ciues in eadem re publica. quid est enim ciuitas nisi iuris societas
ciuium? (- - -)
XXXIII. SCIPIO - - - ceteras uero res publicas ne
appellandas quidem putant iis nominibus quibus illae sese appellari uelint.
cur enim regem appellem Iouis optimi
nomine hominem dominandi cupidum aut imperii singularis, populo oppresso
dominantem, non tyrannum potius? tam enim esse clemens tyrannus quam rex
inportunus potest: ut hoc populorum intersit utrum comi domino an aspero
seruiant; quin seruiant quidem fieri non potest. quo autem modo adsequi poterat
Lacedaemo illa tum, cum praestare putabatur disciplina rei publicae, ut bonis
uteretur iustisque regibus, cum esset habendus rex quicumque genere regio natus
esset? nam optimatis quidem quis ferat, qui non populi concessu sed suis
comitiis hoc sibi nomen adrogauerunt? qui enim iudicatur iste optimus? doctrina
artibus studiis, audio: quando? (- - -)
XXXIV. SCIPIO - - - Si fortuito id faciet, tam
cito euertetur quam nauis, si e uectoribus sorte ductus ad gubernacula
accesserit. quodsi liber populus deliget quibus se committat, deligetque si modo
saluus esse uult optimum quemque, certe in optimorum consiliis posita est
ciuitatium salus, praesertim cum hoc natura tulerit, non solum ut summi uirtute
et animo praeesse inbecillioribus, sed ut hi etiam parere summis uelint. uerum
hunc optimum statum prauis hominum opinionibus euersum esse dicunt, qui
ignoratione uirtutis, quae cum in paucis est tum a paucis iudicatur et cernitur,
opulentos homines et copiosos, tum genere nobili natos esse optimos putant. hoc
errore uulgi cum rem publicam opes paucorum, non uirtutes tenere coeperunt,
nomen illi principes optimatium mordicus tenent, re autem carent eo nomine. nam
diuitiae, nomen, opes uacuae consilio et uiuendi atque aliis imperandi modo
dedecoris plenae sunt et insolentis superbiae, nec ulla deformior species est
ciuitatis quam illa in qua opulentissimi optimi putantur. uirtute uero
gubernante rem publicam, quid potest esse praeclarius? cum is qui inperat aliis
seruit ipse nulli cupiditati, cum quas ad res ciuis instituit et uocat, eas
omnis conplexus est ipse, nec leges inponit populo quibus ipse non pareat, sed
suam uitam ut legem praefert suis ciuibus. qui si unus satis omnia consequi
posset, nihil opus esset pluribus; si uniuersi uidere optimum et in eo
consentire possent, nemo delectos principes quaereret. difficultas ineundi
consilii rem a rege ad plures, error et temeritas populorum a multitudine ad
paucos transtulit. sic inter <in>firmitatem unius temeritatemque multorum medium
optimates possederunt locum, quo nihil potest esse moderatius; quibus rem
publicam tuentibus beatissimos esse populos necesse est, uacuos omni cura et
cogitatione, aliis permisso otio suo, quibus id tuendum est neque committendum
ut sua commoda populus neglegi a principibus putet. (53) Nam aequabilitas quidem
iuris, quam amplexantur liberi populi, neque seruari potest - ipsi enim populi,
quamuis soluti ecfrenatique sint, praecipue multis multa tribuunt, et est in
ipsis magnus dilectus hominum et dignitatum -, eaque quae appellatur
aequabilitas iniquissima est: cum enim par habetur honos summis et infimis, qui
sint in omni populo necesse est, ipsa aequitas iniquissima est; quod in iis
ciuitatibus quae ab optimis reguntur accidere non potest. haec fere Laeli et
quaedam eiusdem generis ab iis qui eam formam rei publicae maxime laudant
disputari solent'.
XXXV. Tum Laelius: 'quid tu' inquit 'Scipio? e
tribus istis quod maxime probas?' SCIPIO recte quaeris quod maxime e tribus,
quoniam eorum nullum ipsum per se separatim probo, anteponoque singulis illud
quod conflatum fuerit ex omnibus. sed
si unum ac simplex p<ro>bandum <sit>, regium <pro>bem atque in primis
laudem. In primo autem genere, quod hoc loco appellatur, occurrit nomen quasi
patrium regis, ut ex se natis ita consulentis suis ciuibus et eos con<s>eruantis
stu<dio>sius quam redigentis in seruitutem : ut sane utilius sit facultatibus et
mente exiguos sustentari unius optimi et summi uiri diligentia. Adsunt
optimates, qui se melius hoc idem facere profiteantur, plusque fore dicant in
pluribus consilii quam in uno, et eandem tamen aequitatem et fidem. ecce autem
maxima uoce clamat populus neque se uni neque paucis uelle parere; libertate ne
feris quidem quicquam esse dulcius; hac omnes carere, siue regi siue optimatibus
seruiant. ita caritate nos capiunt reges, consilio optimates, libertate populi,
ut in conparando difficile ad eligendum sit quid maxime uelis'. LAELIUS 'credo'
inquit, 'sed expediri quae restant uix poterunt, si hoc incohatum reliqueris'.
XXXVI. SCIPIO 'imitabor ergo Aratum, qui magnis de
rebus dicere exordiens a Ioue
incipiendum putat'. LAELIUS 'quo Ioue? aut quid habet illius carminis simile
haec oratio?' SCIPIO 'tantum' inquit 'ut rite ab eo dicendi principia capiamus,
quem unum omnium deorum et hominum regem esse omnes docti indoctique <expoliri>
consentiunt. 'quid?' inquit Laelius'. Et ille SCIPIO 'quid censes nisi quod est
ante oculos? siue haec ad utilitatem uitae constituta sunt a principibus rerum
publicarum, ut rex putaretur unus esse in caelo, qui nutu ut ait Homerus, totum
Olympum conuerteret, idemque et rex et pater haberetur omnium, magna auctoritas
est multique testes, siquidem omnis multos appellari placet, ita consensisse
gentes decretis uidelicet principum, nihil esse rege melius, quoniam deos omnis
censent unius regi numine; siue haec in errore inperitorum posita esse et
fabularum similia dicimus, audiamus communis quasi doctores eruditorum hominum,
qui tamquam oculis illa uiderunt, quae nos uix audiendo cognoscimus'. 'quinam'
inquit Laelius 'isti sunt?' et ille SCIPIO 'qui natura omnium rerum
peruestiganda senserunt omnem hunc mundum mente' (- - -).
XXXVII. SCIPIO - - - 'sed si uis Laeli, dabo tibi
testes nec nimis antiquos nec ullo modo barbaros'. LAELIUS 'istos' inquit uolo'.
SCIPIO 'uidesne igitur minus quadringentorum annorum esse hanc urbem ut sine
regibus sit?' LAELIUS 'uero minus'. SCIPIO 'quid ergo? haec quadringentorum
annorum aetas ut urbis et ciuitatis num ualde longa est?' LAELIUS 'ista uero'
inquit 'adulta uix'. SCIPIO 'ergo his annis quadringentis Romae rex erat?'
LAELIUS 'et superbus quidem. SCIPIO quid supra? LAELIUS 'iustissimus, et
deinceps retro usque ad Romulum, qui ab hoc tempore anno sescentesimo rex erat'.
SCIPIO 'ergo ne iste quidem peruetus?' LAELIUS 'minime, ac prope senescente iam
Graecia'. 'cedo, num' Scipio 'barbarorum Romulus rex fuit?' LAELIUS 'si ut
Graeci dicunt omnis aut Graios esse aut barbaros, uereor ne barbarorum rex
fuerit; sin id nomen moribus dandum est, non linguis, non Graecos minus barbaros
quam Romanos puto'. et Scipio: 'atqui ad hoc de quo agitur non quaerimus gentem,
ingenia quaerimus. si enim et prudentes homines et non ueteres reges habere
uoluerunt, utor neque perantiquis neque inhumanis ac feris testibus.
XXXVIII. Tum Laelius: 'uideo te Scipio testimoniis
satis instructum, sed apud me, ut apud bonum iudicem, argumenta plus quam testes
ualent'. tum Scipio: 'utere igitur argumento Laeli tute ipse sensus tui'.
'cuius' inquit ille LAELIUS 'sensus?' SCIPIO 'Si quando, si forte tibi uisus es
irasci alicui'. LAELIUS 'ego uero saepius quam uellem'. SCIPIO 'quid? tum cum tu
es iratus, permittis illi iracundiae dominatum animi tui?' LAELIUS 'non
mehercule' inquit, 'sed imitor Archytam illum Tarentinum, qui cum ad uillam
uenisset et omnia aliter offendisset ac iusserat, 'a te <in> felicem' inquit
uilico, 'quem necassem iam uerberibus,
nisi iratus essem'. (60) 'Optime'
inquit Scipio. 'ergo Archytas iracundiam uidelicet dissidentem a ratione
seditionem quandam animi esse iure ducebat, atque eam consilio sedari uolebat;
adde auaritiam, adde imperii, adde gloriae cupiditatem, adde libidines, et illud
uides: si in animis hominum regale imperium sit, unius fore dominatum, consilii
scilicet - ea est enim animi pars optima -, consilio autem dominante nullum esse
libidinibus, nullum irae, nullum temeritati locum'. LAELIUS 'sic' inquit 'est'.
SCIPIO 'probas igitur animum ita adfectum?' LAELIUS 'nihil uero' inquit 'magis'.
SCIPIO 'ergo non probares, si consilio pulso libidines, quae sunt innumerabiles,
iracundiaeue tenerent omnia?' LAELIUS 'ego uero nihil isto animo, nihil ita
animato homine miserius ducerem'. SCIPIO 'sub regno igitur tibi esse placet
omnis animi partes, et eas regi consilio?' LAELIUS 'miti uero sic placet'.
SCIPIO 'cor igitur dubitas quid de re publica sentias? in qua si in plures
translata res sit, intellegi iam licet nullum fore quod praesit inperium, quod
quidem nisi unum sit esse nullum potest'.
XXXIX. Tum Laelius: 'quid quaeso interest inter
unum et plures, si iustitia est in pluribus?' et Scipio: 'quoniam testibus meis
intellexi Laeli te non ualde moueri, non desinam te uti teste, ut hoc quod dico
probem'. 'me?' inquit ille LAELIUS 'quonam modo?' SCIPIO 'quia animum aduerti
nuper, cum essemus in Formiano, te familiae ualde interdicere, ut uni dicto
audiens esset'. LAELIUS 'quippe uilico'. SCIPIO 'quid? domi pluresne praesunt
negotiis tuis?' LAELIUS 'immo uero unus' inquit. SCIPIO 'quid? totam domum num
quis alter praeter te regit?' LAELIUS 'minime uero'. SCIPIO 'quin tu igitur
concedis <it>idem in re publica singulorum dominatus, si modo iusti sint, esse
optimos?' LAELIUS 'adducor,' inquit, 'et prope modum adsentior'.
XL. Et Scipio: 'tum magis adsentiare Laeli, si -
ut omittam similitudines, uni gubernatori, uni medico, si digni modo sint iis
artibus, rectius esse alteri nauem committere, aegrum alteri quam multis - ad
maiora peruenero'. LAELIUS 'quaenam ista sunt?' SCIPIO 'quid? tu non uides unius
inportunitate et superbia Tarquinii nomen huic populo in odium uenisse regium?'
LAELIUS 'uideo uero' inquit. SCIPIO 'ergo etiam illud uides, de quo progrediente
oratione plura me dicturum puto, Tarquinio exacto mira quadam exultasse populum
insolentia libertatis; tum exacti in exilium innocentes, tum bona direpta
multorum, tum annui consules, tum demissi populo fasces, tum prouocationes
omnium rerum, tum secessiones plebis, tum prorsus ita acta pleraque ut in populo
essent omnia'. LAELIUS 'est' inquit 'ut dicis'. 'Est uero' inquit Scipio 'in
pace et otio - licet enim lasciuire, dum nihil metuas - ut in naui ac saepe
etiam in morbo leui. sed ut ille qui nauigat, cum subito so mare coepit
horrescere, et ille aeger ingrauescente morbo unius opem inplorat, sic noster
populus in pace et domi imperat et ipsis magistratibus, minatur, recusat,
appellat, prouocat, in bello sic paret ut regi; ualet enim salus plus quam
libido. grauioribus uero bellis es etiam sine collega omne imperium nostri penes
singulos esse uoluerunt, quorum ipsum nomen uim suae potestatis indicat. nam
dictator quidem ab eo appellatur quia
dicitur, sed in nostris libris uides eum Laeli magistrum populi appellari'.
LAELIUS 'uideo' inquit. et Scipio: 'sapienter igitur illi uete<res> (- - -).
XLI. (Scipio.) - - - 'iusto quidem rege cum est
populus orbatus, 'pectora dura tenet desiderium,' sicut ait Ennius, post optimi
regis obitum; - - - simul inter Sese sic memorant: 'o Romule Romule die, Qualem
te patriae custodem di genuerunt! O pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!'
non eros nec dominos appellant eos quibus iuste paruerunt, denique ne reges
quidem, sed patriae custodes, sed patres, sed deos; nec sine causa; quid enim
adiungunt? 'Tu produxisti nos intra luminis oras'. Vitam honorem decus sibi
datum esse iustitia regie existimabant. mansisset eadem uoluntas in eorum
posteris, si regum similitudo permansisset, sed uides unius iniustitia
concidisse genus illud totum rei publicae'. LAELIUS 'uideo uero' inquit 'et
studeo cursus istos mutationum non magis in nostra quam in omni re publica
noscere'.
XLII. Et Scipio: 'est omnino, cum de illo genere
rei publicae quod maxime probo quae sentio dixero, accuratius mihi dicendum de
commutationibus rerum publicarum, etsi minime facile eas in ea re publica
futuras puto. sed huius regiae prima et certissima est illa mutatio: cum rex
iniustus esse coepit, perit illud ilico genus, et est idem ille tyrannus,
deterrimum genus et finitimum optimo; quem si optimates oppresserunt, quod ferme
euenit, habet statum res publica de tribus secundarium; est enim quasi regium,
id est patrium consilium populo bene consulentium principum. sin per se populus
interfecit aut eiecit tyrannum, est moderatior, quoad sentit et sapit, et sua re
gesta laetatur, tuerique uult per se constitutam rem publicam. sin quando aut
regi iusto uim populus attulit regnoue eum spoliauit, aut etiam, id quod euenit
saepius, optimatium sanguinem gustauit ac totam rem publicam substrauit libidini
suae: caue putes aut{em} mare ullum aut flammam esse tantam, quam non facilius
sit sedare quam effrenatam insolentia multitudinem!
XLIII. Tum fit illud quod apud Platonem est
luculente dictum, si modo id exprimere Latine potuero; difficile factu est, sed
conabor tamen. "Cum" enim inquit "inexplebiles populi fauces exaruerunt
libertatis siti, malisque usus ille ministris non modice temperatam sed nimis
meracam libertatem sitiens hausit, tum magistratus et principes, nisi ualde
lenes et remissi sint et large sibi libertatem ministrent, insequitur insimulat
arguit, praepotentes reges tyrannos uocat." puto enim tibi haec esse nota'.
'uero mihi' inquit ille LAELIUS 'notissima'. SCIPIO 'ergo illa sequuntur, "eos
qui pareant principibus agitari ab eo populo et seruos uoluntarios appellari;
eos autem qui in magistratu priuatorum similes esse uelint, eosque priuatos qui
efficiant ne quid inter priuatum et magistratum differat, <ef>ferunt laudibus,
<et> mactant honoribus, ut necesse sit in eius modi re publica plena libertatis
esse omnia, ut et priuata domus omnis uacet dominatione, et hoc malum usque ad
bestias perueniat, denique ut pater filium metuat, filius patrem neclegat, absit
omnis pudor, ut plane liberi sint, nihil intersit ciuis an peregrinus, magister
ut discipulos metuat et iis blandiatur, spernantque discipuli magistros,
adulescentes ut senum sibi pondus adsumant, senes autem ad ludum adulescentium
descendant, ne sint iis odiosi et graues; ex quo fit ut etiam serui se liberius
gerant, uxores eodem iure sint quo uiri, inque tanta libertate canes etiam et
equi, aselli denique libere <sint> sic incurrant ut iis de uia decedendam sit.
ergo ex hac infinita," inquit, "licentia haec summa cogitur, ut ita fastidiosae
mollesque mentes euadant ciuium, ut si minima uis adhibeatur imperii, irascantur
et perferre nequeant; ex quo leges quoque incipiunt neclegere, ut plane sine
ullo domino sint".
XLIV. Tum Laelius: 'prorsus' inquit 'expressa sunt
a te quae dicta sunt ab illo'. SCIPIO 'atque ut iam ad sermonis mei auctorem
reuertar, ex hac nimia licentia, quam illi solam libertatem putant, ait ille ut
ex stirpe quadam existere et quasi nasci tyrannum. nam ut ex nimia potentia
principum oritur interitus principum, sic hunc nimis liberum populum libertas
ipsa seruitute adficit. sic omnia nimia, cum uel in tempestate uel in agris uel
in corporibus laetiora fuerunt, in contraria fere conuertuntur, maximeque <id>
in rebus publicis euenit, nimiaque illa libertas et populis et priuatis in
nimiam seruitutem cadit. itaque ex hac maxima libertate tyrannus gignitur et
illa iniustissima et durissima seruitus. ex hoc enim populo indomito uel potius
immani deligitur aliqui plerumque dux contra illos principes adflictos iam et
depulsos loco, audax, inpurus, consectans proterue bene saepe de re publica
meritos, populo gratificans et aliena et sua; cui quia priuato so sunt oppositi
timores, dantur imperia, et ea continuantur, praesidiis etiam, ut Athenis
Pisistratus, saepiuntur, postremo, a quibus producti sunt, existunt eorum
ipsorum tyranni; quos si boni oppresserunt, ut saepe fit, recreatur ciuitas; sin
audaces, fit illa factio, genus aliud tyrannorum, eademque oritur etiam ex illo
saepe optimatium praeclaro statu, cum ipsos principes aliqua prauitas de uia
deflexit. sic tanquam pilam rapiunt inter se rei publicae statum tyranni ab
regibus, ab iis autem principes aut populi, a quibus aut factiones aut tyranni,
nec diutius unquam tenetur idem rei publicae modus.
XLV. Quod ita cum sit, <ex> tritus primis
generibus longe praestat mea sententia regium, regio autem ipsi praestabit id
quod erit aequatum et temperatum ex tribus primis rerum publicarum modis. placet
enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati
principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res seruatas iudicio uoluntatique
multitudinis. haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam {magnam}, qua
carere diutius uix possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima
facile in contraria uitia conuertuntur, ut exsistat ex rege dominus, ex
optimatibus factio, ex populo turba et confusio; quodque ipsa genera generibus
saepe conmutantur nouis, hoc in hac iuncta moderateque permixta constitutione
rei publicae non ferme sine magnis principum uitiis euenit. non est enim causa
conuersionis, ubi in suo quisque est gradu firmiter collocatus, et non subest
quo praecipitet ac decidat.
XLVI. Sed uereor, Laeli uosque homines amicissimi
ac prudentissimi, ne si diutius in hoc genere uerser, quasi praecipientis
cuiusdam et docentis et non uobiscum simul considerantis esse uideatur oratio
mea. quam ob rem ingrediar in ea quae nota sunt omnibus, quaesita autem a nobis
iam diu. sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam omnium rerum
publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam esse
cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt.
quam, si placet, quoniam ea quae tenebatis ipsi etiam ex me audire uoluistis,
simul et qualis sit et optimam esse ostendam, expositaque ad exemplum nostra re
publica, accommodabo ad eam si potero omnem illam orationem quae est mihi
habenda de optimo ciuitatis statu. quod si tenere et consequi potuero, cumulate
munus hoc, cui me Laelius praeposuit, ut opinio mea fert, effecero'.
XLVII. Tum Laelius: 'tuum uero' inquit 'Scipio, ac
tuum quidem unius. quis enim te potius aut de malorum dixerit institutis, cum
sis clarissimis ipse maioribus? aut de optimo statu ciuitatis? quem si habemus,
etsi ne nunc quidem, tum uero, quis te possit esse florentior? aut de consiliis
in posterum prouidendis? cum tu
duobus huius urbis terroribus depulsis in omne tempus ei prospexeris?' I.
Sic, quoniam plura beneficia continet patria et
est antiquior parens quam is, qui creavit, maior ei profecto quam parenti
debetur gratia.
II. Nec tantum Karthago habuisset opum sescentos
fere annos sine consiliis et disciplina.
III. Cognoscere mehercule, inquit, consuetudinem
istam et studium sermonis.
IV. Profecto omnis istorum disputatio, quamquam
uberrimos fontes virtutis et scientiae continet, tamen collata cum eorum actis
perfectisque rebus vereor ne non tantum videatur attulisse negotii hominibus,
quantam oblectationem. |
279
TRAITÉ
DE LA RÉPUBLIQUE.
LIVRE PREMIER.
I. ... Sans cette vertu, C. Duellius, Aulus Atilius, L. Métellus
n'auraient point délivré Rome de la terreur de Carthage; les deux
Scipions n'auraient point éteint dans leur sang l'incendie de la
seconde guerre Punique, qui jetait ses premières flammes. Quand il
éclata de nouveau plus menaçant et plus vif, ce fléau n'eût pas été
victorieusement combattu par Q. Maximus, étouffé par M. Marcellus;
et des portes de Rome qu'il
280
assiégeait, rejeté par P. l'Africain jusque dans le sein de la cité
ennemie. M. Caton, que nous regardons tous, nous qui marchons sur
ses traces, comme le modèle du citoyen actif et dévoué, pouvait sans
doute, alors qu'il était inconnu et sans nom, goûter les douceurs du
repos dans les champs de Tusculum, sous ce beau ciel et si près de
Rome. Mais il fut assez insensé, si l'on en croit ces partisans de
la mollesse, pour s'exposer jusqu'à son extrême vieillesse, sans que
rien lui en fît un devoir, sur cette mer orageuse des affaires
publiques, et préférer tant d'agitation aux charmes d'une vie
retirée et tranquille. Je pourrais citer un nombre infini d'hommes
qui tous ont rendu à notre patrie des services signalés; mais je me
fais surtout une loi de ne nommer aucun de ceux qui se rapprochent
de notre âge, afin que personne ne puisse se plaindre de mon silence
sur quelqu'un de sa famille ou sur lui-même. Tout ce que je veux
faire entendre, c'est que la nature a fait aux hommes une telle
nécessité de la vertu, et leur a inspiré une si vive ardeur pour la
défense du salut commun, que cette noble impulsion triomphe
facilement de toutes les séductions de la volupté et du repos.
II. Il n'en est pas de la vertu comme d'un art, on ne l'a point si
on ne la met en pratique. Vous pouvez ne pas exercer un art et le
posséder cependant, car il demeure avec la théorie; la vertu est
tout entière dans les œuvres, et le plus grand emploi de la vertu,
c'est le gouvernement des États, et la perfection accomplie, non
plus en paroles, mais en réalité, de toutes ces grandes parties dont
on fait tant de bruit dans la poussière des écoles. Il n'est aucun
précepte de la philosophie, j'entends de ceux qui sont honnêtes et
dignes de l'homme,qui n'ait été quelque part deviné et mis en
pratique par les législateurs des peuples. D'où viennent la piété et
la religion? A qui devons-nous le droit public et les lois civiles?
La justice, la bonne foi, l'équité, et avec elles la pudeur, la
tempérance, cette noble aversion pour ce qui nous dégrade, l'amour
de la gloire et de l'honneur, le courage à supporter les travaux et
les périls, qui donc les a enseignés aux hommes? Ceux-là même qui,
après avoir confié à l'éducation les semences de toutes ces vertus,
ont établi les unes dans les mœurs, et sanctionné les autres par les
lois. On demandait à l'un des plus célèbres philosophes, Xénocrate,
ce que ses disciples gagnaient à ses leçons: «Ce qu'ils y gagnent?
répondit-il; c'est qu'ils apprennent à faire de leur propre
mouvement ce que les lois ordonnent.» Il faut donc en conclure que
celui qui obtient d'un peuple entier, par l'empire salutaire et le
frein des lois, ce que les philosophes peuvent à grand'peine
persuader à quelques auditeurs, doit être mis fort au-dessus de ces
docteurs habiles, malgré tous leurs beaux discours. Quelles
merveilles leur talent peut-il produire, qui soient comparables à un
grand corps social parfaitement établi sur le double fondement des
lois et des mœurs? Autant les grandes villes,» les cités
dominatrices, «comme les appelle Ennius. l'emportent sur les
bourgades et les châteaux forts, autant il me semble que la sagesse
des hommes qui gouvernent ces cités et en règlent les destins,
s'élève au-dessus d'une doctrine conçue loin du monde et du jour des
affaires. Ainsi donc, puisque notre plus grande ambition est de
servir la cause du genre humain; puisque nos pensées et nos efforts
n'ont véritablement qu'un seul but, donner à la
281 vie de. l'homme plus de
sécurité et en accroître les ressources; puisque la nature elle-même
nous donne un si généreux élan, poursuivons cette carrière, où nous
voyons devant nous tout ce que le monde a compté d'hommes
excellents, et n'écoutons point ces efféminés qui sonnent la
retraite, et voudraient rappeler ceux que leur ardeur a déjà
emportés.
III. A ces raisons si certaines et si évidentes, qu'opposent les
philosophes que je combats? D'abord les rudes travaux sans lesquels
ou ne peut servir son pays; obstacle bien peu fait pour arrêter un
homme vigilant et actif, obstacle méprisable non-seulement au prix
de tels intérêts, mais même dans la poursuite des biens de l'esprit
les moins relevés, dans l'accomplissement des devoirs les moins
importants, dans les affaires les plus simples. Ils parlent ensuite
des périls que l'on court sans cesse, et cherchent à inspirer aux
hommes de cœur cette terreur de la mort qui retient les lâches,
oubliant que les hommes de cette trempe regardent comme un plus
grand malheur d'être lentement consumés et de s'éteindre de
vieillesse, que de faire à la patrie, dans une belle occasion, le
sacrifice de cette vie, que tôt ou tard il eût fallu rendre à la
nature. Mais où croient triompher ces philosophes paresseux? c'est
quand ils rassemblent toutes les infortunes des grands hommes, et
les traitements indignes que leur a fait souffrir l'ingratitude de
leurs concitoyens. La Grèce leur fournit plus d'un douloureux
exemple: Miltiade, victorieux des Perses anéantis par ses armes, la
poitrine encore saignante des blessures qu'il a reçues au milieu de
son éclatante victoire, trouve dans les prisons d'Athènes la mort
qui l'avait épargné sur le champ de bataille; Thémistocle, proscrit
par le peuple qu'il a sauvé, craignant pour ses jours, vient
chercher un asile non dans les ports de la Grèce, dont il est le
libérateur, mais sur les rivages des Barbares que ses armes ont
moissonnés. Les exemples de l'inconstance des Athéniens et de leur
cruauté envers leurs plus grands hommes sont innombrables;
l'ingratitude a pris en quelque façon naissance chez eux, et partout
nous en voyons les marques; mais dans Rome même, dans l'histoire de
cette grave cité, ne les retrouvons-nous pas à chaque pas? On cite
alors l'exil de Camille, la haine qui poursuivait Ahala,
l'impopularité de Nasica, la proscription de Lénas, la condamnation
d'Opimius, la fuite de Métellus, Marius et son affreux destin, les
chefs de l'État immolés, et les maux terribles qui bientôt après
désolèrent notre patrie. Il n'y a pas jusqu'à mon nom qui ne soit
invoqué: et parce que ces amis de la paix croient sans doute qu'au
prix de mes veilles et de mes périls j'ai protégé leur vie et
garanti leur repos, ils me plaignent avec plus d'effusion et de
sympathie que pas un autre. Mais moi, je ne puis comprendre comment
des hommes qui, pour s'instruire et voir le monde, traversent les
mers ......
(Il manque deux pages au manuscrit.)
IV Lorsqu'au sortir de mon consulat, je pus déclarer avec serment,
devant Rome assemblée, que j'avais sauvé la république, alors que le
peuple entier répéta mon serment, j'éprouvai assez de bonheur pour
être dédommagé à la fois de toutes les injustices et de toutes les
infortunes. Cependant j'ai trouvé dans mes malheurs mêmes plus
d'honneur que de peine, moins d'amertume que de gloire; et les
regrets des gens de bien ont plus réjoui mon cœur que la joie des
méchants ne l'avait attristé. Mais, je le répète, si ma dis-
282 grâce avait eu un dénoûment
moins heureux, de quoi pourrais-je me plaindre? J'avais tout prévu,
et je n'attendais pas moins pour prix de mes services. Quelle avait
été ma conduite? La vie privée m'offrait plus de charmes qu'à tout
autre, car je cultivais depuis mon enfance les études libérales, si
variées, si délicieuses pour l'esprit: qu'une grande calamité vînt à
nous frapper tous, du moins ne m'eût-elle pas plus particulièrement
atteint, le sort commun eût été mon partage: eh bien! je n'avais pas
hésité à affronter les plus terribles tempêtes, et, si je l'ose
dire, la foudre elle-même, pour sauver mes concitoyens, et à dévouer
ma tête pour le repos et la liberté de mon pays. Car notre patrie ne
nous a point donné les trésors de la vie et de l'éducation pour ne
point en attendre un jour les fruits, pour servir sans retour nos
propres intérêts, protéger notre repos et abriter nos paisibles
puissances; mais pour avoir un titre sacré sur toutes les meilleures
facultés de notre âme, de notre esprit, de notre raison, les
employer à la servir elle-même, et ne nous en abandonner l'usage
qu'après en avoir tiré tout le parti que ses besoins réclament.
V. Ceux qui veulent jouir sans discussion d'un repos inaltérable
recourent à des excuses qui ne méritent pas d'être écoutées: Le plus
souvent, disent-ils, les affaires publiques sont envahies par des
hommes indignes, à la société desquels il serait honteux de se
trouver mêlé, avec qui il serait triste et dangereux de lutter,
surtout quand les passions populaires sont en jeu; c'est donc une
folie que de vouloir gouverner les hommes, puisqu'on ne peut dompter
les emportements aveugles et terribles de la multitude; et c'est se
dégrader que de descendre dans l'arène avec des adversaires sortis
de la fange, qui n'ont pour toutes armes que les injures, et tout
cet arsenal d'outrages qu'un sage ne doit pas supporter. Comme si
les hommes de bien, ceux qui ont un beau caractère et un grand cœur
pouvaient jamais ambitionner le pouvoir dans un but plus légitime
que celui de secouer le joug des méchants, et ne point souffrir
qu'ils mettent en pièces la république, qu'un jour les honnêtes gens
voudraient enfin, mais vainement, relever de ses ruines.
VI. Ils nous accordent une exception, il est vrai, mais qui ne peut
faire passer leur système; le sage ne doit, selon eux, se mêler
d'affaires publiques que s'il y est contraint par la nécessité et
clans des circonstances éminemment critiques. Y eut-il jamais, je le
demande, de circonstances plus critiques que celles où je me trouvai
moi-même? et dans ces circonstances qu'aurais-je pu faire, si je
n'avais été consul? et le titre de consul, comment aurais-je pu
l'obtenir, si je ne m'étais dès mon enfance avancé dans cette
carrière qui m'a conduit par degrés, moi obscur chevalier romain, à
cet honneur suprême? Vous ne pouvez donc venir au secours de votre
patrie, quand vous le souhaitez, dans une circonstance critique,
dans un danger pressant, si vous n'êtes déjà en position de la
servir. Ce que j'admire surtout dans les écrits de ces philosophes,
c'est que des hommes qui sur une mer calme ne croiraient pas pouvoir
servir de pilotes, parce qu'ils n'ont pas appris l'art de tenir le
gouvernail, déclarent qu'ils sont tout prêts à conduire un vaisseau
au milieu des tempêtes. Ils disent fort ouvertement qu'ils n'ont
jamais appris et qu'ils
283
n'enseignent pas l'art de constituer et de gouverner les États; ils
le disent et s'en font gloire; ils soutiennent que ce n'est pas là
l'affaire des savants ni des sages, et qu'il faut laisser ce soin!
aux politiques. Mais alors pourquoi promettre de prêter leur secours
à l'État, si la nécessité les y contraint? pourquoi, lorsqu'ils
avouent qu'ils seraient incapables de prendre part aux affaires
publiques dans les temps ordinaires, et sans comparaison plus
faciles? Mais entrons dans leurs vues; admettons que le sage ne
descendra; pas volontairement à s'occuper des intérêts de l'État,
mais que si les circonstances l'y obligent jamais, il ne reculera
point devant le fardeau qu'elles lui imposeront: je dis qu'alors
même le sage ne doit point négliger l'étude de la politique, car il
est de son devoir de se préparer à toutes les ressources dont il
ignore s'il ne sera pas un jour obligé de faire usage.
VII. Si je me suis étendu sur ce sujet, c'est que me proposant de
traiter de la République dans cet ouvrage, et ne voulant pas faire
un livre inutile, je devais avant tout lever tous les doutes sur
l'excellence de la vie publique. S'il est des esprits qui aient
besoin pour se rendre de l'autorité des philosophes, qu'ils jettent
les yeux sur les écrits de ceux qui tiennent la première place dans
l'estime des meilleurs juges, et dont la gloire est incomparable;
ils verront ce que pensent ces grands maîtres, qui tous n'ont pas eu
des États à gouverner, mais qui, méditant et écrivant avec tant
d'ardeur sur les sociétés humaines, me semblent avoir exercé par là
quelque importante magistrature. Quant aux sept sages dont la Grèce
s'honore, je les vois presque tous engagés dans les affaires
publiques. C'est qu'en effet l'homme ne se rapproche jamais plus de
la Divinité que lorsqu'il fonde des sociétés nouvelles, ou conduit
heureusement celles qui déjà sont établies.
VIII. Pour nous, nous avons peut-être plus d'un titre à entreprendre
cet ouvrage; car nous réunissons le double avantage d'avoir signalé
notre carrière politique par quelque fait digne de mémoire, et
acquis par l'expérience, par l'étude et l'usage constant de
communiquer nos connaissances, une certaine facilité à traiter ces
matières délicates; tandis que ceux qui nous ont ouvert la carrière
ont tous été ou d'élégants écrivains, dont on ne pourrait citer
aucune action mémorable, ou des politiques habiles, mais étrangers à
l'art d'écrire. D'ailleurs mon intention n'est pas de développer ici
un nouveau système politique éclos de mon imagination, mais de
rapporter en narrateur fidèle, et tel que nous l'avons entendu de la
bouche de P. Rutilius Rufus, lorsque nous passâmes, vous et moi,
vous bien jeune alors, plusieurs jours à Smyrne, l'entretien de
quelques anciens Romains, les plus illustres de leur temps et les
plus sages de notre république. Dans cet entretien se trouve
rassemblé, à ce que je crois, tout ce qui a un rapport essentiel aux
intérêts et au gouvernement des États.
IX. On était alors sous le consulat de Tuditanus et d'Aquillius;
Publius l'Africain, le fils de Paul Émile, avait décidé qu'il
passerait les féries Latines dans ses jardins, et ses plus intimes
amis lui avaient promis de venir le voir souvent pendant ces jours
de fêtes. Le premier luisait à peine, que
284 Q. Tubéron, son neveu,
devançant tous les autres, se présente. Scipion, charmé de le voir
et lui faisant un aimable accueil: Eh quoi! mon cher Tubéron, lui
dit-il, vous si matin chez moi! ces jours de repos vous offraient
cependant une belle occasion de vous livrer à vos études favorites.
— J'ai tout le temps d'être avec mes livres, répondit Tubéron, car
personne ne me les dispute; mais c'est une bonne fortune que de vous
trouver de loisir, surtout à une époque orageuse comme celle-ci. —
De loisir, je le veux bien; mais je vous avoue que vous me trouvez
plus libre de corps que d'esprit. — Cependant, reprit Tubéron, il
faudra bien que vous donniez aussi quelque relâche à votre esprit;
car nous sommes plusieurs qui avons formé le dessein, si notre
empressement ne vous est pas importun, de venir goûter dans votre
société le repos que les fériés nous donnent. — Ce me sera une
distraction fort agréable, et j'espère qu'elle nous rendra pour un
temps aux douces préoccupations de la science.
X. — Voulez-vous donc, Scipion, puisque vous m'encouragez et me
donnez l'espoir de vous entendre, que nous examinions ensemble,
avant l'arrivée de nos amis, ce que ce peut être que ce second
soleil dont on a annoncé l'apparition au sénat? Ceux qui déclarent
avoir vu deux soleils sont nombreux et méritent confiance; il ne
peut être question de contester ce prodige; le mieux, selon moi, est
de chercher à l'expliquer. — Que n'avons-nous ici, dit alors
Scipion, notre ami Panétius, qui étudie avec tant d'ardeur tous les
secrets de la nature, et surtout ces phénomènes célestes! Mais, à
vrai dire, Tubéron, car je veux vous déclarer franchement ce que je
pense, pour toutes ces questions mystérieuses je ne m'en rapporte
pas aveuglément à notre confiant ami; bien des choses qu'il est déjà
très-hardi de conjecturer, Panétius les affirme avec tant
d'assurance qu'il semble les voir de ses yeux ou les toucher de ses
mains. Cette témérité me fait mieux apprécier toute la sagesse de
Socrate, qui s'était interdit ces recherches curieuses, et avait
pour maxime que la découverte des secrets de la nature excède la
portée de notre esprit, et n'est absolument d'aucun intérêt pour la
vie humaine. — Je ne sais, reprit Tubéron, pourquoi l'opinion s'est
répandue que Socrate proscrivait toutes les recherches physiques et
ne s'occupait que de morale. Qui peut nous faire connaître Socrate
avec autant d'autorité que Platon? et ne voyons-nous pas dans les
dialogues du disciple le maître parler en plus de vingt endroits non
pas seulement des mœurs, des vertus, de la république, mais des
nombres de la géométrie divine, de l'harmonie des sphères, à
l'exemple de Pythagore? — Je suis loin de contester ce que vous
dites, Tubéron; mais vous devez savoir qu'après la mort de Socrate,
Platon, emporté par l'amour de la science, alla d'abord en Égypte,
et vint plus tard en Italie et en Sicile pour s'instruire dans la
doctrine de Pythagore; vous savez qu'il eut de fréquents entretiens
avec Archytas de Tarente et Timée de Locres, qu'il recueillit tous
les ouvrages de Philolaüs, et que dans ces contrées, que remplissait
à cette époque la renommée de Pythagore, il se livra aux hommes de
cette école et à leurs études favorites. Mais comme il avait voué un
culte exclusif à Socrate et qu'il voulait lui faire honneur de
toutes les richesses de son esprit, il unit avec art la grâce
Socratique et son habile dialectique aux dogmes obscurs et aux
graves enseignements de Pythagore.
XI. A peine Scipion avait-il prononcé ces der-
285 niers mots, qu'il vit entrer
L. Furius; il le salua, le prit amicalement par la main, et le fit
asseoir près de lui. P. Rutilius, celui qui nous a rapporté cet
entretien, arrivait en même temps. Scipion, après les premiers
compliments, lui fit prendre place près de Tubéron. De quoi
parliez-vous? dit alors Furius; est-ce que notre brusque arrivée
aurait mis fin à votre conversation? — Nullement, répondit Scipion;
car la question que Tubéron avait soulevée entre nous est de celles
qui ont d'ordinaire le privilège de vous intéresser vivement. Et
quant à Rutilius, je me souviens que sous les remparts mêmes de
Numance il proposait parfois des sujets semblables à nos entretiens.
— Mais enfin, de quoi était-il question? demanda Philus. — De ces
deux soleils dont tout le monde parle, dit Scipion; et j'aurais
grande envie de savoir ce que vous-même pensez de ce prodige.
XII. A cet instant, un esclave vint annoncer que Lélius sortait de
chez lui et se dirigeait vers les jardins de Scipion. Celui-ci se
lève, met à la hâte sa chaussure et une toge, et sort de son
appartement; après avoir fait quelques pas sous le portique, il
rencontre et reçoit Lélius, et avec lui Spurius Mummius, pour qui il
avait une tendresse particulière; G. Fannius et Q. Scévola, tous
deux gendres de Lélius, jeunes gens d'un esprit fort cultivé, et qui
déjà avaient atteint l'âge de la questure. Scipion fait accueil à
chacun, puis il se retourne pour les conduire, en ayant soin de
laisser la place du milieu à Lélius. C'était en effet comme une
convention sacrée de leur amitié, que dans les camps Lélius honorât
Scipion comme un dieu, à cause de sa grande gloire militaire, et
qu'une fois les armes déposées, Scipion à son tour témoignât le
respect d'un fils à Lélius, qui avait plus d'âge que lui. Toute la
société fit d'abord un ou deux tours sous le portique, en échangeant
quelques paroles de bienvenue. Bientôt Scipion, qui était heureux et
charmé de l'arrivée de ces hôtes, leur offrit de venir se reposer à
l'endroit de la prairie le plus exposé au soleil, car on était alors
en hiver. Ils se rendaient à son invitation, lorsque survint un
habile jurisconsulte, M. Manilius, qui leur était cher et agréable à
tous; Scipion et la société le reçurent avec un empressement
affectueux, et il alla prendre place auprès de Lélius.
XIII. Je ne crois pas, dit alors Philus, que l'arrivée de nos amis
doive nous faire changer d'entretien; la seule obligation qu'elle
nous impose, c'est de traiter le sujet avec le plus grand soin, et
de nous montrer dignes d'un tel auditoire. — Quel est donc ce sujet,
demanda Lélius, et quelle conversation avons-nous interrompue? —
Scipion me demandait, dit Philus, ce que je pensais de l'apparition
incontestable d'un second soleil. —
Lélius. Eh quoi!
Philus,sommes-nous assez édifiés sur ce qui se passe chez nous ou
dans la république, pour nous mettre ainsi en quête des phénomènes
célestes? — Philus.
Croyez-vous donc, Lélius, que nos intérêts les plus chers ne
demandent pas que nous sachions ce qui se passe dans notre propre
demeure? Mais la demeure de l'homme n'est pas renfermée dans
l'étroite enceinte d'une maison; elle est aussi vaste que le monde,
cette patrie que les Dieux ont voulu partager avec nous. Et
d'ailleurs, si nous ignorons ce qui se passe dans les cieux, combien
de vérités, que de choses importantes nous seront éternellement
cachées! Pour moi du moins,
286
et je puis dire hardiment pour vous aussi, Lélius, et pour tous les
vrais amis de la sagesse, étudier la nature, approfondir ses
mystères, est une source de plaisirs inexprimables. —
Lélius. Je ne m'oppose
pas à ces bel les spéculations, surtout un jour de fête; mais
pouvons-nous encore vous entendre, ou sommes-nous arrivés trop tard?
— Phi. Nous n'avions
pas même commencé; le champ est entièrement libre, et je suis tout
prêt, Lélius, à vous céder la parole. —
Lél. Il vaut bien mieux
vous entendre; à moins toutefois que Manilius ne veuille, en
jurisconsulte consommé, régler le litige entre les deux soleils, et
assigner à chacun la possession définitive d'une partie du ciel. —
Manilius. Vous ne
cesserez donc pas, Lélius, de tourner en raillerie un art dans
lequel vous excellez vous-même, et dont les lumières sont
indispensables à l'homme pour qu'il sache quel est son droit, quel
est le droit d'autrui? Tout n'est pas dit là-dessus entre nous; mais
pour le moment écoutons Philus, que l'on consulte, à ce que je vois,
sur des matières plus graves que celles qui nous exercent
d'ordinaire, Mucius et moi.
XIV. Ce que je vous dirai, reprit Philus, n'est pas nouveau; je n'en
suis pas l'inventeur et ma mémoire seule en fera les frais. Je me
souviens que C. Sulpicius Gallus, un des plus savants hommes de
notre pays, comme vous ne l'ignorez pas, s'étant rencontré par
hasard chez M. Marcellus, qui naguère avait été consul avec lui, la
conversation tomba sur un prodige exactement semblable; et que
Gallus fit apporter cette fameuse sphère, seule dépouille dont
l'aïeul de Marcellus voulut orner sa maison après la prise de
Syracuse, ville si pleine de trésors et de merveilles. J'avais
souvent entendu parler de cette sphère qui passait pour le
chef-d'œuvre d'Archimède, et j'avoue qu'au premier coup d'œil elle
ne me parut pas fort extraordinaire. Marcellus avait déposé dans le
temple de la Vertu une autre sphère d'Archimède, plus connue du
peuple et qui avait beaucoup plus d'apparence. Mais lorsque Gallus
eut commencé à nous expliquer, avec une science infinie, tout le
système de ce bel ouvrage, je ne pus m'empêcher de juger qu'il y
avait eu dans ce Sicilien un génie d'une portée à laquelle la nature
humaine ne me paraissait pas capable d'atteindre. Gallus nous disait
que l'invention de cette autre sphère solide et pleine remontait
assez haut, et que Thaïes de Milet en avait exécuté le premier
modèle; que dans la suite Eudoxe de Cnide, disciple de Platon, avait
représenté à sa surface les diverses constellations attachées à la
voûte du ciel; et que, longues années après, Aratus, qui n'était pas
astronome, mais qui avait un certain talent poétique, décrivit en
vers tout le ciel d'Eudoxe. Il ajoutait que, pour figurer les
mouvements du soleil, de la lune et des cinq étoiles que nous
appelons errantes, il avait fallu renoncer à la sphère solide,
incapable de les reproduire, et en imaginer une toute différente;
que la merveille de l'invention d'Archimède était l'art avec lequel
il avait su combiner dans un seul système et effectuer par la seule
rotation tous les mouvements dissemblables et les révolutions
inégales des différents astres. Lorsque Gallus mettait la sphère en
mouvement, on voyait à chaque tour la lune succéder au soleil dans
l'horizon terrestre, comme elle lui succède tous les jours dans le
ciel; on voyait par conséquent, le soleil disparaître comme
287 dans le ciel, et peu à peu la
lune venir se plonger dans l'ombre de la terre, au moment même où le
soleil du côté opposé
(Il manque ici huit pages dans le manuscrit, selon Angelo Mai.)
XV. ...... Scipion. J'étais moi-même fort attaché à Gallus, et je
savais que PauL.Émile, mon père, l'avait singulièrement apprécié et
beaucoup aimé. Je me souviens que dans ma première jeunesse, lorsque
mon père commandait les armées romaines en Macédoine, une nuit que
nous étions dans les camps, toutes nos légions furent frappées d'une
terreur religieuse, parce que la lune, alors dans tout son éclat,
s'était soudainement obscurcie. Gallus, qui dans cette campagne
était le lieutenant de mon père, une année environ avant son
consulat, n'hésita pas à déclarer le lendemain aux légions qu'il n'y
avait eu aucun prodige, que ce phénomène était dans l'ordre de la
nature et se reproduirait à des époques réglées, toutes les fois que
le soleil se trouverait situé de manière à ne pouvoir éclairer la
lune de ses rayons. — Mais c'est une vraie merveille, dit Tubéron;
comment Gallus A.t-il pu faire comprendre cette explication à des
hommes grossiers? comment A.t-il osé braver la superstition de ces
soldats ignorants? — II l'a fait, reprit Scipion, et avec une
grande......
(Il manque ici deux pages au moins, selon Angelo Mai.)
...... Point de vaine ostentation, point de langage indigne d'un
homme grave; et ce n'était pas un médiocre succès que d'affranchir
ces esprits troublés et superstitieux de leur folle terreur.
XVI. Il arriva quelque chose d'assez semblable pendant la longue
guerre que se firent les Athéniens et les Lacédémoniens avec un si
terrible acharnement. On nous rapporte que Périclès, qui par son
crédit, son éloquence et son habile politique, était devenu le chef
d'Athènes, voyant ses concitoyens consternés d'une éclipse de soleil
qui les avait plongés dans des ténèbres subites, leur expliqua ce
qu'il avait appris lui-même de son maître Anaxagore, qu'un pareil
phénomène est dans l'ordre de la nature et se reproduit à des
époques déterminées, lorsque le disque de la lune s'interpose tout
entier entre le soleil et nous; et que s'il n'est pas amené à chaque
renouvellement de la lune, il ne peut toutefois avoir lieu qu'à
l'époque précise où la lune se renouvelle. Périclès décrivit aux
Athéniens tous ces mouvements astronomiques; il leur en fit
comprendre la raison, et dissipa leur terreur; l'explication des
éclipses de soleil par l'interposition de la lune était alors assez
nouvelle et peu répandue. Thaïes de Milet est, dit-on, le premier
qui la proposa. Plus tard elle ne fut pas inconnue à notre poète
Ennius, puisqu'il dit que vers l'an 350 de la fondation de Rome,
«aux nones de juin, le soleil fut dérobé aux hommes par la lune et
les ténèbres.» Aujourd'hui l'habileté des astronomes et la justesse
de. leurs calculs vont si loin, qu'à partir de ce jour, indiqué par
Ennius et consigné dans les Grandes Annales, ils ont supputé toutes
les éclipses de soleil antérieures jusqu'à celle des nones de
juillet, arrivée dans le règne de Romulus, et qui répandit sur la
terre cette nuit soudaine pendant laquelle le fondateur de Rome,
enlevé au monde, subit probablement la loi commune, mais put aux
yeux du vulgaire passer pour avoir été ravi au ciel par sa vertu
surhumaine.
XVII. Tubéron l'interrompit: Ne voyez-vous
288 pas, Scipion, que malgré le
sentiment que vous exprimiez tout à l'heure
(Il manque deux pages au manuscrit.)
Scip.
Mais qu'est-ce que tout l'éclat des choses humaines, comparé aux
magnificences de ce royaume des Dieux? qu'est-ce que leur durée au
prix de l'éternité? Et la gloire, qu'est-elle pour celui qui a vu
combien la terre est petite, et encore quelle faible portion de sa
surface est habitée par les hommes; qui a su comprendre la vanité de
ces pauvres humains, perdus dans un imperceptible canton du monde, à
tout jamais inconnus à des peuples entiers, et qui croient que
l'univers va retentir du bruit de leur nom? Qu'est-ce que tous les
biens de cette vie, pour celui qui ne consent pas même à regarder
comme biens, ni champs, ni maisons, ni troupeaux, ni trésors, parce
qu'il en trouve la jouissance médiocre, l'usage fort restreint, la
possession incertaine, et que souvent les derniers hommes ont toutes
ces richesses à profusion? Qui peut se dire véritablement heureux en
ce monde? n'est-ce pas celui qui seul peut se reconnaître le maître
souverain de toutes choses, non pas en vertu du droit civil, mais au
nom du beau privilège des sages; non par un contrat tout couvert de
formules, mais par la loi de nature, qui n'admet pour possesseurs
des choses que ceux qui savent s'en servir? celui qui voit dans le
commandement des armées, dans le consulat lui-même, des charges à
accepter par patriotisme, et non des titres à ambitionner, de graves
obligations à remplir, et non des honneurs ou de brillants avantages
à poursuivre; qui peut enfui comme Scipion mon aïeul, au rapport de
Caton, se rendre ce témoignage, qu'il n'est jamais plus actif que
lorsqu'il ne fait rien, et jamais moins seul que dans la solitude?
Qui pourrait croire en effet que Denys, détruisant par ses menées
infatigables la liberté de sa patrie, accomplissait une plus grande
œuvre qu'Archimède son concitoyen, inventant dans son apparente
inaction cette sphère dont nous parlions tout à l'heure? L'homme
qui, au milieu de la foule, et en plein forum, ne trouve personne
avec qui il lui soit agréable d'échanger ses pensées, n'est-il pas
plus seul que celui qui, sans témoin, s'entretient avec lui-même,
ou, se transportant dans la société des sages, converse avec eux,
étudie avec délices leurs découvertes et leurs écrits? Pouvez-vous
imaginer un mortel plus riche que celui à qui rien ne manque de ce
que la nature réclame; plus puissant que celui qui vient à bout de
tout ce qu'il désire; plus heureux que celui dont l'âme n'est agitée
par aucun trouble; ou possédant une fortune plus solide que celui
qui pourrait, suivant le proverbe, retirer avec lui tous ses trésors
du naufrage? Est-il un commandement, une magistrature, une couronne
comparable à la grandeur de l'homme qui regardant de haut toutes les
choses humaines, et n'accordant de prix qu'à la sagesse,
n'entretient sa pensée que d'objets éternels et divins? Il sait de
science certaine que si rien n'est plus commun que le nom d'homme,
ceux-là seuls devraient le porter qui ont reçu cette culture sans
laquelle il n'est point d'homme. Et, ace propos, il me revient un
mot fort heureux de Platon, ou peut-être de quelque autre
philosophe. La tempête l'avait jeté sur une plage inconnue et
déserte; tandis que ses compagnons d'infortune étaient effrayés de
ne pas savoir en quel lieu ils se trouvaient, il aperçut, dit-on,
des figures de géométrie tracées sur le sable: «Bon courage,
289 s'écriA.t-il, je vois ici des
vestiges humains!» Et à quoi les reconnaissait-il? Ce n'était
certainement pas à la culture de la terre, mais aux traces d'une
meilleure culture, celle de l'esprit. Voilà pourquoi, Tubéron, j'ai
toujours eu tant de goût pour la science et les savants, et en
particulier pour vos études favorites.
XVIII. Lélius adressant alors la parole à Scipion: Je n'oserais rien
objecter à ce que vous venez de dire; et c'est beaucoup moins vous,
ou Philus, ou Manilius......
(Il manque ici deux pages au manuscrit.)
...... Nous avons eu dans la famille de Tubéron un ami bien digne de
lui servir de modèle, «Élius Sextus, cet homme de tant de
sens et de finesse;» fin et sensé vraiment, et bien nommé par
Ennius, non qu'il se creusât l'esprit à chercher ce qu'on ne peut
découvrir, mais parce qu'il donnait à ceux qui l'interrogeaient des
réponses qui leur soulageaient l'esprit et les tiraient d'affaire.
Il livrait à l'astronomie de Gallus de rudes combats, et il avait
toujours à la bouche ces vers d'Achille dans Iphigénie: «Tous ces
astronomes étudient les mouvements de leurs constellations; c'est
Jupiter, c'est la Chèvre, c'est le Scorpion et je ne sais quelle
autre bête dont ils veulent voir surgir les cornes; ils ne voient
point ce qui est a leurs pieds, et ils veulent lire dans les cieux.»
Ëlius, que j'écoutais souvent et avec grand plaisir, disait encore
que le Zéthus de Pacuvius lui paraissait trop ennemi de la science;
il goûtait davantage le Néoptolème d'Ennius, qui veut bien
philosopher, mais doucement, car trop ne lui saurait plaire. Si
cependant les études des Grecs ont tant de charmes pour vous, il en
est de moins abstraites qui conviennent à un plus grand nombre
d'esprits, et qui ont au moins une utilité pratique, soit pour notre
conduite morale, soit pour le gouvernement des États. Quant aux
sciences dont nous parlions, si elles sont bonnes à quelque chose,
ce ne peut être qu'à exercer et aiguiser un peu l'esprit des jeunes
gens, pour les rendre capables de travaux plus sérieux.
XIX. Tubébon. Je
partage votre sentiment, Lélius; mais ces études plus sérieuses,
quelles sont-elles dans votre pensée? —
Lél. Je vais vous le
dire; mais je crains fort de m'exposer à vos dédains, car c'est
vous, je me le rappelle, qui avez proposé à Scipion cette question
sur un phénomène céleste, tandis que dans mon opinion il est bien
plus important de nous occuper de ce qui est devant nos yeux. Eh
quoi! le petit-fils de PauL.Émile, le neveu de Scipion l'Africain,
le membre d'une si noble famille, le citoyen d'une si grande
république, demande pourquoi l'on a vu deux soleils, et ne demande
pas pourquoi nous voyons aujourd'hui dans un seul État deux sénats
et presque deux peuples? Vous en êtes témoins comme moi, la mort de
Tibérius Gracchus, et auparavant tous les actes de son tribunal, ont
divisé le peuple romain en deux camps: les détracteurs et les
envieux de Scipion, enrôlés d'abord sous la bannière de P. Crassus
et d'Appius Claudius, n'en continuent pas moins, après la mort de
ces deux chefs, à entretenir l'hostilité d'une partie du sénat
contre nous, Métellus et Mucius en tête; les alliés se remuent, les
Latins se soulèvent; on viole les traités; des triumvirs
290 séditieux nous font voir
chaque jour des nouveautés étranges; les gens de bien sont menacés
dans leurs fortunes, de toutes parts il n'y a que périls: un homme,
un homme seul pourrait les conjurer, mais on ne veut pas qu'il sauve
son pays. Ainsi donc, jeunes gens, si vous m'en croyez, ne vous
mettez pas en peine de ce second soleil: ou c'est une apparition
trompeuse, ou c'est un prodige dont nous n'avons rien à redouter;
n'espérez pas qu'il nous soit jamais donné de découvrir ces
mystères, ou que leur découverte puisse nous rendre meilleurs ni
plus heureux: mais l'unité du sénat, la concorde dans le peuple,
voilà ce qui est possible, voilà ce dont la perte est une calamité
publique; nous savons, nous voyons que cette calamité afflige Rome,
et qu'en réunissant nos efforts, nous pouvons renaître à la vertu et
au bonheur.
XX. Mucius. Que
devons-nous donc apprendre, Lélius, pour être capables de faire ce
que vous demandez? — Lél.
L'art de la politique, qui nous rend utiles à notre pays; car
c'est là, selon moi, le plus magnifique emploi de la sagesse, la
plus grande marque de la vertu, et le premier devoir de la vie.
Ainsi, pour consacrer ces jours de fêtes aux entretiens qui peuvent
être le plus profitables à notre chère patrie, prions Scipion de
nous expliquer quelle est, à ses yeux, la meilleure forme de
gouvernement. Nous examinerons ensuite d'autres questions, et
lorsqu'elles seront suffisamment éclaircies, nous reviendrons,
j'espère, par une voie naturelle, au grave sujet qui nous
préoccupait à l'instant, et nous pourrons porter un jugement certain
sur l'état critique où Rome est tombée.
XXI. Philus, Manilius et Mummius se joignirent avec empressement à
Lélius...... (Il manque deux pages au manuscrit.)
...
Comme si un autre ne pouvait tracer ici le modèle d'une autre
république. (Diomède, liv. i) ......
...... Ainsi donc, nous vous en prions, faites descendre votre
discours du ciel sur cette terre qui nous porte (Nonius, ii, 126;
iv, 143.) ......
Lél.
Si je me suis adressé à vous, c'est d'abord parce qu'il appartient
naturellement au premier citoyen de l'État de parler de la
république, en second lieu parce que je me souvenais que vous aviez
eu de fréquents entretiens sur cette matière avec Panétius et devant
Polybe, deux des plus profonds politiques de toute la Grèce; et
qu'après maintes observations et réflexions, vous en étiez venu à
conclure que de toutes les formes de gouvernement, celle que nous
ont laissée nos ancêtres est incomparablement la meilleure. Préparé
comme vous l'êtes sur cet important sujet, vous nous ferez à tous,
car je puis répondre pour nos amis, un vrai plaisir en nous
expliquant ce que vous pensez de la constitution et de la conduite
des États.
XXII. Je dois avouer, Lélius,qu'aucun sujet de méditation n'a plus
assidûment et plus vivement exercé mon esprit que celui même qui
m'est aujourd'hui proposé par vous. Aussi bien, quand je vois dans
toutes les carrières ceux qui sortent de la foule n'avoir d'autre
pensée, d'autre soin, d'autre rêve que d'exceller dans leur genre,
ne serais-je pas convaincu d'une inertie coupable, moi dont l'unique
carrière, toute tracée par l'exemple de mon père et de mes aïeux,
est de veiller aux intérêts publics et de conduire les affaires de
l'État, si je consacrais au premier de tous les arts moins de
veilles et de soins que le plus humble des artisans n'en donne à son
mé- 290 tier? Mais je ne suis
point satisfait des ouvrages politiques que nous ont laissés les
plus grands philosophes et les plus beaux génies de la Grèce; et,
d'un autre côté, je n'ose préférer mes propres idées à leurs
systèmes. Écoutez-moi donc, je vous prie, non comme un homme à qui
les livres des Grecs seraient entièrement inconnus, ou comme un
esprit entêté de leurs théories,et commettant la faute, surtout en
politique, de les préférer à nos antiques maximes, mais comme un
Romain, qui doit à la sollicitude de son père une éducation
libérale, qui est enflammé depuis son enfance du désir d'apprendre,
et que l'expérience et les enseignements domestiques ont formé bien
plus que les livres.
XXIII. Phil. Je suis
convaincu, Scipion, qu'il est impossible d'avoir un génie plus
heureux que le vôtre, et que pour l'expérience des grandes affaires
politiques personne ne vous égale; nous savons d'ailleurs quelle a
toujours été votre ardeur pour l'étude. Aussi dès que vous nous
donnez l'assurance que vos méditations se sont portées sur l'art
difficile et sur les théories dont nous parlons, je ne puisque
remercier Lélius du fond de mon cœur; car j'ai l'espérance que votre
entretien nous instruira plus que ne feraient jamais tous les livres
des Grecs. — Scipion.
Vous promettez à l'avance des merveilles de mon discours. Savez-vous
bien que c'est là mettre dans une position difficile celui qui doit
parler de grandes choses? —
Phil. Quelle que soit notre attente. vous la surpasserez,
comme c'est votre usage; et il n'est pas à craindre que vous,
Scipion, en parlant de la république sentiez tarir vos idées.
XXIV. Scip. J'essaierai
donc de répondre à vos désirs dans la mesure de mes forces; et, pour
débuter, je suivrai une règle à laquelle je crois qu'il faut se
conformer dans toutes les discussions, si l'on veut éviter l'erreur.
Cette règle consiste, quand le nom de l'objet en question est
parfaitement arrêté, à expliquer nettement ce qu'il signifie. Ce
n'est qu'après être tombé d'accord sur cette définition que l'on
doit entrer en matière; car avant de découvrir quelles qualités une
chose doit avoir, il faut d'abord comprendre ce qu'elle est. Ainsi
donc, puisque nous voulons parler de la république, voyons d'abord
ce qu'il faut entendre par république. — Lélius fit un signe
d'approbation, et Scipion poursuivit: Mon intention n'est pas, en
nous entretenant d'une chose si manifeste et si connue, de remonter
aux premiers principes, comme font d'ordinaire les philosophes,
d'aller prendre mon point de départ à la première union de l'homme
et de la femme, aux premiers liens du sang et aux différents nœuds
de parenté qui se formèrent bientôt après; je ne veux pas non plus
définir chacun des termes, ni en marquer minutieusement toutes les
diverses acceptions: je sais que je parle à des hommes éclairés, et
qui se sont montrés, dans la première république du monde, à la fois
de grands citoyens et de grands guerriers, et je ne veux pas
m'exposer à leur donner des explications plus obscures que la chose
même que je prétends éclaircir. Je ne m'engage pas à vous faire,
comme un maître de gymnase, une leçon où rien ne soit omis; je ne
vous promets pas de tout dire sans négliger le moindre détail. —
Lél. Voilà bien la
méthode que j'attendais de vous, Scipion.
XXV. Scip. La chose
publique, comme nous 292
l'appelons, est la chose du peuple; un peuple n'est pas toute
réunion d'hommes assemblés au hasard, mais seulement une société
formée sous la sauvegarde des lois et dans un but d'utilité commune.
Ce qui pousse surtout les hommes à se réunir, c'est moins leur
faiblesse que le besoin impérieux de se trouver dans la société de
leurs semblables. L'homme n'est pas fait pour vivre isolé, errant
dans la solitude; mais sa nature le porte, lors même qu'il serait
dans l'affluence de tous les biens...
(Il manque deux pages au manuscrit.)
[Qu'est-ce que la chose publique, si ce n'est la chose du peuple?
c'est donc la chose commune, la chose de la cité. Mais qu'est-ce que
la cité, si ce n'est une multitude d'hommes fondus dans un même
corps et vivant d'une vie commune? Aussi lit-on chez les politiques
romains: «Une multitude «d'hommes errants et dispersés s'unit par la
concorde et devint une cité.»] Saint Augustin, Ep. 138, 10.
[On a expliqué diversement l'origine des sociétés. Les uns
rapportent que les hommes, les premiers nés de la terre, menaient
une vie errante au milieu des forêts et des champs, n'avaient point
de langage pour s'entendre mutuellement, ni de lois pour se
respecter; des branches d'arbre et l'herbe des campagnes leur
servaient de couche; les cavernes et les antres, d'habitations; mais
en cet état ils étaient la proie des animaux féroces, plus forts
qu'eux. Ceux qui avaient pu échapper à leurs dents meurtrières, ou
bien ceux qui avaient vu périr quelqu'un de leurs semblables non
loin d'eux, avertis de leur propre péril, se réfugièrent près
d'autres hommes, implorèrent leur secours, et leur firent comprendre
par geste, ce qu'ils attendaient de leur aide; peu après les
premiers éléments du langage furent inventés, on donna des noms à
chaque chose; insensiblement les langues se perfectionnèrent.
Bientôt les hommes s'aperçurent que, réunis en troupes, ils
n'étaient pas encore assez protégés contre les bêtes sauvages; ils
s'enfermèrent alors dans des remparts qui leur ménagèrent un asile
sûr pour les nuits, et leur permirent de repousser sans combats les
attaques des animaux féroces. D'autres philosophes ont traité, et
avec beaucoup de raison, ce système de visions chimériques, et ont
enseigné que ce n'était pas aux attaques de bêtes féroces, mais
plutôt à la nature humaine, qu'il fallait faire honneur de la
formation des sociétés; que les hommes se sont rassemblés parce
qu'ils ont naturellement horreur de la solitude et besoin d'être
réunis à leurs semblables.] Lactance, Instit. I. iv, 10.
XXVI. ...... Toutes les choses excellentes ont des semences
naturelles; ni les vertus, ni la société, ne reposent sur de simples
conventions. Les diverses sociétés, formées en vertu de la loi
naturelle que j'ai exposée, fixèrent d'abord leur séjour en un lieu
déterminé et y établirent leurs demeures; ce lieu fortifié à la fois
par la nature et par la main des hommes, et renfermant toutes ces
demeures, entre lesquelles s'étendaient les places publiques et
s'élevaient les temples, fut appelé forteresse ou ville. Or, tout
peuple, c'est-à-dire toute société établie sur les principes que
j'ai posés; toute cité, c'est-à-dire toute constitution d'un peuple,
toute chose publique, qui est la chose du peuple, comme je l'ai dit
déjà, a besoin, pour ne pas périr, d'être gouvernée par intelligence
et conseil; et ce conseil doit se rapporter sans cesse
292 et avant tout au principe
même qui a produit la société. Il peut être exercé ou par un seul,
ou par quelques hommes choisis, ou par la multitude entière. Lorsque
le souverain pouvoir est dans les mains d'un seul, ce maître unique
prend le nom de roi, et cette forme de gouvernement s'appelle
royauté. Lorsqu'il est dans les mains de quelques hommes choisis,
c'est le gouvernement aristocratique. Quand le peuple dispose de
tout dans l'État, c'est le gouvernement populaire. Chacun de ces
trois gouvernements peut, à la condition de maintenir dans toute sa
force le lien qui a formé les sociétés humaines, devenir, je ne
dirai pas parfait ni excellent, mais tolérable; et suivant les temps
l'une ou l'autre de ces constitutions méritera la préférence. Un roi
équitable et sage, une aristocratie digne de son nom, le peuple
lui-même (quoique l'état populaire soit le moins bon de tous), s'il
n'est aveuglé ni par l'iniquité ni par les passions, tous, en un
mot, peuvent donnera la société une assiette assez régulière.
XXVII. Mais dans les monarchies la nation entière, à l'exception
d'un seul, a trop peu de droits et de part aux affaires; sous le
gouvernement des nobles, le peuple connaît à peine la liberté,
puisqu'il ne participe pas aux conseils et n'exerce aucun pouvoir;
et dans l'état populaire, quand même on y rencontrerait toute la
justice et la modération possibles, l'égalité absolue n'en est pas
moins de sa nature une iniquité permanente, puisqu'elle n'admet
aucune distinction pour le mérite. Ainsi, que Cyrus, roi de Perse,
ait montré une justice et une sagesse admirables, je ne puis
cependant me persuader que son peuple se soit trouvé dans l'état le
plus parfait sous la conduite et l'empire absolu d'un seul homme. Si
l'on peut me montrer les Marseillais, nos clients, gouvernés avec la
plus grande équité par quelques citoyens choisis et tout-puissants,
je n'en trouve pas moins dans l'état du peuple, soumis à de tels
maîtres une image assez, frappante de la servitude. Enfin lorsque
les Athéniens, à une certaine époque, supprimèrent l'Aréopage, et ne
voulurent plus reconnaître d'autre autorité que celle du peuple et
de ses décrets, au milieu de cette égalité injurieuse au mérite,
Athènes n'avait-elle pas perdu son plus bel ornement?
XXVIII. Et quand je parle ainsi de ces trois formes de gouvernement,
ce ne sont pas les États bouleversés et déchirés que je juge, mais
les sociétés florissantes. Dans la monarchie comme dans les deux
autres, nous trouvons d'abord les inconvénients nécessaires dont
j'ai parlé; mais bientôt on y peut découvrir d'autres germes plus
graves d'imperfection et de ruine, car chacune de ces constitutions
est toujours près de dégénérer en un fléau insupportable. A l'image
de Cyrus, que je devrais appeler, pour bien dire, un roi
supportable, mais que je nommerai, si vous le voulez, un monarque
digne d'amour, succède en mon esprit le souvenir de Phalaris, ce
monstre de cruauté; et je comprends que la domination absolue d'un
seul est entraînée par une pente bien glissante vers cette odieuse
tyrannie. A côté de cette aristocratie de Marseille, Athènes nous
montre la faction des Trente. Enfin, dans cette même Athènes, pour
ne pas citer d'autres peuples, la démocratie sans frein nous donne
le triste spectacle d'une multitude qui s'emporte aux derniers excès
de la fureur, et dont l'aveuglement...
294
(Il manque deux pages au manuscrit.)
XXIX. ...... De l'anarchie sort le pouvoir des grands, ou une
olygarchie factieuse, ou la royauté, ou très-souvent même un état
populaire; celui-ci, à son tour, donne naissance à quelques-uns de
ceux que j'ai déjà nommés; et c'est ainsi que les sociétés semblent
tourner dans un cercle fatal de changements et de vicissitudes. Le
sage médite sur ces révolutions; mais l'homme qui a le don de
prévoir les orages dont est menacé son pays, la force de lutter
contre le torrent qui entraîne chefs et peuples, la puissance de
l'arrêter ou d'en modérer le cours, celui-là est un grand citoyen,
et j'oserais presque dire un demi-dieu. C'est ce qui me porte à
regarder comme la meilleure forme de gouvernement cette forme mixte
qui est composée des trois premières, se tempérant l'une l'autre.
XXX. Lél. Je sais que
c'est là votre sentiment arrêté, Scipion, car je vous l'ai entendu
exprimer plus d'une fois; mais cependant, si ce n'est pas trop
exiger, je voudrais apprendre de vous auquel de ces trois modes de
gouvernement vous donnez la préférence. Je crois qu'il ne serait pas
sans utilité......
(Il manque deux pages au manuscrit.)
XXXI. Scip. ......
telle est la nature et la volonté du souverain, telle est
invariablement la société qu'il régit. Aussi n'y A.t-il que les
États où le peuple a le pouvoir suprême qui puissent admettre la
liberté; la liberté, le plus doux de tous les biens, et qui n'existe
pas sans une égalité parfaite. Et comment serait-il possible de
trouver cette égalité, je ne dis pas dans une monarchie où la
servitude est manifeste et avouée, mais dans ces États où les
citoyens ont toutes les apparences de la liberté? Ils donnent leurs
suffrages, ils font des généraux, des magistrats; on les sollicite,
on brigue leurs faveurs; mais ces faveurs, il faut bien qu'ils les
accordent, bon gré mal gré; ce qu'ils prodiguent ainsi ne leur
appartient jamais; car ils sont exclus du commandement des armées,
des conseils de l'État, du jugement de toutes les causes
importantes, et les hautes fonctions sont le privilège exclusif de
la noblesse ou de la fortune. Chez un peuple libre, au contraire,
comme à Rhodes, à Athènes, il n'est pas un seul citoyen qui......
(Il manque deux pages au manuscrit.)
XXXII. ...... Qu'au milieu d'une nation il s'élève un ou plusieurs
hommes riches et opulents, bientôt, disent les partisans de la
démocratie, leur orgueil et leur dédain font naître des privilèges
que reconnaît la foule des lâches et des faibles, pliant sous
l'arrogance des riches. Les mêmes politiques ajoutent qu'on ne peut
rien imaginer de plus libre, de plus heureux, de plus excellent
qu'un État où le peuple a conservé tous ses droits, parce qu'alors
il est l'arbitre souverain des lois, des jugements, de la paix, de
la guerre, des alliances, de la vie et de la fortune de chacun;
voilà, disent-ils, le seul gouvernement qui mérite le nom de
république, c'est-à-dire de chose du peuple. Aussi voit-on
d'ordinaire le peuple chercher à s'affranchir du pouvoir des rois ou
des patriciens, tandis qu'il est sans exemple qu'un peuple libre ait
recouru à la royauté ou à la domination protectrice des grands. Ils
prétendent que l'on serait fort injuste de condamner sans retour la
cause popu- 295 laire a en
haine des dérèglements d'un peuple; qu'il n'y a rien de plus fort et
de plus inébranlable qu'une république où règne la concorde, et où
l'on ne connaît d'autre ambition que de maintenir la liberté de
l'État, et de veiller à son salut; qu'enfin la concorde est
très-facile dans une société dont tous les membres ont le même
intérêt, tandis que c'est la diversité d'intérêts qui partout donne
naissance à la discorde. Aussi, à les entendre, jamais gouvernement
aristocratique n'a offert de stabilité; encore bien moins en
trouverait-on dans l'état monarchique, qui ne connaît ni foi ni loi,
comme le dit Ennius. Puisque la loi est le lien de la société
civile, et que le droit donné par la loi est le même pour tous, il
n'y a plus de droits ni de règles dans une société dont les membres
ne sont pas égaux. Si l'on ne veut point admettre l'égalité des
fortunes, s'il faut avouer que celle des esprits est impossible, au
moins doit-on établir l'égalité des droits entre tons les citoyens
d'une même république. Qu'est-ce en effet qu'une société, si ce
n'est la participation à de certains droits communs?......
(Il manque deux pages au manuscrit.)
XXXIII. Ces politiques vont jusqu'à refuser aux autres formes de
gouvernement le nom dont elles veulent être appelées. Pourquoi
donner le titre de roi, ce beau nom du monarque des cieux, à un
homme avide de dominer et de commander seul à un peuple qu'il
opprime? Le nom de tyran ne lui convient-il pas mieux? La tyrannie
peut être douce, et la royauté insupportable; ce qui importe à des
sujets, c'est de porter un joug commode, et non pas cruel: mais
qu'ils ne soient pas sous le joug, c'est là ce qui ne se peut faire.
Comment Lacédémone, à l'époque même où sa constitution politique
passait pour un chef-d'œuvre, pouvait-elle avoir la certitude d'être
gouvernée toujours par des rois bons et justes, quand il fallait
qu'elle reçût invariablement pour maître le rejeton d'une souche
royale? Quant à l'aristocratie, comment souffrir ces princes de
l'État, qui ne tiennent pas du suffrage public, mais qui se
décernent à eux-mêmes ce titre magnifique? Ou ont-ils fait leurs
preuves ces hommes qui s'arrogent la suprématie de la science, du
talent, de la vertu?......
(Il manque quatre pages au manuscrit.)
XXXIV. Si une société choisit au hasard ceux qui la doivent
conduire, elle périra aussi promptement qu'un vaisseau dirigé par un
des passagers que le sort aurait appelé au gouvernail. Un peuple
libre choisira ceux à qui il veut se confier, et s'il pense à ses
vrais intérêts, il fera choix des meilleurs citoyens; car c'est de
leurs conseils, on n'en peut douter, que dépend le salut des États;
et la nature, tout en destinant les hommes qui ont le plus de
caractère et de noblesse à conduire les faibles, a inspiré en même
temps à la foule le besoin de voir à sa tête les hommes supérieurs.
Mais on prétend que cette forme excellente de gouvernement est
décréditée par les faux jugements du vulgaire, qui ne sachant
discerner le vrai mérite, aussi rare peut-être à découvrir qu'à
posséder, prend pour les premiers des hommes ceux qui ont de la
fortune, de la puissance, ou qui portent un nom illustre. Une fois
que cette erreur du peuple a donné à la puissance le rang que devait
seule avoir la vertu, ces chefs de faux aloi gardent obstinément le
nom d'aristocrates, qui ne leur convient en aucune façon. Car
les richesses, l'éclat du nom, la puissance, sans la
296 sagesse qui apprend à se
gouverner soi-même et à conduire les autres, ne sont plus qu'une
honteuse et insolente vanité; et il n'est pas au monde de plus
triste spectacle que celui d'une société où l'on estime les hommes
en proportion de leur fortune. Mais aussi que peut-on comparer à une
république gouvernée par la vertu, alors que celui qui commande aux
autres n'obéit lui-même à aucune passion; alors qu'il ne donne à ses
concitoyens aucun précepte dont l'exemple ne reluise en sa personne;
qu'il n'impose au peuple aucune loi dont il ne soit l'observateur le
plus fidèle; et que sa conduite entière peut être proposée comme une
loi vivante à la société qu'il dirige? Si un seul homme pouvait
satisfaire à tout à la fois, le concours de plusieurs deviendrait
inutile; si tout un peuple pouvait voir le bien et le poursuivre
d'un commun accord, on n'aurait pas besoin de faire choix de
quelques chefs. La difficulté de former un sage conseil a fait
passer le pouvoir du roi aux grands; les errements et la témérité
des peuples l'ont transporté des mains de la foule dans celles du
petit nombre. Ainsi, entre l'impuissance d'un seul et l'aveuglement
de la multitude, l'aristocratie tient le milieu, et présente par sa
position même les garanties de la plus parfaite modération. Sous son
gouvernement tutélaire les peuples doivent être le plus heureux
possible, vivre sans inquiétude ni tourments, puisqu'ils ont confié
leur repos à des protecteurs dont le premier devoir est la
vigilance, et dont la préoccupation constante est de ne point donner
au peuple l'idée que les grands négligent ses intérêts. Quant à
l'égalité absolue des droits, que poursuivent les peuples libres,
elle n'est jamais qu'une utopie; les nations les plus jalouses de
leur liberté et les plus impatientes de tout frein accordent
cependant une foule de distinctions, et savent parfaitement classer
les hommes et faire acception du mérite. D'ailleurs cette égalité
absolue serait le comble de l'iniquité. Essayez de mettre sur la
même ligne les grands hommes et cette lie du peuple qui se trouve
nécessairement partout, et vous reconnaîtrez que c'est par esprit
d'équité commettre l'iniquité la plus révoltante. Dans les
gouvernements aristocratiques, une pareille absurdité ne sera jamais
à craindre. Voila, Lélius, à peu près du moins, ce que disent les
partisans et les admirateurs de l'aristocratie.
XXXV. Lél. Mais vous,
Scipion, lequel de ces trois gouvernements préférez-vous? —
Scip. Vous avez raison
de me demander lequel je préfère, car je n'approuve aucun des trois
séparément, et je mets fort au-dessus de chacun d'eux celui qui les
réunit tous. Mais s'il fallait en choisir un exclusivement, je me
prononcerais pour le gouvernement royal. Il semble que le titre de
roi a quelque chose de paternel; il nous montre un chef de famille
qui veille sur ses sujets comme sur ses propres enfants, qui protège
son peuple avec amour, bien loin de le réduire en esclavage; c'est
un homme excellent et tout-puissant qui soutient et guide les petits
et les faibles: est-il rien de plus raisonnable? Mais voici les
grands qui réclament pour eux l'honneur de mieux accomplir cet
ouvrage, et qui nous disent qu'il y a plus de lumières dans une
assemblée que dans un seul homme, et tout autant d'équité et de
bonne foi. Enfin voici le peuple qui nous crie, de toutes ses
forces, qu'il ne veut obéir ni à un seul ni à plusieurs; que pour
les animaux eux-mêmes rien n'est plus doux que la liberté, et
qu'elle périt sous l'empire d'un roi comme sous la domination
297 des grands. Ainsi un roi nous
offre la tendresse d'un père, les grands leur sage conseil, le
peuple la liberté; entre les trois le choix est difficile. —
Lél. Je le crois comme vous; mais cependant, si cette
difficulté n'est résolue, je ne vois pas comment nous pourrons
aborder toutes celles qui suivent.
XXXVI. Scip. J'imiterai
donc Aratus, qui, au début de son grand ouvrage, commence par
invoquer Jupiter. — LÉl.
Pourquoi Jupiter? et quelle ressemblance y A.t-il entre le
poëme d'Aratus et notre entretien politique? —
Scip. II n'y en a
qu'une: c'est que nous devons, nous aussi, au début de nos
recherches, élever notre pensée à celui que le monde entier, d'un
commun accord, savants et ignorants, regarde comme le roi des Dieux
et des hommes. — Pourquoi donc? dit Lélius. — Pourquoi?repartit
Scipion; vous pouvez en juger vous-même. En effet, ou les chefs des
nations ont répandu parmi le peuple, pour l'intérêt des sociétés,
cette croyance qu'il y a dans le ciel un maître souverain, qui d'un
froncement de sourcil, comme dit Homère, ébranle l'Olympe, et que
l'on adore comme le roi et le père de tous les êtres; et s'il en est
ainsi, nous voyons que la plupart des nations, pour ne pas dire
toutes, entrant dans l'esprit de leurs chefs, ont reconnu par un
éclatant témoignage l'excellence de la royauté, puisqu'elles
s'accordent à penser que tous les Dieux sont gouvernés par un seul
monarque tout-puissant: ou si l'on prétend que ce sont là des fables
accréditées par la superstition des peuples, consultons ces maîtres
révérés de tous les gens instruits, ces hommes supérieurs qui ont vu
de leurs yeux en quelque façon ce qu'à peine nos oreilles peuvent
entendre. — De quels hommes voulez-vous parler? demanda Lélius. —
Scip. De ceux qui, en
approfondissant tous les secrets de la nature, comprirent que le
monde entier est gouverné par une intelligence......
(Il manque quatre pages au manuscrit.)
[Angelo Mai croit que l'on peut combler cette lacune par le passage
suivant de Lactance, qui semble reproduire en substance les pages de
Cicéron perdues pour nous:]
«Platon établit la royauté en principe, quand il déclare qu'il n'y a
qu'un Dieu par qui le monde a été formé et ordonné suivant les
règles admirables de la raison éternelle. Aristote, son disciple,
affirme que le monde est gouverné par une intelligence souveraine et
unique. Antisthène dit que la nature ne connaît qu'un seul Dieu,
régulateur suprême de tout ce qui est. Il serait superflu de
recueillir ici ce qu'enseignaient sur la Divinité Thalès, Pythagore
et Anaximène, et longtemps après eux les Stoïciens, Cléanthe,
Chrysippe, Zénon, et Tullius lui-même; car tous faisaient profession
de reconnaître que le monde est sous l'empire d'un seul Dieu. Hermès
à qui sa vertu et sa vaste science valurent le surnom de
Trismégiste, Hermès dont la doctrine remonte bien plus haut que les
plus anciens systèmes des philosophes, et que les Égyptiens révèrent
comme un dieu, adresse au Dieu unique et à sa majesté sainte des
louanges infinies, lui donne le nom de maître et de père......»
Lactance, Épit. 4.
XXXVII. ...... Mais si vous voulez, Lélius, je vous produirai des
témoins qui ne sont ni trop anciens ni barbares. —
Lél. Des témoins de
cette sorte me conviendraient fort. —
Scip. Et d'abord, vous
savez qu'il n'y a pas encore quatre
298
cents ans que Rome n'est plus gouvernée par des rois. —
Lél. Je le sais, sans doute. —
Scip. Mais, selon vous, quatre cents ans d'âge est-ce
beaucoup pour une ville ou pour un État? —
Lél. C'est à peine
l'âge adulte. — Scip.
Ainsi donc, il y a quatre cents ans, Rome avait un roi? —
Lél. Et même un roi
superbe. — Scip. Mais
avant celui-là? — Lél.
Un roi très-juste, et ainsi des autres en remontant jusqu'à Romulus,
qui régnait il y a six siècles. —
Scip. Romulus lui-même
est-il bien ancien? — Lél.
Nullement; car à son époque la Grèce était déjà bien près de
vieillir. — Scip. Romulus, dites-moi, régnait-il sur des barbares? —
Lél. S'il faut écouter
les Grecs, pour qui tous les hommes sont ou des Grecs ou des
barbares, je crains bien que Romu1ns n'ait été un roi de barbares;
mais s'il faut juger un peuple par ses mœurs et non par sa langue,
je ne crois pas les Romains plus barbares que les Grecs.
D'ailleurs, reprit Scipion, pour le point qui nous occupe, c'est
moins le témoignage d'une nation entière que celui des hommes
éclairés que nous voulons consulter. Si donc il est constant qu'à
une époque peu reculée, des hommes sages ont voulu être gouvernés
par des rois, voilà bien, comme je vous le promettais, des témoins
qui ne sont ni trop anciens ni barbares.
XXXVIII. Lél. Je vois
bien, Scipion, que vous ne manquez pas de témoins; mais auprès de
moi comme auprès de tous les juges, les preuves bien raisonnées
valent mieux que les témoins. —
Scip. Vous voulez des
preuves, Lélius: eh bien! votre propre expérience va vous en
fournir. — Lél. Quelle
expérience? — Scip.
Dites-moi, vous êtes-vous jamais senti en colère? —
Lel. Plus souvent que
je n'eusse voulu. — Scip.
Et lorsque vous êtes en colère, permettez-vous à cette
passion de dominer votre âme?
Lél. Non, par Hercule; mais j'imite alors cet Archytas de
Tarente, qui arrivant à sa campagne et trouvant qu'en tout on y
avait pris justement le contrepied de ses ordres: Malheureux, dit-il
à son fermier, je t'aurais déjà roué de coups, si je n'étais en
colère. — Parfaitement, dit Scipion. Archytas regardait donc la
colère, celle du moins que la raison désarme, comme une certaine
sédition de l'âme; et il voulait l'apaiser par la réflexion.
Mettez-vous maintenant devant les yeux l'avarice, l'ambition, la
vanité, toutes les passions, et vous comprendrez que si l'âme est
gouvernée royalement, tout en elle sera soumis à l'empire de la
raison (puisque la raison est la partie la plus excellente de
l'âme), et que, sous cet empire, il n'y a plus de place pour les
passions, plus de place pour la colère et l'aveuglement. —
Lél. Rien n'est plus
vrai. — Scip.
Approuvez-vous une âme ainsi réglée? —
Lél. On ne peut
davantage. — Scip. Vous
ne pourriez donc souffrir que, méconnaissant la raison, l'âme
s'abandonnât à ses passions qui sont sans nombre, ou se laissât
emporter à la colère? — Scip.
A mon avis, rien de plus misérable qu'une telle âme et qu'un
homme en proie à ses passions. —
Scip. Vous voulez donc
qu'une royauté s'établisse dans l'âme humaine, et que la raison y
règle tout souverainement? —
Lél. Sans nul doute. —
Scip. Comment donc pouvez-vous hésiter sur le gouvernement
qui convient aux États? Ne voyez-vous pas que, dans une nation, si
le pouvoir est partagé, il n'y a plus d'autorité souveraine? car la
souveraineté, si on la divise, est anéantie.
299
XXXIX. Lél. Mais, je
vous prie, qu'importe le gouvernement d'un seul ou de plusieurs, si
ce dernier est juste? — Scip.
Je vois que mes autorités n'ont pas produit grande impression
sur vous: aussi suis-je bien résolu â ne plus invoquer, à l'appui de
mon sentiment, que votre propre témoignage. —
Lél. Quel témoignage
tirerez-vous de moi? — Scip.
J'ai remarqué dernièrement, lorsque nous étions ensemble à
Formies, que vous enjoigniez formellement à vos esclaves de ne
prendre les ordres que d'un seul chef. —
Lél. Oui sans doute, de
mon fermier. — Scip. Et
à Rome, vos affaires sont-elles dans les mains de plusieurs
intendants? — Lél. Non,
certes; je n'en ai qu'un seul. —
Scip. Enfin le
gouvernement général de toute votre maison, le partagez-vous avec
quelqu'un? — Lél. Pas
le moins du monde, j'espère. —
Scip. Que n'accordez-vous donc également que pour les
sociétés l'empire d'un seul, lorsqu'il est équitable, est de tous le
meilleur? — Lél. Je me
sens entraîné, et je me rends presque à votre avis.
XL. Scip. Vous vous y
rendrez bien mieux encore, Lélius, si laissant de côté la
comparaison du vaisseau, du malade, qu'il vaut mieux confier à un
seul pilote ou à un seul médecin-expérimenté, que de le remettre à
la direction de plusieurs, j'arrive à des considérations d'un ordre
plus relevé. — Lél.
Quelles considérations? —
Scip. Vous savez que c'est la cruauté et la domination
superbe du seul Tarquin, qui a fait détester au peuple romain
jusqu'au nom de roi? — Lél. Je le sais. —
Scip. Vous n'ignorez pas non plus qu'après avoir chassé
Tarquin, le peuple, enivré de sa liberté nouvelle, s'emporta à des
excès dont bientôt j'aurai à vous entretenir longuement. On vit
alors des innocents exilés, un grand nombre de citoyens dépouillés,
des magistrats annuels, les faisceaux inclinés devant le peuple, la
multitude jugeant en dernier ressort, la fameuse retraite au mont
Aventin; enfin une longue suite de mouvements et d'actes qui
devaient aboutir à la souveraineté absolue du peuple. —
Lél. C'est la vérité. —
Scip. Mais tout cela se
passait en temps de paix et de sécurité. Lorsqu'on n'a rien à
craindre, un peu de licence est bien permise, témoin les malades
attaqués légèrement, et les passagers d'un vaisseau qui ne court
point de danger; mais quand la mer devient houleuse, quand la fièvre
redouble, passagers et malades s'abandonnent à une main exercée.
Ainsi le peuple de Rome, en paix et dans ses foyers, commande,
menace ses magistrats, désobéit à leurs ordres, appelle de leur
décision, les traduit devant son tribunal; en temps de guerre, on
pourrait croire qu'il obéit à un roi; car l'intérêt du salut parle
plus haut que la passion de l'indépendance. Bien mieux, dans les
guerres importantes, nos ancêtres ont voulu que toute l'autorité fût
réunie dans les mains d'un seul homme, dont le titre même indique
l'extrême puissance. On le nomme dictateur, parce qu'un
consul le proclame (quia dicitur); mais dans nos livres vous
voyez, Lélius, qu'il est appelé le maître du peuple. —
Lél. C'est très-vrai. —
Scip. Reconnaissons la
sagesse de ces anciens......
(II manque deux pages au manuscrit.)
XLI. ...... Lorsqu'un peuple a perdu un bon roi, alors, comme le dit
Ennius en parlant de la mort d'un prince excellent, «les cœurs de
fer sont émus jusqu'aux larmes; de tous côtés on entend ces cris de
deuil: O Romulus, divin Romulus, père de la patrie, que le ciel nous
avait donné! ô notre ami, notre dieu tutélaire, digne
300 fils des immortels!» Ils
n'appellent ni maître ni seigneur celui qui leur a commandé avec
tant de justice; ils ne lui donnent pas même le nom de roi; c'est la
providence de la patrie, c'est un père, c'est un dieu. Et ces titres
sont fondés; écoutez ce que le peuple ajoute: «C'est à toi
que nous devons la vie.» Ils pensaient donc, ces anciens Romains,
que la vie, l'honneur et la gloire sont donnés au peuple par la
justice du roi. Leur postérité aurait conservé les mêmes sentiments,
si ce caractère sacré s'était toujours maintenu dans la personne des
rois; mais vous voyez que l'injuste domination d'un seul entraîna
pour toujours la chute de la royauté. —
Lél. Je le vois, et il
me tarde de connaître le cours de ces vicissitudes politiques,
non-seulement dans notre pays, mais dans toutes les sociétés
possibles.
XLII. Scip. Lorsque je vous aurai exposé mon sentiment sur la forme
de gouvernement qui, de toutes, me paraît la meilleure, j'aurai à
vous entretenir avec soin de ces grandes révolutions politiques;
quoique je pense qu'elles doivent difficilement se produire dans un
État gouverné comme je l'entends. Quant au pouvoir royal, en voici
la première et la plus infaillible altération: dès qu'un roi devient
injuste, la royauté disparaît, et fait place à la tyrannie, le pire
des gouvernements et qui tient de si près au meilleur. Lorsque la
tyrannie est abattue par les grands, ce qui est assez l'usage,
l'État prend alors la seconde des trois formes générales; c'est un
conseil aristocratique qui veille aux intérêts du peuple avec une
sollicitude paternelle, et qui a par cet endroit quelque chose de
royal. Si c'est le peuple lui-même qui a tué ou chassé un tyran, il
garde assez de modération, tant que le bon sens l'inspire; et comme
il s'applaudit de ce qu'il a fait, il veut donner à l'État restauré
par lui une certaine consistance. Mais si le peuple a porté une main
violente sur un bon roi, ou, ce que l'on voit plus souvent, s'il a
versé le sang des nobles, et soumis tout l'État à ses fureurs, il
n'est point de tempête, point d'incendie, qui ne soient plus faciles
à calmer que les emportements d'une multitude effrénée.
XLIII. Il arrive alors ce que Platon décrit avec des couleurs si
vives, et que je voudrais exprimer d'après lui; je ne sais si notre
langue s'y prêtera; du moins c'est un effort à tenter. «Lorsque,
dit-il, le peuple est dévoré d'une soif intarissable d'indépendance,
et que, servi par de perfides échansons, il a vidé jusqu'à la lie la
coupe enivrante d'une liberté sans mélange; alors ses magistrats et
ses chefs, s'ils ne sont relâchés et débonnaires, deviennent l'objet
d'attaques, de poursuites, d'accusations terribles; il les appelle
dominateurs, rois, tyrans.» Je pense que vous connaissez ce passage.
— Lél. Je le savais par
cœur. — Scip. Voyons la
suite: «Ceux qui obéissent aux magistrats sont insultés par le
peuple, qui les nomme des esclaves volontaires; les magistrats, au
contraire, qui affectent de descendre au niveau des simples
citoyens, et les citoyens qui s'étudient à effacer toute différence
entre eux et les magistrats, sont couverts de louanges et surchargés
d'honneurs. Il faut nécessairement que dans une telle société la
liberté afflue partout; qu'au sein des familles toute au-
301 torité disparaisse, et que
les animaux eux-mêmes soient atteints de cette contagion. Le père
craint son fils, le fils ne connaît plus son père; toute pudeur est
proscrite, pour que la liberté soit entière; il n'y a plus de
différence entre le citoyen et l'étranger; le maître redoute ses
élèves et les flatte, les élèves prennent leur maître en dédain; les
jeunes gens s'arrogent l'autorité des vieillards; les vieillards
prennent part aux amusements de la jeunesse, pour ne pas lui être
odieux et à charge. Bientôt l'esclave se donne tous les airs d'un
homme libre, la femme se croit l'égale de son mari; et au milieu de
cette indépendance universelle, il n'est pas jusqu'aux chiens, aux
chevaux et aux ânes qui ne se trémoussent de liberté, et qui ne
courent en bêtes libres sur la voie publique, forçant les hommes à
leur laisser e passage. De cette licence illimitée il résulte enfin
que les esprits deviennent si ombrageux et si délicats, qu'au
moindre signe d'autorité ils s'irritent et regimbent, et que de
proche en proche ils vont jusqu'au mépris des lois, afin d'être plus
complètement libres de sujétion.»
XLIV. Lél. Vous avez, ce me semble, rendu avec une fidélité
parfaite ce qu'a dit Platon. —
Scip. Pour reprendre maintenant la suite de nos idées, nous
voyons (c'est Platon qui nous l'enseigne) que de cette extrême
licence, réputée pour l'unique liberté, sort la tyrannie comme de sa
souche naturelle. Le pouvoir excessif des grands amène la chute de
l'aristocratie; tout pareillement l'excès de la liberté conduit un
peuple à la servitude. Ne voyons-nous pas constamment pour l'état du
ciel, pour les biens de la terre, pour la santé, qu'un extrême se
tourne subitement en l'extrême contraire? c'est là surtout la
destinée des États; l'extrême liberté pour les particuliers et pour
les peuples se change bientôt en une extrême servitude. De la
licence naît la tyrannie, et avec elle le plus injuste et le plus
dur esclavage. Ce peuple indompté, cette hydre aux cent têtes se
choisit bientôt contre les grands, dont le pouvoir est déjà abattu
et les dignités abolies, un chef audacieux, impur, persécuteur
impudent des hommes qui souvent ont le mieux mérité de leur patrie,
prodiguant à la populace la fortune d'autrui et la sienne. Comme
dans la vie privée il pourrait craindre pour sa tête, on lui donne
des commandements, on les lui continue; bientôt sa personne est
protégée par une garde, témoin Pisistrate à Athènes; enfin il
devient le tyran de ceux mêmes qui l'ont élevé. S'il tombe sous les
coups des bons citoyens, comme on l'a vu souvent, alors l'État est
régénéré; s'il périt victime de quelques audacieux, la société est
en proie à une faction, autre espèce de tyrannie qui succède encore
parfois à ce beau gouvernement des nobles, lorsque l'aristocratie se
corrompt et s'oublie. Ainsi le pouvoir est comme une balle que se
renvoient tour à tour les rois aux tyrans, les tyrans aux grands ou
au peuple, ceux-ci aux factions ou à de nouveaux tyrans; et jamais
une forme politique n'est de bien longue durée dans un État.
XLV. Pour toutes ces raisons, je tiens donc que la royauté est de
beaucoup préférable nu gouvernement des grands ou du peuple; mais la
royauté elle-même le cède dans mon esprit à une constitution
politique qui réunirait ce que les trois premières ont de meilleur,
et allierait dans une 302
juste mesure les trois pouvoirs. J'aime que dans un État il y ait
quelque chose de majestueux et de royal; qu'une part soit faite à
l'influence des nobles, et que certaines choses soient réservées au
jugement et à l'autorité du peuple. Cette forme de gouvernement a
d'abord l'avantage de maintenir une grande égalité, bienfait dont un
peuple libre ne peut être privé longtemps; elle a ensuite beaucoup
de stabilité, tandis que les autres sont toujours près de s'altérer,
la royauté inclinant vers la tyrannie, le pouvoir des grands vers
l'oligarchie factieuse, et celui du peuple vers l'anarchie. Taudis
que les autres constitutions se renversent et se succèdent sans fin,
celle-ci, fondée sur un sage équilibre et qui n'exclut aucun pouvoir
légitime, ne peut guère être sujette à toutes ces vicissitudes sans
que les chefs de l'État n'aient commis de grandes fautes. On ne peut
trouver de germe de révolution dans une société où chacun tient son
rang naturel, y est solidement établi, et ne voit point au-dessous
de place libre où il puisse tomber.
XLVI. Mais je crains, Lélius, et vous, mes sages amis, que si je
m'arrête trop longtemps à ces questions générales, mon discours ne
ressemble plutôt à la leçon d'un maître qu'au libre entretien d'un
ami qui cherche la vérité avec vous. C'est pourquoi je vais vous
parler de choses qui sont connues de tous, et qui ont été depuis
longtemps l'objet de nos réflexions. Je le reconnais donc, je le
sens, je le déclare, il n'est aucune forme de gouvernement qui, par
sa constitution, son organisation, ses règles, puisse être comparée
a celle que nos pères nous ont transmise et que nos ancêtres ont
établie. Et puisque vous voulez entendre de ma bouche ce que vous
savez si bien vous-mêmes, j'exposerai d'abord le système de la
constitution romaine, je montrerai que de tous il est le plus
excellent; et, proposant ainsi notre république pour modèle,
j'essaierai de rapporter à cet exemple tout ce que j'ai à dire sur
la meilleure forme de gouvernement. Si j'en viens à bout, si je puis
toucher le but, je crois que j'aurai surabondamment rempli la tâche
que Lélius m'a imposée.
XLVII. Lél. Imposée,
dites-vous! Mais s'il en est une qui vous convienne, c'est bien
celle-là. Qui pouvait parler des institutions de nos ancêtres mieux
que Scipion, issu d'un sang si glorieux? Qui aurait mieux que vous
le droit de nous entretenir de la meilleure forme de gouvernement,
de cet état prospère qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, mais qui ne
le pourrait devenir sans vous rendre aux premiers honneurs? A qui
appartient-il enfin de nous parler d'avenir et de prévoyante
sagesse, si ce n'est au héros qui a renversé deux puissantes
rivales, la terreur de Rome, et garanti par là nos futures
destinées?
FRAGMENTS DU LIVRE PREMIER,
DONT LA PLACE EST INCERTAINE.
I. Mais comme la patrie nous comble de bienfaits, et qu'elle est
notre mère bien avant celle qui nous a donné le jour, nous lui
devons plus de reconnaissance qu'à nos propres parents. (Nonius, v,
17.)
II. Carthage n'aurait pas été si florissante pendant près de six
siècles, sans un gouvernement sage et une forte discipline. (Nonius,
xii, 30.)
303
III. Ils ont, dit-il, l'habitude de ces sortes d'entretiens; ils en
ont le goût. (Nonius, iv, 109.)
IV. Certes, toutes les théories de ces beaux penseurs, quoiqu'elles
contiennent les sources les plus fécondes de la vertu et du savoir,
mises en regard des œuvres et de la vie si pleine des hommes
d'action, paraîtront, je le crains, offrir moins d'utilité pour les
affaires publiques que d'agrément pour nos loisirs. (Lactance,
Instit. iii, 16.)
|